
HISTOIRE DE L'OPÉRA DE PARIS

Jacques Rouché, directeur et mécène de l'Opéra de Paris
=> les Treize salles de l'Opéra par Albert de Lasalle, 1875
=> les Quinze salles de l'Opéra par André Lejeune et Stéphane Wolff, 1955
=> l'Opéra de 1874 à 1925, par Louis Laloy
=> l'Opéra de la rue Le Peletier
=> l'Opéra par Louis Gallet (la Nouvelle Revue, 01 janvier 1880)
=> Histoire de l'Opéra de 1669 à 1960 (les Théâtres de France, 1960)
LES DIRECTEURS
| Académie d'opéra (28 juin 1669) |
1669-1672 |
Pierre PERRIN [1620 – 25 avril 1675], directeur (28 juin 1669 – 16 mars 1672) |
Salle d'Issy (Issy-les-Moulineaux) (1659) Salle du Jeu de paume de la Bouteille (rue Mazarine) (03 mars 1671 - 30 mars 1672) |
|
Académie royale de musique (13 mars 1672) |
1672-1687 |
Jean-Baptiste LULLY, directeur (29 mars 1672 – 22 mars 1687) |
Salle du Jeu de paume de Bel-Air (rue de Vaugirard) (15 novembre 1672 - 1673) |
|
Première Salle du Palais-Royal (Palais-Royal) (15 juin 1673 - incendie, 06 avril 1763) |
|||
|
1687 |
Jean-Louis de LULLY, directeur |
||
|
1687-1698 |
Jean-Nicolas FRANCINI dit de FRANCINE [1662 – 06 mars 1735], directeur (27 juin 1687 – 1698) |
||
|
1698-1704 |
Jean-Nicolas de FRANCINE et Hyacinthe DUMONT DE GAURÉAULT [1647 – 19 mars 1726], directeurs (30 décembre 1698 – 05 octobre 1704) |
||
|
1704-1712 |
Pierre GUYENET [– 21 août 1712], directeur (05 octobre 1704 – 21 août 1712) |
||
|
1712 |
Jean-Nicolas de FRANCINE et Hyacinthe GAURÉAUD DE DUMONT, directeurs |
||
|
1713-1723 |
Les créanciers de Pierre Guyenet ; Jean-Nicolas de FRANCINE, régie ; André-Cardinal DESTOUCHES, inspecteur |
||
|
1723-1728 |
Jean-Nicolas de FRANCINE et Hyacinthe GAURÉAUD DE DUMONT, directeurs (1723 – 08 février 1728) |
||
|
1728-1730 |
André-Cardinal DESTOUCHES [avril 1672 – 07 février 1749], directeur (08 février 1728 – 01 juin 1730) |
||
|
1730-1731 |
Maximilien-Claude GRUËR, concessionnaire ; André-Cardinal DESTOUCHES, directeur |
||
|
1731-1733 |
Claude LECOMTE, directeur |
||
|
1733-1744 |
Louis Armand Eugène de THURET [– 1762], directeur (01 avril 1733 – 18 mars 1744) |
||
|
1744-1747 |
Jean-François BERGER [– 09 novembre 1747], directeur (18 mars 1744 – 09 novembre 1747) |
||
|
1748-1749 |
Joseph GUÉNOT DE TRÉFONTAINE, administrateur (1748 – 26 août 1749) |
||
|
1749-1753 |
Régie de la Ville de Paris : Marquis d'ARGENSON, administrateur ; François REBEL et François FRANCŒUR, directeurs |
||
|
1753-1755 |
Régie de la Ville de Paris : Marquis d'ARGENSON, administrateur ; Joseph Nicolas Pancrace ROYER et THURET, directeurs |
||
|
1755-1757 |
Régie de la Ville de Paris : Marquis d'ARGENSON, administrateur ; BONTEMPS et LEVASSEUR, directeurs |
||
|
1757-1767 |
François REBEL [19 juin 1701 – 07 novembre 1775] et François FRANCŒUR [21 septembre 1698 – 05 août 1787], directeurs (01 avril 1757 – 01 avril 1767) |
||
|
Salle des Machines (Palais des Tuileries) (28 avril 1763 - 1769) |
|||
|
1767-1769 |
Pierre Montan BERTON et Jean-Claude TRIAL [13 décembre 1732 – 23 juin 1771], directeurs (03 février 1767 – 1769) |
||
|
1769-1776 |
Régie de la Ville de Paris : Pierre Montan BERTON, Jean-Claude TRIAL [† 23 juin 1771], Antoine DAUVERGNE [04 octobre 1713 – 12 février 1797] et Nicolas-René JOLIVEAU [– 14 août 1790], directeurs (1769 – avril 1776) |
||
|
Deuxième Salle du Palais-Royal (Palais-Royal) (02 janvier 1770 - incendie, 08 juin 1781) |
|||
|
1776-1777 |
Denis Pierre PAPILLON DE LA FERTÉ [17 février 1727 – 07 juillet 1794], commissaire royal ; Pierre Montan BERTON, directeur |
||
|
1777-1780 |
Régie de la Ville de Paris : Anne-Pierre-Jacques DEVISMES DU VALGAY [1745 – 03 mai 1819], directeur (1777 – 1779) puis régisseur |
||
|
1780 |
Denis Pierre PAPILLON DE LA FERTÉ, commissaire royal ; Pierre Montan BERTON, directeur |
||
|
1780-1782 |
Denis Pierre PAPILLON DE LA FERTÉ, commissaire royal ; Antoine DAUVERGNE et François-Joseph GOSSEC, directeurs |
Salle des Tuileries (19 juin 1781 - 13 août 1781)
Salle des Menus-Plaisirs (rue Bergère) (14 août 1781 - 26 octobre 1781) |
|
|
1782-1784 |
Denis Pierre PAPILLON DE LA FERTÉ, commissaire royal ; François-Joseph GOSSEC, directeur |
Salle de la Porte-Saint-Martin (16 boulevard Saint-Martin) (27 octobre 1781 - 15 avril 1794) |
|
|
1785-1790 |
Denis Pierre PAPILLON DE LA FERTÉ, commissaire royal ; Antoine DAUVERGNE, directeur |
||
|
1790-1791 |
Régie de la Commune de Paris : DE LA SUZE, président |
||
|
Opéra (24 juin 1791) Académie de musique (29 juin 1791) Académie royale de musique (17 septembre 1791) Académie de musique (15 août 1792) |
1791-1792 |
Régie de la Commune de Paris : Louis-Joseph FRANCŒUR [08 octobre 1738 – 10 mars 1804], directeur |
|
|
1792-1793 |
Régie de la Commune de Paris : Louis-Joseph FRANCŒUR et Jacques CELLERIER, directeurs (1792 – 16 septembre 1793) |
||
|
Opéra (12 août 1793) Opéra national (18 octobre 1793) Théâtre des Arts (07 août 1794) |
1793-1794 |
||
|
Régie de la Commune de Paris : Comité d'Artistes ; BRALLE, inspecteur général |
|||
|
1794-1798 |
Comité d'Artistes |
Théâtre National [Salle Montansier] (rue de Richelieu) (16 avril 1794 - 13 février 1820) |
|
| Théâtre de la République et des Arts (02 février 1797) |
1798-1799 |
Comité d'Artistes ; Louis-Joseph FRANCŒUR, DENESLE et BACO, administrateurs provisoires |
|
|
1799-1800 |
Anne-Pierre-Jacques DEVISMES DU VALGAY, directeur ; Joseph Balthazar BONET DE TREICHES, commissaire du gouvernement |
||
|
1800-1801 |
Joseph Balthazar BONET DE TREICHES, commissaire du gouvernement et directeur |
||
|
1801-1802 |
Jacques CELLERIER, directeur |
||
| Théâtre de l'Opéra (24 août 1802) |
1802-1803 |
Tutelle de la Maison du Premier Consul : Etienne MOREL DE CHÉDEVILLE, directeur |
|
|
1803-1807
|
Tutelle de la Maison du Premier Consul : Joseph Balthazar BONET DE TREICHES, directeur (1803 – 1807) |
||
|
Académie impériale de musique (29 juin 1804) |
|||
|
1807-1814
|
Tutelle du Premier Chambellan de l'Empereur : Louis-Benoît PICARD [Paris, 19 juillet 1869 – 31 décembre 1828], directeur (01 novembre 1807 – 1814) |
||
|
Académie de musique (03 avril 1814)
Académie royale de musique (05 avril 1814) |
|||
|
Tutelle du Ministre de la Maison du Roi : comte de PRADEL, surintendant ; Louis-Benoît PICARD, directeur |
|||
|
Académie impériale de musique (21 mars 1815) |
1814-1815 |
||
|
Académie royale de musique (09 juillet 1815) |
1816-1817 |
Tutelle du Ministre de la Maison du Roi : Louis PAPILLON DE LA FERTÉ fils, intendant général ; Alexandre-Etienne CHORON, directeur |
|
|
1817-1819 |
Tutelle du Ministre de la Maison du Roi : Louis PAPILLON DE LA FERTÉ fils, intendant général ; Louis-Luc LOISEAU DE PERSUIS, directeur (03 septembre 1817 – 13 novembre 1819) |
||
|
1819-1821 |
Tutelle du Ministre de la Maison du Roi : Giovanni Battista VIOTTI, directeur |
||
|
Théâtre Louvois (6 rue de Louvois) (27 mars 1820 - 18 avril 1820)
1re Salle Favart (place Boieldieu) (19 avril 1820 - 14 mai 1821)
Théâtre Louvois (6 rue de Louvois) (15 mai 1821 - 15 juin 1821) |
|||
|
1821-1824 |
Tutelle du Ministre de la Maison du Roi : François HABENECK [Mézières [auj. Charleville-Mézières], Ardennes, 22 janvier 1781 - Paris, 08 février 1849], directeur (01 janvier 1821 – 1824) |
Salle Le Peletier (12 rue Le Peletier) (16 août 1821 - incendie, 28 octobre 1873) |
|
|
1824-1827 |
Tutelle du Ministre de la Maison du Roi : Raphaël de FRÉDOT DUPLANTYS, directeur |
||
|
1827-1830 |
Tutelle du Ministre de la Maison du Roi : Emile-Thimothée LUBBERT [ – 1859], directeur |
||
|
Théâtre de l'Opéra (04 août 1830) Académie royale de musique (10 août 1830) |
1831-1835 |
Louis-Désiré VÉRON [Paris, 05 avril 1798 - Paris, 27 septembre 1867], directeur-entrepreneur (01 mars 1831 – 01 septembre 1835) |
|
|
1836-1840 |
Edmond DUPONCHEL, directeur |
||
|
1840-1841 |
Léon PILLET et Edmond DUPONCHEL, directeurs |
||
|
1841-1847 |
Léon PILLET [1803 – 1867], directeur |
||
|
1847 |
Léon PILLET, Edmond DUPONCHEL et Nestor ROQUEPLAN, directeurs |
||
|
Edmond DUPONCHEL et Nestor ROQUEPLAN, directeurs (mai 1847 – octobre 1849) |
|||
|
Théâtre de la Nation (26 février 1848) |
1848-1849 |
||
|
Opéra-Théâtre de la Nation (29 mars 1848) |
1849-1854
|
Nestor ROQUEPLAN (Nestor ROCOPLAN dit) [13.Mallemort, 1804 – 1870], directeur (octobre 1849 – 06 novembre 1854) |
|
|
Académie nationale de musique (02 septembre 1850) |
|||
|
Académie impériale de musique (02 décembre 1852) |
|||
|
Théâtre Impérial de l'Opéra (01 juillet 1854 - fermé le 02 septembre 1870) |
1854-1856 |
Liste Civile, Ministère d'Etat : François-Louis CROSNIER*, directeur |
|
|
1856-1862 |
Alphonse ROYER, directeur (01 juillet 1856 – décembre 1862) |
||
|
1862-1866 |
Liste Civile, Ministère d'Etat : Emile PERRIN [Rouen, 19 janvier 1814 - Paris, 08 octobre 1885, enterré au cimeière de Montmartre (27e division)], directeur |
||
|
1866-1870 |
Emile PERRIN, directeur-entrepreneur |
||
|
1870-1871 |
Les Artistes en Société : Emile PERRIN, directeur |
||
|
Théâtre National de l'Opéra (12 juillet 1871-) |
1871 |
La Commune de Paris ; Les Artistes en Société : Eugène Joseph GARNIER [† avril 1893], directeur |
|
|
Les Artistes en Société : Hyacinthe-Olivier-Henri HALANZIER-DUFRESNOY [Paris, 11 décembre 1819 – Paris, 28 décembre 1896], directeur provisoire (09 juillet 1871 – 31 octobre 1871) |
|||
| 1871-1879 |
Olivier HALANZIER-DUFRESNOY, directeur entrepreneur (01 novembre 1871 – 15 juillet 1879) |
||
|
Salle Ventadour (rue Méhul) (19 janvier 1874 - 30 décembre 1874) |
|||
|
1879-1884 |
Emmanuel-Auguste VEAUCORBEILLE dit FERVILLE puis VAUCORBEIL [Rouen, Seine-Inférieure [auj. Seine-Maritime], 15 décembre 1821 - Paris, 02 novembre 1884, enterré au cimetière de Montmartre (25e division)], directeur (16 juillet 1879 – 02 novembre 1884) |
Palais Garnier (place de l'Opéra) (05 janvier 1875-) |
|
|
1884 |
Direction des Beaux-Arts : DES CHAPELLES, directeur intérimaire (02 novembre 1884 – 30 novembre 1884) |
||
| 1884-1891 |
Eugène RITT, directeur-entrepreneur (01 décembre 1884 - 31 décembre 1891) |
||
|
1892-1893 |
Eugène BERTRAND, directeur (01 janvier 1892 – 1893) |
||
|
1893-1899 |
Eugène BERTRAND et Pedro GAILHARD, directeurs (1893 – 31 décembre 1899) |
||
|
1900-1907 |
Pedro GAILHARD, directeur (01 janvier 1900 – 1907) |
||
|
1908-1914 |
André MESSAGER et Leimistin BROUSSAN **, directeurs (01 janvier 1908 – 31 août 1914) |
||
|
1914-1939
|
Jacques Louis Eugène ROUCHÉ [Lunel, Hérault, 16 novembre 1862 - Paris 17e, 07 novembre 1957], directeur intérimaire (01 septembre 1914 – 16 janvier 1919) ; directeur (17 janvier 1919 – 13 janvier 1939) Création de la Réunion des théâtres lyriques nationaux (14 janvier 1939) |
||
|
1939-1941 |
Philippe GAUBERT, directeur (1939 – 08 juillet 1941) |
||
|
1941-1944 |
Marcel SAMUEL-ROUSSEAU, directeur (29 octobre 1941 – 1944) |
||
|
1945-1946 |
Reynaldo HAHN, directeur (23 juin 1945 – 1946) |
||
|
1946-1951 |
Henri BÜSSER, directeur [devient conseiller technique de la RTLN au 01 janvier 1952] |
||
|
1952-1959 |
Emmanuel BONDEVILLE, directeur (01 janvier 1952 – 1959) |
||
|
1959 |
Le poste de Directeur est supprimé |
* François-Louis CROISNU dit CROSNIER (Paris, 12 mai 1792 - septembre 1867) fut député au Corps législatif.
"Il a été successivement, et d'abord sous le pseudonyme d'Edmond, maître de table d'hôte, auteur dramatique, puis directeur des théâtres de la Porte-Saint-Martin, de l'Opéra-Comique et de l'Opéra, et encore chef de bataillon de la garde nationale à Pantin, et enfin, pendant plus de dix ans, député et conseiller général du Cher. Il est mort commandeur de la Légion d'honneur. Sa mère, qu'on n'appelait que la mère Crosnier, a été longtemps concierge de l'Opéra. Les grandeurs de son fils l'avaient si peu changée qu'elle avait quand même gardé sa loge ; elle ne consentit à l'abandonner que longtemps après l'avènement de son fils à la direction du théâtre." (Georges d'Heylli, Dictionnaire des pseudonymes, 1887)
** Jean Leimistin BROUSSAN (décédé à 101 ans à Paris le 01 octobre 1959) a épousé Madeleine Lagarde, fille de Paul Lagarde et de l'actrice Jeanne Samary.

Leimistin Broussan, codirecteur de 1908 à 1914
LES ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX DE LA RTLN
La Réunion des théâtres lyriques nationaux (R.T.L.N.) est un établissement public créé par la loi du 14 janvier 1939 pour englober les théâtres de l’Opéra et de l’Opéra-Comique et les réunir sous la direction d’un administrateur commun. Seul fonctionnaire de l’établissement, l’administrateur engage un directeur pour chacun des deux théâtres, et l’ensemble du personnel artistique et technique, tous étant soumis au régime juridique de droit commun. Dotée de l’autonomie financière et de la personnalité civile, la Réunion a un budget propre, principalement alimenté par une subvention de l’Etat. Son objet est de représenter dans les deux salles les ouvrages lyriques du répertoire, accomplissant ainsi une tâche inaccessible aux théâtres privés. Elle sera dissoute le 07 février 1978.
|
1939 |
1945 |
Jacques ROUCHÉ (14 janvier 1939 – 21 février 1945) |
|
1945 |
1945 |
André GADAVE (administrateur provisoire, 21 février – 22 juin 1945) |
|
1945 |
1946 |
Maurice LEHMANN (23 juin 1945 – 1946) |
|
1947 |
1951 |
Georges HIRSCH [Paris 19e, 22 février 1895 - Paris 16e, 12 mai 1979] [épouse à Paris 9e le 18 septembre 1925 Madeleine MATHIEU, cantatrice] (1947 – 28 septembre 1951) |
|
1951 |
1951 |
André GADAVE (administrateur par intérim, 28 septembre – 17 novembre 1951) |
|
1951 |
1955 |
Maurice LEHMANN (17 novembre 1951 – 1955) |
|
1955 |
1956 |
Jacques IBERT (01 octobre 1955 – démissionne, avril 1956) |
|
1956 |
1959 |
Georges HIRSCH (13 avril 1956 – 1959) |
|
1959 |
1962 |
Aman-Maistre JULIEN (12 avril 1959 – 12 avril 1962) |
|
1962 |
1968 |
Georges AURIC (19 avril 1962 – 1968) |
|
1968 |
1969 |
André CHABAUD [Champs-sur-Tarantaine, Cantal, 26 août 1921 - Mauriac, Cantal, 10 août 2019] (administrateur par intérim, 13 septembre 1968 – 30 septembre 1969) |
|
1969 |
1971 |
René Eugène Joseph NICOLY [Avon, Seine-et-Marne, 22 septembre 1907 - Paris 9e, 22 mai 1971] (01 octobre 1969 – 22 mai 1971) |
|
1971 |
1972 |
Daniel-Jean-Yves LESUR dit DANIEL-LESUR [Paris, 19 novembre 1908 - Paris, 02 juillet 2002] (administrateur intérimaire, 02 juin 1971 – 31 décembre 1972) |

Maurice Lehmann, administrateur des Théâtres Lyriques nationaux, avec Emmanuel Bondeville, directeur de l'Opéra, Louis Beydts, directeur de l'Opéra-Comique, et son état-major, lors de la réunion hebdomadaire dite de l'affiche, en 1952.
de g. à dr. : MM. Favre Le Bret, Gadave (assis), Maurice Decerf, Serge Lifar (penché), Emmanuel Bondeville, Maurice Lehmann, Louis Beydts, X (en arrière-plan), Pierre Jamin, Baldy, Mercier, Albert Aveline.

René Nicoly en 1969, président des Jeunesses Musicales de France et administrateur général de la RTLN, mort en 1971 d'un infarctus dans son bureau du Palais Garnier.
LES DIRECTEURS DE LA MUSIQUE
| 1779 | 1781 | Louis-Joseph FRANCŒUR |
| 1781 | 1810 | Jean-Baptiste REY |
| 1810 | 1815 | Louis-Luc LOISEAU DE PERSUIS |
| 1815 | 1824 | Rodolphe KREUTZER |
| 1824 | 1830 | François-Antoine HABENECK et Henri VALENTINO |
| 1831 | 1846 | François-Antoine HABENECK |
| 1847 | 1859 | Narcisse GIRARD |
| 1860 | 1862 | Pierre-Louis DIETSCH |
| 1863 | 1866 | Georges HAINL |
| 1867 | 1871 | François-Auguste GEVAERT |
| 1872 | 1873 | Georges HAINL |
| 1873 | 1876 | Ernest DELDEVEZ |
| 1877 | 1878 | Charles LAMOUREUX |
| 1879 | 1887 | Ernest ALTÈS |
| 1887 | 1891 | Auguste VIANESI |
| 1891 | 1892 | Charles LAMOUREUX |
| 1892 | 1893 | Edouard COLONNE |
| 1894 | 1905 | Paul TAFFANEL |
| 1906 | 1914 | Paul VIDAL |
| 1915 | 1923 | Camille CHEVILLARD |
| 1924 | 1939 | Philippe GAUBERT |
| 1940 | 1946 | François RÜHLMANN |
| 1947 | 1951 | Henri BÜSSER |
| 1952 | 1959 | poste inoccupé |
| 1959 | 1966 | Emmanuel BONDEVILLE |
| 1970 | 1971 | Georges PRÊTRE |
LES DIRECTEURS DE LA SCÈNE
| DUBOIS (en poste en 1826) | |
| 1850 | Hippolyte LEROY |
| 1856 | Gustave VAEZ |
| 1859 | Eugène CORMON |
| 1871 | |
| 1874 | Léon CARVALHO |
| 1877 | Adolphe MAYER (épouse Sophie BOULART, cantatrice de l'Opéra-Comique) |
| 1880 | François Joseph Philoclès REGNIER DE LA BRIÈRE |
| 1884 | Pedro GAILHARD |
| 1892 | CAMPOCASSO (Auguste DELOCHE dit) (Albert, Somme, 30 septembre 1833 - Paris 10e, 25 août 1908) [épouse à Paris 9e le 26 juin 1873 Marie LOVATO, choriste à l'Opéra] |
| 1894 | Alexandre LAPISSIDA |
| 1901 | Victor CAPOUL |
| 1907 | Pierre-Barthélemy GHEUSI |
| 1908 | Pierre LAGARDE |
| 1910 | Paul STUART († février 1914) |
| 1915 | Octave LABIS |
| 1919 | Emile MERLE-FOREST |
| 1920 | Léo DEVAUX (Léon-Charles-J. dit) (Namur, Belgique, 21 janvier 1872 - 1951) |
| 1921 | Emile MERLE-FOREST |
| 1922 | Pierre CHEREAU |
| 1949 | Max de RIEUX (Max Ernest GAUTIER dit) (Paris 5e, 05 mars 1901 – Fréjus, Var, 10 mars 1963) |
| 1950 | Jean MERCIER |
| 1952 | André LEJEUNE |
| 1956 | José BECKMANS |
| 1960 | poste supprimé |
| 1964 | Robert GILLES |
| 1967 | Gabriel COURET |

Pierre Lagarde, directeur de la scène de 1908 à 1910

Robert Gilles, metteur en scène et directeur de la scène de 1964 à 1967 [photo Lipnitzki, 1966]
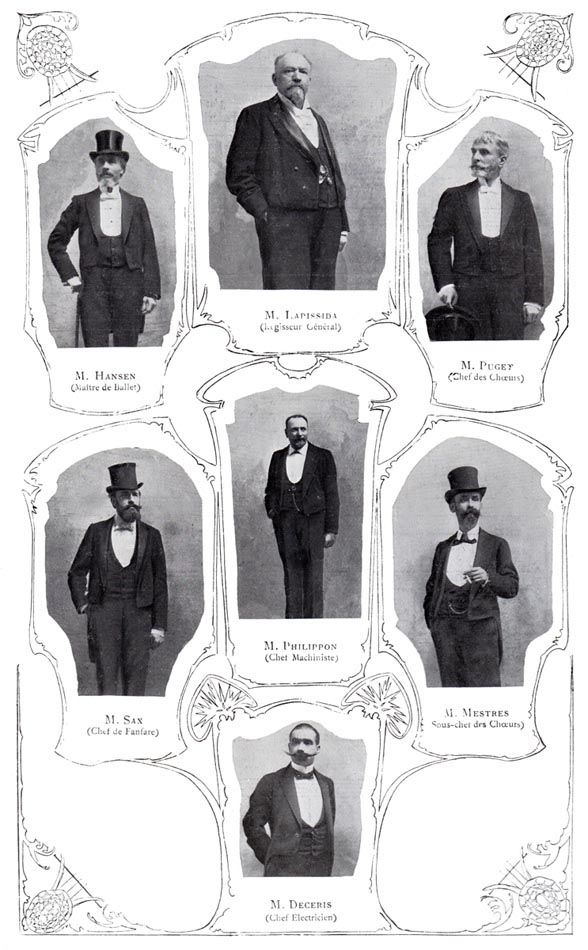
service de la scène à l'Opéra en 1904

Stéphane Cognet (né à Saint-Etienne), surveillant général [nouvelle fonction créée par Messager et Broussan] en 1908 et 1909 [photo Antony's]
Les Secrétaires de Direction
1871 : Jules-Alexandre-Charles LEPOT-DELAHAYE dit DELAHAYE [Tours, 03 décembre 1818-] — 1880 : Henri DARCEL — 1882 : Ferdinand MOBISSON — 1891 : Léon BARON [† novembre 1892] — 1892 : MAILLARD — 1907 : Lucien BILLANGE — 1908 : SURICAU — 1912 : Maurice LEFÈVRE — 1915 : Mlle THOMAS — 1919 : M. BLANCHARD — 1955 : Mme WILLEMETZ — 1959 : Mme PELLETIER.
Les Directeurs des Services Administratifs
1871 : AVRILLON — 1875 : Jules BOURDON — 1887 : JUSSEAUME — 1889 : CLÉMENT — 1893 : SIMONOT Antoine [-av. 1900] — 1907 : Pierre Claude Marius GABION [Saint-Étienne, Loire, 17 octobre 1867* - Paris 16e, 28 janvier 1945*] [épouse 1. à Paris 18e le 07 juillet 1894* Claudine Vallas ; 2. à Paris 9e le 27 novembre 1905 Marie Angelle Dupuy] — de 1915 à 1960, successivement : Paul BLONDOT ; ROGE ; René GADAVE ; André CHABAUD [Champs-sur-Tarantaine, Cantal, 26 août 1921 - Mauriac, Cantal, 10 août 2019].
Secrétaires de l'Administration : P. D'HORMOYS (en poste en 1864) — GUILLET (1865) — Nérée DESARBRES, librettiste [Villefranche-sur-Saône, Rhône, 12 février 1822 - Paris, 16 juillet 1872] (01 juillet 1856 - 01 mars 1863).

la direction de l'Opéra en 1908 : André Messager et Leimistin Broussan (directeurs), Pierre Lagarde (directeur de la scène), Marius Gabion (administrateur général), Pierre Soulaine (secrétaire général)

de g. à dr. : André Messager (codirecteur), Marius Gabion (directeur des services administratifs), Pierre Lagarde (directeur de la scène), Leimistin Broussan (codirecteur), en 1908

la direction de l'Opéra en février 1908 (photo prise dans le cabinet directorial le jour de la prise de possession) de g. à dr. : Pierre Lagarde (directeur de la scène), Marius Gabion (administrateur général), Paul Vidal (chef d'orchestre), Leimistin Broussan (codirecteur), Paul Stuart (régisseur général), André Messager (codirecteur)
Les Secrétaires Généraux
1875 : Jules-Alexandre-Charles LEPOT-DELAHAYE dit DELAHAYE [Tours, Indre-et-Loire, 03 décembre 1818-] — 1879-1880 : Edmond CHEROUVRIER — 1884 : Emile BLAVET — 1891 : Georges BOYER — 1907 : Pierre SOULAINE.
de 1915 à 1960 (par ordre alphabétique) : Paul ACHARD ; Alphonse CAMBARROT ; Maurice DECERF ; Robert FAVRE LE BRET [Paris 17e, 25 août 1904 - 27 avril 1987] ; Louis LALOY (en poste en 1919) ; Georges LINOR ; de la ROMIGUIERE.
 |
 |
||
|
|
Maurice Decerf, Inspecteur Général de la RTLN en 1955 |
Robert Favre Le Bret, Secrétaire Général de la RTLN en 1955 |
|
La Bibliothèque de l’Opéra
Fondée par M. Ch. Nuitter, et rendue publique par un arrêté ministériel du 10 décembre 1881, la Bibliothèque occupe le pavillon ouest de l'Opéra, auquel on accède dans la journée par deux rampes situées à l'intersection des rues Scribe et Auber.
Elle se divise en deux parties principales, l'une musicale, l'autre dramatique.
La partie musicale comprend la collection à peu près complète des 686 opéras et ballets qui ont été représentés sur le théâtre de l'Opéra depuis 1671 jusqu'à ce jour et dont la Bibliothèque possède les partitions d'orchestre, le plus souvent accompagnées des parties d'orchestre, des parties de chœurs, des rôles, conducteurs, réduction pour piano, etc.
Outre ces partitions, qui forment le répertoire proprement dit, la Bibliothèque possède :
Un grand nombre de partitions d'opéras, d’opéras-comiques et d'opérettes ;
Une importante collection de morceaux de chant et d'airs à danser ;
Une collection de cantates, d'hymnes, de chants patriotiques, d'airs nationaux, français et étrangers ;
Des morceaux de concert et de musique religieuse ;
Enfin, une précieuse collection d'autographes musicaux, la plupart de grands maîtres, dont les ouvrages ont été représentés à l'Opéra.
La partie dramatique comprend 15.000 volumes et brochures, relatifs au théâtre et à la musique : ouvrages d'histoire, de littérature, de critique, d'administration, de législation, de biographie, de costumes, de décors, de machinerie, de mise en scène, etc.
On y trouve encore :
60.000 estampes, gravures et photographies, portraits d'artistes, plans et vues, costumes et scènes de théâtre, etc.
Enfin, une importante collection de journaux littéraires et musicaux dont quelques-uns, du XVIIIe siècle et de la période révolutionnaire, sont devenus très rares.
La Bibliothèque est ouverte tous les jours au public, sauf les dimanches et jours fériés, de onze heures à quatre heures. (1904)
Les Archives de l’Opéra
Installées dans de vastes galeries au-dessus des salons du glacier, les archives alignent, sur d'interminables rayons, 800 cartons, 1.500 registres, dossiers, liasses et portefeuilles, renfermant l'histoire administrative et la comptabilité du Théâtre de l'Opéra depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours.
Elles possèdent en outre :
Une volumineuse correspondance, où sont représentés par de nombreux autographes, quantité d'artistes et d'hommes politiques ;
La collection ininterrompue des affiches collées à la porte, depuis l'année 1800 ;
400 maquettes de décors, ainsi que de nombreux projets et esquisses ;
Environ 4000 modèles originaux de costumes, dont quelques-uns du XVIIe siècle, exécutés par des maîtres, et constituant une série d'œuvres d'art du plus grand intérêt et du plus haut prix.
Le Musée de l’Opéra
La Bibliothèque et les Archives sont complétées par un Musée, que M. le ministre de l'Instruction publique est venu solennellement inaugurer, en juin 1903.
Là sont réunis et groupés méthodiquement de nombreux objets se rapportant à l'Opéra, aux œuvres qui y ont été exécutées et aux artistes qui s'y sont produits. On peut voir des spécimens d'affiches, de costumes et de décors ; une chambre noire est même spécialement réservée aux maquettes de ces décors établis à l'échelle de 1/300e et éclairées à la lumière électrique. D'anciennes salles d'Opéra reconstituées, des poupées costumées, des tableaux, des bustes, des caricatures, des autographes, des curiosités diverses, souvenirs et reliques artistiques, racontent à leur manière l'histoire d'un théâtre sur lequel ont pris naissance tant de chefs-d'œuvre.
Le Musée est situé au premier étage du pavillon ouest (entrée par la Bibliothèque) ; il est ouvert au public tous les jours, sauf les dimanches et lundis, de midi à trois heures. (1904)
Les Bibliothécaires
01 avril 1774 à novembre 1814 : Jean-Baptiste-François-Augustin LEFEBVRE (Mareuille, Aisne, 1738 -) — novembre 1814 au 01 janvier 1829 : François Charlemagne LEFEBVRE (compositeur, fils de J.-B.-F.-A. Lefebvre) — 01 janvier 1829 à mars 1866 : Aimé Ambroise Simon LEBORNE [Bruxelles, 29 décembre 1797 - Paris 9e, 02 avril 1866] (compositeur, gendre de F.-C. Lefebvre) — 1865 à 1875 : Ernest REYER — 1875 à 1888 : Ernest REYER et Théodore de LAJARTE — 1889 : Ernest REYER — 1890 : Ernest REYER et Antoine BANÈS — 1893 : Ernest REYER — 1908 : Charles MALHERBE — 1912 : Martial TENÉO — 1922 : Charles BOUVET — 1931 : Jacques-Gabriel PROD'HOMME [Paris, 28 novembre 1871 - Paris, 18 juin 1956] — 1940 : Jean CORDEY — 1942 : Denise LAUNAY — 1943 : Annette DIEUDONNÉ — 1944 à 1972 : André MÉNETRAT.
Bibliothécaire-adjoint : 1895 à 1907 : Antoine BANÈS.
Les Archivistes
1866 : Charles NUITTER — 1899 : Charles MALHERBE — 1908 : Antoine BANÈS — 1912 : Henri QUITTARD — 1919 : Charles BOUVET.
1931 à 1940 : Jacques-Gabriel PROD'HOMME [Paris, 28 novembre 1871 - Paris, 18 juin 1956].
Archiviste-adjoint : 1893 : Antoine BANÈS — 1895 à 1898 : Charles MALHERBE.
Administrateur de la bibliothèque, des archives et du musée : 1912 : Antoine BANÈS.

une salle de travail à la Bibliothèque de l'Opéra en 1904 (en médaillon : Charles Malherbe)
« L'Opéra »
Album hebdomadaire de l'Académie Nationale de Musique et de Danse.
Administration : 106 boulevard Saint-Germain, Paris, puis (août 1905) 6 rue du Louvre, Paris. — Rédaction : au Théâtre National de l'Opéra. — Le gérant : A. Houdin. — J. Rueff, éditeur.
Edité chaque semaine du 01 janvier 1904 jusqu'en mai 1907 a minima.
« L'Opéra de Paris »
Organe officiel des Théâtres Lyriques Nationaux. 26 numéros de 1950 à 1969.
Direction, rédaction, administration : Théâtre National de l'Opéra, 8 rue Scribe, Paris 9e, tel. OPEra 50-70.
Le Gérant : Maurice Decerf (n° 01 à 26). — Le Comité de Rédaction : MM. Maurice Dirand (n° 06 à 13 ; 18 ; rédacteur en chef n° 22 à 26), Roger Marzauk (n° 06 à 26), André Ménetrat (n° 06 à 26), René Delange (n° 13 à 17). — Direction artistique : A.-F. V. Antoine (n° 01 à 04). — Réalisation artistique de François Martin Salvat (n° 06 à 26).
N° 01 (juillet 1950) ; 02 (novembre 1950) ; 03 (1951) ; 04 (1951) ; 05 (1952) ; 06 (1953) ; 07 (2e trim. 1953) ; 08 (4e trim. 1953) ; 09 (2e trim. 1954) ; 10 (4e trim. 1954) ; 11 (2e trim. 1955) ; 12 (1er trim. 1956) ; 13 (2e trim. 1956) ; 14 (2e trim. 1957) ; 15 (4e trim. 1957) ; 16 (3e trim. 1958) ; 17 (4e trim. 1958) ; 18 (4e trim. 1959) ; 19 (4e trim. 1960) ; 20 (4e trim. 1961) ; 21 (1er trim. 1963) ; 22 (1er trim. 1964) ; 23 (1er trim. 1965) ; 24 (2e trim. 1966) ; 25 (2e trim. 1967) ; 26 (2e trim. 1969).
Les Chefs de Chant
Louis Sébastien LEBRUN [Paris, 10 décembre 1764 – Paris, 27 juin 1829], haute-contre qui débuta à l'Opéra le 24 mars 1787 et y devint bientôt chef du chant (encore en poste en 1815). — Charles Éléonor RAGAINE.
1809 : MM. Henri Montan BERTON — 1822 : Jean Madeleine Marie SCHNEITZHŒFFER [Toulouse, Haute-Garonne, 13 ou 15 octobre 1785 – Paris, 04 octobre 1852] — 1827 : Ferdinand HEROLD — vers 1829 : Jules Roch Louis dit Jules PICCINNI [Paris ancien 2e, 31 août 1809-] — 1830-1845 : Fromental HALÉVY — 1840 : Pierre Louis Philippe DIETSCH [Dijon, Côte-d'Or, 17 mars 1808 - Paris, 20 février 1865] — 1840-1872 : François BENOIST [Nantes, Loire-Inférieure [auj3. Loire-Atlantique], 10 septembre 1794 - avril 1878] — 1850 : Henri-Hippolyte POTIER [Paris, 10 février 1816 - Paris, 09 octobre 1878] — 1856-1870 : Eugène VAUTHROT — 1858-1887 : Louis Joseph Arnaud CROHARÉ [Paris, 27 février 1820 - Paris, 21 janvier 1895] — 1871-1891 : Hector SALOMON [Strasbourg, Bas-Rhin, 29 mai 1838 - mars 1906] — 1875-1893 : Jules-Emile-David COHEN [Marseille, Bouches-du-Rhône, 02 novembre 1835 - Paris, 13 janvier 1901] — 1878 : Léon DELAHAYE (Léon Jules Jean Alexandre LEPOT dit) [Tours, Indre-et-Loire, 21 novembre 1844 - Le Vésinet, Seine-et-Oise [auj. Yvelines], 16 juin 1896] — 1879 : HUSTACHE — 1884 : LOTTIN — 1887 : Edouard MANGIN (Eugène-Edouard BOCQUET dit) [Paris, 07 décembre 1837 - Paris, 24 mai 1907] — 1891 : Fidèle KŒNIG [† septembre 1904] (fils du ténor Koenig) — 1892 : Paul VIDAL — 1893 : Eugène-Georges MARTY [Paris, 16 mai 1860 - Paris, 11 octobre 1908] — 1894 : Alfred BACHELET — 16 mai 1901 : Alphonse CATHERINE — 1904 : Charles LEVADÉ — 1904-1910 : Marcel CHADEIGNE — 1905 : ESTYLE, Walther STRARAM — 1908 : Paul-Adrien RAY [Paris, 13 février 1863-] (nommé 2e chef avant 1900).
De 1915 à 1960 (par ordre alphabétique) : MM. Maurice BECHE ; Georges BECKER (en poste en 1924) ; Mme Simone BLANC [† mars 2017] (de 1951 à 1974) ; MM. Henry DEFOSSE (en poste en 1923) ; Alphonse-Godefroy-Auguste DELACROIX (en poste en 1919) ; Mme Odette DUFOUR ; MM. Maurice FAURE ; Maurice FRANCK ; Mme Jeanne KRIEGER-BELIGNE [Colombes, Seine [auj. Hauts-de-Seine], 1887 - 1973] (épouse Arthur Endrèze) (de 1916 à 1948) ; MM. Jean LAFORGE [Paris 5e, 07 août 1925-] ; R. LAUTEMANN (en poste en 1919) ; Henri LAUTH ; Félix LEROUX (01 avril 1920-) ; Mme Germaine MORDANT ; M. Roger PENAU ; Mme Simone PETIT ; MM. Maurice PICARD ; Michel QUEVAL ; Mme Henriette ROGET ; MM. Victor SERVENTI ; Georges TRUC ; Georges VISEUR (en poste en 1919).
Les Chefs des Chœurs
1840-1860 : MM. Pierre Louis Philippe DIETSCH [Dijon, Côte-d'Or, 17 mars 1808 - Paris, 20 février 1865] — 1860 : Victor MASSÉ — 1862 : Charles PREVOST (2e chef en poste en 1862) — 1865-1872 : Léo DELIBES (2e chef) — 1870 : Hector SALOMON [Strasbourg, Bas-Rhin, 29 mai 1838 - mars 1906] (2e chef) — 1874 : HUSTACHE (2e chef) — 1878 : Jules-Emile-David COHEN [Marseille, Bouches-du-Rhône, 02 novembre 1835 - Paris, 13 janvier 1901] (poste déjà tenu jusqu'au 30 septembre 1874) — 1878-1889 : Antonin-Émile-Louis CORBAZ-MARMONTEL [Paris ancien 3e, 24 novembre 1850* - Paris 9e, 23 juillet 1907*] (sous-chef) — 1889 : Paul VIDAL (sous-chef) — 1891 : Léon DELAHAYE (Léon Jules Jean Alexandre LEPOT dit) [Tours, Indre-et-Loire, 21 novembre 1844 - Le Vésinet, Seine-et-Oise [auj. Yvelines], 16 juin 1896] (1er chef, 1891-1896) ; ROY ; SAVARD — 1894 : Claude dit Claudius BLANC [Lyon 5e, Rhône, 20 mars 1854* - Lyon 5e, 14 juin 1900*] (2e chef en 1894 ; 1er chef, 1896-1900) — 1896 : Eugène-Henri MESTRES [Montmartre, Seine [auj. Paris 18e], 23 juin 1856-] (2e chef en 1896) — 1900 : Paul PUGET — 1908 : Jean Charles Claude dit Jean GALLON [Saint-Josse-ten-Noode, Belgique, 25 juin 1878 - Paris, 23 juin 1959] ; Félix LEROUX — 1909-1915, 1919 : Marcel CHADEIGNE.
De 1915 à 1960 (par ordre alphabétique) : MM. CARPENTIER ; René DUCLOS (en poste en 1953) ; Jean LAFORGE [Paris 5e, 07 août 1925-] (sous-chef en 1958 ; chef en 1964) ; André Charles LEPÎTRE [Paris 4e, 05 avril 1884 - Paris 6e, 25 novembre 1956*] (en poste en 1919) ; Omer LETOREY ; Eugène PICHERAN ; Robert Lucien SIOHAN [Paris, 27 février 1894 - 1985] (de 1932 à 1946).
Charles COGNET fut accompagnateur des chœurs (en poste en 1888).
Les Régisseurs des Chœurs
Ce poste a été créé en 1908 par André MESSAGER. L'ont successivement tenu (jusqu'en 1960) : CABILLOT ; Louis MARIE ; SAINT-MAURICE ; DEMAGNY ; Henry ROBERT ; Roland LAIGNEZ.
|
René Duclos, chef des chœurs |
Jean Laforge, qui fut chef de chant et chef des chœurs à l'Opéra |
Les Maîtres de ballet : Voir la Danse à l'Opéra
Les Accompagnateurs
1901-1903 : Marcel CHADEIGNE — 1904 : ESTYLE — 1906 : Jean GALLON.
Les Souffleurs
MOREAU (en poste en 1836) — ROBIN (en poste en 1855) — 1871 à 1875 : Auguste-Charles COÉDÈS [Paris, 11 décembre 1840-13 juillet 1884] — 1876 à 1894 : CLAMENTZ — 1895 à juillet 1896 : Eugène-Henri MESTRES [Montmartre, Seine (auj. Paris 18e), 23 juin 1856-] — juillet 1896 à 1914 : Louis IDRAC.
de 1915 à 1960 (par ordre alphabétique) : MM. BERNARD ; CHARLES-PAUL ; DAVID ; Raoul GILLES ; Georges TRUC. [de 1920 à 1945, le service du souffleur a été assuré en alternance par les Chefs de chant].
Les Chefs machinistes
SACRÉ (en poste en 1855) — VALLENOT (en poste en 1893) — PHILIPPON (sous-chef en poste en 1893 ; chef en poste en 1901) — Frédéric Armand PÉTREMAND [Vesoul, Haute-Saône, 1861 - Paris 8e, 23 juin 1916*] (en poste en 1914).
Les Chefs électriciens
Raoul Henri Édouard de CÉRIS [Nogent-le-Rotrou, Eure-et-Loir, 05 octobre 1862 - Paris 8e, 25 octobre 1939] (en poste en 1900 et 1904).
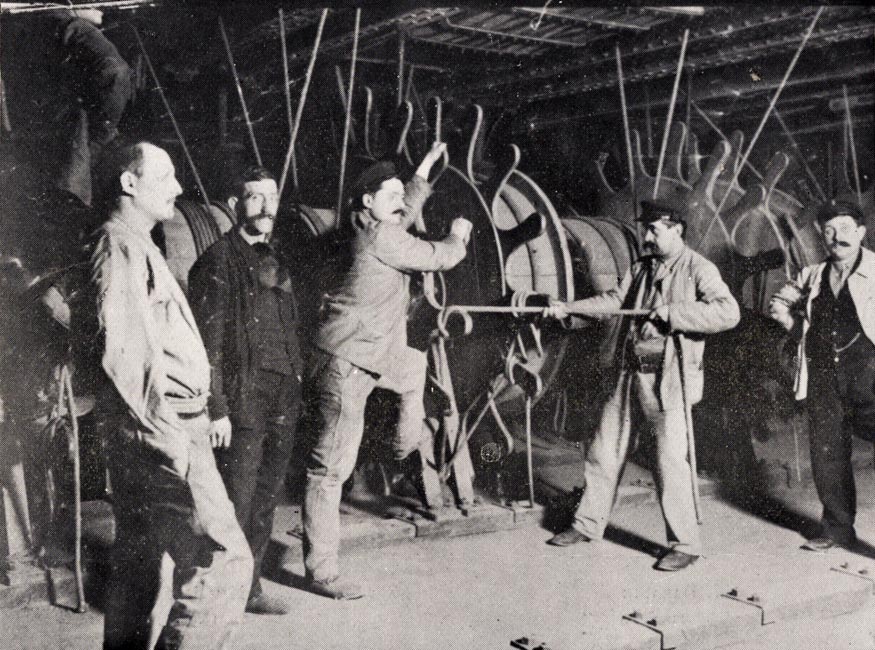
Dans les 5mes dessous : manoeuvre des tambours [revue l'Opéra, janvier 1904]

Dans les 5mes dessous : la pompe dans la galerie de la rivière souterraine [revue l'Opéra, janvier 1904]
Les Chefs de Fanfare
De 1875 à 1960 : Adolphe SAX ; Adolphe SAX fils ; Alexandre COURTADE ; Roger FAYEULLE.
Les Régisseurs Généraux
1859 à 1872 : Eugène CORMON — 1872 à 1890 : Adolphe MAYER [Paris, 1820-] (démissionne le 17 mars 1890) — 1890 à 1904 : Alexandre LAPISSIDA — 1905 à 1906 : Jules SPECK [Paris, 22 août 1857 - 22 janvier 1931] — 1907 à 1914 : Paul STUART († février 1914) — 1915 à 1938 : Joseph REFFET — 1938 à 1951 : André LEJEUNE — 1955 à 1967 : Gabriel COURET.

Jules Speck en 1905, régisseur général de 1905 à 1906 [photo Compagnie Belge]
"Un changement considérable a eu lieu dans l'administration de l'Opéra : M. Lapissida, ayant demandé de prendre sa retraite, a été remplacé, comme régisseur général, par M. Speck, dont la compétence et la courtoisie ont déjà été éprouvées en plusieurs villes, où il s'est acquis d'unanimes sympathies." (Musica, novembre 1905)

Paul Stuart, régisseur général de 1907 à 1914 [photo Antony's, 1909]
Les Régisseurs de la Scène
1856 à 1871 : Alexis COLLEUILLE — 1871 au 03 septembre 1902 : Georges COLLEUILLE [second régisseur, 1868-1871] — 10 septembre 1902 à 1914 : Maurice COLLEUILLE [second régisseur, 1898-1902].
de 1915 à 1950 (par ordre alphabétique) : Pierre GAYAN (en poste en 1955) ; Robert GILLES ; Roland LAIGNEZ ; André LEJEUNE ; Félix LEROUX ; Jules OUDART (qui fut également régisseur de la danse) ; Charles PELLETIER ; Maurice PICHERY ; Marc ROLLAND ; Philippe ROMIEU (en poste en 1955) ; Guy SAINT-CLAIR. — 1964 : Jules OUDART ; J. RAGARU.
Les Chefs de Figuration
De 1875 à 1960 : Aimé CARRERE — Robert SAURIN — Robert DUMANY.
Les Décorateurs
Il faut citer les noms de AMABLE — Alexandre BAILLY — Charles Antoine CAMBON — Eugène CARPEZAT — CHERET — Joseph CHÉRET — Charles CICERI — Jacques DAGUERRE — Dominique Louis DARAN — Jean Emile DARAN — Ignazio DEGOTTI — Edouard DESPLECHIN — Maxime DETHOMAS — Jules DIETERLE — Léon FEUCHÈRE — Pierre-François-Léonard FONTAINE — Eugène GARDY — Claude GILLOT (Langres, Haute-Marne, 28 avril 1673 - Paris, 04 mai 1722), peintre et graveur qui dirigea les décorations et l'atelier des costumes à l'Opéra. — Jean-Baptiste ISABEY — Marcel JAMBON — Antoine LAVASTRE — Jean-Baptiste LAVASTRE — Marcel MOISSON — François-Joseph NOLAU — Charles PERCIER — Humanité René PHILASTRE — Henry ROBECCHI — Auguste Alfred RUBÉ — Polycarpe Charles SÉCHAN — Eugène Martial SIMAS — Joseph THIERRY.
De 1875 à 1960, si les décors ne furent pas réalisés par ceux qui les avaient conçus ou en avaient établi la maquette, ils le furent par l'un ou l'autre des Artistes suivants :
Oreste ALLEGRI — AVISON — Nicolas BENOIS — Emile BERTIN — Maurice BRUNET — Emile CHAPERON — Philippe CHAPERON — CHAZOT — CHEVALLIER — CILLARD — DARLOT — Raymond DESHAYS — DURAND — GARDENS — GERVAL — Léonce HENRY — LAILHACA — LAVERDET — LAVIGNAC — MATAGNE — Maurice MOULÈNE — Georges MOUVEAU — MULLER — M. NUMA — OUDOT — PAQUEREAU — PELLEGRY — K. POPOFF — ROGER — Eugène RONSIN — STREIFF.
Les Costumiers
Beaucoup de maquettes ont été réalisées par Alfred ALBERT — Jean Simon BERTHÉLEMY — Charles BÉTOUT — Maxime DETHOMAS — Hippolyte LECOMTE — Paul LORMIER — François Guillaume MENAGEOT.
De 1875 à 1960, ils furent en général réalisés par ANTOINETTE — Charles BIANCHINI — Germaine BONAFOUS — CALVIN — DESVIGNES — FALK — FRENIET — GROMSTEFF — KARINSKA — Eugène LACOSTE — LEBRUN — MATHIEU — MADELLE — MUELLE — A. PHOCAS — Joseph PINCHON — André PONTET — Mme RASIMI — RAYMOND et CATHERINE — Alyette SAMAZEUILH — SOLATGES — Mme Raymonde THIEBAULT — Mme TROSSEAU — TURPIN — Mme VATRIQUANT.
Les Perruquiers
Les perruques furent en général fournies (de 1875 à 1960) par les Maisons BERTRAND ou PONTET.
Le 06 août 1920, une médaille d'honneur en argent a été accordée à Auguste Émile VALLERANT [Paris, 23 septembre 1853 - Palais Garnier, Paris 9e, 26 février 1922*] pour 34 ans de service à l'Opéra en qualité de concierge.

Eugène Cyprien Marie Joseph CŒUILLE (Paris 11e, 11 octobre 1858* - janvier 1928), commissaire de police de service à l'Opéra en 1904 [revue l'Opéra, mars 1904]
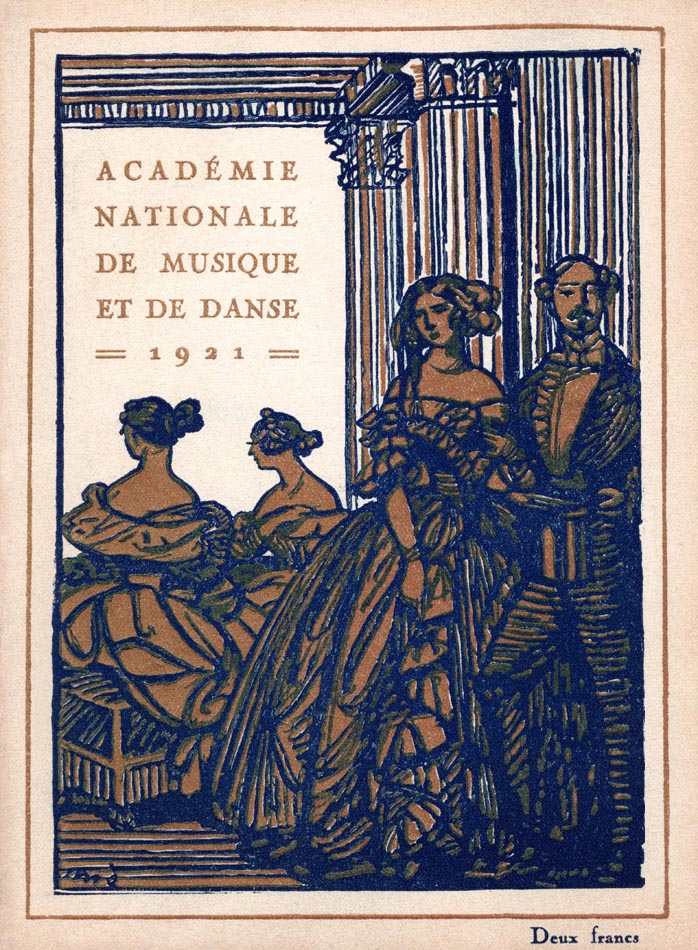

couverture de programmes de l'Opéra de Paris (1921-1926 et 1926-1936)
|
I. Salles affectées à l'Opéra.
Ce théâtre ouvrit le 19 mars 1671 dans une salle que l'abbé Perrin avait fait construire au jeu de paume de la Bouteille, rue Mazarine, vis-à-vis de la rue Guénégaud. Lully, après avoir enlevé à l'abbé Perrin la direction de l'Académie royale de musique, employa Vigarani pour bâtir une salle nouvelle sur l'emplacement d'un autre jeu de paume, celui du Bel-Air, situé rue de Vaugirard, près du Luxembourg. Cette construction manquait de solidité, et elle menaçait ruine, lorsque la mort de Molière permit au Florentin de prendre possession de la salle du Palais-Royal, où le premier de nos auteurs comiques avait fait représenter tous les chefs-d'œuvre qu'il écrivit de 1660 à 1673. C'est dans cette grande salle du Palais-Royal, édifiée par ordre et pour les plaisirs du cardinal-duc de Richelieu, c'est dans cette enceinte spacieuse qui contenait prés de trois mille spectateurs, que s'installa l'Académie royale de musique, le 15 juin 1673, pour y demeurer jusqu'au 6 avril 1763. Après l'incendie de la salle du Palais-Royal, l'Opéra fut installé aux Tuileries : le 24 janvier 1764, on inaugura le théâtre qu'avait construit Soufflot dans la vaste salle des machines. La sonorité en parut mauvaise, et un spectateur désappointé ne put s'empêcher de s'écrier : « Que cette nouvelle salle est sourde ! » — « Elle est bien heureuse ! » lui répondit son voisin, l'abbé Galiani, avec sa vivacité d'esprit habituelle. Le théâtre du Palais-Royal, reconstruit par Moreau sur un autre plan que celui qu'avait adopté Lemercier en 1637, ouvrit ses portes au public le 26 janvier 1770 ; il fut de nouveau détruit par le feu, le 8 juin 1781. L'Opéra dut alors se contenter de la salle des Menus-Plaisirs du roi, rue Bergère, et il y donna la première de ses représentations le 14 août 1781. Le 27 octobre suivant, il inaugura la salle de la Porte-Saint-Martin, construite en quatre-vingt-six jours par l'architecte Lenoir. Cette soirée d'ouverture fut offerte aux Parisiens à l'occasion de la naissance du Dauphin : dix mille amateurs assistèrent à ce spectacle gratuit, et, sous ce poids énorme, le nouvel édifice tassa de deux pouces à droite et de quinze lignes à gauche. Un ordre du Comité de salut public obligea l'Opéra de quitter le théâtre de la Porte (Saint-) Martin et de s'emménager au Théâtre national, salle construite aux frais de Mlle Montansier (Marguerite Brunet), en face de la Bibliothèque de la rue Richelieu. L'ancienne Académie de musique y devient le Théâtre des Arts et y commence ses représentations le 7 août 1794. — C'est dans cette salle de spectacle que Louvel assassina le duc de Berry, le 13 février 1820. L'Académie royale de musique fut contrainte, aussitôt après ce tragique événement, d'abandonner un théâtre que l'autorité supérieure avait résolu de faire promptement disparaître : du 19 août 1820 jusqu'au 11 mai 1821, les représentations de notre première scène lyrique eurent lieu dans la salle Favart. Après avoir donné plusieurs concerts et deux représentations au Théâtre Louvois, l'Académie alla enfin s'installer rue Le Peletier dans la salle provisoire construite par l'architecte Debret. Elle occupe encore ce vaisseau sonore, au moment où nous écrivons ces lignes ; mais, le 21 juillet 1862, à la suite d'un brillant concours d'architecture, on a posé la première pierre de la nouvelle salle dont M. Ch. Garnier a fourni et fait exécuter les plans. Cet édifice est aujourd'hui terminé, et, si aucun événement imprévu ne s'y oppose, on ne tardera pas sans doute à en ouvrir les portes au public.
II. Noms donnés à ce théâtre
L'Académie royale de musique et de danse, après avoir été ainsi appelée depuis sa création jusque vers la fin du règne de Louis XVI, reçut le nom de Théâtre de l’Opéra, le 22 juin 1791. Quelques mois après, le 13 septembre, on lui rendit son titre d'Académie royale de musique : c'était une manière de remercier Louis XVI d'avoir signé la constitution. Mais à l'Académie royale succède bientôt l'Opéra national, qui devient, en 1794, le Théâtre des Arts, et, le 4 février 1797, le Théâtre de la République et des Arts. — A partir de 1803, on supprime dans les documents officiels ce mot de République, et, sous l'Empire, le Théâtre des Arts quitte ce nom pour recevoir celui d'Académie impériale de musique. — En 1814, l'Académie impériale voit rentrer les Bourbons, ce qui l'oblige à se déclarer royale ; puis elle redevient impériale pendant les Cent jours. Du 9 juillet 1815 jusqu'à la révolution de 188, elle conserva le titre d'Académie royale de musique. Sous la seconde République, on l'appela Théâtre de la Nation. Le règne de Napoléon III lui a valu de reprendre le nom adopté du temps de Napoléon Ier ; mais, au mois de juillet 1854, en cessant d'être une entreprise particulière, l'Académie impériale de musique devint le Théâtre impérial de l'Opéra. La liberté des théâtres (22 mars 1866) rendit pour quelque temps à l'Opéra son titre d'Académie impériale de musique, titre inscrit d'abord au fronton du somptueux monument édifié par M. Ch. Garnier. Depuis la révolution du 4 septembre 1870, notre première scène lyrique s'appelle le Théâtre national de l'Opéra.
III. Ses directeurs
Nous n'avons pas la prétention de retracer ici l'histoire des révolutions administratives de l'Académie de musique. Pour indiquer les causes de la chute ou de l'avènement de certains directeurs de l'Opéra au siècle dernier, il nous faudrait écrire tout un volume qui renfermerait assurément de fort curieuses révélations, mais qui devrait contenir aussi bien des anecdotes galantes, bien des aventures scandaleuses. Nous ne voulons point recueillir, dans un ouvrage destiné aux amis des sérieuses études, toutes les indiscrétions des poètes satiriques et des auteurs de mémoires ; mais nous croyons utile de présenter la liste des personnes qui ont dirigé notre première scène lyrique. La voici, aussi exacte, aussi complète qu'il nous a été possible de la dresser : 1668. — 10 novembre. — L'abbé Pierre Perrin obtient le privilège de fonder une Académie de musique. 1669. — 28 juin. — Lettres-patentes qui concèdent à l'abbé Perrin la direction de l'Académie de musique. 1672. — 30 mars. — Révocation du privilège de l'abbé Perrin au profit de Lully. 1687. — 27 juin. — Francine, gendre de Lully, lui succède comme directeur. Il administre mal : obligé de s'adjoindre les capitalistes Fouassin, l'Apôtre et Montarsy, il se débarrasse d'eux, une fois qu'il a reçu leur argent. 1698. — 30 décembre. — Nouveau privilège accordé pour dix années à Francine, à la condition d'associer à son entreprise Hyacinthe, Gaureaut et Dumont, écuyer commandant l'écurie du Dauphin. — Ces directeurs s'endettent, cèdent leur privilège à Pécourt et à Belleville, mais ne tardent pas à le leur reprendre. 1704. — 7 octobre. — Guyenet, payeur de rentes et riche propriétaire, obtient des lettres-patentes qui lui attribuent le privilège de l'Académie de musique et sa prolongation pour dix années, à partir du 1er mars 1709. Il s'oblige à payer les dettes de ses vendeurs (elles s'élevaient à 380,780 livres) et à leur servir une pension. Ce directeur, après avoir mangé sa fortune et ruiné sa famille, meurt le 20 août 1712. 1712. — 12 décembre. — Francine et Dumont obtiennent du Conseil un arrêt qui annule leur traité avec Guyenet et leur rend le privilège qu'ils lui avaient cédé. 1713. — 8 janvier. — Francine et Dumont reçoivent de nouvelles lettres-patentes : ils les rétrocèdent aux syndics de la faillite Guyenet : Benier, Chomat, Duchesne, Laval et Saint-Pont. — Les syndics de la faillite Guyenet résilient leur marché, après avoir ajouté 73,114 livres de dettes nouvelles aux 400,000 livres que devait déjà l'infortuné directeur mort le 20 août 1712. — Francine et Dumont reparaissent pendant quelques mois à la tête de l'administration ; mais les syndics, avec lesquels ils se trouvaient en désaccord, reprennent bientôt la direction des affaires de l'Opéra. 1715. — 2 décembre. — La haute régie de ce théâtre est confiée au duc d'Antin, qui donne promptement sa démission. — D'autres grands personnages lui succèdent. Pendant cette période d'intrigues nombreuses et de licence extrême, Francine continue de diriger l'Académie de musique et de danse. 1728. — 8 février. — Destouches obtient le privilège de Francine. 1730. — 1er juin. — Arrêt du Conseil qui révoque tous les privilèges antérieurs et en accorde un nouveau au sieur Gruer, qui doit eu jouir pendant trente-deux ans à partir du 1er avril 1730, et sous l'inspection du prince de Carignan. Ce directeur prend plusieurs associés, entre autres le président Lebœuf et le comte de Saint-Gilles : il se brouille avec ce dernier, qui dénonce au roi l'orgie à laquelle Gruer convia ses amis à l'hôtel de l'Académie, le 15 juin 1731. 1731. — 18 août. — Nouvel arrêt du Conseil qui retire à Gruer son privilège et le donne à Lecomte. Celui-ci s'associe le président Lebœuf. 1733. — 30 mai. — A Lecomte, révoqué de ses fonctions de directeur privilégié succède Eugène de Thuret, ancien capitaine du régiment de Picardie. Onze années d'administration de l'Opéra suffisent pour appauvrir Thuret et pour lui ruiner la santé. 1744. — 18 mars. — Le privilège de ce théâtre est accordé à François Berger, ancien receveur général des finances du Dauphiné, qui, en trois années, augmente de 400,000 livres les dettes de l'administration. 1748. — 3 mai. — A Berger, mort à la peine, succède Tréfontaine. Il s'adjoint Saint-Germain, la Feuillade, Bougenier et le chevalier de Mailly, ancien associé du précédent directeur. Il est dépossédé de son privilège, après une gestion de seize mois, se soldant par un déficit de plus de 250,000 livres. 1749. — 25 août. — Arrêt du Conseil qui donne à la ville de Paris la direction de l'Opéra, sous les ordres du marquis d'Argenson. Deux jours après, le 27 août 1749, Tréfontaine et ses associés sont dépossédés. 1753. — 28 novembre. — Rebel et Francœur sont nommés directeurs pour le compte de la ville de Paris. Les ennuis dont on les abreuve contraignent ces deux artistes et inséparables amis à se démettre de leurs fonctions. — Royer, maître de musique des enfants de France et compositeur de la chambre du roi, est nommé, en 1754, inspecteur général de l'Opéra ; mais sa mort (11 janvier 1755) laisse bientôt libre la place qu'avaient occupée avant lui Rebel et Francœur. 1755. — 9 avril. — Bontemps et Levasseur succèdent à Royer. 1757. — 13 mars. — Rebel et Francœur obtiennent le privilège de l'Opéra et s'engagent à diriger ce théâtre à leurs risques et périls. La ville de Paris acquitte les anciennes dettes s'élevant à 1,200,000 livres. 1767. — 6 février. — Berton et Trial sont nommés directeurs privilégiés de l'Académie royale de musique. Ces deux artistes ne montrent pas la même habileté administrative que leurs prédécesseurs et demandent à résilier leur contrat. 1769. — 9 novembre. — Un arrêt du Conseil remet la direction de l'Opéra à la ville de Paris, qui fait gérer ce théâtre par Berton, Trial (mort subitement le 23 juin 1771), Dauvergne et Joliveau. Ces quatre auteurs administrent en hommes désireux de produire leurs œuvres, et leur gestion amène un déficit de 500,000 livres. 1776. — 18 avril. — Publication de l'arrêt du Conseil qui nomme commissaires du roi pour gouverner l'Académie de musique les intendants des Menus-Plaisirs : Papillon de la Ferté, Maréchal, des Entelles, de la Touche et Bourboulon, conjointement avec Buffault, ancien marchand d'étoffes de soie. Cette nouvelle administration, en proie à mille tracasseries, se retire au bout d'un an ; Berton, conjointement avec Buffault, dirige alors l'Opéra. 1777. — 18 octobre. — Arrêt du Conseil qui accorde pour douze ans le privilège à de Vismes du Valgay. Ce directeur dépose un cautionnement de 500,000 livres ; il accepte les charges de l'entreprise, mais il obtient de la ville de Paris une subvention de 80,000 livres. Il entre en jouissance le 1er avril 1778, et déploie beaucoup de talent et d'activité dans son administration : il ne réussit pas toutefois à déraciner mille abus, et s'il lutte avec succès contre les intrigues ou les cabales de Vougny, Delaborde et Beaumarchais, c'est grâce à l'appui de Campan, valet de chambre de Marie-Antoinette. 1779. — 19 février. — Un arrêt du Conseil ordonne que l'Opéra sera régi pour le compte de la ville de Paris et dirigé par de Vismes. 1780. — 19 mars. — L'administration de l'Académie est retirée à la ville de Paris, qui n'en doit pas moins payer les dettes de ce théâtre, et Berton est nommé directeur pour le Compte du roi. Ce musicien meurt le 14 mai 1780, et Dauvergne lui succède, ayant Gossec pour sous-directeur. La Ferté est chargé de remplir les fonctions de commissaire royal. 1790. — 8 avril. — La direction est reprise par la ville de Paris. Peu de temps après, un décret du 13-19 janvier 1791 proclame la liberté des théâtres. 1792. — 8 mars. — La commune de Paris, qui n'avait point à se féliciter des résultats obtenus par ses commissaires (l'année 1791 s'était soldée par un déficit de 627,590 livres), cède l'entreprise de l'Opéra pour trente années aux citoyens Francœur et Cellerier. Ces administrateurs sont déclarés suspects le 17 septembre 1793 : Cellerier prend la fuite et se dérobe aux conséquences de ce décret de la commune de Paris, mais Francœur est arrêté et écroué à la Force. Un comité administratif, composé de purs républicains, remplace ces deux directeurs. Le régime des sans-culottes ne fait point merveille, et les abus continuent de plus belle, en même temps que s'accroit le déficit. Lays, Rey, Rochefort et Lasuze sont mis à la tête du comité administratif. Plus tard, on y place Chabeaussière, Mazade, Caillot et de Parny. Enfin à Mirbeck, commissaire du Théâtre de la République et des Arts, succèdent Francœur, Denesles et Baco, en qualité d'administrateurs provisoires. 1799. — 12 septembre. — Le Directoire nomme pour administrateurs Devismes et Bonnet de Treiches. 1800. — 13 mars. — Devismes passe directeur et Bonnet n'a plus que le titre de conservateur du matériel. Accusé de gestion malhonnête, Devismes est révoqué de ses fonctions, et Bonnet le remplace, le 23 décembre 1800 , avec le titre de commissaire du gouvernement. 1801. — 15 décembre. — Cellerier, agent comptable sous les administrations précédentes, redevient directeur, et Everat est nommé chef de la comptabilité. 1802. — 20 novembre. — Le Théâtre des Arts est mis par le premier consul sous la surveillance des préfets du palais, et Morel, le trop fécond librettiste Morel, est nommé en remplacement de Cellerier, avec Bonnet pour administrateur comptable. 1807. — 29 juillet. — Un décret impérial supprime la liberté des théâtres et réduit à huit le nombre des scènes lyriques et dramatiques de la ville de Paris. 1807. — novembre. — Création de la surintendance des grands théâtres : l'administration de l'Académie impériale de musique entre dans les attributions du premier chambellan de l'empereur. Picard, l'auteur de tant de comédies charmantes, est nommé directeur de l'Opéra ; Wante, administrateur comptable ; Despréaux, inspecteur ; Courtin, secrétaire. — En 1814, l'Académie royale de musique passe dans les attributions du ministre de la maison du roi : Picard en reste le directeur, et M. de Pradel, ministre, en devient le surintendant. 1816. — 18 janvier. — Picard cède la direction à Papillon de la Ferté, qui prend pour régisseur Choron, et Persuis pour inspecteur de la musique. Choron avec son caractère droit et ses idées d'artiste sérieux, ne réussit qu'à se créer des ennemis nombreux, et il est contraint de se retirer en 1817. Persuis le remplace, et, jusqu'à sa mort, conserve la direction musicale de l'Académie. 1819. — 30 octobre. — L'illustre violoniste Viotti est nommé directeur. 1821. — 1er novembre. — Un autre violoniste de talent, Habeneck, prend la direction de l'Opéra. 1824. — 26 novembre. — Par décision royale, et à compter du 1er décembre, Duplantys remplace François Habeneck, qui succède à R. Kreutzer en qualité de chef d'orchestre de ce théâtre. 1827. — 12 juillet. — Lubbert prend possession du fauteuil directorial, mais toujours sous la surveillance du surintendant des théâtres. Depuis 1816, c'est au baron Papillon de la Ferté, puis au comte de Blacas, au marquis de Lauriston, au duc de Doudeauville et au vicomte Sosthènes de la Rochefoucauld, qu'incombe la responsabilité des fautes commises, et non aux musiciens et aux administrateurs placés sous leurs ordres. 1831. — 2 mars. — Le docteur Véron est installé directeur de l'Opéra, qu'il se charge d'administrer pendant cinq ans à ses risques et périls. Ce théâtre passe dans les attributions du ministre de l'intérieur, et reçoit, à titre de subvention, une somme de 810,000 francs pour la première année de la direction du docteur Véron, de 760,000 pour la deuxième, et de 710,000 francs pour les trois dernières années. 1835. — 15 août. — Le docteur Véron, après avoir fait fortune, cède la direction à l'architecte Duponchel. 1839. — 15 novembre. — On adjoint le journaliste Edouard Monnais au successeur du docteur Véron. 1841. — 1er juin. — Formation d'une société entre Duponchel et Léon Pillet. Ce dernier prend le titre de directeur, et Duponchel se charge d'administrer le matériel. Edouard Monnais, à sa vive satisfaction, remplace Léon Pillet en qualité de commissaire royal. 1847. — 31 juillet. — Léon Pillet quitte l'Opéra et cède son privilège à Duponchel et Nestor Roqueplan. Les nouveaux directeurs prennent à leur charge les 400,000 francs de dettes que laisse leur prédécesseur. 1849. — 21 novembre. — Duponchel donne sa démission de directeur, et Nestor Roqueplan reste seul chargé de l'administration de l'Opéra. 1854. — 30 juin. — Dissolution de la société Roqueplan et Cie, qui laisse un passif de 900,000 francs. Un décret impérial du 14 février 1853 avait placé les théâtres impériaux dans les attributions du ministre d'État : un nouveau décret, en date du 1er juillet 1854, décide que l'Opéra sera régi par la liste civile impériale. Nestor Roqueplan en est nommé administrateur. 1854. — 11 novembre. — Décret qui nomme le député Crosnier administrateur général de l'Opéra. 1856. — 1er juillet. — M. Alphonse Royer succède à Crosnier. 1862. — 20 décembre. — M. Émile Perrin, directeur du théâtre de l'Opéra-Comique, est nommé administrateur de l'Opéra, en remplacement de M. Alphonse Royer. 1866. — 11 avril. — Décret instituant M. Émile Perrin directeur responsable de l'Opéra. En conséquence d'un autre décret du 22 mars 1866, et qui avait proclamé la liberté des théâtres, le nouveau directeur-entrepreneur est obligé de déposer un cautionnement de 500,000 francs ; mais il reçoit une subvention de 800,000 francs, et l'empereur lui accorde en outre une somme de 100,000 francs sur sa cassette particulière. 1870. — 6 septembre. — M. Émile Perrin donne sa démission de directeur, mais reste administrateur provisoire de l'Opéra. 1871. — 8 juillet. — M. Émile Perrin est nommé administrateur-général du Théâtre-Français et est remplacé comme administrateur provisoire de l'Opéra par M. Halanzier, qui, jusqu’au 30 octobre suivant, préside le comité de la société des artistes. 1871. — 1er novembre. — M. Halanzier, administrateur provisoire, est nommé directeur-entrepreneur de l’Opéra.
(Gustave Chouquet, Histoire de la musique dramatique en France, 1873)
|
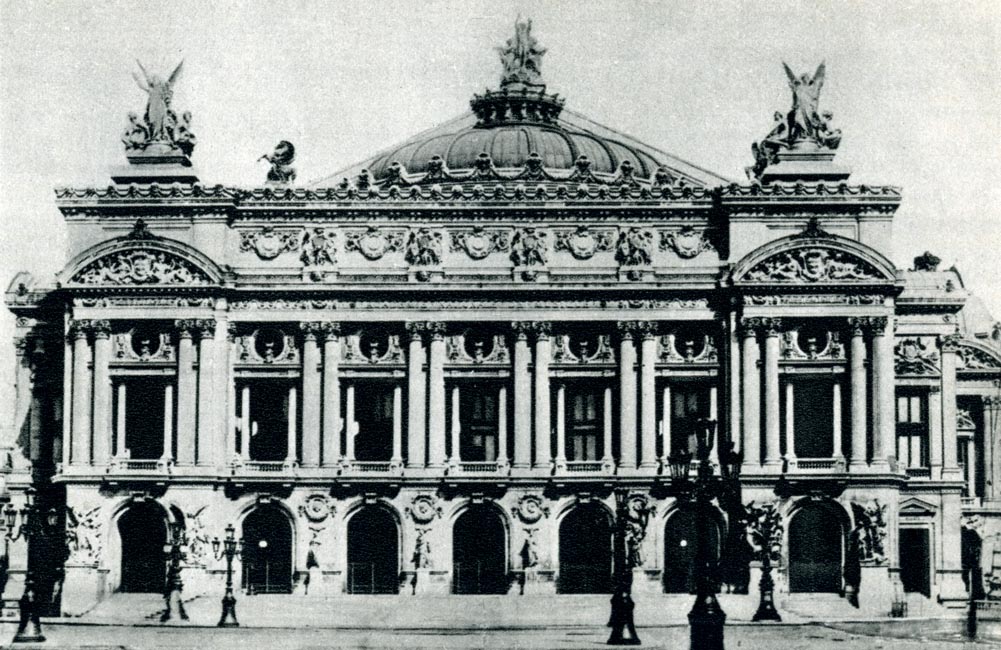
|
Histoire de l'Opéra de Paris
Le théâtre de l'Opéra, appelé aussi Académie royale de musique sous l'ancienne monarchie, de Louis XIV à Louis XVI, Théâtre de l'Opéra en 1791, Opéra national en 1794, Théâtre des Arts en 1797, Académie impériale de musique sous les deux Empires napoléoniens, Académie royale sous la Restauration, redevenu enfin, en 1848, et en 1870 Théâtre national de l'Opéra, a presque aussi souvent changé de résidence que de désignation.
Enfin, l'abbé Perrin s'étant associé avec
Cambert pour composer des œuvres lyriques, tous deux obtinrent, le 28
juin 1669, des lettres patentes leur accordant pour douze ans
le privilège d'établir « en la ville de Paris et
autres du royaume des académies de musique
pour chanter en public des pièces de théâtre », et firent représenter l'opéra de
Pomone (19
mars 1671). C'est le premier opéra véritablement français. Il fut joué pendant huit
mois avec le plus grand succès et rapporta
aux auteurs 120.000 livres. La troupe primitive qui le joua se composait de cinq hommes,
quatre femmes, quinze choristes et treize
symphonistes à l'orchestre. On était loin alors,
comme on voit, des splendeurs de l'exécution
moderne. Lulli, directeur de la musique du roi, rusé comme un Italien, supplanta Perrin et Cambert et, après un procès, obtint pour lui le privilège, le 30 mars 1672. Il abandonna leur théâtre et en fit élever un au jeu de paume de Bel-Air, rue de Vaugirard, près du Luxembourg, qu'il inaugura le 15 novembre 1672 par la représentation des Fêtes de l'Amour et de Bacchus, suivie bientôt de Cadmus et d'Alceste, qui firent les délices de Louis XIV. Mais cette salle était peu solide ; après la mort de Molière, il fut permis à Lulli de prendre possession du théâtre du Palais-Royal, où notre grand comique avait fait représenter ses chefs-d'œuvre. Ce fut dans cette enceinte spacieuse et magnifique, qui contenait près de trois mille spectateurs et qui avait été construite pour les plaisirs du cardinal de Richelieu, que s'installa d'une manière définitive l'Académie royale de musique, le 15 juin 1673 ; elle devait y demeurer jusqu'au 6 avril 1763. Cette salle, détruite par un incendie, sort ordinaire des salles d'opéra, occupait à peu près l'emplacement de la cour des Fontaines.
Les efforts de Lulli furent couronnés de succès ; l'Opéra devint le spectacle le plus goûté et le plus à la mode. Il eut cependant ses détracteurs et ne s'établit pas sans de vives oppositions. Plusieurs écrivains de cette époque se moquèrent de cette innovation, et La Fontaine rimait ces plaisants vers :
Malgré tous les quolibets et les critiques, le
théâtre de l'Opéra obtint un grand succès. Il
suffisait d'ailleurs que Louis XIV aimât ce
spectacle. En cela, comme dans les autres
choses, le roi-soleil régla le goût de la cour ;
il aimait cette salle, où tout était réuni pour
le plaisir de ses yeux avides de la pompe et
de ses oreilles sensibles aux louanges. On y
chantait ses vertus, cela seul était suffisant.
Chaque ouvrage était précédé d'un prologue
qui n'était d'un bout à l'autre qu'un dithyrambe en l'honneur du roi. Aussi, ce que
Louis XIV préférait dans les opéras, c'étaient
ces morceaux ; il les chantait souvent lui-même, et on l'entendait fredonner de sa voix
la plus fausse :
Plus brillant et mieux fait que tous les dieux ensemble, ou encore :
Le grand roi, comme on sait, ne se donnait pas la peine de feindre la modestie.
Quoique le théâtre de l'Opéra commence à
tenir, au XVIIe siècle, une grande place dans
la vie oisive des courtisans et de l'aristocratie élégante, il ne devient que plus tard, sous
la Régence, avec les fameux bals, un foyer
d'intrigues restées fameuses et le temple
scandaleux où les grands seigneurs vinrent
se choisir leurs sérails. La constante protection accordée par Louis XIV à son Académie de musique et les cajoleries de la cour
pour tout ce qui était acteur ou danseur contribuèrent surtout à faire insensiblement
prendre cette importance à l'établissement
fondé par Lulli. En payant les dettes de ses
chanteurs, en excusant leurs mauvaises
mœurs, en les introduisant pour ainsi dire
dans sa familiarité, le roi donna l'exemple à
ses courtisans et montra qu'il pardonnait tout à ceux qui contribuaient
à ses plaisirs. Il tolérait de la part de ses chanteurs et de ses
danseurs des libertés de langage qu'il ne
laissait jamais impunies chez les autres. On
raconte que le chanteur Gaye, s'étant permis un jour quelques
plaisanteries contre l'archevêque de Reims et apprenant que celui-ci
avait eu connaissance de ses propos, alla
trouver le roi, lui avoua tout et lui en demanda pardon. Quelques jours
après, comme il chantait à la messe en présence de Sa Majesté,
l'archevêque, pour se venger, dit assez haut
pour être entendu : « C'est dommage, ce pauvre Gaye perd sa voix.
– Vous vous trompez, repartit le roi, il chante bien, mais il
parle mal. » Les acteurs de l'Académie étaient
presque tous des ivrognes qu'on était obligé la plupart du temps d'aller
chercher au cabaret au moment de commencer le spectacle.
Duménil, Thévenard avaient peine à se tenir
sur leurs jambes lorsqu'ils entraient en scène.
Il fallait à Duménil six bouteilles de vin de
Champagne pour chaque représentation.
Boutelon avait aussi des manies extravagantes. Plusieurs fois on le mit en prison. Craignant que la mauvaise chère n'altérât son
organe, Louis XIV lui faisait servir chaque
jour une table de six couverts, et de douze si
l'amphitryon avait porté jusqu'à douze le
nombre de ses convives. Cette sollicitude pour tout ce qui touchait à l'Opéra, les talents de Lulli comme administrateur et comme musicien contribuèrent beaucoup à donner de l'éclat à ce théâtre. Mais après la mort de son chef, en 1687, il ne tarda pas à tomber en décadence. Francine, gendre de Lulli, lui succéda le 27 juin 1687 ; il administra mal et fut obligé, en 1698, d'associer à son entreprise trois collègues qui s'endettèrent pour une somme de 380.780 livres, et, malgré ce sacrifice, se virent forcés, en 1704, de céder leur privilège à Guyenet, payeur de rentes. Celui-ci ne réussit pas davantage. Après avoir liquidé les comptes de ses devanciers, il fit des dettes comme eux, ruina sa santé et laissa à sa mort un déficit de 400.000 livres (20 août 1712). L'administration de l'Opéra allait de mal en pis. Après avoir été mise sous la surveillance du duc d'Antin, puis de divers grands seigneurs dont l'influence fut déplorable, on la confia aux soins de Destouches (1728), de Gruer (1730), d'Eug. de Thuret, ancien capitaine, qui, après onze années (1733-1744), se trouva forcé, comme ses devanciers, de déposer son bilan. Ses successeurs n'eurent pas plus de bonheur, et, jusqu'à la Révolution, malgré des moments d'éclat et de fortune, l'Opéra fut un gouffre où vint s'engloutir l'argent des directeurs, alléchés par l'appât du gain et ayant trop de confiance dans leur habileté. Ainsi, cet établissement, à la fin du règne de Louis XIV, après un brillant début, se trouvait, comme tout le reste, dans le plus piteux état. L'orgueilleux monarque ne devait voir, dans sa vieillesse, que des ruines préparées par son faste insouciant, ses folles dépenses et sa fatale politique.
Pour dignes émules, ce danseur eut Mlles
Camargo et Sallé, dont la grâce arrachait à
Voltaire un cri d'admiration :
Ah ! Camargo, que vous êtes brillante ! Ce ne fut point cependant par cette réunion de talents divers, d'artistes remarquables que l'Opéra acquit, sous la Régence et le règne de Louis XV, une réputation si éclatante. C'est une autre raison, connue de tous et devenue légendaire, qui lui valut sa bruyante célébrité. De même que la pénurie du trésor royal, sur la fin du siècle de Louis XIV, avait développé et fait connaître une race d'hommes appelés les traitants, dont Samuel Bernard est resté comme un des types les plus accomplis, ainsi, au commencement de la Régence, ou vit surgir une espèce féminine particulière à laquelle on donna le nom de filles d'Opéra. Leurs orgies, leurs dépenses folles, le nombre et le rang illustre de leurs amants, leur luxe inouï, la place qu'elles occupent dans les Mémoires du temps, leurs querelles avec les dames de la cour, tout cela leur donne droit de cité dans l'histoire d'une époque dont elles représentent les mœurs. Les filles d'Opéra, d'abord repoussées avec mépris par la société des femmes a laquelle avait appartenu Mme de Sévigné, finirent par être admises et même recherchées, au XVIIIe siècle, par les plus grandes dames. La reine Marie-Antoinette consulta plus tard et écouta avec respect les avis de la Guimard sur les choses de toilette. Le régent d'abord, puis Louis XV, avaient donné l'exemple en choisissant leurs maîtresses parmi les étoiles de l'Académie de musique ; les grands seigneurs firent comme eux, et cela fut bientôt une question de mode que contribua à répandre l'innovation des bals masqués. Ces bals, créés en 1717 par le chevalier de Bouillon, qui avait imaginé une machine ingénieuse pour amener le parterre au niveau de la scène, furent pendant plus d'un siècle le privilège exclusif de l'Opéra. Donnés, dans l'origine, tous les dimanches, depuis la Saint-Martin jusqu'à l'Avent, et depuis les Rois jusqu'à la fin du carnaval, il s'y noua des intrigues célèbres. Leur vogue fut incroyable. Le Régent, dont les appartements du Palais-Royal touchaient à l'Opéra, y vint souvent, et quelquefois dans un état d'ivresse honteux, ainsi que ses courtisans, le conseiller d'Etat Rouille et le duc de Noailles. Quelques dessins de Watteau nous ont conservé le souvenir de ces fêtes. Ce ne fut que quelques années plus tard qu'afin d'attirer plus de monde aux bals masqués, on imagina d'y introduire des danseurs de l'Opéra pour y exécuter des danses de caractère. Ceux-ci s'y firent remarquer par leurs innovations, et c'est de là que viennent les danses des Calotins, la Farandole, les menuets à deux, les contredanses à huit, puis à seize, le pas des Rats, la Calotine, le Poivre, la Monaco, etc.
Nous ne pouvons rappeler ici les noms de
toutes les beautés de l'Opéra, chanteuses, figurantes, danseuses ou
choristes qui se rendirent célèbres à cette époque ; on trouvera
le récit de leurs aventures dans les Mémoires
de l'époque. Donnons pourtant une mention
aux aimables sœurs Louison et Fanchon Moreau, que Monseigneur, fils de Louis XIV, se
fit amener un jour chez lui par un homme de
confiance, et auxquelles il daigna prodiguer
ses bonnes grâces ; à la choriste Souris, « ainsi
nommée à cause de sa taille svelte et fine » ; à la figurante Emilie Dupré,
à la petite Leroi, toutes trois maîtresses avouées du Régent, etc. L'opulence et les prodigalités de
Mlle Pelissier et de Mlle Deschamps, à cette
époque, sont restées historiques, et toutes
deux, quoique simples figurantes, savaient admirablement dévorer les
millions des fermiers généraux, et des milords anglais. Et
non seulement le roi et ses courtisans, mais
aussi les prélats venaient à l'Opéra, au
foyer de la danse ou aux bals. On lit ce qui
suit dans le Journal de Barbier (année 1750) : «
M. le comte de Clermont, abbé de Saint-Germain-des-Prés, a publiquement Mlle Le
Duc, qui était une danseuse de l'Opéra ; elle
passe les trois quarts de l'année à Berny, maison de plaisance de l'abbé, où elle tient et
fait les honneurs de la table. Elle a une belle
maison dans la rue de Richelieu, où le prince
de Clermont passe quelquefois huit jours. On
y fait des concerts. Les Pères de l'abbaye
qui ont affaire au prince viennent l'y trouver
le matin. » Cette Mlle Le Duc se promenait
au bois de Boulogne couverte de diamants,
et le prince de Clermont se montrait avec
elle dans un carrosse traîné par six chevaux.
Il finit par se marier secrètement avec elle.
Nous n'en finirions pas si nous nous mettions à raconter les traits d'indécence, les
orgies de toute sorte des sirènes de l'Opéra. Le scandale était si
grand, que l'administration du théâtre fut plus d'une fois obligée
d'avoir recours à des peines disciplinaires. Ainsi, Mlle Pelissier fut congédiée le 13 février 1734, pour des raisons qui ne peuvent
s'écrire. Il en fut de même pour Mlle Petit,
surprise dans le dessous du théâtre en costume de « Vénus sortant de l'onde », écoutant
les douceurs que lui contait le marquis de
Rounac. Un directeur de l'Opéra, Gruer, fut
renvoyé à cause de ses orgies : c'est lui qui,
fin gastronome, avait fait apporter sur un plat immense, dans un de ses
festins, un poisson de son invention : du milieu d'une touffe
de persil, artistement disposé, sortit tout à
coup une charmante beauté dans un costume
de naïade. Ou comprend combien l'avantage
de pouvoir figurer a l'Opéra devait être ambitionné par un grand nombre de postulantes ;
l'emploi conduisait aux honneurs et à la richesse. Le directeur Monnet songea à tirer
parti des demandes qui l'assiégeaient et fit payer une redevance aux
demoiselles qui aspiraient à être figurantes. C'est à cette époque aussi que l'on vit de malheureuses jeunes
filles arrachées à leurs parents et reléguées à
l'Opéra comme dans un cloître d'un nouveau
genre. Il suffisait de les faire inscrire sur les
contrôles du théâtre pour les soustraire aux
réclamations de leurs familles. Les seigneurs
qui dédaignaient de prendre la peine de les séduire usaient de ce moyen.
Le comte de
Melun fit enlever ainsi d'un seul coup les deux
demoiselles de Camargo, dont l'une n'avait
pas encore atteint l'âge de treize ans. l'Opéra
était un asile inviolable comme autrefois le temple de Vesta, avec cette
différence qu'ici la
virginité n'était pas de rigueur. Les lettres de
cachet donnaient des acteurs ou des danseuses à l'Académie de musique de la même façon
qu'elles fournissaient des captifs à la Bastille.
Malgré l'importance croissante de l'Opéra,
le talent des acteurs, le perfectionnement des décors et des ballets, la
situation pécuniaire de ce théâtre ne se trouvait pas améliorée. Après le capitaine
Thuret, dont la direction avait eu une fin si malheureuse (1744),
on vit Rebel et Francœur, qui gardèrent l'administration jusqu'en 1757 et
furent remplacés successivement par MM. Trial et Le Breton. A cette époque, un terrible accident
compromit encore l'état de l'Académie de musique. Le 6 avril 1763, à
huit heures du matin, le feu prit au théâtre et consuma la salle
bâtie par Richelieu, et où l'on jouait depuis quatre-vingt-dix ans des œuvres lyriques. Le
désastre était considérable. Un grand nombre
de projets furent présentés pour une reconstruction immédiate. Les uns proposèrent les
bâtiments du Louvre ou la place du Carrousel ; d'autres insistèrent pour que l'Opéra fût
installé au Palais-Royal. Le duc d'Orléans
appuyait ce dernier projet et offrait 100.000 fr. par an pour ses loges
personnelles. Il fut décidé que provisoirement l'Opéra donnerait
ses représentations au théâtre des Machines,
aux Tuileries, que Soufflot répara à cet effet. L'inauguration eut lieu
le 24 janvier
I764, avec Castor et Pollux, de Rameau. La
sonorité en parut mauvaise, et un spectateur
désappointé ne pût s'empêcher de s'écrier : «
Que cette nouvelle salle est sourde !
– Elle
est bien heureuse », lui répondit son voisin, l'abbé Galiani, avec sa
vivacité d'esprit habituelle.
Deux lettres patentes du roi, datées de février
suivant, décrétèrent enfin la reconstruction immédiate du théâtre, et les travaux
commencèrent sur les plans de l'architecte Moreau, qui mit six ans à les terminer.
Ce long provisoire nuisit beaucoup à l'Opéra :
on allait peu aux Tuileries ; car la cour, ayant le théâtre sous la
main, y paraissait très
souvent, et alors adieu les conversations
bruyantes de l'entr'acte, adieu la liberté d'allures ! Enfin, le 2 janvier 1770, la nouvelle
salle fut ouverte.
L'entrée du théâtre était sur la place du
Palais-Royal. L'ouverture de la scène avait 36 pieds et sa profondeur
était énorme. L'architecture, qui semblait d'une légèreté effrayante,
était pleine de délicatesse et de grâce. L'avant-scène, notamment, était décorée de
quatre colonnes très minces, affaiblies encore par des cannelures à jour. Le théâtre
avait quatre rangs de loges. Dans le foyer,
on avait placé les bustes de Quinault, Lulli
et Rameau. Cette belle salle fut encore brûlée en 1781 ; c'est elle qui
vit le commencement de la réforme musicale opérée par Gluck
et Piccinni, et qui fut le témoin des luttes
acharnées de leurs partisans. Gluck fit représenter successivement à l'Opéra :
Iphigénie
en Aulide, Orphée, Alceste, Armide, Iphigénie
en Tauride ; Piccinni fit entendre de suaves
mélodies dans Roland, Athys, Iphigénie en
Tauride ; enfin ; l'arrivée à Paris de la troupe
des bouffes italiens, en 1778, dont les représentations alternaient trois fois la semaine
avec celles des opéras français, firent goûter
aux amateurs parisiens les chef-d'œuvre des
Sarti, des Anfossi, des Paisiello, etc. « Les ramistes, ou
partisans de Rameau, dit M. Audiffret, qui avaient triomphé des
lullistes, furent vaincus à leur tour, et le dernier coup
fut porté à la vieille et lamentable musique
française. » Ce ne fut pas sans combat. On
vit alors au foyer de l'Opéra, à la cour et
dans les salons, se former des factions et des
cabales en faveur des gluckistes ou des piccinnistes ; toute la société aristocratique en fut
troublée. Dans le monde des lettres, Suard,
Arnaud, Du Rollet commandaient les gluckistes ; Laharpe, Ginguené, d'Alembert,
Marmontel marchaient à la tête des piccinnistes. Les écrivains, d'ailleurs, n'entendaient
pas grand chose à la musique et se laissaient
entraîner dans l'un ou l'autre parti plutôt par
des querelles particulières et des intrigues
galantes que par un goût bien décidé et bien
personnel pour tel ou tel genre de musique.
Cette épigramme courait sur Marmontel :
Ce Marmontel si long, si lent, si lourd,
La salle du Palais-Royal ayant été de nouveau incendiée le 8 juin 1781, on construisit le théâtre de la Porte-Saint-Martin en
soixante-cinq jours. Là reine Marie-Antoinette, qui aimait passionnément l'Opéra et
avait peur d'être privée longtemps de ce spectacle, avait dit à
l'architecte Lenoir, l'auteur
de ce tour de force : « Vous me promettez d'avoir fini le 30 octobre ;
je vous donne jusqu'au 31, et si la clef de ma loge m'est remise ce jour-là, vous aurez le cordon de
Saint-Michel en échange. » Lenoir tint parole,
et, le 31 octobre 1781, l'Opéra était installé à
la Porte-Saint-Martin. On vit alors dans tout
leur éclat les splendides ballets de Noverre
et de Gardel, on entendit les œuvres de Grétry, de Sacchini, de Lemoyne, de Vogel, de
Mozart, qui débutait, etc.
Cette seconde partie du XVIIIe siècle fut
extrêmement brillante pour l'Opéra ; les plus
merveilleux talents s'y trouvèrent réunis.
Voici ce qu'écrivait, en 1788, le Journal de
Paris : « Ce spectacle, le plus imposant de
tous par la richesse qu'il étale dans tous les
genres, par le grand nombre de sujets dont
il est composé, enfin par les chefs-d'œuvre
qui depuis quelques années se sont multipliés, a reçu toutes les faveurs
de la part de l'administration chargée de le diriger. Des prix
sont proposés pour les meilleurs poèmes ; des
maîtres, choisis dans la classe des artistes
éprouvés, enseignent gratuitement les élèves ; des encouragements de
tous genres sont prodigués aux talents qui veulent se consacrer
à la perfection... » Parmi les artistes de cette
époque, il faut rappeler les noms de Jélyotte, «
le beau chanteur », comme on disait, Larrivée, Legros, puis Lainé, Loïs,
Adrien, Chardini, Rousseau, Chéron, etc. Parmi les femmes, la célèbre Sophie Arnould brillait au
premier rang ; vinrent ensuite Mme Saint-Huberty, Mlle Maillard, etc.
Parmi les coryphées de la danse, il nous
suffira de mentionner les noms si connus de
Gaétan Vestris, de Didelot, de Laborie, Coulon, de Mme Guimard ;
Fuyez, arrêtez-vous, suspendez votre ivresse ;
Mlles Heinel, Allard, Lamy avaient précédé
à l'Opéra cette femme, qui resta jeune jusqu'à soixante ans. G. Vestris avait succédé
au grand Dupré ; lui-même fut éclipsé par
son fils Auguste. Il disait plaisamment à ce
propos : « Auguste est plus habile que moi,
c'est tout simple ; Gaétan Vestris est son
père, avantage que la nature m'a refusé »,
ou encore : « Si le diou de la danse veut bien
toucher à terre de temps en temps, c'est pour
ne pas humilier ses camarades ». Auguste Vestris débuta en 1772 et surpassa tout ce qu'on
avait vu jusqu'à lui. On n'avait pas encore vu
battu d'entrechat, filé de pirouette, avec une
aussi rare perfection.
Les acteurs et actrices, les danseuses et
figurantes de l'Opéra jouent peut-être un plus
grand rôle encore dans l'histoire des mœurs
de la fin du XVIIIe siècle que dans la première moitié. Un acteur de l'Académie de
musique était alors un homme de la plus haute importance ; les dames de qualité faisaient
des folies pour se l'arracher. Chassé, le baryton, eut la gloire singulière d'être cause
d'un duel entre deux femmes. Une Polonaise
et une Française se le disputèrent le pistolet
au poing dans le bois de Boulogne. Notre
compatriote fut blessée ; quant à la Polonaise,
un ordre du roi l'exila pour le bruit qu'avait
fait cette aventure. Mmes de Polignac et de
Nesle avaient donné l'exemple d'un pareil
combat en se disputant dans un duel le duc
de Richelieu. Si les chanteurs excitaient de
pareils enthousiasmes, à combien plus forte
raison les actrices et les danseuses. Les prodigalités des seigneurs et des financiers, les
orgies et le luxe des filles d'Opéra prirent
des proportions incroyables. On a écrit des
volumes rien qu'en mentionnant les hôtels
généreusement donnés à des figurantes. Aussi
la place était de plus en plus ambitionnée.
Les spirituels Statuts rimés pour l'Académie
royale de musique, composés en 1767, imposaient, pour leurs débuts,
à ces jeunes personnes, les conditions suivantes :
Pour toute jeune débutante . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Que celles qui, pour prix de leurs heureux travaux, . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leur défendons en conséquence
Balcons : 11 livres 10 sous.
Malgré l'appui de la noblesse, malgré le talent des musiciens et des artistes de cette
époque, l'Académie de musique continuait à
ne pas faire ses frais. Momentanément placée
sous la direction de la commune de Paris, qui
confia la gestion aux soins actifs et éclairés
de Devismes du Valgy (1778), avec 80.000 fr.
de subvention, elle n'eut pas plus de bonheur. Le trésor particulier du roi était obligé,
en maintes circonstances, d'aider le directeur. C'est que l'Académie
occupait un personnel nombreux, et un matériel énorme : on y comptait
toujours au moins 6 basses-tailles, 4 hautes-contre, 2 tailles, 8 cantatrices,
40 choristes hommes et femmes, 12 danseuses et danseurs, 16 coryphées, un orchestre de 50 musiciens. Venaient ensuite l'école
de chant, puis l'école de danse, puis les
employés au magasin : 1 décorateur, 1 peintre, 1 dessinateur des habits, l machiniste,
1 maître tailleur, 1 copiste de musique, 1 accordeur de clavecin, 1
comptable, plus environ 50 pensionnaires quelconques, qui n'avaient guère, pour toute occupation, qu'à
émarger à la caisse. En outre, on avait été
obligé d'augmenter de plus en plus les appointements du personnel. Au début, les premiers sujets de l'Opéra ne touchaient que
1.200
et 1.500 livres. Doublés à partir de 1713,
les appointements des premiers acteurs et
danseurs se montaient en 1770, avec les feux,
à 7.000 et 8.000 livres. Voici, du reste, un état
comparatif des dépenses de l'Opéra pour les
années 1713 et 1778 :
1713.
Danse : 24 personnes : 15.000 livres.
1778.
Danse : 90 personnes : 139.000 livres.
Pendant les deux années 1787 et 1788, on ne représenta que deux nouveautés, une par an. Les temps, en effet, devenaient de plus en plus sombres. L'extrait suivant des Mémoires de Francœur en dira plus dans sa concision qu'une longue dissertation : « La sérénade de Saint-Louis (24 août 1787) se donna aux Tuileries comme de coutume, mais les affaires de l'Etat et du parlement ayant prodigieusement échauffé les esprits, il nous fut fait diverses menaces par lettres anonymes, tant pour nous défendre de la donner que pour nous inviter à la faire devant Henri IV, sur le pont Neuf. La police, pour maintenir le bon ordre, fit placer 400 à 500 hommes dans le jardin et tout se passa sans aucun tumulte. – Dimanche 24 août 1788. Le soir, la sérénade aux Tuileries, où la garde-française, les Suisses et les invalides furent, doublés à cause des troubles de l'Etat. – Mercredi 29 avril 1789. Ce soir, répétition au grand théâtre pour les Prétendus. – Nota : Les régiments de gardes-françaises, des Suisses, de Royal-Cravate et les maréchaussées furent en faction, depuis six heures du matin, vis-à-vis la salle de l'Opéra (à la suite du pillage de la maison de Réveillon, faubourg saint Antoine). – Dimanche 12 juillet 1789. RELÂCHE. – 14 JUILLET 1789. Relâche exigée par le peuple. » Avons-nous besoin d'indiquer les causes de ces deux relâches ? Le dimanche, le ministre Necker était renvoyé ; le 14 juillet, la Bastille était prise.
La Révolution ne fut pourtant pas une
époque malheureuse pour l'Opéra. Ce théâtre
trouva, au contraire, des succès dans les pièces de circonstance et les airs patriotiques.
L'administration, confiée d'abord à Hébert,
fut donnée à Francœur et à Cellerier (1792),
puis à Morel (30 frimaire an II) et à M. Bouet (20
nivôse, même année). Tous les privilèges ayant été détruits, on vit tout
à coup se fonder une foule de théâtres ; soixante-trois salles de spectacle furent construites à Paris,
et, parmi elles, seize représentaient des drames lyriques. La plupart firent de l'argent,
quoique la misère fût grande dans le peuple
et que l'on manquât souvent de pain. Aussi
disait-on :
Il
ne fallait au fier Romain
Les ouvrages représentés dans cette période sont presque tous d'actualité. Lemière
de Corvey mit en musique un article du Journal du soir contenant la sommation de rendre Mayence faite à Custine et la réponse de
ce général. Marchant avait ajusté la constitution sur des airs de vaudeville. On faisait
des symphonies intitulées : la Prise de la Bastille, la Bataille de
Jemmapes, Fabius, Horatius Coclès, Miltiade et Marathon. Le commandant Beaurepaire se tue pour ne pas signer la capitulation de Verdun ; aussitôt
l'Opéra joue : la Patrie reconnaissante ou l'Apothéose de Beaurepaire, par Lebœuf, musique de
Candeille. Puis viennent : le Siège de
Thionville, par Saulnier et Dutil, musique de
Jadin ; la Montagne ou la Fondation du temple de la Liberté, paroles de Desriaux, musique de
Fontenelle ; la Réunion du dix août
ou l'Inauguration de la République française,
paroles de Moline et Bouquier, musique de
Porta ; la Journée du 10 août 1792 ou la Chute
du dernier tyran, paroles de Saulnier et Darrieux, musique de Kreutzer. Le 27 janvier
1793,
six jours après la mort du roi, l'Opéra
donna le Triomphe de la République, paroles
de M.-J. Chénier, musique de Gossec. On vit
ensuite successivement défiler : la Fête de la
Raison ou la Rosière républicaine, par Sylvain Maréchal, musique de Grétry ;
Toulon
soumis, paroles de Fabre d'Olivet, musique de
Rochefort. Tel était le répertoire de l'Opéra à
cette époque, et on peut dire qu'aucun théâtre de Paris ne déployait une semblable activité. Il semblait que, sous le régime populaire,
les artistes de l'Académie nationale de musique dussent racheter les loisirs que leur avait
faits la royauté. Ils sont mis à contribution
pour toutes les fêtes et toutes les cérémonies. Un jour, on joue
extraordinairement en l'honneur des fédérés ; un autre jour, les choristes
figurent au convoi de Mirabeau et à la translation du corps de Voltaire au Panthéon ; le
personnel de l'Opéra reste, en un mot, en
permanence. Plus d'une actrice en vogue dut
se transformer en déesse de la Raison ou de la Liberté, chanter aux
fêtes de l'Etre suprême, aux fêtes funèbres, entonner, à première réquisition, des hymnes nationaux,
supporter sans protestation un accroissement
de travail écrasant. Les contemporains nous
ont transmis les noms des déesses qui furent
prises à l'Académie de musique ; ce sont
Mlles Maillard et Aubry. Ce tableau est suffisant pour donner l'idée de
l'Opéra sous la Révolution. Et nous ne dirons pas (mais on se l'imagine aisément) combien de fois retentirent
sous les voûtes du théâtre de la Porte-Saint-Martin les hymnes pleins de
flamme : la Marseillaise, le Chant du départ, la Carmagnole.
Un décret du 7 mars au III (25 juin 1794)
ayant déclaré propriété nationale le théâtre
que Mlle Montansier avait fait bâtir rue de Richelieu, en face de la
Bibliothèque, l'Opéra quitta la Porte-Saint-Martin et vint
prendre possession de cette salle. Elle fut
inaugurée le 26 juillet 1794, c'est-à-dire la
veille du 9 thermidor. Dès le lendemain,
le spectacle changea ; l'opéra révolutionnaire
avait vécu ; peu à peu se reforma l'ancienne
Académie de musique. Le Directoire ramena
le goût de la mythologie héroïque et l'on vit
alors se succéder : Psyché, Castor et Pollux, le Jugement de Pâris,
Anacréon chez Polycrate, Adrien, Héro et Léandre, Hécube, la Dansomanie, Praxitèle, Pygmalion,
les Horaces, Flaminius à Corinthe, Astyanax, etc.
Peu à peu, la noblesse rentra en France et
revint à l'Opéra ; mais elle n'y pouvait plus
étaler, comme autrefois, son insolente profusion dans des loges où des actrices étaient
appelées pour servir à ses plaisirs. Elle se
trouvait maintenant au parterre, confondue
avec la foule. Qu'on se figure une représentation d'alors : ici, c'est Barras qui entre aux
acclamations de la salle, applaudissant le héros du 13 vendémiaire ; là, c'est Mme Tallien,
la Notre-Dame de Thermidor, que le public
salue de ses sourires admiratifs. Parfois, un
royaliste ricane quand Laïs exécute un chant
patriotique, et le tumulte aussitôt éclate. On
entrevoit dans l'ombre d'une loge le maigre
profil de Bonaparte. Sur la scène, on voit
bien peu d'acteurs nouveaux ; sauf Nourrit père, Lainez, Rode, Rousseau,
Mlles Armand
et Branchu pour le chant, et Deshayes, Saint-Amand, Beaupré, Duport, le rival de Vestris,
Mlles Bigottini et Duport pour la danse, ce
sont toutes les gloires antiques qu'on applaudit. Il faut mentionner à part Garat,
l'incoyable Garat, qui parut quelquefois à l'Opéra
durant cette période. Un jour que son nom
était annoncé sur l'affiche, la recette monta
à 15.000 francs. « Pourtant, dit quelqu'un, ce
Garat n'a qu'un petit filet de voix.
– Tudieu !
répondit-on, vous appelez petit filet celui qui
pêche 15.000 francs d'un seul coup dans la
poche des Parisiens ! »
L'Empire rendit à l'Opéra son ancien titre,
avec la modification inévitable d'Académie impériale de musique. Un nouveau mode de
régie fut adopté : l'empereur nomma le directeur et les employés supérieurs d'administration sur la présentation de son premier
chambellan (1807). Picard eut la direction.
Malgré la protection de Napoléon et sa sollicitude pour tout ce qui touchait à
son Académie de musique, l'Opéra n'eut pas de succès
sous son règne. On ne peut guère citer que
quelques œuvres de Spontini, de Kreutzer,
de Persuis, les ballets remarquables de Gardel, de Duport, de Milou et d'Aumer, qui soient
dignes de ce théâtre national.
Par décret du 13 août 1811, les redevances
abolies en 1789, que payaient toutes les salles
de spectacle à l'Opéra, furent rétablies.
Voici la teneur des principaux articles de ce
décret :
«
Art. 1er. L'obligation à laquelle étaient assujettis tous les théâtres
du second ordre, les petits théâtres, les cabinets de curiosités,
machines, figures, animaux, toutes les joutes
et jeux et en général tous les spectacles, de
quelque genre qu'ils fussent, tous ceux qui
donnaient des bals masqués ou des concerts
dans notre bonne ville de Paris, de payer une
redevance à notre Académie impériale de musique, est rétablie à compter
du 1er septembre prochain. Les panoramas, les cosmoramas, Tivoli et autres établissements nouveaux y sont de même assujettis, ainsi que
le Cirque-Olympique, comme théâtre où l'on
joue des pantomimes. Nos Théâtre-Français,
de l'Opéra-Comique et de l'Odéon sont exceptés de la disposition concernant les théâtres.
Art. 2. Ne sont pas compris dans l'obligation imposée à ceux qui donnent des bals tous
les bals et danses qui ont lieu hors des murs d'enceinte ou dans les
guinguettes des faubourgs, même dans l'enceinte des murs.
Art. 3. Cette redevance sera, pour les bals,
concerts, fêtes champêtres de Tivoli et autres du même genre, du cinquième brut de la
recette, déduction faite du droit des pauvres,
et, pour les théâtres et tous les autres spectacles et établissements, du vingtième de la
recette, sous la même déduction. »
Ces dispositions draconiennes en faveur de
l'Opéra ne furent abolies qu'en 1831, par
Louis-Philippe. Napoléon s'occupa aussi du droit des auteurs et changea les règlements qui existaient depuis 1713. Le droit des auteurs, pour un opéra formant à lui seul un spectacle entier, fut de 500 francs à partager, pour chacune des quarante premières représentations ; il fut fixé à 200 francs pour la quarante et unième représentation et les suivantes. Pour un opéra en un ou deux actes, les droits d'auteur furent de 240 francs à partager, pour chacune des quarante premières représentations, et de 100 francs pour la quarante et unième et les suivantes.
Ces dispositions prises par le gouvernement impérial avaient été inspirées par l'état
financier du théâtre, qui ne pouvait parvenir
à équilibrer son budget. La Restauration
exerça une influence déplorable sur les destinées de l'Opéra et empira
encore sa situation. Le premier soin du nouveau pouvoir,
en 1815, fut naturellement de rendre à cette
salle son ancien titre d'Académie royale de
musique. Après lui avoir donné comme directeur Persuis (1817), puis Viotti (1819), le
célèbre violoniste, on la plaça sous la surveillance de grands
seigneurs, administrateurs inintelligents, qui reçurent le titre de
surintendants des théâtres royaux. Sous l'administration successive de Papillon de La
Ferté, du comte de Blacas, du marquis de
Lauriston, du duc de Doudeauville, du vicomte Sosthène de La
Rochefoucauld, l'Opéra s'endetta de plus en plus. Le déficit, qui
s'élevait à 680.000 francs à la fin de l'Empire,
atteignit 950.000 francs sous la Restauration.
Des pensions étaient accordées à tort et à
travers, sans discernement ; les mutations les
plus onéreuses étaient faites à la légère ; tout
était donné à la faveur.
L'assassinat du duc de Berry, le 13 février
1820,
provoqua la destruction du théâtre de
la place Louvois. Ce prince, poignardé, comme
on sait, sur les marches de l'Opéra, à onze
heures du soir, fut apporté expirant au foyer,
et l'archevêque de Paris, appelé en toute hâte
pour lui administrer les sacrements, refusa
de se rendre dans un lieu si profane, s'il ne
lui était promis qu'on démolirait la salle.
On le lui promit. L'Opéra resta fermé pendant deux mois, et l'on mit
aussitôt à l'étude un projet de construction. C'est à ce
moment qu'on choisit le vaste emplacement
de l'hôtel Choiseul, rue Le Peletier, pour y élever, en 1821, une salle
qui devait être provisoire et qui dura jusqu'au 28 octobre 1873.
Quoique bâtie légèrement, toute de bois et
de plâtre, cette salle ne coûta pas moins de 1.800.000
francs. L'ouverture eut lieu le 16 août 1821. Admirablement disposée, parfaitement
sonore, elle vit s'accomplir les révolutions musicales les plus
étonnantes et entendit les œuvres des plus merveilleux génies qui aient illustré la musique dramatique.
L'administration de la nouvelle salle fut
donnée à M. Habeneck, qui la garda trois
ans ; elle passa ensuite à M. Duplanty et à
M. Lubbert. Le vicomte Sosthène de La Rochefoucauld était alors surintendant des théâtres et ne se distinguait que par ses tentatives ridicules, sérieusement faites, pour transformer l'Académie de musique en une école
de morale. L'Opéra sut du moins s'attacher des
artistes du premier mérite. En 1822 débuta Adolphe Nourrit, admirable
ténor, bien supérieur à son père, et qui ne put fournir qu'une trop
courte carrière. A côté de lui étaient Dabadie, Dupont, Mmes Grassari, Paulin-Lafeuillade, Cinti-Damoreau, etc. On admirait les
danseurs Paul, surnommé l'aérien, Coulon
fils, Mme Noblet, Montessu, Legallois, Julia, etc. Quelques années plus tard, en 1827,
débutait Mlle Marie Taglioni, charmante danseuse, dont le nom est devenu européen. « Sa
grâce naïve, dit Castil-Blaze, ses poses décentes et voluptueuses, son extrême légèreté,
la nouveauté de sa danse dont les effets semblaient appartenir aux
inspirations de la nature, au lieu d'être les résultats des combinaisons
de l'art et du travail de l'école, produisirent une sensation très vive
sur le public. » Ce fut avec le concours de tels artistes que Rossini, ce maître de génie, vint faire admirer l'aimable et facile musique de sa première manière. Aidé par le directeur, M. Lubbert, admirateur éclairé et enthousiaste de la musique italienne, il fît représenter en quelques années plusieurs œuvres magnifiques, et enfin Guillaume Tell. C'est aussi à cette époque, un peu avant 1830, qu'Auber donnait la Muette de Portici.
Le nouveau directeur se mit à l'œuvre et
fit preuve d'habileté. Il diminua (c'est lui qui
nous l'apprend dans ses intéressants Mémoires) le nombre des loges de six places et multiplia celles de quatre places, dont le prix
réduit pouvait mieux convenir à la fortune et
aux habitudes d'économie de la nouvelle cour
bourgeoise. En un mot, il sut faire de l'Opéra une excellente opération
commerciale, si excellente même que, en 1834, un député,
M. Charlemagne, effrayé par les succès du
nouveau directeur, s'écria à la tribune : « Où est la nécessité qu'un
directeur d'Opéra s'enrichisse au bout de trois ans ? Pourquoi ne
mettrait-il pas dix ans à faire fortune ? Serait-ce se montrer trop rigoureux que de le
réduire à la condition d'un agent de change
ou d'un banquier ? » La protestation était plaisante et n'eût cependant été que juste si le
député eût ajouté que ce même directeur ne
pourrait pas se ruiner dans le même espace
de temps et qu'il serait toujours indemnisé
de ses pertes.
Les premiers opéras joués après l'entrée en
fonction de M. Véron furent le Philtre et le Serment d'Auber. Il donna ensuite
Robert le
Diable de Meyerbeer (22 novembre 1831).
Cette œuvre fut supérieurement exécutée par
Nourrit, Levasseur, Lafond, Mmes Damoreau, Dorus ; l'orchestre était dirigé avec une
extrême habileté par Habeneck. Dans les
ballets, on vit Mmes Noblet, Montessu, Dupont, Taglioni, Julia et M. Perrot. Ciceri
avait fait de magnifiques décors, Duponchel
dirigé la mise en scène, Coralli organisé la
danse. Ainsi représenté, Robert le Diable
obtint un succès éclatant et prolongé et fit la
fortune du directeur. Nous ne nous étendrons pas davantage sur cette
brillante administration, qui eut le bonheur d'avoir à représenter
des œuvres du premier ordre, jouées par des
interprètes hors ligne : la Sylphide, ballet ; la Tentation, autre ballet-féerie ;
Gustave III ou le
Bal masqué d'Auber; Ali-Baba de Cherubini,
et la Juive. La Juive, un triomphe, couronna
cette administration qui, en somme, avait été
souvent heureuse et toujours habile. Ajoutons enfin que, sous la direction Véron,
Armide et la Vestale furent reprises avec éclat
et que Don Juan fut traduit et joué dans
son entier, avec Mmes Damoreau, Dorus et
Falcon, MM. Nourrit et Levasseur, pour interprètes.
M. Véron céda ses pouvoirs à M. Duponchel, qu'il s'était adjoint, quelque temps avant
sa retraite, comme coadministrateur. L'avènement de M. Duponchel fut signalé par un
grand succès : le 29 février 1836 eut lieu
la première représentation des Huguenots.
L'Opéra donna ensuite la Esmeralda de
Mlle Louise Bertin, dont Victor Hugo avait consenti à écrire le poème,
faisant par amitié, ainsi que nous l'apprend le biographe
anonyme témoin de sa vie, ce qu'il avait toujours refusé par intérêt. En effet, Meyerbeer
avait fait en vain des démarches très pressantes auprès du poète afin d'en obtenir un
scénario. Stradella de Niedermeyer succéda
à l'œuvre de Mlle Bertin, sans relever la fortune du théâtre. C'est à ce moment que parut Duprez.
Il débuta dans Guillaume Tell, à une reprise
et on sait son triomphe. Puis il imprima aux diverses œuvres du répertoire
cette grandeur d'interprétation que nul depuis lui n'a pu atteindre. Une nouvelle étoile,
Mme Stoltz, parut le 5 mars 1838. La même
année fut représenté Guido et Ginevra d'Halévy, qui n'obtint qu'un succès d'estime et
auquel succéda bientôt Benvenuto Cellini,
opéra de Berlioz. Il n'est pas, au théâtre, un
second exemple de chute aussi éclatante. Les
autres œuvres que monta M. Duponchel furent : le Lac des Fées d'Auber, la
Xacarilla
de Marliani, le Drapier d'Halévy et, enfin,
les Martyrs de Donizetti.
Le 1er juin 1840, M. Léon Pillet succédait
à M. Duponchel et, comme son prédécesseur,
il eut un début très heureux. La Favorite de
Donizetti (2 décembre 1840) fut un succès immense. Jamais peut être
pièce ne fut si richement montée, sans parler de la distribution des rôles, confiés à Mme Stoltz, à Duprez,
à Barroilhet et à Levasseur. En 1841, un nouveau ténor surgit à l'horizon
: Mario se produisit avec tant de charme dans le rôle de Robert,
que les Italiens l'enlevèrent immédiatement
à l'Opéra. Après une très brillante reprise de Don Juan, où Barroilhet se place au premier
rang, après la réussite du charmant ballet
de Giselle, de Th. Gautier, où Carlotta Grisi
obtient tous les suffrages, Halévy donne une
nouvelle œuvre, la Reine de Chypre, où
Mme Stoltz, Duprez et Barroilhet continuent
à soutenir leur réputation. Deux ans après
la Reine de Chypre, le même compositeur
donne Charles VI, dont la vogue prend presque les proportions d'un événement politique et nécessite notes sur notes diplomatiques
au ministère Guizot. A partir de ce moment, M. Pillet voit décliner sa fortune.
Don
Sébastien, la dernière œuvre de Donizetti, est le dernier succès de
cette direction. Le Lazzarone, Richard en Palestine, Marie Stuart,
l'Etoile de Séville, Lucie de Lammermoor, le
Roi David (le début de Mermet, l'auteur futur
de Roland à Roncevaux), l'Ame en peine et Robert Bruce ne ramenèrent pas plus la foule
dans la salle que l'argent dans les caisses. En
même temps que Mme Stoltz, fatiguée par un
travail incessant, était forcée de prendre sa
retraite, à la suite d'une orageuse représentation de Robert Bruce, M. Léon Pillet résignait ses fonctions
entre les mains de MM. Duponchel et Roqueplan, auxquels il laissait une
dette s'élevant à 400.000 francs.
M.Duponchel s'adjoignit M. Nestor Roqueplan, homme d'esprit, peu administrateur,
mais plein de vues neuves et qui ne pouvait
manquer de rendre de grands services.
Mme Stoltz laissait, néanmoins un vide difficile à combler. Mais Duprez restait, et, avec
Duprez, rien n'était désespéré. Le grand artiste trouva encore une superbe création
dans la Jérusalem de Verdi. Le ballet de la Fille de Marbre, dansé par Cerrito et Saint-Léon, fut vivement applaudi. Tout semblait
présager un avenir prospère, quand la révolution de février éclata.
L'Opéra subit alors le sort commun à tous
les théâtres et dut sacrifier à l'actualité. La République fit pulluler
les cantates, les couplets, les pièces de circonstance. L'Académie
nationale de musique suivit le mouvement et
donna, le 5 mars 1848, c'est-à-dire dix jours
après le 24 février, les Barricades de 1848,
paroles de MM. Brisebarre et Saint-Yves,
musique de MM. Pilati et Gauthier.
La révolution avait suspendu le succès de
Carlotta Grisi dans Grisélidis, charmant ballet d'Adolphe Adam ; la fusillade de juin
étouffa l'Eden de Félicien David. Néanmoins
l'année 1848 vit encore, après l'apaisement
des troubles, Nisida, par Mlle Plunkett, la Vivandière de Pugni,
Jeanne la folle de Clapisson. 1849 réservait à l'Opéra un grand
événement.
Le 16 avril 1849 eut lieu la première représentation du
Prophète, le troisième chef-d'œuvre de Meyerbeer, dont l'apparition fut
saluée avec un enthousiasme presque religieux. Ajoutons que, lors de la création,
Mme Viardot prêta l'éclat de son magnifique
talent au rôle admirable de Fidès, que l'Alboni chanta plus tard avec un égal succès,
tout en l'interprétant d'une autre manière.
Roger, émigré de l'Opéra-Comique, consacra
sa réputation dans le rôle de Jean de Leyde et promettait aux
dilettantes un digne successeur de Duprez et de Nourrit, lorsqu'un
horrible accident vint briser sa carrière.
Le 6 décembre 1850, l'Enfant prodigue
d'Auber succède au Prophète. Puis viennent
le Démon de la nuit de Rosenhain, Sapho, la
première partition de Gounod, dans laquelle
Mme Viardot fait valoir les grandes qualités
du nouveau venu qui devait monter si haut.
L'Alboni, dans la Corbeille d'oranges d'Auber, attire Paris entier, et, la même année,
Halévy, longtemps silencieux, fait jouer le Juif errant.
Le 2 décembre 1852, l'Opéra reprend son
titre d'Académie impériale du musique. L'année 1853 voit passer : le ballet
d'Orfa, Luisa
Miller, de Verdi, qui sert de début à Mme Bosio ; la Fronde, de Niedermeyer ; le
Maître
chanteur, de Limnander ; Jovita, ballet de Labarre, où se lève une nouvelle étoile, la Rosati.
C'est la dernière victoire de M. Roqueplan, qui donne sa démission le 30 juin 1854 ;
Cette période de l'histoire du théâtre (1854-1870)
fut marquée par les Vêpres siciliennes,
de Verdi ; le ballet du Corsaire, dans lequel
luttaient deux étoiles de la danse, la Rosati
et Mme Ferraris ; le Trouvère, de Verdi ; la Magicienne, d'Halévy ;
Herculanum, de Félicien David ; Roland à Roncevaux, de Mermet ;
l'Africaine, de Meyerbeer, si longtemps attendue ; Don Carlos, de Verdi ;
Hamlet, d'Ambroise Thomas ; Faust, de Gounod, et enfin Erostrate, de Reyer. Roger et Mario, sur
leur déclin, Gueymard, Faure, Obin, Bonnehée, Mmes Viardot, Alboni,
Sophie Cruvelli, Tedesco, Miolan-Carvalho, Nilsson et
Marie Sass, pour l'opéra ; Saint-Léon, Mérante, Mlles Cerrito, Rosati, Ferraris, Marie
Vernon, Fioretti, Fiocre, pour la danse, ont surtout brillé à cette
époque. Le luxe des décorations et de la mise en scène n'avait jamais été poussé plus loin, et les ballets eurent
souvent sur les opéras une prépondérance
assez marquée. En 1871, M. Perrin ayant été nommé administrateur du Théâtre-Français par le gouvernement, l'administration de l'Opéra fut confiée à M. Halanzier (8 juillet), avec le titre d'administrateur-entrepreneur. Les débuts du nouveau directeur furent signalés par un terrible accident. Au moment où il se disposait à monter une nouvelle œuvre, Jeanne Darc, de M. Mermet, un incendie éclata dans la salle de la rue Le Peletier. En quelques heures, ce théâtre, où l'on avait entendu tant de chefs-d'œuvre, devint la proie des flammes. M. Halanzier demanda aussitôt et obtint d'installer provisoirement l'Opéra à la salle Ventadour, en faisant alterner ses représentations avec celles des Italiens jusqu'à ce que le splendide monument construit par Ch. Garnier pût ouvrir ses portes et donner enfin un asile durable au théâtre qui a jusqu'à présent habité tant de salles toujours détruites par des incendies.
(Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, 1876)
Le nouvel Opéra de Paris fut inauguré le 5 janvier 1875, sous la direction de M. Halanzier, à qui M. Vaucorbeil succéda le 16 mai 1879. A la suite du décès de M. Vaucorbeil, survenu en novembre 1884, la direction de l'Opéra fut confiée à MM. Ritt et Gailhard. La nouvelle direction organisa, dès 1885, des représentations populaires à prix réduits. De 1875 à l'Opéra a eu plusieurs chefs d'orchestre. En 1877, le pupitre fut remis à M. Charles Lamoureux par M. Deldevès, qui avait, en 1872, succédé à M. Georges Hainl et que sa santé força à résigner ses fonctions. M. Lamoureux occupa le poste pendant deux ans. Le 21 décembre 1879, il fut remplacé par M. Altès. A la retraite de celui-ci (1887), M. Vianesi fut nommé chef d'orchestre. Parmi les principaux artistes qui se sont fait applaudir, de 1875 à 1889, sur notre première scène lyrique, il convient de citer, pour le chant : MM. Faure, que l'on n'a pas remplacé, Duc, les frères de Reszké, Boudouresque, Gailhard, Lassalle, Salomon, Sellier, Bosquin, etc. ; Mmes Miolan-Carvalho, Krauss, Daram, Caron, Richard, Lureau-Escalaïs, etc. ; pour la danse : Mmes Rosita Mauri, Sanlaville, etc.
(Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, 2e supplément, 1888)
|
|
les Directeurs de l’Opéra
Le privilège conféré à M. Gailhard, directeur du Théâtre national de l'Opéra, expirant d'ici quelque temps, une certaine effervescence se manifeste actuellement dans divers journaux pour ou contre le maintien du directeur actuel. Encore qu'il ne nous convienne pas de participer au débat, où souvent la partialité semble empiéter sur la saine raison, il nous a semblé curieux d'esquisser pour nos lecteurs le roman qu'est l'histoire véritable des Directeurs qui se sont succédé à l'Académie royale, impériale ou nationale de musique. Cela, nous le répétons, n'est qu'une esquisse ; dix volumes ne suffiraient point à épuiser la matière. Tel qu'il est, cet article, tout en instruisant et divertissant le public, peut jeter quelque lumière dans le débat aujourd'hui engagé, prématurément d'ailleurs.
Rebel, qui, de 1749 à 1767, fut deux fois directeur de l'Opéra
Il n'est que justice de faire, au début de cet article, honneur à Carpentras du premier opéra français. C'est, en effet, dans cette ville — alors capitale du Constat-Venaissin — que fut représentée, le 1er février 1646, une œuvre de l'abbé de Mailly : Akiba, roi du Mogol, qui est le premier essai d'opéra français. L'initiative en revient au cardinal-évêque de cette cité, Alessandro Bichi. La place nous est trop mesurée pour que nous puissions dire par le menu les tentatives qui aboutirent à la fondation, en 1669, de l'Académie royale de musique. Voici apparaître le marquis de Sourdéac, homme extraordinaire, exercé à tous les métiers. L'abbé Perrin faisant les vers, Gilles et Cambert, organiste de Saint-Honoré, composant la musique, lui, marquis de Sourdéac, s'improvisant machiniste, des représentations d'opéra furent données dans son hôtel, sis à Paris, 10, rue Garancière. Certaines de ces représentations furent gratuites, cadeau de six cents billets étant fait aux amateurs. Sourdéac organisa aussi des représentations en son château de Le Neubourg ; c'est là que parut, en 1660, la Toison d'Or, mélodrame à grand spectacle, à « machines », prélude brillant de l'opéra français. L'établissement de notre Académie de musique fut provoqué par la représentation de la Pastorale en musique, paroles de l'abbé Perrin, musique de Cambert, qui eut lieu dans la maison de M. de La Haye, sise à Issy. On voit combien il est injuste d'avoir fait à Lulli honneur de la création de l'opéra français. Il revient au parolier Perrin, membre de l'Académie française, au compositeur Cambert, et au machiniste Des Rieux, marquis de Sourdéac. Les lettres patentes qui fondaient l'Académie royale de musique furent données à Perrin, le 28 juin 1669, au château de Saint-Germain-en-Laye. Perrin s'adjoignit comme financier un certain Champeron. Ici, commence une histoire souvent extravagante, qui pourrait se résumer en quelques mots plutôt catégoriques : vicissitudes, attaques, faillites, arbitraire. Dès la première direction (Perrin-Cambert-Sourdéac-Champeron), l'Académie royale de musique est l'objet d'attaques violentes de la part de l’Italien Lulli. Quand celui-ci voit que la seule œuvre Pomone (premier opéra français représenté devant un public nombreux) a valu rien qu'à Perrin 30.000 livres de bénéfices, il ne pense plus qu'à parvenir à la direction de l'Opéra ; la faveur et les intrigues de la Montespan l'y amenèrent. Il parvint à ses fins alors que Perrin allait monter l'Ariane de Cambert, Cambert fit représenter son Ariane à Londres. Malgré le succès de son œuvre, il mourut de chagrin (1677). Lulli, dont les procédés furent du reste unanimement honteux (se rappeler ses menées contre la veuve de Molière et ses acteurs dès la mort du grand poète), essuya, lui aussi, force attaques ; dans un factum paru en 1676, sous la signature du parolier Guichard, il est couvert d'injures. Sa direction fut toute de courtisanerie. Il abandonna l'hôtel de Nevers, où s'était établi Perrin, fit élever un théâtre au Jeu de Paume de Bel-Air près du Luxembourg, puis il alla au Jeu de Paume de la Bouteille ; quand Molière fut mort, il obtint de Louis XIV la salle du Palais-Royal, où l'Opéra resta jusqu'en 1781. Durant sa direction (15 novembre 1672-22 mars 1687, date de sa mort), Lulli ne fit jouer que ses œuvres. Voici les titres des principales : les Fêtes de l'Amour et de Bacchus, Cadmus et Hermione, Alceste, Thésée, Atys, Psyché, Proserpine, Roland, Amide, etc. Lulli a écrit la musique de vingt-cinq ballets. A cela Lulli s'acquit 60.000 livres environ de bénéfices annuels. Voici imminer l'ère de constante faillite, coupée, à de rares intervalles, de regains heureux. Francine, maître d’hôtel du Roi, gendre de Lulli, lui succède. Il réalisa 30.000 livres de bénéfices par an, d'abord ; puis on constate diminution progressive des revenus. En 1699, on adjoint à Francine, Dumont, écuyer du Dauphin : titre qui, sans doute, le faisait compétent en musique. Les recettes baissent encore. En 1704, le payeur de rentes Guyenet est nanti du privilège. Son déficit s'élevait à 380.780 livres quand la mort lui vint épargner d'aviser à payer ses dettes (1713). Francine et Dumont rentrent en scène, et les créanciers du payeur de rentes s'unissent à eux pour l'exploitation du privilège. En 1715, le Roi se fait représenter par le ministre de sa maison. En 1716, il se fait représenter par le duc d'Antin et M. de Landivisiau, maître des requêtes ; puis, en 1717, par Landivisiau, seul. Une assez jolie anarchie, qui dura longtemps, régnait alors à l'Opéra. On était forcé de poser des sentinelles dans les couloirs afin d'interdire aux grands seigneurs, noblement ivres, l'accès des loges d'actrices. En 1728, Destouches, musicien, est nommé. Voici les temps extravagants où le prince de Carignan représenta le Roi à l’Académie royale de musique. En 1731, Gruer, financier, achète la direction 300.000 francs. Cependant, que grâce aux billets de Law, tout le monde s'acquittait facilement de ses dettes, on avait omis de payer les dettes du pauvre Opéra. Les 300.000 francs de Gruer y furent, insuffisamment d'ailleurs, employés ; fin 1731, Gruer fut révoqué.
Francœur, qui, de 1749 à 1767, fut deux fois directeur de l'Opéra
Le président Lebeuf et Lecomte (de Saint-Gilles), qui lui succédèrent, éprouvèrent personnellement qu'il en pouvait coûter cher alors de mécontenter une danseuse aux charmes influents. Ayant refusé une augmentation à la ballerine Mariette,... protégée du prince de Carignan, ils furent exilés par lettre de cachet. En 1733, le prince de Carignan se refusant à payer au sieur Eugène-Armand de Thuret, capitaine au régiment de Picardie, écuyer du feu duc de Gesvres, une pension de 10.000 livres qu’il lui devait verser en sa qualité d'héritier du feu duc, lui découvre des aptitudes à gouverner l'Opéra et le bombarde directeur de ce terrible lieu de délices. La pension fut mise à la charge du théâtre, qui continua à la payer à Thuret quand celui-ci eut résigné ses fonctions (1744). Nous avons dit l’autorité despotique de Mlle Mariette. Voici pour le moins aussi bien : En 1735, les destinées de l'Opéra furent, on peut dire, à la discrétion de Mlle Le Maure, dont la voix était merveilleuse. Ses caprices passaient toute imagination. Ainsi, jouant Jephté, elle quitte la scène au milieu de la représentation. Maurepas la fit enfermer pour cela au Fort-L'Evéque, où elle subit une courte captivité. Elle se refusa, à sa libération, à reparaître au théâtre. Un financier, Berger, est nommé : honneur qui lui valut 400.000 livres de dettes et des chagrins dont il mourut. Grâce à la protection de la princesse de Conti, Tréfontaine, qui s'associa quelques spéculateurs de son acabit, obtint le privilège. En seize mois, au bout desquels ils furent dépossédés, ils réalisèrent un déficit — Castil-Blaze, auquel nous empruntons souvent pour cet article, dit ironiquement : « apparent » — de 252.909 livres. C'est alors que Mme la marquise de Pompadour, qui, semble-t-il, aima les arts, eut cette idée congrue : qu'elle s'accommoderait volontiers des sommes que Louis XV payait à l'Opéra sur sa cassette. Elle contraignit la Ville de Paris à assumer le privilège de l'Opéra, que surveillerait d'Argenson, ministre du département de Paris, son âme damnée. La Ville, à qui on ne laissait pas le choix, accepta ; et, pour son compte, les musiciens Rebel, François et Francœur, dirigèrent l'Opéra. L'honneur leur revient d'avoir monté les œuvres de Rameau, malgré l'opposition fréquente de d'Argenson. Un autre musicien, Royer, les remplace ; il meurt en 1755. Les capitalistes Bontems et Levasseur prennent la suite de ses affaires. Ils firent si bien que, cette année, l'Opéra devait 1.200.000 livres que la Ville paya. Les honneurs étant charge lourde, elle sollicita le roi afin que licence lui fût donnée de faire exploiter son privilège par Rebel et Francœur, opérant à leur compte. Signalons, de 1755 à 1764, une véritable pénurie de ténors. Un premier sujet de l'Opéra a pris une grande importance. Qu'on en juge : une Polonaise et une Française se battent en duel en l’honneur du baryton Chassé.
l'auteur dramatique Picard, directeur de l'Opéra (1807-1815)
Cependant, que pensait-on de l'Opéra ? Savourez : J.-J. Rousseau en fait une description grotesque dans Julie ; Bachaumont lui est plutôt dur. Et Voltaire écrit : « L'Opéra n'est qu'un rendez-vous public où l'on s'assemble certains jours sans savoir pourquoi ; c'est une maison où tout le monde va, quoiqu'on pense mal du maître et quoiqu'il soit assez ennuyeux. » (Lettre, 1732). Puis : « Vous ne me parlez point, mes anges, de l'incendie de l'Opéra : c'est une justice de Dieu ; on dit que ce spectacle était si mauvais qu'il fallait tôt ou tard que la vengeance divine éclatât. » (Lettre, 1763). Notons successivement à la direction de l'Opéra : Berton et Trial, musiciens (1767) ; Berton, Dauvergne, Trial, musiciens, et Joliveau, parolier (1769) ; Rebel, Berton, Dauvergne, Joliveau (1772) ; Berton, Dauvergne, Joliveau (1775). En 1776, la Ville cède son privilège à un groupe de capitalistes pour le compte desquels Berton est directeur. En 1778, apparaît De Vismes du Valgay, dont la direction fut artistique, ce qui lui valut force mécomptes. Il demeure devant la postérité l'homme avisé, compréhensif, souvent vaillant, à qui l'on doit la représentation des chefs-d'œuvre de Gluck. En 1780, la Ville, lasse de dettes, répudie son privilège. Un arrêt du 17 mars l'attribua au secrétaire d'Etat ayant le département de la Ville de Paris, représenté par l'intendant des Menus-Plaisirs du Roi. Sous cette autorité supérieure, Berton est à nouveau directeur. Il meurt le 4 mai. Dauvergne lui succède. En 1782, l'Opéra est sans directeur. Les acteurs se partagent les bénéfices. Un comité, élu par eux, administre le théâtre. En 1785, Dauvergne et Louis Francœur, neveu du ci-dessus nommé, dirigent avec l'aide du Comité.
le musicien Viotti, directeur de l'Opéra (1819-1821)
La Révolution vient d'éclater. La Commune de Paris reprend l'Opéra dans ses attributions et le fait administrer par un comité de régie composé de La Suze, chef du chant, Gardel, chef de danse, Rey, chef d'orchestre. L'Opéra va connaître d'ineffables gloires. Chaumette, Hébert, Henriot, Danton et J. J. Le Roux, membres de la Commune de Paris, sont chargés de le surveiller et de le régir hautement. Sous la surveillance des commissaires ci-dessus désignés. Louis Francœur assume la fonction de régisseur général (1791). Un tome épais ne suffirait pas à contenir la relation de toutes les extravagances dont l'Opéra est alors le lieu. On y boit ferme, l'obèse général Henriot ayant constamment la gorge sèche. Il est paternel, d'ailleurs, le vin échauffant généreusement les cœurs. Goûtez cette miette de harangue : « Je monte dans ta loge, citoyen ténor. Veille à ce que j'y trouve du vin ». L'Opéra retentit d'immenses spectacles civiques. On y chante les cantates républicaines de Gossec, de Cherubini, de Méhul, etc. Recettes fabuleuses : un soir, on encaisse 120.000 francs ; oui, mais on avait payé en assignats ; or, ceux-ci n'ayant bientôt plus cours, on juge de la déconvenue de l'Opéra. En 1792, la Commune cède le théâtre à Louis Francœur et à l'architecte Cellerier, dirigeant à leurs risques. En 1792, elle le leur reprend pour le donner aux acteurs, s'administrant eux-mêmes sous la surveillance du commissaire du gouvernement Bralle. Après dix- huit mois de gestion, le déficit s'élevait à 165.624 francs. En 1795, le ministre de l'Intérieur met l'Opéra dans son département ; un certain de Mirbec le représente, lequel avait été commissaire du roi à Saint-Domingue. Nommés par lui, se succèdent comme directeurs ou administrateurs : La Chabeaussière, Watteville et l'acteur d'opéra-comique Caillot (1795) ; Louis Francœur, Baco et Denesle (1798) ; De Vismes et Bonnet de Treiches (qui avait été député à la Convention sous le nom de Bonet fils) (1799) ; Bonet (1800) ; Cellérier (1801). En 1802, le Premier Consul mit l'Opéra sous la surveillance d'un des préfets du Palais. Sont directeurs : 1802, Morel, parolier, et Lemoyne, musicien. En 1803, rentrée de Bonet de Treiches. En 1807, Napoléon donne la surintendance de l'Opéra à son premier chambellan. L'auteur dramatique Picard est nommé directeur. Les Bourbons étant revenus, le ministre de la Maison du Roi prend l'Opéra dans ses attributions. 1814 : Exeunt les Bourbons ; cent jours après, lesdits étant revenus, le distingué Papillon de la Ferté est nommé directeur général pour le ministre. Se succèdent à la direction effective de l'Opéra : 1815. Choron et Persuis, musiciens ; 1817. Courtin et Persuis ; 1818. Persuis ; 1819. Viotti ; 1821. Habeneck ; 1824. Duplantys, qui, précédemment, était ... inspecteur d'un dépôt de mendiants ; 1828. Lubbert. A cette époque, l'Opéra absorbait 1.150.000 francs de plus qu'il ne produisait. Ce que constatant, le ministre de la maison du roi abandonne la régie de l’Académie de Musique et en accorde le privilège au docteur Véron, directeur de la Revue de Paris (1831). Il dura tant bien que mal quatre ans, montant 51 actes nouveaux, au nombre desquels Robert le Diable et la Juive. L'architecte Duponchel lui succède, montant 60 actes nouveaux, dont les Huguenots. A sa dernière année de direction (1840), il s'adjoignit Edouard Monnais, homme de lettres. En 1841, vient M. Léon Pillet. Il régna six ans, favorable à Halévy, dont il fit représenter la Reine de Chypre et Charles VI ; à Donizetti, dont il joua la Favorite et Lucie. En 1847, revient Duponchel, suivi de Nestor Roqueplan, directeur du Journal de Paris, homme considérable par le talent et le nez. Il termina seul cette direction, montant 83 actes nouveaux, dont le Prophète.
M. Pierre Gailhard, directeur de l'Opéra depuis 1884
De 1854 à 1856, s'essaye M. Crosnier. De 1856 à 1862, domine M. A. Royer qui monta notamment le Trouvère et Tannhäuser. Emile Perrin lui succède et dure jusqu'à la Commune (1871). Tous ces directeurs avaient été plutôt abondamment attaqués. Halanzier, qui accepta, après la Commune, une succession difficile, et se maintint jusqu'en 1879, fut l'objet de libelles passionnés. Les attaques contre lui furent telles qu'en 1877 il intentait à la Presse un procès en diffamation. Le rédacteur responsable était notre confrère Léon Kerst, l'actuel critique dramatique du Petit Journal. Celui-ci avançait, entre autres aménités, que le déficit s'élevait à 693.392 fr. 84, et mettait au défi tout homme sérieux d'accepter la succession de M. Halanzier. Cet « homme sérieux » se présenta, le 1er novembre 1879, en la personne de M. Vaucorbeil, qui ne fit point fortune, dit-on. Il mourut le 2 novembre 1884. M . Ritt, ancien directeur de l'Opéra-Comique et de la Porte-Saint-Martin, et M. Gailhard, basse chantante justement célèbre du même Opéra, assumèrent la direction le 1er décembre 1884. Leur administration fut heureuse, ce que la presse s'avisa souvent de contrebalancer par des dénigrements passionnés. C'est pour y répondre dignement que MM. Ritt et Gailhard montèrent Lohengrin et appelèrent au pupitre de chef d'orchestre Charles Lamoureux. « Brûlons » ce qui est encore de l'actualité. Le 1er janvier 1892, M. Bertrand, qui venait des Variétés, est nommé directeur de l'Opéra. Il s'adjoint M. Campocasso, directeur de la scène, et M. Edouard Colonne, chef d'orchestre. Il fit grandement les choses, organisant des représentations populaires nombreuses, montant avec un luxe inouï la Salammbô de Reyer. Cela lui fut irrémédiablement dispendieux. Le 25 mars 1893, l'association Bertrand-Campocasso est rompue d'un commun accord, et remplacée par la raison artistique et commerciale Bertrand-Gailhard. Un des premiers actes de cette nouvelle direction fut la mise à la scène de l'Opéra de la Walkyrie ; et elle réalisa des merveilles, nous donnant le meilleur Siegmund (Van Dyck) qui soit, le meilleur Wotan (Delmas) et la meilleure Brunnhilde (Mme L. Bréval). Elle fut laborieuse, et l'art lui doit l’imposition définitive, triomphale, au public parisien, d'autres œuvres de Wagner. M. Bertrand étant mort le 31 décembre 1899. M. Gailhard est depuis lors seul directeur de l'Opéra ; M. Capoul, rappelé par lui de New York, l'assiste comme directeur de la scène. Notre répugnance à toute polémique nous fait arrêter ici l'histoire romanesque de l'Opéra, ce temple où Plutus, a-t-on pu constater, ne s'est manifesté que très rarement.
à g. charge d'Halanzier, directeur de l'Opéra (1871-1879) ; à dr. charge de Vaucorbeil, directeur de l'Opéra (1879-1884)
Mais, sans participer en rien au débat, on se doit de faire acte de justice. Or, ce n'est être que juste que de louer dans M. Pierre Gailhard un travailleur acharné, un artiste ayant au point le plus éminent le sens du théâtre. Ayant assumé la direction d'un théâtre où tout effort est contrarié par l'excessive capacité de la salle, par une déplorable acoustique, il a fait tout le possible. On peut faire facilement une critique de l'Opéra, mais il faut pour cela oublier que ce théâtre ne se prête guère qu'aux représentations d'œuvres exigeant une mise en scène considérable. Oublier cela n'est pas possible, à moins de céder à la plus blâmable partialité. Honnêtement, il faut reconnaître que M. Gailhard a travaillé sans relâche et qu'il a travaillé pour l'Art.
(Félicien Grétry, Musica, décembre 1905)
à g. caricature de Nestor Roqueplan, directeur de l'Opéra (1847-1854) ; à dr. le Docteur Véron par Dantan (Véron fut directeur de l'Opéra, 1831-1835)
|
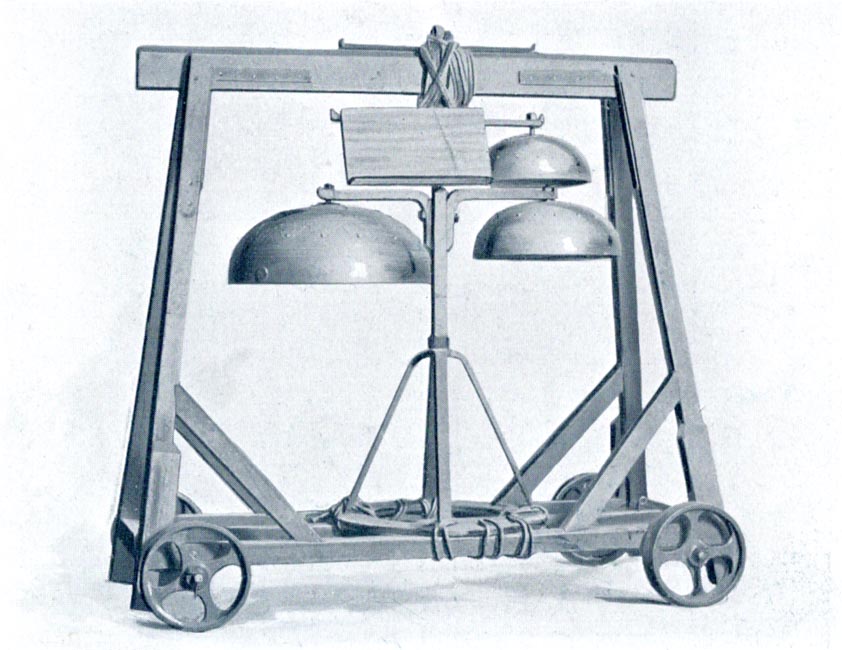
le Codonophone, instrument servant à imiter les cloches dans les coulisses à l'Opéra de Paris [revue l'Opéra, avril 1904]
|
Mlle Jeanne Delsaux, qui tire ici avec Mlle Yvonne Thomas, sujet de quadrille comme elle, est une gloire prochaine à la fois de l'escrime et de la danse. On la dit désignée pour le premier quadrille et promise au rang d'étoile. Elle pare prime sur le fer de Mlle Yvonne Thomas. Celle-ci s'est fendue avec une correction et une franchise qui feraient honneur à un vieil escrimeur.
Sait-on qu’il y a à l’Opéra, comme au Conservatoire, des cours d'escrime ? Ceux que M. Gailhard a établis sont ouverts aux pensionnaires, qu'ils appartiennent à la danse ou au chant. Il va de soi qu'il ne s'agit pas de faire des simples rats, ou même des sujets du premier quadrille, des Mira et des Maupin. Mais on a cru que la pointe et les pointes iraient de compagnie. Elles sont pareillement des disciplines du mouvement. L'escrime apprend la précision du geste, la netteté de l'effort ; elle élimine le mouvement inutile. Elle donne à la démarche une simplicité et une beauté. Aussi la pratique-t-on à l'Opéra comme un exercice du mouvement. On est sévère sur la pureté du jeu, la détente et la fixité. On a surtout soin de développer pareillement les deux mains. Et l'art mortel du fleuret, par un aimable échange, ne sert ici qu'à faire une jolie taille, à quoi il excelle. (la Vie heureuse, février 1905)
Les leçons se prennent dans la salle des Fanfares, toute simple et parée seulement de fleurets et de masques. M. Millet croise le fer de deux jeunes rats. Celles-ci et leurs camarades font des armes dans le costume même de leurs exercices de danse. Elles ont seulement ôté leur jupe de tarlatane et revêtu un plastron.
|

M. Millet, maître d'armes et ses élèves dans la salle d'escrime de l'Opéra en 1904
|
L’Opéra. — A propos de la nouvelle direction.
A l'occasion du choix fait par le ministre de la nouvelle direction de l'Opéra, bien des avis ont surgi au sujet de ce qu'il conviendrait d'entreprendre pour obtenir une gestion parfaite. On sait assez combien, chez nous, dès qu'il s'agit de théâtre, les langues se délient facilement. Des discussions s'élèvent de toute part. Chacun donne son opinion, chacun fait valoir ses préférences. Cependant, le point le plus important me paraît quelque peu négligé. Il me semble qu'on perd de vue le véritable rôle qui appartient à notre Académie de Musique, celui de musée. Je désirerais le démontrer en examinant, tour à tour, sa principale fonction, son répertoire, l'intérêt des œuvres représentées, surtout au point de vue de l'influence qu'elles peuvent avoir sur l'avenir de notre Ecole musicale française. Et, d'abord, à quelle nécessité répond l'Opéra, quelle est son utilité ? Il est incontestable que le but idéal à poursuivre est de mettre à même les artistes, les dilettantes, les amateurs d'entendre les chefs-d'œuvre de la musique de tous les temps et de tous les pays. La musique possède cette précieuse qualité d'être, comme la peinture et la sculpture, un art essentiellement international. On peut fort bien la goûter sans être originaire du pays dont elle est issue. Elle offre ce privilège d'être de circulation facile et de pouvoir être aisément appréciée, alors même qu'elle est écrite sur un texte étranger. Nous en avons eu des exemples probants dans la vogue ancienne du théâtre italien à Paris et dans celle d'aujourd'hui pour les saisons russes. De plus, il n'est pas rare d'assister, en certains pays, à l'audition d'un opéra dont les interprètes chantent en diverses langues. Il est donc vrai de dire que les beautés de la musique se révèlent à nous de façon équivalente à celles de la peinture ou de la sculpture. Je suis alors logiquement autorisé à établir une analogie entre le Musée du Louvre et l'Académie de Musique, et il me semble qu'on ne doit pas agir de façon différente pour enrichir nos collections artistiques ou pour augmenter notre répertoire musical. On doit rechercher toutes les œuvres typiques susceptibles de produire un enseignement fécond. Le principe appelé à servir de guide dans le choix de ces œuvres réside uniquement dans leur valeur réelle et représentative. Aussi importe-t-il de se défier de la mode. Il faut accueillir les tendances les plus diverses. Par le seul fait qu'un ouvrage est de premier ordre dans un genre spécial, il est utile qu'il ait accès au répertoire de l'Opéra. Il est indispensable, en effet, de favoriser chez nous l'éclosion de talents variés et, dans ce but, de permettre aux nouvelles générations de se rendre compte des meilleures et des plus suggestives productions parues. Aussi suis-je, ici, en désaccord avec beaucoup de mes confrères qui, pour ne pas envisager le caractère essentiel de l'Opéra : son rôle de musée, désapprouvent le maintien de certaines œuvres au répertoire. Sous prétexte que les musiciens actuels n'écrivent plus de ces vastes compositions décoratives si fort en faveur pendant la période romantique, ils estiment qu'il conviendrait de rejeter le répertoire de Meyerbeer et de ceux qui s'en inspirèrent. Je répondrai que l'Académie de Musique n'a nullement à se préoccuper des préférences de telles ou telles générations. C'est ainsi, qu'on ne saurait prétendre que le goût dominant de nos auteurs dramatiques contemporains soit de faire revivre la tragédie classique ou le drame en vers romantique. S'ensuit-il que la Comédie-Française doive rejeter de son répertoire l'œuvre de Racine ou de Victor Hugo ? Allons-nous condamner tous les amateurs de théâtre à n'entendre que ces petits drames intimes sans développement de caractère, se déroulant en trois actes rapides, vers lesquels inclinent tant de nos auteurs actuels ? Et en peinture ? Parce que nos artistes ne représentent plus de scènes religieuses, faut-il donc écarter, chasser des salles du Louvre tout tableau de ce genre ? Quelle désastreuse élimination ! Encore une fois, un musée ne saurait avoir égard aux goûts changeants d'une époque. Pendant toute la période romantique, Racine était fort peu en vogue. Il était raillé par les littérateurs d'alors. C'est l'inverse, qui se produit aujourd'hui. Ce sont les exagérations romantiques qui sont ridiculisées par les écrivains actuels. D'ailleurs, l'ironie est une arme qui vise surtout les défauts superficiels. Elle peut faire illusion, mais le bon sens a vite fait de remettre les choses au point. On s'est beaucoup moqué des choristes s'invectivant, se démenant, clamant : « Marchons, marchons ! » sans bouger de place. Aimerait-on mieux qu'ils courent en chantant faux ?... Nous venons d'avoir, justement, un exemple de cette méconnaissance des nécessités de l'art musical dans la dernière pièce représentée à l'Opéra : les Joyaux de la Madone. Au début du premier acte, on a voulu donner la sensation du mouvement dans une fête populaire ; on n'a obtenu qu'un abominable charivari de bruits discordants qui rend l'audition de la musique impossible ! L'orchestre lui-même ne parvient pas à dominer ce tumulte. C'est la négation de la musique ! Par contre, dans le célèbre chœur de la dispute, au troisième acte des Huguenots, les choristes, placés sur deux rangées parallèles, se chamaillent, s'injurient copieusement ; ils chantent, même, si j'ai bonne mémoire : « Mort à qui nous résiste. » Le combat n'est assurément jamais bien acharné ! mais quel superbe morceau ! Qui ne se rappelle la magnifique entrée des basses, tandis qu'on a encore dans l'oreille ces notes stridentes des voix féminines criant : « Nos têtes sont montées ! Nos têtes sont montées ! » C'est la musique et non pas les paroles — encore moins les coups — qui nous donne ici la sensation de l'âpreté de la lutte, de l'ardeur de la dispute. De même, dans le septuor du duel qui précède, ce n'est nullement ce duel en lui-même (lequel, du reste, avorte) qui nous importe, c'est ce qui se passe dans l'âme des combattants. Le musicien doit nous donner l'impression de l'âme loyale et héroïque de Raoul, et il y parvient admirablement dans la phrase aiguë du ténor : « Et bonne épée, et bon courage !... » Je ne veux pas me laisser entraîner à des citations qui me mèneraient beaucoup trop loin. Je veux simplement exprimer cette idée que l'opéra décoratif qui a pour titre les Huguenots a tout autant droit de cité dans un musée de musique dramatique — tel que doit être l'Opéra — que les tragédies lyriques de Gluck, les si harmonieuses compositions de nos grands maîtres français, ou encore les drames lyriques si pathétiques, si colorés, de l'Ecole russe, et l'incomparable épopée qu'est la tétralogie de Wagner. La principale condition d'un musée est sa richesse, sa variété en œuvres de mérite typique. Dès lors, que viennent faire ici ces essais de compositeurs contemporains que l'Etat exige des directeurs ? Remarquez que cette obligation se justifiait autrefois, alors que les musiciens français n'avaient d'autres débouchés à Paris que l'Opéra et l'Opéra-Comique. Mais combien les choses sont changées, aujourd'hui ! D'abord, l'Opéra-Comique, qui, jadis, ne recevait que des œuvres du genre opéra-comique, c'est-à-dire des partitions légères dans lesquelles s'intercalait du dialogue, — n'en donne plus du tout aujourd'hui. C'est le théâtre de Trianon-Lyrique qui exploite ce répertoire. Les partitions nouvelles des compositeurs contemporains sont exécutées à l'Opéra-Comique en nombre bien plus considérable qu'il n'était possible autrefois à l'Opéra et, vu l'exiguïté de la scène de la place Boieldieu, les musiciens peuvent donner libre cours à leurs préférences pour le drame intime. Puis, ils ont eu la chance de trouver en M. Albert Carré un directeur qui sut admirablement donner l'impulsion pour indiquer les moyens de mettre en relief le caractère essentiel de chacun de leurs ouvrages. De plus, il importe de noter que nos musiciens sont encore gratifiés de deux autres scènes : la Gaîté-Lyrique et le Théâtre des Champs-Elysées. A chaque saison, il leur est loisible de s'y faire apprécier. La Gaîté reçoit même une subvention dans ce but. Quant au Théâtre des Champs-Elysées, il annonce pour cette année plusieurs ouvrages de nos compositeurs actuels et il a déjà commencé avec les Trois Masques, de M. Isidore de Lara. C'est pourquoi l'Opéra pourrait, et devrait, à mon avis, se borner à son rôle exclusif de musée, où seraient, en quelque sorte, exposés les chefs-d'œuvre de tendances les plus diverses. J'ajouterai que l'audition de ces partitions serait d'un enseignement beaucoup plus fécond pour notre jeune Ecole musicale contemporaine que celle des quelques nouveautés dont l'exécution a été proscrite par un règlement devenu inutile. Enfin, au lieu de consacrer de longues semaines à faire étudier et à mettre en scène des nouveautés d'une existence éphémère, on aurait tout le loisir nécessaire à l'interprétation modèle des chefs-d'œuvre. Il ne faut pas oublier qu'à l'Opéra, le travail s'accomplit très lentement en raison de l'étrange concession faite aux choristes de ne répéter qu'un jour sur deux, soi-disant afin de conserver les voix fraîches pour les représentations ! Raison de plus de ne pas gaspiller un temps si parcimonieusement mesuré ! Si nous considérons le labeur important et si intéressant auquel s'est livré M. Jacques Rouché, le nouveau directeur, pendant son trop court passage au Théâtre des Arts, il me semble qu'on peut avoir toute confiance en lui et que ce choix est de ceux qui méritent d'être loués sans restriction. En s'adjoignant M. Camille Chevillard, dont la compétence musicale est indéniable, M. Jacques Rouché s'est assuré une excellente collaboration, qui aura l'agrément de tous. Des diverses intentions qui ont été prêtées au nouveau directeur, je ne veux retenir que cette phrase, prononcée par M. Rouché au cours de la conversation qu'il eut avec un rédacteur du Temps, le jour même de sa nomination : « Nous aurons un programme éclectique, qui satisfera tous les dilettantes, sans parti pris d'Ecole et avec la volonté de servir les musiciens français. » On ne saurait mieux servir les musiciens français qu'en leur permettant, comme nous le disions plus haut, de faire ample connaissance avec les chefs-d'œuvre de l'art lyrique de toutes les époques et de tous les pays. Et, à ce titre, nous espérons que M. Jacques Rouché établira au répertoire de l'Opéra — entre autres œuvres — l'incomparable Idoménée, de Mozart, dont il nous a fait entendre de si beaux fragments, la saison dernière, au Théâtre des Arts... Il y aurait bien d'autres considérations à présenter sur cette question de l'Opéra, si complexe et qui touche à des intérêts de nature si diverse ; mais j'ai voulu me borner à ce qui me paraît être l'essentiel pour le bon fonctionnement de notre première scène musicale subventionnée, maintenant que quatre théâtres de musique : l'Opéra-Comique, le Théâtre des Champs-Elysées, la Gaîté et Trianon-Lyrique, sont régulièrement offerts à l'activité de notre jeune Ecole musicale contemporaine. (Albert Dayrolles)
Il est de mode, à Paris, de dire que l'Opéra est le dernier des théâtres, qu'il n'a ni orchestre, ni chœurs, ni chanteurs, que les représentations y sont « au-dessous de tout ». Les délicats qui parlent ainsi ont coutume d'ajouter qu'ils n'y vont jamais, ce qui est une étrange manière de se renseigner. La vérité est que l'Opéra de Paris, malgré ses dimensions, — peut-être même à cause d'elles, — est un lieu unique et merveilleux : les exécutions y prennent des airs d'apothéoses, les ouvrages y acquièrent une ampleur, un essor, qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. J'en appelle à ceux qui se souviennent encore d'avoir vu Roméo sur la scène de l'Opéra-Comique, où il semblait être à sa vraie place, et qui ont pu constater sa transfiguration sur la scène de l'Opéra. La vérité est que l'orchestre, composé de virtuoses de premier ordre, a émerveillé les chefs d'orchestre étrangers qui sont venus le diriger ; que les chœurs, d'une qualité de sonorité supérieure, sont meilleurs encore qu'ils n'ont jamais été ; quant aux artistes, c'est la plus belle réunion de voix et de talents qui se puissent voir, et l'art du chant y atteint à la perfection. On n'y entend pas, il est vrai, de ces « coups de gueule » (pardon!) qui transportent d'aise les foules naïves ; on y trouve, en revanche, des voix saines, cultivées, ayant souci du style, de la déclamation, de toutes les qualités qui font le prix d'un chanteur et qui assurent la conservation de l'organe. Croit-on que des artistes comme M. Delmas, M. Noté, si fidèles à la maison, auraient toujours conservé intactes leurs belles voix s'ils ne possédaient pas tous les secrets de l'art du chant ? (Camille Saint-Saëns, de l’Institut)
à g., Jacques Rouché [photo Henri Manuel] - au centre, la Sortie de l'Opéra, tableau de J. Lefort - à dr. Camille Chevillard [photo Henri Manuel]
les Créateurs de l’Opéra français
Pendant longtemps, les dictionnaires ont fait honneur à Lulli et à Quinault de l'installation en France du drame musical. Les recherches savantes de M. Arthur Pougin, de M. Lavoix, du bon Nuitter, ont rétabli dans leurs droits l'abbé Perrin, le musicien Cambert et le marquis de Sourdéac. Il sied, pour ne pas décourager les capitalistes, d'associer à ces noms vengés de l'oubli celui du sieur Bersac de Champeron, qui créa ce beau type national : le commanditaire. Ces quatre hommes nous ont doté d'une grande chose. Ils en furent punis à l'excès. Qu'était-ce que ce Pierre Perrin ? Venu de Lyon à Paris pour chercher fortune, un tout petit peu abbé, marié tout à fait, type d'aventurier intelligent, pauvre de talent et riche d'idées, un de ces êtres incomplets et amusants faits pour tout entreprendre et tout rater. Il rimaillait, ni mieux ni plus mal que tous les poètes à gages de son temps. Littérairement, il se présente à nous accablé des mépris de Boileau. C'était un croquant de lettres, avec trop peu de style pour devenir un écrivain et trop de projets pour s'enrichir. Il paraît avoir été redoutable comme emprunteur. On le voit, tout d'abord, qui achète à Voiture la charge d'introducteur des ambassadeurs auprès de Monsieur, frère du roi. Perrin entrait ainsi dans les honneurs en s'endettant de onze mille livres. Gaston, prince déplorable, avait du goût et de la curiosité : il aimait les spectacles. Son « domestique », passionnément épris de théâtre, était chargé d'improviser des pastorales pour égayer l'illustre ennuyé. La mort de Gaston d'Orléans laissa Perrin sans protecteur. Il avait une idée pour tout capital. En écoutant les chanteurs italiens, attirés à Paris par Mazarin, il s'était demandé pourquoi des airs français sur des paroles françaises ne donneraient pas autant de plaisir. Il s'associa le musicien Cambert. A eux deux, ils firent représenter à Issy, dans la maison d'un M. de La Haye, une Pastorale qui fut appréciée. M. Arthur Pougin a publié une lettre bien intéressante, écrite en 1659 par Perrin à l'archevêque de Turin : « Après avoir veu plusieurs fois tant en France qu'en Italie la représentation des comédies en musique italiennes, lesquelles il a plu aux compositeurs et aux exécuteurs de désigner du nom d'Opre, pour ne pas, à ce qu'on m'a dit, passer pour comédiens, après avoir examiné curieusement les raisons pour lesquelles elles déplaisaient à notre nation, je n'ai pas désespéré comme les autres qu'on n'en pût faire de très galantes en nostre langue et de fort bien reçeues en évitant les deffauts des Italiennes et en y ajoutant toutes les beautez dont est capable cette espèce de représentation, laquelle, avec tous les avantages de la comédie récitée, a sur elle celuy d'exprimer les passions d'une manière plus touchante, par les fléchissements, les élévations et les cheutes de la voix. » Tout ce document est à lire ; la théorie parfaite du drame lyrique s'y trouve prophétiquement définie. A défaut du talent littéraire que Boileau lui refusait avec férocité, Pierre Perrin avait des heures de prescience. Il était né directeur de théâtre, au bonheur près, et ce fut, dans ce métier cruel, le premier inventeur digne de se ruiner. Ayant avec lui Cambert, un musicien d'élite, plein de confiance eu lui-même pour la partie poétique, Perrin découvrit dans le marquis de Sourdéac le metteur en scène de ses rêves. Ce marquis, un peu toqué, pas mal intrigant, faisait représenter dans son château des « pièces à machines ». Tallemant a dit de lui : — C'est un original. Il a de l'inclination aux mécaniques ; il travaille de la main admirablement ; il n'y a pas un meilleur serrurier au monde. A eux trois, Perrin, Cambert et Sourdéac semblaient réaliser l'idéal de la direction théâtrale. Ils attendirent dix ans leur privilège. Enfin, en 1669, le roi leur accorda des lettres patentes. L'Opéra français était créé.
***
Hélas ! bientôt, les trois concessionnaires furent ruinés ! La discorde se mit entre eux. Après la débâcle, Cambert alla finir sa carrière à Londres. Le marquis de Sourdéac, qui était peut-être un drôle, évinça Perrin assez malproprement. Il y eut entre les anciens associés des procès vilains. Sur les ruines de leur entreprise, un quatrième larron fonda sa fortune : Lulli, en surplus de ses talents incomparables, possédait le don de l'intrigue et le sens pratique du pétitionnement. Devançant les méthodes du bonhomme Poirier, ce Florentin ne traitait les affaires artistiques qu'à l'heure du dîner des artistes. Il alla trouver Perrin dans la prison pour dettes où il languissait et lui filouta le privilège, bon gré mal gré. Le pauvre diable d'inventeur dépossédé traîna quelque temps une misérable vie mendiante et finit par mourir dans une maison garnie, à la charité de son logeur. Pierre Perrin n'était sans doute pas le plus galant homme de son temps, ni le meilleur poète, et Lulli avait assurément du génie, avec la manière de s'en servir. Au dire de Molière, de Boileau et de La Fontaine, il était, en outre, tout à fait un coquin. Cela ne nuisit pas à son avancement. Ce fut, d'ailleurs, pour le plus grand bien de la musique ; nous ne reprochons donc rien à Louis XIV. Mais l'abbé Perrin, et Cambert et Sourdéac, et même le bailleur de fonds Champeron, par-dessus le marché, ont bien le droit de conserver à l'Opéra d'éternelles et vagues entrées de faveur. On leur doit la loge des ombres plaintives. (Henry Roujon, de l’Académie française)
Un décor de Faust, peint par Fritz Erler. Document rapporté par M. Jacques Rouché et publié dans son livre : L'Art Théâtral Moderne.
Le nouveau directeur de l'Opéra, M. Jacques Rouché, s'est toujours occupé des questions d'esthétique théâtrale. Il consigna naguère, dans un petit livre, les observations qu'il avait recueillies au cours d'un voyage d'étude en Allemagne et en Russie. Nous en détachons cette page :
La Rénovation de la mise en scène
L'art de la scène est l'art le plus varié qu'il soit ; il ne saurait obéir à une règle unique. La mise en scène a pour but de mettre en lumière le corps d'une pièce, d'en dégager les lignes principales, de l'habiller, si l'on peut dire. Or, le premier principe de l'art du couturier n'est-il point d'adapter à la beauté particulière de chaque femme la robe qui doit la revêtir ? Il tient compte de sa taille, de son teint, de la nuance indéfinissable de sa grâce que son effort tend à mettre en valeur ; il considère le cadre où sera exhibée la robe qu'on lui commande, et ne combine pas une toilette de ville ou de simple visite d'après les mêmes lois qu'un trotteur ou qu'une tea-gown. Enfin, quand il est un artiste, le couturier qui compose une robe d'apparat n'oublie pas d'en harmoniser l'étoffe, le style et les tons au style et aux tentures du salon où il sait que la robe doit être portée ; surtout, il se garde bien de l'alourdir par un clinquant de scintillantes richesses dont le seul résultat serait de laisser soupçonner des défectuosités regrettables dans le corps qu'elles dissimulent. De même, la mise en scène d'une pièce ne doit ni la déformer, ni la parer à l'excès, mais seulement mettre en valeur ses lignes principales et le caractère propre de sa beauté. Mais, ce qui est plus important encore, et ce que le décorateur ne doit jamais perdre de vue, c'est l'époque même où il vit, l'ensemble des sensations, des idée, des impressions, des notions communes à ses contemporains, et qui constituent la vision d'art particulière à chaque génération. En vain prétendrait-on, pour la reconstitution du passé, et même pour la représentation du présent, obtenir à grand effort de recherches érudites une précision regrettable et laborieuse ; la vérité ainsi atteinte aujourd'hui paraîtrait, demain, fausse et surannée. Chaque âge se fait des diverses époques du passé une conception plus ou moins arbitraire, et qui change avec lui ; il utilise pour cela les connaissances que la science lui livre, en les vulgarisant. Chaque époque a sa vision d'art. Feuilletons les illustrations successives d'un livre ancien qui ont paru à quelque cinquante ans d'intervalle : nous verrons une série de visions, toutes intéressantes et, cependant, différentes. L'art pictural évolue : il y a trente ans, l'impressionnisme d'un Monet transformait l'art de peindre ; depuis, les Vuillard et les Maurice Denis nous ont enseigné le prix d'autres procédés, la valeur des oppositions de couleurs les plus délicates. N'est-il point temps de chercher dans quelle mesure il serait possible de rajeunir, chez nous, la mise en scène, de la faire correspondre à la vision d'art exprimée par les peintres d'aujourd'hui, et de la rendre harmonieuse à un mouvement général des idées et de la sensibilité dont il est presque paradoxal que, seul, l'art scénique ait pu s'abstraire jusqu'ici ? (Jacques Rouché)
(les Annales, 09 novembre 1913)
|
|
L'Opéra depuis la Guerre
Castor et Pollux (Rameau) - Acte I. le Mausolée de Castor
Pendant la guerre, le problème était, à l'Opéra comme ailleurs, de vivre et de durer. Non seulement on vécut, et le plus humble des petits « rats » put manger à sa faim, grâce à l'organisation d'une cantine et d'une coopérative qui subsistent encore aujourd'hui, mais la nouvelle direction réussit, malgré les mille difficultés de l'heure, à donner, en dehors des représentations habituelles, quelques spectacles de circonstance destinés à résumer, dans un cadre incomparable, la glorieuse histoire de la musique française. Elle fit mieux encore. C'est du 21 mars 1918, c'est-à-dire d'une des époques les plus angoissantes de la mêlée, que date la brillante reprise de Castor et Pollux, chef-d’œuvre de notre grand Rameau. Deux mois plus tard, on montait, en outre, la Rebecca de César Franck. L'Opéra soutenait, avec ses moyens et à sa manière, notre prestige national.
Des tentatives aussi heureuses laissaient prévoir ce que seraient les destinées de l'illustre maison, une fois la paix rétablie. M. Jacques Rouché, en effet, se mit en devoir de reprendre un à un, tous les opéras courants qu'on n'avait pu jouer durant quatre ans et demi de guerre (à commencer par ceux de Wagner) et de restituer à certaines œuvres classiques, comme l'Enlèvement au Sérail et la Flûte Enchantée, du divin Mozart, la place d'honneur qui leur était due. Il s'agissait ensuite de faire connaître ou réentendre les ouvrages les plus caractéristiques des compositeurs contemporains. Il s'agissait surtout de les mettre à la scène avec ces recherches et ce goût de l'art moderne qui, depuis quelque quinze ans, ont complètement renouvelé notre concept de la décoration scénique sous tous ses aspects.
le Jardin du Paradis (Bruneau)
Aussi est-ce avec la collaboration des peintres modernes les plus en vue qu'on allait monter, dès 1919, quatre ouvrages nouveaux et autant en 1920. La Tragédie de Salomé, de M. Florent Schmitt, les Goyescas, de Granados, l'Antar de Gabriel Dupont, sont de cette période que domine de toute sa puissance lyrique la Légende Saint-Christophe, du maître Vincent d'Indy. L'année 1921, riche de sept créations nouvelles, est marquée par la triomphante reprise des Troyens, que le monde musical appelait depuis longtemps de tous ses vœux. La même année on jouait deux subtils ouvrages de M. Maurice Ravel, Daphnis et Chloé, et cette exquise Heure Espagnole, dont la fable et la musique sont du plus charmant esprit parisien. La saison suivante amenait le tour de la musique russe avec Boris Godounov et le retour de la musique italienne avec le joyeux Falstaff, de Verdi. Entre les deux œuvres étrangères, l'école française moderne s'épanouissait, avec le Martyre de Saint-Sébastien, de Debussy, comme un pur et mélodieux jet d'eau entre deux massifs de somptueuses verdures. Citons enfin parmi les dernières créations : Padmâvatî, de M. Albert Roussel, l’Arlequin de M. Max d'Ollone (deux opéras dont les décors et les costumes furent dessinés par M. Valdo Barbey), Esther, de M. Mariotte, le Jardin du Paradis, de M. Alfred Bruneau, l'Île désenchantée, de M. Henry Février, Brocéliande, de M. André Bloch, etc.. Au total, une trentaine d'opéras.
Mais les opéras ne sont pas tout. M. Jacques Rouché est, Dieu merci, de ces directeurs pour qui les ballets existent, comme la plus noble expression animée du monde extérieur. Tous ceux qui aiment l'art vivant sous sa forme la plus humaine savent gré à M. Jacques Rouché d'avoir refait de l'Ecole de Danse de notre Académie Nationale la première du monde entier, et d'avoir repris ou monté plus de vingt ballets ou divertissements : Taglioni chez Musette, Cydalise, Siang-Sin, le Triomphe de l'Amour (de Lulli), la Nuit Ensorcelée, la Naissance de la Lyre, Giselle, Sylvia et les Deux Pigeons. Aussi l'élite des arts et du monde, que la guerre avait dispersée, fréquente-t-elle de nouveau, avec exactitude, l'Opéra cher à nos aînés. Les soirs d'abonnement, la corbeille et les loges resplendissent, toute la salle rayonne. Et la Duchesse de Guermantes, guettée par Marcel Proust, s'y plairait encore, comme jadis, dans sa baignoire couleur « rocher de Corail »...
(programme de l’Opéra, 23 avril 1926)
la Légende de saint Christophe (Indy)
|
|
LES DÉCORS DE L'OPÉRA
Le Grand Sorcier ou les Décors et les Machines de Giacomo TORELLI (Fano, Etats-Pontificaux, 1608 – Fano, 1678)
la Finta Pazza, décor de Jacques Torelli : Prologue
Mazarin, l'illustre Mazarin, était féru d'opéras. Ce genre de spectacle était déjà très populaire en Italie qu'à la Cour de France on en ignorait tout encore. Le cardinal fit venir à grands frais, de son pays, la meilleure troupe de chanteurs qu'il pût recruter. On prit vite flamme, à Paris, pour la « Tragédie Lyrique ». Ah, oui, grâce à la musique, d'un caractère tout nouveau pour des oreilles françaises, grâce à la poésie, qui... ? Du tout, grâce aux décors ou, pour parler plus exactement, aux « Machines » de Jacques Torelli — à qui nous devons, mon Dieu, nos machinistes actuels. La musique italienne, on ne la prisa guère, en dehors du Palais Royal, et Mazarin, peu accommodant là-dessus, fit embastiller sans scrupules quelques poètes du Marais qui en avaient parlé d'une façon trop cavalière. Mais les machines de Torelli mirent tout le monde d'accord. On les célébra jusqu'aux nues... d'où elles seraient bien descendues toutes seules. On ne parlait plus que de ces incroyables inventions, de ces brusques changements de décor du « Grand Sorcier »,
Magicien expert et Faiseur de Miracle,
— ainsi que La Fontaine lui-même allait le qualifier, un peu plus tard. Aussi peut-on avancer que ce diable d'homme (c'est Torelli que je veux dire) a été, à tout prendre, le vrai fondateur de l'Opéra en France.
la Finta Pazza, décor de Jacques Torelli : une galerie dans le palais de Lycomédès
C'était un ingénieur né gentilhomme, à Fano, et qui, dès 1641, avait fait, à Venise, les décors d'un opéra intitulé la Finta Pazza (la Fausse folle). Des comédiens italiens, qui étaient à Paris, l'appelèrent. Il arrive, se brouille avec ces comédiens, puis se raccommode avec eux, et, avec eux, ayant obtenu la protection de la Reine, monte, pour la grande joie du Cardinal, cette même Finta Pazza, de Giulio Strozzi, qui l'avait mis en vue au-delà des Alpes. Il brosse de nouveaux décors et construit de nouvelles machines, plus merveilleuses les unes que les autres — de quoi étonner la nation française toute entière. Le Cardinal suspend toute négociation politique et ne quitte plus le théâtre où se font les répétitions, c'est-à-dire la scène du Petit-Bourbon, sise rue des Poulies, en face de Saint-Germain l'Auxerrois, là même où l'on allait bâtir bientôt la splendide colonnade du Louvre.
la Finta Pazza, décor de Jacques Torelli : la place publique de Scyros (Au ciel, l'assemblée des Dieux)
Cette Finta Pazza, dont le livret, avec ses planches gravées, nous a été conservé, Dieu merci, c'est l'histoire d'Achille caché dans l'Ile de Scyros, déguisé en femme parmi les filles du roi Lycomédès. Il a séduit la princesse Déidamie et cherche à fuir pour éviter de l'épouser. Mais la princesse, maligne, simule la folie, et Achille, finalement, se laisse attendrir. Jacques Torelli était à son aise dans ce domaine mythologique. On vit dans son premier décor, celui du prologue, trois allées de cyprès, se rejoignant au fond devant un palais, et, au ciel, le char de l'Aurore s'avançant tiré par des Angioletti alati, des Angelots ailés, tandis que Flore, sous les yeux des zéphyrs cueilleurs de roses, s'élevait dans les airs, elle aussi, soutenue par d'adorables amours. Ces machines s'ébranlaient en « traînant tous les cœurs après soi ».
(Programme de l'Opéra, 1928)
la Finta Pazza, décor de Jacques Torelli : Colonnade de thermes dans le jardin de Lycomédès
|
|
Les « HABITS de THÉÂTRE »
Fig. 1 et 2
François Boucher
Bérain, à qui l'on doit les dessins des premiers « Habits de Théâtre » de l'Opéra, est mort en 1711. Quand Servandoni, qui fut décorateur de l'Académie de Musique durant une vingtaine d'années, se retira à son tour, en 1742, les Parisiens apprirent avec joie que leur peintre favori, François Boucher, recueillait sa succession. L'œuvre de Boucher, qui, toute sa vie, a travaillé d'arrache-pied dix heures par jour, était déjà considérable et illustre. Les amateurs, les architectes, les fabricants, les marchands, tous se disputaient les travaux ou la collaboration du Maître à la mode, qui, à ce moment même, terminait sa Diane sortant du bain, aujourd'hui au Louvre. Il avait coutume de peindre à merveille, comme écrivait le Directeur des Bâtiments, « les paysages, les bambochades, les grotesques, les ornements, les fleurs, les fruits, l'architecture, les petits sujets galants et de mode » : il allait brosser avec non moins d'ardeur et d'adresse des décors pour l'Opéra... aux appointements de 5.000 livres par an. Le peintre de Vénus et de ses cortèges n'était-il pas à sa place, d'ailleurs, sur cette scène que les amours, entourés de toutes les divinités mythologiques, peuplaient chaque « jour de jeu » ? Boucher était si bien chez lui dans ce monde de nymphes et de héros que plusieurs ballets ou tragédies lyriques repris à cette époque, comme Thésée, Athys, Silvia durent leur vogue passagère à ses seules toiles ou « machines ». A ses costumes aussi.
Fig. 3 et 4
On conserve à la Bibliothèque de l'Opéra, quelques-uns de ses modèles au lavis ou à la plume. Ceux de Pygmalion (pour « l'entrée de ballet » de Rameau, qui fut jouée en 1748 et remontée une dizaine de fois, avec beaucoup de succès) sortent à coup sûr de son atelier. Si celui de la Statue (Fig. 1) (rôle de Mlle Puvignée) trahit le genre de Boquet, élève de Boucher, celui de Pygmalion (Fig. 2) pourrait être attribué au Maître lui-même. La touche, l'aisance, le délié, le style du personnage, la manière dont il se pose ou plutôt s'enlève, sont bien de lui. Et le costume est charmant, dans sa grâce d'opéra. Il s'inspire des modes du temps (l'Olympe faisait alors très bon ménage avec les tailleurs et les chapeliers) et allie la blancheur de la perruque Louis XV avec le flou et les flots d'un « tonnelet » de fantaisie, ondulant sur des cothurnes classiques. Un autre dessin (Fig. 3), qui représente un jeune seigneur avec une toque à plumes sur la tête et une souple ceinture aux flancs, paraît bien être de la même veine et de la même période. « S'il n'est pas entièrement de la main de Boucher, écrit M. Ch. Bouvet (qui compte bien retrouver d'autres ouvrages du « Premier Peintre du Roi » dans les archives confiées à sa garde), il a été exécuté en tout cas dans l'atelier et sous la surveillance de ce Maître par un Boquet d'une essence rare ». Mais quelques croquis portent la signature de Boucher en toutes lettres, en particulier ceux de Titon et de l'Aurore. Titon et l'Aurore, pastorale héroïque de Mondonville, avait fait triompher la musique française, lors de la « première », le 9 janvier 1753, et entraîné l'expulsion des Bouffons italiens. Dix ans plus tard, à la reprise, Boucher eut à cœur d'en crayonner les costumes de ses propres doigts. Ne s'agissait-il pas, une fois de plus, de glorifier l'Amour dans un décor de pastorale. Titon avant de « passer au rang des dieux », ne s'écriait-il pas : « Ah ! rendez-moi l'amour ou laissez-moi mourir ! » Et l'Aurore, à son tour, ne faisait-elle pas des professions de foi telles que celle-ci : « Ce n'est jamais en vain qu'on implore l'amour ». L'Aurore, du reste, que Boucher avait peinte aux côtés de Céphale, figurait parmi ses personnages familiers. Il lui fit un bel habit à paniers de gaze d'argent, froncé avec des nœuds de perles et de roses, et une riche mante d'azur. Et Titon, berger à houlette (Fig. 4), reçut une tunique croisée et frangée bouffant sur le tonnelet, un manteau de fourrure, et un splendide turban empanaché. La reine exotique, sa voisine, — peut-être Aline, reine de Golconde, ou Ermelinde princesse de Norvège ? (Fig. 5) — et l'homme à la torche (Fig. 6), avec son tour de satin jonquille et sa mante de satin cerise, semblent appartenir à la même série. François Boucher, décorateur et costumier, avait marqué son passage, tout en maintenant les traditions de Bérain. Il pouvait retourner à ses Artémis et à ses Vulcains de chevalet. Il avait formé Boquet.
Fig. 5 et 6
L'atelier des costumes au dix-huitième siècle
Nous pouvons suivre d'assez près le mouvement de l'atelier des costumes de l'Opéra, vers le milieu du 18e siècle, grâce aux précieuses Archives de la maison, qui ont été, tout compte fait, peu exploitées. Il y reste d'importants inventaires de cette époque, l'un, en particulier, qui porte sur une période allant de 1749 à 1754, l'autre qui date de 1767.
costumes dessinés pour l'Opéra par Jean-Baptiste Martin vers 1740
Dans ce dernier inventaire, l'énumération des habits ne tient pas moins de cinquante-deux feuillets et si nous faisons le compte à notre tour, page par page, nous voyons que l'Académie Royale de Musique, à ce moment-là, ne conservait pas dans ses magasins moins de cinq mille habits d'hommes ou de femmes. Le registre en mains, nous parvenons très bien à nous faire une idée de ce qu'étaient ces habits et de ce qu'ils valaient. D'un coup d'œil, nous voyons, par exemple, comme s'ils étaient rangés devant nous, dix habits de Plaisirs (les Plaisirs dansaient des pas charmants avec les Grâces) « en taffetas chair, gaze argent, ornements de gaze de soie, réseaux d'argent et rosettes vertes », estimés cent louis au total (on avait, vers 1770, un Plaisir complet pour dix livres net !) ; un habit de Sylphe (un habit de Sylphe ! quel rêve !) « fonds et culotte en taffetas bleu et draperie de gaze d'argent », estimé trente livres (la culotte, à vrai dire, dépoétise un peu notre Sylphe) ; « un habit de Sylphide, de même étoffe », estimé quinze livres (la Sylphide est la moitié du Sylphe) ; « un habit d'Amour » — oui, d'Amour — « corps (c'est le fourreau du torse) et manches en taffetas chair, draperie argent, revers (de draperie) de taffetas rose, ornements de guirlandes », estimé vingt-deux livres ; dix habits de Tritons, avec leurs maillots d'écailles, leurs lambrequins d'algues et leurs coiffures de coraux, estimés soixante-quatre livres ; vingt-deux habits de Faunes — « corps et manches de toile chair, tonnelet de toile verte, draperie de futaine tigrée » — estimés quatre-vingt-huit livres, ce qui met le faune entoilé, tigrage compris, à quatre livres pièce ; et un habit de Vulcain — « corps et manches de taffetas chair brûlée, vêtement grec de satin ponceau, tablier souci, chaînons or » — qui vaut à lui seul cent-vingt livres, chiffre de poids dans ce temps-là, et qui fait de ce Vulcain « à tablier souci » le plus cher des Dieux...
costume dessiné pour l'Opéra par Jean-Baptiste Martin vers 1740
Voilà pour les résurrections mythologiques, rôles d'hommes. Et les habits de femmes sont innombrables, dans toutes les catégories, du reste. Ils sont chers, en général. Un habit de femme, composé d'une jupe de taffetas blanc, (d'une énorme jupe à paniers, il est vrai) avec volants de gaze blanche et découpures roses, d'un corselet, de manches et d'une seconde jupe de taffetas vert, à découpures, celle-là aussi, coûte cinquante-quatre livres, au prix d'inventaire. Il s'agit d'une robe de demi-caractère ; mais une robe de grand luxe, avec « jupe de satin vert ornée de satin gris peint en peau, draperie et manches de satin ponceau, revers de peluche de soie tigrée, le tout orné de feuillages », vaut jusqu'à cent soixante-huit livres. La soie et le satin tigré ne se donnaient pas en 1767 ! A tant de costumes tout faits, notez qu'il faut ajouter encore les provisions de tissus et de garnitures de toutes sortes, accumulées dans les armoires du magasin, pour le travail à venir, les aunes de soie, de satin, de taffetas d'Angleterre ou de Florence empilées à côté des aunes de « réseaux or et argent » de diverses grandeurs, des « marcs » de paillons et de paillettes, des « grosses » de boutons, des pelleteries, des chapeaux, des bas de soie, qu'on achète couramment onze livres dix deniers la paire — ce qui, au taux actuel, peut consoler plus d'une femme élégante de nos jours, persuadée de payer ses bas au-delà de tous les prix imaginables.
costume dessiné pour l'Opéra par Jean-Baptiste Martin vers 1740
D'où viennent toutes ces fournitures ? Les étoffes sont envoyées de Lyon par un Commissionnaire général, selon les besoins de l'Opéra... et, plus souvent encore, selon ses besoins à lui (on l'accuse, en 1782, de se faire 20.000 livres de rente sur le dos de « l'Académie »). Et, ce sont, naturellement, les tailleurs de la maison — payés à la journée, et dont les salaires, certains exercices, s'élèvent à près de 30.000 livres — qui, sous la direction d'un maître tailleur et de son « survivancier », coupent et façonnent ces tissus et en font, d'après les croquis du dessinateur attitré, tous les habits de la troupe. Mais quantité d'autres fournitures sont commandées au jour le jour, à Paris même, aux artisans ou aux marchands du voisinage : au marchand de modes, qui apporte les rubans, les bouffettes, les rosettes, tous les falbalas, (l'essentiel, après tout !), au joaillier, (encore des rosettes, mais autrement brillantes !), au passementier, au cordonnier, au « coiffurier », « l'épinglier », etc., etc, et surtout à l'imprimeur sur étoffes, qui transforme la plus simple toile en « moire d'acier » pour les cottes d'armes des Renaud et des Bellone... Tant et si bien qu'au bout de l'année, vers 1780, il y en a pour plus de cent mille livres, y compris « le rouge et la pommade », mais sans compter « le fourbisseur », qui a négligé d'envoyer son mémoire. Le total est honnête.
costume dessiné pour l'Opéra par Jean-Baptiste Martin vers 1740
l’Œuvre de Boquet
Après Boucher, c'est un simple Martin (Jean-Baptiste Martin) qui devient dessinateur des habits à l'Opéra. Il occupa ses fonctions durant plusieurs années, mais sur lui-même, on ne sait hélas que fort peu de chose. Heureusement, il nous a laissé un album de vingt planches gravées qui représentent ses principaux costumes. Ces planches nous permettent de constater qu'il avait un talent très gracieux, et que le fameux costume d'opéra du XVIIIe siècle est déjà tout formé de son temps. Le fourreau de couleur chair qui, barré d'une écharpe en bouffettes ou d'une guirlande de roses et de feuilles, gaine le torse du danseur comme un maillot : le large tonnelet, sur lequel vient se disposer la « draperie » ; les paniers, démesurés, tout chargés, avec leur draperie également, de rangs de volants, de découpures de gaze, de bouffettes et de rosettes... tout cela est déjà dans les habits de J.-B. Martin. Mais, Martin disparu, sans laisser de traces, Boquet vient, qui lui prend sa place et sa réputation. Dessinateur des Menus Plaisirs du Roi, il entre, en outre, à l'Opéra, officiellement, en 1759 et il y restera jusqu'à la Révolution, pourvu, d'ailleurs, à partir de 1780, du titre d'Inspecteur du matériel. Pendant ce long intervalle il dessinera inlassablement, tant pour les représentations de l'Académie Royale de Musique, que pour celles de la Cour, à Choisy, à Versailles, à Fontainebleau, — à Fontainebleau surtout, — des quantités de croquis de costumes qui remplissent aujourd'hui, malgré tout ce qui a été perdu, une dizaine de gros albums des Archives de l'Opéra, sans parler du recueil du Cabinet des Estampes, ni de ceux des collections privées.
dessins de Boquet
Et ces costumes, tous conçus d'après le même type — tracé déjà par J.-B. Martin — sont presque tous les mêmes, à quelques variantes près. Costumes de Nymphes, de Flores, de Dianes, d'Ismènes, de « Bactériennes », de « Peuples Grecs » ou d'Esprits du Feu, de « Jeunesses », de « Plaisirs », de Pâtres, de Cyclopes, de Faunes, etc., ils se composent invariablement, pour les hommes, du tonnelet plus ou moins vaste, du fourreau appelé « corps » avec ses manches serrées à « l'amadis » de la draperie (souvent tigrée), de l'étroite culotte et du haut plumet ; pour les femmes, du corsage en pointe, également appelé « corps », de la vaste jupe, surchargée de rangs d'ornements et de guirlandes en rinceaux, et d'une mante passant en écharpe sur le buste. Quand il s'agit d'un zéphyr ou de quelque autre Esprit de l'air, son tonnelet — ou ses paniers, — sont recouverts de nuages de gaze blanche « parcourant » le satin ou le taffetas. Quand il s'agit d'une naïade, son « corps » et sa draperie sont recouverts d'écailles vertes en étoffe. Les changements sont de détail et de peu d'importance, mais Boquet, qui a la plume facile — je dis la plume, parce que la plupart de ses dessins d'au jour le jour sont à l'encre, et teintés par là-dessus — dessine en conscience un nouveau croquis pour chaque nouveau détail. Il griffonne dix croquis — d'affilée, dirait-on — pour changer la courbe d'une draperie, quelques volants, les arceaux d'une guirlande, une teinte de fond de jupe ou de « haut de manches », quelques traits insignifiants, la courte plume frisée d'une coiffure féminine à deux ou trois boucles retombantes, et faire ainsi d'une Néréide une Sylvie, ou un Tancrède d'un Dardanus. Ah, il ne plaint pas sa peine, comme on eut dit à son époque ! De la sorte, les Génies, les Scythes, les bergers, les bergères, les Armides, les Hymens, les Palmyres, les Callirrhoés, les Neptunes, les Iphigénies, les Naïs, etc., etc., tous et toutes en soie bouffante, en « glacé d'argent » et en « moire d'acier », se multiplient sous ses doigts habiles, et ses croquis, reproduits en couleurs à de nombreux exemplaires par les soins de son atelier, à l'usage des tailleurs et des brodeuses de la maison, serviront à faire habiller, durant plus de trente ans, les Carville, les Peslin, les Allard, les Dauberval, les Pillot, les Lyonnais, les Lany, les Vestris, les Sophie Arnould, toutes les gloires de l' « Académie », c'est-à-dire de l'Opéra, y compris la brillante Guimard, ce « squelette des Grâces », l'éternelle mécontente qui peste sans cesse contre tous ses costumes et en réclame toujours, avec éclat, de plus beaux, de plus riches et de plus nouveaux.
dessin de Boquet
Elle ne saurait en souhaiter de mieux dessinés. Boquet est un dessinateur exquis. Il n'a pas fait montre de beaucoup d'imagination, mais ses croquis sont ravissants de légèreté, d'aisance, d'envol et de chic. Il procède à petits traits brusques et ses mollets sont pointus comme des arêtes ; l'ensemble n'en est pas moins charmant. Sa palette est courte, composée de quelques tons très simples et très doux, qui ne varient pas plus que ses costumes : le rose et le vert tendre, le bleu clair, le gris, le carmin, sans citer le « blanc d'argent » dont il raffole, et les bruns réservés aux dieux infernaux. Mais quelle adorable fraîcheur dans tous ces tons, jetés sur les habits avec une franchise et un goût parfaits ! Ce sont des couleurs de printemps, qui vous enchantent ; et Boquet lui-même, avec sa souplesse, ce quelque chose d'aérien qui le distingue, est comme le Sylphe ou l'Ariel des costumiers. Un Ariel robuste, qui mourut fort tard (en 1814) mais qui, dès 1780, se fait aider, sinon remplacer, par Cotibert, un ancien élève de Boucher, et ensuite par Ménageot, membre de l'Académie de peinture. Il n'empêche que jusque dans les premiers temps de la Révolution, les costumes de l'Opéra resteront, à part quelques exceptions, des habits « à la Boquet », et les habits « à la Boquet » resteront toujours comme les « habits de théâtre » les plus caractéristiques du XVIIIe siècle.
dessins de Boquet
la Réforme du Costume à la fin du XVIIIe siècle
Nous voici arrivés à l'époque de la fameuse réforme qui allait enfin (proclamait-on) mettre la vérité au théâtre, en particulier dans les costumes jusque-là « ridicules », et substituer à l'Opéra, comme ailleurs, le « bon goût » à la « routine », comme si les habits de Boquet, de J.-B. Martin, de Boucher, de Gillot, de Bérain, avaient manqué réellement de goût et de caractère ! Les costumes des chanteurs, des chanteuses et de la danse allaient être enfin d'une « rigoureuse exactitude historique » ! En réalité l'affaire de la réforme a été bien plus — jusqu'à la Révolution, du moins — un thème de littérature, une querelle de doctrinaires, un dada d'Encyclopédistes, qu'une pratique de scène et d'atelier. Ainsi à la Comédie-Française même, où furent risquées, par Mlle Clairon et Lekain, aux alentours de 1753, les premières tentatives sérieuses pour rétablir « la vérité » et « l'exactitude » dans le costume, la nouveauté de l'essai, d'ailleurs bien incomplet et mêlé de toutes sortes d'étranges invraisemblances, céda bien vite aux habitudes anciennes et quotidiennes. Et de même, à l'Opéra, les tâtonnements des uns et des autres restèrent longtemps isolés, si rares, en somme, qu'on trouve aujourd'hui, à l'Opéra même comme ailleurs, fort peu de documents iconographiques qu'en fassent foi et les Lettres du célèbre maître de ballets Noverre ne remplacent pas, hélas ! les dessins qui nous combleraient. Noverre, fougueux et verbeux — le Diderot de la danse — clamait, dès 1760 environ, qu'il fallait « briser des masques hideux, brûler des perruques ridicules, supprimer des paniers incommodes, bannir des hanches plus incommodes encore », mais, quand il fut en place à l'Académie Royale de musique, en 1776, il dut bien se contenter des modèles courants.
Mlle Sophie Arnould. Rôle d'Iphigénie en Aulide
Cependant, la réforme ayant enfin touché l'Opéra, comment s'y est-elle étendue ? D'après Noverre, c'est Chassé, ce « grand homme » (on est grand homme à bon compte avec lui) qui aurait le premier « secoué les paniers » et « proscrit les habits symétriques » pour adopter à leur place « des draperies bien entendues » et « des plumes distribuées avec goût et élégance ». Or, Chassé était en pleine vogue dès avant 1730. Dans ces conditions il aurait pu inspirer Lekain lui-même ! Mais c'est tout ce que nous savons de sa discrète entreprise. Et il nous faut atteindre l'année 1771 pour assister à la disparition effective des masques (qui, jusque-là imposés à tous les danseurs, furent conservés pour les seules Furies) puis dépasser l'année 1782, pour trouver dans les textes et les images du temps, quelques documents précis sur la nouveauté des costumes « à l'antique », dus cette fois à un dessinateur et à une chanteuse de renom, Moreau le Jeune et Mlle Saint-Huberty, et reproduits dans l'ouvrage d'un contemporain, les Costumes et Annales des Grands Théâtres de Paris, de Levacher de Charnois (1).
(1) Bibliothèque de l'Arsenal, Collection Rondel.
Costume de Mlle Saint-Huberty. Rôle d'Iphigénie en Aulide
Dès les premiers feuillets du premier volume, on tombe sur le portrait de la Saint-Huberty dans son célèbre costume de Didon « qu'elle a fait faire, dit Levacher, d'après le dessin de M. Moreau, dessinateur du Cabinet du Roi, actuellement à Rome » (en 1783). Et Levacher indique lui-même la composition du costume : « La tunique est en toile de lin, les brodequins sont lacés sur le pied nu, la couronne entourée d'un voile qui retombe par derrière, le manteau de pourpre, la robe attachée par une ceinture placée au-dessous de la gorge ». J'ajoute que, d'après la gravure, la tunique de lin porte au bas une bordure d'or entre deux galons d'or également et se double d'une autre tunique, d'une jupe un peu plus longue et de nuance paille ; la ceinture, guillochée de bleu, remonte en pointe, formant une sorte de petit plastron ; chaque bras a son bracelet, de la même matière que la ceinture, la couronne, enfin, est une couronne dorée à dents aiguës. Il est certain que, par rapport aux habits à la J.-B. Martin ou à la Boquet, presque tout, là-dedans, est nouveau, à commencer par « le pied nu » ! Mais que de détails fantaisistes — comme la couronne dentelée avec son voile retombant — qui feraient sourire aujourd'hui un élève de première année de l'École du Louvre ! Pourtant Moreau s'était déjà exercé avant Didon, à ces copies ou à ces interprétations d'après l'antique. Dès 1780, il avait soumis au Ministre de la Maison du Roi un « court mémoire » où, parlant au nom des artistes « qu'on ne consultait guère », il exposait ses idées assez singulières et où, par exemple, après avoir proposé (non sans raison) de « bannir l'usage des gants » il ajoutait : « Ils (les artistes en question, enfin consultés) ne souffriraient pas que les habits des divinités infernales et des démons fussent brodés en paillettes, ni galonnés d'argent. » Pourquoi diable, puisqu'il s'agit de l'Enfer, les démons et les Furies seraient-ils privés de galons et de paillettes ? On croirait vraiment que cet habile Moreau avait déniché quelque part la tenue authentique des divinités et des demi-divinités de l'Hadès. Selon lui encore, les dieux devaient toujours être « la tête découverte, vêtus d'un habit couleur de chair, avec un beau manteau. » Ce vêtement était « plus noble et plus conforme aux idées reçues ».
à g. Costume d'Iphigénie en Tauride - à dr. Costume d'une Bacchante
Les « idées reçues » voilà le grand mot lâché. Mais l'Opéra ne s'écartera de sa vieille tradition que peu à peu et avec beaucoup de prudence. Il n'habillera de neuf ses Grecs et ses Latins, avec des cottes d'armes à lambrequins, qu'en se souvenant, dirait-on, de ses beaux jours du temps de Louis XIV, où les peintres, tous plus ou moins « romains », connaissaient à fond les principes essentiels des costumes à l'antique. Et, tout à la fin du siècle, l'acteur Chéron, une basse, profitera de tant de retenue, pour jouer, à son tour, au rénovateur plein d'audace ! Il existe, en effet, une gravure allégorique dont la lettre est : « L'acteur Chéron, réformateur du costume à l'Opéra, parmi les Furies », et où on le voit protégé par Minerve contre l'assaut de quelques Harpies, et couronné de fleurs par la Renommée... On s'explique mal, aujourd'hui, une pareille apothéose, car de ce grand « réformateur », il ne reste rien... que ce dessin, où les Furies indignées font mine de se jeter sur lui !
(Programmes de l’Opéra, 1930 à 1936)
Costume à l'antique
|
|
la Décoration théâtrale en France
Les peintres et le théâtre. — De tout temps, le théâtre a fait appel à des peintres pour imaginer et renouveler la décoration de ses spectacles. Cependant, l'histoire de la décoration théâtrale reste indépendante de l'histoire de la peinture proprement dite. Même lorsqu'elle dépend de peintres ayant acquis une certaine réputation comme peintres de chevalet, elle ne suit pas le même déroulement esthétique et évolue, certes, dans le même esprit, mais passe par des étapes sensiblement différentes. Cette particularité est très évidente au XIXe siècle, où la succession : classicisme, romantisme, réalisme, suit le mouvement général de la peinture et des idées, mais ne participe pas de façon aussi active aux grands conflits esthétiques. Cette démarche individuelle est plus sensible encore au XXe siècle, bien que le théâtre ait, dans de très brillantes réussites, sollicité la collaboration des peintres les plus éminents de l'art contemporain. On a coutume de situer la renaissance de la décoration théâtrale à l'arrivée des Ballets russes de Serge de Diaghilev, en 1908. Ceux-ci apparurent en effet, au grand public, comme une révélation et suscitèrent à la fois les enthousiasmes et les attaques les plus passionnés. En fait, le terrain était préparé depuis plusieurs années et l'on sentait la nécessité de renouveler les formules réalistes qui avaient triomphé au cours du XIXe siècle. Déjà, à la fin de ce XIXe siècle, quelques tentatives avaient suggéré une voie nouvelle et appelé la curiosité des milieux théâtraux. Le théâtre d'Art de Paul Fort (1890), devenu peu de temps après sa fondation, le théâtre de l’Œuvre (1893), sous l'active direction de Lugné-Poe, tenta les expériences les plus intéressantes. Lugné-Poe, en même temps qu'il introduit dans le répertoire français les œuvres de dramaturges scandinaves s'adresse à ses amis peintres pour donner un cadre original à ses créations. Les programmes, les décors, les rideaux d'avant-scène sont l'œuvre de jeunes artistes du temps qui sont Vuillard, Maurice Denis, Bonnard, Anquetin, Sérusier, Ibels. Un projet de décor est même demandé à Toulouse-Lautrec. Mais cette tentative conserve un caractère épisodique et ne touche pas encore le grand public. Elle montre cependant la volonté d'échapper aux conventions et de trouver, pour chaque œuvre, un cadre original, la volonté d'associer les audaces picturales aux nouveautés théâtrales. L'arrivée des Ballets russes est donc, en fait, le début de l'épanouissement d'idées qui étaient dans l'air et attendaient, pour se concrétiser, le dynamisme de Serge de Diaghilev. Renouveau pour le théâtre lyrique. —Diaghilev arrive en 1908 avec une équipe de peintres russes dont certains ont déjà acquis dans leur pays une réputation méritée. Des peintres comme Golovine, Korovine, Repine, Roerich, Bilibine sont considérés en Russie comme de grands artistes et leur succès à Paris n'est qu'une extension de leurs réussites antérieures. Mais c'est surtout avec Alexandre Benois et Bakst que le public parisien subit l'éblouissement de cette imagerie à la fois raffinée et populaire qui porte à la scène le faste des féeries orientales. Serge de Diaghilev comprend rapidement qu'une partie de son succès tient à l'effet de surprise produit par ses décorateurs. Il comprend qu'il devra, pour maintenir son prestige, s'attacher à renouveler constamment ses formules et à conserver, dans chaque nouveau spectacle, le même esprit de découverte. Il lui est nécessaire de satisfaire le snobisme qui a fait le triomphe de ses premières manifestations. Il songe alors à s'adresser aux jeunes peintres de l'école française qui commencent à connaître auprès de ce public une audience faite, elle aussi, d'enthousiasme et de scandale. Ainsi est-il amené à rechercher la collaboration des adeptes du cubisme et du fauvisme. Picasso, Derain, Braque, Matisse sont les premiers artistes auxquels il fait appel pour se détacher de l'imagerie russe : Picasso en 1917 avec Parade, Derain en 1919 avec la Boutique fantasque, Matisse en 1919 avec le Chant du rossignol, Braque en 1924 avec les Fâcheux. Chacun inaugure, dans un style très personnel, une formule particulière, Picasso allant tout de suite jusqu'à l'extrême des inventions possibles, reconstruisant les formes et imaginant un monde plastique spécialement adapté à la scène avec la volonté de détruire les apparences réalistes ; Derain avec une imagerie faite de nouveauté savante, rejoignant les habiletés et le pittoresque de la Comédie italienne, Matisse cherchant à transformer la perspective dans l'espace scénique, Braque avec un renouvellement des traditions qui accorde les souvenirs classiques et les conceptions modernes. Cette expérience se développera dans les années suivantes, et l'ensemble des programmes des Ballets russes constitue un petit panorama de l'art contemporain avec les noms de Chirico, Utrillo, Bauchant, Survage, Masson et autres. Cette orientation qui prend pour base la peinture française n'amène cependant pas Serge de Diaghilev à renier totalement ses origines russes. Il trouve, avec Gontcharowa et Larionov, deux artistes exceptionnellement doués, qui réussissent la difficile synthèse entre l'imagerie populaire de leur pays et les formes les plus avancées de l'art moderne. Le succès de ces initiatives incite Rolf de Maré à s'engager dans une voie analogue lorsqu'il monte sa troupe des Ballets suédois pour Jean Borlin, en 1920. En quelques années on voit paraître des décors de Bonnard, Fernand Léger, Picabia, Hélène Perdriat, Irène Lagut, avec des costumes de Jean Hugo, qui, ainsi, débute brillamment au théâtre. Au mois de mai 1924, le comte Etienne de Beaumont organise, sous le titre « Soirées de Paris », une série de spectacles éblouissants qui sont comme le résumé et l'apothéose de cet effort de rénovation. On y peut voir, en effet, des ballets et des œuvres dramatiques dans des décors de Derain (Salade), de Picasso (Mercure), de Jean Hugo (Roméo et Juliette). Renouveau pour le théâtre dramatique. — Cette rénovation du spectacle lyrique et l'adhésion enthousiaste qu'elle rencontre auprès du public ne doivent pas faire oublier l'effort accompli parallèlement pour le théâtre dramatique à la même époque par Jacques Rouché qui, devenu directeur du théâtre des Arts en 1910, poursuit et développe l'initiative prise par Lugné-Poe. Dunoyer de Segonzac, Georges d'Espagnat, Robert Bonfils, Desvallières participent à cette expérience ; mais c'est surtout avec Maxime Dethomas et Drésa que Rouché obtiendra les réussites les plus exemplaires. Devenu directeur du théâtre de l'Opéra en 1916, il s'attachera ces deux artistes et leur demandera une collaboration permanente pour rénover totalement les décors de ce théâtre, devenus démodés. Il fera en outre appel, pour chaque nouveau spectacle, à d'autres peintres, tels que René Piot, Maurice Denis, Valdo-Barbey. C'est à ce moment que naît, sur l'initiative de Jacques Copeau (1913), un mouvement qui devait avoir des conséquences considérables sur l'esthétique théâtrale. Pour détruire définitivement la notion réaliste du théâtre dramatique, Jacques Copeau impose ses théories, austères et précises, en faveur d'une mise en scène au style extrêmement dépouillé, sur un plateau à peu près nu. Il supprime presque totalement le décor, mais donne aux accessoires ou aux costumes un relief et une importance accrus. Dans une architecture de scène très rigide, il se contente de quelques éléments décoratifs pour situer le lieu et l'action ; il conserve toujours visible ladite architecture, qui, par la multiplicité des plans, lui permet des mouvements très divers. En 1922, Dullin, quoique formé à l'école de Copeau, adopte des formes décoratives plus souples et plus variées. Il demande à Guy Dollian, à Touchagues, à Jean Hugo, une formule intermédiaire entre la rigueur du Vieux-Colombier et les fastes auxquels nous ont habitués les Ballets russes. Dullin inaugure un nouveau style de décor. Il ne s'adresse pas, comme Rouché, Diaghilev et Rolf de Maré, à des peintres de tableaux, mais plutôt à des illustrateurs de livres, qui se caractérisent par un dessin précis, un souci de minutie dans les détails, une écriture simplifiée mais très aiguë. Il atteint une réussite parfaite dans le premier décor d'un jeune artiste : André Barsacq, pour Volpone, en 1928. Celui-ci devait par la suite exécuter de nombreux et excellents décors, puis prendre la succession de Dullin au théâtre de l'Atelier. Antoine, avec sa conception du théâtre réaliste, n'a pas apporté une rénovation durable ni éclatante dans la décoration théâtrale, sauf quelques tentatives à l'Odéon, mais son adepte immédiat, Firmin Gémier, s'est engagé dans une voie plus, riche et plus ample, dans une conception du théâtre dramatique qui rejoint les grandes apothéoses du théâtre lyrique. On lui doit notamment quelques mises en scène très significatives pour Shakespeare, spécialement pour le Marchand de Venise. Mais c'est surtout dans le spectacle monté, en 1919, au Cirque d'Hiver pour une présentation d'Œdipe, roi de Thèbes, avec un dispositif scénique d'Émile Bertin et des costumes d'Ibels, qu'il a donné la mesure de ses conceptions et du sens de la grandeur qui l'animait. Gaston Baty fit là ses premières armes et commença à se manifester en toute indépendance dans le spectacle suivant : la Grande Pastorale. Il devait, quelques années plus tard, en 1921, au théâtre de la Chimère, tenter une exploitation régulière pour l'application de ses idées. Ainsi, aux environs de 1925, on peut dire que la rénovation théâtrale est totalement accomplie, que les anciennes conceptions sont abandonnées et que le théâtre moderne a pris une forme décorative renouvelée de fond en comble. La suite ne sera que le développement de ce nouvel état d'esprit, et toutes les expériences seront, d'une façon ou d'une autre, la conséquence du combat livré et gagné par les initiateurs que nous venons de citer. L'artiste qui, durant les années suivantes, devait le plus profondément marquer le théâtre est Christian Bérard. Ayant débuté en 1930 dans une troupe issue des Ballets russes de Diaghilev avec un ballet de Sauguet, la Nuit, il trouve bientôt dans les spectacles montés par Jouvet l'occasion de créer un style très particulier, d'une élégance raffinée, qui transfigure totalement les notions de la fantaisie et de la magie théâtrales. Les temps du théâtre réaliste sont révolus, tout le théâtre contemporain sera désormais marqué par cette recherche d'une préciosité qui échappe au maniérisme et donne à chaque œuvre un cadre particulier. Les théâtres officiels, qui ont si longtemps vécu sur leur routine, s'engageront bientôt dans la même voie et renouvelleront complètement la présentation de leur répertoire. A la Comédie-Française, en 1922, Charles Granval sera l'initiateur de ce renouvellement qui atteint aussi bien les classiques que le théâtre moderne. Les jeunes équipes apparaissent également à l'Opéra, puis à l'Opéra-Comique. Nouvelles équipes, après 1945. — La Seconde Guerre mondiale n'interrompt pas ce mouvement, et de jeunes troupes tentent, avec des fortunes et des moyens divers, de maintenir la qualité de cet effort. Depuis 1945, on assiste à l'épanouissement de l'apport de ces jeunes équipes et de nouveaux artistes ont pris la succession de leurs aînés. Ceux qui se sont le plus nettement signalés par la qualité de leur invention sont : François Ganeau, Suzanne Reymond, Lucien Coutaud, Suzanne Lalique, Brianchon, Chapelain-Midy, Yves Bonnat, Jean-Denis Malclès, Georges Wakhevitch et Cassandre. L'arrivée de Maurice Lehmann à la direction de l'Opéra donne une nouvelle impulsion par des créations dépassant en somptuosité ce qui avait été fait jusqu'alors et retrouvant la tradition des spectacles de Cour dont le prestigieux souvenir est peut-être dépassé par les actuelles réalisations, mais qui sont bien dans cette formule de féerie. Les trois derniers spectacles, les Indes galantes, Obéron et la Flûte enchantée, apparaissent comme le point culminant de ce que peut être le spectacle, mêlant tous les moyens de séduction pour aboutir à un ensemble d'une parfaite cohésion et capable de satisfaire à la fois la vue et l'esprit. En outre, les spectacles de ballet, qui avaient connu une période moins brillante entre les deux guerres, ont retrouvé un éclat égal à celui des Ballets russes, grâce à l'effort de quelques troupes indépendantes (les Ballets des Champs-Elysées, les Ballets de Roland Petit et la Compagnie du marquis de Cuevas). Ils ont révélé entre autres deux peintres particulièrement originaux : Antoni Clavé et Carzou. D'autre part, on assiste à différentes tentatives qui tendent à éliminer le décor théâtral pour y substituer une suggestion d'espace et d'atmosphère où domine la lumière et dont le style est donné à peu près exclusivement par les personnages et leurs costumes. Jean Vilar en fait la démonstration dans ses spectacles de plein air au Festival d'Avignon avec la précieuse collaboration du peintre Gischia. Il réussit à transporter ces mêmes principes dans la vaste salle du palais de Chaillot, où il retrouve d'analogues dimensions. Le succès remporté par de nombreux festivals dans les villes de province pendant la saison d'été prouve l'intérêt qu'accorde le public à ces tentatives. Enfin, dans un cadre plus restreint mais répondant au même état d'esprit, les récentes expériences faites par Jan Doat pour Shakespeare au Cirque d'Hiver ou par le Théâtre en Rond avec des œuvres d'Oscar Wilde et de Marcel Achard montrent la même préoccupation qui refuse le décor et rend au texte sa primauté. Donc, si l'on peut situer la période des précurseurs entre 1895 et 1907, celle des créateurs entre 1908 et 1925, celle de l'épanouissement entre 1925 et 1940, on assiste actuellement à la conclusion, qui est comme une apothéose en même temps probablement que le prélude d'une nouvelle conception du théâtre, qui tend à le faire sortir du cadre rigide de la scène à l'italienne et à s'épanouir dans d'autres dimensions, dans une autre notion de l'espace.
(Raymond Cogniat, Larousse Mensuel Illustré, octobre 1955)
|
|
le Théâtre lyrique contemporain
La crise du théâtre lyrique contemporain. — Depuis bientôt une trentaine d'années, le théâtre lyrique traverse une crise due à deux causes principales, toutes deux de caractère purement matériel, et jouant dans la plupart des pays du monde, mais surtout en France. D'abord, le financement d'un théâtre d'opéra est une chose qui demande des capitaux considérables. Dans ces conditions, les responsables de ces entreprises — qu'elles soient publiques ou privées — ont tendance à fixer leur politique artistique sur les ouvrages les plus populaires du répertoire, les ouvrages à grosses recettes (Faust, Manon, le répertoire italien, etc.). Ces recettes, pour confortables qu'elles soient, suffisent souvent à peine à faire vivre normalement un tel théâtre, lequel doit alors recourir soit à des subventions d'État, soit au mécénat sous une forme quelconque, avec tous les risques que cela comporte. D'autre part, en examinant le problème sous l'angle du musicien, il faut constater que la composition d'un opéra est un travail de très longue haleine. Pendant un temps considérable, souvent plusieurs mois, sinon plusieurs années, l'activité du compositeur sera mobilisée par un travail dont il est à peu près sûr qu'il ne sera retenu, une fois terminé, par aucun théâtre. Dans le cas le plus favorable, l'ouvrage attendra des mois, voire des années, avant d'être accepté, même si le comité de lecture lui a donné quelque attention. Ce n'est donc pas, comme on se plaît à le répéter, que les musiciens d'aujourd'hui n'ont plus la tête lyrique. Le problème est d'ordre purement économique : pas de demande, donc pas d'offre. Ce sont là, semble-t-il, les deux raisons logiques — et complémentaires — qui expliquent ce qui a pu amener de plus en plus le théâtre lyrique à une crise qui témoigne d'une hypotension assez inquiétante. A ces deux raisons, on peut en ajouter quelques autres, d'ordre psychologique ou technique. D'abord le fait que certaines couches du public qui seraient jadis allées à l'opéra sont aujourd'hui attirées soit par le ballet, soit par le cinéma. Les progrès techniques du ballet et du cinéma ont parfaitement adapté ces deux genres aux exigences du public du XXe siècle, ce qui n'est pas le cas de l'opéra (sauf quelques tentatives assez discutables, comme le Consul aux États-Unis, ou des reprises comme les Indes galantes et Obéron à l'Opéra de Paris, en ce qui concerne le répertoire traditionnel). Ensuite, le fait que les moyens matériels mis au service du ballet et du cinéma sont plus considérables, et en tout cas plus adéquats, que ceux qui sont consacrés au théâtre d'opéra. Du point de vue psychologique, la désaffection du public à l'égard du théâtre lyrique peut s’expliquer par le fait que, auprès des générations nouvelles, le répertoire, parfois un peu vieillot, est présenté d'une façon souvent conventionnelle. Quant aux nouveautés, même lorsqu'elles ont une réelle qualité musicale, dramatique et littéraire, elles souffrent aussi de présentations routinières, désuètes. Enfin, le théâtre lyrique pâtit du fait que l'école de chant est assez pauvre, surtout en Allemagne et en France, deux grands pays fournisseurs de voix. Trop souvent on ne sait pas utiliser les quelques voix dont on dispose : les erreurs de distribution sont courantes elles sont désagréables pour le public, et souvent fatales pour les artistes, dont elles déplacent la voix. C'est là un problème de direction technique qui pèse d'un poids très lourd sur la gestion artistique des théâtres actuels. D'autre part, l'enseignement du chant est généralement assez faible en certains pays. Et c'est sans doute là une des causes essentielles de ce qu'on appelle la crise du théâtre lyrique. Cela dit, l'activité lyrique depuis 1940 prouve que le théâtre d'opéra ne demande qu'à vivre. Le théâtre lyrique en France. — La production française des quinze dernières années ne laisse pas apparaître des tendances très caractérisées. Chaque compositeur semble avoir fait cavalier seul, sans se soucier d'une politique esthétique ou technique répondant à un besoin d'époque ou à une mode. Depuis 1940, le Théâtre national de l'Opéra, qui s'est cantonné dans l'exploitation d'un répertoire restreint, s'est montré dans l'ensemble peu entreprenant à l'égard des nouveautés. Cependant, quelques ouvrages importants sont à noter. En premier lieu, la Médée de Darius Milhaud, créée à une époque fort peu favorable (mai 1940), et qui est une tragédie lyrique sur un livret de la femme du compositeur, dans un décor d'André Masson et une mise en scène de Charles Dullin. Cette œuvre puise à la fois chez Euripide, Sénèque et Corneille. Le compositeur a souligné l'opposition existant entre le doux personnage de Créuse et celui, furieux et glacial, de l'héroïne. Agissant plus en dessinateur qu'en peintre, il a véritablement trouvé la musique de son sujet, une robuste pâte sonore, des lignes mélodiques allongées, les caractères y étant bien tracés, celui de Médée haletant de cruauté, trépignant de haine froide, et celui de Créuse tout de délicatesse et de sensibilité légère. La création de l'Antigone d'Arthur Honegger (février 1943) devait être une des rares nouveautés importantes que connurent les sombres années de l'occupation allemande. L'œuvre fut montée dans des décors et une mise en scène remarquables de Jean Cocteau, qui était également l'auteur du livret, adapté librement d'après Sophocle. La partition est d'une intensité tragique saisissante, et cela avec une rare économie de moyens. Le compositeur s'y est également efforcé de résoudre le difficile problème du parlé-chanté, en recherchant une prosodie très particulière, très syllabique, et une accentuation tonique donnant au texte toute sa clarté et au mot une valeur musicale. C'est sans doute là une des œuvres les plus hautement significatives de la production de ce musicien. En ce qui concerne cette même époque, on notera, pour mémoire, deux ouvrages lyriques montés sur les suggestions diversement heureuses des autorités d'occupation : Peer Gynt, de Werner Egk, et Palestrina, de Pfitzner. Depuis la Libération, la cadence se poursuit toujours à un rythme ralenti. En 1948, c'est le Lucifer de Claude Delvincourt, sur un livret de René Dumesnil, vaste ouvrage fait de chant, de danse et de mime, dans lequel les auteurs ont voulu faire revivre les procédés des anciens mystères. Au printemps de 1950 fut monté Bolivar, troisième panneau de la grande trilogie sud-américaine de Darius Milhaud, tiré de la pièce de Jules Supervielle et créé dans des décors de Fernand Léger ; les aventures héroïques et sentimentales de ce général de vingt-neuf ans, libérateur de son pays, sont traitées ici, par Milhaud, dans le style d'une violente imagerie populaire aux couleurs éclatantes et franches, au dessin clair et simple, dans une action dramatique pleine de mouvement. A l'automne de 1951, Jeanne au bûcher, d'Arthur Honegger, entrait à son tour à l'Opéra ; cet oratorio dramatique, qui marque la première collaboration du compositeur avec Paul Claudel, est une vaste fresque où se mêlent aussi chant, danse, mime, parler. La partition de Honegger souligne et amplifie la grande musique qui se dégage d'elle-même du texte lyrique de Claudel. Dans la dernière semaine de 1954, l'Opéra présentait enfin une reprise de la Flûte enchantée de Mozart, dans des décors et des costumes de Chapelain-Midy, spectacle de sérieuse qualité. Présentée en 1950 par la Radiodiffusion française, la Phèdre de Marcel Mihalovici se révèle comme l'une des productions les plus remarquables du théâtre lyrique contemporain par sa puissance tragique, l'économie de ses moyens et la nouveauté de sa formule de raccourci : un grand acte en cinq scènes séparées par des interludes symphoniques, et dans lesquelles intervient le chœur pour commenter l'action, par opposition aux cinq personnages qui la jouent et la chantent. Pendant la même époque, le théâtre national de l'Opéra-Comique a créé un plus grand nombre d'ouvrages, mais, dans l'ensemble, de valeur moins significative : d'abord le Rossignol de Saint-Malo, de Paul Le Flem (1942), d'après un conte breton ; puis Ginevra, opéra giocoso de Marcel Delannoy (1942), sur un livret de Julien Luchaire, d'après un conte de Boccace, œuvre aussi colorée que les décors de Chapelain-Midy dans lesquels elle fut représentée ; la Gageure imprévue, de Henri Sauguet (1943), sur un livret et dans le style galant et légèrement sentimental de Carmontelle ; les Mamelles de Tirésias surtout (1947), opéra bouffe d'après l'œuvre de Guillaume Apollinaire, auquel Francis Poulenc pensait depuis longtemps déjà et qui est un des ouvrages les plus merveilleusement burlesques et poétiques à la fois qui se soient jamais joués devant le public des Pêcheurs de perles ; enfin, la Farce de maître Pathelin, de Henri Barraud, et le Carrosse du Saint-Sacrement, de Henri Büsser (1948), Guignol, d'André Bloch (1949), et surtout Madame Bovary (1951), d'Emmanuel Bondeville, œuvre pleine de réelle poésie musicale, mais que ne soutient pas toujours un livret de René Fauchois, difficile à rédiger en raison de l'élément plus psychologique que dramatique du roman de Flaubert. Il était un petit navire, de Germaine Tailleferre (1949), n'eut pas le succès que lui méritaient ses intentions : une charge des poncifs traditionnels du théâtre d'opéra-comique excellemment pensée par Henri Jeanson, dont le texte était cependant un peu longuet et n'inspira pas à la musicienne une partition suffisamment soutenue. En 1954, enfin, il faut citer la création d'un opéra bouffe, la Femme à barbe, de Claude Delvincourt. Les théâtres de province ont, de leur côté, fait un effort intéressant. On citera, à leur actif, des créations d'œuvres, étrangères pour la plupart : à Bordeaux, la Main de gloire, de Jean Françaix (1950) ; à Strasbourg, Mathis le Peintre, de Hindemith (1951), Peter Grimes, de Britten (1950), Puck, de Marcel Delannoy (1947), The Rake' s Progress, de Stravinsky (1952) ; à Mulhouse, le Rire de Nils Halerius, de Marcel Landowsky (1950), le Consul, de Menotti (1951), le Viol de Lucrèce, de Britten (1948). Le théâtre lyrique en Allemagne et en Autriche. — Les tendances de l'Allemagne contemporaine ne sont guère plus nettement affirmées que les tendances françaises. On va du néo-classicisme au néo-romantisme, en passant par un néo-modernisme attardé. Et l'on n'y distingue guère d'œuvres pouvant se comparer aux grandes partitions que Milhaud, Honegger ou Mihalovici ont données en France. Après Werner Egk, dont le style est souvent assez hétérogène (Peer Gynt, Circé, Christophe Colomb), il faut insister sur les œuvres de Carl Orff, le représentant le plus considérable de la musique dramatique allemande contemporaine. Orff se révèle, par nature, non-conformiste, mais on le sent pris entre le goût de la nouveauté et celui de la tradition. Son tempérament d'homme de théâtre est éclatant dans des ouvrages tels que Carmina Burana, Catulli Carmina (1943), Antigone (1949) et Trionfo di Afrodite (1953), où, à l'exemple de nombreux compositeurs de sa génération, il recherche la combinaison du chant, de la danse, du mime et du parler pour en tirer des effets dramatiques, dynamiques et sonores nouveaux. Il faut également mentionner les derniers opéras de Richard Strauss, l'Amour de Danaé (1940) et Capriccio (1941), tous deux marqués du classicisme dépouillé caractérisant les dernières partitions de l'auteur de Salomé. Au titre de l'Allemagne également, et bien qu'il ne s'agisse pas d'œuvres nouvelles, il convient cependant de souligner la renaissance du théâtre de Bayreuth, où les festivals traditionnels ont repris lors de la saison 1951. Wolfgang et Wieland Wagner, petits-fils du compositeur, ont cherché — et dans une très grande mesure réussi — à adapter la présentation de ces ouvrages aux exigences du public moderne. A cet égard, c'est un des efforts les plus intelligents qui aient été faits pendant cette période en ce qui concerne la scène lyrique. Les deux metteurs en scène allemands ont élagué, dépouillé, stylisé, symbolisé, et en fin de compte allégé, l'œuvre de Wagner en la réduisant, du point de vue scénique, à ses éléments essentiels et suffisants. C'est une grande réussite, et qui permettra au génie wagnérien de conquérir de nouveaux adeptes parmi les jeunes générations. En Autriche, le festival de Salzbourg a créé deux ouvrages intéressants du jeune compositeur Gottfried von Einem : la Mort de Danton, sur le beau texte de Büchner (1947), ainsi que le Procès, d'après Kafka (1953), dans lequel les réalisations du metteur en scène et du librettiste ont un peu débordé le musicien lui-même, qui a fait preuve d'une discrétion excessive. Le théâtre lyrique en Angleterre. — C'est essentiellement Benjamin Britten qui illustre le théâtre lyrique anglais contemporain. Ce compositeur, qui a porté l'école musicale anglaise à un rang qu'elle avait perdu depuis assez longtemps, est surtout un homme de théâtre. Il a trouvé un mélange de symbolisme et de réalisme qui ne peut laisser indifférent le public d'aujourd'hui. Et si, parfois, ses partitions peuvent paraître un peu minces du point de vue strictement musical, il n'est pas niable qu'il excelle à créer un climat poétique très personnel et un mouvement dramatique incontestable. Ainsi en est-il d'œuvres telles que Peter Grimes, le plus remarquable opéra qu'il ait donné (1945), le Viol de Lucrèce, d'après Tite-Live, sur un livret d'André Obey (1946), Albert Herring, d'après le Rosier de Madame Husson, de Maupassant (1947), l'Opéra de quat' sous (1948), le Petit Ramoneur (1949) et Billy Budd, d'après Hermann Melville (1951). Le théâtre lyrique aux Etats-Unis. — Comme en Allemagne, la vie lyrique aux Etats-Unis est très intense et très riche. Mais il s'agit surtout de l'exploitation du répertoire. Dans l'ensemble, on ne peut guère noter de créations d'une importance très marquante, en dehors des œuvres de Gian Carlo Menotti et d'Igor Stravinski. Gian Carlo Menotti, musicien américain d'origine italienne, a créé un genre d'opéra dont le style est très hétérogène, très peu personnel, qui s'apparente de très près à la technique du cinéma moderne, ce qui lui confère une vérité et un mouvement dramatique remarquables. Menotti est influencé, sur le plan scénique, par les véristes italiens, dont il a su adapter l'esthétique aux exigences de l'Amérique, et, sur le plan purement musical, par des auteurs aussi différents que Stravinsky, Prokofiev, Richard Strauss, Debussy et Puccini. Ces influences sont assez sommairement assimilées, mais, malgré cela, il est incontestable que l'art un peu facile et trivial de Menotti est très convaincant, entre autres dans des œuvres telles que le Médium (1946), le Téléphone (1947) et le Consul (1949). Igor Stravinsky n'a donné qu'un ouvrage lyrique, The Rake's Progress (1948-1951), d'après la célèbre série de gravures de William Hogarth. Il y a cherché le style de l'opéra de chambre du genre Cosi fan tutte. C'est là un retour total et volontaire à une forme traditionnelle que le compositeur a traitée dans le style italien sur le plan scénique et musical, et où il a rendu des hommages non déguisés à Mozart, à Rossini, à Donizetti, à Verdi, à Gluck, à Bach et à Tchaïkovski, ce qui n'empêche nullement ce dramma giocoso de constituer en fin de compte un des produits les plus typiques et les plus subtilement personnels du génie de Stravinsky. Le théâtre lyrique en Italie. — De la production lyrique italienne contemporaine, il faut surtout isoler Vol de nuit, que Luigi Dallapiccola écrivit d'après le roman d'Antoine de Saint-Exupéry (1948), et où le musicien a recherché une formule nouvelle combinant les possibilités du chant, du récitatif, et du Sprechgesang, d'une façon extrêmement ingénieuse, en créant une ambiance poétique et dramatique très particulière et d'un caractère nouveau et personnel. Il faut citer également, du même Dallapiccola, Il Prigioniero (1950), drame musical en un acte et un prologue sur un livret que le compositeur a tiré de l'un des Nouveaux Contes cruels de Villiers de L'Isle-Adam, intitulé la Torture par l'espérance ; c'est une partition d'obédience dodécaphonique beaucoup plus stricte que la précédente. Le théâtre lyrique en U. R. S. S. — De Serge Prokofiev, qui a assuré l'essentiel de la production lyrique en U. R. S. S. au cours des quinze dernières années, il faut citer Simeon Kotko (1939), les Fiançailles au monastère, d'après Sheridan (1940-1941), et surtout Guerre et Paix, d'après Tolstoï (1941-1942).
(Claude Rostand, Larousse Mensuel Illustré, février 1955)
|
|
« En reprenant la direction des Théâtres Lyriques, Georges Hirsch avait, notamment, affirmé sa volonté de remettre au répertoire les œuvres de Wagner qui, pendant des années, avaient été maintenues à l'affiche. Aussi, après Tannhäuser, vient-il de nous rendre le Vaisseau fantôme et la Walkyrie. Certes, ces spectacles ne sauraient être parfaits : décors et mises en scène sont entièrement à revoir, et il faut reconstituer une troupe wagnérienne française. Du moins, cette première étape a-t-elle déjà permis de saluer la beauté vocale et dramatique de Régine Crespin (Sieglinde), la vaillance de Sarroca (Senta) et de Bianco (le Hollandais) ; de rendre à nouveau hommage aux qualités et à la conscience de Lucazeau (Brünnhilde), de Fronval, de Rita Gorr, de Medus... Très belles exécutions d'orchestre, sous la direction de Fourestier et de Sébastian. L'adhésion du public a été significative et encourageante. » (Jacques Feschotte, Directeur de l’Ecole Normale de Musique, Musica, octobre 1956)
« A l'Opéra, on attend. A l’Opéra de Paris, les membres du corps de ballet n'ont pas beaucoup souffert avant d'apprendre sur quel pied ils allaient danser. Après l'examen, le classement a été publié immédiatement. Les étoiles demeurent, même si leur contrat a été quelque peu modifié. Harald Lander et George Skibine continuent à se surveiller comme chien et chat. Mais, du côté du chant, l'incertitude et même une certaine inquiétude règnent. L'administration semble vouloir tenir davantage sous sa coupe les premiers rôles payés au mois. Et Gabriel Dussurget clame, à qui veut l'entendre, que les grands noms ne l'intéressent pas, et qu'on fait d'excellentes troupes avec des jeunes inconnus ! La preuve ? Le festival d'Aix-en-Provence. Aussi les poulains que l'on a applaudis dans le spectacle Ravel piaffent-ils d'impatience. Quant aux autres, en attendant des précisions sur les modalités de leur nouveau contrat, ils acceptent des engagements en province. Et si ça ne marche pas, disent-ils, nous ferons de l'agriculture dans le Midi. Jane Rhodes se sent une vocation pour planter les eucalyptus. Les musiciens de l'orchestre se montrent tout aussi déchaînés. Ils ne tiennent pas du tout à se voir enlever la possibilité d'appartenir à de grandes associations symphoniques ou celle de faire des disques. Mais, pour cela aussi, M. Julien veille. Il a fait savoir aux différentes firmes phonographiques qu'elles n'avaient pas le droit d'utiliser le nom de l'Opéra ou de l'Opéra-Comique, qui est propriété de la Réunion des Théâtres Lyriques Nationaux, sans son autorisation. Et là, l'orchestre n'est plus du tout d'accord... L'histoire ne fait que commencer. » (Musica disques, juin 1960)
|