
Cinquante ans de musique française (1874 - 1925)

figures de danse (eau-forte de Paul Renouard)
L'OPÉRA
par Louis LALOY
I
Constitution de l'Opéra Français.
Il n'est guère possible d'étudier l'opéra français, à une période quelconque de son histoire, sans rappeler d'abord le mot de La Bruyère : « Le propre de ce spectacle est de tenir les esprits, les yeux et les oreilles dans un égal enchantement ».
Tout en rendant hommage à la sagacité du moraliste, il importe cependant de remarquer qu'en faisant une place à l'opéra dans son chapitre des Ouvrages de l'esprit, il n'a nullement prétendu donner une définition du genre, alors dans sa première nouveauté, mais seulement en marquer au passage les traits les plus frappants et les plus singuliers. Il ne compose pas un Art poétique comme Boileau ; il nous invite à visiter une galerie de Caractères, complaisamment poussés à la charge. L'opéra et ceux qui s'occupent de ce spectacle à la mode s'y reconnaissent à leur affairement, à leur vantardise et à des ambitions qu'un pur homme de lettres comme La Bruyère ne peut estimer que follement présomptueuses. Et c'est pourquoi, de peur qu'on ne s'y trompe, il prend soin de commencer ainsi : « L'opéra est l'ébauche d'un grand spectacle ; il en donne l'idée ».
En fait, tous les pays civilisés où existe un art dramatique ont été naturellement conduits à souhaiter, et à obtenir selon leurs moyens, la triple adhésion dont parle La Bruyère, pour la simple raison que des hommes assemblés ne peuvent être émus que de ce qu'ils voient, entendent ou comprennent. La parole, la musique et la représentation des êtres et des choses sont les trois instruments de l'art dramatique, et il n'en est point d'autres. La tragédie et la comédie de la Grèce et de Rome avaient leurs dialogues, leurs monologues, leurs parties chorales, leurs morceaux de chant, leur musique de scène, leurs choristes astreints à des évolutions cadencées, leurs masques, leurs costumes. Les « mistères » du moyen âge, succédant aux drames liturgiques, faisaient comme eux alterner la récitation avec le chant des paroles, soutenu par les instruments ; les démons y dansaient ; les anges y descendaient du ciel ; on reconnaissait les uns à leurs cornes et à leurs fourches, les autres à leurs ailes ; Dieu le Père, la Vierge et les Saints apparaissaient en robes somptueuses ; la trappe donnant accès à l'enfer s'ouvrait devant la scène, entourée des diverses mansions ou constructions figurant la maison de la Vierge à Nazareth, le palais de Ponce Pilate, le temple de Jérusalem et les autres édifices, tous ouverts du côté du public, où tour à tour passaient les personnages. Les acteurs chinois chantent et parlent, eux aussi ; un orchestre où la percussion domine scande leurs mouvements et en fait une danse expressive, dont les simulacres suppléent à l'absence du décor et des accessoires ; les costumes et le maquillage leur prêtent un aspect fantastique ou les transfigurent en héros de légendes.
Ce sont là trois types de théâtre bien différents, et on en pourrait citer d'autres, comme l'opéra-comique ou le drame wagnérien : tous ont pour objet, comme l'opéra, de prendre possession des âmes par l'intermédiaire des yeux, des oreilles et des intelligences. L'opéra ne ressemble à aucun d'eux, pas même à la tragédie grecque qu'il a d'abord voulu restaurer.
On sait que l'opéra fut inventé en Italie, vers la fin du seizième siècle, par quelques beaux esprits férus d'antiquité (1). De la musique antique, il ne leur était resté que de rares débris, tous de basse époque ; et il faut avouer que de nos jours nous ne sommes guère mieux partagés. Ils n'en pouvaient donc juger que par les préceptes des théoriciens, les appréciations des critiques et les considérations des philosophes. De ces divers témoignages, ils conclurent avec raison que la musique antique ignorait l'art de combiner entre elles des voix chantantes, qu'on appelait alors le contrepoint et qui était en pleine floraison. Comme d'autre part les auteurs anciens célébraient à l'envi les effets puissants de cette musique, capable d'exciter ou d'apaiser à volonté, moyennant le changement de quelques notes dans la gamme ou de quelques temps dans la mesure, toutes les passions de l'âme humaine, ils les crurent sur parole, et cherchant à ces effets extraordinaires une cause, la trouvèrent dans la simplicité extrême de la structure. Ils s'imaginèrent donc que pour rendre à la musique ce pouvoir d'expression ou, comme ils disaient, de représentation, perdu depuis l'antiquité, il suffirait de la réduire à une seule mélodie. Telle fut la règle de leur « style représentatif », dont ils opposaient non sans orgueil la subtilité linéaire aux groupements complexes du motet ou du madrigal. L'imitation de l'antiquité les conduisait à une de ces réactions qui se produisent périodiquement dans l'histoire de la musique et de tous les autres arts : quand une technique progressivement développée a atteint son point de ,maturité, il se trouve des esprits novateurs pour en dédaigner les ressources trop connues et demander qu'on en fasse table rase. Ils maudissent une science qui leur paraît vaine et appellent de leurs vœux le retour à l'innocence des premiers âges. Mais dans la production artistique aussi bien que dans les institutions politiques ou sociales la régression est impossible. Ces réactionnaires sont des révolutionnaires, et l'on voit bientôt que s'ils arrivent à faire tomber quelques procédés devenus coutumiers et passés à l'état de formules, la technique n'en souffrira pas, bien au contraire : loin d'être ramenée à un état primitif, elle cherchera des procédés nouveaux en tenant compte de tous les progrès de la pensée et de la sensibilité dont témoignaient les formes abandonnées.
(1) L'ouvrage à consulter sur ce sujet est le livre de M. Romain Rolland sur l'Histoire de l'Opéra en Europe avant Lully et Scarlatti. Paris, 1895.
Si les fondateurs de l'opéra avaient voulu reproduire exactement la musique antique, ils devaient se contenter de mélodies isolées, sans aucun accompagnement. Ils ne purent s'y résoudre, parce que depuis cinq ou six siècles l'oreille s'était progressivement accoutumée à entendre plusieurs sons à la fois. Mais dans le contrepoint chacun de ces sons faisait partie d'une mélodie distincte. Dans le style représentatif, un seul se rattache à la mélodie, les autres subordonnés au premier forment entre eux un accord qui le soutient. Le contrepoint, au quinzième et au seizième siècle, tenait déjà grand compte des accords, et calculait la marche des voix de manière à les obtenir aussi satisfaisants pour l'oreille que possible. Cependant aucun des maîtres de cette technique n'était jamais arrivé à considérer un accord détaché de son contexte, ni à le présenter sans que chacune de ses notes constitutives fût justifiée par celles qui précédaient et suivaient, dans la même partie. On peut dire, en empruntant une image à nos habitudes modernes de notation, que ces musiciens lisaient la musique horizontalement, non verticalement ; et c'est pourquoi leurs œuvres n'étaient jamais publiées qu'en parties séparées, non en partitions. Les partitions, qui permettent une lecture synoptique des parties, ne se rencontrent qu'au dix-septième siècle, après la fondation de l'opéra.

buste de Lully par Coysevox
L'imitation de la musique antique a conduit les réformateurs italiens de la fin du seizième siècle à un progrès décisif, qui rompant avec l'usage de leur temps marque l'avènement de la musique moderne. La distinction nette entre la partie principale et les parties d'accompagnement et la faculté de frapper un accord sans en relier chaque note à un chant sont les premières conditions d'une technique nouvelle qui bientôt devait être amenée à étudier les diverses sortes d'accords, à les classer et à prescrire des règles à leur enchaînement. Caccini, Peri et Monteverdi présidaient ainsi à la naissance de l'harmonie. Par là même ils s'écartaient bien plus encore que leurs contemporains de la musique antique, qui si elle a admis, entre le chant vocal et le jeu des instruments, quelques divergences passagères où l'on peut voir les signes précurseurs du contrepoint, n'a jamais eu la moindre idée de ce que nous appelons l'harmonie.
La nouvelle musique devait représenter les sentiments. C'est pourquoi on ne pouvait la séparer d'un sujet défini. C'est la parole qui définit, non la musique. La jeune école ne concevait donc pas de musique sans paroles, et comme c'est dans le drame que la parole prend toute sa force et son accent le plus passionné, la musique ne devenait maîtresse de tous ses effets que si on l'appliquait au drame. Par là encore on croyait suivre l'exemple des anciens, et on se trompait fort, car l'antiquité avait sa musique de concert, destinée à des virtuoses du chant ou des instruments, donc beaucoup plus savante et raffinée que celle de la tragédie, dont les chœurs n'étaient jamais exécutés que par des amateurs. C'est sous l'influence de cette musique que le plus délicat et le plus inquiet des tragiques grecs, Euripide, avait introduit dans ses œuvres des solos de chant où les acteurs pouvaient rivaliser avec les artistes du concert, et dont les vocalises ont excité la verve d'Aristophane. Ces détails étaient aussi accessibles aux philologues du seizième siècle qu'à ceux de notre temps. Mais les lettrés ni les musiciens n'en faisaient état, parce qu'ils démentaient leur préjugé de la simplicité antique, qui trouve encore de nos jours de nombreux adeptes.
Comme la musique devait, d'après eux, renforcer la signification des paroles, ils s'imaginèrent qu'elle avait partout son emploi, et que la tragédie grecque n'admettait pas plus les paroles sans musique que la musique sans paroles. C'est là une erreur flagrante, qui paraît résulter de la confusion entre certains passages de la tragédie grecque, destinés à introduire un chœur, et le dialogue courant. A ces passages seuls, aisément reconnaissables par leur cadence à quatre temps, s'applique l'allusion, d'ailleurs assez obscure, que font certains auteurs à une déclamation intermédiaire entre le chant et la parole. Mais toutes les scènes d'action, écrites en vers analogues aux alexandrins de la tragédie française, étaient parlées. La tragédie grecque ressemble ainsi bien plus à un opéra-comique ou à un drame chinois qu'au drame musical de la Renaissance italienne.
Partis de là, les auteurs de ce drame se mirent en quête, pour tous les endroits où le mouvement de la scène ne souffrait aucun délai, d'une forme de chant où la musique fût aussi effacée que possible, sans pourtant disparaître complètement, et c'est ainsi qu'ils ont inventé le récitatif, sorte de mélodie sans mélodie, suite de notes soumises au seul entraînement des syllabes et accompagnées de l'harmonie la plus rudimentaire. C'est à ce prix qu'ils arrivèrent à ne jamais interrompre le cours de la musique. Il n'existe en aucun temps ni aucun pays un théâtre en musique où le même principe soit observé. Partout, sauf en Europe depuis trois siècles, on a suivi cette règle de bon sens que ce qui ne doit pas être dit, se chante, et que ce qui ne peut être chanté, se dit. Mais c'est encore un préjugé, transmis de génération en génération jusqu'à la nôtre, que l'alternance du chant et de la parole est bonne tout au plus pour l'opéra-comique, mais ne conviendrait pas au sérieux d'un drame ou d'une tragédie.
Les premiers ouvrages ainsi conçus étaient désignés comme des drames ou des fables en musique, et destinés à des sociétés d'amateurs qu'on appelait, encore en souvenir de l'antiquité, des académies, ou à des cours princières. Le succès en fut tel que bientôt il se trouva des entrepreneurs, en italien impresarii, pour exploiter dans les principales villes d'Italie des théâtres où l'on jouait des drames musicaux, devant un public payant. C'est alors qu'on prit l'habitude d'en parler comme de l'œuvre, opera, de tel ou tel musicien, sans préciser autrement le genre, car c'était inutile : chacun savait de quelle sorte d'œuvre il était question.
Le drame en musique résumait alors la musique entière. Après avoir absorbé les autres genres, il allait les reformer à son image : l'oratorio et la cantate sont des opéras ou des scènes d'opéra, adaptés à un sujet religieux et aux exigences de l'exécution dans une église ; la sonate et le concerto sont des morceaux d'opéra où le chanteur est remplacé par un instrument ; la symphonie est une sonate en concert.
C'est sous le nom d'opéra que le drame musical fut introduit en France, après plusieurs tentatives infructueuses, par les soins de Lulli et avec l'approbation de Louis XIV, en 1672. Le mot, étant d'origine étrangère, ne suivait pas les règles de la grammaire française ; il ne prenait pas d'accent aigu et restait invariable au pluriel. Les auteurs de l'Encyclopédie, dans la troisième édition qui date de 1778, écrivent encore : des opera. La France n'avait pas attendu l'introduction de l'opéra pour avoir des représentations théâtrales accompagnées de musique. Au moyen âge, c'est ainsi qu'on donnait les mistères. Ils ne purent se maintenir, au seizième siècle, devant les critiques des humanistes, les railleries des protestants et les scrupules du clergé catholique, qui devait désormais éviter toute occasion de scandale. Le 17 novembre 1548, un arrêt du Parlement interdit les « mistères sacrés », et il n'y en avait point d'autres.
En France comme en Italie, c'est la tragédie grecque qu'on s'efforça de faire revivre, mais sous une forme toute littéraire et sans aucun mélange de musique. La Cléopâtre de Jodelle, représentée en 1552 à l'hôtel de Reims, devant le roi Henri II, par l'auteur et ses amis, fut la première tragédie française. Ce n'est pas que Ronsard et ses disciples aient dédaigné la musique. Bien au contraire, ils souhaitaient vivement de l'unir, comme les anciens, à la poésie. Ronsard ambitionnait la gloire d'un Pindare français, mais non pas celle de Sophocle ou d'Euripide. Bon musicien lui-même, il connaissait trop les difficultés de la technique de son temps pour se risquer à composer ; il se remettait de ce soin à des maîtres tels que Clément Janequin, Roland de Lassus, Goudimel, Costeley, Certon, Claudin de Sermisy, dont on trouve, dans certaines éditions faites de son vivant, les airs notés à la suite de ses poèmes.

Antoine de Baïf, d'après un médaillon du XVIe siècle conservé à la Bibliothèque Nationale
En novembre 1570, le poète Antoine de Baïf et le musicien Thibaut de Courville obtenaient des lettres patentes pour la fondation d'une Académie de poésie et de musique, inaugurée au mois de février de l'année suivante. C'est la première institution qui en France porte ce nom, appliqué en 1635 à l'Académie française, et en 1669 à l'Académie de musique où l'on se proposait d'introduire les opéras. Cette première académie, qui comprenait des musiciens et des auditeurs, tenait des séances régulières où les compositions nouvelles étaient montrées, et avait le privilège de leur exécution. Elle avait pour objet de donner à la France une poésie lyrique, digne d'être comparée à celle des anciens. Baïf croyait y parvenir en astreignant le vers français aux formes métriques d'Horace ou de Pindare ; Thibaut de Courville, Claude Le Jeune ou Jacques Mauduit mettaient en musique ces vers « mesurés à l'antique », de manière à en respecter le rythme, ou plutôt à le rendre sensible, car la langue française ne distingue pas, comme le grec et le latin, les syllabes longues des syllabes brèves, et c'est la musique seule qui pouvait assigner aux unes comme aux autres une durée déterminée. Baïf se proposait-il d'aller plus loin, et quand les règles de la poésie lyrique, c'est-à-dire de la poésie en musique, seraient bien établies, de faire l'application de cette poésie au théâtre ? Il avait été en Italie et y avait sans doute eu connaissance des discussions auxquelles donnait lieu dès cette époque le théâtre en musique. On peut donc croire Sauval (2), lorsqu'il rapporte que « sans les troubles qui survinrent, Mauduit et Baïf auraient fait représenter une pièce de théâtre en vers mesurés à la façon des Grecs ».
(2) Antiquités de Paris, tome II, p. 493, cité par M. P.-M. Masson, la Musique mesurée à l'antique, dans le Mercure musical, 1907, p. 685.

Claude Le Jeune, d'après une gravure de l'époque
Cependant la musique intervenait, dès cette époque, en un autre genre de spectacles, qui étaient les ballets de cour. De tout temps elle avait été associée aux fêtes royales ou princières, entrées triomphales, cortèges, réceptions, carrousels. L'un des amusements les plus goûtés sous les Valois était la mômerie, où l'on se déguisait pour danser. Une de ces mômeries, donnée le 29 janvier 1393, en l'hôtel Saint-Pol, a laissé un souvenir tragique dans l'histoire, sous le nom de « bal des ardents ». Charles VI y dansait, et l'émotion qu'il ressentit quand une torche tombant sur un de ses compagnons mit le feu à son costume de sauvage, ne fut pas étrangère, à ce que l'on croit, à la folie dont les premiers symptômes se déclarèrent peu après ce funeste accident.
Après le tournoi fatal qui coûta la vie à Henri II, les jeux guerriers furent abandonnés, et les mômeries, devenues mascarades à l'italienne, furent de plus en plus à la mode. La Cour de Catherine de Médicis y introduisit le ballet proprement dit, dont le nom ne se rencontre pas avant cette époque : c'est une danse générale, exécutée par les seigneurs et les dames, tous masqués et déguisés, suivant des figures compliquées et cérémonieuses, qu'on peut comparer à celles de la chaconne au dix-huitième siècle, et du quadrille au dix-neuvième. Une mascarade composée de plusieurs épisodes, ou comme on disait dès lors, de plusieurs entrées, et suivie de ce ballet qu'on prit l'habitude d'appeler le « grand ballet », constituait le ballet de cour. Le premier ballet de cour sur lequel nous soyons suffisamment renseignés est le Ballet comique de la reine, composé par Beaujoyeux et dansé, en 1561, dans la salle de Bourbon.

un ballet au XVIe siècle : scène du Ballet Comique de la Royne, par Balthazar de Beaujoyeux, 1561 (Prunières, le Ballet de Cour en France, Laurens, édit.)
Le ballet de cour a duré, avec une faveur croissante, jusqu'à l'avènement de l'opéra (3). Louis XIII, qui était très bon musicien, ne se contentait pas d'y paraître. Le ballet de la Merlaison, dansé en 1635, était entièrement de sa composition ; s'il faut en croire la Gazette du 22 mars de cette année, il en avait lui-même inventé « les pas, les airs et la façon des habits ». Louis XIV, en sa jeunesse et jusqu'à l'âge mûr, faisait volontiers son rôle dans les ballets. C'est par les ballets dont il a écrit la musique que Lulli s'est fait d'abord connaître et a mérité la confiance du roi, qui en 1672 le chargeait de fonder une « Académie royale de musique », pour y jouer des opéras. Dans les années précédentes, c'est avec la comédie qu'on avait essayé de combiner le ballet. Les dissentiments qui s'élevèrent entre Molière et Lulli et la mort du poète, survenue peu après, en 1673, arrêtèrent le développement de la comédie-ballet, laissant la place libre à l'opéra. Mais l'opéra trouvait la tradition du ballet bien établie et Lulli, depuis son arrivée en France, s'en était trop pénétré lui-même pour n'en pas tenir compte en s'efforçant de la concilier avec les règles de l'opéra (4).
(3) On trouvera tous les détails sur l'histoire du ballet de cour dans le livre de M. Henry Prunières, le Ballet de cour en France avant Benserade et Lully. Paris, 1914.
(4) L'histoire des origines de l'Opéra français a été exposée de la façon la plus exacte et la plus complète par M. Lionel de la Laurencie, dans son livre sur les Créateurs de l'Opéra français, Paris, 1921.
Le ballet de cour était dansé par des gentilshommes, auxquels furent adjoints, au dix-septième siècle, des amateurs de tout rang et des danseurs de profession : cette concession devenait nécessaire à mesure que le genre se perfectionnait et qu'un plus grand talent y était requis. Mais le spectacle, dès l'origine, en était public, et l'on s'y écrasait. Les gradins étaient disposés d'ordinaire sur trois côtés de la salle réservée à la danse, le quatrième côté étant occupé par la scène, où l'on voyait paraître successivement les personnages des diverses entrées. Plusieurs heures à l'avance, toutes les places étaient prises et les portes occupées par une foule si compacte que le roi lui-même avait parfois du mal à se frayer passage. Il arrivait aussi que le service d'ordre était débordé et la salle envahie.
La musique du ballet, jusqu'à la fin du seizième siècle, était écrite en contrepoint à plusieurs parties. Au dix-septième siècle, elle suit le nouvel usage que l'opéra italien a fait prévaloir dans toute l'Europe et emploie le chant accompagné. L'ancien ballet comportait en effet des morceaux de chant, placés d'ordinaire au début des entrées, pour les annoncer et les expliquer. Les danses étaient accompagnées par un orchestre à cordes, qu'on appelait les Violons, et qui était placé dans la salle. Il. y avait aussi un orchestre de scène, où figuraient des instruments variés : flûtes, hautbois, musettes, cornets, cromornes, cors de chasse, luths, théorbes, guitares. Les musiciens de cet orchestre étaient le plus souvent déguisés et masqués eux-mêmes. Ils précédaient, selon le caractère de leurs instruments, les entrées de bergers, de nymphes, de satyres, de démons, de chasseurs, de magiciennes, de sauvages, et souvent restaient sur la scène pour accompagner, à la place des violons ou de concert avec eux, certaines danses nationales, comme la sarabande de Grenade, qui exigeait la guitare, ou le pas des Suisses, battu par deux tambours et un fifre, à la mode du pays. L'orchestre du ballet prenait ainsi une diversité de couleur inconnue à l'opéra italien.
Les entrées procédaient parfois d'une action suivie, comme dans le ballet de la Délivrance de Renaud, représenté pour la première fois en 1617 et repris, en 1912, au Théâtre des Arts. L'expression des sentiments dans ce cas n'est pas négligée ; mais elle n'occupe qu'une place restreinte. Guédron, célèbre musicien de ce temps, n'insiste pas sur la fureur d'Armide à la façon de Gluck ni même de Lulli ; il l'indique cependant assez pour justifier l'apparition des démons en formes de vieilles femmes qui presque aussitôt personnifient cette fureur vaine. Mais le plus souvent le ballet de cour est descriptif, comme celui de la Merlaison, qui avait pour sujet la chasse, le ballet du Château de Bicêtre, où l'on voyait des voleurs, des faux-monnayeurs, des nécromants trouver un abri en ce château hanté, ou le Ballet de la nuit, dansé le 23 février 1653, l'un de ceux auxquels a travaillé Lulli, qui montre ce qui se passe, dans une rue de Paris, après la fin du jour : des allumeurs de lanternes, des filous, des laquais préparant une salle de bal, des galants qui s'empressent à un rendez-vous, des sorciers, des bourgeois effrayés par un incendie, y font des entrées successives, divisées en quatre veilles et terminées par le lever du soleil, représenté par le roi. Costumes et masques étaient burlesques, terribles, magnifiques, et toujours de fantaisie. Le travesti, qui dans ces conditions n'offrait aucune difficulté, était de règle, et les dames ne dansaient que dans le grand ballet. On faisait exception quelquefois pour un talent rare, et c'est ainsi que la belle demoiselle Paulet avait paru en 1609 dans le ballet de la Reine Mère devant Henri IV, qui en avait reçu une impression très vive (5).
(5) Tallemant des Réaux, éd. Monmerqué, II, p. 317.
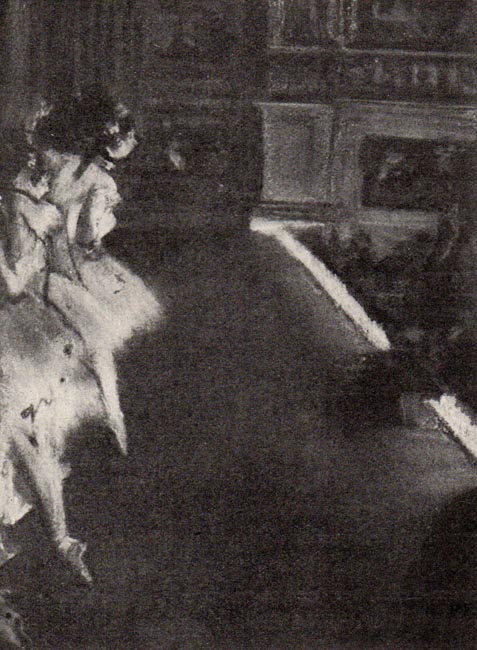
Edgar Degas. Danseuses de l'ancien Opéra.
Lulli fit une large place au ballet dans l'opéra français : il y eut au moins une entrée, et le plus souvent plus d'une, dans chacun des actes. Le ballet de cour, tout en inventions étranges et surprenantes, a communiqué à l'opéra français ce goût du « chimérique » ou du « merveilleux » qui a tant frappé les contemporains, et scandalisé les esprits critiques, comme Saint-Evremond et La Bruyère. L'opéra se jouant sur un théâtre permanent pouvait disposer, pour assurer l'illusion scénique, d'une machinerie autrement savante que celle du ballet de cour. Il n'y manque pas. Les apparitions de démons sortis des dessous et de divinités descendues des cintres, les vols, les engloutissements dans les trappes, les écroulements, les incendies, les changements à vue furent l'un des attraits du nouveau spectacle, et l'on ne manquait guère de citer, après les noms du poète et du musicien, ceux des auteurs du décor et des « machines ».
La salle de l'opéra se trouvait à Paris. Mais les premiers essais des nouveaux opéras, que nous appellerions aujourd'hui les répétitions générales, avaient lieu à Versailles, devant le roi et la cour. L'opéra appartenait au roi. C'est pourquoi il s'ouvrait par un prologue sans aucun lien avec la pièce, qui en était la dédicace et contenait, sous le voile transparent des allégories mythologiques, les compliments d'usage et souvent des allusions aux récents événements de la politique et même aux incidents de la vie mondaine dont on s'entretenait alors à la cour. Louis XIV, qui se souvenait de la Fronde, n'allait jamais à Paris pour son plaisir. Mais le duc d'Orléans y eut ses loges, et la meilleure noblesse se partagea les autres. On peut voir, dans les Mémoires de Saint-Simon, que les préséances étaient à l'Opéra aussi marquées qu'à la Cour et aussi âprement disputées (6).
(6) Mémoires, éd. Chéruel, XI, p. 31. Contestation entre la Duchesse d'Orléans et Madame, sa belle-mère, au sujet d'un tapis dans une loge.
Les ballets de l'Opéra étaient d'abord exécutés, comme les ballets de cour, par des danseurs. C'est en 1681 que parut sur cette scène la première danseuse, mademoiselle Fontaine. Cette innovation fut bien accueillie. L'Opéra compta bientôt autant de danseuses que de danseurs. Il doit aux ballets le nom, qu'il a gardé jusqu'à nos jours et qui le distingue de tous les autres théâtres, d'Académie de musique et de danse.
C'est Lulli qui recrutait et formait lui-même sa troupe. Après sa mort, le même soin fut prescrit à ses successeurs, et c'est ainsi qu'un arrêt du 11 novembre 1713 stipule que les directeurs, Dumont et Francine, « devront choisir les meilleurs sujets pour la voix, la danse et les instruments, avec l'approbation du sieur Destouches, inspecteur général », et leur apprendre gratuitement leur métier à l'Opéra.
Depuis la fondation du Conservatoire, sous la Révolution, l'Opéra s'en remet à cet établissement de lui envoyer ses lauréats pour le chant, et peut aussi recruter des artistes hors du Conservatoire. Mais il est resté une école gratuite de danse, parce que l'enseignement de cet art n'est pas dispensé officiellement ailleurs.
Le corps de ballet de l'Opéra a donné lieu, depuis bientôt deux siècles et demi, à bien des critiques, à bien des plaisanteries, à bien des pamphlets. De quelque manière qu'ait été compris, à de certaines époques, le recrutement de ce corps de ballet, et si peu de ressemblance qu'il y ait, au moins en apparence, entre un abonné de l'Opéra sous la troisième république et un courtisan du Roi-Soleil, il n'en est pas moins vrai que le foyer de la danse, où danseuses et abonnés se retrouvent aux entractes, rappelle jusque par sa forme rectangulaire la salle où l'on dansait jadis le grand ballet. Et si les abonnés de trois soirs par semaine, qui seuls ont droit d'aller au foyer, tiennent tant à ce privilège, il ne faut pas oublier que même sans le savoir ils défendent ainsi une tradition.
Le ballet n'a pas été entièrement absorbé par l'opéra. Il a continué d'exister, auprès de l'opéra, comme un genre indépendant. Jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, il a toujours comporté des parties de chant. Quand il comprenait plus d'un acte, il prenait d'ordinaire le nom d'opéra-ballet, et ne se distinguait d'un opéra régulier que par la division de l'action, qui changeait d'acte en acte au lieu de se continuer.
Le ballet sans chant ou ballet-pantomime a été introduit par Noverre, fort timidement d'abord et sur des airs de musique empruntés, vers 1770, et n'a eu les honneurs d'une musique nouvelle qu'en 1790 pour un ballet de Pierre Gardel, Télémaque dans l'île de Calypso, dont il fit écrire la partition par le musicien Miller, son beau-père.
Quand l'opéra fut introduit en France, il y trouva la tragédie dans toute sa gloire. C'est pourquoi prit pour poèmes des tragédies en cinq actes et s'intitula tragédie en musique. Mais ces tragédies étaient agencées de manière à ménager le plus naturellement qu'il se pouvait des morceaux lyriques et des entrées de ballet. Les morceaux lyriques permettaient d'apprécier la vérité de l'expression. Les entrées de ballet et tout ce qui s'y rattachait comme les cortèges, les cérémonies, les prodiges, donnaient lieu au musicien d'utiliser, comme faisait déjà le ballet de cour, les ressources variées de l'orchestre, et c'est pourquoi un grand symphoniste comme Rameau donnait résolument la préférence au ballet sur la tragédie. Gluck au contraire, plus attentif au intérêts du poème qu'à ceux de la musique, prétendait comme les créateurs italiens de l'opéra, faire du chant un autre langage, et se recommandait comme eux de l'exemple de l'antiquité.
Au dix-neuvième siècle, le drame historique ou légendaire, à la façon des romantiques, supplante la tragédie sur la scène de l'Opéra comme à la Comédie-Française, et s'y maintient jusqu'à la période qui nous occupe. L'opéra-ballet a disparu. Mais, pour donner l'occasion de développer ses effets à la virtuosité de danseuses célèbres comme Taglioni ou Fanny Elssler, on compose alors des ballets pantomimes, c'est-à-dire sans mélange de chant, en deux ou trois actes, avec une action suivie.
L'opéra français se distingue de toutes les autres sortes d'opéras par la place importante et nécessaire qu'y occupe la danse. Le théâtre français d'opéra se distingue de tous les théâtres lyriques par la communication établie entre la salle et la scène. L'opéra français a, de tout temps, été divisé et souvent disputé entre le chant et la danse, l'action et le spectacle. la voix et l'orchestre. Le théâtre français d'opéra a toujours été soutenu par un public non pas anonyme ni de passage, mais connu et permanent, qui a ses places marquées dans la salle comme les artistes sur la scène, se sent chez lui dans le théâtre et ajoute par sa présence à l'éclat des représentations.
II
L'Opéra pendant la Guerre de 1870 et la Commune.
A la date du 4 septembre 1870, le livre de la régie de l'Opéra, tenu avec la plus minutieuse fidélité par le deuxième régisseur, Georges Colleuille, porte en grosses lettres les mentions suivantes :
CHANGEMENT DE GOUVERNEMENT
UN GOUVERNEMENT PROVISOIRE EST CRÉÉ
PROCLAMATION
DE
LA RÉPUBLIQUE
LE THÉATRE PREND LE NOM DE
THÉATRE DE L'OPÉRA
Suivent, en caractères un peu plus petits, les indications de service :
M. Perrin donne l'ordre de retirer les affiches.
Les répétitions annoncées pour demain sont décommandées par ordre de M. Perrin.
Deux jours avant les graves événements ainsi rapportés dans leur ordre hiérarchique, le 2 septembre, l'Opéra jouait Guillaume Tell, avec une recette, encore honorable, de 6.657 fr. 33.
La déclaration de guerre, survenue le 19 juillet, l'avait trouvé en pleine prospérité. Au mois de juin, les recettes avaient été les suivantes :
|
01 juin 03 juin 06 juin 08 juin 10 juin 13 juin 15 juin 17 juin 20 juin 22 juin 24 juin 27 juin 29 juin Total |
Robert le Diable le Freischütz, Coppelia les Huguenots le Freischütz, Coppelia Guillaume Tell le Freischütz, Coppelia Robert le Diable le Freischütz, Coppelia le Freischütz, Coppelia les Huguenots le Freischütz, Coppelia la Favorite le Freischütz, Coppelia
|
9.774,83 10.402,12 10.474,93 10.001,07 8.102,18 8.242,84 6.876,43 7.004,65 5.543,48 6.126,37 7.313,42 5.795,23 7.841,95 103 499,52 |
Les dépenses régulières, pour un mois de 1870, s'élevaient à 163.440 fr. 29, qui se décomposaient ainsi (7) :
|
Administration et bureaux Scène, régisseur et chefs de chant Artistes du chant Artistes de la danse Chœurs Corps de ballet Orchestre Employés du théâtre Employés du contrôle Nettoyage Employés des costumes Machinistes Figuration Droit des indigents Honoraires d'auteurs Chauffage (mois de mars) Eclairage Entretien des calorifères et ventilateurs Assurance contre l'incendie Total |
2.075,10 4.633,25 60.971,25 14.725,00 9.773,90 6.350,10 3 .170,85 551,65 1.143,95 461,70 4.533,15 7.667,20 1.199,75 15.872,68 7.550,00 1.500.00 9.775.00 250,00 1.235,75 163.440,29 |
(7) Chiffres empruntés au mémoire d'Halanzier, Exposé de ma gestion de l'Opéra. Paris, 1875.

le première affiche de la Société des Artistes de l'Opéra
Les « feux », allocations supplémentaires aux artistes qui dépassent le nombre prévu de représentations, ne figurent pas dans ce budget. Si on en évalue le total à 6.500 francs, ce qui est probablement excessif, on arrive, pour les dépenses mensuelles, à une somme d'environ 170.000 francs. Mais il faut déduire une mensualité de 75.000 francs, pour la subvention, fixée alors à 800.000 francs, mais augmentée d'une somme de 100.000 francs que l'Empereur payait sur sa cassette pour la location de ses loges. Ainsi les dépenses mensuelles, en 1870, étaient d'environ 95.000 francs. Le bénéfice net, pour le mois de juin, atteignait à peu près 8.500 francs. Pour le mois d'avril, où les recettes s'étaient élevées à 177.579 francs, il dépassait 82.000 francs. Mais il ne faut pas oublier qu'une partie de ces bénéfices devait être employée à monter de nouveaux ouvrages. L'opéra qui dépendait de la liste civile depuis le 1er juillet 1854, avait en effet recouvré sa liberté le 22 mars 1866. Emile Perrin, qui s'était d'abord fait connaître comme peintre et avait ensuite dirigé l'Opéra-Comique et le Théâtre-Lyrique, en était administrateur depuis le 20 décembre 1862. Le 11 avril, il devenait directeur à ses risques et périls, sous le régime de la subvention et moyennant un cautionnement de 500.000 francs. Tout compte fait, il lui restait, à la fin de sa direction, un bénéfice de 416.323 francs (8).
(8) Chiffres donnés par Jules Simon, ministre de l'Instruction publique, à la séance de l'Assemblée nationale du 21 mars 1872.
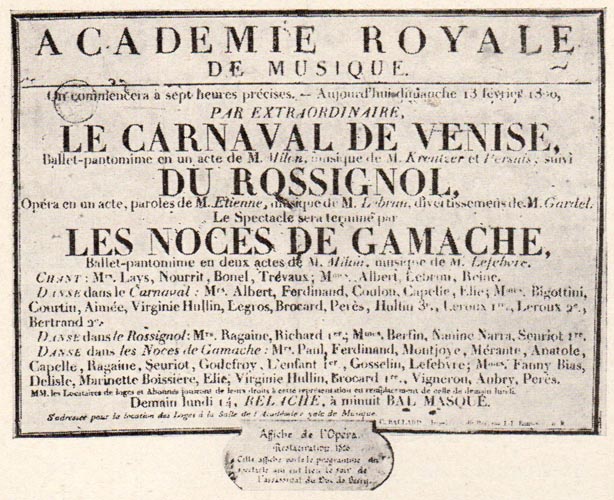
affiche du jour de l'assassinat du Duc de Berry [13 février 1820]
L'Opéra était alors dans la rue Le Peletier. Après l'assassinat du duc de Berry, survenu le 13 février 1820 comme ce prince sortait de l'Opéra, la salle de la rue Richelieu, qui faisait face à la Bibliothèque royale, fut fermée, l'archevêque de Paris n'ayant consenti à y porter les sacrements qu'à cette condition. L'Opéra se transportait à la salle Favart, où il donnait, le 19 avril, sa première représentation avec Œdipe à Colone, puis à la salle Louvois, construite en 1791 par Brongniart à l'emplacement du n° 8 de la rue de Louvois, seulement pour quelques concerts, pendant qu'on édifiait la nouvelle salle.
L'emplacement choisi était celui de l'ancien hôtel du financier Bouret, occupé ensuite par MM. de Laborde, la Reynière et le duc de Choiseul. L'architecte fut Debret, qui venait de restaurer la chapelle de Saint-Denis. Les travaux commencèrent le 13 août 1820 et furent vivement poussés, mais il était entendu que l'Opéra ne viendrait là qu'à titre provisoire, en attendant un édifice plus digne de lui. Les bâtiments de l'hôtel, qui étaient en façade de la rue Grange-Batelière, aujourd'hui rue Drouot, furent presque entièrement conservés et servirent à loger les services du théâtre. La salle fut construite dans le jardin, avec son entrée sur la rue Le Peletier. On la fit sur le modèle de la salle précédente, et on utilisa tout ce que l'on put des corniches, colonnes et garnitures de loges de l'édifice démoli. La dépense atteignit cependant le chiffre de 2.300.000 francs. Le théâtre fut inauguré, le 16 août 1821, par une représentation de la Bayadère, opéra en trois actes de Jouy et Catel, et du Retour de Zéphyre, ballet en un acte de Gardel et Steibelt, qui produisit une recette de 9.251 fr. 10.
Il contenait 1.171 places, ainsi réparties :
|
Orchestre Parterre Baignoires Stalles d'amphithéâtre Premières loges Deuxièmes loges Troisièmes loges Quatrièmes loges et amphithéâtre Cinquièmes loges |
204 280 86 121 218 238 246 334 44 |
Cette salle fut bientôt considérée comme une des meilleures de Paris, aussi bien pour les proportions que pour l'acoustique.
Le cadre de scène avait 12 mètres 60 d'ouverture, et 13 mètres 80 de hauteur. La largeur totale de la scène, coulisses comprises, était de 33 mètres, la profondeur de 30 mètres. Les dessous avaient 10 mètres de hauteur, les cintres 17 mètres. Ces dimensions n'ont pas été de beaucoup dépassées par la suite. Elles suffisaient à l'ampleur du spectacle et à l'agencement de la machinerie.
Par contre, les loges des artistes étaient étroites, les corridors obscurs ; le foyer de la danse n'était lui-même qu'une pièce oblongue et mal éclairée. La construction était faite de mauvais matériaux, et Castil-Blaze dès 1855 signalait le danger de l'incendie pour « cet amas de bois et de plâtras ».
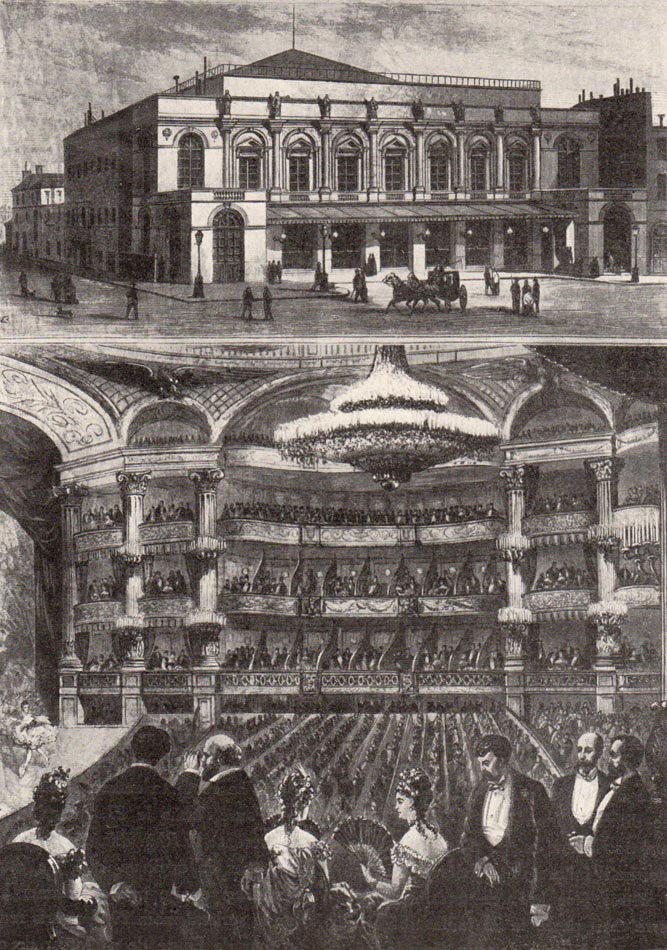
l'Opéra de la rue Le Peletier
L'Opéra jouait trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, et de temps à autre le dimanche. Le tarif des places, depuis le 3 mars 1869, était le suivant :
|
Orchestre Parterre Amphithéâtre Baignoires Premières loges d'avant-scène et de face ou du foyer Premières loges de côté ou de balcon Deuxièmes loges de face Deuxièmes loges de côté Troisièmes loges de face Troisièmes loges de côté Quatrièmes loges de face Quatrièmes loges de côté Quatrième amphithéâtre Cinquièmes loges |
12 fr. 7 fr. 15 fr. 12 fr. 14 fr. 12 fr. 12 fr. 10 fr. 9 fr. 6 fr. 6 fr. 3 fr. 3 fr. 3 fr. |
Dans ce tarif ne sont pas comprises les loges sur la scène, réservées au directeur.
L'Opéra avait son magasin de décors dans la rue Richer. Détruit par un incendie dans la nuit du 19 au 20 juillet 1861, il avait été reconstruit l'année suivante sous la direction de l'architecte Garnier, le même qui venait d'être chargé de la construction du nouvel Opéra, déclaré d'utilité publique par un décret du 29 septembre 1860.
Le projet pour cet édifice avait été mis au concours, devant un jury présidé par le comte Walewski, ministre de la maison de l'Empereur, et composé de douze membres, Lebas, Gilbert, Caristie, Duban, de Gisors, Hittorff, Lesueur, Lefuel, membres de l'Institut, de Cardaillac, Fuestel, Lenormand, Constant Dufeux, membres du Conseil général des bâtiments civils.
Après plusieurs éliminations, ce jury qui avait à choisir entre 143 projets, ne parvint pas à décerner la suprême récompense, et il fallut procéder à un nouveau concours dont le résultat, proclamé le 2 juin 1861, fut l'adoption à l'unanimité du projet présenté par Charles Garnier, ancien élève de l'école des Beaux-arts, prix de Rome en 1848. Les travaux commencèrent au mois d'août et furent presque aussitôt entravés par une difficulté imprévue : à huit mètres de profondeur, on trouva une nappe d'eau, véritable rivière souterraine, qu'il fallut épuiser pour établir les fondations, dix mètres plus bas, en terrain solide. La première pierre était posée le 28 juillet 1862, la maçonnerie commençait à sortir de terre l'année suivante, la façade était découverte le 15 août 1867, et en 1870 le gros œuvre était à peu près achevé.
Le 19 juillet, le tableau de service de l'Opéra portait :
A une heure, au foyer des chœurs : la Muette.
Ensuite, la Marseillaise. Tout le monde. MM. Massé et Delibes.
Massé et Delibes étaient alors chefs des chœurs à l'Opéra. Pendant qu'ils faisaient répéter les ensembles, la soliste désignée, madame Marie Sass, répétait la Marseillaise « avec MM. Perrin et Gevaert », sans doute dans le bureau du directeur. Gevaert était directeur des études musicales. Marie Sass, de son vrai nom Marie Sax, était venue du café-concert au Théâtre-Lyrique, puis à l'Opéra en 1860. Elle avait créé le rôle d'Élisabeth dans Tannhäuser, le 13 mars 1861, et c'était une des interprètes préférées de Meyerbeer. Le rôle de Selika dans l'Africaine lui avait valu un grand succès en 1865. Une caricature du temps nous la montre jouant du trombone, joues et poitrine gonflées, entre J.-B. Faure qui mange un poulet vivant, dans le rôle de Nelusko, et Naudin qui fait un cours de géographie sous le costume de Vasco ou Fiasco de Gama (9).
(9) Caricature de Hadol, reproduite dans le livre de M. Henri de Curzon sur Meyerbeer, page 131.
Le lendemain on avait la preuve que la précaution était bonne. Après le duo du deuxième acte de la Muette de Portici, « Amour sacré de la patrie », le public demanda la Marseillaise. Alors Georges Colleuille, dont les fonctions comportaient, comme on dit au théâtre, de « parler au public », s'avança et prononça cette phrase : « Messieurs, pour se conformer à votre désir, madame Sass chantera la Marseillaise après le troisième acte ».
Il en fut de même à la représentation du 22, à cela près que cette fois le deuxième couplet fut chanté par Faure, qui ce soir là venait remplacer Devoyod dans le rôle de Pietro.
Le 23, on mettait en répétition un autre morceau de circonstance, le Rhin allemand d'Alfred de Musset, mis en musique par le pianiste Charles Delioux. Le secret ne fut pas gardé, et ne pouvait l'être. Le 25, on se contenta encore de la Marseillaise, chantée par Faure. Mais le 27, quand il eut fini, des cris s'élevèrent : le Rhin allemand ! Colleuille accourut sur la scène et expliqua que les études n'étant pas terminées, on ne pouvait donner le Rhin allemand que le surlendemain 29. Les cris redoublèrent. Ce fut au tour de Faure de s'efforcer de calmer le tumulte en s'excusant de ne pouvoir donner satisfaction aux vœux de l'auditoire : par deux fois il prit la parole, par deux fois sa voix fut couverte. Colleuille revint, et fut hué. Il fallut appeler le commissaire de police et faire baisser le rideau. Cet expédient ne fit que redoubler le tapage. Sur la scène on tenait conseil. Faure cédant à d'instantes prières fini par « se décider à chanter le Rhin allemand, mais à la condition que monsieur Caron qui se trouvait au théâtre terminerait le rôle de Pietro », dans les deux derniers actes de la Muette. Alors, « le personnel des chœurs ayant été réuni, on a relevé pour la troisième fois le rideau et le régisseur a annoncé que pour se rendre aux vœux du public la répétition générale du Rhin allemand qui devait se faire à la fin du spectacle, allait avoir lieu immédiatement devant lui ». On excusait ainsi de probables défaillances d'exécution, qui d'ailleurs passèrent inaperçues dans l'enthousiasme général.
Le vendredi 29, tout était prêt. On décida, pour ne pas finir trop tard, de ne donner que les quatre premiers actes de la Muette. Au troisième entracte, le Rhin allemand fut chanté par Faure et les chœurs, et suivi, à la demande du public, de la Marseillaise dont Marie Sass chanta le premier couplet, Faure le second. Le Rhin allemand était cette fois présenté avec une figuration appropriée. Quatre-vingt-quatorze soldats étaient sur la scène ; ils étaient venus, le même jour à une heure, pour apprendre à se placer. Les chanteurs des chœurs étaient habillés les uns en mobiles ou en zouaves, les autres dans les costumes du Freischütz. Le décor était celui de la kermesse de Faust, et Faure portait un uniforme d'officier de la garde nationale.
Le 1er, le 3 et le 5 août, on jouait encore la Muette, avec le Rhin allemand et la Marseillaise. Le 8 août, c'était aussi la Muette, mais le Rhin allemand était remplacé par un autre morceau, A la frontière, ode-cantate avec solo et chœurs, dont Gounod venait d'écrire la musique sur un poème de Jules Frey. Le soliste fut le baryton Devoyod, et voici le premier couplet :
Entendez-vous cette immense rumeur
Qui va grondant autour de nos murailles ?
Est-ce le glas, prophète de malheur,
D'un peuple entier sonnant les funérailles ?
C'est l'étranger : sur notre sol sacré,
Sur notre sol rebelle à l'esclavage,
Il veut planter son drapeau détesté,
Et de la France accomplir le partage.
Ces pauvres vers traduisent une inquiétude sincère, et les coups de canon que Gounod avait mis à l'orchestre étaient d'une vérité prophétique.
L'ode-cantate ne fut chantée que deux fois, le 8 et le 10 août, toujours avec la Muette. Le 12 et le 15, on ne donnait que la Marseillaise, à un entracte de la Muette et du Freischütz. Le 17, on jouait la Favorite suivie d'un ballet du compositeur russe Minkous, Néméa, et le livre de la régie porte cette remarque : « La Marseillaise n'a pas été demandée ».
Elle fut chantée de nouveau le 19, par Marie Sass, le 22 par mademoiselle Hisson, au troisième entracte de la Muette, et une dernière fois le 2 septembre, au commencement du troisième acte de Guillaume Tell, par Caron en uniforme de garde mobile.
Les recettes du mois d'août atteignirent encore la somme de 88.730 fr. 77. La vie du théâtre continuait, avec les allées et venues d'artistes, tour à tour en congé, qui sont de règle en ces mois d'été. Le 29, Marie Sass faisait sa rentrée dans le Trouvère.
Mais en septembre, les événements se précipitent. Dès le 4, tous les théâtres sont fermés à l’exception du Châtelet et le 10, une ordonnance de police généralise cette mesure. Le livre de régie n'a plus rien à signaler, sinon, quelques jours plus tard, cet événement :
Le siège de Paris commence aujourd'hui 18 septembre.
Le 1er octobre, une note du Secrétaire de l'administration Avrillon avertit les artistes et employés de la maison que la subvention est supprimée et que les appointements seront payés pour le mois échu, puis suspendus jusqu'à nouvel ordre. Ils se réunissent, le 7 octobre, et adressent au ministre de l'instruction publique Jules Simon une supplique où ils font valoir la détresse où vont se trouver beaucoup d'entre eux et le caractère national de l'Opéra. Leur directeur est plus avisé : il forme le projet d'une société en participation qui donnera des concerts à l'Opéra. Pasdeloup, toujours entreprenant, vient justement de diriger, le 23 octobre, au Cirque national, un concert de musique classique au bénéfice de l'œuvre des Fourneaux, et le public ne lui a pas manqué. Les statuts de la société sont adoptés à l'unanimité par la réunion qui a lieu de 27 octobre. Les délégués seront, pour le chant, Villaret et Caron, pour l'orchestre, Leroy et Garcin, pour les chœurs, Bay et Margaillan. On décide que le bénéfice du premier concert sera consacré aux victimes de l'incendie de Châteaudun. Le lendemain 28, le ministre accordait aux artistes « l'autorisation de se constituer en société, pour donner à leurs risques et périls des concerts qui auront lieu le jeudi et le dimanche, concerts dans lesquels on ne fera que de la musique sérieuse, sans décorations ni costumes ».
Emile Perrin, pour la circonstance, reprit bénévolement sa place à la tête de son personnel, qui se trouvait presque au complet. Le livre de la régie ne signale, comme ayant quitté Paris avant le siège, que Gevaert, directeur de la musique, Massé, chef des chœurs, deux chanteurs et sept chanteuses des chœurs, un danseur et sept danseuses, ainsi que madame Taglioni, inspectrice de la danse, absente par congé, treize musiciens de l'orchestre. Les défections étaient un peu plus nombreuses parmi les artistes du chant ; étaient absents Faure, Colin, David, Castelmary, Sapin, Mechelaere, Cléophas, Tissier, mesdames Carvalho, Mauduit, Bloch, Thibaut, Godefroy. L'archiviste Nuitter vint se mettre à la disposition du comité. Il fut décidé que Colleuille le père conserverait « officieusement sa fonction d'inspecteur général de la salle et du contrôle ». Quant à Georges Colleuille, il continua, en qualité de régisseur de la scène, de venir à l'Opéra sans manquer un seul jour, avec un dévouement qui n'est pas rare au théâtre, mais dont les exemples les plus touchants se trouvent peut-être en une maison dont le passé glorieux inspire une légitime fierté à tous ceux qui en font partie.

caricature de Jean-Baptiste Faure par Edward Ancourt
Le premier concert fut donné le 6 novembre, sous la direction de Georges Hainl. Le programme comprenait l'ouverture de Guillaume Tell, des fragments d'Alceste, du Prophète, du Freischütz, de la Muette, des Huguenots, et le Chant du départ de Méhul. Villaret, Devoyod, Ponsard, Bosquin, Caron, Gaspard, mesdames Gueymard-Lauters et Julia Hisson étaient les principaux solistes. Selon l'usage des concerts, l'orchestre était à sa place, les artistes sur le devant de la scène, et les chœurs placés sur une estrade qui montait jusqu'au deuxième plan. Le prix des places allait d'un franc à six francs, et pour la première fois les dames étaient admises à l'orchestre. La recette fut de 6.788 francs. C'était un encourageant début.
La semaine suivante, on mettait à l’étude les chœurs du Tannhäuser.
La marche fut jouée au concert du 13 novembre, à celui du 17, accompagnée cette fois de chœurs, ainsi que le 4 décembre. Personne ne songea à protester.
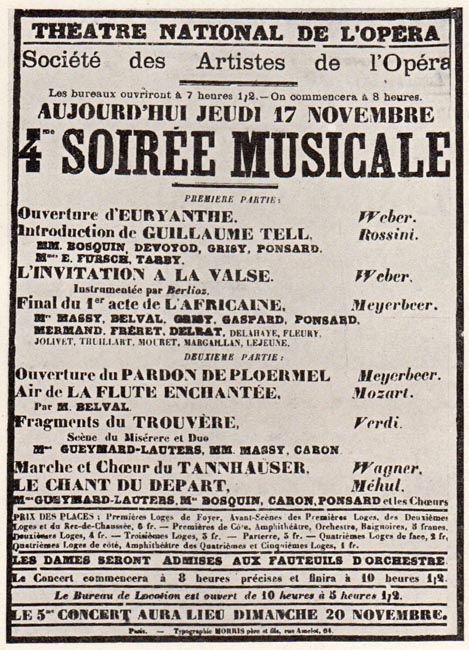
affiche du concert donné à l'Opéra le 17 novembre 1870
Le 6 décembre, Delibes devait partir. Sa lettre, hâtivement écrite sur du papier à en-tête de la Garde nationale du département de la Seine, Etat-major, a été intercalée dans le livre de la régie par Colleuille à qui elle était adressée :
Mon cher ami,
Je reçois à l'instant l'ordre de partir en avant de Vincennes. Il n'y a pas à hésiter.
Je vous en prie, faites le nécessaire avec Georges Hainl et Vauthrot pour que les dames puissent répéter la bénédiction des drapeaux.
La scène que Delibes était chargé de faire répéter aux dames des chœurs et qu'il confiait aux soins du chef d'orchestre et d'un chef de chant était tirée du Siège de Corinthe de Rossini. Elle fut en effet exécutée au prochain concert.
Du 6 novembre au 12 mars, les artistes de l'Opéra donnèrent dix-neuf concerts, dont la recette totale fut de 73.672 frs. Le vingtième concert était annoncé pour le 19. On y devait donner, comme à plusieurs des précédents, le Désert de Félicien David. Il ne put avoir lieu, « par suite des événements politiques » : cet euphémisme désigne l'insurrection de la Commune.
Le 1er mai, les artistes étaient convoqués à l'Opéra. Le « citoyen Regnaud, secrétaire général de l'ex-préfecture de police », leur fut présenté par Emile Perrin et prit aussitôt la parole.
Il ne faut pas, disait-il, que les membres de la Commune, que l'on traite parfois de Barbares et de Vandales, veuillent, parce qu'ils font démolir la colonne Vendôme, faire subir un échec à l'art.
En conséquence, il communiquait aux artistes, de la part de son gouvernement, le désir de voir l'Opéra organiser des représentations. La première devait être donnée au bénéfice des blessés de la garde nationale. Emile Perrin, mandé à la préfecture, expliqua qu'il ne croyait pas possible de réunir un personnel assez complet, et le 9 mai, il était révoqué par un décret qui lui donne pour successeur le citoyen Eugène Garnier, assisté d'une « commission instituée pour veiller aux intérêts de l'art et des artistes » et composée des citoyens Cournet, A. Regnard, Lefèvre-Roncier, Raoul Pugno, Edmond Levraud, Selmer.

caricature de Villaret par Etienne Carjat
Le livre de la régie donne, le 10 mai, le tableau de la nouvelle administration.
Directeur : Eugène Garnier, artiste des Bouffes.
Secrétaire général : Adolphe Dupeuty.
Directrice des études musicales : la citoyenne Ugalde.
Secrétaire de Mme Ugalde : Ed. Philippe.
Eugène Garnier avait en effet chanté aux Bouffes-Parisiens, et partagé quelque temps avec Ugalde la direction de ce théâtre. En se rendant chez Perrin, il s'était muni, à tout hasard, d'un mandat d'arrêt qui ne fut pas utile : la transmission des pouvoirs se fit sans difficulté.
Dupeuty était un journaliste et vaudevilliste, ami de Noriac, l'auteur du Cent-unième régiment, qui lui fit une préface pour un livre publié, en 1864, sous ce titre : Où est la femme ? C'est un recueil d'anecdotes sur l'Opéra, lestes mais non sans lourdeur, qui commence par cette phrase : « Quand je serai directeur de l'Opéra, ce qui ne peut manquer d'arriver, puisque je ne sais pas une note de musique ». Le 12 mai, le nouveau directeur était présenté aux artistes par Regnaud, accompagné de Levraud, Pugno et Selmer. Il les traitait aussitôt de « chers camarades » et leur promettait deux représentations pour commencer, le 20 et le 22.
Le directeur et son comité s'occupèrent sans tarder du programme. Raoul Pugno y fit inscrire deux morceaux de sa composition, un Hymne aux immortels, et un chœur intitulé l'Alliance des peuples. Selmer, qui était aussi du comité, réussit à faire agréer une Marche funèbre dont il était l'auteur. Mais il fallait aussi des fragments d'opéras, et le recrutement des chanteurs n'allait pas sans difficultés. C'est ainsi que le 14 mai Edouard Philippe doit se rendre, sous les obus, à Boulogne et à Passy pour s'entendre avec Morère (10) et Melchissédec. Il ne peut aller jusqu'à la maison du premier, et chez l'autre ne trouve que sa mère qui promet de faire son possible. Morère cependant fut touché par une lettre qu'on lui avait adressée, « par précaution », au café de Suède. Mais le lendemain, il arriva un événement bien fâcheux : le père de Melchissédec, ancien commissaire de l'Empire, était arrêté. On craignait que le fils, mécontent, ne refusât son concours, et cependant, disait madame Ugalde qui ne manquait pas d'expérience, « ce serait un excellent moyen de tout arranger ».
(10) Morère devait chanter un hymne de Darcier, intitulé Quatre-vingt-neuf, qui fut ensuite retiré du programme à la requête du chef d'orchestre Hainl.

Delmas dans les Huguenots (photo Bert)
Le 17 mai, d'autres difficultés surviennent. Pugno n'est pas content : il se plaint qu'on néglige, au bénéfice des morceaux du répertoire, les œuvres nouvelles, qui ne seront pas prêtes. Il faut remplacer, faute d'interprètes, les airs de la Juive et de Don Juan. Le choix de la direction se porte sur le Trouvère et le 4e acte de la Favorite, avec madame Ugalde dans le rôle de Léonore. Pugno et Selmer ont gardé le respect des grandes œuvres : ils « déclarent ce projet insensé et ajoutent que la commission n'acceptera pas cette combinaison ». Enfin Georges Hainl, qui a accepté de diriger l'orchestre et vient seulement d'arriver, examine le programme : il demande et obtient qu'on en retire la Marche funèbre de Selmer. De tous ces tiraillements il résulte que la représentation du samedi 20 ne peut avoir lieu. Ce ne devait pas être une représentation, d'ailleurs, mais un spectacle coupé où seuls les actes du Trouvère et de la Favorite seraient donnés dans leurs décors. On posa des affiches le dimanche 21 pour la soirée du lendemain, qui comportait le même programme et n'eut pas lieu davantage, parce que ce dimanche, vers le soir, les troupes régulières ou versaillaises commencèrent d'entrer dans Paris.
Le lendemain, les fédérés, menacés d'un mouvement tournant par le boulevard Malesherbes, évacuèrent sans combat le quartier de l'Opéra pour se retirer sur la butte de la Madeleine, bien que plusieurs bataillons eussent été cantonnés à la mairie de la rue Drouot, un autre, le 174e, dans la cour du théâtre qui lui faisait face, et qu'on eût élevé deux barricades dans la rue Drouot, l'une au coin de la rue Rossini, l'autre au coin du boulevard. On forçait les passants à y travailler, si bien que « la charmante mademoiselle Arnaud, qui venait s'assurer de ce qui se passait à l'Opéra, fut également obligée de payer son tribut à la défense de la Commune en jetant deux pavés sur la barricade des rues Rossini et Drouot ».
Antoinette Arnaud avait un emploi de soprano léger à l'Opéra et portait avec crânerie les travestis d'Urbain et de Jemmy, dans les Huguenots et Guillaume Tell. Inscrite au programme de ce 22 mai, pour l'air des bijoux de Faust, elle devait être encore tout émue quand arrivée au théâtre elle y fit le récit de sa mésaventure, désormais consignée au livre de régie.
Elle épousa plus tard un capitaine d'infanterie.

Léo Delibes par Louise Abbéma
III
Réouverture de l'Opéra. — Débuts de la direction Halanzier.
(9 juillet 1871 - 30 décembre 1874)
Le retour du gouvernement parlementaire avait rendu l'espoir aux artistes. Cependant ils ne voyaient rien venir. Le 17 juin, ils adressaient une pétition à l'Assemblée nationale pour obtenir le rétablissement de la subvention. Mais l'Assemblée nationale ne peut inscrire immédiatement cette question à l'ordre du jour. Ils décident alors de se former en société pour exploiter eux-mêmes l'Opéra. La société est constituée le 3 juillet. Elle comprend le personnel administratif, les artistes du chant et de la danse, des chœurs et de l'orchestre. Les artistes du chant qui en font partie sont : Mmes Gueymard-Lauters, Julia Hisson, Mauduit, Berthe Thibault, Arnaud, Fursch, Bloch, Desbordes ; MM. Villaret, Colin, Bosquin, Grisy, Hayet, Mermand, Caron, Delrat, Gaspard, Bouhy, Cléophas, Ponsard, Fréret. Les artistes de la danse sont Mlles Beaugrand, Fonta, Fiocre (E.), Marquet, Mérante, Parent, Lamy, Stoïkof, Montaubry, Pallier, Vilcoq, Fatou, Invernizzi, Parent (A.), Mooris (A.), MM. Mérante, Remond, Carnet, Pluque, Friant, Mérante (F.).

Caron
Le comité administratif comprend, sous la présidence de Perrin, G. Hainl, chef d'orchestre, Victor Massé, chef de chant, Villaret, Caron, artistes du chant, Mérante, de la danse, Margaillan, Bay, des chœurs, Leroy, Garcin, de l'orchestre. Chaque membre de la société signait l'engagement suivant :
Nous soussignés, artistes du chant et de la danse, déclarons faire acte d'adhésion à la Société autorisée par M. le Ministre de l'instruction publique et à donner à ladite société notre concours le plus entier tant pour les représentations et répétitions que pour tout ce qui sera utile au bien et à l'intérêt général.
Nous nous engageons à nous soumettre au règlement général de l'Opéra qui reste en vigueur et nous acceptons la réduction proportionnelle qui, en cas d'insuffisance des recettes, serait exercée mensuellement sur les émoluments dépassant 6.000 francs par année.

Mlle Arnaud
Le même jour, le ministre donnait son autorisation et accordait à la Société, à défaut de la subvention toujours supprimée, un secours de 50.000 francs par mois. Mais, le 9 juillet, on apprenait que Perrin était nommé administrateur de la Comédie-Française en remplacement de Thierry, démissionnaire depuis le 4 septembre 1870. C'est Halanzier qui était désigné comme administrateur, à titre provisoire, de la Société des artistes de l'Opéra.
Perrin avait reculé devant les difficultés de l'entreprise. On ne savait pas combien de temps serait nécessaire pour rendre à l'Opéra son ancienne prospérité, ni même s'il la retrouverait jamais. Une seule chose était certaine ; c'est que la subvention, quand elle serait rétablie, ne dépasserait pas 800.000 francs, les 100.000 francs ajoutés par la cassette de l'Empereur ayant disparu avec le régime aboli. Perrin déclara que l'Opéra ne pouvait vivre dans ces conditions (11) et se retira. Halanzier eut plus de courage.
(11) D'après Halanzier, Exposé de ma gestion de l'Opéra, page 4.
Né en 1819, Olivier Halanzier-Dufrénoy était le fils d'une actrice qui eut son heure de succès sous la Restauration, et d'un ancien officier du premier Empire, capitaine de cavalerie en demi-solde. Quand sa mère ayant quitté la scène fut devenue directrice de théâtre, il fut son collaborateur. C'est à son école qu'il apprit les ressources et les tours du métier qu'il exerça ensuite à Rouen, Marseille, Bordeaux, Bruxelles, Strasbourg et Lyon.

Mlle Fiocre
Le bâtiment de l'Opéra était intact, rien ne manquait au magasin, et le personnel, malgré quelques absences, suffisait à assurer les représentations. Dès le 12 juillet, Halanzier pouvait rouvrir l'Opéra. Sans se mettre autrement en frais d'imagination, il inscrivit au programme de cette soirée d'inauguration l'ouvrage joué si fréquemment aux mois de juillet et d'août de l'année précédente, la Muette de Portici. Ce choix d'ailleurs était aussi un hommage à la mémoire d'Auber, qui venait de mourir le 12 mai.
Rien de changé pour l'interprétation. Le rôle de Masaniello fut chanté par Villaret, excellent artiste, toujours sur la brèche et d'une fidélité à toute épreuve, qu'un contemporain (12) appelle « une des colonnes chantantes qui soutiennent le mieux le vaste et fatigant répertoire de l'Opéra, où ce ténor a abordé avec un constant succès les rôles les plus difficiles ». Agé à cette époque d'une quarantaine d'années, il était déjà sous la direction de Perrin de presque toutes les distributions, avait donné son concours à tous les concerts de l'Opéra pendant les derniers mois, même à celui du 22 mai, et méritait pleinement l'éloge que lui décerne, quelques années plus tard, ce quatrain anonyme (13) :
C'est un ténor incomparable,
S'il arrivait de Londres, il n'aurait pas son prix ;
Mais c'est un grand coupable :
Il n'a jamais quitté Paris.
(12) D'Heylli, Foyers et coulisses, Opéra, tome III, page 362.

Mlle Fonta
On rencontrait déjà, et jusqu'à nos jours on trouve encore à l'Opéra de tels artistes, dont la conscience professionnelle et le dévouement font contraste avec les caprices de certains de leurs camarades, et qui seraient plus célèbres encore, s'ils avaient fait parler d'eux davantage ; mais ils aiment trop la maison pour la quitter ; ils y passent leur vie entière ; on ne mène pas grand bruit autour d'eux ; et quand ils disparaissent, on s'aperçoit qu'on n'a personne pour les remplacer.
Caron, qui chantait ce soir-là le rôle de Pietro, appartenait à la même lignée (13) :
Un artiste modeste, ennemi des réclames.
Saluez ! de combien en peut-on dire autant ?
Excellent comédien : un Mazetto frappant.
Il plaît aux vrais artistes, il ne plaît pas aux femmes.
(13) L'Opéra, Eaux- fortes et Quatrains (attribués à F. Cohen). Paris, Jouaust, 1876.
Moins brillant que Faure, il avait sur lui le précieux avantage d'être toujours là, et c'est ainsi qu'en l'absence de Faure, c'est Caron qui avait eu l'honneur de chanter la Marseillaise à la dernière représentation de l'Opéra, le 2 septembre 1870. Il avait débuté dans le Trouvère le 22 septembre 1862.
Bosquin, le second ténor, chargé du rôle d'Alphonse, avait débuté le 18 octobre 1869 dans la Favorite, et comme les précédents, était demeuré à Paris pendant le siège et la Commune. Il en était de même pour Antoinette Arnaud qui dut peut-être à cette circonstance le rôle, un peu fort pour elle, d'Elvire. Le rôle muet de Fenella était mimé, comme toujours, par Eugénie Fiocre, célèbre pour sa beauté plastique (13) :
Déesse aux cheveux d'or, fille de Praxitèle,
Toi qu'on eût adorée aux bords de l'Eurotas,
Pour nous faire admirer ta splendeur immortelle
A Vénus de Milo que manque-t-il ? Tes bras.
(13) L'Opéra, Eaux- fortes et Quatrains (attribués à F. Cohen). Paris, Jouaust, 1876.
On pouvait donc dire, en parodiant un mot célèbre, fort anachronique en l'occurrence, qu'il n'y avait rien de changé à l'Opéra, mais seulement une représentation de la Muette de plus. Celle-ci produisit une recette, fort honorable pour le temps où l'on était, de 8.727 fr. 69. Elle se termina à 11 heures 43 minutes, en violation flagrante de l'ordonnance du maréchal de Mac-Mahon, commandant en chef de l'armée de Versailles, en date du 30 mai, qui prescrivait de fermer tous les lieux publics à onze heures du soir « en raison des circonstances exceptionnelles où se trouve en ce moment la ville de Paris et de la nécessité de rétablir promptement la tranquillité publique ». Mais le lendemain 13 juillet l'ordonnance était rapportée, le délai prorogé jusqu'à minuit ; l'Opéra ne fut pas inquiété pour cette légère anticipation.
Les représentations continuèrent, avec ces programmes et ces recettes :
|
14 juillet 1871 17 juillet 1871 19 juillet 1871 22 juillet 1871 24 juillet 1871 26 juillet 1871 28 juillet 1871 31 juillet 1871 |
le Trouvère, Néméa la Muette de Portici la Favorite, Néméa les Huguenots les Huguenots Faust Faust les Huguenots |
5.088,00 2.265,64 1.673,00 5.164,92 3.511,13 6.890,64 4.949,51 4.642,33 |
Avec la recette du premier jour, le total fut ainsi, pour le mois, de 42.902 fr. 76. C'est un total très faible si on le compare à ceux de l'année précédente. Il faut observer que l'abonnement n'avait pas encore repris son cours. Mais même en tenant compte de ce déficit, on voit qu'à aucune des représentations on ne retrouva un chiffre de recettes comparable à celui de la première, dont le succès n'était dû qu'à un mouvement de curiosité.
Au mois d'août, les recettes sont moins élevées encore : elles n'atteignent, pour tout le mois, que 45.373 fr. 68. C'est en vain que la Juive a été réintégrée au répertoire. Les deux représentations qui en furent données, le 11 et le 14, n'ont eu que 3.610 fr. 65 et 2.894 fr. 30 de recette.
Les résultats de septembre furent meilleurs. On rentrait de villégiature. Les recettes montèrent, pour le mois, à 60.462 fr. 70. Halanzier eut alors l'idée passablement aventureuse de monter, sans plus attendre, un ouvrage nouveau, pour montrer son savoir-faire et sans doute aussi pour se faire bien voir des autorités : il n'était administrateur que provisoirement ; comment n'eût-il pas aspiré au titre définitif ?
Erostrate est un opéra en deux actes, qui avait été commandé à Reyer en 1862 par Bénazet, fermier des jeux de Bade. Le poème est de Méry. Bénazet demandait chaque année, pour le théâtre annexé à ses « salons de conversation », un ouvrage inédit à un ou deux compositeurs français. Chaque ouvrage ne devait avoir que deux représentations. Dans ces conditions, le succès était à peu près assuré. Le public d'une station balnéaire qui était en même temps une maison de jeux se montrait incapable d'un sérieux effort d'attention, mais d'humeur assez facile. Les comptes rendus de la presse étaient toujours favorables, et on pouvait presque dire que la partie était gagnée d'avance.
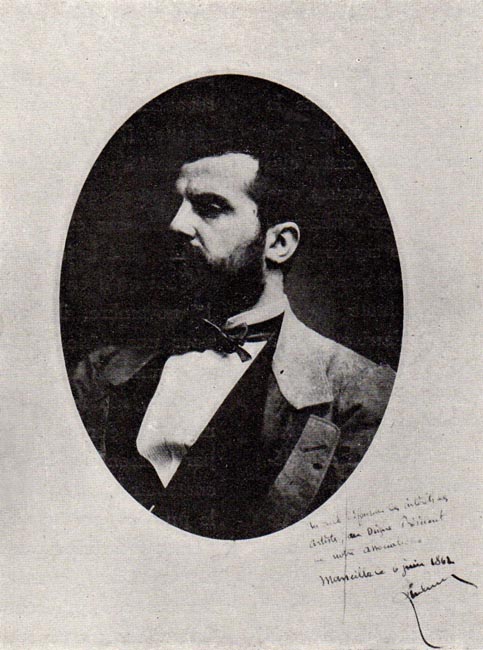
Halanzier
En 1862, Bénazet, qui inaugurait une nouvelle salle cette année-là, s'était adressé à Berlioz et à Reyer. Le premier lui avait donné Béatrice et Bénédict, représenté le 9 août, le second Erostrate, donné le 21 du même mois, tous deux bien accueillis.
Reyer, âgé alors de quarante-huit ans, n'était pas un inconnu, loin de là. Lié d'amitié avec plusieurs hommes de lettres tels que Méry, originaire comme lui de Marseille, Théophile Gautier, Maxime du Camp, Camille du Locle, il avait succédé à Berlioz, comme critique musical des Débats, en 1866. Il avait déjà fait représenter Maître Wolfram, opéra-comique en un acte, au Théâtre-Lyrique, le 20 mai 1854, le ballet de Sacountala, sur un scénario de Théophile Gautier, à l'Opéra le 14 juillet 1858, et la Statue, opéra-comique en trois actes, au Théâtre-Lyrique le 11 avril 1861. Ce dernier ouvrage avait fort bien réussi.
A qui revient l'idée de monter Erostrate à l'Opéra ? Théoriquement, c'est le comité de la Société des artistes qui était responsable, Halanzier n'étant que l'administrateur de la Société. Mais un comité, et surtout un comité d'artistes, est d'ordinaire trop divisé pour faire prévaloir une opinion décisive, et il devait être bien aisé à un vieux routier du théâtre comme Halanzier d'imposer, sans trop en avoir l'air, la sienne. Faire entrer Erostrate à l'Opéra, c'était obliger Reyer, et il semblait qu'on ne risquât rien, puisque l'ouvrage avait déjà fait ses preuves. Ainsi devait raisonner cet homme d'expérience, et il se trompait fort, comme il arrive souvent aux hommes d'expérience.
Le poème d'Erostrate est une fantaisie à l'antique où l'auteur a pris avec l'histoire de telles libertés que par endroits il touche, sans le vouloir ni peut-être le savoir, à la parodie, et on voit bien qu'il a plus de goût pour Orphée aux enfers que pour Orphée. Athénaïs, courtisane d'Ephèse, est sollicitée à la fois par le riche Erostrate et par le sculpteur Scopas. Elle repousse les présents d'Erostrate et se jette dans les bras de Scopas, parce qu'il a la gloire, et la lui fera partager. Il vient en , effet d'achever une statue de Vénus dont elle est le modèle et qui est un chef-d’œuvre. Erostrate se désespère :
D'Argos aux rives d'Agrigente
Les rois m'ont admis à leur cour,
Et ma richesse est indigente,
Car je n'ai pas trouvé l'amour.
On voit que Méry ne laissait pas échapper une rime riche, quand il pouvait la capturer. Mais il savait aussi se contenter à moins de frais, comme en ces deux vers chantés en chœur :
Femmes, enfants, vieillards, en foule sont venus
Saluer de leurs chants la nouvelle Vénus.
Mais Junon est jalouse. Elle obtient de Jupiter qu'il frappe de la foudre la statue trop belle. Le coup de foudre emporte les bras de la Vénus de marbre. Athénaïs furieuse demande à Scopas de briser, par représailles, la statue de Diane. Il se refuse à ce sacrilège. Alors Athénaïs appelle Erostrate qui lui obéit : non seulement il brise la statue, mais il met le feu au temple. Il est massacré par le peuple indigné, et Athénaïs meurt avec lui.
C'est ainsi que Méry expliquait l'incendie du temple d'Ephèse, et aussi la mutilation de la Vénus de Milo, en supposant que Scopas fût l'auteur de cette statue, alors plus célèbre encore que de nos jours.
La musique de Reyer est aimable, mais d'une amabilité un peu froide et stérile. La mélodie a de gracieux essors, mais ne va pas loin, retombe pour repartir, toujours réduite à elle-même, sans cette force d'expansion qui fait sortir les idées l'une de l'autre et seule donne à l'œuvre un mouvement soutenu. L'harmonie est tout aussi brusque, sans liant, sans transitions ni dégradations, toute en lignes brisées. On remarque en plusieurs morceaux, notamment dans les couplets de Scopas au premier acte et dans le chœur final, la prédilection du musicien pour les tons chargés d'accidents à la clef, échangeant entre eux leurs dièses et leurs bémols par ces équivoques que les musiciens appellent des modulations enharmoniques. C'est là, comme on sait, un des signes particuliers du style de Reyer. On n'y peut reconnaître que la maladresse d'un musicien qui faute de don naturel ou d'un suffisant exercice, n'arrive pas à maîtriser sa modulation et se laisse entraîner par elle, toujours plus loin de son point de départ. En d'autres ouvrages de Reyer, ces défauts de la technique sont amplement rachetés par la force, la précision et l'élévation des pensées. Mais il ne pouvait se tirer à son avantage d'un sujet qui comme celui d'Erostrate ne lui offrait qu'une intrigue sans vraisemblance et des personnages de convention.
Le rôle d'Athénaïs, créé à Bade par Marie Sass, fut donné pour cette reprise à Julia Hisson, qui avait débuté à l'Opéra dans le Trouvère le 16 juillet 1868. C'était une artiste bien douée pour le théâtre, mais inégale, incapable d'un effort prolongé, et qui pour cette raison n'arriva jamais au premier rang. Le rôle de Scopas fut chanté par Bosquin, le second ténor de la Muette, et celui d'Erostrate par Bouhy, jeune baryton d'origine belge qui faisait partie de l'Opéra depuis 1870 mais devait le quitter en 1872 pour l'Opéra-Comique. Il avait alors vingt-trois ans. Ce n'était pas une interprétation de premier ordre. Quant aux décors, ils n'avaient guère d'importance et on devait trouver aisément, dans le magasin, les colonnades et les rochers nécessaires. L'écroulement du temple, qui termine la pièce et nécessitait un appareillage spécial, fut supprimé.
Erostrate, suivi du ballet de Coppelia, fut représenté pour la première fois à l'Opéra le 16 octobre 1871. La recette fut de 5.673 fr. 88. Elle tombait le surlendemain, avec le même programme, à 1.817 fr. 16. C'était un échec complet, si complet que les artistes prirent peur, et l'ouvrage n'obtint pas la troisième représentation qui était d'usage, et presque de droit. Reyer se plaignit du procédé dans une lettre adressée, le 19 octobre, au comité des artistes, et déclara qu'il retirait Erostrate du répertoire (14). Ce n'est pas Halanzier qu'il met en cause, et il devait savoir comment les choses s'étaient passées. On conçoit d'ailleurs fort bien que les artistes, si la pièce avait été choisie par Halanzier un peu contre leur gré, aient pris leur revanche en refusant de la jouer après une mauvaise recette. Il paraît établi que Julia Hisson n'ait pas consenti à paraître une troisième fois sur la scène dans un ouvrage qui devait l'avoir mise de fort méchante humeur, car elle avait, après la première représentation, giflé le journaliste Jouvin, du Figaro.
(14) Lettre passée en vente le 20 juin 1892 et éditée par Arthur Pougin, Musiciens du XIXe siècle, page 238.
Quoi qu'il en soit, Halanzier arrivait à ses fins : le 1er novembre, il était nommé directeur de l'Opéra pour une période de huit années, qui devait donc se terminer à la même date de l'année 1879. La subvention, réduite à 800.000 francs, lui était promise, mais non donnée, car il fallait que le crédit fût voté par l'Assemblée nationale. En attendant, il devait se contenter du secours mensuel de 50.000 francs. Aussi le prudent directeur s'était-il réservé le droit de donner sa démission, au cas où le crédit serait refusé. Le tarif des places restait le même, ainsi que le nombre des représentations, fixé par l'article 74 du Cahier des charges.
L'Académie de musique donne ordinairement trois représentations par semaine et se réserve de porter le nombre à quatre, jusqu'à concurrence de 182 représentations par an, y compris toutes représentations à bénéfice, celles dites capitations au nombre de deux, au bénéfice de la Caisse des pensions, et les concerts, à l'exécution desquels tous les artistes sont tenus de concourir.
L'article 9 imposait l'obligation suivante :
Le directeur sera tenu de faire représenter chaque année deux ouvrages nouveaux pendant toute la durée de son exploitation : un grand opéra avec ballet ; un opéra ou ballet en un acte.
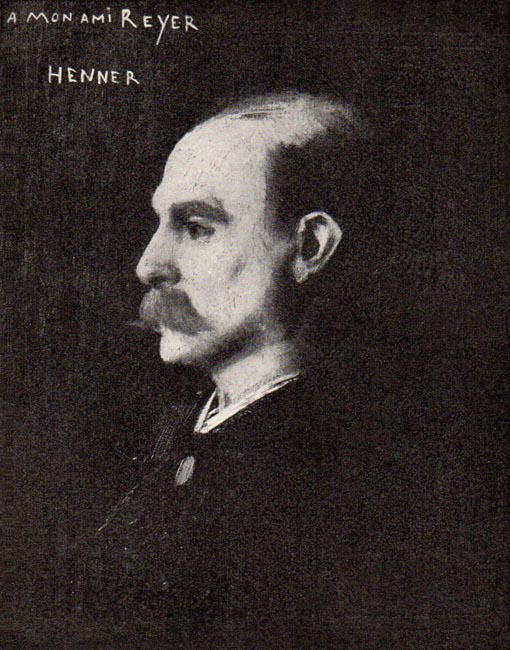
portrait de Reyer par Henner (musée de l'Opéra)
Halanzier, aussitôt en place, fit ratifier les nominations qui lui étaient nécessaires pour avoir son personnel au complet. Il se contenta des changements indispensables, et c'était sans aucun doute le parti le plus sage. Delahaye fut nommé Secrétaire de la direction, mais Avrillon demeura secrétaire de l'administration, et Nuitter, de son vrai nom Truinet, archiviste. Comme régisseur général, il choisit Adolphe Mayer, et Georges Colleuille, second régisseur, prit le titre de régisseur de la scène. Croharé et Salomon furent nommés chefs de chant, et Hustache accompagnateur en remplacement de Léo Delibes qui venait de donner sa démission. Garcin remplaça, comme troisième chef d'orchestre, Deldevez, mis à la retraite, et Mérante devint maître de ballets à la place de Saint-Léon, mort subitement dans les premiers mois de la guerre.
Les chefs de services furent donc :
|
ADMINISTRATION Delahaye Avrillon Nuitter Bleynic Lachausse SCÈNE Mayer Georges Colleuille SALLE Colleuille (père du précédent) CHANT Salomon Croharé Victor Massé Hustache Coedès ORCHESTRE Georges Hainl Ernest Altès Garcin DANSE Mérante Pluque Mathieu Blanchet Mme Z. Mérante |
Secrétaire de la Direction. Secrétaire de l'Administration. Archiviste. Caissier. Chef du service des Abonnements.
Régisseur général. Régisseur de la scène.
Inspecteur de la salle et du contrôle.
Chef de chant. Chef de chant. Chef de chant. Accompagnateur. Souffleur.
Premier chef d'orchestre. Deuxième chef d'orchestre. Troisième chef d'orchestre.
Maître de ballet. Régisseur de la danse. Professeur de danse. Professeur de danse Professeur de danse |
Le personnel artistique restait le même, mais allait bientôt s'augmenter. L'abonnement fut rétabli, le résultat ne se fit pas attendre : les recettes, qui avaient été de 87.879 fr. 40 en octobre, montèrent, pour le mois de novembre, à 161.747 fr. 38. Ainsi l'Opéra retrouvait son public fidèle, beaucoup plus tôt que nous ne serions portés à le croire, d'après notre expérience. Mais la guerre de 1870, si funeste par son résultat, avait pourtant épargné bien des familles, surtout dans les classes riches, à cause du système de conscription et de sa courte durée ; elle n'avait pas bouleversé le commerce et l'industrie, ni ruiné les classes moyennes ; et le changement de régime était sans influence sur les mœurs.
C'est dans ces conditions que le nouveau directeur donna, le 3 novembre, la première représentation dont il eût l'entière responsabilité. C'était une représentation de Faust, dont l'intérêt était augmenté par deux débuts, ceux de Mme Fidès Devriès dans le rôle de Marguerite, et de Pedro Gailhard en celui de Méphistophélès. Mme Fidès Devriès devait bientôt quitter l'Opéra pour l'Opéra-Comique. Pedro Gailhard, né à Toulouse en 1847, avait obtenu au Conservatoire, en 1867, les premiers prix de chant, d'opéra et d'opéra-comique. Engagé d'abord à l'Opéra-Comique où il débutait le 5 décembre 1867, dans le rôle de Falstaff du Songe d'une nuit d'été (15), il méritait, par sa belle voix, de passer à l'Opéra où il conquit d'emblée la faveur du public et devait parvenir aux plus hautes destinées.
(15) Cet opéra-comique d'Ambroise Thomas avait eu sa première représentation le 20 avril 1850.

portrait charge d'Halanzier par Alfred Le Petit, dans le Charivari
Le programme de novembre fut le suivant :
|
01 novembre 03 novembre 05 novembre 06 novembre 08 novembre 10 novembre 12 novembre 13 novembre 15 novembre 17 novembre 19 novembre 20 novembre 22 novembre 24 novembre 26 novembre 27 novembre 29 novembre Total |
Robert le Diable Faust Faust Don Juan Don Juan Don Juan Faust Don Juan Don Juan Don Juan Don Juan Robert le Diable Don Juan la Favorite, Jeanne d'Arc (16) Robert le Diable le Trouvère, le Marché des Innocents (17) Don Juan
|
10.136,00 10.766,59 4.275,14 12.077,30 10.514,73 11.851,24 5.147,74 10.192,03 10.360,99 11.205,48 8.048,97 8.872,61 10.745,30 12.216,63 5.533,88 5.629,24 11.173,00 161.747,35 |
(16) C'est la cantate qui venait de valoir le prix de Rome à M. Serpette. Elle fut exécutée à l'Opéra selon la coutume, ayant pour interprètes Gailhard, Richard et Madame Bloch.
(17) Ballet en un acte de Petitpa, avec musique de Pugni, donné pour la première fois le 29 mai 1861.
Don Juan, qu'on voit reparaître en ce mois de novembre et dont le succès se maintient durant neuf représentations, avait été donné pour la première fois à l'Opéra le 10 mars 1834, dans l'arrangement de Castil-Blaze, Blaze de Bury et Emile Deschamps, avec une interprétation qui réunissait Nourrit, Mesdames Dorus-Gras, Falcon et Damoreau, et le succès depuis lors ne s'était jamais démenti. La dernière reprise avait eu lieu en 1869, et les interprètes de 1871 furent les mêmes, à l'exception de madame Miolan-Carvalho qui à ce moment n'était plus à l'Opéra et fut remplacée dans le rôle de Zerline par madame Thibaut. On retrouva J.-B. Faure dans le rôle de don Juan. Né à Moulins le 15 janvier 1830, engagé à l'Opéra-Comique en 1852, il avait débuté à l'Opéra le 14 octobre 1861 dans un ouvrage du prince Joseph Poniatowski, Pierre de Médicis, et il était professeur au Conservatoire depuis 1857. Il savait admirablement tirer parti d'une voix plus agréable que puissante, se distinguait par son goût musical et son sentiment artistique, et n'avait qu'un défaut : il quittait trop souvent l'Opéra : (18)
Quand dira-t-il enfin : Paris vaut une Messe ?
Il revient, on le fête. Il s'éloigne, on l'attend.
Ah ! s'il pouvait avoir un peu moins de talent,
Et pour son vieux théâtre un peu plus de tendresse !
Le rôle de don Ottavio était chanté par Villaret, celui de Mazetto par Caron, et le rôle de Leporello par Obin, qui était né en 1820 et faisait partie de l'Opéra depuis 1850. Mademoiselle Thibault, chargée du rôle de Zerline, avait débuté dans celui de Marguerite de Faust en juillet 1869. Julia Hisson gardait le rôle de dona Anna, et madame Gueymard-Lauters celui d'Elvire. Cette artiste était à l'Opéra depuis 1857. Née à Bruxelles, elle avait débuté au Théâtre-Lyrique le 15 octobre 1854 sous le nom de Deligne-Lauters, qui réunissait au sien celui de son premier mari. Elle épousa ensuite le ténor Gueymard, qui chantait aussi à l'Opéra. C'était une belle Flamande, dont la voix était d'une solidité à toute épreuve. C'est pourquoi son nom revenait très fréquemment sur les affiches, et le public ne s'en plaignait pas, bien que ce quatrain compare sa splendeur à celle du soleil couchant, et non pas d'une aurore (18) :
Le jour fuit : l'Angelus invite à la prière ;
La reine des moissons chante un dernier refrain,
L'astre-roi disparaît dans des flots de lumière :
Un beau Claude Lorrain.
(18) L'Opéra, Eaux-fortes et Quatrains.

Pedro Gailhard
Il est tout à l'honneur d'Halanzier d'avoir réintégré Don Juan au répertoire dès le début de sa direction. Il est également à l'honneur du public d'avoir assuré à cet ouvrage, pendant trois semaines consécutives, les plus fortes recettes du mois.
En décembre, la reprise de Guillaume Tell avait lieu avec une interprétation beaucoup moins brillante, Dulaurens, dans le rôle d'Arnold, Rondil dans celui de Guillaume, y faisaient leurs rentrées, pour peu de temps d'ailleurs, à l'Opéra ; madame Devriès et mademoiselle Arnaud étaient Mathilde et Jemmy ; les recettes, pour les trois représentations du 6, du 8 et du 10 furent successivement de 8.693 fr. 95, 5.686 fr. 10 et 2.951 francs. C'est pourquoi on en resta là. Le total du mois ne fut que de 125.434 fr. 06. Les plus fortes recettes furent celles du Prophète, dont les trois premières représentations, le 20, le 22 et le 25, donnèrent 10.042 fr. 10, 7.678 fr. 38 et 6.140 francs ; la quatrième, le dimanche 31, tombait déjà à 5.633 francs.

Lassalle
Le lendemain, l'année 1872 commençait par une représentation de Faust qui donna 8.820 fr. 92, avec Bosquin, Gailhard, Caron, mesdames Devriès, Arnaud, Desbordes, et mesdemoiselles Beaugrand, Fonta, Fiocre, dans le ballet, sous la direction de Georges Altès. Déjà Gailhard s'était imposé dans le rôle de Méphistophélès au point qu'à la représentation du 5, où l'on devait encore jouer Faust, comme il se trouva enroué, on changea de spectacle plutôt que de remplacer l'interprète : on donna la Favorite et le ballet de Graziosa, créé le 25 mars 1861, dans le goût espagnol, sur une musique de Labarre. Mais Faust reparut dès que Gailhard fut guéri, le 12 et le 17, ce qui fait trois représentations dans le mois. Le Prophète en eut quatre, les 3, 8, 15 et 19 ; la Favorite deux, le 5 et le 26, et les deux fois par changement de spectacle ; le Trouvère deux aussi, le 10 et le 22 ; Guillaume Tell une seule, le 7. On préparait en même temps la reprise de l'Africaine qui eut lieu le 24 avec un très grand succès : la recette fut de 11.735 fr. 96. Villaret y reprit le rôle de Vasco, Caron celui de Nelusko, Gailhard y parut dans celui de l'Inquisiteur, mesdames Hisson et Devriès furent Selika et Ines. L'Africaine devait encore être jouée le 26 : une indisposition de Villaret s'y opposa. Le 28 on fit relâche pour l'anniversaire de la reddition de Paris. L'Africaine occupa les deux dernières représentations du mois, le 29 et le 31.
Les spectacles de février furent composés du même répertoire, auquel s'ajouta, le 5, le 9, et le 14, Don Juan avec des recettes de 12.392 fr. 96, 12.469 fr. 17, et 9.667 fr. 80 ; le 28 Hamlet, où Faure reprit le rôle principal et dont la recette fut de 11.847 fr. 04.
Hamlet et Don Juan font encore les plus fortes recettes de mars, avec 12.888 fr. 14 pour le premier ouvrage, le 13, et 12.463 fr. pour le second, le 15.
L'Africaine, les Huguenots, et Robert le Diable, se partagent le succès en avril et en mai. Le 7 juin, une représentation de Guillaume Tell, où le baryton Lassalle fait ses débuts, atteint 10.828 francs 71, mais le 10 et le 19 les recettes du même ouvrage descendent à 9.535 fr. 21 et à 6.457 fr. 16.
Le mois de juillet n'offre que des représentations du Trouvère, de Robert le Diable, de l'Africaine et de Faust, sans aucune recette qui dépasse 10.000 francs. Durant tout le mois on travaille à la reprise de la Juive qui a lieu enfin le 19 août avec Villaret, Belval, Bosquin, mesdames Mauduit et Devriès. Belval avait débuté en 1855 dans le rôle de Bertram. Sa voix de basse profonde était une voix rare en France :
Un Raoul, un Robert, ce n'est pas l'oiseau rare,
On en trouve à la Chambre et même à l'Opéra,
Mais les Bertram s'en vont, le ciel en est avare,
Que Belval ait un rhume, Halanzier toussera.
Le livre de régie apprécie en ces termes la reprise de la Juive : « Splendide représentation. Mise en scène des plus admirables et remarquables. Excellente exécution. Public bien justement enthousiasmé. En un mot, grand succès dont la direction doit s'enorgueillir et être fière à juste titre. » De fait, la recette du 19 août fut de 10.365 fr. 99, et la Juive fut jouée sans interruption jusqu'à la fin du mois les 21, 23, 26, 28, et 30, avec des recettes de 8.971,75 ; 11.052,56 ; 9.921, 49 ; 10.316,25 ; 11.089,52.
La Juive obtient encore les plus fortes recettes de septembre, pour être remplacée, en octobre, par la Favorite, dont les recettes, le 4, le 9 et le 11, sont de 12.959,94 ; 12.933,54 et 12.427,86. Mais Don Juan se maintient au même niveau avec 12.508,94 le 6 septembre, 12.578,29 le 14 octobre, 12.072,96 le 22 novembre. L'année se termine par une série de représentations d'Hamlet, le 2, le 4, le 6 et le 13, dont les recettes sont de 10.790,50 ; 9015,60 ; 11.888,10 et 11.594 francs 10.
Le total des recettes pour cette année a été de 1.681.504 fr. 15. La subvention a été votée le 20 mars, après une discussion assez vive où naturellement il se trouva un député pour faire sourire ses collègues en soutenant qu'il n'était guère possible d'assimiler les danseuses de l'Opéra à des fonctionnaires. Mais les interventions énergiques de Jules Simon, ministre de l'Instruction publique, et de Beulé, rapporteur du budget des Beaux-Arts, enlevèrent le vote. Il s'agissait de 940.000 francs, dont 800.000 pour l'Opéra et 140.000 pour l'Opéra-Comique, la subvention de l'un comme de l'autre étant diminuée de 100.000 francs
Avec l'appoint de la subvention, une somme de 50.000 francs représentant la redevance des bals, et 20.000 francs pour les concessions du programme et du buffet, les sommes encaissées étaient de 2.551.504 frs. 15. Les dépenses ne s'étant élevées qu'à 2.150.680 frs. 30, le bénéfice net était de 400.823 frs. 85. C'était pour une première année un résultat encourageant.
Sur le total des recettes, le chiffre imputable à l'abonnement est de 501.607 frs. 65. Dès le premier jour, ils étaient tous revenus, les habitués de l'Opéra, heureux de retrouver ces brillantes soirées où ce n'est pas seulement un plaisir, mais aussi un honneur de se montrer. Le livre de caisse établi à la date du 31 octobre 1871 témoigne de leur empressement. Sur les talons des quittances, voici les noms qu'on relève :
Aux loges d'avant-scène, baignoires et deuxièmes loges : André, Aguado, de Vatry, prince Troubetzkoï, comte de Saint-Sauveur, baron de Fitz-James, duc de Nemours, prince d'Hénin, duc d'Albuféra, comtesse Le Hon, Archdeacor, Toché, Debains, Rambourg de Commettry, comtesse Ferrat, van der Marck, Soubeyran, Decan, Talabot, Hennecart, Benazet, de Basilevski, Boutarel, Acloque, Gaillard, de Camondo.
Aux premières loges : Ashburton, Schneider, Heine, Johnston, Defresne, Calderon (dans la loge dite ex-impériale), Gendrin, Hottinguer, Biesta, comtesse de Waldner, C. Say, Haussmann, Nitot, Bavoux, Monthiers, Piltet, Munster, Firino, Girardin, Cercle de l'Union, Général Fleury, comte Sapieha, E. Brun, Madame André, Garfunkel, veuve Thomas (de Colmar), Madame Renaud, Th. Gentil, Bischoffsheim, Abel Laurent, Sebert, Conegliano, Fould, vicomte de Plancy, Dumont de Sainte-Croix, Ernest Chabrier, Ambassade russe, de Latour du Moulin, Montané, Pillet-Will, Regnault de Querrien, comtesse Roger, comtesse Menckel, de Pontevès, de Casariera, de Bojano, de Castries, comte de Croix, Ch. Laffite, Dollfus-Mieg, baronne de Poilly, comte de Cambaceres, Hollander, Albert Duval, baron Lacaze, Joubert.

danseuses du corps de ballet (d'après une eau-forte de Paul Renouard)
Les loges sur la scène ne devaient en principe être occupées que par la direction, ses invités ou ses collaborateurs. L'article 57 du cahier des charges stipulait même qu'aucune loge « ne pouvait être la propriété du directeur ». Cependant ces loges étaient données, elles aussi, à l'abonnement, moyennant 12.000 francs pour l'année, comme le montrent les reçus établis aux
noms de Morton et Foerbey.
Les dames n'étaient pas admises aux fauteuils d'orchestre. A ces places, on était entre hommes. Mais plusieurs abonnés de fauteuils avaient aussi leur place dans une loge, où se trouvait leur famille. Arrighetti, d'Abancourt, comte de Sange, de Mourgues, duc de Bojanov, vicomte des Maisons, Jemil-pacha, G. Cocteau, van Owenhuysen, de la Boissière, Albert Duruy, Rothschild, de Saint-Martin, Pierre Petit, baron Seillière, prince Galytzine, Oppenheim, Lebas, Rostand, H. Vogt, R. Ledieu, comte de Charnacé, Malançon, Toché, de la Chateigneraie, Laferrière, amiral Saisset, de Sarzana, Michel Ephrussi : tels sont quelques-uns des abonnés qui dès le mois de novembre 1871 avaient repris leurs places à l'orchestre de l'Opéra, lorgnant tour à tour la scène, assez proche pour qu'un sourire, un signe de tête ou un battement des cils n'y fussent pas perdus, et la salle où ils adressaient à plus longue distance des saluts tempérés de bienséances mondaines et de relations personnelles.
L'abonnement était établi, durant l'année complète, pour une des trois soirées du lundi, du mercredi ou du vendredi, ou pour deux de ces soirées, ou pour les trois. Le mercredi était alors le jour le mieux fréquenté. Une société, si choisie qu'elle soit, ne peut demeurer entièrement homogène. Il s'y forme des groupes privilégiés où l'on se donne le mot pour se retrouver à date fixe. Mais le secret ne peut être gardé, le jour choisi est envahi peu à peu par ceux qui veulent en être, sans qu'on les ait spécialement conviés. Alors on en change. C'est ainsi que pendant le demi-siècle qui nous sépare de cette époque le mercredi a été supplanté par le vendredi qui lui-même a cédé au lundi. Le problème n'admettant que des solutions périodiques, on peut prévoir que bientôt le mercredi retrouvera sa faveur, et ainsi de suite. En principe, les abonnés des trois soirs avaient et ont encore seuls accès au foyer de la danse. C'est vers la fin du dix-huitième siècle qu'on avait ainsi régularisé un privilège qui jusque là appartenait à la naissance, ou à l'audace qui savait en tenir lieu, en un temps de mœurs faciles où personne ne se mettait en peine de contrôler l'authenticité d'un titre pourvu qu'il fût bien porté.
Le corps de ballet de l'Opéra a eu, au dix-huitième siècle, une réputation de galanterie sans doute méritée. Encore ne savons-nous pas bien, à cette distance, distinguer la vérité de la légende. Il est probable qu'en ce temps-là, comme au nôtre, le talent pouvait avoir ses aventures, mais ignorait la débauche et surtout le vice. La danse classique est de tous les arts d'exécution celui qui demande l'apprentissage le plus rude et le plus constant exercice. Les leçons, les répétitions et les représentations auxquelles elle prend part ne laissent guère de loisirs à une danseuse vraiment éprise de son art, et ambitieuse d'arriver au premier rang. Le bonheur dont elle rêve est un bonheur tranquille, aussi pareil que possible à celui du mariage, qui pour elle ne peut guère être qu'un mariage de raison.
S'il est des exceptions à cette règle, ce n'est pas au foyer de la danse qu'elles se font remarquer. Il existe en ce lieu une tradition de politesse qui remonte à plus de deux siècles et fut toujours observée. Un huissier en uniforme en garde la porte, et on n'y pénètre que chapeau bas. On offre des bonbons aux danseuses, on leur fait un compliment, et on cause des événements du jour. Le foyer de l'Opéra est un cercle mieux partagé que les autres pour le plaisir des yeux, et un salon de conversation où les danseuses peuvent placer leur mot, mais le plus souvent se contentent de se laisser regarder. Un ancien abonné nous a transmis, sur le foyer de la salle de la rue Le Peletier, ces souvenirs émus (19) :
Vous souvient-il, quand on montait sur le théâtre, du beau suisse vert et écarlate, tout brodé d'or, l'épée au côté, le chapeau en bataille, les armes de l'Empereur sur la poitrine ? Comme il vous montrait que vous entriez dans une bonne maison où la tenue était obligatoire !
Je sais bien que, pris dans son ensemble, ce vieil Opéra n'était pas aussi spacieux, aussi commode, aussi magnifique que le nouveau. Le foyer de la danse n'y brillait ni par le luxe, ni par le confort : c'était une grande pièce attenante à l'hôtel Choiseul, assez mal éclairée, meublée d'une banquette en velours rouge usé, garnie de boiseries ouvragées à la mode du siècle dernier et décorée de glaces au cadre enfumé, écaillé, aux baguettes d'or terni. Pour tout ornement, pour toute relique, on y conservait un buste en marbre de la Guimard, posé sur une simple colonne en bois peint.
Oui, mais sur cette banquette s'était assis, dans ces glaces s'était reflété tout un monde de causeurs et de promeneurs dont on retrouverait difficilement la monnaie parmi les habitués de l'époque actuelle : Balzac, Janin, Gautier, Méry, Roger de Beauvoir, Rolle, Altaroche, Roqueplan, le baron de Bazancourt, Lireux, Perpignan, Romieu, Aguado, les Rothschild, de Saint-Georges, de Lesseps, Halévy, Adam, Boyer, Waez, Gozlan, Eugène Guinot, les deux Reybaud, Taxile Delord, Amédée Achard, Albéric Second, de Boigne, de Dreux-Brézé, Latour-Mézeray, Berlioz, la prince Toufiakine, le colonel Montaigu, M. Schickler, lord Hertford, Chaix d'Est-Ange, Eugène Lamy, Isabey, Gavarni, les Escudier, les Batta, etc.
Sous le second empire, on rencontrait au foyer de la danse le marquis de Massa, le marquis de Caux, les Montreuil, Davilliers, Saint-Léger, des Varannes, Duperré, Fitz-James, Poniatowski père et fils, le marquis de Toulangeon, le baron Lambert, M. de Saint-Pierre, Persigny, le colonel Fleury, le maréchal Bosquet, le comte Arese, les Aguado, le comte Walewski, Mérimée, le comte Lepic, le comte de la Redorte, la Bourdonnaye, de Bernis, Fontenillat, Narichkine, Demidoff, de Gouy, Hamilton, le père Auber qui se réveillait à tous les entr'actes pour faire un brin de cour à la plus jolie, le comte de Saint-Vallier, A. de Vogué, Scépeaux, d'Overschie, les Fould, Delahante, Magnan, Blount.
(19) Ces Demoiselles de l'Opéra, par Un vieil abonné (attribué à Paul Mahalin). Paris 1887. Pages 270, 272.
Voilà certes de beaux noms, dont quelques-uns illustres. Mais ceux qui viennent d'être cités montrent qu'en 1871 l'abonnement de l'Opéra n'avait en rien dégénéré. Le vieil abonné est de tous les temps. Il ne faut pas discuter avec lui, mais écouter sans protester ses doléances, car elles marquent le grand intérêt qu'il continue de porter à une maison où pourtant il ne trouve plus ses amis d'autrefois.
Pendant la première année de sa direction, Halanzier n'avait monté aucune œuvre nouvelle. Il est vrai que l'échec d'Erostrate, survenu quand il n'était encore qu'administrateur, n'avait rien d'encourageant. Mais le cahier des charges était formel : d'un mois de novembre à l'autre il fallait donner un grand opéra, et un ballet ou un opéra en un acte. Halanzier eut alors l'idée de s'adresser à Verdi pour lui demander Aïda, qui lui avait été commandé par Ismaïl Pacha pour l'inauguration du théâtre italien du Caire et venait d'y être représenté le 24 décembre de l'année précédente, avec un grand succès. Le Trouvère était au répertoire de l'Opéra depuis le 1er avril 1857, et Halanzier l'avait repris dès le premier mois de sa direction. Mais Verdi n'était pas bien disposé pour l'Opéra en ce temps-là. Peut-être gardait-il sur le cœur le mauvais sort de Don Carlos, écrit spécialement pour cette scène sur des paroles françaises et donné le 11 mars 1867, qui n'avait pu se maintenir au répertoire. Il répondit par cette lettre (20) :
Busseto, 24 août 1872.
Monsieur Halanzier,
Je vous remercie de la façon tout à fait gracieuse avec laquelle vous avez bien voulu entrer en relations d'affaires avec moi. Je suis aussi particulièrement flatté que vous ayez trouvé la partition d'Aïda digne de l'Opéra. Mais d'abord, je connais trop imparfaitement le personnel actuel de l'Opéra, et ensuite, permettez-moi de l'avouer, j'ai été si peu satisfait toutes les fois que j'ai eu affaire avec votre grand théâtre, que dans ce moment je ne suis pas disposé à tenter une nouvelle épreuve. Il se peut que plus tard, si vous conservez vos bonnes dispositions à mon égard, je change d'avis, mais à présent je n'aurais pas le courage d'affronter encore une fois toutes les tracasseries et les sourdes oppositions qui dominent en ce théâtre et dont je conserve un pénible souvenir.
Excusez-moi, Monsieur, d'avoir peut-être exposé mes idées avec trop de franchise ; mais j'ai voulu vous parler de suite à cœur ouvert pour faire les positions nettes. Cela ne m'empêche pas d'avoir pour vous personnellement, Monsieur, un sentiment de reconnaissance pour les expressions courtoises dont vous avez bien voulu m'honorer dans votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments et de ma considération.
VERDI
(20) Citée par Halanzier, Exposé de ma gestion de l'Opéra, p. 10.

Mme Gueymard-Lauters
En 1864, Carvalho qui dirigeait le Théâtre-Lyrique, avait eu l'idée de mettre au concours un ouvrage pour son théâtre. Le résultat de ce concours fut la Fiancée d'Abydos, de Barthe, d'après Byron. Il fut jugé assez encourageant pour qu'un nouveau concours fût institué en 1869. Mais cette fois, sur l'avis de Camille Doucet, directeur du bureau des théâtres au ministère des Beaux-Arts, l'Opéra et l'Opéra-Comique furent associés au Théâtre-Lyrique et trois ouvrages furent retenus. C'étaient pour le Théâtre-Lyrique, le Magnifique, de J. Barbier et Philipot, pour l'Opéra-Comique, le Florentin, de Saint-Georges et Lenepveu, pour l'Opéra, la Coupe du roi de Thulé, dont le poème était de Gallet et Blau, la musique d'Eugène Diaz. Le musicien qui avait été choisi de préférence à Barthe, Guiraud et Massenet, ses concurrents, était le fils du peintre Diaz de la Peña, célèbre à cette époque pour ses tableaux mythologiques. Il avait fait jouer au Théâtre-Lyrique, le 8 juin 1865, un opéra-comique assez agréable, le Roi Candaule. La guerre était survenue avant que Perrin eût donné à l'Opéra la Coupe du roi de Thulé. Halanzier résolut de tenir l'engagement de son prédécesseur. La difficulté du choix lui était ainsi épargnée.
Le vieux roi de Thulé fait jeter sa coupe dans la mer, sentant la mort venir. La main de sa fille Myrrha et la couronne appartiendront à celui qui la rapportera. C'est le bouffon Paddock qui annonce à la foule surprise ces dernières volontés. Myrrha aime le seigneur Angus et est aimée du pêcheur Yorrick. C'est le pêcheur qui se jette à la mer. Il est reçu au palais des Sirènes et leur reine Claribel l'instruit du destin qui l'attend : elle lui montre au loin, sur terre, Myrrha dans les bras d'Angus. Mais l'amour pour l'ingrate est le plus fort. Yorrick revient aux rives du Thulé et offre sa coupe à Myrrha qui lui dit gentiment merci, mais donne ce précieux gage à Angus. Alors Yorrick appelle la tempête qui engloutit l'île de malheur et retrouve aux profondeurs des flots les douces Sirènes :
Maîtresse immortelle,
Dans ton palais bleu,
Reçois pour jamais ton amant fidèle,
Terre ingrate, adieu !
Le sujet donnait lieu à des oppositions de sentiments et de conditions, à un deuxième acte fantastique et à un dénouement mélancolique dont le musicien pouvait tirer d'heureux effets. Diaz n'y a mis que des barcarolles, pauvrement orchestrées, et c'est pourquoi l'ouvrage, représenté pour la première fois le 10 janvier 1873, ne put se maintenir, malgré l'interprétation qui réunissait Faure dans le rôle de Paddock, le ténor Achard, fils du comédien Pierre-Frédéric Achard, et récemment venu de l'Opéra-Comique à l'Opéra, en celui de Yorrick, Bataille (Angus), mesdames Gueymard-Lauters (Myrrha), Rosine Bloch (Claribel) et Arnaud (Syrène).

Mlle Rosine Bloch
Halanzier fut plus heureux avec le ballet nouveau, représenté le 7 mai de la même année ; c'était Gretna-Green, de Guiraud, sur un scenario de Nuitter, archiviste de l'Opéra, et de Mérante, maître de ballet. C'est sans doute Nuitter qui avait découvert, dans le livre intitulé Itinéraire et souvenirs d'Angleterre et d'Ecosse, par le baron Ducos, ancien ambassadeur de France, et publié en 1834, la description du site de Gretna-Green et de la coutume qu'on y observe pour les mariages ; le passage est cité en tête du scenario :
Il faut que la fiancée arrive la première. Loin qu'elle ait à se défendre, mollement si l'on veut, contre une douce violence, sa bonne volonté doit se manifester par la liberté dont elle jouit et l'empressement qu'elle témoigne. C'est elle qui demande et veut qu'on la marie.
Le forgeron Toby a une fille, Pretty, qui voudrait bien épouser Williams le beau chasseur. Mais le père refuse un pareil gendre, car Williams est pauvre. Le voici justement qui revient de la chasse, il offre à Pretty une alouette blessée. Pretty a pitié du gentil oiseau qui était si heureux de voler jusqu'au ciel ; elle imite en dansant les ébats de l'alouette, et Williams s'attendrit. Un autre couple vient demander au forgeron de les unir suivant la coutume. C'est Jackson et la timide Jenny. Toby consent. Edward est un jeune lord qui a enlevé une jeune fille de son monde, Angelica. Ils s'adressent, eux aussi, au forgeron de Gretna-Green, mais quand la prude Angelica apprend que c'est elle qui doit parler la première, elle n'y veut jamais consentir. Pendant qu'ils se querellent, on entend sonner les cors. C'est le père d'Edward qui chasse dans ces parages et arrive bientôt. Les gens du pays dansent en son honneur. Edward et Angelica empruntent, pour se sauver, les vêtements de Williams et de Pretty, qui mettent les leurs. Pretty imitant de son mieux l'air guindé d'Angelica s'adresse à Toby qui se laisse duper et la marie à Williams, qu'il ne reconnaît pas davantage. La ruse découverte, sa fureur s'apaisera bientôt, car le vieux seigneur donnera une dot à Pretty. On reconnait l'intervention de Mérante en ce scénario dont chaque épisode est l'occasion d'une danse d'expression, de caractère ou d'imitation. C'est un bon scenario de ballet. Guiraud, né à la Nouvelle-Orléans le 23 juin 1837, prix de Rome en 1859, avait alors fait jouer à l'Opéra-Comique Sylvie, le 11 mai 1864, et le Kobold, le 2 juillet 1870. Une suite d'orchestre, exécutée aux concerts populaires en février 1872, l'avait fait connaître comme symphoniste ; il appartenait au groupe des jeunes musiciens qui réuni autour de Camille Saint-Saëns venait de fonder, le 25 février 1871, la Société Nationale.
La musique qu'il a écrite pour Gretna-Green a une grâce alerte, une justesse d'expression et une vivacité de repartie qui étaient exactement les qualités requises en la circonstance, et le nouvel ouvrage, donné après le Trouvère et dansé par Mlle Beaugrand dans le rôle de Pretty, Eugénie Fiocre dans le travesti de Williams, Sanlaville en celui de Jackson, Bourgoing (Angelica), Pallier (Jenny), et par Berthier et Rémond dans les rôles de Toby et d'Edwards, eut un vif succès. On voit par cette distribution que les danseurs n'étaient guère employés, à cette époque, que pour les rôles secondaires, les premiers rôles, même masculins, étant réservés aux danseuses. Il n'en était pas de même au siècle précédent, où Noverre, Gardel et Vestris n'étaient pas moins célèbres que mademoiselle Sallé ou la Camargo. Les danseurs, durant tout le dix-neuvième siècle, ont été victimes d'un préjugé qui disparait seulement de nos jours, après l'arrivée en France des ballets russes, restés fidèles à l'ancienne tradition.

Mlle Sanlaville
Alors, comme aujourd'hui, les fillettes que leurs parents destinaient à la danse, entraient, vers l'âge de neuf ou dix ans, dans l'une des classes de l'Opéra pour passer de là, à la suite d'examens, au deuxième, puis au premier quadrille, d'où elles pouvaient sortir pour devenir coryphées, deuxièmes ou petits sujets, premiers ou grands sujets. Les danseurs observent la même hiérarchie, sauf qu'ils n'ont qu'un quadrille et une division de sujets. Les classes à cette époque n'avaient pas lieu à l'Opéra, mais dans les bâtiments de la rue Richer.
Halanzier, si nous en croyons Reyer (21) qui d'ailleurs ne lui est pas hostile, « avait un grand avantage sur quelques-uns de ses confrères : il ne savait pas la musique, mais là pas du tout, et il n'en était pas plus fier pour cela ». Mais ce n'était pas un sot. Il ne lui avait pas fallu longtemps pour reconnaître l'importance du ballet et l'avantage que donnait à l'Opéra, sur tous les théâtres de musique, son école de danse ; dès le début de sa direction il s'est efforcé de rendre plus sérieuses les études de cette école, en décidant que les examens seraient plus fréquents et auraient lieu devant un jury plus nombreux, où les artistes auraient leurs représentants à côté de ceux de l'administration et des professeurs. C'est après l'examen du 2 février 1873 qu'il a porté ces réformes à la connaissance du personnel intéressé, en une allocution d'un ton paternel, mais ferme, que le livre de régie nous a conservée :
Mes enfants.
Si je vous ai réunies toutes aujourd'hui, c'est non seulement pour vous faire connaître les résultats du dernier examen, mais aussi pour vous répéter une fois de plus que ces résultats vous ne les devez qu'à vous-mêmes, à votre travail, et cela en dehors de toute influence étrangère.
En confiant votre éducation chorégraphique à des professeurs d'un mérite éprouvé, dont je suis heureux de reconnaître en votre présence le talent et le zèle, en vous donnant pour juges des artistes qui honorent cet art charmant de la danse dont vous êtes appelées à recueillir les traditions, en adjoignant à cet aréopage excellent quelques chefs de service de mon administration sympathiques à vos efforts, j'ai voulu constituer en faveur des classes de danse de l'Opéra une sorte de conseil de famille qui fût pour vous et pour moi une garantie d'impartialité. Je crois y avoir réussi.
On dit que je suis sévère. C'est peut-être plutôt une nécessité de ma situation qu'une tendance de mon caractère. Quoi qu'il en soit, je tiens à ce que vous sachiez que ma bienveillance est acquise à tous ceux, grands et petits, qui font légalement leur devoir.
Travaillez donc avec courage, mettez à profit les conseils de vos professeurs, les modèles que vous avez sous vos yeux, ayez l'ambition de vous montrer dignes de cette noble maison de l'Opéra, à laquelle nous sommes tous honorés d'appartenir, et vous trouverez toujours en moi plus qu'un Directeur, un ami attentif à vos progrès et plein de sollicitude pour votre avenir.
C'est dans ces idées que j'ai pris la résolution suivante :
A l'avenir, un examen de toutes les classes de la danse aura lieu tous les trois mois pour constater l'état des études, et un autre examen aura lieu tous les six mois avec un classement dans les quadrilles du corps de ballet.
(21) Journal des Débats, 21 juin 1885.
Le jury réunissait autour du directeur son secrétaire général Delahaye, qui était sans doute un des « chefs de service sympathiques aux efforts » des artistes de la danse, le maître de ballet Mérante, le régisseur de la danse Pluque, mesdames Dominique et Zina Mérante, messieurs Berthier et Rémond, représentant les artistes.

Jean-Baptiste Faure
Quand vint l'été, Halanzier s'occupa, comme c'était son devoir, de désigner l'opéra nouveau destiné à la saison suivante, pour en commencer les études dès que serait passée la période des congés. Cette fois encore son choix se porta sur un ouvrage reçu par son prédécesseur. Mermet, né à Bruxelles en 1810, fils d'un officier général de Napoléon Ier, avait d'abord préparé l'école Polytechnique. Il s'était mis ensuite à la musique et était arrivé à faire jouer à l'Opéra, le 3 juin 1846, un ouvrage en trois actes intitulé le Roi David et tiré de la tragédie de Saül, de Soumet, par F. Mallefille. Malgré le concours de madame Stoltz dans le travesti de David, le succès ne répondit pas à l'espérance des auteurs. Mermet rendit le librettiste responsable de sa déception et résolut d'être, à l'avenir, à l'instar de Berlioz et de Wagner, son propre poète. C'est ainsi qu'il conçut et composa, pour les paroles comme pour la musique, Roland à Roncevaux, opéra en cinq actes dont la première représentation eut lieu à l'Opéra le 3 octobre 1864, avec Gueymard, Cazaux, Belval, et madame Gueymard-Lauters dans les rôles de Roland, Ganelon, Turpin et de la belle Aude. Ce fut un grand succès, que les critiques expliquent par la popularité du sujet et de gros effets de musique militaire à l'orchestre. Ils ont probablement raison, car deux ans plus tard, le premier engouement calmé, une reprise de Roland à Roncevaux laissa le public indifférent. Cependant l'ouvrage avait fourni d'emblée une carrière de près de cent représentations. Perrin ne pouvait donc refuser la Jeanne d'Arc que lui présentait Mermet, fidèle au genre patriotique qui lui avait bien réussi. Halanzier en 1873 était d'autant mieux disposé pour cette Jeanne d'Arc restée en expectative, qu'une autre scène annonçait une pièce du même titre. En ce temps-là, comme de nos jours, un homme de théâtre expérimenté se croyait assuré du succès par la contrefaçon. La Jeanne d'Arc de Mermet fut donc mise à l'étude, mais un événement imprévu en retarda la représentation, et le théâtre de la Gaîté fut seul à donner sous ce titre, le 8 novembre 1873, un drame en cinq actes de Jules Barbier, avec une musique de scène de Gounod.

Mlle Litvinne dans Déjanire (photo Bert)
Le 28 octobre 1873, qui était un mardi, deux artistes chargés de rôles en double dans le nouvel ouvrage, madame Rivet et le baryton Auguez, étaient venus répéter à huit heures et demie du soir et avaient quitté le théâtre sans rien remarquer d'anormal. A onze heures vingt-cinq, le sergent de pompiers de garde descendait de la scène en criant : Au feu ! Les concierges rouvrirent aussitôt les portes, puis remontèrent sur la scène avec le sergent, rejoints bientôt par un machiniste qui s'était attardé dans un débit de vins de la rue Drouot, par le commissaire de police du quartier Vassal, et par le directeur, qui logeait au théâtre et avait été averti par son domestique.
Le feu avait pris dans les décors rangés sur le côté gauche de la scène, vue de la salle, qu'on appelle au théâtre le côté jardin. Déjà une fumée épaisse empêchait d'approcher. Quelques minutes plus tard, on voyait accourir deux artistes de l'Opéra, Gailhard et Salomon, qui avaient appris la nouvelle au café Cardinal et n'y avaient ajouté foi qu'en voyant la fumée sortir en abondance par les fenêtres de la rue Rossini, à l'angle de la rue Le Peletier. Des pompes à vapeur arrivaient et étaient mises en batterie au coin de la rue Richelieu sur le boulevard, rue Chauchat, place Maubeuge. Le colonel Charreyon, commandant les sapeurs-pompiers, prenait la conduite des opérations. A minuit trois quarts, il déclarait à M. Halanzier qu'il ne répondait de rien, passé le délai d'une demi-heure, et on s'occupait en toute hâte de sauver la caisse et les meubles du directeur dans les bâtiments de la rue Drouot. A deux heures, la salle entière était en feu ; à deux heures et demie la toiture s'effondrait et tombait dans la rue Rossini. A quatre heures du matin, l'incendie était circonscrit et le colonel affirmait que les bâtiments de la rue Drouot ne couraient plus aucun danger. Le général Ladmirault, gouverneur de Paris, le général de Geslin, commandant la place, le préfet de la Seine Ferdinand Duval, le préfet de police Léon Renault étaient sur les lieux. Batbie, ministre de l'Instruction publique, accompagné de Charles Blanc, directeur des Beaux-Arts, s'y rendaient au petit jour ; le maréchal de Mac-Mahon, président de la République et Beulé, ministre de l'Intérieur, à deux heures de l'après-midi. Une enquête était ouverte par le commissaire de police et ne donnait aucun résultat. L'incendie avait fait une victime, le caporal Bellet, des sapeurs-pompiers, dont les funérailles eurent lieu le 6 novembre au Val-de-Grâce, avec le concours des artistes et des chœurs de l'Opéra. Faure y chanta le Pie Jesu.

Incendie de l'Opéra (vu de la rue Le Peletier), d'après l'Univers illustré
Tous les décors qui se trouvaient au théâtre étaient détruits. C'étaient ceux des pièces alors au répertoire, la Juive, les Huguenots, la Favorite, le Prophète, le Trouvère, Don Juan, l'Africaine, Hamlet, Faust, le Freischütz, la Coupe du roi de Thulé, la Source, Coppelia, Gretna-Green, et deux décors de Jeanne d'Arc, qui avaient été apportés et réglés le jour même. Les partitions d'orchestre de ces ouvrages avaient subi le même sort, ainsi que celles de Guillaume Tell et une partie de la partition de la Muette.
Le 31 octobre, les artistes et collaborateurs de l'Opéra réunis chez leur directeur y apprenaient que leurs appointements seraient payés jusqu'à cette date, et Halanzier recevait pour sa générosité les félicitations du ministre. Mais la gravité des circonstances donnait cours bientôt aux récriminations, et le 2 novembre, on pouvait lire dans Paris-Journal une lettre signée Un musicien de l'orchestre, adressée au directeur des Beaux-Arts, Charles Blanc et au directeur des théâtres Vaucorbeil, dont voici le principal passage :
M. Garnier verra peut-être cesser plus tôt qu'il ne l'aurait voulu le fructueux canonicat où il se complaît depuis tantôt dix ans ; mais nous tous, artistes, employés et ouvriers de tous grades, nous ne demeurerons pas aux prises avec la misère qui nous attend si l'on nous laisse pendant deux ans sans travail.
On a dit, il est vrai, que M. Halanzier conclut au transport de son entreprise dans les bâtiments du Châtelet. M. Halanzier, s'il a réellement conclu de cette sorte, a donné une preuve de plus qu'il n'a pas encore dépouillé le vieil homme et qu'il est demeuré le directeur de province qu'il a été toute sa vie. Il ne faut pas en effet savoir le premier mot des habitudes parisiennes et élégantes du public qui forme la base de la clientèle de l'Opéra pour s'imaginer que ce public ira chercher à une lieue de l'endroit où il avait coutume de le trouver le théâtre de sa prédilection.
L'Opéra de M. Halanzier n'a rien de commun avec le théâtre qui comptait dans sa troupe Marco, Tamburini, la Grisi, la Sontag. Il agonise dans les mains du plus boutiquier de ses directeurs. Il serait absolument désert dans six mois, si la folle idée de M. Halanzier venait à être prise en considération.

Mme Krauss
Le lendemain les délégués de l'orchestre, J. Garcin, Vigner, Rabaux, faisaient insérer une protestation contre une signature « apposée à leur insu et sans aucun droit ». La lettre ne prouvait qu'une chose : c'est que le directeur en exercice avait des ennemis prêts à tirer parti contre lui de toutes les circonstances. Et il n'est pas sans intérêt de remarquer que l'un des destinataires de cette lettre était Vaucorbeil, qui devait succéder à Halanzier à l'issue de son privilège.
Halanzier se le tint pour dit. Il se fit confirmer, le 29 décembre, dans son privilège pour les six années qui lui restaient. Le 8 janvier 1874, il obtenait un crédit de 609.258 fr. 39 pour l'exploitation provisoire qu'il allait entreprendre. Le 12 janvier, pour répondre aux objections de ceux qui lui reprochaient de n'être qu'un homme d'affaires, il s'adjoignait, comme directeur de la scène, Carvalho, qui avait été directeur du Théâtre-Lyrique et y avait monté les Noces de Figaro, le Médecin malgré lui, Faust, la Statue de Reyer, Mireille, la Flûte enchantée ; il venait alors du Vaudeville qu'il dirigeait depuis 1872. Si Halanzier avait eu sérieusement l'idée de transférer l'Opéra au Châtelet, il y renonçait, s'entendait avec les directeurs du Théâtre-Italien, Strakosch et Merelli, alors aux abois, pour donner les représentations de l'Opéra dans leur salle de la rue Ventadour, en alternant avec leurs spectacles, moyennant un loyer de 240.000 francs par an, soit le double de celui qu'ils payaient eux-mêmes. C'est là qu'il reprit sa saison interrompue, le 19 janvier 1874, par une représentation de Don Juan, avec ses interprètes de premier rang, Faure, Villaret, Gailhard, Caron, Gaspard, mesdames Gueymard-Lauters, Ferrucci, Thibaut. Le 18 février, Faure faisait sa rentrée dans Guillaume Tell qu'il n'avait pas chanté depuis 1870, et ce fut, dit le livre de la régie, une « splendide représentation ». Le prix des places, un peu moins élevé qu'à l'Opéra, allait de 2 francs aux cinquièmes loges à 12 francs aux fauteuils d'orchestre. Le public resta fidèle, mais les habitués se plaignirent. Reyer (22) cite ce mot de l'un d'eux : « Les artistes de l'Opéra chantant aux Italiens me font l'effet d'étrangers donnant une fête dans un hôtel garni ». Aussi se préoccupait-on en haut lieu de presser l'achèvement de la nouvelle salle. Il fallait pour cela six millions. On les trouva, par différents expédients budgétaires qui firent l'objet d'un rapport présenté à l'Assemblée Nationale par Caillaux, membre de l'Assemblée, le 23 février 1874.
(22) Journal des Débats, 25 février 1874.

Villaret
Sitôt installé au Théâtre-Italien, Halanzier se mit en devoir d'y donner un nouvel ouvrage. Remettant à plus tard Jeanne d'Arc, qui demandait une plus grande scène, il se rabattit sur un opéra qui attendait son tour depuis plus longtemps encore. L'Esclave, dont les paroles étaient de Foussier et de Got, l'acteur de la Comédie Française, la musique de Membrée, avait été reçue en 1853. La première représentation fut donnée le 15 juillet 1874, ce qui prouve qu'un auteur reçu à l'Opéra ne doit jamais désespérer. Toutefois on ne peut s'empêcher de trouver Reyer un peu sévère, lorsqu'il donne à entendre (23) que Membrée, pour obtenir un tour de faveur, aurait usé d'influences politiques. Il est sévère aussi lorsqu'il dénonce les « cadences surannées, les rythmes vulgaires et les formes mélodiques qui ont singulièrement vieilli » d'une partition vieille en effet de vingt ans. Membrée, né à Valenciennes le 14 novembre 1828, élève du Conservatoire de cette ville, puis du Conservatoire de Paris, avait une facilité mélodique attestée par de nombreuses romances, dont l'une, Page, écuyer, capitaine, avait eu grand succès. Le sujet de l'Esclave nous transporte au seizième siècle dans la Russie méridionale. C'est l'histoire d'un proscrit, ancien révolté du Caucase, Kaledji, à qui le pope Paulus donne asile. La fille du pope, Praskovia, est convoitée par le Comte, seigneur du lieu. Kaledji la défend, mais en vain. Praskovia est enlevée par le méchant seigneur qui cédant aux objurgations de Paulus finit par consentir à une légitime union. Alors Kaledji se révolte à nouveau, mais il est tué, et Praskovia le suit dans la mort. Il y a là une chaumière, une campagne où passera une chasse, un palais où les danseuses seront le plus bel ornement d'un festin, des scènes d'amour et de vengeance, enfin tout ce qu'il faut pour un opéra au temps de Meyerbeer. Membrée à qui manque, pour tirer de ce sujet tout ce qu'il peut fournir, l'émotion tragique et le sens du pittoresque, a su pourtant trouver des airs et surtout des morceaux d'ensemble agréables, et son orchestre, composé seulement, outre les cordes, de flutes, de hautbois, de clarinettes, de cors, de trombones et d'un ophicléide, est écrit avec une élégante simplicité. L'interprétation réunissait Silva, Lassalle, engagé en 1872, Gailhard, Bataille, mesdames Mauduit et Ecarlat-Geismar. Le succès fut honorable et l'Esclave fut jouée quinze fois jusqu'à la fin de l'année, qui fut aussi celle de sa carrière.
(23) Journal des Débats, 19 juillet 1874.
Le 30 décembre, l'Opéra devait donner Robert le Diable. Par suite de l'indisposition du ténor Silva, cet ouvrage fut remplacé par Faust avec Vergnet, Gailhard, madame Fursch-Madier, et ce fut la dernière représentation de l'Opéra à la salle Ventadour.

caricature d'Halanzier
IV
Le nouvel Opéra. Fin de la Direction Halanzier.
(5 janvier 1875 - 15 juillet 1879)
La nouvelle salle, enfin achevée, fut inaugurée le 5 janvier 1875 par une représentation de gala qui suivant l'usage de cette sorte de cérémonies réunissait des fragments d'ouvrages divers, composant ce qu'on appelle au théâtre un spectacle coupé. Comme de coutume aussi, on avait eu beaucoup de peine à en arrêter le programme, où il s'agissait de faire entrer tout ce que l'Opéra pouvait montrer de plus célèbre et de plus brillant. Christine Nilsson qui avait créé Hamlet et Faust sur cette scène, le 9 mars 1868 et le 3 mars 1869, se récusa au dernier moment, ce qui fit tomber du programme les scènes de ces deux ouvrages où elle devait paraître avec Faure. On ne trouva plus moyen de caser Faure, et le spectacle se réduisit finalement aux deux premiers actes de la Juive, chantés par mesdames Krauss, Marie Belval et par Villaret, Belval, Bosquin, Gaspard, Auguez, à la Bénédiction des Poignards des Huguenots, avec Gailhard dans le rôle de Saint-Bris, et au premier tableau du deuxième acte de la Source, de Léo Delibes, dont les premières danseuses furent mesdemoiselles Sangalli, Fiocre, Zina Mérante, Marquet, Sanlaville, Piron et Montaubry. Ce ballet, donné pour la première fois le 12 novembre 1866, avait été repris le 7 septembre 1872 pour les débuts de mademoiselle Sangalli. C'était la meilleure partie du programme, car il faut avouer qu'en ce qui concerne l'opéra on pouvait trouver mieux, et surtout plus nouveau. Cependant madame Krauss qui débutait dans la Juive y fut applaudie. D'ailleurs chacun sait qu'en de pareilles circonstances, le spectacle est dans la salle bien plus que sur la scène. L'un des principaux attraits était le Lord-maire de Londres, en son costume de cérémonie. Et voici les personnages officiels qui occupaient les premières loges :
1. Le maréchal de Mac-Mahon, la duchesse de Magenta.
2. M. Buffet, président de l'Assemblée Nationale.
3. Le Lord-maire.
4. Le bureau de l'Assemblée Nationale.
5. M. Batbie.
6. M. Baragnon, sous-secrétaire d'Etat.
7. M. de Fourtou.
8. M. Passy, sous-secrétaire d'Etat.
9. M. Martel.
10. Le duc d'Audiffret-Pasquier.
11. Madame Buffet.
12. Le président du Conseil d'Etat.
13. Le roi de Hanovre.
14. Le premier président de la Cour de Cassation.
15. M. de Royer, président de la Cour des Comptes.
16. Le préfet de la Seine.
17. Le comte de Paris.
18. Le général Vinay.
19. Le général de Ladmirault.
20. S. M. la reine Isabelle et le roi d'Espagne Alphonse XII.
21. Le maréchal Canrobert.
22. M Desjardins, sous-secrétaire d'Etat.
23. La duchesse de Malakoff.
24-26-27-28. Le corps diplomatique.
25. Le duc Decazes.
29. M. Caillaux, ministre des Travaux Publics.
32. Le général de Cissey.
33. M. Grivart, ministre du Commerce.
34. M. Montaignac, ministre de la Marine.
35. M. de Cumont, ministre de l'Instruction Publique.
36. M. Mathieu-Bodet, ministre des Finances.
37. M. Tailhaud, ministre de la Justice.
38. Le duc Decaze, ministre des Affaires Etrangères.
39. Le duc de Broglie.

première affiche du nouvel Opéra
Pour cette représentation solennelle ce fut Halanzier en personne qui prit en main le bâton du régisseur de la scène et frappa les trois coups. Le prix des places avait été augmenté et allait de 5 à 30 francs. La recette fut de 36.282 francs, chiffre assez peu élevé, si l'on tient compte du tarif, mais la liste précédente montre qu'il avait fallu inviter un grand nombre de hautes personnalités.
La première représentation régulière fut donnée trois jours plus tard, le 8 janvier. La Juive y fut chantée, avec un grand succès, par Villaret, Belval, Vergnet, madame Krauss, qui venait de faire ses débuts à l'Opéra le 5 dans le même rôle, celui de Rachel, et mademoiselle Belval, qui avait débuté le 22 mai 1874, dans les Huguenots. La recette, de 16.985 frs, accuse une salle comble.
Le nouvel édifice fut unanimement admiré. Georges d'Heylli, qui termine vers le mois de janvier 1875 son histoire anecdotique de l'Opéra (24), n'a que des éloges pour le « monumental escalier », qui doit à la variété des marbres et à la profusion des sculptures « l'aspect le plus éblouissant et le plus splendide », pour la décoration de la salle, dont « on ne saurait trop louer l'harmonie et la magnificence », pour les « remarquables peintures » de Paul Baudry et les « admirables cheminées » qui ornent le foyer du public, pour le foyer de la danse, « salle immense où se réunissent les dames du corps de ballet », pour les quatre grandes compositions de Boulanger, les colonnes en spirales, les statues plus grandes que nature et les médaillons ovales qui y célèbrent l'art de la danse et les artistes qui l'ont illustré depuis la fondation de l'Opéra. Le temps a passé. L'émerveillement de la première impression s'est calmé. Le goût a changé. Trente ans plus tard, les plus sérieux de nos critiques étaient d'accord pour railler ces proportions colossales et ce luxe d'ornementation qui leur paraissaient contraire à l'esprit de la musique, parce qu'à cette époque la musique, à l'exemple de la poésie, recherchait le secret, l'intimité, la pénombre. Mais le temps a passé encore, et un goût moins sévère permet à l'art ses fêtes comme il eut et a encore ses mystères. Une représentation de l'Opéra est une grande fête, et pour emprunter une expression au langage liturgique, une fête double de première classe, où la scène réunit la meilleure société d'artistes, comme la salle assemble la meilleure société d'auditeurs, où l'éclat, l'élégance et la courtoisie sont de part et d'autre. Le bâtiment de l'Opéra répond à sa destination. Il y répond à la manière et avec l'accent du second Empire, puisque c'est en ce temps là qu'il fut conçu. Aujourd'hui l'éloignement est assez grand pour que nous ne soyons plus choqués par les détails passés de mode, et prenions intérêt au style. C'est pourquoi nous avons cessé de nous associer aux anathèmes de M. Romain Rolland (25) contre un « théâtre de luxe et de vanité », et sommes plutôt portés à admirer, avec Georges d'Heylli et les témoins de l'inauguration, « ce gigantesque et merveilleux monument ».
(24) Georges d'Heylli, Foyers et Coulisses, Opéra, t. III, pp. 397 et suiv.
(25) Musiciens d'aujourd'hui, Paris, 1908, p. 225. Ce chapitre est le remaniement d'un petit volume publié en langue allemande, à Berlin, en 1904, sous le titre La musique à Paris, Paris als Musikstadt.
Les dimensions considérables de l'Opéra de Garnier tiennent surtout au développement qui y est donné d'une part à l'entrée, avec son foyer du public et son escalier célèbre, d'autre part aux dépendances de la scène, qui contiennent environ cinq cents loges d'artistes, plusieurs foyers d'études pour le chant et la danse, et des salles de classe où vint s'installer l'école de danse, jusque là établie dans le magasin de décors de la rue Richer. La scène ni la salle ne dépassent de beaucoup en grandeur celles de l'Opéra de la rue Le Peletier. La première a 15 m. 10 en hauteur et en largeur d'ouverture au cadre, 52 m. 90 de largeur totale. La seconde a 20 m. 59 de largeur, 25 m. 65 de profondeur, 20 m. de hauteur. Elle contenait, à l'origine, 2.156 places, dont voici la répartition, avec le tarif qui leur était appliqué et qui resta en vigueur jusqu'à l'année 1914 :
|
Parterre Orchestre Amphithéâtre Baignoires 1res loges 2es loges 3es loges 4es loges et 4e amphithéâtre 5es loges |
Nombre de places. 255 247 178 118 254 242 254 532 76 |
Prix au bureau. 7 fr. 13 fr. 15 fr. 12 et 13 fr. 13 et 15 fr. 10 et 12 fr. 6 et 8 fr. 2,50 et 4 fr. 2,50 fr. |
Prix en location. 9 fr. 15 fr. 17 fr. 14 et 15 fr. 15 et 17 fr. 12 et 14 fr. 8 et 10 fr. 3 et 6 fr. 3 fr. |
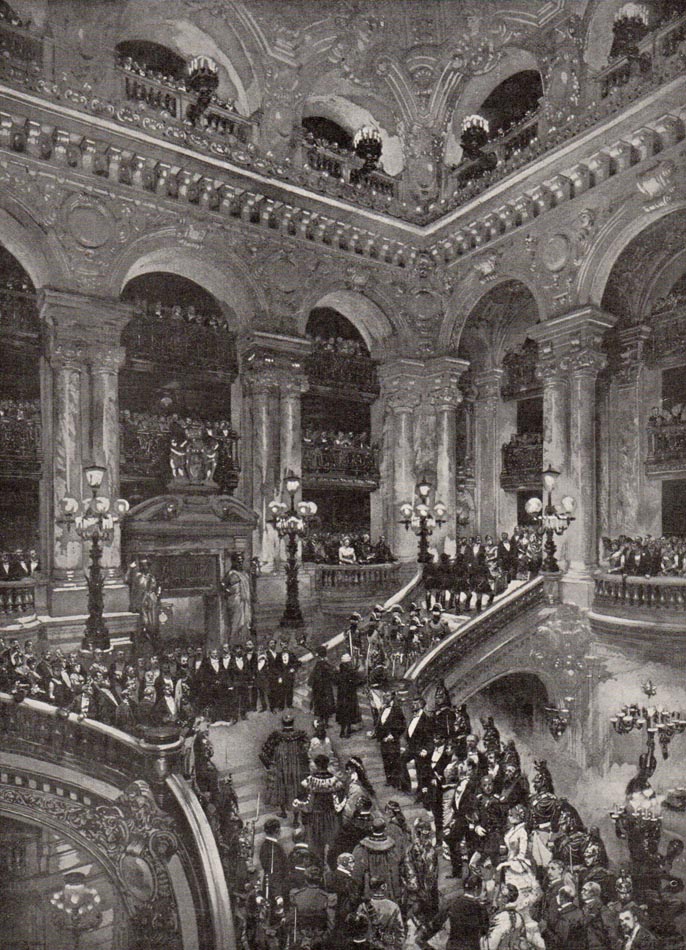
Inauguration du nouvel Opéra. Arrivée du cortège du Lord Maire. Dessin au lavis rehaussé de gouache par Edouard Detaille (musée du Luxembourg)
A la reprise de la Juive succéda, le 25 janvier, la reprise de la Favorite, et le 26 février celle de Guillaume Tell, l'une et l'autre avec Faure ; le 31 mars on reprenait Hamlet avec Mme Miolan-Carvalho, engagée pour deux ans, qui le 6 septembre reparaissait, à la reprise de Faust, dans le rôle de Marguerite, créé par elle au Théâtre-Lyrique le 19 mars 1859, et reprise à l'Opéra le 28 avril 1869. La reprise de Don Juan, le 29 novembre, avec Faure, Gailhard, Vergnet, Caron, mesdames Krauss, Carvalho, Gueymard-Lauters, était la dernière de l'année, qui fut prospère, car les recettes (26) atteignirent, subvention comprise, le chiffre total de 4.304.957 fr. 93, et comme les dépenses n'étaient que de 3.653.393 fr. 85 il restait un bénéfice net de 651.564 fr. 08. L'affluence du public était due certainement pour une bonne part à la curiosité de voir le nouvel édifice. Le répertoire se composait, cette année là, de neuf ouvrages, qui se partagèrent ainsi les 185 représentations :
la Juive, reprise le 8 janvier : 42 représentations.
la Favorite, reprise le 25 janvier : 22 représentations.
la Source, reprise le 10 février : 2 représentations.
Guillaume Tell, repris le 26 février : 20 représentations.
les Huguenots, repris le 26 mars : 32 représentations.
Hamlet, repris le 31 mars : 30 représentations.
Coppelia, reprise le 4 juin : 4 représentations.
Faust, repris le 6 septembre : 19 représentations.
Don Juan, repris le 29 novembre : 14 représentations.
(26) Ces chiffres sont cités dans le Rapport de la commission des Théâtres sur la question de l'Opéra, en 1879. Les livres de comptes de l'Opéra n'indiquent, pour le total des recettes de l'année, sans la subvention, que 3.447.762 fr. 83, ce qui fait une différence en moins de 57.195 fr. 10, imputable à des redevances fixes comme celle du buffet.
La reprise de Faust avait été particulièrement brillante. Gounod y assistait, dans la loge du directeur. Il revenait alors de Londres et on attendait avec impatience son opéra de Polyeucte. Le chœur des soldats fut bissé. C'est à partir de la représentation qui suivit cette reprise, le 10 septembre, que sur la demande de madame Miolan-Carvalho, l'artiste chargée du rôle de Marguerite fut remplacée par une danseuse, pour l'apparition du premier acte. Cet usage s'est conservé jusqu'à nos jours.
Il n'y eut pas, en 1875, de première représentation à l'Opéra. On tint compte à Halanzier de la difficulté qu'il avait eue pour monter ces neuf ouvrages, dont il avait dû refaire tous les décors, et on le dispensa pour cette année de l'obligation où il était tenu par le cahier des charges de donner un opéra et un ballet inédits.
Halanzier cependant songeait à l'avenir. Dès la fin de l'année il faisait reprendre les études de la Jeanne d'Arc de Mermet, interrompues par l'incendie, et il accordait, le 23 septembre, une audition à Victorin Joncières, qui venait lui offrir son opéra de Dimitri, dont J. Barbier et A. Silvestre avaient fait le livret. Félix Lutger Rossignol, dit Victorin Joncières ou de Joncières, était le fils d'un journaliste qui avait collaboré à la Patrie. Né à Paris le 12 avril 1839, il s'était d'abord essayé dans la peinture, et était entré ensuite au Conservatoire où il fut l'élève d'Elwart pour l'harmonie, de Leborne pour la composition. Il en sortit à la suite d'une violente querelle avec Leborne au sujet de Wagner, après les concerts donnés à Paris par le maître allemand en janvier 1860. En 1866, le 21 juin, il assistait à la première représentation des Maîtres chanteurs à Munich. Il avait fait représenter deux drames au Théâtre-Lyrique, Sardanapale, le 8 février 1867, et le Dernier jour de Pompéi, le 21 septembre 1869, et il était aussi l'auteur d'une Symphonie romantique, exécutée par Pasdeloup en 1873. Il était chargé du feuilleton musical au journal la Liberté.
L'épreuve ne fut pas favorable, mais par égard pour le musicien on l'engagea à présenter un ouvrage en deux actes, de préférence à un grand opéra. Il accepta, et apporta Dimitri au Théâtre-Lyrique où il fut représenté le 5 mai de l'année suivante, avec un médiocre succès.
En 1876, Halanzier satisfit à ses obligations et donna deux ouvrages nouveaux. Ce furent Jeanne d'Arc et Sylvia. La première représentation de Jeanne d'Arc eut lieu le 5 avril, avec une brillante interprétation qui réunissait Faure dans le râle de Charles VII et madame Krauss en celui de Jeanne d'Arc, Salomon, Gailhard, Caron, Menu et mademoiselle Daram dans les autres rôles, mesdemoiselles Fonta, Colombier, Marquet, Sanlaville, Montaubry dans le ballet.
Le poème, où l'on voyait Jeanne d'Arc amoureuse, parut ridicule aux connaisseurs, et la musique grossière. Paul de Saint-Victor exerce sa verve aux dépens de Mermet, responsable de l'un et de l'autre (27) :
Ce n'est pas seulement en musique mais aussi en paroles que l'auteur a exécuté sa malheureuse héroïne. Après l'avoir torturée à petit feu sur son libretto, il l'a retournée sur sa partition, et le premier supplice est pire que le dernier... C'est sur un mirliton gothique que M. Mermet a chanté Jeanne d'Arc.
(27) Cité par Noël et Stoullig, Annales du théâtre, 1877.
Cependant le public ne fit pas trop mauvais accueil à un ouvrage que sans doute il comprenait sans peine. La recette fut de 15.357 francs à la première représentation, de 17.948 fr. 24 à la deuxième, le 10 avril, de 18.346 fr. 47 à la troisième, le 12. Cette progression ascendante était de bon augure : Jeanne d'Arc eut douze représentations consécutives, dont la onzième, le 28 avril, produisait 22.021 fr. 47, et la dernière, le 6 mai, 19.181 fr. 74. Mais quand on voulut la reprendre, le 24 et le 27 novembre, les recettes ne furent plus que de 13.855 fr. 34 et de 11.949 fr. 54 : il fallut y renoncer. Moins éclatant que celui de Roland à Roncevaux, le succès de Jeanne d'Arc ne fut pas moins éphémère.

décor de Sylvia par Chaperon (Bibliothèque de l'Opéra)
Le 14 juin, la première représentation de Sylvia ouvrait une plus longue carrière. Léo Delibes avait été chef des chœurs à l'Opéra de 1864 à 1871. Perrin, alors directeur, l'avait pris en affection et l'avait chargé d'écrire la cantate pour la fête nationale du 15 août 1865, dont le titre était cette année là Alger, puis la première partie du ballet de la Source, l'autre étant réservée au compositeur « russe » Minkous (28). La première représentation de ce ballet fut donnée le 12 novembre 1866, et une reprise venait d'avoir lieu, avec succès, en 1872. En 1867, c'est encore Delibes qui ajoutait un divertissement, pour la reprise, au ballet d'Adam le Corsaire, dont la première représentation avait eu lieu le 23 janvier 1856, et le 25 mai 1870 le ballet de Coppelia, qui depuis lors s'est toujours maintenu au répertoire, le rendait célèbre.
(28) Louis Minkous, né à Vienne en 1827, était un violoniste et compositeur de musique de ballets assez célèbre de l'époque. Etabli à Pétersbourg en 1853, il y avait joué d'abord dans l'orchestre privé du prince Yousoupov, puis de 1861 à 1872, dans ceux des théâtres impériaux, pour finir sa carrière avec les titres d'inspecteur de la musique aux théâtres impériaux de Moscou et de compositeur de ballets pour les théâtres de Pétersbourg. Son œuvre comprend seize ballets, parmi lesquels la Source et Néméa, dont la première représentation fut donnée à l'Opéra de Paris le 11 juillet 1864.

caricature de Léo Delibes
Léo Delibes, né le 23 février 1836 à Saint-Germain du Val (Sarthe) avait été élève, pour la composition, d'Adolphe Adam et s'était fait connaître d'abord par des opérettes (29) : Deux sous de charbon (février 1856), Deux vieilles gardes (8 août 1856), Six demoiselles à marier (12 novembre 1856), Maître Griffard (3 octobre 1857), le Jardinier et son seigneur (1 mai 1863), le Serpent à plumes (16 décembre 1864), le Bœuf Apis (25 avril 1865). Le Théâtre des Arts a repris, en 1911, les Deux vieilles gardes, dont on a pu apprécier la verve sans façon. Quand on lui fit l'honneur de lui demander des ballets pour l'Opéra, Léo Delibes soigna davantage son style, mais garda une sûreté de rythme et une abondance de mélodie qui font de lui un des maîtres du genre. Il conçut aussi des ambitions plus hautes et abandonna l'opérette pour l'opéra-comique : le Roi l'a dit (24 mai 1873), Jean de Nivelle (8 mars 1880), Lakmé (14 avril 1883), achevèrent sa renommée et lui ouvrirent, en 1881, les portes du Conservatoire où il devint professeur de composition, en 1884 celles de l'Institut.
(29) On trouvera la liste complète de ces ouvrages dans l'étude d'Arthur Pougin sur Léo Delibes, qui termine son livre sur les Musiciens du XIXe siècle, p. 254 et suiv.
Sylvia ou la Nymphe de Diane est, comme Coppelia, un ballet en trois actes. Le scenario avait été tiré de l'Aminte du Tasse par les efforts combinés du baron de Reinach, du poète Jules Barbier, l'auteur de la Jeanne d'Arc dont Gounod avait écrit la musique de scène pour le théâtre de la Gaîté, et du maître de ballet Mérante. Le premier de ces auteurs devait à sa situation mondaine de garder l'incognito. Jules Barbier eut une contestation avec Mérante au sujet de leurs droits respectifs. Pour les mettre d'accord, on ne nomma ni l'un ni l'autre, si bien que le nom de Delibes, après la première représentation, fut seul proposé aux applaudissements du public.
Le berger Aminta ayant surpris Sylvia dans ses jeux avec les vierges ses compagnes, est percé d'une flèche par la jeune chasseresse, dont la chaste Diane est la divinité tutélaire. Mais Sylvia est elle-même enlevée par le sauvage Orion. L'Amour guérit Aminta et le prend sous sa protection. C'est encore l'Amour qui au second acte délivre Sylvia enfermée dans la grotte d'Orion, pour la ramener au troisième acte, voilée comme une esclave, dans le tumulte d'une fête. Mais Aminta la reconnaît aussitôt, à sa danse, et l'Amour sait conjurer la colère de Diane. Seul Orion expie ses forfaits. Le rôle de Sylvia fut créé par Rita Sangalli qui avait fait ses débuts à l'Opéra le 10 octobre 1872, ceux d'Aminta et d'Orion par Mérante et Magri ; mesdemoiselles Marquet et Sanlaville furent Diane et l'Amour.
Le succès de Sylvia fut modéré, mais soutenu. La première représentation produisit 15.192 fr. 50 ; les deux suivantes, le 16 et le 19 juin, 17.352 fr. 97 et 17.390 fr. 74. On se décida alors à donner Sylvia avec un opéra, en commençant à sept heures un quart. C'est ainsi que quatre représentations de la Favorite et de Sylvia, les 21, 23, 26 et 30 juin, obtinrent des recettes toujours supérieures à 16.000 francs et qui montèrent pour la dernière, à 21.230 fr. 05. Sylvia fit ensuite spectacle avec le Freischütz, les 17, 21, 26 et 31 juillet ; la recette fléchit d'abord, oscilla entre 13.000 et 15.000 francs, pour se relever le 31 juillet, jusqu'à 18.133 fr. 24. Mais à cette représentation Mlle Sangalli fit un faux pas, d'où résulta une entorse, et comme son rôle n'avait pas été préparé en double, il fut impossible de continuer la série, pourtant bien recommencée, des représentations.
Sylvia ne devait plus être reprise qu'en 1880, en 1882, puis en 1892. Mais deux ans plus tard les décors étaient détruits par l'incendie du magasin. L'ouvrage a été remis à la scène le 19 décembre 1919, dans de nouveaux décors de M. Maxime Dethomas, qui ont fait de cette reprise une véritable résurrection, et depuis lors s'est maintenu au répertoire ; il fait spectacle avec des ouvrages en un ou deux actes, dont l'Opéra était dépourvu en 1876. Pendant qu'il avait disparu de la scène, une suite d'orchestre tirée de la partition avait souvent été exécutée dans les concerts. De retour au théâtre, cette musique aisée sans vulgarité et nourrie sans excès d'embonpoint s'est montrée fort bien appropriée à son but, qui est d'animer une danse saine et franche, assez développée pour remplir la scène, toujours maîtresse d'elle-même, équilibrée et souriante, comme une jeune personne raisonnable qui ne se laisse pas entraîner par la passion et sait rehausser sa toilette d'un colifichet pittoresque, le bon ton exigeant qu'on rapporte de voyage un bijou curieux mais non un costume national. L'entrée des paysans, au premier acte, la danse au tambourin de deux esclaves d'Orion, au second, le cortège de Bacchus et sa truculence feinte, au troisième, puis la phrase des violons à l'unisson, en sa claire éloquence, enfin les pizzicati dont certes la sécheresse supplée mal aux vibrations de ces lyres inertes aux mains des figurants, mais détache en un crépitement d'étincelles les jetés de la danseuse étoile : autant d'airs de ballet dont l'entraînement pour nous est immédiat, et si parfois l'intérêt languit, cela tient à certaines complications du scénario, au premier et au troisième acte, que la pantomime est inhabile à débrouiller. Le croirait-on ? C'est la musique, en 1876, que quelques esprits chagrins accusèrent d'obscurité ; on y décelait l'influence de Wagner. Il avait inauguré son théâtre de Bayreuth, le 2 août 1872, et Léo Delibes avait été l'un des premiers à s'y rendre. On disait (30) de sa musique qu'elle était « retour de Bayreuth ».
(30) Mot cité par Arthur Pougin, Musiciens du XIXe siècle, p 266.

Mlle Lucienne Bréval dans Macbeth (photo Chéré Rousseau)
La meilleure réponse à ce mot est un autre mot (31), un peu grincheux, de Camille Saint-Saëns : « Ce n'est pas à Delibes que la critique française a reproché de n'avoir pas de mélodie : il avait fait des opérettes ». Il est de fait que Delibes n'a jamais écrit autre chose que des mélodies accompagnées. L'art des combinaisons lui était étranger. Quand il fut nommé professeur de composition au Conservatoire, il eut même des scrupules à ce sujet et en fit part à Ambroise Thomas (32), qui aurait répondu : « Vous ne savez pas la fugue ? Eh bien, vous l'apprendrez ». Que pouvait-il donc y avoir de commun entre la musique de Wagner et la sienne ? Qu'y a-t-il de wagnérien dans Sylvia ? Les contemporains devaient cependant savoir ce qu'ils voulaient dire, et je suppose qu'ils avaient été frappés par certaines sonorités de l'orchestre, qui a en effet plus de puissance dans Sylvia que dans Coppelia. Est-ce l'Anneau du Nibelung dont les échos retentissaient encore aux oreilles de Delibes et l'avaient, si l'on peut dire, mis en appétit ? C'est possible, mais il se garde d'user des mêmes procédés, et se contente de renforcer sa mélodie en la faisant jouer par tous les violons ensemble, ou par les instruments de cuivre, quand Wagner répartit entre les divers instruments les notes d'un accord ou les fragments de différents thèmes, de manière à ménager les transitions en effaçant le relief et évitant les ponctuations.
(31) Cité par Julien Tiersot, Un demi-siècle de musique française, Paris, 1918, p. 69.
(32) D'après Arthur Pougin, Musiciens du XIXe siècle, p. 271.
Ce qu'il faut surtout retenir de ce reproche injuste, c'est que Wagner, honteusement chassé de l'Opéra en 1861 (33), commençait à donner de nouvelles inquiétudes à ses adversaires, car depuis la petite ville d'Allemagne qu'il avait choisie pour y régner seul, sa gloire comme un phare élevé rayonnait jusqu'à Paris et les meilleurs de nos musiciens, ceux même qui suivaient d'autres voies et y étaient trop engagés pour se détourner de leur route, ne pouvaient qu'en subir la fascination.
(33) Les trois représentations tumultueuses du Tannhäuser à l'Opéra avaient eu lieu les 13, 18 et 24 mars 1861.

portrait de Massenet jeune, d'après un dessin de Chaplain
L'événement de l'année 1877 fut la première représentation, qui eut lieu de 27 avril, du premier opéra de Massenet, le Roi de Lahore. Né le 15 mai 1842 à Montaud (Loire), où son père était maître de forges, Jules Massenet était entré fort jeune au Conservatoire et y avait obtenu le prix de Rome à vingt et un ans, en 1863. Ses premiers ouvrages furent des suites d'orchestre et c'est pourquoi sans doute, lorsqu'il prit part au concours de 1869 en mettant en musique le poème imposé de Gallet et Blau, la Coupe du roi de Thulé, sa partition, classée la seconde, après celle de Diaz (34), fut frappée de cette note rédhibitoire : « L'auteur poursuit un but élevé sans doute, mais qui a semblé incompatible avec les nécessités du théâtre ». La première en date de ces suites, exécutée le 24 février 1866 dans un casino, avait pour titre Pompeia : c'étaient ses impressions d'Italie. Elle n'a pas été publiée, mais nous savons qu'elle comprenait un Prélude, un Hymne à Eros, un Chœur de funérailles et une Bacchanale. Pasdeloup, peu accueillant pour la musique moderne et voué presque uniquement à Beethoven et à Wagner, fit cependant exception en faveur de Massenet dont il admit une autre suite, le 24 mars 1867, au programme de ses concerts populaires. C'est à ces mêmes concerts que furent exécutées, le 26 novembre 1871, des Scènes hongroises, et le 22 février 1874 l'ouverture pour Phèdre, composée sur la demande de Pasdeloup qui s'était adressé, en même temps qu'à Massenet, à Bizet et à Guiraud pour que chacun lui donnât une ouverture symphonique. Massenet était au nombre des premiers membres de la Société nationale de musique, fondée le 25 février 1871, et c'est là que furent chantées les mélodies telles que le Poème du Souvenir, qui ont été ses premiers essais d'expression lyrique. Le 16 novembre 1873, c'est Colonne qui dirigeait, au Concert national inauguré à l'Odéon le 2 mars de la même année, ses Scènes pittoresques, et il parvenait au Conservatoire le 10 janvier 1875, avec les Scènes dramatiques d'après Shakespeare.
(34) Julien Tiersot, Un demi-siècle de musique française, p. 49
Cependant le théâtre l'attirait déjà. Il avait donné en 1867 un petit acte à l'Opéra-Comique, la Grand-tante, et le 30 novembre 1872, au même théâtre, Don César de Bazan, dont il n'est rien resté que l'ouverture. Le 6 janvier 1873, l'Odéon donnait la première représentation des Erinnyes de Leconte de Lisle, avec une musique de scène de sa composition. Il est possible que Massenet ait fait entrer dans cette partition quelques morceaux de Pompeia. Ce sont des substitutions qui n'ont aucune importance, la musique ne prenant un sens défini que par reflet ou voisinage : c'est pourquoi Bach et Gluck ne se sont jamais fait scrupule de changer l'application d'un morceau, son titre ou ses paroles. Une certaine conformité de mouvement et de coloris est seule exigible en pareil cas. Massenet pouvait en prendre à son aise, ayant reçu en partage une ingénuité musicale qui sans aucune intention particulière pouvait prendre un air de simplicité antique dans les Erinnyes, de pureté mystique dans un oratorio comme Marie-Magdeleine, exécuté au Concert national le 11 avril 1873, ou Eve, joué par l'Harmonie sacrée de Charles Lamoureux le 18 mars 1875, et de même assumer une naïveté un peu étrange pour répondre à l'exotisme tempéré mais non inexact du Roi de Lahore.
Louis Gallet, devenu le librettiste le mieux achalandé de l'époque, avait en effet proposé à Massenet un sujet emprunté à l'histoire de l'Inde. Scribe travaillant pour Meyerbeer prenait également ses sujets dans l'histoire. Mais l'Inde est un pays où la religion est souveraine, et cette religion, bien différente en cela des nôtres, qui sont étroitement réglementées, a gardé jusqu'à nos jours une fécondité qui l'enrichit constamment d'autres légendes et de miracles dont personne ne songe à douter, comme c'était le cas pour le paganisme des Grecs ou le christianisme du Moyen-âge, avant que l'esprit rationaliste de la Renaissance y eût introduit la rigidité protestante et contraint les catholiques eux-mêmes à arrêter la croissance de leur religion, pour mettre un terme aux polémiques. Louis Gallet a fort bien vu ce trait. C'est pourquoi son drame historique est en même temps légendaire, et même fantastique. Pendant les deux premiers actes, il n'y est encore question que de passions humaines et d'événements ordinaires. La ville de Lahore est assiégée par les Musulmans dont le chef est Mahmoud. Le roi Alim pourra-t-il la sauver ? Jusqu'ici il n'a guère donné de preuves de sa valeur, absorbé par l'amour de Sita, nièce de son ministre Scindia qui est aussi son rival. L'action qui s'engage ainsi pourrait ressembler à celle de beaucoup d'autres poèmes d'opéra, si déjà le scrupule religieux n'y tenait une grande place. Sita est prêtresse ; ce n'est pas au palais d'Alim, mais dans le temple d'Indra, où se passe sa vie, que nous introduisent les deux tableaux du premier acte. C'est en ce temple qu'Alim vient la voir en secret, et son amour n'est pas une faiblesse ni un caprice : c'est un sacrilège qui mérite la mort. Dénoncé par Scindia, maudit par le grand-prêtre Timour, Alim va racheter son crime en se mettant à la tête de ses troupes, pour vaincre ou mourir.
Le deuxième acte nous transporte au campement, devant la tente royale où des guerriers oisifs, comme les preux de Charlemagne au début de la Chanson de Roland, se divertissent à des assauts d'escrime et des parties d'échecs. Les présages sont mauvais, l'inquiétude étreint les cœurs. Les Musulmans se portent à l'attaque et bientôt les premiers fuyards reviennent en désordre. Scindia est parmi eux. Il annonce la mort d'Alim, et c'est une débandade générale. Cependant Alim n'est pas mort. Il revient du champ de bataille grièvement blessé et soutenu par Sita qui ne l'a pas quitté. C'est en vain qu'il essaie de rallier ses troupes. Tous l'abandonnent et le laissent mourir ; Sita ne peut rester auprès de lui : Scindia l'enlève, malgré ses pleurs.
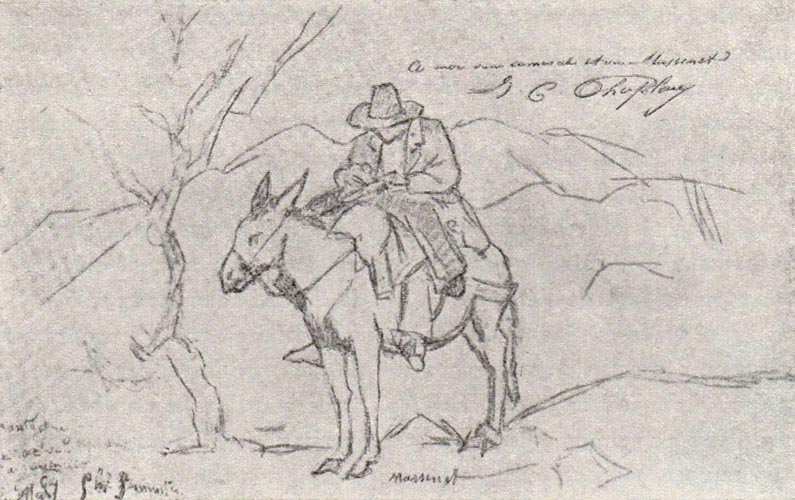
croquis de Chaplain représentant Massenet, dans la campagne romaine, en train de noter un air joué par un pâtre
En Europe, le drame, au moins en ce qui regarde Alim, se terminerait là. Mais selon les croyances hindoues il ne fait que commencer. Le troisième acte ouvre à nos yeux le paradis l'Indra où se présente l'âme d'Alim, troublée, anxieuse, inassouvie. Non, Alim ne veut pas de l'oublieuse félicité que lui offrent les anges de ce ciel, il refuse de dissoudre ce qui lui reste encore d'humanité dans le néant divin, et c'est pourquoi Indra, voyant que des liens trop forts le retiennent à l'existence, lui accorde de continuer sa vie interrompue, mais comme un fantôme de lui-même :
Qu'il soit lui, qu'il ne soit plus lui !
Qu'il dorme dans la tombe et marche sur la terre,
Que son âme immortelle ait un corps de poussière,
Qu'elle prenne encore une voix !
La scène change, et au deuxième tableau Alim redescendu sur terre a pris la figure d'un mendiant. Sur les marches de son palais légitime, il assiste à l'entrée triomphale de Scindia, usurpateur du trône, et son rival. Il veut se faire reconnaître, mais ne réussit qu'à ameuter la foule. Seul Timour le protège et lui donne asile dans le temple.
Au quatrième acte, Sita vient elle aussi chercher un refuge au saint lieu, et c'est là que soudain Alim reparait devant elle. Sa surprise bientôt cède aux transports de l'amour, et quand Scindia survient, transporté de fureur, les deux amants le bravent, car la mort va les unir. Sita quittera ce monde la première :
Oui, l'heure est venue où lasse de vivre,
Apaisant mon cœur d'amour consumé,
Je pourrai te suivre, ô mon bien aimé.
Alim répond aux menaces de Scindia :
Tu ne peux rien sur moi, car je meurs de sa mort,
Et les dieux bienfaisants me frappent avec elle.
Les mêmes voix qui n'avaient pu retenir Alim au ciel d'Indra s'élèvent, et cette fois c'est l'oubli total de l'existence et l'éternel apaisement qu'elles promettent à ces deux âmes purifiées par l'épreuve :
Nous planons dans la lumière,
Dans ces jardins enchantés,
Tout rayonne et tout s'éclaire.
La musique du Roi de Lahore contient, à ce que l'on assure (35), quelques morceaux empruntés à la partition composée par Massenet pour la Coupe du roi de Thulé, où l'on trouvait aussi des enchantements, mais d'origine magique et non religieuse. Rien ne trahit ces emprunts. Massenet dans ses premières œuvres, et surtout dans le Roi de Lahore, se révèle non seulement comme un grand, mais comme un profond musicien. L'expression peut surprendre, car on a coutume, surtout depuis Wagner, de confondre la profondeur avec l'épaisseur. Rien pourtant n'en diffère davantage. Un profond musicien découvre entre les sons des analogies inconnues jusque là, et qu'il lui suffit d'énoncer pour qu'elles deviennent évidentes. Il ne lui est pas nécessaire de les préparer, ni de les justifier, ni de les atténuer, encore moins de les dissimuler ; tout son effort sera au contraire de supprimer les transitions, d'élaguer les détails, pour présenter ces beaux rapprochements dans leur fraîcheur première. Ainsi un penseur profond n'a pas besoin d'un appareil logique, ni de conditions restrictives, ni d'épithètes explicatives : il affirme, sans démontrer.
(34) Julien Tiersot, Un demi-siècle de musique française, page 49.
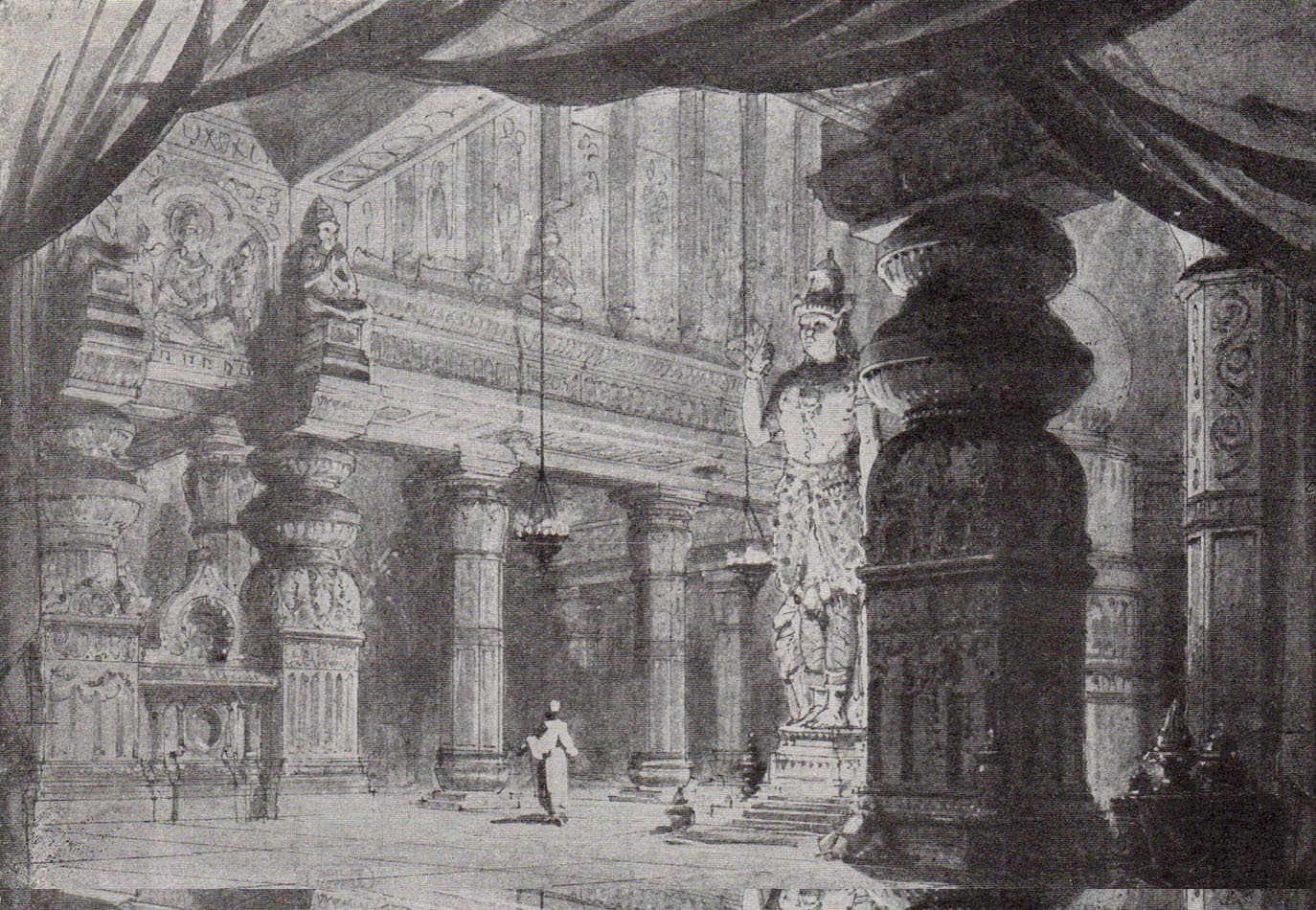
esquisse de Chaperon pour le décor du 2e tableau du 4e acte du Roi de Lahore (Bibliothèque de l'Opéra)
La musique de Wagner n'est pas profonde ; en quoi elle ressemble à celle de Beethoven et de presque tous les musiciens allemands du dix-neuvième siècle, à l'exception de Schumann en quelques pages. Elle ne procède que de relations d'harmonie et de figures rythmiques d'un usage courant à cette époque, qui sont à la musique ce que les lieux communs sont à l'éloquence. Mais ces formules sans intérêt par elles-mêmes sont ornementées, compliquées et déformées jusqu'au moment où elles deviennent méconnaissables. Un exemple célèbre est donné par les deux premières mesures du prélude de Tristan et Yseult, assemblage de sons à dessein trouble et confus dont l'oreille ne peut d'abord déterminer la tonalité, et qui pourtant se réduit, quand l'auteur à bout d'expédients et de retardements veut bien donner le mot de l'énigme, à un simple accord de septième, sur la dominante du ton de la mineur ; mais chacune des notes de cet accord ne nous est délivrée qu'après des feintes et des hésitations calculées, et par demi-tons progressifs. Je ne dis pas que l'indéniable puissance de cet effet fut à la portée de quiconque connaissait l'emploi de ce procédé qui est défini dans les traités d'harmonie, aux chapitres des altérations et des appogiatures. Pour en user ainsi, il fallait du génie. Mais le génie de Wagner s'exerce sur les procédés. C'est un génie de combinaison, et ce n'est pas vainement que sa musique a été qualifiée de savante. On peut dire sans aucune exagération qu'elle ne consiste qu'en une suite de ces cadences entre les accords de la dominante et ceux de la tonique qu'on appelle les cadences parfaites et qui sont les premiers et plus clairs indices de la tonalité, mais si industrieusement arrondies, amenuisées et chantournées, qu'on passe d'un ton à l'autre par des transitions insensibles, et certes on ne saurait trop admirer un assemblage à angles droits qui donne l'illusion de la courbe continue, et où mortaises et tenons, si solides pourtant, sont invisibles.
On reconnaît aussitôt que la musique de Massenet n'a rien de commun avec celle de Wagner en ce qu'elle n'use qu'avec discrétion, et toujours avec franchise, des altérations chromatiques. Comme la musique de Rameau, de Haydn, de Mozart au dix-huitième siècle, comme celle de Rossini, de Boieldieu, d'Auber et de Gounod au dix-neuvième siècle, elle n'a besoin d'autres notes que de celles que lui fournit, dans le ton choisi, la gamme majeure ou mineure. Mais Massenet se distingue de tous les musiciens qui l'ont précédé par un sentiment plus vif de la tonalité qui lui permet d'user non seulement des accords de tonique et de dominante, mais de ceux qui sont construits sur les autres degrés de la gamme et qu'on appelle, quand ils comprennent quatre notes, les accords de septième de seconde, troisième ou quatrième espèce, sans leur faire subir d'autre modification que de mettre à la basse l'une des notes supérieures, par l'artifice qui porte le nom de renversement. De tels accords ne sortent pas de la tonalité, car ils ne contiennent aucune note qui lui soit étrangère ; mais ils ne la déterminent pas avec une précision absolue, car chacun d'eux peut appartenir à plus d'une gamme. Aucune règle fixe ne préside à leur emploi. Tout dépend du contexte, et l'on peut en dire ce que Rameau disait de la mélodie, comparée à l'harmonie rigoureuse dont il faisait une science, que « le bon goût y a plus de part que le reste ». C'est bien une mélodie d'accords que l'on forme ainsi, et leur enchaînement est légitime, si l'effet qu'on se propose est produit. Ainsi, dans la marche religieuse qui commence le deuxième tableau du Roi de Lahore, celui qui se passe dans le sanctuaire, une oscillation légère résulte d'un accord de seconde sur la note sol, qui pourrait appartenir au ton d'ut majeur, mais se résout aussitôt en la mineur, par un accord de quarte et sixte sur le mi. L'oreille est tenue en suspens sans toutefois être déroutée, et c'est un cortège de prêtresses voilées qui passe, sans le bruit des cadences parfaites qui frapperaient la terre. Des successions du même genre, plus impalpables encore, soutiennent dans les airs la Marche céleste au Paradis d'Indra, et d'autres, plus caressantes, enveloppent et précipitent, dans les scènes d'amour, ces doux transports dont aucun musicien n'a su comme Massenet traduire l'extase et l'abandon. Le ballet est placé à ce tableau : c'est un ballet d'esprits ; Massenet lui a donné une musique dont les rythmes s'affirment et se soutiennent sans qu'il soit besoin d'y insister, et si elle emploie une mélodie hindoue, elle est choisie parmi celles qui entrent sans difficulté dans une gamme européenne ; elle s'entoure de variations fleuries où cependant cette pointe d'accent étranger est toujours reconnaissable. Si le chromatique intervient, soit en ce tableau pour le verdict d'Indra, ou dans la marche guerrière de l'acte précédent, c'est celui que fournit notre gamme mineure, sans altérations surajoutées. Dans les récits et les airs, le chant suit le mouvement des paroles et prend soin surtout de ne pas le ralentir, faisant volontiers glisser tout un alexandrin sur des triolets qui en prennent la cadence et préviennent toute emphase.
Ce qui réussit moins à Massenet, ce sont les mouvements violents et les éclats d'orchestre. Il n'y est pas à son aise, et ne trouve, quand la situation les lui impose, que des pensées banales, des formules usées, qui lui donnent un faux air de brutalité, bien éloigné de sa nature. Mais il ne faudrait pas conclure de là que la force dramatique lui fasse défaut. Rien de plus poignant au contraire que ces scènes où l'on se confie à mi-voix la folie du désir ou l'attirance de la mort ; le philtre de Tristan se répand dans l'orchestre dont il soulève les flots effervescents ; mais ici, c'est Alim et Sita qui en sont possédés. Par ces effets de force, Wagner continue, bien plus qu'il ne le croit, Meyerbeer. Massenet suit Gounod et comme lui, mais par des accents plus pénétrants encore, il sait nous révéler le secret de nos cœurs.
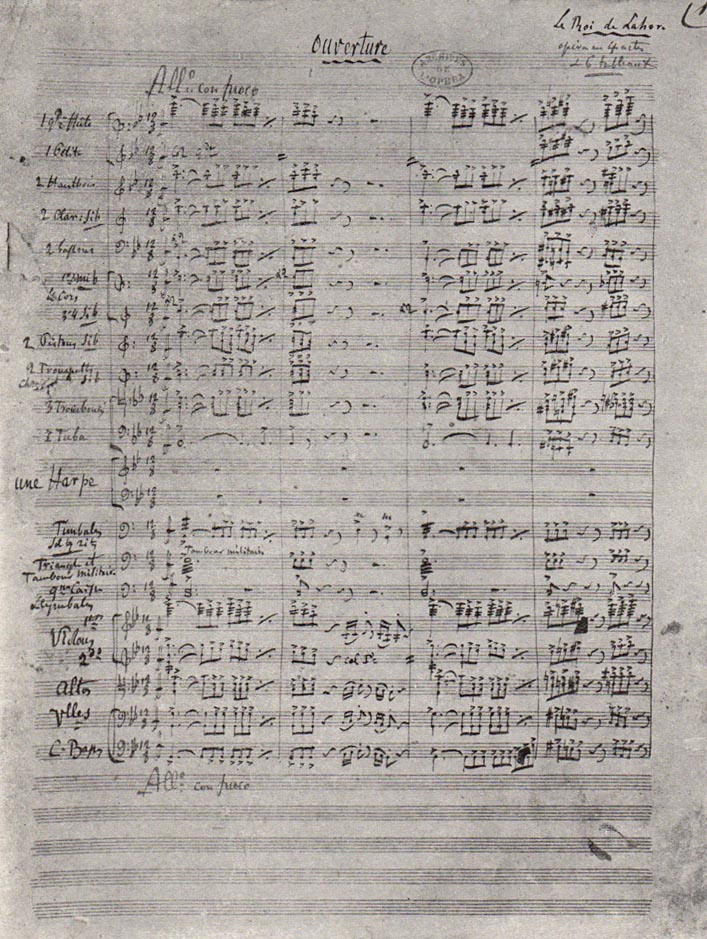
manuscrit de la première page de la partition d'orchestre du Roi de Lahore, autographe de Massenet
Le Roi de Lahore a eu pour interprètes, à la première représentation, Salomon dans le rôle d'Alim, Mademoiselle de Reszké en celui de Sita, Lassalle, Boudouresque et Menu en ceux de Scindia, Timour et Indra. La recette de cette représentation fut de 14.212 francs. Les trois suivantes, le 30 avril, le 2 et le 4 mai, produisirent 18.984 francs 75, 18.393 francs 33, et 18.699 francs. L'ouvrage eut trente représentations dans l'année, avec des recettes toujours comprises entre 18.000 et 20.000 francs. Succès d'autant plus remarquable qu'une reprise de la Reine de Chypre, qui eut lieu le 6 août, ne donna que des recettes de 15.000 à 17.000 francs ; pourtant cet ouvrage d'Halévy, donné pour la première fois le 22 décembre 1841, passait encore pour un chef-d’œuvre, et l'interprétation réunissait Rosine Bloch, Villaret, Lassalle, Menu, Caron.
Fidèle au cahier des charges, Halanzier donnait, le 26 novembre la première représentation d'un ballet intitulé le Fandango, dont le scenario avait pour auteurs Meilhac, Halévy et Mérante ; la musique était de Salvayre, né à Toulouse le 24 juin 1847, prix de Rome en 1872. On y voyait, par un procédé qui a beaucoup servi depuis lors, une fête nuptiale interrompue par l'arrivée de Bohémiens, de manière à confronter, dans une rivalité qui est aussi une rivalité d'amour, des danses de caractère différent. Associé d'abord à la Favorite, puis au Freischütz, et de nouveau à la Favorite, ce ballet ne produisit, à ses trois représentations du 26, du 28 et du 30 novembre, que 13.446 fr. 80, 15.242 fr. 94 et 15.391 fr. 21. C'était un échec incontestable.
Le 5 juillet 1877, Charles Lamoureux était nommé premier chef d'orchestre à l'Opéra pour remplacer Deldevez, qui avait demandé un congé. Né à Bordeaux le 28 septembre 1843, il avait fait ses études au Conservatoire, était premier violon à l'orchestre de l'Opéra depuis 1873 et avait fondé, en 1875, les concerts de l'Harmonie sacrée où il n'avait pas craint d'accueillir Massenet auprès de Bach et de Haendel.
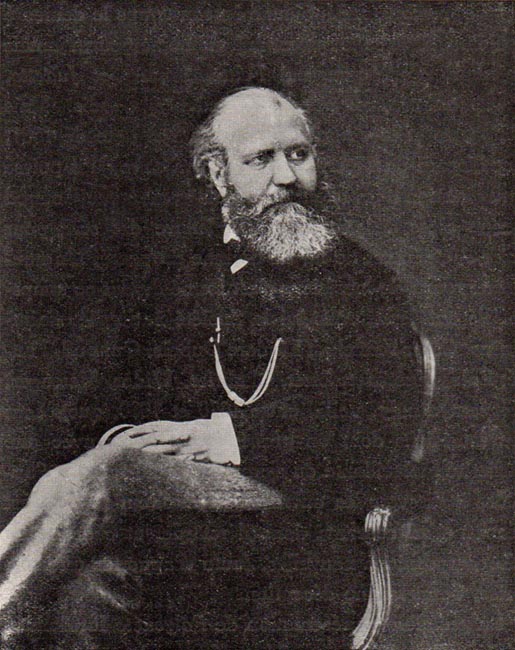
Charles Gounod en 1870
Les deux ouvrages nouveaux de l'année 1878 furent Polyeucte de Gounod et la Reine Berthe de Joncières. Après l'exécution à l'Opéra de sa cantate A la frontière, rapportée précédemment, Gounod renonçant à pleurer les malheurs de la patrie avait quitté Paris pour Dieppe, puis pour l'Angleterre où il abordait le 13 septembre 1870. Des amis fidèles l'y appelaient et lui donnaient l'occasion de composer un oratorio, Gallia, exécuté sous sa direction à Londres le 1er mai 1871, avec un immense succès. Le 26 février de cette même année, il avait fait la connaissance de M. et de Mme Weldon, le mari sans profession déterminée, mais surnommé le Capitaine, la femme cantatrice de salons. Comme elle lui témoignait une admiration passionnée, il lui promit le rôle de Pauline dans l'opéra de Polyeucte et se rendit à Paris dans les premiers jours d'août pour imposer cette interprète imprévue. Halanzier sut se dérober, Georgina Weldon dut se contenter de chanter Gallia au Conservatoire, puis à l'Opéra-Comique, avec un médiocre succès, et à la fin de l'année elle regagnait l'Angleterre, ramenant avec elle son musicien devenu l'hôte du ménage. Il trouva là de si bons soins que bientôt il ne se sentit plus le courage de s'en priver. Déjà, en juin 1871, il avait refusé la place de directeur du Conservatoire que la mort d'Auber laissait vacante. Deux ans plus tard, ce fut Mme Weldon qui vint à Paris, avec ses pouvoirs, pour assister aux répétitions de la Jeanne d'Arc de Jules Barbier dont il avait écrit la musique de scène et dont la première représentation eut lieu au théâtre de la Gaîté le 8 novembre 1873. Ce n'est qu'au mois de mai 1874 que grâce à l'intervention d'une amie désintéressée, Luisa Brown, Gounod put être arraché à sa douce prison, et ramené dans sa famille où son premier cri fut un cri de délivrance. Il avait alors cinquante-six ans.
Son départ imprévu ne lui avait pas laissé le temps d'emporter les œuvres composées durant son séjour, parmi lesquelles la partition de Polyeucte, commencée en 1869, terminée à cette époque, et qu'il lui fallut reconstituer de la première à la dernière note. C'est encore Jules Barbier, associé à Michel Carré, qui avait été le collaborateur de Gounod, ou plutôt les deux librettistes avaient assumé le rôle d'intermédiaires, entre la tragédie de Corneille, si éloignée de la scène lyrique en général et de la musique de Gounod particulièrement, et les projets du compositeur, qui ne voyait là qu'une occasion d'exalter la foi chrétienne, dans toute la sincérité de son cœur. Ce sont eux qui pour acclimater l'ouvrage à l'Opéra ont mis à la scène l'entrée triomphale de Sévère salué par les chœurs, coupé les stances célèbres et introduit, pour le contraste et surtout pour l'avantage du spectacle, toutes les voluptés païennes, toujours si bien accueillies quand la musique les accompagne et qui, comme on dit, font si bien sur la scène : invocation à Vesta, chœur de joyeux fêtards qui chantent les amours de Diane et d'Endymion, fête avec danses où tour à tour on évoque Pan, Bellone, Vénus et Bacchus. Gounod a traité avec un zèle égal les deux religions opposées. Camille Saint-Saëns, à qui il avait joué un des morceaux les plus païens de Polyeucte, lui en fit la remarque : « Si vous entourez le paganisme de telles séductions, quelle figure fera le christianisme ? — Je ne puis pourtant pas lui ôter ses armes », aurait répondu Gounod avec un sourire plein de rêves antiques et peut-être de récents souvenirs (35). Mais cette explication, si elle est authentique, a sans doute été improvisée pour les besoins de la cause, et Gounod n'était pas homme à réfléchir longtemps, avant de se mettre à l'œuvre, sur le dogme d'une religion ou sa morale. Il était fort bon chrétien ; mais si les circonstances l'avaient voulu il n'eût pas été moins bon païen. C'est pourquoi à l'une et l'autre religion il confère non seulement, comme il le dit, des avantages presque égaux, mais une douceur presque pareille, répandant sur toutes deux les flots d'une bienveillance optimiste qui était le fond de sa nature et dont tous ceux qui l'approchaient sentaient les effluves caressants. Le Christ en avait reçu le suprême hommage. Mme Weldon en avait su tirer profit.
(35) Anecdote rapportée par M. Camille Bellaigue dans son livre sur Gounod, p. 156.

buste de Charles Gounod (appartient à M. Choudens)
Sa musique, de même, est d'une facilité admirable et d'un charme délicieux, mais peu varié, incapable de creuser un caractère soit jusqu'aux faiblesses inavouées dont se moque l'auteur comique, soit jusqu'aux grandes passions qui font les tragédies. C'est pourquoi ses opéras-comiques s'arrêtent au sourire, et ses opéras ne mettent jamais les larmes aux yeux. Il ne doit ses grands succès qu'au genre intermédiaire, qui comprend Faust, Philémon et Baucis, Roméo et Juliette. Nul n'a su comme lui traiter légèrement un sujet pathétique sans en détruire l'émotion, mais en la soutenant, la consolant sans cesse, comme une malade qu'on rassure, ou au contraire mêler à un ironique apologue un attendrissement indulgent. La tragédie de Polyeucte, même édulcorée par les soins de ses librettistes, lui présentait encore trop d'héroïsme dans les pensées et trop de fermeté dans les résolutions pour que sa musique pût y ajouter quoi que ce fût. On ne peut se défendre de quelque regret quand on entend par exemple Polyeucte articuler posément, sur une suite de noires qui vont l'une derrière l'autre sans se troubler, ce vers brûlant de foi :
Elle a trop de vertu pour n'être pas chrétienne.
Et puis, Gounod était vieux. Il n'avait, il est vrai, que dépassé de quelques années la cinquantaine quand il écrivit Polyeucte, et Rameau a composé Hippolyte et Aricie, son premier opéra, à la même époque de sa vie, Wagner n'a achevé Parsifal qu'à soixante ans passés. Mais Gounod était vieux parce que sa musique n'était plus jeune. Les êtres vivants vieillissent en perdant leurs traits d'autrefois et en cessant, comme on dit, de se ressembler. La musique, comme aussi la poésie et la peinture, vieillit en restant pareille à elle-même et en se ressemblant trop. Déjà Roméo et Juliette, en 1867, rappelait un peu trop Faust, son aîné de huit ans. Polyeucte rappelle beaucoup trop l'un et l'autre. Gounod n'est pas, n'a jamais été, au même degré que Massenet, un profond musicien. Il a eu cependant ses instants de profondeur, assez pour dérouter, à la première représentation de Faust, certains auditeurs et ravir les autres. C'est plutôt, dans cette partition, la conduite de la mélodie et le coloris de l'orchestre qui contiennent des trouvailles. Mais il y a dans Philémon et Baucis, qui date de 1860 et certainement est de tous ses ouvrages le plus achevé pour le style, des enchaînements d'harmonie dont Bizet, dans l'Arlésienne écrite douze ans plus tard, ne dépassera pas l'ingénieuse simplicité. C'est en effet Bizet qui fait suite à Gounod, bien plus que Massenet, et qui aurait été, s'il eût vécu, son héritier légitime, car sa pensée est aussi claire, d'une clarté un peu superficielle, mais avec des aperçus intéressants, au lieu que Massenet va droit au but et découvre sans les chercher des rapprochements dont nul ne se fût avisé sans lui.
Une musique qui fut jeune en son temps le demeure toujours. Mais celle qui est née vieille ne pourra jamais rajeunir. Voilà pourquoi Faust, Roméo et Juliette, Philémon et Baucis sont toujours applaudis. Mais Polyeucte et le Tribut de Zamora, qui date de 1881, ont disparu du répertoire de l'Opéra sans qu'il puisse être question d'un retour. Les trois années que Gounod venait alors de passer en Angleterre ont suffi pour faire décidément de lui un homme du passé. Un nouveau groupe de musiciens s'est formé durant ce temps-là. Ils ont fondé sans lui la Société nationale. Saint-Saëns, César Franck, Théodore Dubois, Guiraud, Fauré, Lalo, Massenet, Bizet, Chabrier, Widor, Messager, Vincent d'Indy, voilà, entre 1870 et 1880, quels sont les musiciens dont on prononce les noms avec une curiosité malveillante ou sympathique et dont on s'apprête à discuter les ouvrages. Mais Gounod ne s'est pas tenu au courant ; donc il retarde, et chacune de ses compositions nouvelles, faute d'apporter une surprise, donnera une déception.
La première représentation de Polyeucte fut donnée le 7 octobre 1878, avec Mme Krauss dans le rôle de Pauline, Salomon en celui de Polyeucte, Lassalle (Sévère), Bosquin (Sextus), Bataille (Siméon), Berardi (Felix), Auguez (Néarque) et Mlle Rosita Mauri, que l'Opéra venait d'enlever à la Scala de Milan, fit ses débuts dans le ballet. La recette de cette représentation fut de 14.831 francs. La deuxième, le 9, et la troisième, le 11 octobre, produisirent 18.686 fr. 55 et 19.460 fr. 66, chiffres fort honorables, mais inférieurs à ce qu'on pouvait attendre du grand renom de l'auteur. Les recettes au lieu de monter baissèrent ensuite progressivement et pour la vingt-deuxième représentation, donnée le 13 décembre, n'étaient plus que de 15.440 fr. 62. C'était un échec que Reyer, obligé comme les autres au respect d'un maître illustre, cherche à expliquer (36) en alléguant que l'ouvrage « tient le milieu entre la tragédie lyrique et l'oratorio ».
(36) Journal des Débats, 15 octobre 1878.

décor pour Polyeucte (Bibliothèque de l'Opéra)
La Reine Berthe est l'ouvrage en deux actes qu'on avait promis de jouer à Victorin Joncières en échange de Dimitri. Jules Barbier en avait fait le livret où l'on voit la reine Berthe en exil, puis en travesti. Ce rôle fut joué par Mlle Daram, les autres par Vergnet, Gailhard, Caron, et Halanzier dut bien regretter sa promesse, car si la première représentation, le 28 décembre 1878, produisit 14.772 fr. 12, les recettes tombèrent, malgré l'appoint du Fandango, à 12.037 fr. 34 pour la deuxième, le 28 décembre, et à 10.828 fr. 47 pour la troisième, le 1er janvier 1879. Nous devons à Victor Fournel (37) ce renseignement que c'est à la première représentation de la Reine Berthe que l'on entendit pour la première fois, dans la nouvelle salle de l'Opéra, le mécontentement d'un auditeur se manifester par un coup de sifflet. On sait que Victorin Joncières avait dès sa jeunesse pris vivement parti pour Wagner. Il est probable que cette protestation était adressée aux opinions de l'auteur, plus qu'à son ouvrage, qui comme Dimitri donné au Théâtre-Lyrique en 1876, montre une habileté d'écriture estimable, sans accent et sans caractère.
(37) Le Correspondant, 10 janvier 1879.
Le 17 janvier 1879, on ajoutait à la Reine Berthe la première représentation de Yedda, ballet en trois actes, à sujet japonais, dont Philippe Gille, Arnold Mortier et Mérante avaient écrit le scénario, Olivier Métra la musique. Le célèbre chef d'orchestre et compositeur de valses, né à Reims en 1830, et sorti du Conservatoire avant d'y avoir terminé ses études, avait mis pour la circonstance, comme le mot courut alors, « une cravate blanche », et son ballet dansé par mesdemoiselles Sangalli, Marquet, Righetti et par L. Mérante eut un certain succès. La première représentation produisit 14.240 fr. 22, la deuxième, le 20 janvier, 12.525 fr. 01, la troisième, où Yedda fut associé à la Favorite, 14.697 francs. Aux représentations suivantes, c'est avec le Freischütz qu'on donna le nouveau ballet, et les recettes se maintinrent jusqu'à la fin de l'année entre 13.000 et 17.000 francs.
C'est le dernier ouvrage que devait monter Halanzier, car sa direction allait se terminer. L'année 1878, qui était celle d'une Exposition universelle, avait été très fructueuse : le total des recettes s'était élevé à 3.506.691 fr. 80, chiffre supérieur même à celui de l'année 1875, où tant de curieux venaient pour voir l'escalier. La situation prospère du directeur lui avait suscité beaucoup d'envieux. Dès 1875, il avait cru devoir se défendre en adressant aux membres de l'Assemblée nationale, au moment où elle allait discuter le budget des beaux-arts, un mémoire daté du 31 mai, intitulé Exposé de ma gestion de l'Opéra (38), et dont voici l'exorde :
On allègue contre moi deux griefs principaux ; ils seraient graves s'ils n'étaient que fondés, mais ils ne sont que précieux. Le premier consiste à dire que je ne suis pas ce qu'on est convenu d'appeler aujourd'hui un directeur-artiste. Le second vise la situation exceptionnellement prospère de l'Opéra.
Je pourrais vous faire remarquer, Messieurs, que de ces deux griefs, le second réfute le premier, car il est généralement admis que la prospérité d'une entreprise, théâtrale ou autre, est le résultat d'une bonne administration. Mais ce serait de la discussion, et je veux me borner à une réponse de fait.
(38) Paris, imprimerie Chaix, 1875.
Les attaques n'en continuèrent pas moins, et en 1877 Halanzier intentait un procès au journal la Presse et à son rédacteur Kerst, pour une série d'articles où on l'accusait d'avoir enfreint le cahier des charges en louant à l'année les loges sur la scène, en établissant des billets d'entrée qui permettaient de visiter l'Opéra dans la journée, pour 2 fr. 50, enfin d'avoir fait figurer sur ses livres des émargements exagérés. Les états de l'année 1878 donnent pour les artistes payés au mois les chiffres suivants :
|
Mmes Krauss Carvalho Bloch Arnaud MM. Villaret Bouhy Lassalle Gailhard Bosquin Sellier Caron |
12.500 fr. 7.000 fr. 4.000 fr. 1.500 fr. 5.000 fr. 4.166 fr. 65 4.166 fr. 65 3.333 fr. 35 3.000 fr. 1.500 fr. 1.000 fr. |
Ce sont des chiffres considérables, surtout si on les compare aux émoluments de la danse qui vont de 125 francs à 3.000 francs par mois, sans jamais dépasser ce maximum. Mais comment supposer que des artistes comme ceux qui viennent d'être nommés aient commis des faux en donnant quittance de sommes supérieures à celles qu'ils auraient touchées ?
Ces polémiques eurent pour effet d'émouvoir l'opinion, et bientôt tout le monde fut d'accord qu'il y avait quelque chose à faire à l'Opéra. Mais quoi ? On ne savait trop. La commission du budget, sur la fin de mars 1879, adoptait les conclusions du rapport d'Antonin Proust qui concluait, pour ne pas priver l'Etat des bénéfices de l'exploitation, à la mise en régie de l'Opéra. Le directeur serait remplacé par un administrateur général, nommé pour trois ans et assisté d'un conseil d'administration de neuf membres, dont un sénateur, un député, un conseiller d'Etat, un conseiller à la cour des comptes, un membre de l'Académie française, un membre de l'Académie des Beaux-Arts, un inspecteur des finances, le directeur du Conservatoire et le secrétaire général de l'administration des Beaux-Arts. Sans tenir compte plus qu'il ne le mérite de ce projet éminemment parlementaire, plusieurs candidats à la direction de l'Opéra s'étaient mis sur les rangs, parmi lesquels Vaucorbeil, Détroyat, Belval, et Cantin qui se serait contenté d'une subvention de 700.000 fr. C'est Vaucorbeil qui fut nommé, le 16 mai 1879. Halanzier ne voulut pas rester plus longtemps à l'Opéra et dès le 15 juillet il cédait la place à son successeur.
V
Direction Vaucorbeil (15 juillet 1879 - 2 novembre 1884)
et gestion provisoire par le Bureau des Théâtres (2 novembre 1884 - 30 novembre 1884)
Né à Rouen en décembre 1821, Vaucorbeil était le fils du comédien Ferville, qui joua au Gymnase jusqu’'en 1863 et mourut l'année suivante. Il avait fait ses études de musique au Conservatoire sous la direction de Cherubini, et plusieurs compositions pour la musique de chambre lui avaient acquis déjà une certaine réputation, lorsqu'il donna à l'Opéra-Comique, en 1863, Bataille d'amour, sur un livret de Sardou et de Karl Daclin. Une scène lyrique, la Mort de Diane, fut chantée au Conservatoire par madame Krauss en mars 1870, et Vaucorbeil gardait en son portefeuille un opéra de Mahomet, sur un poème de Henri de Lacretelle, qu'il ne fit pas représenter à l'Opéra, pas même quand il en fut devenu directeur. Après la guerre, il était entré dans l'administration, en qualité de commissaire du gouvernement auprès des théâtres subventionnés, en 1872 ; il avait été nommé inspecteur des Beaux-Arts en 1878.

Vaucorbeil
La désignation de Vaucorbeil fut fort bien accueillie, car il semblait qu'on allait trouver en lui le directeur artiste que malgré ses protestations Halanzier ne pouvait être ni devenir, et l'expérience ne devait pas lui manquer puisque depuis sept ans il avait eu l'occasion d'étudier de près le fonctionnement des théâtres subventionnés.
Nommé pour sept années, avec un cautionnement de 800.000 francs, Vaucorbeil avait fait ajouter à l'article 1 de son cahier des charges, une clause fort judicieuse, qu'on a eu tort de supprimer, mais raison d'appliquer par la suite :
L'Opéra n'est pas un théâtre d'essai ; il doit être considéré comme le musée de la musique ; il devra donc se distinguer des autres théâtres par le choix des œuvres anciennes et modernes de toutes les écoles qu'on y représentera et par la supériorité des artistes du chant, de la danse et de l'orchestre.
L'obligation de jouer des œuvres nouvelles était réglée ainsi qu'il suit :
§ 9. — Le directeur sera tenu de faire jouer chaque année pendant toute la durée de son exploitation deux ouvrages nouveaux représentant un minimum de six actes dont quatre au moins d'opéra : 1° un grand opéra avec ou sans ballets ; 2° un opéra ou un ballet en un ou deux actes.
§ 10. — La partition du petit ouvrage spécifié dans l'article précédent devra être écrite une fois en deux ans par un élève de Rome, grand prix de composition musicale. Cet élève sera désigné par le ministre sur l'avis de la section de musique de l'Institut qui présentera trois candidats.
On retrouve ces mêmes dispositions, avec quelques changements de détail, dans tous les cahiers des charges jusqu'à nos jours.
L'article 87 fixait les appointements du directeur à 25.000 francs par an, plus deux indemnités de 5.000 francs pour frais de voiture et de 8.000 francs pour le logement qu'il ne trouvait pas à l'Opéra.
L'article 88 rétablissait la caisse des retraites pour les artistes qui en faisaient partie jusqu'à la date de sa suppression, le 22 mars 1866, et l'instituait pour les autres, obligatoirement jusqu'au chiffre annuel de 12.000 francs d'appointements, de façon facultative au-dessus. Une caisse des retraites est fort utile, dans un théâtre comme l'Opéra où la fidélité est de règle. Il faut croire que cet organe nécessaire est aussi bien fragile, puisque l'un des premiers soins de la direction actuelle de l'Opéra fut d'étudier les moyens de rétablir, une fois de plus, la caisse des retraites, et d'en assurer le fonctionnement régulier désormais.
Vaucorbeil avait pris pour secrétaire général Chenouvrier, ancien maire du XIVe arrondissement, musicien comme lui et auteur du Roi des mines, représenté au Théâtre-Lyrique en 1866, et confié les fonctions de directeur de la scène à Regnier, le sociétaire de la Comédie-Française, né à Paris le 2 avril 1807, qui était entré à ce théâtre en 1831 et y avait donné sa représentation d'adieux le 10 avril 1872.
Tout s'annonçait le mieux du monde, et les difficultés commencèrent aussitôt. Elles ne firent que s'aggraver d'année en année, en même temps que baissaient les recettes, tombées à 2.922.031 fr. 26 en 1883, à 2.646.263 fr. 27 pour 1884. Harcelé par les auteurs à qui il avait fait d'imprudentes promesses, pressé d'argent, poursuivi d'une haine tenace par Reyer qui ne lui pardonnait pas d'avoir fait grise mine à Sigurd, vivement attaqué dans le Ménestrel et l'Événement par des journalistes qui lui reprochaient sa mauvaise administration, du même ton dont on accusait Halanzier d'être un trop habile administrateur, le pauvre directeur-artiste finit par mourir à la peine, le 2 novembre 1884, et c'est alors seulement qu'on commença de lui rendre justice. Aussitôt nommé, Vaucorbeil avait eu l'honneur d'être reçu en audience particulière par le Président de la République Jules Grévy qui le laissa, avec bienveillance, lui parler de ses intentions. Elles étaient d'un homme de goût, car Vaucorbeil parlait de remplacer le cri, trop en usage à l'Opéra, par le chant, de supprimer les loges sur la scène, qui nuisaient à l'illusion du théâtre, et d'ajouter au répertoire des ouvrages d'un genre plus léger, comme le Comte Ory de Rossini, pour lesquels on pourrait diminuer les dimensions de la scène.
Mais les chanteurs n'écoutèrent pas ses bons conseils, les loges sur la scène ne furent pas supprimées : elles ne devaient disparaître qu'en 1917. Quant aux œuvres nouvelles que le cahier des charges lui enjoignait de monter, Vaucorbeil était bien embarrassé. Gounod avait bien remis à son prédécesseur, avec qui il était lié par un traité, la partition complète de son nouvel ouvrage, le Tribut de Zamora. Mais le 18 septembre il demandait de la reprendre, pour y introduire quelques remaniements qui devaient avoir beaucoup d'importance, car il ne promettait pas de les terminer avant six mois. Les gens bien informés rapportèrent que Vaucorbeil ayant eu la curiosité d'ouvrir le manuscrit l'aurait trouvé composé, pour un bon tiers, de papier blanc. Il y eut de longs débats, et Gounod finit par s'engager à livrer la partition, complète cette fois, le 1er mai 1880, sous peine d'un dédit de 25.000 francs. Il devait toucher la même somme, si l'ouvrage n'était pas joué avant le 1er octobre 1881.
Vaucorbeil avait inscrit à son programme Françoise de Rimini, nouvel opéra d'Ambroise Thomas, alors achevé et qu'on croyait destiné au même succès que Hamlet. Mais l'auteur ne trouvait pas à l'Opéra les artistes qu'il jugeait indispensables. Hérodiade de Massenet donnait lieu aux mêmes difficultés d'interprétation, et en outre à des objections tirées du sujet, qui mettait en scène un personnage sacré. Vaucorbeil tenta alors une démarche personnelle auprès de Verdi. Accompagné de Thémines de la Lauzière, ami personnel du musicien, il se rendit, en octobre 1879, à Busseto, et en revint avec la promesse d'Aïda pour l'Opéra.
Le 10 novembre, il eut la satisfaction de voir Jules Grévy assister à la reprise de Coppelia, et même, fait assez rare pour qu'il fût noté, y applaudir. Le 31 décembre, Lamoureux donnait sa démission de chef d'orchestre, à la suite de dissentiments avec son directeur, auxquels il fait allusion dans la lettre qu'il lui adresse, en ces termes : « Je n'avais pas prévu, je l'avoue, que vous seriez tenté de prendre une part aussi directe et aussi effective au règlement de certaines questions spéciales dont le chef d'orchestre seul avait eu, jusqu'alors, la charge et la responsabilité. » Le désaccord aurait porté, d'après Reyer, sur les mouvements de Don Juan. Mais Besson, dans l'Evénement, explique que Lamoureux aurait été « retenu, entraîné même par son personnel », ce qui signifie qu'il aurait pris le parti de ses musiciens, de peur d'être désavoué par eux, et obéi à ses subordonnés, pour garder intacte son autorité, en vertu de cet axiome : « Je suis leur chef, il faut bien que je les suive ».
Ce n'est qu'à partir de 1880 que Vaucorbeil commença de donner la mesure de ce qu'il était capable de faire, par une série de créations ou de reprises, dont voici les dates, et les résultats matériels.
|
Dates 22 mars 1880 24 mars 1880 29 mars 1880 |
Ouvrages Aïda (reprise) Aïda Aïda |
Recettes 14.803 fr. 83 18.871 fr. 86 19.949 fr. 70 |
Aux représentations suivantes recettes de 20.000 fr. en moyenne.
|
29 octobre 1880 01 novembre 1880 03 novembre 1880 01 décembre 1880 03 décembre 1880 06 décembre 1880 01 avril 1881 04 avril 1881 06 avril 1881 |
le Comte Ory (reprise), Sylvia le Comte Ory, Sylvia le Comte Ory, Sylvia le Comte Ory, la Korrigane (création) le Comte Ory, la Korrigane le Comte Ory, la Korrigane le Tribut de Zamora (création) le Tribut de Zamora le Tribut de Zamora |
15.875 fr. 47 15.597 fr. 95 15.164 fr. 06 15.346 fr. 05 16.743 fr. 47 16.547 fr. 45 15.522 fr. 47 17.714 fr. 56 19.614 fr. 56 |
Ensuite, recettes d'environ 20.000 fr.
|
27 juin 1881 29 juin 1881 29 janvier 1882 06 mars 1882 08 mars 1882 10 mars 1882 |
Robert le Diable (reprise) Robert le Diable la Muette de Portici (reprise) le Comte Ory, Namouna (création) le Comte Ory, Namouna le Comte Ory, Namouna |
17.149 fr. 56 15.377 fr. 56 16.712 fr. 50 15.315 fr. 56 14.889 fr. 06 16.274 fr. 47 |
Avec le Freischütz, Namouna atteint ensuite de 13.000 à 19.000 fr.
|
14 avril 1882 17 avril 1882 19 avril 1882 |
Françoise de Rimini (création) Françoise de Rimini Françoise de Rimini |
15.722 fr. 47 18.818 fr. 06 19.506 fr. 56 |
Les recettes se maintiennent ensuite autour de 19.000 fr.
|
05 mars 1883 07 mars 1883 14 mars 1883 |
Henry VIII (création) Henry VIII Henry VIII |
16.079 fr. 06 17.574 fr. 06 19.301 fr. 56 |
Les recettes baissent ensuite jusqu'à 16.000 fr.
|
14 décembre 1883 17 décembre 1883 19 décembre 1883 |
Guillaume Tell, la Farandole (création) le Freischütz, la Farandole le Comte Ory, la Farandole |
14.914 fr. 47 16.280 fr. 56 15.303 fr. 06 |
Recettes comprises ensuite entre 13.000 et 15.000 fr.
|
01 janvier1884 07 janvier 1884 18 janvier 1884 |
Sapho (reprise) Sapho Sapho |
15.591 fr. 56 18.080 fr. 56 19.709 fr. 47 |
Recettes comprises ensuite entre 16.000 et 17.000 fr.
Cette énumération est toute à l'honneur de Vaucorbeil, car on n'y rencontre pas une œuvre médiocre. Mais pas un de ces ouvrages, si judicieusement choisis, n'est comme on dit « parti pour le grand succès ». Les recettes, pour aucun d'eux, ne sont arrivées à franchir, pour le dépasser, ce chiffre de 20.000 francs qui était, en fonction du tarif et du nombre des places, la limite idéale tracée entre les ouvrages destinés à s'effacer peu à peu du répertoire ou à n'y figurer, par prudence et pour éviter la satiété, que de loin en loin, et ceux qui portés toujours plus haut par l'enthousiasme du public pourraient non seulement sans inconvénient, mais avec avantage fournir une série presque ininterrompue de représentations de plus en plus chaleureusement applaudies.

Un coin de l'orchestre à l'Opéra (d'après Renouard)
Aïda était alors sans contestation possible le meilleur opéra de Verdi. Même aujourd'hui que nous connaissons ses deux derniers ouvrages, si différents des autres, Otello et Falstaff, on peut encore préférer Aïda, parce que sa verve s'y donne librement carrière dans des airs de bravoure, sans s'astreindre à une vérité, ou plutôt à une vraisemblance qui ne pouvait que l'appauvrir, mais s'accompagne déjà d'harmonies plus délicates et d'un orchestre plus nuancé. Avec cela, de grands décors que pour l'Opéra on fit, selon les données de la science d'alors, aussi exacts que possible, des cortèges, des chœurs religieux ou triomphaux, un ballet, des trompettes sur la scène, dont le timbre strident n'est malheureusement employé qu'à une marche vulgaire, un orchestre dans une tribune, montrant des Egyptiens qui jouent du bugle ou du trombone, mais aussi une émotion vive et sincère dans les épisodes pathétiques, un sentiment de gravité ou de mystère obtenu, quand il le faut, par des moyens simples comme une altération chromatique dans la gamme, un unisson à l'antique, enfin une action facile à suivre et un dénouement d'une poignante tristesse : rien ne manquait, à ce qu'il semble, pour faire de cet opéra un des modèles accomplis du genre, et lui assurer, en 1880, un aussi brillant destin qu'à ceux de Meyerbeer, quarante ans plus tôt. L'interprétation réunissait dans le rôle de Radamès, Sellier, ancien garçon de café à la Rotonde qui venait d'être remarqué par des habitués, et engagé à l'Opéra pour sa voix exceptionnelle, Maurel (Amonasro), Boudouresque (Ramfis), Menu (Le roi), mesdames Krauss (Aïda) et Bloch (Amnéris). Quant à la salle elle était, pour cette première représentation, très favorablement disposée, ainsi que le constate Victor Fournel (39), sur ce ton de blague boulevardière que se croyait alors obligé de prendre un chroniqueur, pour avoir l'air bien parisien :
Un vent d'enthousiasme italien soufflait dans la salle. On a offert à Verdi une lyre et une couronne. Le public l'a rappelé à grands cris après la pièce. Rendons lui cette justice qu'il a fait une belle et longue résistance. On assure qu'une lutte sérieuse à mains plates s'engagea dans la coulisse entre l'illustre compositeur, qui ne voulait absolument pas reparaître, et ses principaux interprètes, qui ne comprenaient rien à de pareils scrupules. Il se défendait comme un lion, faisant face à M. Maurel, à M. Sellier et à M. Boudouresque, à la fois. Un instant, on fut sur le point d'aller chercher à l'avenue de Vincennes, où il fait les délices de la foire aux pains d'épices, l'indomptable Marseille jeune, à qui nul athlète n'a jamais pu résister et qui l'eût, au besoin, après l'avoir couché les épaules sur les planches, traîné par les pieds jusqu'à la rampe. Mais, profitant d'un faux mouvement du maestro, Maurel qui est vigoureusement bâti, parvint à le saisir à la ceinture et à le projeter sur la scène, où Verdi, furieux, mais dominé par l'impérieuse nécessité des circonstances, donna aussitôt à sa physionomie rigide et glaciale l'expression la plus aimable qu'il put, et se mit à sourire comme une danseuse qu'on applaudit.
(39) Le Correspondant, 10 mai 1890, page 518.
Mais cette triomphale soirée n'eut pas les suites qu'on en pouvait espérer. Aïda fut le meilleur succès de l'année, puisqu'on put en donner 49 représentations, alors que Faust n'en obtenait que 18, la Juive et Guillaume Tell que 14. Mais ce ne fut pas, pour employer un langage vulgaire mais significatif, un succès d'argent.
Le Comte Ory est un opéra bouffe de Rossini, et c'est le premier ouvrage qu'il ait écrit directement sur des paroles françaises. La première représentation en fut donnée, avec un grand succès, le 20 août 1828. Le vaudeville de Scribe, arrangé pour la circonstance par Delestre-Poirson, datait de 1816. Rossini a mis dans le Comte Ory quelques morceaux de sa cantate Il viaggio a Reims, le Voyage à Reims, composée en 1826 pour le sacre de Charles X. C'est ainsi qu'un récit de bataille est devenu une chanson à boire et que le dénombrement des bouteilles a remplacé celui des régiments :
Là je vois l'Allemagne,
Ici brille l'Espagne,
Là frémit le champagne
Du joug impatient.
Le comte Ory, qui monte à l'assaut non d'un château mais de sa châtelaine, pendant que son écuyer Raimbaut explore ainsi la cave, est selon Scribe un gentilhomme du onzième siècle. Ce vin de champagne peut donc paraître un peu prématuré. Mais nos arrière-grands-pères n'y regardaient pas de si près pour les anachronismes, quand la musique les invitait, comme celle de Rossini, à une franche gaieté. Le Comte Ory est un autre Barbier de Séville, avec peut-être un peu moins de faconde, mais aussi plus d'élégance, Rossini ayant déjà compris ce qu'il fallait au goût français. L'air du gouverneur traduit avec une naïveté amusante une inquiétude que le sentiment du devoir n'est pas seul à inspirer :
Veiller sans cesse,
Craindre toujours
Pour son Altesse
Ou pour mes jours.
Et l'air du page, Une dame de haut parage, est d'une galanterie que ne dépassera pas Meyerbeer, dix-huit ans plus tard, quand il fera chanter le page des Huguenots.
Le Comte Ory fait appel, comme tous les ouvrages de ce temps, à des chanteurs très exercés. Dereims, Boudouresque, Melchissédec, mesdames Daram, Janvier, Nivet-Grenier s'en tirèrent de leur mieux, et ce petit ouvrage tint longtemps l'affiche, associé d'abord à une reprise de Sylvia, puis au nouveau ballet de Widor, la Korrigane.
Né à Lyon le 24 février 1845, M. Ch. M. Widor était organiste de Saint-Sulpice depuis 1869 et s'était déjà fait connaître par des symphonies pour orgue ou pour orchestre, d'un style élevé et soutenu. François Coppée, associé pour la chorégraphie à Mérante, lui avait donné le sujet de la Korrigane, où se reconnaît un poète, car les caractères de la frivole Yvonnette, du pauvre cornemuseux Lilez, du méchant sacristain Paskou, du gamin Janik y sont fermement tracés, et sans effort l'action nous transporte, pour le deuxième tableau, au royaume enchanté où Lilez est bien près de succomber à l'épreuve et de ne pouvoir sortir de la route funeste, pour revenir, enfin sauvé, à la place du village et à son clocher protecteur. La cornemuse, les grands chapeaux, les coiffes à l'ancienne mode sur de jeunes visages, les sabots entrechoqués, les lutins échappés des chênes tortus et les feux follets qui dansent sur les eaux dormantes, ce mélange, qu'on ne peut trouver qu'en Bretagne, de rusticité et de fantastique, fournissait au musicien une matière qu'il a traitée en maître, car sa science ici se fait aimable, et c'est justement parce qu'il connaît à fond toutes les complications de l'art d'associer les voix ensemble, qu'on appelle le contrepoint, qu'il lui est si facile d'indiquer, par un seul déplacement du temps fort, une seule altération chromatique, le poids des sabots ou la grâce fugitive des phalènes. Dansée par mesdemoiselles Mauri, Sanlaville, Ottolini, par Mérante et Ajas, la Korrigane fut très favorablement appréciée des connaisseurs, dont l'opinion jusqu'à ce jour n'a pas changé.
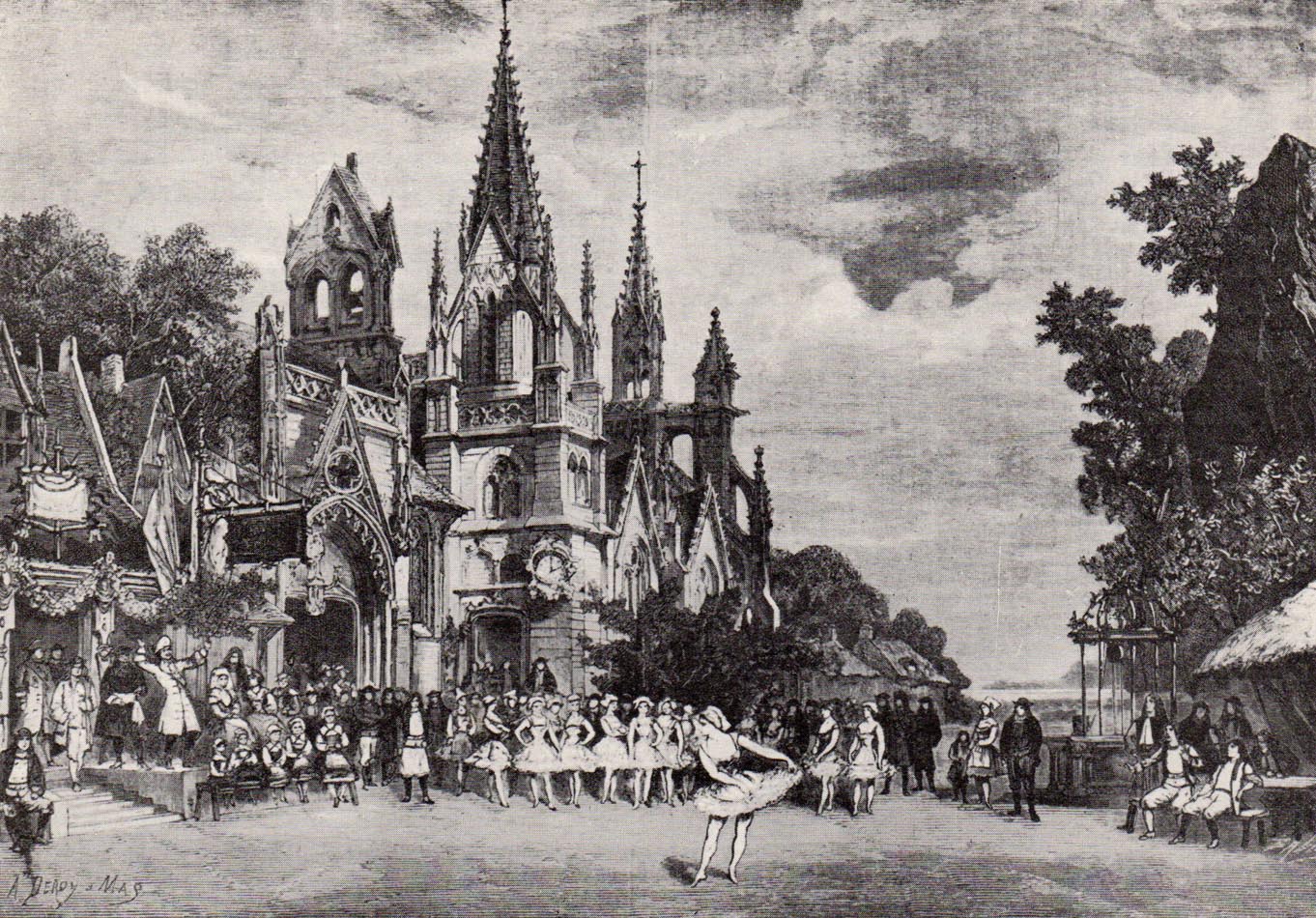
la Korrigane. La place du village. Danse d'Yvonnette (1er acte)
Le Tribut de Zamora fait allusion par son titre à une bataille, perdue par les chrétiens d'Espagne au dixième siècle et au traité humiliant qui l'a suivie. En vertu de ce traité, le seigneur d'Oviedo doit céder sa fille Xaïma au khalife de Cordoue Hadjar ben Saïd. Manoel Diaz, qui l'aime, jure de l'arracher à l'odieux ennemi et se glisse, par une ruse, dans le camp musulman. Xaïma y a retrouvé sa mère captive qui favorisera son évasion, et il est tout naturel que le khalife ait parmi ses captives des danseuses, prêtes au ballet. C'était là un sujet de drame romantique, encore moins approprié à la nature de Gounod que celui de Polyeucte, et qui n'avait pas l'avantage ou l'excuse de lui offrir, toujours reconnaissables sous n'importe quelle musique, de beaux vers. La critique, pleine d'égards pour un maître illustre, s'évertua pour célébrer un morceau d'intention excellente, le récit de la prise de Zamora, chanté par la mère captive, sur ces paroles qu'il suffit de citer :
Debout, enfants de l'Ibérie,
Haut les glaives et hauts les cœurs !
Des païens nous serons vainqueurs,
Ou nous mourrons pour la patrie !
Grâce à la renommée de Gounod, on parvint à jouer 34 fois dans l'année le Tribut de Zamora, dont l'interprétation comprenait mesdames Krauss, Daram remplacée dès la seconde représentation par Dufrane, Janvier, les chanteurs Sellier, Lassalle, Melchissédec, Giraudet ; depuis lors, l'ouvrage est tombé dans l'oubli.

le Tribut de Zamora. Décor pour le 3e acte (Bibliothèque de l'Opéra)
Vaucorbeil eut besoin de toute son autorité, l'année suivante, pour mener à leur terme les études du ballet de Namouna, composé par Edouard Lalo sur un scénario de Nuitter et Petipa. Ce musicien dont le nom reste un des plus glorieux de cette époque était né à Lille, le 27 janvier 1823, et n'avait étudié au Conservatoire que le violon, non la composition musicale. Il avait pris part sans succès à l'un des concours du Théâtre-Lyrique ; quelques airs de sa partition de Fiesque, chantés depuis dans les concerts, montrent déjà cette force grave et cette ardeur concentrée qui donnent un si beau caractère à tout ce qu'il a écrit. Le concerto pour violon et la Symphonie espagnole, exécutés aux concerts Colonne en 1874 et 1875, le concerto pour violoncelle (1877), et sa Rhapsodie norvégienne, exécutée pour la première fois à la Société nationale le 20 avril 1879, lui avaient concilié l'admiration de tous les musiciens. Vaucorbeil, soutenu par Antonin Proust et peut-être, comme on l'a dit, à son instigation, avait alors commandé à Lalo le ballet de Namouna. Dès que les artistes de la danse eurent commencé l'étude de leurs pas, les plus malveillantes rumeurs se répandirent, depuis les salles de classe et la rotonde jusqu'au foyer de la danse, et de là, par les couloirs agités d'habits noirs en révolte, jusqu'aux loges les plus fidèles et les mieux gardées. Ce qu'on disait ? Mais ce qu'on a dit, ce qu'on dira toujours d'une musique qui n'est pas exactement pareille à celles dont on a l'habitude : qu'elle était informe, et mettait les pauvres artistes en présence d'insurmontables difficultés d'exécution.
Il faut beaucoup se méfier de ces grands mouvements d'opinion qui prennent leur point de départ dans les coulisses d'un théâtre. Sans manquer de respect aux artistes chargés, à des titres divers, de l'interprétation, il est permis de remarquer qu'ils sont rarement à même de porter un jugement réfléchi sur l'ensemble d'un ouvrage dont chacun ne connaît que son rôle particulier, qu'il est naturellement porté à apprécier en raison du succès qu'il en espère, de la peine qu'il y prend, des accidents qu'il y redoute. On sait dans quelle atmosphère de suspicion furent conduites, en 1902, les études de Pelléas et Mélisande à l'Opéra-Comique : les musiciens de l'orchestre, notamment, en faisaient à l'avance des gorges chaudes, escomptant un succès de fou rire qui se produisit en effet et sans quelques partisans fidèles, donc fanatiques, eût fait tomber l'œuvre à ses premières représentations. A l'Opéra, et surtout pour un ballet, l'opposition à tout ce qui est ou paraît nouveau est plus forte encore, parce que le corps de ballet de l'Opéra, comme il a été expliqué au début de cette étude, est fier d'une tradition qui remonte à l'ancien régime, et que les habitués du foyer de la danse, dont elle flatte les opinions politiques, sont eux aussi tout disposés à défendre. Telle était du moins la situation jusqu'à ces toutes dernières années. C'est seulement sous la présente direction de l'Opéra que parmi d'autres améliorations il faut compter un libéralisme et même une curiosité d'esprit, toutes nouvelles en un lieu aussi auguste, aussi vénérable que le foyer de la danse de l'Opéra.
Mais en 1882 une danseuse de l'Opéra aurait été montrée au doigt par toutes ses camarades, et peut-être délaissée par son ami le plus dévoué, si elle avait marqué du goût pour la musique qu'on appelait alors difficile, ou même simplement pour la musique. La répétition générale de Namouna avait eu lieu le 7 février, mais le lendemain Rita Sangalli, qu'on avait forcée à jouer le rôle principal, vint déclarer, sans doute après avoir pris conseil de quelque personnage à qui elle devait le respect, que décidément il lui était impossible de danser sur une pareille musique. Il ne fallut pas moins d'un mois d'objurgations, de menaces et de négociations pour venir à bout d'une résistance secrètement ou même ouvertement encouragée, et c'est pourquoi la première représentation n'eut lieu que le 6 mars.
Le sujet de Namouna est inspiré par les aventures de Casanova et se place comme elles à ces confins du monde musulman où le voile des femmes et le silence des captives ajoutent encore, du moins pour des chrétiens à qui la possession du corps sans l'âme ne suffit pas, à leur attrait énigmatique et à la difficulté de leur conquête. Namouna appartient à Adriano qui la joue et la perd. Elle ne le lui pardonne pas, et bien que le généreux Ottavio qui l'a gagnée l'ait rendue à Adriano, elle saura bien s'arranger pour le rejoindre. La jalousie réveille alors l'amour d'Adriano et l'intrigue se poursuit, de mascarade en sérénade, pour finir par un coup de poignard. La musique a des mélodies si fortes et si marquées qu'elles peuvent se passer d'accompagnement ; c'est à peine en effet si l'auteur jette sur leur nudité comme un voile léger quelques accords, ceux qui les premiers viennent à l'esprit, et sous leur forme primitive, sans altération, sans addition, sans interversion de notes. Tels, ses airs de danse partent tour à tour, impatients de bondir, de marteler le sol, et certes il n'y a pas moyen de se méprendre au rythme qu'ils scandent sans omettre un temps fort. Mais peut-être est-ce justement cette franchise qui déroutait les esprits habitués à de plus coquets détours ? La musique de Lalo a de mâles accents. Elle est faite pour des danseurs, plutôt que des danseuses. Mais en son temps la danse d'opéra était livrée aux femmes, et il faudra attendre trente ans et l'arrivée des danseurs russes pour que se renoue la tradition française des Noverre et des Vestris. Quel beau ballet il eût écrit pour de tels interprètes !

Namouna. Le pas des épées (d'après un dessin d'Adrien Marie)
Namouna ne réussit pas, ne pouvait réussir. Reyer lui-même (40), tout en prenant sa défense, lui fait d'assez mauvais compliments. Après avoir rappelé que la fanfare des trompettes, qui a fait scandale au début de la fête foraine, est écrite sur un chant populaire de la Grèce, il conclut par cette appréciation :
Vous ne trouverez là ni la valse de Giselle, ni la mazurka de la Korrigane, ni la valse lente de Sylvia, ni même la polka du colonel qui dans un ballet bien dansant serait tout à sa place. Mais vous y trouverez sans trop chercher des motifs exquis sur lesquels, je vous assure, l'habitude en étant prise, il n'est pas plus difficile de danser que sur des motifs vulgaires : laissez-moi vous citer par exemple la valse de la Charmeuse ou de la Cigarette, celle des Forbans, la danse romaine ou le pas de la bouquetière, la sieste des esclaves ou le divertissement des fleurs... Si les bals publics, les bals du grand monde ne trouvent rien ou peu de chose à glaner dans la partition de Namouna, les concerts peuvent y venir puiser à pleines mains.
(40) Journal des Débats, 12 mars 1882.

Ambroise Thomas
Françoise de Rimini, qui comme le Tribut de Zamora avait été léguée à Vaucorbeil par son prédécesseur, était attendue avec impatience. En effet, comme l'écrivait pendant que l'ouvrage était en répétitions, le critique de la Revue des Deux Mondes (41), Blaze de Bury, « M. Ambroise Thomas est le seul qui ait su écrire pour l'opéra un ouvrage d'envergure à se maintenir au répertoire ». Cet ouvrage est Hamlet, représenté pour la première fois le 9 mars 1868 et qui en effet est resté au répertoire depuis lors, et même jusqu’à nos jours. Né à Metz le 5 août 1811, condisciple au Conservatoire de Gounod et de Berlioz, prix de Rome en 1832, Ambroise Thomas avait commencé par la Double Echelle, donnée à l'Opéra-Comique le 27 août 1837, une heureuse carrière qui devait le conduire à l'Institut dès 1850, à la direction du Conservatoire en 1871. Mignon, en 1866, avait obtenu un succès mérité par une sensibilité fine et aimable. Hamlet est l'œuvre d'un homme de goût qui sans atteindre à la puissance de Shakespeare la comprend, l'apprécie, et en fait par sa musique une copie un peu pâle, mais soignée. L'expression n'est jamais forte, mais est toujours juste, et la sonorité agréable. Sans doute peut-on regretter que l'orchestre réserve quelques-uns de ses plus jolis effets pour une des scènes les plus terribles, celle de la comédie. Mais en écoutant la musique, on ne songe guère à discuter. Nous connaissons le drame de Shakespeare, et c'est pourquoi nous faisons bon accueil au musicien qui vient non pas le refaire devant nous, mais nous le rappeler, nous le raconter comme une belle histoire, cherchant à plaire, plutôt qu'à toucher.
(41) 1er janvier 1882.
Françoise de Rimini, que chantèrent Sellier, Lassalle, Gailhard, Giraudet, mesdames Salla, Richard et Barbot, et où parut Mlle Mauri dans le ballet, fut une grave déception. C'est cependant encore une œuvre fort bien écrite, et on y rencontre des effets d'orchestre intéressants, comme dans la scène de l'enfer où tous les timbres sourds s'unissent en lugubres plaintes. Mais les airs de chant sont tantôt fades et tantôt emphatiques, parce que l'auteur, au lieu de rester l'agréable causeur qui nous intéressait à Hamlet, a voulu hausser le ton jusqu'aux grandes et funestes passions dont son heureuse nature pouvait bien concevoir l'idée, mais non pas éprouver les tourments.
C'est Vaucorbeil qui avait demandé un opéra à Saint-Saëns, en lui imposant pour librettiste son ami Détoyat, qui lui avait apporté le poème de Henry VIII (42). Saint-Saëns, né à Paris le 9 octobre 1835, avait alors la plus compromettante réputation de symphoniste et de wagnérien. Il devait la première à ses deux symphonies composées en 1855 et 1859, à ses poèmes symphoniques tels que le Rouet d'Omphale (1872), Phaéton (1875), la Danse macabre (1875), la Jeunesse d'Hercule (1877), Suite algérienne (1880), ainsi qu'à l'oratorio du Déluge (1876), la seconde à ses relations avec Wagner dont il avait fait la connaissance dès 1861, à son voyage à Munich où il était allé entendre l'Or du Rhin en 1869, à Bayreuth en 1876, et à Weimar où Liszt faisait jouer Samson et Dalila le 2 décembre 1877. Cependant Saint-Saëns avait écrit pour le théâtre, outre ce dernier ouvrage, le Timbre d'argent, opéra fantastique sur un livret de Jules Barbier et Michel Carré, achevé dès 1865 et joué au Théâtre-Lyrique le 23 février 1877, la Princesse jaune, sur des paroles de Louis Gallet, donnée à l'Opéra-Comique le 12 juin 1872, et Etienne Marcel, opéra dont Louis Gallet avait également écrit le poème, et dont la première représentation avait eu lieu à Lyon le 8 février 1879. D'autre part il avait protesté à plusieurs reprises, dans ses articles du Voltaire, contre ce qu'il appelle la wagnéromanie, et Hans von Bülow, rendant compte de la représentation de Samson et Dalila à Hambourg le 14 mars 1882, avait félicité Saint-Saëns d'être « le seul musicien contemporain qui ne se soit pas laissé égarer par la doctrine wagnérienne, mais en ait tiré un enseignement salutaire ».
(42) Ces détails et ceux qui suivent sont empruntés au livre de Jean Bonnerot sur Saint-Saëns, écrit d'après les souvenirs du maître, qui avait très bonne mémoire.

décor pour Françoise de Rimini (Bibliothèque de l'Opéra)
Mais on répondait à cela qu'il ne pouvait être qu'un odieux novateur, puisque c'est lui qui avait fondé en 1871, avec Romain Bussine, la Société nationale. Gounod ne s'y était pas trompé. Intercédant en sa faveur auprès de Vaucorbeil, il avait eu ce mot où perce le désir de se rassurer soi-même, mais qui manque de charité chrétienne : « Saint-Saëns a bien le droit de faire un four à l'Opéra ».
La première représentation de Henry VIII eut lieu le 5 mars 1883, avec mesdames Krauss, Richard, les chanteurs Lassalle, Dereims et Boudouresque dans les principaux rôles, mesdemoiselles Subra, Sanlaville, Invernizzi dans le ballet, et faillit donner raison à Gounod, car le public fut assez froid, mais la critique fut dans l'ensemble élogieuse. Blaze de Bury, qui signe F. de Lagenevais dans la Revue des Deux Mondes (43) se montre aussi indulgent qu'il pouvait l'être à un auteur qu'il devait considérer comme des plus dangereux : « Œuvre de réflexion, plus que d'inspiration, très travaillée et très compacte, Henry VIII n'a qu'un tort, c'est de manquer de personnalité ». Gounod, dans la Nouvelle Revue, oublie qu'il a été un prophète de malheur et salue en Saint-Saëns, « l'une des plus étonnantes organisations musicales qu'il ait connues ». Reyer dans le Journal des Débats (44) montre par une analyse précise que Saint-Saëns n'est pas si wagnérien qu'on a bien voulu le dire :
(43) 1er avril 1883.
(44) 11 mars 1883.
Rien ne rentre moins dans le système wagnérien que la partition de Henry VIII, partition très claire bien que fortement ouvragée, même dans son plus menu détail, partition très française surtout. Il n'en est pas moins vrai que la division de chaque acte en une succession de scènes ne portant aucune désignation du genre de chaque morceau, duo, chœur, quatuor ou romance, il n'en est pas moins vrai, dis-je, que cette méthode suivie par M. Saint-Saëns dans Henry VIII et précédemment dans Samson et Dalila et dans Etienne Marcel, est d'invention wagnérienne et que, en l'adoptant comme d'autres compositeurs l'ont adoptée aussi, M. Saint-Saëns n'a pas fait autre chose que ce que Richard Wagner avait fait avant lui, et pour la première fois dans Lohengrin... Ces phrases typiques, qui reparaissent chaque fois que la situation ou l'entrée d'un ou plusieurs personnages motive leur rappel dans l'orchestre, ce rôle donné par conséquent à l'orchestre dans le drame lyrique de M. Camille Saint-Saëns, n'est-ce pas aussi un procédé dont Richard Wagner peut revendiquer sinon la priorité absolue du moins l'application systématique et très développée ? Et ces récits auxquels d'élégantes broderies instrumentales se mêlent si ingénieusement n'appartiennent-ils pas un peu à l'école de la mélodie continue ?
Mais rassurez-vous. Là se bornent les affinités, les rapprochements qu'il est possible d'établir entre la manière de Richard Wagner et celle de l'auteur de Henry VIII. Ces récits d'ailleurs, si ornés qu'ils soient de broderies et d'arabesques, ne font aucun tort aux morceaux qui vont suivre et dont la forme est très saisissable, très voulue. Ce sont romances et cavatines, duos, trios, quatuors et morceaux d'ensemble tout comme ailleurs.
Il conclut en s'inclinant avec respect devant la science du musicien :
Quel admirable musicien que M. Saint-Saëns ! Il sait la musique autant qu'on peut la savoir, tandis qu'on disait de Gluck et de Spontini, ces deux musiciens de génie, le premier qu'il ne la savait guère, le second qu'il ne la savait pas.
Une vingtaine d'années plus tard, Claude Debussy rendait à Saint-Saëns le même hommage (45), presque dans les mêmes termes : « M. Saint-Saëns est l'homme qui sait le mieux la musique du monde entier ». Mais Reyer termine sa phrase par un rapprochement où perce une sorte de regret et peut-être une secrète envie. On croit deviner qu'aux noms de Gluck et de Spontini il ajouterait le sien s'il osait se décerner du génie.
(45) Monsieur Croche antidilettante, page 25.
Le sujet de Henry VIII n'est pas emprunté, comme on pourrait le croire, à Shakespeare, mais à une comédie de Calderon, la Cisma in Inglaterra, le Schisme en Angleterre, dont la pièce française reproduit l'intrigue tourmentée. Henry VIII épris d'Anne Boleyn va répudier Catherine d'Aragon. Mais Anne Boleyn a d'abord agréé les hommages d'un seigneur espagnol, Gomez, ambassadeur du Roi catholique. Henry VIII reçoit mal les remontrances du légat du pape et prononce le schisme qui lui permettra le divorce. Une lettre d'Anne Boleyn à Gomez est tombée aux mains de Catherine d'Aragon. Henry VIII torturé par la jalousie va interroger la répudiée qui d'abord hésite, la vengeance lui étant si aisée, puis par un retour de générosité jette au feu la lettre accusatrice. D'où le mot (46) d'un rédacteur du Gaulois : « Tiens ! Vaucorbeil s'amuse à reprendre les Pattes de mouche ! » Cette comédie de Victorien Sardou, qui date de 1860, a en effet pour sujet le sort d'une lettre, constamment perdue et retrouvée, non seulement au nez du mari, mais par le mari lui-même, qui n'y voit goutte, et c'est une suite d'escamotages, dignes d'un Robert-Houdin du théâtre, et fort divertissants. Mais personne n'avait eu l'idée de la mettre en musique.
(46) Cité par M. Henri de Curzon dans son livre sur Saint-Saëns, page 184.
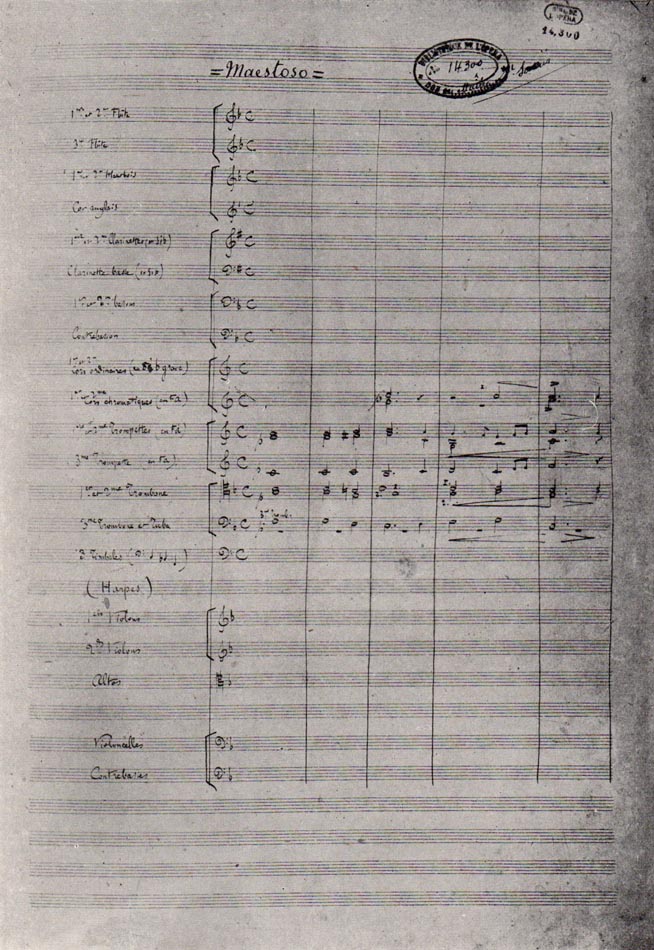
une page de la partition d'orchestre autographe de Saint-Saëns, pour Henry VIII
La complication de l'intrigue est le défaut de tous les opéras de Saint-Saëns, à l'exception d'un seul qui dans la pensée de l'auteur n'était pas, pour commencer, un opéra, mais un oratorio : c'est Samson et Dalila. Après Henry VIII, tous les critiques, même les plus favorables à Saint-Saëns, sont d'accord pour regretter qu'il ait comme on dit joué la difficulté en acceptant une pièce où les sentiments et les passions avaient à peine le temps de s'exprimer, même de se définir. Claude Debussy qui vient d'entendre les Barbares (47), en 1901, ne peut comprendre, lui non plus, « ce maladif besoin d'écrire des opéras et de tomber de Louis Gallet en Victorien Sardou ».
(47) Monsieur Croche antidilettante, page 26.
Une erreur aussi prolongée, aussi réitérée peut être qualifiée de systématique. Saint-Saëns est resté attaché toute sa vie à l'opéra historique et rêvait même, après Etienne Marcel, d'écrire une suite d'opéras sur l'histoire de France, en commençant par Vercingétorix (48). Wagner dès qu'il a pris conscience de son génie a abandonné les sujets historiques pour les sujets légendaires ou tout au moins, comme dans les Maîtres-chanteurs, librement inventés, alléguant pour expliquer cette prédilection des raisons de philosophie qui se réduisent à une raison de technique. Ce qu'il appelle la pure humanité, ou ce qui l'intéresse dans cette pure humanité, c'est la musique pure, celle qui se soutient d'elle-même, quand on ne saurait pas à quoi chacun de ses motifs peut bien faire allusion. Mais Saint-Saëns se tient, avec une sorte d'obstination rageuse, à l'opéra historique pour résister au charme wagnérien. Le bouclier d'Etienne Marcel et la cuirasse de Henry VIII le défendent contre les actes sans division intérieure et la mélodie continue. Et pourtant il est, comme Wagner, symphoniste dans l'âme. C'est même un symphoniste de goût classique.
(48) Bonnerot, Saint-Saëns, page 97.
De goût classique, plutôt que vraiment classique, et dans la même relation avec Bach, Haendel, Rameau et Mozart que les poètes alexandrins avec Anacréon et Euripide, ou les parnassiens de son temps avec les poètes français du dix-septième siècle. La raison qui est sa faculté maîtresse se contente des idées reçues et des jugements déjà prononcés, au lieu de chercher, comme ont fait les classiques, tous novateurs, tous audacieux, souvent incompris d'abord, des relations inaperçues jusque là et d'autres aspects de la vérité. Il sait si bien la musique que l'expression lui est donnée en même temps que la pensée et qu'il peut tout faire, jusqu'à des quintes parallèles imitant la musique javanaise, dans son cinquième concerto daté de 1896, mais seulement comme une exception, que son habileté sauve, aux règles établies, donc sans y attacher d'importance. De là son dédain pour la musique qu'il a pu entendre dans les vingt dernières années de sa vie. « Ce n'est pas difficile d'écrire ainsi, et j'en ferais bien autant si je voulais. » Telle était sa conviction sincère, mais erronée, car il ne remarquait que des artifices d'écriture en des suites de notes ou d'accords qui étaient pour nous autant de révélations. Et c'est pourquoi, malgré tout ce qu'il a pu dire, il n'a jamais composé une ligne ni une mesure qui ressemblât, même de loin, à la musique de Debussy, pas même à cette Damoiselle élue que je l'ai vu écouter, vingt ans plus tard, à la répétition du concert Colonne où il avait pourtant eu la curiosité de se rendre, d'un air si revêche et excédé.

Saint-Saëns a 10 ans
La musique de Saint-Saëns n'est jamais jeune. Elle n'est pas vieille non plus, toujours prête à accueillir une locution nouvelle, que cependant elle se garderait d'inventer. Elle est née à l'âge mûr, où l'expérience de la vie et l'usage du monde indiquent en chaque cas l'attitude à prendre et suscitent le sentiment approprié. C'est une musique de bonne compagnie, qui aime, comme on disait alors, les belles choses, et ce n'est pas la sincérité qui lui manque, c'est la spontanéité. De là, répandue sur tout ce qu'elle contemple, rêverie du soir, danse ancienne, scène d'amour, cette mélancolie distinguée qui est le regret de n'en pouvoir approcher davantage. Flottant devant les objets comme un voile, elle les rend presque semblables entre eux et nous empêche de les discerner. C'est pourquoi les productions les plus satisfaisantes de ce musicien sont celles qui n'annoncent pas une expression ni une description particulière, sonates, concertos, symphonies. Les poèmes symphoniques sont encore des symphonies dont il serait bien difficile, exception faite pour la Danse macabre à cause du xylophone, de déterminer, sans le titre, la signification même approximative. Les oratorios et les opéras sont écrits aussi dans le style de la symphonie classique. Les idées sont claires, mais peu distinctes. Elles sont, comme on dirait aujourd'hui, interchangeables, et même quand elles reparaissent on a peine à les reconnaître, faute de traits marqués qui les aient gravées dans la mémoire. Le développement en est facile, mais prévu, et ne leur ajoute rien. Pendant toute la durée d'un morceau de chant ou d'ensemble, ou même d'un des passages de transition qui relient entre eux les morceaux, c'est la même situation qui nous est expliquée, et on croit moins assister à un spectacle de théâtre qu'à l'analyse de la pièce, conduite d'ailleurs avec beaucoup d'intelligence, d'ordre et de finesse. Ce n'est pas sur Saint-Saëns qu'il faut compter pour donner une vie nouvelle au genre, vieilli à cette époque puisqu'il remonte aux temps du romantisme, de l'opéra historique.

Saint-Saëns par Pauline Viardot (1858)
La Farandole est un ballet de Philippe Gille, Arnold Mortier et Louis Mérante pour le scénario, Théodore Dubois pour la musique, sorte de Korrigane provençale où un tambourinaire remplace le joueur de cornemuse.
Né à Rosnay, dans la Marne, le 2 août 1837, Théodore Dubois était alors plus connu par son oratorio les Sept paroles du Christ, exécuté en 1867 à Sainte-Clotilde, que par ses deux opéras-comiques la Guzla de l'émir, donnée au Théâtre-Lyrique en 1873, et le Pain bis, joué à l'Opéra-Comique en 1879. Il faisait partie du groupe des jeunes musiciens qui avaient fondé la Société nationale ; le ballet dansé par Mlles Mauri, Sanlaville, Piron, fut assez bien accueilli. La musique en parut un peu froide, mais distinguée, on applaudit une Valse des olivettes, et une variation en pizzicati fut redemandée.
Sapho est le premier en date des opéras de Gounod. Il l'avait écrit sur un poème d'Emile Augier et la première représentation en avait eu lieu, sans grand succès, le 16 avril 1851. Réduit de trois actes à deux, Sapho avait été reprise le 26 juillet 1858, et n'était pas parvenue, cette fois non plus, à se maintenir au répertoire. Vaucorbeil, qui manquait à ce qu'il paraît d'œuvres inédites, avait obtenu de Gounod qu'il développât l'ouvrage en quatre actes, ajoutât un rôle, celui de Pittacus, et un ballet où devait danser Mlle Subra. Sapho lui fut ainsi comptée comme une œuvre nouvelle, ainsi qu'on avait déjà fait pour Aïda en 1880. Sous sa première forme, Sapho se recommandait par cette noblesse incolore et dénudée qui passait depuis Gluck pour la marque distinctive du style antique. Mais Gluck y mettait plus de chaleur, et Gounod plus de douceur. Reyer (49), qui l'admirait beaucoup, regrette de ne plus la retrouver :
Aux cadences si souples, aux pages de forme si pure de la première Sapho sont venus s'ajouter des points d'orgue et des effets de virtuosité dont trente ans auparavant le compositeur s'était bien peu inquiété.
Expliquant ensuite comment Vaucorbeil a eu l'idée de reprendre Sapho, il ajoute :
Un ouvrage français transporté, sur une scène étrangère et qui y était passé presque inaperçu semblait donner raison au directeur de notre première scène lyrique, qui l’ayant jugé pour ce qu'il valait, sans avoir même demandé à l'entendre, ne prit pas la peine de l'aller voir.
(49) Journal des Débats, 16 octobre 1884.
Cette phrase chargée d'allusions appelle aujourd'hui un commentaire. En 1884 chacun comprenait que Reyer avec cette modestie affectée voulait parler de son Sigurd, qui venait d'être joué à Bruxelles le 7 janvier.
Vaucorbeil avait fait admettre à l'Opéra, non sans peine, Widor, Lalo, Saint-Saëns et Théodore Dubois. Il s'apprêtait à donner un ouvrage d'un autre musicien du même groupe, qui était alors le groupe des jeunes. C'est en effet à M. André Messager qu'il avait commandé le ballet des Deux pigeons, dont il avait choisi lui-même le sujet, en chargeant Regnier, son directeur des études, d'arranger pour le théâtre la fable de la Fontaine.
Tant de bonne volonté et les preuves d'un goût aussi délicat devaient, à ce qu'il semble, concilier à Vaucorbeil les sympathies même de ceux qui ne partageaient pas ses opinions sur la musique. Il n'en fut rien. Un directeur de l'Opéra a toujours beaucoup d'envieux qui cherchent à l'atteindre par son faible, surtout quand la fin de son privilège approche. On savait que Vaucorbeil avait des embarras d'argent. Dès ce moment, l'énormité de l'édifice construit par Garnier et les exigences croissantes des artistes du chant rendaient l'exploitation fort onéreuse, la subvention notoirement insuffisante. Mais on aima mieux rendre le directeur responsable de tout le mal. Un grand musicien, qui était le critique d'un journal important, pouvait et devait, à ce qu'il semble, le défendre, en oubliant, s'il en avait, ses motifs de rancune personnelle. Mais Reyer, pareil en cela à beaucoup d'artistes créateurs, réservait pour ses œuvres toute la noblesse des sentiments et le sublime des vertus. Il s'associe (50) aux attaques de Louis Besson dans l'Evénement, de Moreno dans le Ménestrel, et cite avec une satisfaction manifeste la conclusion de celui-ci :
Nous connaissons M. Vaucorbeil pour un galant homme et nous allons risquer un conseil assez délicat : il doit bien se rendre compte aujourd'hui qu'il s'est fourvoyé en s'improvisant directeur.
(50) Journal des Débats, 16 octobre 1884.
Devant tant d'injustice, Vaucorbeil s'il eût été Chinois se fût tué pour infliger la torture du remords à ses ennemis. Il n'était qu'Européen : une maladie subite l'emporta, et ceux qui s'étaient tant acharnés contre lui en demeurèrent fort penauds.
C'est de Chapelles, chef du bureau des théâtres au Ministère, qui assura la gestion provisoire de l'Opéra en attendant la désignation du nouveau directeur. Sa seule initiative fut de reprendre Françoise de Rimini, le 12 novembre, et elle fut désastreuse, car la recette n'atteignit ce soir là que 12.583 fr. 06, et tomba jusqu'à 11.000 francs aux représentations suivantes. C'est ainsi qu'un zèle maladroit peut précipiter la chute d'un ouvrage, et c'est vraiment le pavé de l'ours que le chef du bureau des théâtres venait d'asséner au visage du directeur du Conservatoire.
Les candidats ne manquaient pas : Armand Gouzien, commissaire du gouvernement auprès des théâtres subventionnés, Léonce Detroyat, le chanteur Faure, le chef d'orchestre Lamoureux, étaient sur les rangs ainsi que l'association formée entre le baryton Pedro Gailhard et Ritt, ancien directeur des théâtres de l'Opéra-Comique et de la Porte Saint-Martin. Ce furent ceux-ci qui obtinrent la préférence. Ils entrèrent en fonctions le 1er décembre 1884. Regnier, que Vaucorbeil s'était attaché comme directeur des études, donna sa démission.

Saint-Saëns, caricature de Charles Kotra
VI
L'Opéra de Pedro Gaillard.
(1er décembre 1884 - 31 décembre 1907)
Ritt et Gailhard, qui avaient choisi pour secrétaire général Emile Blavet, rédacteur au Figaro, pour secrétaire particulier Mobisson, étaient nommés pour sept ans et se croyaient assurés d'obtenir le renouvellement de leur privilège. Mais Bertrand, directeur des Variétés depuis vingt ans, fut désigné à leur place, le 4 avril 1891. Ils en furent si indignés que du coup, pour montrer de quoi ils étaient capables, ils jouèrent Lohengrin.
Bertrand s'était engagé à donner des représentations à prix réduit, au nombre de vingt-quatre par an. Il s'était adjoint Campocasso qui, paraît-il, avait de grands talents pour trouver et recruter des artistes, surtout en province. Mais Campocasso se croyait capable de mieux encore, d'être directeur de l'Opéra à lui seul. Dès que Bertrand eut connaissance de cette ambition, il fit alliance avec son prédécesseur évincé qui n'avait cessé de roder autour de la maison ; le 25 mars 1893 un nouveau décret nommait directeurs de l'Opéra Bertrand et Gailhard qui entraient en fonction le 1er avril. Campocasso disparaissait. Les chefs de service étaient les suivants :
Secrétaire général : Georges Boyer.
Administrateur : Simonot.
Chef de l'abonnement : Eugène Maillard.
Régisseur général : Lapissida (51).
Chefs d'orchestre : Taffanel (52), Madier de Montjau, Mangin.
Chefs de chant : Mangin, Vidal, Marty, Lottin, Kœnig.
Maître de ballet : Hansen.
(51) Il avait succédé dans ces fonctions le 17 mars 1890 à Mayer, démissionnaire.
(52) Nommé le 23 juillet 1891.

Pedro Gailhard à son bureau
Le nouveau cahier des charges supprimait les représentations à prix réduit : on s'était aperçu en effet qu'elles n'avaient d'autre effet que d'enlever aux représentations régulières un certain nombre de spectateurs économes, sans attirer un autre public. L'incendie du magasin des décors de la rue Richer, survenu le 6 janvier 1894, fit disparaître momentanément un certain nombre d'ouvrages du répertoire. Les directeurs s'engagèrent à refaire avant le 31 décembre 1899, les décors de l'Africaine, d'Aïda, du Cid, de Coppelia, de Don Juan, de la Favorite, du Freischütz, de Guillaume Tell, d'Hamlet, des Huguenots, de la Juive, de la Muette, de Patrie !, du Prophète et de Roméo et Juliette. Bertrand mourut avant la fin du privilège, le 30 décembre 1899. Gailhard resta seul directeur et fut en cette qualité prorogé de sept années encore, en 1900, jusqu'au 31 décembre 1907. Ainsi pendant vingt-trois années, dont il ne faut déduire qu'une interruption de quinze mois, seul ou en compagnie d'associés sur qui il avait le grand avantage d'être de la maison, Gailhard demeura directeur de l'Opéra. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'être surpris si cette stabilité sans précédent depuis Lulli conduisit bientôt à l'idée qu'on ne pouvait se passer de Gailhard et qu'il était le seul directeur possible. Comme d'autre part sa direction donnait lieu à de nombreuses et graves critiques, de plus en plus nombreuses et graves à mesure que le temps passait, l'opinion s'accrédita que l'Opéra ne pouvait faire mieux, que Gailhard en tirait le meilleur, ou plutôt le seul parti possible, et qu'après lui cette vieille machine qui déjà ne pouvait plus rendre aucun service à l'art moderne, tomberait en ruines et ne serait plus qu'un souvenir.
Il fallait, dès 1884, un certain courage pour rechercher la direction de l'Opéra. Reyer (53) rapporte qu'un des candidats, ayant appris que les frais de balayage s'élevaient à eux seuls, pour l'année, à la somme de 36.000 francs, se serait écrié en levant les bras au ciel : « Si au moins pour ce prix là on pouvait donner un bon coup de balai ! » Les résultats du mois de décembre 1884 furent bien peu encourageants pour les nouveaux directeurs. Le 24, veille de Noël, Aïda ne faisait que 12.767 fr. 05 de recettes ; le 26, les Huguenots atteignaient 15.231 fr. 47, et Robert le Diable, le 31, seulement 13.778 fr. 56. Aussi le livre où ces chiffres sont consignés sort-il de sa réserve habituelle pour inscrire, à la colonne des Observations, ce cri d'alarme : « Désastreuses recettes. Désordre administratif. Tout le monde commande ».
Le désordre ne fut pas de longue durée. Il faut rendre cette justice à Gailhard qu'il était bon administrateur. Il était même artiste à sa façon, qui était celle d'un baryton de l'ancien répertoire, je veux dire du répertoire antérieur à Wagner, excellent dans le rôle de Méphistophélès. Reyer (53) déplore les exigences des chanteurs qui grèvent d'une trop lourde charge le budget de l'Opéra. Gailhard devenu directeur a toujours bien payé ses anciens camarades. C'est aux dépens des œuvres nouvelles qu'il a fait des économies, soit en s'arrangeant pour éluder les obligations du cahier des charges et laissant passer, comme en 1887, plus d'une année sans en mettre une seule à la scène, soit en lésinant sur les décors ou l'interprétation. Le tableau suivant résume le résultat de ses efforts. Les chiffres des recettes sont les plus sûrs indices du goût du public. On verra donc par ces chiffres soit l'impossibilité où se trouvait l'Opéra de garder au programme un ouvrage, ou la facilité qu'il aurait eue à le mieux soutenir, ou dans certains cas le courage qu'il lui fallut pour le défendre, et finalement l'imposer.
(53) Journal des Débats, 16 octobre 1884.
|
Dates 12 janvier 1885 14 janvier 1885 16 janvier 1885 |
Œuvres Tabarin, le Fandango « « « « |
Recettes 14.067 fr. 30 11.341 fr. 80 13.101 fr. 97 |
Ensuite : de 12.000 à 13.000 fr.
|
28 février 1885 02 mars 1885 04 mars 1885 |
Rigoletto « « |
15.905 fr. 68 18.531 fr. 18 13.036 fr. 30 |
Ensuite : de 16.000 à 18.000 fr.
|
12 juin 1885 15 juin 1885 17 juin 1885 |
Sigurd « « |
15.550 fr. 18 14.961 fr. 68 14.825 fr. 80 |
Ensuite : 13.000 à 15.000 fr.
|
30 novembre 1885 02 décembre 1885 04 décembre 1885 |
le Cid « « |
16.582 fr. 41 19.095 fr. 26 21.019 fr. 91 |
Ensuite : de 18.000 à 21.000 fr.
|
27 janvier 1886 18 octobre 1886 20 octobre 1886 22 octobre 1886 |
Rigoletto, les Jumeaux de Bergame la Favorite, les Deux pigeons Rigoletto, les Deux pigeons le Freischütz, les Deux pigeons |
13.125 fr. 26 16.381 fr. 41 18.144 fr. 26 18.700 fr. 91 |
Ensuite : de 14.000 à 18.000 fr.
|
20 décembre 1886 22 décembre 1886 24 décembre 1886 |
Patrie ! « « |
16.700 fr. 41 19.365 fr. 26 20.471 fr. 41 |
Ensuite : au-dessus de 20.000 fr.
|
30 janvier 1888 01 février 1888 03 février 1888 |
la Dame de Monsoreau « « |
17.151 fr. 41 16.457 fr. 26 17.403 fr. 91 |
Ensuite : de 12.000 à 15.000 fr.
|
28 novembre 1888 01 décembre 1888 03 décembre 1888 |
Roméo et Juliette « « |
18.360 fr. 76 21.322 fr. 00 21.848 fr. 91 |
Ensuite : de 22.000 à 23.000 fr.
|
26 juin 1889 28 juin 1889 05 juillet 1889 21 mars 1890 24 mars 1890 26 mars 1890 |
la Tempête « Rigoletto, la Tempête Ascanio « « |
17.547 fr. 26 19.876 fr. 91 21.050 fr. 41 16.880 fr. 91 17.241 fr. 91 17.265 fr. 26 |
Ensuite : autour de 17.000 fr.
|
28 mai 1890 06 juin 1890 09 juin 1890 11 juin 1890 20 juin 1890 16 mars 1891 18 mars 1891 20 mars 1891 |
Zaïre, Coppelia « « Zaïre, le Rêve « « « « le Mage « « |
16.166 fr. 26 13.921 fr. 41 14.613 fr. 91 17.022 fr. 26 18.577 fr. 41 16.603 fr. 91 18.968 fr. 76 19.567 fr. 41 |
Ensuite : 15.000 à 19.000 fr.
|
16 septembre 1891 18 septembre 1891 21 septembre 1891 |
Lohengrin « « |
15.891 fr. 76 18.652 fr. 41 20.764 fr. 91 |
Ensuite : plus de 21.000 fr.
|
28 décembre 1891 06 janvier 1892 09 janvier 1892
16 mai 1892 18 mai 1892 20 mai 1892 17 juin 1892 23 novembre 1892 25 novembre 1892 28 novembre 1892 |
Tamara, la Tempête « « « «
Salammbô « « la Vie du Poète, Sylvia Samson et Dalila « « |
15.244 fr. 41 13.291 fr. 76 08.296 fr. 50 (Sans abonnement) 13.890 fr. 41 18.430 fr. 76 21.229 fr. 75 14.286 fr. 41 14.253 fr. 92 17.903 fr. 25 18.353 fr. 41 |
Ensuite : de 16.000 à 18.000 fr.
|
09 décembre 1892 14 décembre 1892 19 décembre 1892 |
Samson et Dalila, Stratonice « « « « |
17.898 fr. 91 18.239 fr. 17 16.319 fr. 25 |
Ensuite : 15.000 à 18.000 fr.
|
24 février 1893 27 février 1893 01 mars 1893 12 mai 1893 15 mai 1893 17 mai 1893 |
Stratonice, la Maladetta la Favorite, la Maladetta « « la Walkyrie « « |
13.149 fr. 25 15.795 fr. 91 16.199 fr. 76 15.388 fr. 91 18.667 fr. 75 22.338 fr. 26 |
Ensuite : plus de 22.000 fr.
|
15 septembre 1893 20 septembre 1893 25 septembre 1893 27 décembre 1893 29 décembre 1893 03 janvier 1894 |
Déidamie, la Maladetta Samson et Dalila, Déidamie « « Gwendoline Gwendoline, Déidamie Gwendoline, la Maladetta |
15.020 fr. 41 16.249 fr. 76 16.788 fr. 91 13.970 fr. 76 14.883 fr. 91 14.769 fr. 76 |
Ensuite : de 13 000 à 16.000 fr.
|
16 mars 1894 19 mars 1894 21 mars 1894 |
Thaïs « « |
14.607 fr. 91 16.525 fr. 76 19.474 fr. 41 |
Ensuite : de 15.000 à 17.000 fr.
|
12 octobre 1894 15 octobre 1894 17 octobre 1894 |
Othello « « |
14.023 fr. 91 18.846 fr. 41 21.641 fr. 76 |
Ensuite : vers 20.000 fr.
|
25 mai 1894 30 mai 1894 02 juin 1894 |
Djelma, Déidamie Djelma, Gwendoline Djelma, la Maladetta |
14.343 fr. 41 14.495 fr. 76 13.541 fr. 91 |
Ensuite : de 14.000 à 15.000 fr.
|
08 février 1895 11 février 1895 13 février 1895 |
la Montagne noire « « |
14.087 fr. 41 13.100 fr. 91 12.107 fr. 76 |
Ensuite : 12.000 à 14.000 fr.
|
13 mai 1895 17 mai 1895 22 mai 1895 |
Tannhäuser « « |
14.455 fr. 91 19.126 fr. 91 23.070 fr. 76 |
Ensuite : 22.000 à 23.000 fr.
|
18 décembre 1895 20 décembre 1895 23 décembre 1895 |
Frédégonde « « |
14.206 fr. 76 15.786 fr. 91 15.705 fr. 91 |
Ensuite : 12.000 à 15.000 fr.
|
24 avril 1896 27 avril 1896 29 avril 1896 |
Hellé « « |
14.402 fr. 91 15.348 fr. 41 16.032 fr. 26 |
Ensuite : de 16.000 à 17.000 fr.
|
19 février 1897 22 février 1897 24 février 1897 |
Messidor « « |
13.177 fr. 91 14.168 fr. 41 14.077 fr. 76 |
Ensuite : de 14.000 à 16.000 fr.
|
31 mai 1897 01 juin 1897 05 juin 1897 10 novembre 1897 12 novembre 1897 15 novembre 1897 |
Thaïs, l’Etoile l'Etoile, la Favorite l’Etoile, Samson et Dalila les Maîtres-chanteurs « « |
12.972 fr. 91 15.309 fr. 76 13.485 fr. 00 13.107 fr. 76 18.343 fr. 41 21.876 fr. 91 |
Ensuite : de 19.000 à 22.000 fr.
|
08 juin 1898 13 juin 1898 17 juin 1898 |
la Cloche du Rhin, l'Etoile la Cloche du Rhin, la Maladetta « « |
13.160 fr. 26 15.115 fr. 41 16.242 fr. 41 |
Ensuite : 13.000 à 15.000 fr.
|
23 décembre 1898 26 décembre 1898 28 décembre 1898 |
la Burgonde « « |
13.121 fr. 41 14.394 fr. 41 12.546 fr. 76 |
Ensuite : de 11.000 à 14.000 fr.
|
08 mai 1899 12 mai 1899 20 mai 1899
26 mai 1899 29 mai 1899 31 mai 1899 |
Briséis, Samson et Dalila « « « «
Joseph, Briséis Joseph, l'Etoile Joseph, Briséis |
13.180 fr. 91 17.938 fr. 41 12.700 fr. 00 (Sans abonnement) 13.224 fr. 91 14.101 fr. 26 13.872 fr. 91 |
Ensuite : 12.000 à 16.000 fr.
|
15 novembre 1899 17 novembre 1899 20 novembre 1899 |
la Prise de Troie la Prise de Troie, l’Etoile (1er acte) la Prise de Troie, Coppelia |
13.164 fr. 76 17.224 fr. 91 16.718 fr. 91 |
Ensuite : 13.000 à 14.000 fr.
|
05 février 1900 07 février 1900 14 février 1900 |
Lancelot « « |
12.839 fr. 26 14.926 fr. 91 11.454 fr. 26 |
Ensuite : de 11.000 à 12 000 fr.
|
15 février 1901 18 février 1901 20 février 1901 |
Astarté « « |
14.133 fr. 41 17.178 fr. 91 15.708 fr. 26 |
Ensuite : de 16.000 à 17.000 fr.
|
26 avril 1901 29 avril 1901 04 mai 1901
|
le Roi de Paris, la Korrigane le Roi de Paris, Coppelia le Roi de Paris, la Maladetta
|
13.518 fr. 41 14.978 fr. 91 09.793 fr. 00 (Sans abonnement) |
Ensuite : de 14.000 à 15.000 fr.
|
23 octobre 1901 25 octobre 1901 28 octobre 1901 |
les Barbares « « |
14.267 fr. 76 18.620 fr. 41 18.601 fr. 91 |
Ensuite : de 15.000 à 20.000 fr.
|
03 janvier 1902 06 janvier 1902 10 janvier 1902 |
Siegfried « « |
15.378 fr. 91 20.202 fr. 41 22.257 fr. 41 |
Ensuite : 21.000 à 22.000 fr.
|
21 mai 1902 26 mai 1902 16 juin 1902
|
Orsola Orsola, Coppelia Orsola, la Korrigane
|
13.591 fr. 76 14.361 fr. 41 09.003 fr. 50 (Sans abonnement) |
Ensuite : de 11.000 à 12.000 fr.
|
26 novembre 1902 28 novembre 1902 01 décembre 1902 17 décembre 1902 19 décembre 1902 22 décembre 1902 |
les Barbares, Bacchus « « Rigoletto, Bacchus Paillasse, Bacchus « « « « |
12.237 fr. 26 13.683 fr. 41 14.173 fr. 41 18.508 fr. 91 10.508 fr. 91 16.557 fr. 41 |
Ensuite : vers 15.000 fr.
|
06 mars 1903 09 mars 1903 11 mars 1903 |
la Statue « « |
13.183 fr. 41 14.305 fr. 91 13.351 fr. 76 |
Ensuite : 12.000 à 14.000 fr.
|
04 décembre 1903 07 décembre 1903 12 décembre 1903
16 décembre 1903 19 décembre 1903 |
l’Etranger, l’Enlèvement au sérail Samson et Dalila, l’Enlèvement au sérail l’Etranger, l’Enlèvement au sérail
l’Etranger, la Korrigane l’Etranger, l’Enlèvement au sérail |
15.095 fr. 41 12.604 fr. 41 07.861 fr. 50 (Sans abonnement) 15.413 fr. 76 13.336 fr. 50 |
Ensuite : 13.000 à 14.000 fr.
|
20 avril 1904 22 avril 1904 25 avril 1904 |
le Fils de l’Etoile « « |
13.305 fr. 26 19.160 fr. 41 20.797 fr. 41 |
Ensuite : 16.000 à 17.000 fr.
|
14 décembre 1904 19 décembre 1904 23 décembre 1904 |
Tristan et Isolde « « |
15.248 fr. 26 20.099 fr. 41 22.144 fr. 34 |
Ensuite : 15.000 à 20.000 fr.
|
27 janvier 1905 01 février 1905 06 février 1905 |
Daria, Coppelia Rigoletto, Daria « « |
11.828 fr. 91 14.795 fr. 76 13.796 fr. 91 |
Ensuite : de 11.000 à 12.000 fr.
|
12 avril 1905 14 avril 1905 19 avril 1905 |
Armide « « |
13.915 fr. 26 18.241 fr. 41 20.589 fr. 76 |
Ensuite : 20.000 à 22.000 fr.
|
27 octobre 1905 01 novembre 1905 06 novembre 1905 22 décembre 1905 27 décembre 1905 29 décembre 1905 |
le Freischütz, le Jugement de Pâris « « « « le Freischütz, la Ronde des Saisons « « Samson et Dalila, la Ronde des Saisons |
15.001 fr. 91 16.970 fr. 76 15.840 fr. 41 14.036 fr. 41 15.029 fr. 76 17.439 fr. 41 |
Ensuite : 15.000 à 17.000 fr.
|
31 octobre 1906 02 novembre 1906 05 novembre 1906 |
Ariane « « |
14.305 fr. 76 20.006 fr. 91 21.688 fr. 41 |
Ensuite : 18.000 à 22.000 fr.
|
24 mai 1907 27 mai 1907 01 juin 1907
|
la Catalane « «
|
11.961 fr. 34 12.722 fr. 91 08.800 fr. 50 (Sans abonnement) |
Ensuite : de 14.000 à 16.000 fr.
|
25 novembre 1907 02 décembre 1907 13 décembre 1907 |
Samson et Dalila, le Lac des Aulnes « « « « |
15.597 fr. 41 17.794 fr. 41 17.160 fr. 41 |
Il faut, pour interpréter convenablement ces chiffres, se souvenir que les œuvres nouvelles ou les reprises importantes sont presque toujours données aux soirées d'abonnement, où une partie de la recette est de toute façon assurée. C'est la répartition de l'abonnement sur ces soirées qui fait apparaître dans le total les centimes, à première vue inexplicables. Il représentait alors, en moyenne, une somme à défalquer de 9.000 à 10.000 francs. On doit remarquer aussi que les recettes des premières représentations sont toujours moins élevées, parce qu'on était dans l'obligation de donner des places aux auteurs et à quelques directeurs de journaux. En tenant compte de ces circonstances, on arrivera à cette règle approximative, qu'à cette époque de l'histoire de l'Opéra, un ouvrage a un véritable succès quand à partir de la troisième représentation il dépasse 20.000 fr. de recettes. De 16.000 à 20.000 fr., le résultat est douteux. Au dessous de 16.000 fr., c'est un échec incontestable.
Tabarin était un legs de Vaucorbeil, qui en entrant à l'Opéra avait annoncé son intention de monter des ouvrages en deux actes, sans grand spectacle, et même de diminuer pour ces ouvrages, par des artifices dont il voulait faire l'essai, la largeur de la scène (54). Il n'avait trouvé d'abord que le Comte Ory, de Rossini, qui répondît à son dessein. Tabarin, dont Paul Ferrier avait écrit les paroles d'après une pièce jouée à la Comédie-Française en 1875, et Pessard (55) la musique, lui fut apporté trop tard pour qu'il pût veiller lui-même à l'interprétation. Gailhard, qui ne s'intéressait qu'au grand opéra, laissa tomber l'ouvrage, et trente ans devaient s'écouler avant que l'idée d'enrichir ainsi le répertoire de l'Opéra fût reprise, et cette fois, grâce aux progrès de la mise en scène, justifiée par le succès.
(54) Revue des Deux Mondes, 15 octobre 1880.
(55) Emile Pessard, né le 29 mai 1843, prix de Rome en 1866, mort en 1917, est l'auteur d'opérettes telles que la Cruche cassée (1870), le Capitaine Fracasse (1878), les Folies amoureuses (1891).
C'est aussi grâce aux démarches personnelles de Vaucorbeil auprès de Verdi que Rigoletto, représenté pour la première fois à Venise le 11 mars 1851, puis à Paris, au Théâtre-Italien en 1857, au Théâtre-Lyrique en 1863, avait été promis à l'Opéra. On sait que le livret de Piave avait été tiré du drame de Victor Hugo le Roi s'amuse, mais que la police autrichienne était intervenue et que pour éviter l'accusation de lèse-majesté ce roi était descendu au rang de simple duc, en même temps que Triboulet se changeait en Rigoletto. C'est sous cette forme inoffensive que la pièce nous revint, dans la traduction française d'Edouard Duprez. L'interprétation réunissait Lassalle, Dereims, Boudouresque, Gaspard, mesdames Krauss et Richard.

Sigurd. Décor pour le 2e acte, 3e tableau (Bibliothèque de l'Opéra)
Mais Ritt et Gailhard ont eu l'honneur d'introduire Sigurd à l'Opéra. Trois directeurs successifs, Perrin, Halanzier et Vaucorbeil n'avaient pu ou n'avaient voulu jouer l'ouvrage (56), qui avait pris, comme tant d'autres par la suite, le chemin de Bruxelles. Gailhard fit le voyage pour entendre madame Rose Caron, et revint dire à Reyer qu'elle n'avait pas assez de voix pour l'Opéra. Mais Reyer tint bon, car il savait bien qu'à l'Opéra comme ailleurs ce n'est pas en criant qu'on se fait entendre, ou plutôt qu'on se fait écouter. Madame Caron dans le rôle de Brunnhilde fut la triomphatrice de la soirée et Reyer lui adressa ce compliment : « Vous voilà passée au rang d'étoile, tâchez malgré cela de rester une grande artiste ». C'est ce qui arriva en effet. En dépit de ce succès personnel et des applaudissements décernés, dans les autres rôles, à Lassalle, Sellier, Gresse, à mesdames Bosman et Richard, Sigurd ne fit que de maigres recettes. Mais Gailhard s'obstina. Il maintint l'ouvrage, et finit par vaincre l'indifférence du public. Il me disait un jour qu'il avait fait des sacrifices pour Sigurd jusqu'à la centième représentation. C'est là un titre de gloire qu'il ne faut pas lui retirer. Mais pourquoi le public se montrait-il si récalcitrant ? Il ne devait bouder ainsi ni contre le Cid et Patrie !, ni contre Roméo et Juliette, Lohengrin, ni même, sept ans plus tard, contre Salammbô.
(56) Ces détails et ceux qui suivent sont empruntés à l'article de Reyer, dans le Journal des Débats du 12 juin 1885, reproduit dans le recueil Quarante ans de musique, pages 15 et suivantes.
Si on procède par élimination, je veux dire si on cherche par quel endroit Sigurd est constamment en défaut par rapport aux cinq autres ouvrages, on trouvera que c'est pour le sujet. Reyer a décrit plaisamment la stupeur d'Halanzier à la lecture du poème : « Hilda, Brunnhilde, Gunther roi des Burgondes, Uta, Freia, les Valkyries, les Trois Nornes, qu'est-ce que c'est que tous ces gens là ? » Halanzier n'était pas seul à se perdre dans cette mythologie germanique que le public français ne fut obligé d'étudier que plus tard, quand Wagner fut devenu, comme on dit dans les classes, un auteur du programme. Alors, mais alors seulement, le drame de Sigurd sembla clair comme eau de roche, et le succès se dessina. Il n'a fait que se confirmer jusqu'à nos jours. Bien loin que Sigurd ait ouvert la route à la Tétralogie, c'est à la Tétralogie qu'il était réservé d'acclimater en France Sigurd.
C'est Alfred Blau qui avait eu l'idée du sujet. Camille du Locle accepta de le mettre en vers. Reyer affirme que si l'ouvrage est d'une trame continue, sans morceaux séparés, c'est par la volonté du poète. « Oui, mon ami du Locle, c'est vous qui avez fait de moi un wagnérien ». Par contre le retour des thèmes caractéristiques, qui est aussi un des procédés favoris de Wagner, n'est imputable qu'au musicien. Mais ce ne sont là que des ressemblances superficielles. Les mélodies de Reyer sont d'un métal qui ne se laisse ni souder ni forger. D'elles-mêmes elles se détachent et forment des airs à qui rien ne manque, qu'un titre particulier dans la partition. Elles ne se prêtent à aucun travail de développement ; on ne peut ni les étirer, ni les ramasser, ni les découper, ni les infléchir, ni même les rendre adhérentes à d'autres mélodies, ou les envelopper d'un réseau quelque peu serré d'accords : c'est tout juste si elles se laissent accompagner, à leurs notes saillantes, par une cadence d'harmonie élémentaire, donnée une fois pour toutes et qui n'admet aucun changement. Rien n'est plus éloigné du magma wagnérien que ce style sentencieux et tendu, sans grâce, sans résonance, où la pensée toujours en lutte avec l'expression ne dégage sa noblesse que par des éclairs de génie. Reyer est un musicien pauvre et dur, mais c'est un grand poète en musique, et on dira toujours de lui ce que madame de Sévigné disait de Corneille, lui aussi aux prises, surtout au début de sa carrière, avec une langue indocile : « Il a des beautés qui transportent ! »

Massenet par Delaroche
Après Gounod, c'est Massenet qui vint se mesurer, sur la scène de l'Opéra, avec Corneille, mais en de bien meilleures conditions. Le sujet du Cid met en jeu des passions plus humaines que celui de Polyeucte, et par des incidents plus dramatiques. C'est pourquoi il avait été déjà traduit en musique par Sacchini, qui faisait représenter le 18 novembre 1783 une Chimène, sur un poème de Guillard. Bizet, en 1873, avait demandé à Louis Gallet de lui donner un livret pour un Cid qu'il n'eut pas le temps de mettre en musique, enlevé par une mort prématurée le 3 juin 1875. D'Ennery, de son côté, avait commencé d'arranger le même sujet pour la scène lyrique. Il se mit d'accord avec Louis Gallet, grâce à l'intervention d'Alfred Blau, et le livret signé de leurs trois noms fut offert à Massenet. Les auteurs ont très habilement mis en action tous les épisodes dont Corneille, par un respect pour les règles d'unité que d'ailleurs les pédants de l'époque n'estimèrent pas suffisant, ne fait que le récit. C'est ainsi que le premier acte se passe d'abord chez le comte de Gormas, puis devant la cathédrale où Rodrigue est armé chevalier, et qu'au troisième, après le premier tableau dans la chambre de Chimène, nous sommes transportés au camp de Rodrigue et assistons à sa victoire. De plus, ils ont emprunté à la pièce espagnole de Guilhem de Castro, les Enfances du Cid, ainsi qu'au Romancero dont précisément José Maria de Heredia venait de publier, dans la Revue des Deux Mondes, trois fragments traduits pour la première fois en français, des traits de piété dont Corneille avait débarrassé, pour le simplifier, le caractère du héros, mais qui donnent satisfaction au goût romantique de la couleur locale. Rodrigue, au sortir de la cathédrale, fait vœu de fidélité à Saint Jacques de Compostelle, qui va lui apparaître, dans la nuit qui précède la bataille, pour lui promettre son secours. Sans doute il est regrettable que dans leur zèle de mouvement les trois remanieurs aient fait prononcer par Rodrigue au cours même du duel, et dans le moment qu'il transperce le Comte, les vers célèbres :
Mes pareils à deux fois ne se font pas connaître
Et pour leurs coups d'essai veulent des coups de maître.
Comme si le coup de maître était un tour d'escrime et non un acte de courage. Reyer (57), qui relève cette méprise ou cette maladresse, ajoute une objection plus grave. C'est que des vers comme ceux-ci, et d'autres de la même tragédie, que nous savons tous par cœur, ne peuvent rien gagner à être mis en musique :
Le compositeur a eu beau prêter à ces épiques apostrophes l'accent mélodique le plus pompeux, le plus véhément, il n'est pas parvenu à nous émouvoir plus que ne le font les vers du poète, scandés tout simplement par la parole du tragédien.
(57) Journal des Débats, 6 décembre 1885.
Le danger de la comparaison, ou plutôt du souvenir, ne peut être évité et doit mettre les musiciens en garde contre les chefs-d’œuvre de la littérature, déjà consacrés par une admiration séculaire. Les meilleurs endroits du Cid, ceux aussi qui ont d'emblée obtenu le plus de succès, se trouvent dans les scènes les moins connues de la tragédie ou dans celles que les librettistes avaient ajoutées, comme la romance de l'Infante, au deuxième acte, qui fut bissée, la plainte de Chimène, au début du troisième, ou les deux ballets, l'un espagnol, l'autre mauresque, au deuxième et au troisième acte. L'interprétation fut excellente : elle réunissait les deux frères Edmond et Jean de Reszké, dans les rôles de don Diègue et du Cid, Plançon, Melchissédec, mesdames Fidès Devriès, Bosman, et mademoiselle Mauri, dans le ballet dont le caractère était suffisamment espagnol pour lui rappeler son origine et lui permettre de l'accuser davantage. Reyer ne put porter, bien qu'un peu à contrecœur, qu'un jugement favorable :
M. Massenet a bien mis tout ce qu'on attendait de lui. Il y a mis toute la délicatesse, toutes les fines ciselures de son style, l'ingéniosité, le piquant coloris de son instrumentation, la grâce un peu maniérée parfois mais toujours pleine de charme de ses idées mélodiques, et toute la véhémence d'accent, toute la noblesse d'expression que certaines situations exigent. Que pouvait-il faire de plus ?
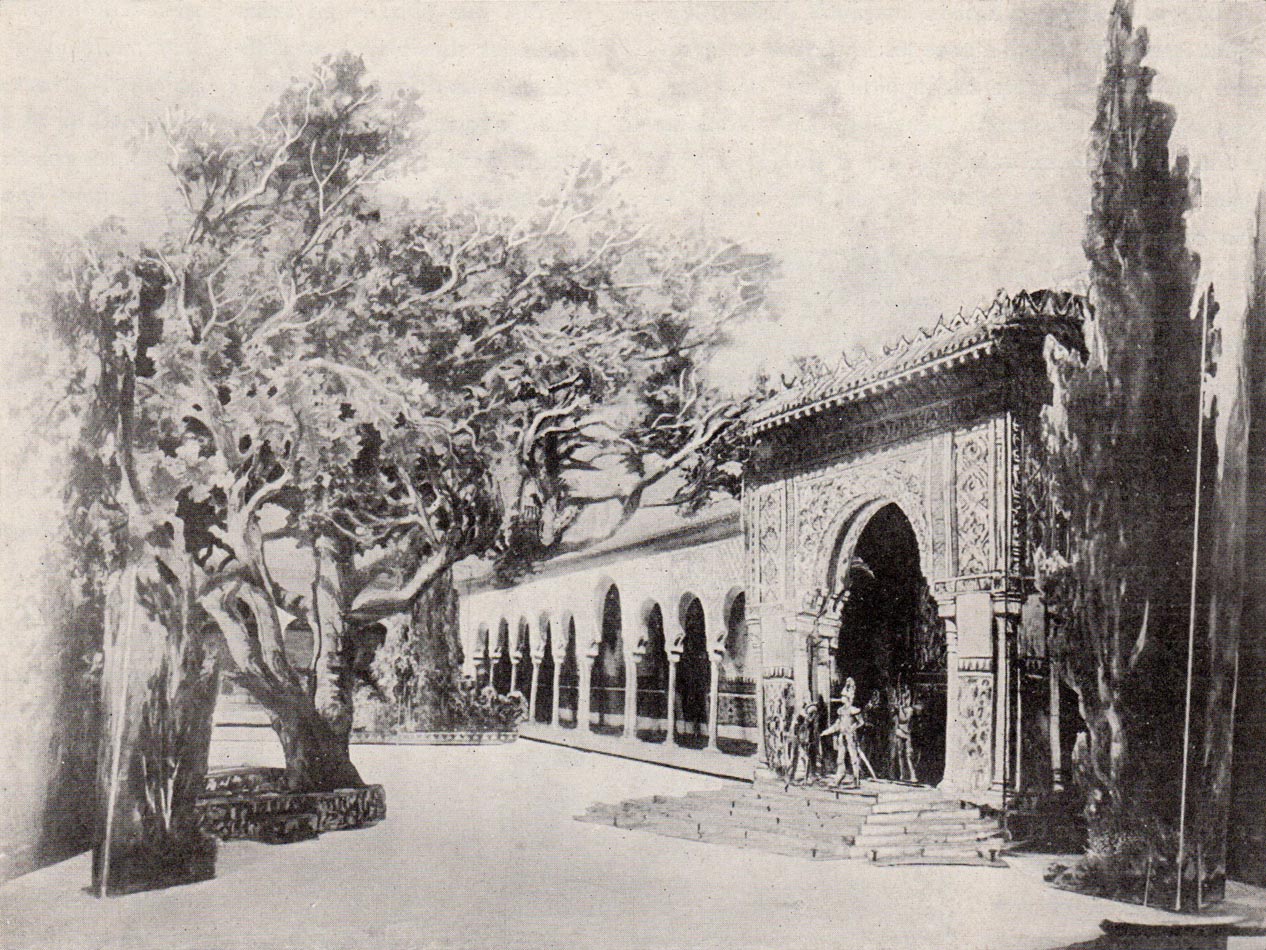
le Cid. Décor pour le 4e acte, 2e tableau (Bibliothèque de l'Opéra)
La partition du Cid vaut mieux que ces éloges restrictifs et ces compliments présentés comme des excuses. Massenet n'ajoute et ne pouvait rien ajouter à Corneille, là où il est sublime ; mais il ne lui fait aucun tort, parce que sa musique, même quand elle manque de vigueur, reste élégante et noble. Par ailleurs, elle abonde en idées justes et neuves, dont l'auditeur sensible est touché aussitôt, tant elles sont claires, sans même remarquer ce qu'elles peuvent contenir d'audacieux et d'imprévu. Peut-être à un examen attentif pourrait-on relever dans le Cid un coloris un peu moins vif que celui du Roi de Lahore dont le sujet, tout de fantaisie, donnait plus de liberté au musicien, un peu préoccupé ici de garder une dignité classique. Mais on y chercherait en vain aucune trace de cette vulgarité qui plus tard fut la faiblesse de Massenet, et dont certes il faut moins l'accuser lui-même que les poètes et les directeurs de théâtre qui s'en faisaient, par grossièreté d'esprit ou par calcul, les complices et les agents provocateurs.
Mais Reyer ne pouvait aimer Massenet, pas plus sans doute que Massenet n'aimait Reyer. Il est tout à l'honneur de la musique française d'avoir pu produire dans le même temps deux génies aussi opposés, et l'avenir s'annonçait brillant pour une scène où l'on jouait tour à tour le Cid et Sigurd. Mais ces belles espérances devaient être déçues.
Les Jumeaux de Bergame sont un ballet de Nuitter et Mérante, d'après un conte de Florian, et la musique était de Théodore de Lajarte. Donné l'été précédent au casino de Paramé, cet ouvrage ne fit qu'une brève apparition à l'Opéra, où certainement Vaucorbeil ne l'eût pas admis.
Par contre, Gailhard ne se montrait nullement pressé de monter le ballet des Deux pigeons (58). C'est Saint-Saëns qui avait recommandé M. Messager à Vaucorbeil, après la première représentation de Henry VIII, profitant, comme il le disait lui-même dans une lettre à son jeune protégé, de l'optimisme qui suit une réussite au théâtre. Mais l'opinion de Saint-Saëns n'avait pas pour Gailhard la même valeur que pour son prédécesseur. Il fallut insister. Le ballet fut enfin mis à l'étude, et la préparation n'en dura pas moins de six mois, ce qui à cette époque ne surprit personne, tant alors le travail était lent à l'Opéra. Cependant on avait accordé à l'auteur une innovation. Jusque là les danses et les pas d'un ballet étaient réglés avec l'accompagnement d'un violon et d'un alto. On devine ce que cette méthode, bonne tout au plus pour Lulli, pouvait donner avec des partitions d'une orchestration aussi variée que par exemple Namouna. Le résultat était qu'à la première répétition d'orchestre, personne ne s'y reconnaissait, et tout était à recommencer. C'est pour les Deux pigeons que l'on introduisit, dans les salles d'études de la danse, le piano dont nous ne concevons pas aujourd'hui qu'on ait jamais pu se passer.
(58) Je dois ces détails à un entretien personnel avec M. André Messager, à qui je tiens à dire ici toute ma reconnaissance.

décor pour les Deux Pigeons (Bibliothèque de l'Opéra)
André Messager, né à Montluçon le 30 décembre 1853, ne sortait pas du Conservatoire, mais de l'école Niedermeyer où il avait été élève de Saint-Saëns. Le ballet des Deux pigeons fait exception dans une carrière entièrement vouée à l'opérette et à l'opéra-comique, et on peut regretter que cette exception soit unique, car les qualités de verve, de goût, d'esprit, la sensibilité artistique et l'élégance innée qui distinguent ce musicien parmi tous ceux de sa génération ne sont pas moins favorables à la danse qu'à la comédie, et le ballet qu'il a donné à l'Opéra peut être considéré comme un modèle du genre, aussi bien pour la grâce de la musique que pour l'énergie intérieure qui l'excite à ce mouvement perpétuel à cette joie infatigable, ordonnée cependant, raisonnée, traduite en harmonie et en rythme comme par son langage naturel, de même que la danseuse sur la scène, dressée sur les pointes par une attraction d'en haut contraire aux lois de la gravitation, frémit, prête à bondir, d'un excès de force juvénile qui tend ses muscles durcis, et pourtant grâce à une discipline ininterrompue depuis l'enfance, évitera toujours et à coup sûr ce que l'exubérance peut avoir de sauvage et la fantaisie d'imprévu, viendra s'inscrire avec une parfaite aisance, quand même la danse serait l'image d'une ardeur bohémienne ou d'un violent désespoir, dans les lignes des figures et des pas tracés d'avance par une géométrie qui n'admet aucune approximation.
Les auditeurs bien nés, quand ils étendent à la musique les opinions conservatrices qui leur appartiennent de droit en politique, ont coutume de prononcer, devant une œuvre nouvelle ou réputée telle, cette formule qui est moins une excuse pour leur incompétence qu'une condamnation de la prétention d'autrui : « Il paraît qu'il faut être initié pour comprendre ». S'il s'agit d'un ballet, ils se gardent de parler ainsi, et cependant aucun art n'exige aussi impérieusement que l'art chorégraphique la connaissance d'une technique qui fait toute sa beauté, aussi indéchiffrable sans cette connaissance que peuvent l'être à qui n'en a pas la clé les hiéroglyphes égyptiens. Mais un habitué de l'Opéra se croit capable de déchiffrer un ballet à première vue, parce qu'il fréquente le foyer de la danse et y a vaguement entendu parler d'entrechats-six. Il se trompe fort, et la preuve en est que le ballet des Deux pigeons ne fut pas d'abord reconnu pour ce qu'il était : un ballet moderne par l'accent des mélodies, la plénitude de l'harmonie et la sonorité de l'orchestre, mais entièrement traditionnel par le sujet, la disposition des épisodes, et leur caractère. Rien n'y manquait, pas même ces touches d'exotisme qui de tout temps ont été fort appréciées dans le ballet, sous la condition toutefois de n'y pas être prises au sérieux plus d'un déguisement dans un bal costumé, et d'y laisser toujours reconnaître, sous la mantille de l'Andalouse ou l'écharpe de l'esclave indienne, les jupes bouffantes de la danseuse, hiérarchiquement arrondies et gonflées jusqu'à la corolle de gaze blanche qui en toute circonstance reste l'apanage et l'insigne de l'étoile. C'était mademoiselle Mauri qui le portait, comme de juste, parmi ses camarades dont un fichu colorié suffisait à affirmer la nationalité : c'est dans un village de la Grèce moderne, près de la mer, que Regnier avait transporté, en même temps que dans la race humaine, la fable dont pourtant une cage avec deux pigeons, accrochée vers le fond du décor, indiquait encore le souvenir. Et à l'instar de Victor Hugo qui avait inventé les noms de Pecopin et de Bauldour pour imiter le cri du coq et le roucoulement de la colombe, il avait donné à la jeune fille le nom de Gourouli, à son fiancé qui va la quitter pour suivre des Bohémiens méchants, celui de Pepio. Selon l'usage du temps, ce rôle masculin était joué, en travesti, par mademoiselle Sanlaville qui était toujours requise en pareil cas. Rien, en tout cela, de révolutionnaire. Mais Messager était à l'Opéra un nouveau venu ; il était jeune, et on le savait affilié au groupement séditieux de la Société nationale. Le préjugé fut assez fort pour rendre le public hésitant, la critique aigre-douce. Mais l'auteur reçut les félicitations de Gounod, qui étaient pour un débutant comme lui un encouragement précieux. Le ballet des Deux pigeons a été fréquemment repris depuis lors, avec un succès qui jusqu'à nos jours ne s'est jamais démenti.
Patrie ! est le dernier exemplaire connu d'un genre qui allait disparaître après un demi-siècle de gloire, et qui est celui de l'opéra historique ; quand je dis qu'il allait disparaître, j'entends que les auteurs l'abandonnaient, mais le public s'y plaisait encore. En 1887, voici en quels termes un critique (59) exprimait son admiration après une reprise du Prophète, de Meyerbeer :
On a fort bien dit : Nous ne reprenons pas les chefs-d'œuvre : ce sont les chefs-d’œuvre qui nous reprennent. Comme le Prophète nous a repris ! Le hasard avait fait que depuis dix ans peut-être nous ne l'avions ni revu ni relu tout d'une haleine. En dix ans, que de musique entendue, soit en France, soit à l'étranger ! Que de courants établis ! Que de doctrines se disputent notre époque incertaine ! Et nous retournions un Prophète avec un peu d'inquiétude. Aujourd'hui, l'on médit tellement de Meyerbeer ! Il est tellement à la mode, parmi les nains du jour, de rapetisser ce géant ! Nous-mêmes, allions-nous donc le trouver amoindri ? Sentirions-nous faiblir au fond de notre cœur notre admiration d'autrefois, et n'entendrions-nous plus, comme dit le poète, chanter l'oiseau de nos jeunes années ? Mais non ; l'œuvre a reparu, et elle a resplendi. La voilà toujours, dans sa grandeur colossale ; la voilà sur sa base inébranlée, avec ses proportions gigantesques et son architecture de cathédrale ; la voilà, cette œuvre de poésie et de vérité, toute vivante, toute vibrante d'humanité, et belle avec cela de certaines beautés plus qu'humaines. La voilà puissante avec sobriété, complexe sans confusion, faite à la mesure de notre âme, pour l'emplir et non pour l'excéder.
(59) Revue des Deux Mondes, 15 juin 1887.
Ce critique n'est autre que M. Camille Bellaigue, de qui il est permis de ne pas partager toutes les opinions, mais non de révoquer en doute ni le talent, ni l'esprit, ni la sensibilité de musicien, ni le goût cultivé. Il n'était certes pas seul de son avis en l'occurrence, puisque le Prophète et les Huguenots ont pu être maintenus au répertoire jusqu'aux dernières années de la dernière direction de Gailhard, avec des recettes suffisantes. Sous la direction suivante, le Prophète tint bon jusqu’au 27 avril 1908, avec 17.677 fr. 41 de recettes, et les Huguenots étaient donnés encore le 17 juillet 1914, où la recette fut de 13.930 fr. 89. Ce n'est que de nos jours que Meyerbeer a disparu, sinon à titre définitif, du moins pour longtemps, du répertoire de l'Opéra, après une reprise des Huguenots qui eut lieu le 10 septembre 1920 et ne donna pas le résultat espéré.

décor pour Patrie ! (Bibliothèque de l'Opéra)
Je ne crois donc pas faire un mauvais compliment à M. Paladilhe en disant que sa musique ressemble à celle de Meyerbeer, d'autant qu'elle lui ressemble, comme on dit, « en bien ». Né à Montpellier en 1844, Paladilhe avait eu son prix de Rome à seize ans, en 1860 ; il avait rapporté d'Italie une mélodie qui du coup le rendit célèbre et fit de lui pour longtemps « l'auteur de Mandolinata ». En 1872, il donnait à l'Opéra-Comique le Passant, d'après la comédie de François Coppée, et en 1875 l'Amour africain, sur un poème d'Ernest Legouvé. La sérénade du Passant, qu'on joue encore au Théâtre-Français, est un morceau fort agréable. Quand on apprit que Louis Gallet arrangeait pour Paladilhe la pièce déjà célèbre de Sardou, plusieurs de ses confrères se montrèrent inquiets de le voir forcer peut-être son talent, et trahirent leur inquiétude en l'appelant plus que jamais « l'auteur de Mandolinata ». Mais il se tira de l'épreuve à son honneur. Sans les grand éclats d'orchestre dont Meyerbeer savait bouleverser son auditoire, Paladilhe a su trouver, pour les chœurs de révolte, le récit d'un capitaine ivrogne, la douleur d'un mari, le désespoir d'une amante ou l'oraison funèbre d'un héroïque sonneur de cloches, les formules qu'on attendait, les présenter avec aisance, et M. Bellaigue (60) a fort sainement jugé quand il a écrit : « La musique de M. Paladilhe manque surtout d'originalité ». La pièce étant d'ailleurs habilement conduite et assez connue pour qu'on pût, même sur la scène lyrique, en suivre sans difficulté toutes les péripéties, le succès fut très vif, et les interprètes, qui étaient Lassalle, E. de Reszké, mesdames Krauss et Bosman, en eurent leur juste part.
(60) Revue des Deux Mondes, 15 janvier 1887.
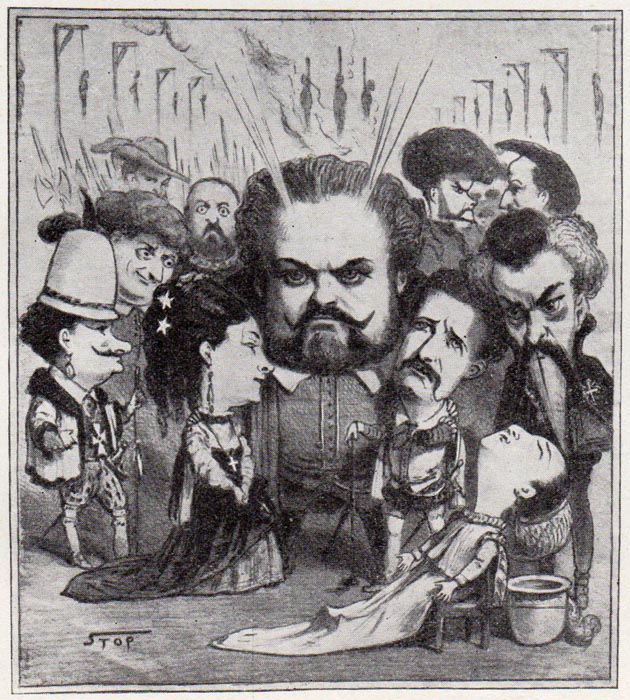
les interprètes de Patrie !, d'après une caricature de Stop, dans Nos Théâtres
Pendant ces trois premières années, l'Opéra comme s'il eût profité de la vitesse acquise, a continué de mettre à la scène des œuvres intéressantes, et bien accueillies du public. En 1887, arrêt brusque. Aucune œuvre inédite ne vient s'ajouter au programme, et la seule innovation de l'année est l'installation à l'Opéra de l'éclairage électrique. Le 25 mai de la même année, le gaz mettait le feu à l'Opéra-Comique. La lumière électrique n'a pas seulement des avantages de sécurité. Elle permet une dispersion des foyers éclairants, une variété de nuances et une rapidité dans leur succession dont les fondateurs de l'Opéra, si occupés du spectacle et si épris de merveilleux, auraient été bien aises de disposer. Mais il faudra trente ans et deux changements de direction pour que ces ressources révélées d'abord dans une féerie du théâtre de l'Eden, puis utilisées assez grossièrement au music-hall, reçoivent à l'Opéra un emploi artistique.
La chute de la Dame de Monsoreau, opéra de Salvayre, sur un drame de Dumas et Maquet, ouvre dans l'histoire de l'Opéra une nouvelle et fort malencontreuse période, où tous les ouvrages inédits avant leur apparition sur cette scène sont voués à l'insuccès. Jusqu'à la fin des directions de Gailhard, cette règle se vérifie sans aucune exception. Les seuls opéras qui aient obtenu des recettes suffisantes pour rester au répertoire sont ceux qui avaient été présentés au public sur d'autres scènes ou même sur celle de l'Opéra, mais jadis : Roméo et Juliette de Gounod, représenté au Théâtre-Lyrique le 27 avril 1867, à l'Opéra-Comique le 20 janvier 1873, et augmenté seulement d'un ballet pour prendre place à l'Opéra ; Salammbô de Reyer qui comme Sigurd avait passé par Bruxelles, le 10 février 1890 ; Samson et Dalila, de Saint-Saëns, joué en 1877 à Dresde, puis à Hambourg, à Cologne, à Dresde, à Rouen le 3 mars 1890, au théâtre lyrique de l'Eden le 30 octobre 1891 ; Armide de Gluck, qui avait bien été créée à l'Opéra, mais en 1777 ; enfin les œuvres de Wagner, dont le succès fut d'autant plus vif que depuis bien des années les partisans de ce nouveau système de musique et de drame les réclamaient, les curieux les attendaient, les amateurs de musique les connaissaient déjà par les concerts.
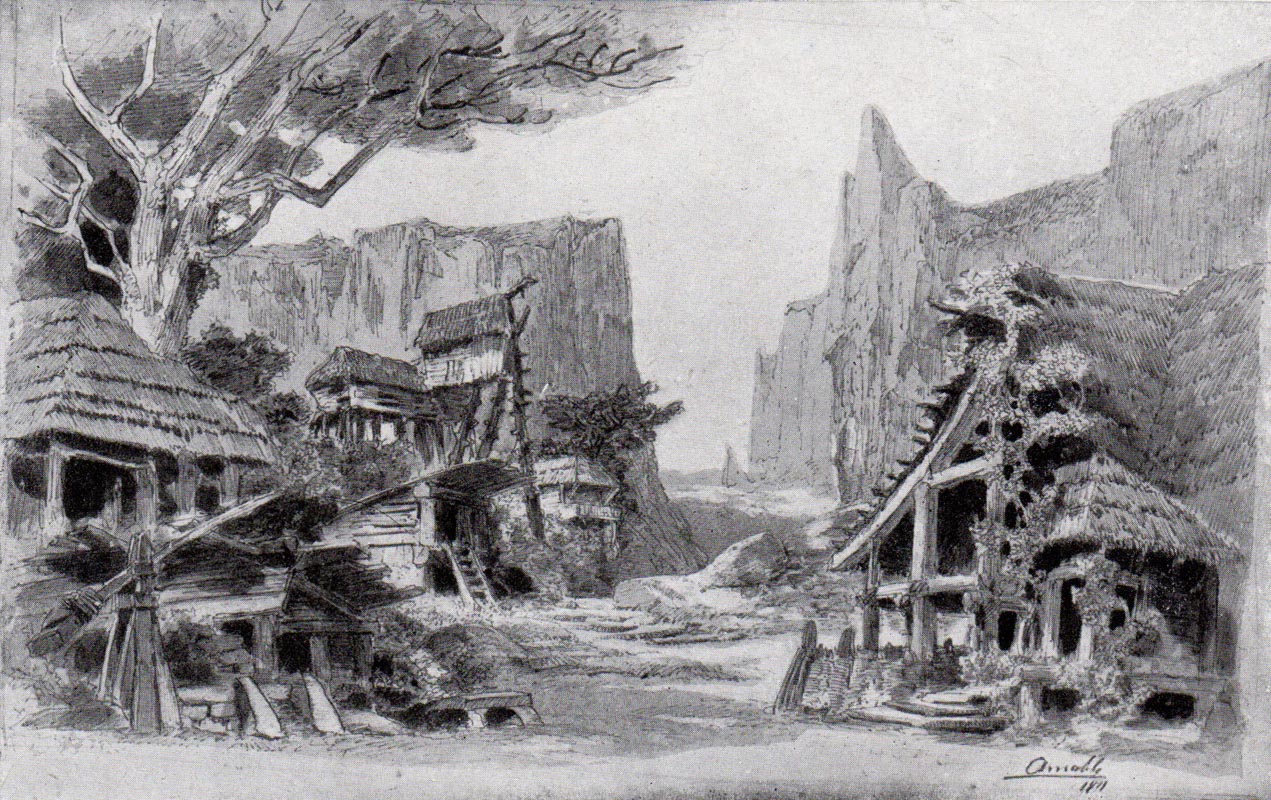
décor d'Amable pour Gwendoline
Cependant, si les opéras déjà représentés sur d'autres scènes ont été les seuls à réussir durant cette période, trouvant à Paris non leur révélation, mais leur consécration, ils n'ont pas tous réussi. La condition était nécessaire, non suffisante. Gwendoline, de Chabrier, avait été donnée d'abord à Bruxelles, le 14 avril 1886, et n'y avait eu que deux représentations parce que le théâtre avait fait faillite sur ces entrefaites ; repris à Karlsruhe le 30 mai 1889, sous la direction de Felix Mottl, à Munich le 28 novembre 1890, à Lyon en avril 1893, cet ouvrage n'en vint pas moins échouer à l'Opéra sur la fin de cette même année. Il en fut de même pour Briséis, opéra inachevé du même auteur, sur un poème de Catulle Mendès, représenté à Berlin le 14 janvier 1899, puis pour l'Etranger de M. Vincent d'Indy, malgré l'heureux précédent de la première représentation, donnée à Bruxelles le 7 janvier 1903, et où l'on fit fête au musicien français. Même des œuvres anciennes, qui semblaient hors de discussion comme l'Enlèvement au sérail de Mozart, alourdi il est vrai de récitatifs par un maladroit scrupule, Joseph de Méhul, le Freischütz de Weber, la Prise de Troie de Berlioz, la Statue de Reyer, n'eurent pas un meilleur sort, et c'est à peine si Otello de Verdi, dont la création à Milan remontait à l'année 1887, put se maintenir à l'Opéra, sept ans plus tard, l'espace d'une saison, grâce à l'interprétation qui réunissait Saléza, Maurel, créateur du rôle d'Iago, puis Renaud dans le même rôle, mesdames Rose Caron et Héglon. Enfin Paillasse, de Leoncavallo, qui entrait à l'Opéra précédé d'une bruyante renommée et ne pouvait passer pour ce qu'on appelait alors une « musique difficile », fut victime lui-même de l'indifférence du public et ne devait atteindre les fortes recettes que beaucoup plus tard, sous la direction actuelle.

décor pour Gwendoline (Bibliothèque de l'Opéra)
Quant aux compositeurs assez audacieux pour se risquer à l'Opéra sans la recommandation d'un succès antérieur, ils furent tous déçus dans leur espérance, et l'on voit, durant ces vingt-trois années, les œuvres inédites tomber l'une après l'autre comme capucins de cartes. Devant une suite aussi ininterrompue de catastrophes, on ne sait si l'on doit admirer davantage la constance héroïque du directeur, fidèle au cahier des charges et obligé de livrer chaque année une bataille qu'il sait perdue d'avance, ou la folle bravoure des auteurs qui ne lui font jamais défaut et chaque année aussi viennent s'enrôler sous son drapeau funeste, et prendre leur part d'une défaite qui pour eux se change aisément en déroute, car le directeur reste à son poste, mais un échec signalé fait disparaître à jamais du répertoire l'œuvre qui l'a causé ; s'il est retentissant, le discrédit s'étend à l'auteur, et à tout ce qu'il pourra produire par la suite : les portes de l'Opéra ne s'ouvriront plus pour lui.

Chabrier au piano par Florian
C'est à l'Opéra que Massenet connut, avec le Mage, son premier insuccès. Thaïs, qui vint ensuite, avait, à ce qu'il nous semble aujourd'hui, tout ce qu'il faut pour plaire, et pourtant ne parvint pas à s'imposer. Ce n'est que sous les deux directions suivantes que des reprises de Thaïs, avec des artistes de choix dans le rôle principal, en ont fait le grand succès que connaissent aujourd'hui tous les habitués de l'Opéra. Ascanio, de Saint-Saëns, n'a pu être réhabilité ainsi, pas même à sa récente reprise, le 14 novembre 1921, non plus que Messidor, de M. Alfred Bruneau, qui dut attendre jusqu'au 22 février 1917 sa douzième représentation, la première où l'on eût respecté les intentions de l'auteur, en donnant au ballet la place qu'il lui avait désignée.
Tous les autres ouvrages n'ont paru sur la scène de l'Opéra, dans l'éclat plus ou moins vif, et la fraîcheur, parfois un peu fanée d'avance, de leur nouveauté, que pour s'y abîmer presque aussitôt dans on ne sait quelles oubliettes, plus profondes encore que la rivière souterraine que Garnier selon la légende aurait canalisée à trente mètres sous la scène et qui n'est qu'un bassin collecteur des eaux d'infiltration, et plutôt pareilles au lac Averne d'où il est impossible, une fois qu'on y est descendu, de remonter au jour. C'est là que gisent côte à côte les opéras mort-nés, dont les érudits de l'avenir exhumeront les restes encore reconnaissables, partitions conservées aux archives, dessins de costumes et photographies de décors, comptes rendus de la répétition générale. Mais il n'entre dans le dessein de cet ouvrage que d'y signaler, à mesure qu'ils se manifestent, les changements survenus dans le goût du public et le style des auteurs ; c'est pourquoi il suffira d'énumérer les ouvrages qui n'ont apporté aucun trait nouveau à l'un ni à l'autre, par suite de leur médiocrité, ou d'une trop brève carrière.
Ce sont, après la Dame de Monsoreau et Ascanio, Zaïre, opéra en deux actes de Véronge de la Nux (61), sur un livret d'Alfred Blau et Besson ; Tamara, opéra en deux actes de Bourgault-Ducoudray (62), sur un livret de Louis Gallet ; Stratonice, opéra en un acte d’Alix Fournier (63), avec le même collaborateur ; Déidamie, opéra en deux actes de M. Henri Maréchal (64), sur un livret de M. Edouard Noël ; Djelma, opéra en trois actes de Charles Lormon pour les paroles, Charles Lefebvre (65) pour la musique ; la Montagne noire, opéra en quatre actes, dont Madame Augusta Holmès (66) avait écrit paroles et musique ; Frédégonde, opéra en cinq actes, de Guiraud, achevé par Saint-Saëns, sur un livret de Louis Gallet ; Hellé, opéra en quatre actes d'Alphonse Duvernoy (67), sur un livret de du Locle et Nuitter ; la Cloche du Rhin, opéra en trois actes de Samuel Rousseau (68), sur un livret de Georges Montorgueil et de M. P.-B. Gheusi ; la Burgonde, opéra en quatre actes de M. Paul Vidal (69), sur un livret d'Emile Bergerat et Camille de Sainte-Croix ; Lancelot, opéra en quatre actes de Joncières, sur un livret de Louis Gallet et Alfred Blau ; Astarté, opéra en quatre actes de Louis de Grammont pour les paroles, Xavier Leroux (70) pour la musique ; le Roi de Paris, opéra en trois actes de M. Georges Hüe (71) sur un livret de Henry Bouchut ; les Barbares, opéra en trois actes et un prologue de Camille Saint-Saëns, sur un livret de Victorien Sardou et de M. P.-B. Gheusi ; Orsola, opéra en trois actes des frères Paul et Lucien Hillemacher (72), sur un livret de M. P.-B. Gheusi ; le Fils de l'Etoile, opéra en cinq actes de Camille Erlanger (73), sur un livret de Catulle Mendès ; Daria, opéra en quatre actes de Georges Marty (74), sur un livret d'Adolphe Aderer et Armand Ephraïm ; Ariane, opéra en quatre actes de Massenet, sur un livret de Catulle Mendès ; la Catalane, opéra en quatre actes M. Fernand Le Borne (75), sur un livret de Paul Ferrier et Louis Tiercelin. Pour les ballets, l'épreuve est moins concluante, parce qu'un ballet de la sorte de ceux qu'on jouait presque uniquement alors, c'est-à-dire un ballet en un ou deux actes, ne forme jamais que la plus petite et la dernière partie du spectacle dont il n'affecte pas, à moins de qualités ou de défauts exceptionnels, très notablement les recettes. Cependant un seul des ballets représentés pour la première fois à l'Opéra durant cette période a pu être repris, de nos jours, avec succès : c'est la Maladetta, ballet en deux actes, dont le scenario pyrénéen était de Pedro Gailhard, la musique de M. Paul Vidal. Tous les autres ont été emportés sans retour, et c'est à peine si on se souvient encore de leurs titres : la Tempête, ballet en trois actes d'Ambroise Thomas, sur un scenario de Jules Barbier et Hansen ; le Rêve, ballet en deux actes de Gastinel (76), sur un scénario de Blau ; l'Etoile, ballet en deux actes de M. André Wormser (77), sur un scénario d'Adolphe Aderer, Camille de Roddaz et Hansen ; Bacchus, ballet en deux actes de Duvernoy, sur un scenario de Georges Hartmann ; la Ronde des saisons, ballet en trois actes de M. Henri Büsser (78), sur un scénario de M. Charles Lomon ; le Lac des Aulnes, ballet en deux actes de M. Henri Maréchal, sur un scénario de Vanara.
(61) Né à Paris en 1853, prix de Rome en 1876.
(62) Né à Nantes en 1840, prix de Rome en 1862, professeur d'histoire de la musique au Conservatoire.
(63) Lauréat pour cet ouvrage du prix Crescent, Alix Fournier était encore élève du Conservatoire à cette époque, n'ayant obtenu l'année précédente que le second grand prix de Rome ; c'est M. Büsser qui avait eu le premier prix.
(64) Né à Paris en 1842, prix de Rome en 1870, auteur de l'Ami Fritz (1876), et des Rantzau (1882).
(65) Né à Paris en 1843, prix de Rome en 1870, surtout connu par son oratorio de Judith.
(66) Née en 1847, auteur de poèmes symphoniques exécutés au concert Colonne.
(67) Né à Paris en 1842, professeur de piano au Conservatoire.
(68) Né en 1853, prix de Rome en 1878.
(69) Né à Toulouse en 1863, prix de Rome en 1883.
(70) Né à Velletri en 1863, prix de Rome en 1885.
(71) Né à Versailles en 1858, prix de Rome en 1879.
(72) Paul Hillemacher, né en 1855, prix de Rome en 1877 ; Lucien, né en 1860, prix de Rome en 1880.
(73) Né à Paris en 1863, prix de Rome en 1888.
(74) Né en 1860, prix de Rome en 1882.
(75) Né à Bruxelles en 1862.
(76) Prix de Rome en 1846, auteur d'opéras bouffes qui eurent un certain succès avant 1870.
(77) Né à Paris en 1851, prix de Rome en 1875.
(78) Né à Toulouse en 1872, prix de Rome en 1893.

Mademoiselle Jeanne Hatto
On peut voir par la comparaison de ces deux listes que le nombre des ballets nouveaux est de beaucoup inférieur à celui des opéras. Le plus souvent Gailhard mettait à la scène, comme le cahier des charges lui en laissait le choix, un opéra en un ou deux actes, de préférence à un ballet. C'est qu'il n'avait de goût que pour le chant. Jusqu'à la fin de son gouvernement à l'Opéra, il s'est assuré le concours des meilleurs chanteurs, et il a su trouver, pour l'interprétation des œuvres de Wagner, les artistes qu'il fallait, je veux dire des artistes de beaucoup supérieurs, par l'intelligence et le goût, à ceux de l'ancien répertoire, dont il était lui-même, des artistes tels que M. Delmas, qui fit ses débuts le 22 septembre 1886 dans Saint-Bris des Huguenots, mademoiselle Bréval, qui parut pour la première fois le 20 janvier 1892 dans l'Africaine, et créa la Walkyrie à l'Opéra, auprès de madame Rose Caron et de Van Dyck, l'année suivante. Les artistes du chant étaient ses préférés ; pour eux seuls il était généreux jusqu'à la prodigalité. C'est ainsi que le rapporteur du budget des Beaux-Arts pour l'année 1907, Buyat, cite ces chiffres d'appointements mensuels :
|
Mlles Bréval Grandjean Hatto MM. Alvarez Affre Delmas Muratore |
7.500 fr. 5.000 fr. 1.500 fr. 8.000 fr. 7.000 fr. 7.000 fr. 2.000 fr. |

M. Muratore dans le rôle de Roméo
Et sans contester le talent de ces artistes, il estime que pour certains, étant donné le petit nombre des représentations auxquelles ils ont pris part, de tels appointements sont une trop lourde charge pour le budget de l'Opéra. Ceux de la danse n'avaient pas été changés depuis la direction de Vaucorbeil, non plus que ceux de l'orchestre qui allaient de 90 fr. par mois, pour la batterie supplémentaire, à 300 fr. pour un premier violon solo, 500 fr. pour le second chef et 1.000 fr. pour le premier. La disproportion entre ces chiffres et ceux qui figurent aux états d'émargement pour les artistes du chant est flagrante, et un de mes confrères (79) écrivait à ce sujet, en 1902 :
Ne sent-on pas là le souvenir d'un autre âge où l'orchestre bornait son rôle à soutenir de quelques accords ou de batteries sempiternelles les trilles et les roulades de la chanteuse ? Les temps sont changés, et les violoncelles qui dessinent ce thème de la Chevauchée dans la Walkyrie, les harpes de l'Incantation du feu, les cors de la scène religieuse de Sigurd, sont des personnages au même titre que ceux qui s'agitent sur la scène. Je veux dire que les chants de l'orchestre ont autant d'importance, exigent une interprétation aussi soignée, aussi expressive, aussi intelligente, que ceux des acteurs.
(79) A. de Longepierre, A propos de la grève des musiciens, dans la Revue musicale, novembre 1902, page 451.

affiche pour Ariane par Albert Maignan
Cette interprétation, l'orchestre de l'Opéra était parfaitement capable de la donner. Alors comme aujourd’hui, il était composé d'artistes de premier ordre, qui pour la plupart étaient les mêmes que ceux de l'orchestre, à juste titre renommé, des concerts du Conservatoire. Mais leur emploi à l'Opéra était pour eux surtout honorifique. Il leur permettait d'élever leurs prix, aussi bien pour les leçons particulières que pour toutes les circonstances où on avait besoin d'eux, hors du théâtre, et aussitôt qu'une de ces circonstances se présentait, ils abandonnaient, s'il le fallait, à un remplaçant leur pupitre de l'Opéra. Les artistes des chœurs, dont les traitements étaient à peu près les mêmes que ceux de l'orchestre, usaient de la même liberté, avec cette seule différence qu'étant d'ordinaire chantres d'église, c'est pour célébrer un mariage ou des funérailles qu'ils manquaient aux répétitions de l'après-midi, au lieu que les instrumentistes sacrifiaient plutôt les représentations à un concert du soir. Le remplacement, qui n'était que toléré sous les directions précédentes, devint un droit sous celle-ci, parce que le prix de la vie avant augmenté, et les salaires restant les mêmes, il était désormais impossible soit à un choriste, soit à un musicien de l'orchestre, de subsister même modestement, s'il ne trouvait d'autres ressources. De là, dans ces deux corporations, l'habitude, bientôt invétérée, de faire passer avant leurs occupations de l'Opéra toutes les autres, parce qu'elles étaient plus lucratives, et de ne venir au théâtre que quand ils ne pouvaient s'en dispenser ou n'avaient rien de mieux à faire. A l'époque où j'ai commencé de fréquenter assez régulièrement l'Opéra, c'est-à-dire dans les premières années de ce siècle, chacun savait que si à la rigueur et à force de réquisitions on pouvait obtenir une exécution digne du renom de ce théâtre pour les quatre ou cinq premières représentations d'un nouvel ouvrage, il fallait ensuite y renoncer, parce qu'un bon nombre des musiciens de l'orchestre n'étaient plus ceux qui avaient pris part au travail des répétitions : ils venaient s'asseoir à la place du titulaire, et déchiffraient leur partie ; étant eux-mêmes des artistes expérimentés, ils s'en tiraient pour les notes, mais non pour l'expression, les nuances et le coloris qui demandent une étude et une entente préalable avec le chef. On citait comme exemple les Maîtres chanteurs et on plaignait ceux qui comme moi n'avaient pu entendre cet ouvrage en 1897, car il paraît que depuis lors il était devenu méconnaissable. On racontait que pour la circonstance on avait vu s'accomplir sur la scène de l'Opéra un véritable prodige, car les choristes chantaient parfaitement juste, avec ensemble, et de plus allaient et venaient, se prenaient réciproquement à témoin, se querellaient, faisaient des gestes d'allégresse, comme leurs rôles dans la pièce le demandaient. Mais un mois ne s'était pas écoulé qu'ils étaient retombés dans leur apathie coutumière parce que le peu de temps dont ils disposaient pour les répétitions suffisait à peine pour l'étude des ouvrages en préparation, de telle sorte qu'ils oubliaient, n'ayant plus jamais le loisir d'y revenir, ce qu'on venait de leur apprendre avec tant de peine.
Il n'en allait pas de même pour les artistes de la danse, bien plus fidèlement attachés au théâtre, quoiqu'ils n'y fussent pas mieux rétribués : danseurs et danseuses ont toujours continué d'avoir chaque matin leurs leçons, et l'après-midi, outre les études des nouveaux ballets, une répétition fragmentaire, ce qu'en langage de théâtre on appelle un raccord, pour les principaux passages du ballet ou du divertissement où ils devaient paraître le soir, fût-ce le ballet de Coppelia ou le divertissement de Faust, qui l'un et l'autre revenaient au programme au moins une fois par semaine. Mais Gailhard n'utilisait pas, ou utilisait mal, ces excellentes dispositions. Pour la technique de la danse, l'Opéra restait, comme il est resté jusqu'à nos jours, sans rival. Mais personne ne semblait s'aviser que de cette même technique, comme d'un instrument bien réglé, on pouvait tirer les effets les plus variés non seulement de grâce ou de force, mais de sentiment et de couleurs. Exemption faite pour des artistes vraiment exceptionnelles et dignes de leur nom « d'étoiles » comme mademoiselle Rosita Mauri ou mademoiselle Zambelli, qui lui succédait vers cette époque, l'une et l'autre d'ailleurs d'origine étrangère, la danse de l'Opéra n'était qu'une gymnastique aimable ; on en retrouvait les exercices, plus ou moins bien exécutés, dans tous les ballets, et par toutes les danseuses, dont les meilleures parvenaient jusqu'au rang de première danseuse, et quittaient alors l'Opéra, avec le regret de n'avoir pu, astreintes à une discipline inflexible, développer leurs qualités naturelles. J'ai reçu à ce sujet, en ce temps-là, plus d'une triste confidence, et c'est en y songeant que je réprouvais (80) le ballet moderne, « si sec, si inexpressif, dont l'idéal même est de tuer toute personnalité, pour aboutir à l'exécution précise de quelques mouvements invariables, danse géométrique où tout est réglé d'avance, danse gymnastique où l'on prise surtout la difficulté vaincue, danse de soldats à la parade, dont la beauté suprême est l'uniformité ». Je ne savais pas alors que la renaissance du ballet était proche, et rien à l'Opéra ne la faisait pressentir.
(80) Revue musicale, 15 mai 1904, page 250.
On ne pouvait dire de Gailhard ce que Reyer disait d'Halanzier, qu'il n'entendait rien à la musique. Il me souvient d'avoir répondu un jour à Jules Combarieu, chef de cabinet du ministre d'alors, qui l'avait entendu, à une répétition, reprendre un chanteur pour un presque imperceptible défaut de justesse : « Il a du solfège ». Mon interlocuteur sourit et malgré sa situation qui l'obligeait à défendre le directeur d'une scène subventionnée, avoua qu'on ne pouvait guère lui accorder davantage. Gailhard entendait bien le chant, et beaucoup moins bien l'orchestre. Mais ce qu'il ne voyait pas du tout, c'est le spectacle. Dès 1890, M. Camille Bellaigue (81) jetait un cri d'alarme, après une représentation de Lucie de Lammermoor où il avait été particulièrement affligé par la misère des décors et des costumes, l'absurdité de la mise en scène. Quinze ans plus tard, l'Opéra avait sa réputation faite. Non seulement les décors n'y étaient que des amoncellements d'objets hétéroclites et tous démesurés, rochers, arbres, colonnes, trônes et lampadaires qui semblaient en carton pâte, et sans autre but que de boucher les interstices de la scène et éviter les courants d'air aux chanteurs, non seulement les costumes, même neufs, paraissaient sortir d'un magasin de vieilles défroques où on les avait pris au hasard, sans aucun égard ni pour la vérité du temps ou du lieu, ni pour la convenance réciproque des couleurs, mais il n'y avait pas une représentation de l'Opéra où l'on ne fût choqué par une faute grossière contre les principes les plus élémentaires de la mise en scène, comme à la reprise du Freischütz les musiciens juchés sur un praticable pour la chasse infernale, avec leurs cors à pistons visibles de tous les points de la salle, ou la galère d'Ariane munie, par un artifice dont on se fût bien moqué au Châtelet, de toutes petites rames, pareilles à des nageoires d'ablette sur un corps de baleine, qui tournaient comme des manivelles, pendant qu'une toile de fond déroulait, à l'instar de l'Or du Rhin, des flots verdâtres, comme si la galère eût navigué entre deux eaux. Pendant ce temps-là M. Jusseaume, à l'Opéra-Comique, sans grands frais d'imagination et en se contentant de transporter sur la scène des tableaux dignes d'une médaille d'or au Salon des artistes français, obtenait des effets qui nous comblaient de joie, parce que chaque détail y venait à sa place.
(81) Revue des Deux Mondes, 15 mars 1890 : Un opéra idéal.
On a coutume de dire qu'un malheur ne vient jamais seul. Gailhard ne parvenait à assurer l'équilibre de son budget et à joindre strictement les deux bouts en accusant, après vingt-trois années d'exercice, un bénéfice net de 97 fr. 50, que par un système d'économies dont les chanteurs seuls étaient exceptés. Dans le même temps que l'Opéra de Paris se trouvait ainsi réduit à des spectacles au rabais qui ne donnaient guère envie aux musiciens de lui porter leurs œuvres, le genre qui donnait son nom à ce théâtre subissait une crise grave. L'opéra historique n'était plus viable. Saint-Saëns en demeurait le plus obstiné comme le plus glorieux partisan, et mal lui en prenait : le seul de ses ouvrages qui ait réussi à se maintenir est Samson et Dalila qui n'est pas un opéra historique, ni même un opéra, mais un oratorio mis à la scène, où la musique n'étant plus gênée par l'intrigue de la pièce se développe en morceaux indépendants, correspondant à autant d'épisodes distincts. On sait en effet que la première intention de Saint-Saëns avait été de composer un oratorio, et que c'est sur les instances de son collaborateur, Ferdinand Lemaire, qu'il a fait un opéra de cet ouvrage, commencé en 1867 et terminé l'année suivante. Ascanio, par contre, et par malheur, est bien un opéra historique, dont Louis Gallet lui a rédigé le livret d'après un drame de Paul Meurice intitulé Benvenuto Cellini. C'est un livret chargé d'incidents où l'on a peine à se reconnaître. La partition contient des jeux d'esprit comme celui-ci (82) :
Ça commence par la peinture d'une activité dévorante qui se calme à l'entrée du héros. Il parle sur un ton demi léger ; quand il arrive au dessin de Pagolo, l'orchestre joue à l'envers le motif du travail pour montrer que Pagolo a travaillé en dépit du bon sens. C'est drôle comme tout.
(82) Lettre de Saint-Saëns, citée par Reyer, Journal des Débats, 30 mars 1890.
Si l'auteur ne nous faisait lui-même valoir ce calembour en musique, il est probable que personne ne s'en fût jamais aperçu. Ce genre de plaisanteries est l'équivalent de ce que chez les peintres on appelle une blague d'atelier. Jean-Sébastien Bach ne s'en est pas privé, non plus qu'un autre musicien que Saint-Saëns n'aimait guère et qui est M. Vincent d'Indy. On y peut goûter un certain air de pédantisme voulu, qui fait sourire. Mais dans un sujet comme celui d'Ascanio, qui ne demandait que de l'élégance, du sentiment et de la grâce, c'est un air qu'il valait mieux ne pas affecter. Ascanio est un ouvrage encore plus froid que Henry VIII, parce que le talent de l'auteur semble s'y contempler comme dans un miroir, les personnages s'y écouter avec une satisfaction agaçante, pareils à ces causeurs moins occupés de ce qu'ils disent, que de le bien dire, et c'est pourquoi on ne peut s'intéresser à l'imbroglio où ils sont mêlés. Seuls les airs de ballet, étrangers au drame, sont joliment inspirés par la mythologie de la Renaissance. Et encore je soupçonne quelque ironie de musicien dans cette valse en si bémol, pour cornet à piston, qui les termine par un bizarre anachronisme. Salammbô est un opéra légendaire, plutôt qu'historique, parce qu'à cette distance et avec le peu de renseignements que nous possédons sur Carthage, à moins d'être des érudits, spécialistes en études puniques, nous sommes transportés, en lisant le roman comme un assistant à la représentation de l'opéra, dans un monde inconnu. Au temps de Meyerbeer, qui est aussi celui de Victor Hugo, on s'attachait à transporter sur la scène, aussi ressemblants que possible non seulement par le caractère, mais aussi par la figure et le costume, un roi de France, un baron du moyen âge, un prince de la Renaissance italienne. En 1890, c'est cette ressemblance même qui paraissait illusoire et facilement ridicule. On se sentait un peu gêné, à voir s'avancer vers le trou du souffleur, pour chanter un grand air ou débiter une tirade en alexandrins, le duc de Nevers, la reine de Navarre, le cardinal de Richelieu ou Lucrèce Borgia. Mais Hamilcar et Giscon ne rappelaient tout au plus, et aux plus lettrés des spectateurs, que quelques lignes de Tite-Live, avant le roman de Flaubert, et Salammbô passait, à tort ou à raison, pour être sortie de son cerveau comme Minerve de celui de Jupiter. C'est ainsi que l'opéra de Salammbô, comme celui d'Aïda, s'écartait assez de l'histoire pour donner à ceux qui l'entendaient, tout autant que Sigurd, ce sentiment du merveilleux dont l'opéra, après s'en être privé, recommençait à éprouver le besoin, comme pendant les deux premiers âges de son existence. Salammbô avait sur Sigurd l'avantage que le sujet en était mieux connu, du moins en France (83), le spectacle plus varié, et aussi que la renommée de l'auteur était mieux établie. C'est pourquoi, bien que les idées y soient un peu moins nobles et que l'orchestre y prenne par endroits un éclat vulgaire, le succès fut immédiat. Il s'est perpétué jusqu'à nos jours. Les interprètes, à la première représentation, étaient madame Rose Caron, Saléza, Renaud et Delmas.
(83) Le roman de Flaubert était cependant connu en Russie, car nous savons aujourd'hui que Moussorgski, en 1864, avait commencé de le mettre en musique. Un fragment a été publié dans le recueil Années de jeunesse.
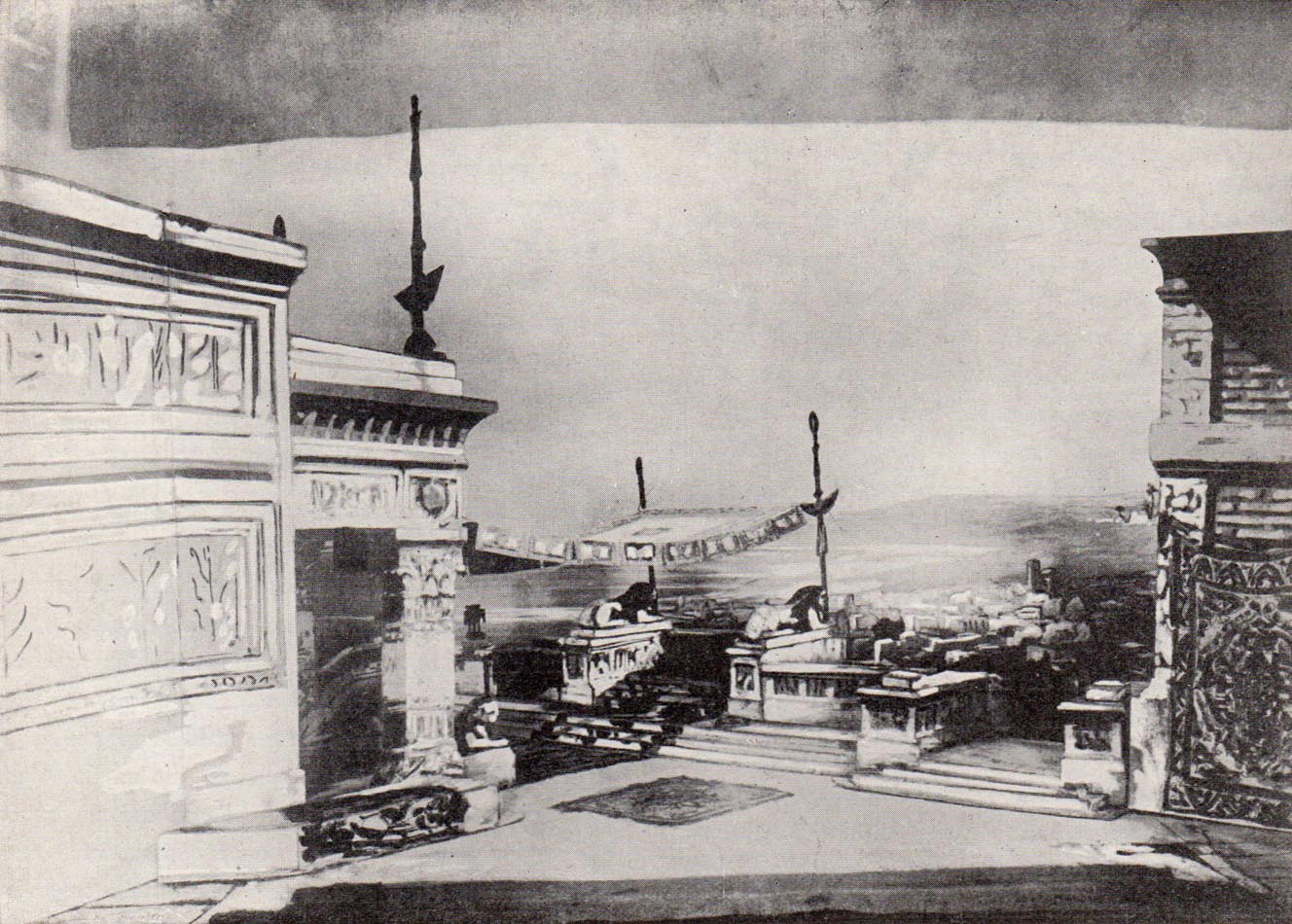
décor pour Salammbô (Bibliothèque de l'Opéra)
Roméo et Juliette, non plus que Faust, n'avait été d'abord écrit pour l'Opéra. Il est fort remarquable que les seuls ouvrages de Gounod qui aient réussi à se maintenir en ce théâtre soient justement ceux qui ne lui étaient pas destinés. C'est que le goût français cherchait à s'évader du romantisme par deux voies divergentes, dont l'une menait à un monde entièrement imaginaire, et l'autre plongeait au contraire aux profondeurs du cœur humain, pour en tirer les sentiments les plus intimes. Les deux routes ne divergeaient d'ailleurs que pour tourner l'obstacle et pouvaient ensuite se rejoindre, l'imagination et la sensibilité se donnant mutuellement la réplique et s'aidant l'une l'autre à traduire l'ineffable et à révéler le mystérieux. C'est le problème que se posaient alors, et que souvent arrivèrent à résoudre, les poètes symbolistes. Massenet, dans ses deux premiers opéras, le Roi de Lahore et le Cid, avait obtenu, sans doute d'instinct, car il était incapable de se constituer à l'avance un système d'esthétique, une très heureuse alliance de la vérité des sentiments, plus profondément observée et plus vivement exprimée qu'on ne le croyait possible jusque là, avec des apparitions fantastiques, des visions, des prédictions et des extases religieuses qui prennent un nouveau pouvoir parce qu'elles ne se montrent plus ici comme des inventions de l'auteur, mais semblent émaner de l'âme même des personnages, que nous venons de sentir toute proche de la nôtre.
Gounod, croyant écrire des opéras-comiques, n'y avait ajouté aucun trait de fantaisie. Le ballet de Roméo, comme celui de Faust, a été composé quand l'ouvrage dut passer à l'Opéra. Il s'en détache aisément. Tout le reste est d'un ton aimable, enjoué, naturel, dont on n'avait guère eu d'exemple à l'Opéra jusque là, et M. Camille Bellaigue (84) a bien raison de remarquer, après une représentation des Troyens de Berlioz à l'Opéra-Comique, qu'il y a bien plus de nouveauté dans Faust, quoi qu'en ait dit Ernst, que dans cet ouvrage :
Les Troyens ne sont en aucune manière une forme nouvelle de l'Opéra ; ils ne disloquent et n'abolissent rien. L'esthétique wagnérienne n'a rien à voir dans ce livret, ni dans cette partition, et le Faust de M. Gounod, par exemple, de quatre ou cinq ans antérieur aux Troyens, marquerait peut-être une évolution plus notable dans l'histoire de notre musique, un écart plus sensible du style et de la tradition classique, où les Troyens ne font que revenir.
(84) Revue des Deux Mondes, 15 juillet 1892, page 459.
Cela est vrai, mais il convient d'ajouter que Faust ne doit rien non plus aux préceptes de Wagner et que Gounod, donnant au Théâtre-Lyrique ou à l'Opéra-Comique des ouvrages qui devaient, par la suite, s'acclimater à l'Opéra, était novateur sans le savoir.
Dès les dernières années de la direction Perrin, il eût été possible de monter Lohengrin à l'Opéra. Paris, le Paris étourdi du second empire, était aussi généreux parce qu'on y oubliait aisément les injures, je veux dire celles dont on s'était rendu coupable, et qui sont, comme on sait, les plus difficiles à pardonner. On en eut la preuve pendant la guerre, où l'on a vu que des fragments de ce même Tannhäuser, si mal accueilli en 1863, purent être joués, à des concerts de l'Opéra, dans la ville assiégée. Mais comme ces maladies qui ne se déclarent qu'après une longue incubation, les germes de haine que l'invasion allemande laissait derrière elle en se retirant ne firent sentir leur virulence que quelques années plus tard. Perrin, s'il eut vraiment l'intention de monter Lohengrin, n'en avait pas eu le temps avant de quitter l'Opéra. Halanzier ne s'en souciait guère. Vaucorbeil à l'Opéra, et Carvalho au Théâtre-Lyrique, avaient donné cette espérance aux wagnériens (85), mais à eux aussi le temps manqua. Charles Lamoureux, en 1887, estima que les nombreuses exécutions aux concerts de morceaux symphoniques tirés des œuvres de Wagner avaient suffisamment préparé l'opinion, et monta à ses frais Lohengrin au théâtre de l'Eden. Dans la salle, on n'entendit que des acclamations. Mais au dehors, profitant de certains incidents de frontière qui avaient fait craindre une nouvelle agression de l'Allemagne, on ne sait quels ennemis de Wagner avaient organisé une manifestation. Les représentations qui devaient suivre furent interdites, et Lamoureux fut ruiné. M. Bellaigue, qu'on ne pouvait soupçonner ni de fanatisme pour Wagner, ni d'être un mauvais Français (86), écrivait alors :
On n'a pu assurer contre l'imbécillité de quelques-uns le plaisir légitime et inoffensif du plus grand nombre... Autant que l'amour de l'art, l'amour de la patrie est intéressé à ce qu'une œuvre allemande soit représentée en France mieux qu'elle ne l'a jamais été en Allemagne.
(85) Revue des Deux Mondes, 15 septembre 1879.
(86) Revue des Deux Mondes, 15 mai 1887.
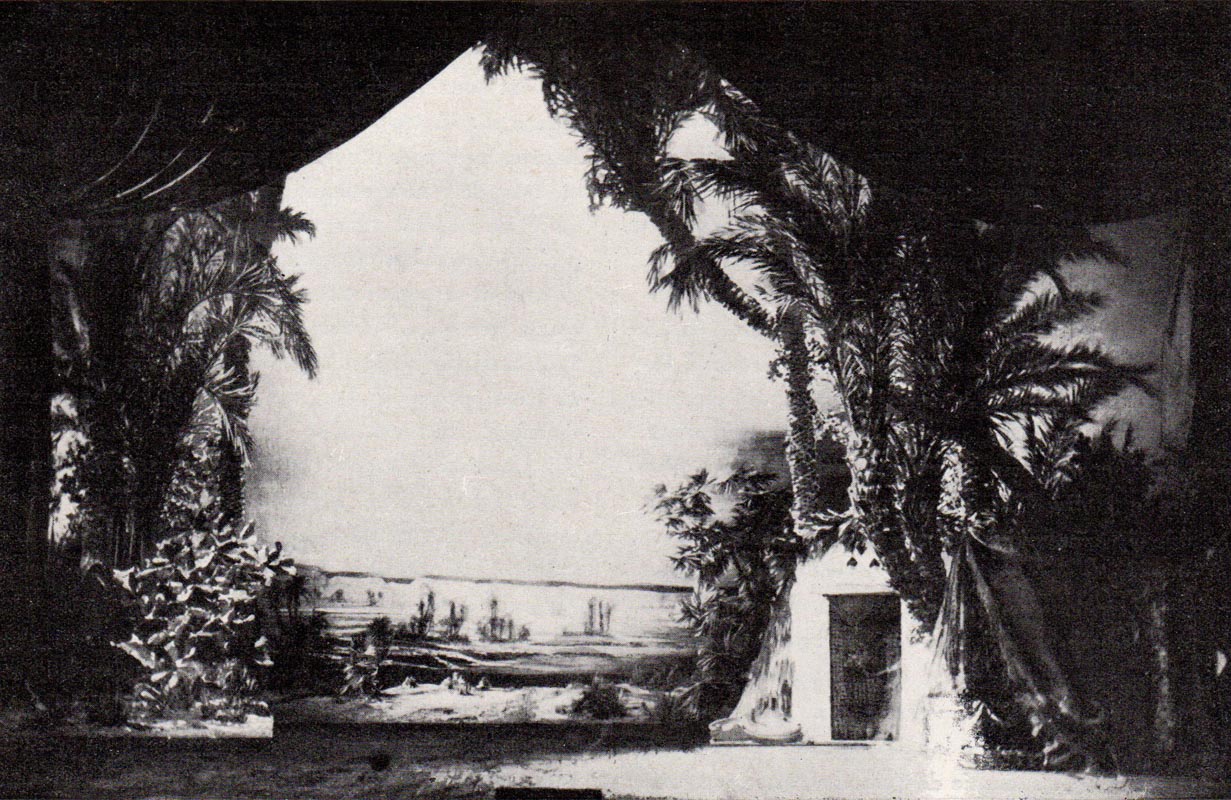
décor pour Thaïs (Bibliothèque de l'Opéra)
Il est fort regrettable que les œuvres de Wagner soient entrées si tardivement au répertoire de l'Opéra. Sans cette longue attente et l'attrait du fruit défendu, leur entrée eût été moins triomphale et leur prestige moins redoutable. Le danger était d'autant plus grand que Wagner paraissait apporter la solution du problème, car il condamnait, lui aussi, l'opéra historique, comme incapable de dégager ce qu'il appelait « la pure humanité ». Mais ce qu'il entend par là est l'humanité abstraite qu'on étudie dans les traités de psychologie, et c'est en vain qu'à travers tout son théâtre on chercherait un caractère. Les personnages ne sont que les personnifications d'un sentiment tel que l'orgueil, la cupidité, l'audace juvénile, l'amour insatiable, l'inspiration poétique, l'envie, la pitié, détaché de tout ce qui dans une âme humaine l'entoure, mais poussé jusqu'à ses extrêmes conséquences et développé dans tout le détail de ses attributs par la savante dialectique de l'orchestre. Chaque opéra de Wagner se réduit ainsi à une suite de dissertations en musique que seul son génie de compositeur parvient à rendre intéressantes. Rien n'était plus contraire à ce goût de la vie intérieure, dont le meilleur musicien de théâtre de l'époque, Massenet, venait de donner l'exemple avec tant de succès.
Massenet n'a jamais été séduit par le système wagnérien, mais ses librettistes le furent, ce qui n'alla pas, pour sa musique, sans quelques fâcheuses conséquences. Ce sont en effet les poètes de ce temps, bien plus encore que les musiciens, qui se sont faits les adeptes du drame de Wagner : Villiers de L'Isle-Adam, Mallarmé, Verlaine, Barrès, Huysmans, Catulle Mendès et le sar Péladan ont célébré tour à tour un mysticisme qui leur paraissait d'autant plus hermétique que leur sens musical était moins développé. C'est certainement à un drame wagnérien, à une wagnérie, comme on disait alors, et même à une wagnérie chaldéenne, comme en annonçait Péladan, que Jean Richepin a songé, bien plutôt qu'à un opéra français, en donnant à Massenet ce poème du Mage, fort bien rimé d'ailleurs, où la rivalité de la prêtresse Djahi et de la captive Anahita symbolise en même temps la lutte des deux races d'Iran et de Touran et le conflit de deux religions, dont l'une triomphe et trouve son prophète en un Zoroastre qui est aussi un vainqueur et presque un surhomme, à la façon du Zarathustra de Nietzsche. Le pauvre Massenet, qui n'avait pas en art de principes arrêtés, était bien incapable de refuser un livret, signé d'un nom déjà célèbre. Mais il se trouva fort gêné quand il fallut écrire la musique, et si en quelques passages, comme le chant des touraniens au premier acte et la plainte des vierges captives au deuxième, il a retrouvé cet exotisme ingénu qui donne tant de charme aux Erinnyes ou au Roi de Lahore, le reste est d'une solennité creuse et d'une brutalité vaine qui expliquent et justifient la chute de l'ouvrage. Le plus grave, c'est qu'il ne parvint jamais, par la suite, à se débarrasser de cette grandiloquence, dans ses opéras. Elle n'était que trop à sa place, dans ceux dont Catulle Mendès lui fournissait le livret chargé de gloses à prétentions philosophiques et encombré de littérature au rabais. Mais dans un sujet comme celui de Thaïs, où Louis Gallet n'avait retenu du roman d'Anatole France que l'aventure amoureuse, en en forçant les traits jusqu'à faire chanter en duo la courtisane et Paphnuce devenu Athanaël pour la circonstance, on s'en fût bien passé. Massenet la croyait nécessaire, désormais, à l'Opéra, et c'est à ses opéras-comiques, à Werther après Manon, puis à Esclarmonde, Grisélidis, qu'il réserva tout ce qu'il possédait encore de délicatesse et de sensibilité.

page manuscrite de Thaïs (Bibliothèque de l'Opéra)
C'est aussi Catulle Mendès qui avait donné à Chabrier les livrets de Gwendoline et de Briséis. Moins bien protégé que Massenet contre une musique qu'il admirait de toute son âme, le charmant auteur de l'Etoile, de l'Education manquée, du Roi malgré lui, voulut être wagnérien jusqu'au bout et s'astreignit à un fatras d'orchestre qui lui attira (87) les justes remontrances de Reyer :
De cette trame harmonique si serrée, de ce tout indissoluble que forment les voix et l'orchestre, la sensation wagnérienne se dégage tellement intime qu'on ne voit apparaître que progressivement et comme si elle sortait d'un rideau de nuages la physionomie très personnelle du compositeur.
(87) Journal des Débats, 18 avril 1886. Article écrit après la représentation de Gwendoline à Bruxelles.
La même erreur fut commise par Ernest Chausson (1855-1899), dans le Roi Artus, qui ne fut joué en entier qu'à Bruxelles, après la mort de l'auteur, le 30 novembre 1903. M. Vincent d'Indy (88), élève de César Franck, est nourri de musique et de littérature allemandes, comme le montrent les titres mêmes de ses premières œuvres, Wallenstein, poème symphonique en trois parties (1874), et le Chant de la cloche, légende dramatique (1886). Fervaal, donné pour la première fois à Bruxelles le 12 mars 1897, et l'Etranger sont tout imprégnés de wagnérisme, à l'exception seulement du coloris orchestral qui reste brillant et net. Mais l'auteur, comme Wagner, écrit lui-même son poème ; comme Wagner, il évite les airs, ne confie aux chanteurs qu'une déclamation intermédiaire entre le chant et le récitatif, et met les mélodies à l'orchestre ; comme Wagner, il fait de ses personnages les emblèmes d'idées abstraites. Fervaal et Guilhen traduisent l'opposition du christianisme futur et du paganisme expirant. L’Etranger est un prophète, ou plutôt un apôtre réincarné, égaré dans un port de pêche où il a pour rival un douanier auprès d'une jeune fille qui s'appelle Vita, la Vie. C'est par ce mélange surprenant, inexplicable et aisément saugrenu, d'allégorie et de réalité contemporaine, que certains musiciens tendaient alors de concilier le goût de l'observation avec le sentiment poétique, pareils à ces peintres dont les tableaux attiraient au Salon des Artistes français des rassemblements ébahis, parce qu'on y voyait le Christ en blouse d'ouvrier, ou bien faisant son entrée, couronne d'épines en tête, parmi les invités d'une soirée mondaine. M. Alfred Bruneau (89) est tombé dans la même erreur, et c'est ainsi que dans Messidor, dont il avait selon sa coutume demandé le poème à Zola, l'or que l'on cherche dans la rivière est en même temps l'image du capitalisme, comme le blé celle du travail, et le ballet de l'or est la figuration chorégraphique de cette antithèse. La disposition de la musique est conforme au système wagnérien, mais comme M. Vincent d'Indy, bien que d'une autre manière, M. Bruneau a un sentiment personnel de l'orchestre, qui le rapproche beaucoup de Massenet. M. Gustave Charpentier (90), lui aussi, a donné dans l'allégorie dès qu'il s'est mêlé d'écrire pour le théâtre. Mais elle n'est pour lui qu'un accessoire, son tempérament qui le porte à la représentation directe de la vie contemporaine est le plus fort, et fera le succès de Louise, à l'Opéra-Comique, en 1902. La Vie du poète, donnée par l'Opéra à titre exceptionnel, annonce quelques-unes des meilleures pages de Louise. Quant à M. Edmond Malherbe, son poème symphonique le Jugement de Pâris avait été choisi par un jury composé de Reyer, Saint-Saëns, Massenet, Dubois, Lenepveu, membres de l'Institut, Bruneau, d'Indy, Erlanger, Fauré. X. Leroux, Widor, Taffanel, Vidal, Mangin et Gailhard. L'expérience, malgré la garantie de si beaux noms, fut malheureuse, et Gailhard, qui s'était flatté d'attirer ainsi à l'Opéra ces jeunes musiciens qu'on lui reprochait de ne pas jouer, estima qu'il n'y avait pas lieu d'insister.
(88) Né en 1841.
(89) Né en 1857.
(90) Né en 1860.
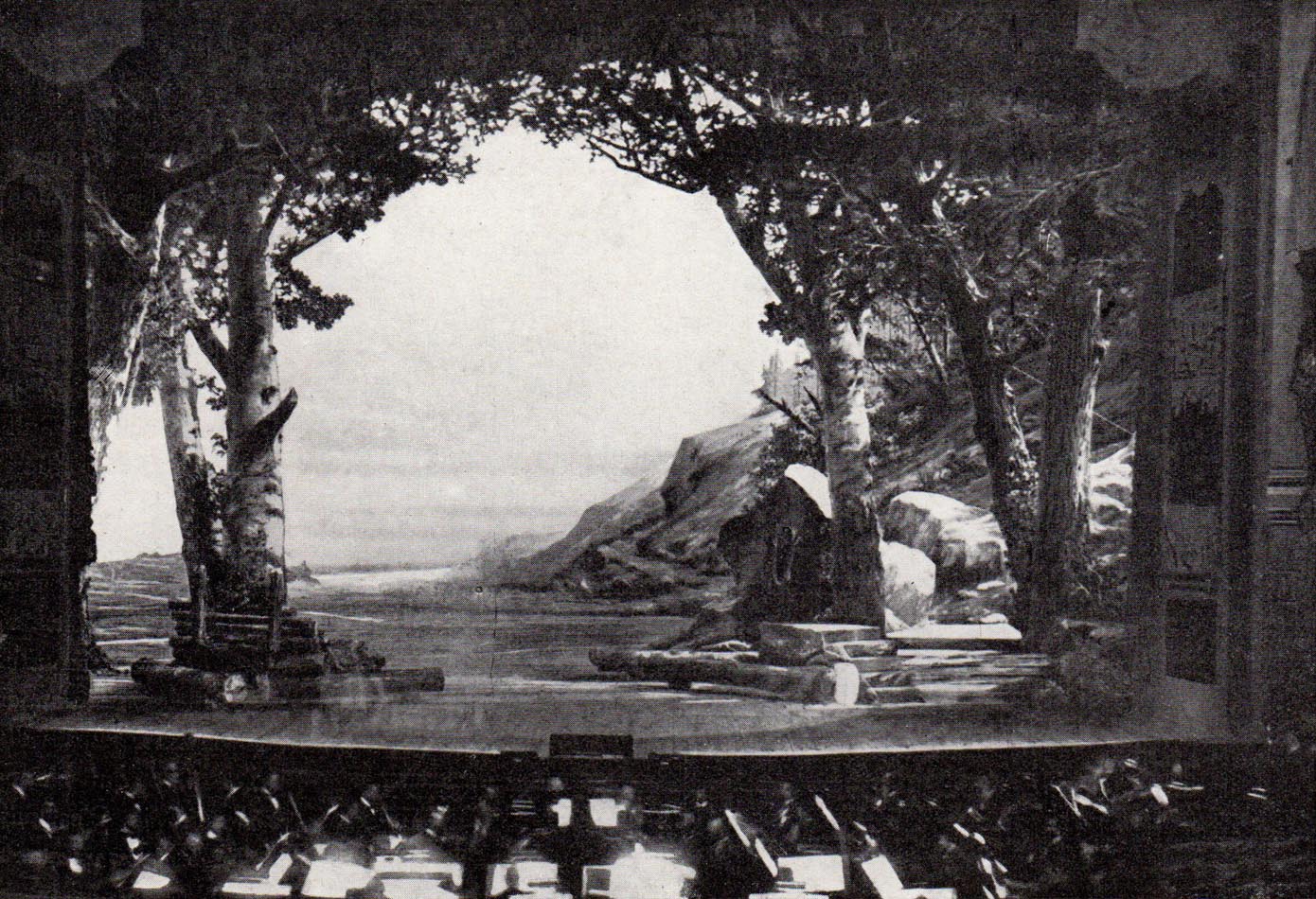
décor pour Messidor (Bibliothèque de l'Opéra)
Les œuvres de Wagner, dès qu'elles furent admises à l'Opéra, lui ont assuré des recettes élevées, et constantes. Sans cet appoint, il est probable que Gailhard, malgré toute son habileté administrative, ne fût pas arrivé à boucler son budget. Pendant toute cette période et même pendant celle qui va suivre, jusqu'en 1914, c'est Wagner qui a fait vivre le théâtre de l'Opéra. Mais aussi il a arrêté net, et retardé de vingt-cinq ans, la renaissance du genre, qui ne se manifeste que de nos jours, parce que c'est de nos jours seulement que les derniers miasmes wagnériens ont été éliminés par une génération nouvelle. Je disais qu'un malheur ne vient jamais seul. Ce proverbe a un sens profond. Il constate ce fait, que la malchance ne s'acharne que sur les faibles ou les malades, parce que personne ne se soucie de leur venir en aide sans résultat ou de risquer la contagion. Si les destins de l'Opéra ont été si longtemps remis à Gailhard, c'est qu'on les lui abandonnait sans regret. Dès 1884, Blaze de Bury sentait venir la crise (91), et proclamait que « les maîtres délaissent l'opéra ». Ils le délaissèrent de plus en plus. Vers le début du vingtième siècle, le genre de l'opéra semblait condamné sans espoir, et on ne parlait du théâtre qu'avec un sourire apitoyé ; de fervents amateurs de musique soutenaient qu'il n'y avait rien à faire, après Gailhard, qu'à le fermer pour transformer l'édifice en music-hall ou en piscine. En attendant, on lui en laissait volontiers la charge, qui le remplissait d'orgueil mais où d'autres eussent trouvé du ridicule. On peut dire de lui, dans un cas où on n'a guère coutume d'employer cette formule, qu'il était l'homme de la situation.
(91) Revue des Deux Mondes, 1er octobre 1884.
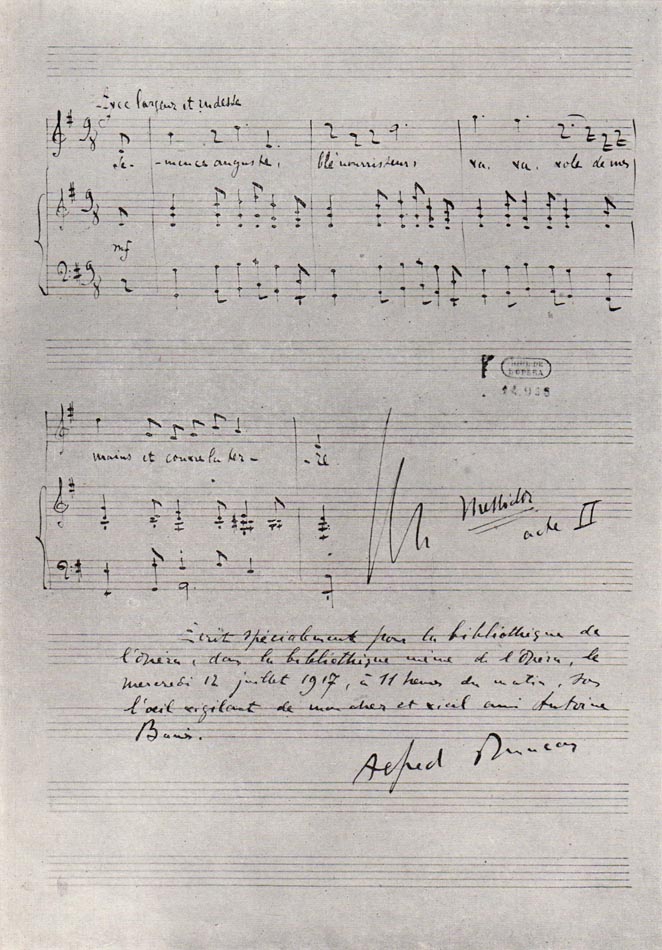
autographe de M. Alfred Bruneau (Bibliothèque de l'Opéra)
VII
Direction Messager et Broussan.
(1er janvier 1908 - 31 août 1914)
Les pouvoirs publics finirent par s'apercevoir que tout n'allait pas aussi bien qu'il eût fallu à l'Opéra. Ne pouvant accepter et n'ayant d'ailleurs pas le droit d'abolir une institution officielle, le ministre de l'instruction publique et le président du conseil estimèrent que pour la sauver, il fallait essayer d'un changement de direction, et le remplacement de Gailhard fut décidé. On trouva une combinaison C'était bien en effet une combinaison, pareille à celles dont on forme un ministère en donnant des gages aux partis opposés, ajoutant ici un radical-socialiste, là un républicain de gauche, réservant un sous-secrétariat d'Etat au représentant d'un journal d'opposition. De la même manière, ces habiles parlementaires avaient été chercher à Lyon M. Broussan, directeur qui en avait, comme on dit, vu bien d'autres et passait pour capable de se tirer de toutes les difficultés financières, pour l'associer à un musicien célèbre, qui était aussi un artiste délicat, sûr de son goût et curieux de tout ce que la musique ancienne ou moderne, française ou étrangère, pouvait offrir de plus intéressant, de plus original, de plus raffiné, ennemi .de toute affectation, de toute grossièreté, pour tout dire profondément français, et jusqu'au bout des ongles : c'était M. André Messager. Après les Deux pigeons, il avait donné, non plus à l'Opéra mais à l'Opéra-Comique, la Basoche (1890), Fortunio (1907), sur d'autres scènes Madame Chrysanthème (1893), Véronique, les P’tites Michu, pour ne citer que ses plus grands succès, et venait de s'illustrer encore d'une autre manière en dirigeant, à l'Opéra-Comique, les représentations de Pelléas et Mélisande, dont la première avait eu lieu le 30 avril 1902.

M. André Messager
M. Broussan était peu connu à Paris. La désignation de M. Messager fut accueillie par des félicitations unanimes. Un seul homme ne s'associait pas à ce concert de louanges : c'était Pedro Gailhard. Jusqu'au dernier moment il avait cru conserver une fois encore la direction de l'Opéra. Déçu, mais non découragé, il gardait la conviction qu'avant peu il faudrait le rappeler, et au moment de partir répétait ce mot dénué de modestie : « Je fais mes Cent Jours. » Peu s'en fallut que l'événement ne lui donnât raison.
Les nouveaux directeurs s'étaient adjoint comme directeur artistique le peintre Pierre Lagarde, parent de l'un d'eux, connu pour ses tableaux d'histoire et l'un des membres influents du salon de la Société nationale. Les autres chefs de services furent :
Secrétaire général : Pierre Soulaine.
Administrateur : Marius Gabion.
Secrétaire de la direction : Lucien Billange, puis Maurice Lefèvre.
Chef de l'abonnement : Eugène Maillard.
Régisseur général : Paul Stuart.
Maîtres de ballets : Leo Staats, puis madame Stichel, puis Ivan Clustine.
Chefs d'orchestre : Paul Vidal, Henri Rabaud, Henri Büsser, Alfred Bachelet.
Chefs des chœurs : Puget, Mestre, Gallon.
Chefs du chant : Catherine, Chadeigne, Rey, Estyle, Straram.
Le 1er janvier 1908, les affiches de l'Opéra portaient ces mots : Relâche pour cause de réparations. Ces réparations consistèrent surtout en nettoyages. De plus, on abaissa le plancher de l'orchestre, afin d'augmenter la place disponible et d'atténuer, en les fondant mieux ensemble, les sonorités. Pas plus que les précédents directeurs, ceux-ci ne purent se résoudre à supprimer les loges sur la scène. Mais ils les séparèrent du décor par un second rideau qui ne servait pas à grand chose, puisque le principal inconvénient subsistait : les artistes ne pouvaient, sans sortir du décor, s'avancer jusqu'au bord de la scène. Ils devaient chanter ou danser à distance.

Mademoiselle Zambelli
Enfin, le 27 janvier, l'Opéra rouvrait ses portes pour une représentation de Faust, avec de nouveaux décors de Pierre Lagarde, où l'on vit notamment un Méphistophélès tout de noir vêtu s'effacer derrière les piliers de l'église. L'opinion générale fut que ces scrupules de vraisemblance partaient d'un bon naturel, mais n'ajoutaient rien au charme d'un ouvrage consacré par un long succès, et qu'il était bien inutile de répondre à des questions que le public ne songeait pas à poser. Les artistes, mesdames Hatto, Martyl, messieurs Muratore, Delmas et Mlle Zambelli furent fort applaudis, et la recette s'éleva à 22.518 fr. 41. Celle de Guillaume Tell, le 29, fut de 19.202 fr. 76 ; le 31, Rigoletto suivi de Coppelia donnait 20.325 fr. 25 C'étaient de bons débuts. L'importance des fonctions attribuées à Pierre Lagarde indiquait la louable intention de remettre en honneur le spectacle, qui est un élément nécessaire de l'opéra et que Gailhard avait complètement négligé. On ne pouvait certes dire que l'interprétation vocale fût sacrifiée, quant aux noms déjà connus sous la direction précédente et à ceux qui viennent d'être cités on voyait s'ajouter ceux de mesdames Litvinne, Kousnetzoff, Mary Garden, Marthe Chenal, de MM. Franz, Renaud, Vanni-Marcoux. Et si l'enseignement de la danse laissait toujours à désirer, parce qu'il était trop uniforme et que l'avancement donné presque toujours à l'ancienneté ne permettait aux artistes d'arriver aux premiers rangs que sur la fin de leur carrière, du moins M. Messager avait-il eu l'heureuse idée d'engager mademoiselle Aïda Boni qui débutait le 29 janvier dans Guillaume Tell et dont les qualités personnelles de vivacité et d'expression formaient avec la pure grâce et l'aérienne légèreté de mademoiselle Zambelli un savoureux contraste.

Paul Franz dans Antar (photo Bert)
Cependant, dès les premières années, les nouveaux directeurs se trouvèrent aux prises avec des embarras d'argent qui ne cessèrent de s'aggraver. Comme ils n'étaient pas d'accord sur les moyens qu'il convenait d'employer pour combler le déficit, l'un d'eux prit bientôt le parti de se désintéresser de ce qui se passait dans la maison, et cette désapprobation tacite n'était pas pour augmenter l'autorité de son collègue. Le 10 juillet 1914, les deux directeurs annoncèrent à leurs commanditaires qu'il leur était impossible de mener leur privilège jusqu'à son terme prévu, qui était le 31 décembre, et qu'ils devaient être considérés comme démissionnaires à partir du 1er septembre.

Mademoiselle Rosita Mauri
A quoi tenaient ces difficultés ? Simplement à ce fait, que le budget de l'Opéra, en raison des frais de plus en plus lourds de l'exploitation et de l'insuffisance de plus en plus avérée de la subvention, se trouvait dans un équilibre instable, que la moindre augmentation de dépenses détruisait sans retour, car même en faisant salle comble, on ne gagnait rien. Le rigoureux système d'économies qui était le secret de Gailhard ne ruinait pas l'Opéra ; il ne ruinait que son prestige. Si on y renonçait il fallait s'attendre à une perte sensible et avoir étudié à l'avance les moyens d'y parer. Les deux directeurs manquèrent de cette prévoyance, l'un parce qu'il croyait trop à son expérience, acquise en province, des affaires de théâtre, l'autre par insouciance d'artiste et dégoût des chiffres, qui d'ailleurs n'étaient pas de son ressort. Ils furent pris au dépourvu et réduits aux expédients. Le tableau suivant indique quelles œuvres sont venues successivement s'ajouter ou tenter de s'ajouter au répertoire de l'Opéra sous leur direction, et quel en fut le succès.
|
Dates 13 mai 1908 18 mai 1908 22 mai 1908 |
Œuvres Hippolyte et Aricie « « |
Recettes 13.142 fr. 26 16.177 fr. 41 16.368 fr. 25 |
Ensuite : de 11.000 à 13.000 fr.
|
23 octobre 1908 28 octobre 1908 02 novembre 1908 |
le Crépuscule des dieux « « |
16.654 fr. 25 23.146 fr. 76 22.863 fr. 41 |
Ensuite : de 20.000 à 23.000 fr.
|
13 janvier 1909 16 janvier 1909
18 janvier 1909 |
Monna Vanna «
« |
11.099 fr. 23 09.431 fr. 50 (Sans abonnement) 12.294 fr. 45 |
Ensuite : de 14.000 à 16.000 fr.
|
05 février 1909 13 février 1909
15 février 1909 05 mai 1909 07 mai 1909 10 mai 1909 |
Samson et Dalila, Javotte « «
« « Bacchus « « |
14.989 fr. 79 11.861 fr. 00 (Sans abonnement) 16.470 fr. 45 13.104 fr. 50 15.557 fr. 33 15.662 fr. 45 |
Ensuite : vers 12.000 fr.
|
17 novembre 1909 19 novembre 1909 22 novembre 1909 |
l'Or du Rhin « « |
14.247 fr 39 19.340 fr. 87 18.628 fr. 99 |
Ensuite : de 16.000 à 18.000 fr.
|
13 février 1910 16 février 1910 18 février 1910 |
la Forêt, la Fête chez Thérèse « « « « |
09.999 fr. 89 11.987 fr. 37 12.742 fr. 49 |
Ensuite : de 11.000 à 12.000 fr.
|
03 mai 1910 06 mai 1910 09 mai 1910 |
Salomé Salomé, la Fête chez Thérèse « « |
16.179 fr. 97 22.665 fr. 09 22.806 fr. 37 |
Ensuite : de 21.000 à 22.000 fr.
|
10 juin 1910 13 juin 1910 17 juin 1910 |
la Damnation de Faust « « |
15.065 fr. 07 20.124 fr. 79 18.740 fr. 47 |
Ensuite : de 15.000 à 18.000 fr.
|
27 décembre 1910 30 décembre 1910 04 janvier 1911
|
le Miracle « «
|
14.582 fr. 07 12.674 fr. 50 09.282 fr. 48 (Sans abonnement) |
Ensuite : de 11.000 à 13 000 fr.
|
30 avril 1911 03 mai 1911 06 mai 1911 |
Gwendoline, España « « « « |
13.225 fr. 55 13.464 fr. 43 15.879 fr. 22 |
Ensuite : de 15.000 à 17 000 fr.
|
06 juin 1911 09 juin 1911 12 juin 1911 21 juin 1911 19 novembre 1911 22 novembre 1911 24 novembre 1911 08 décembre 1911 13 décembre 1911 15 décembre 1911 |
Siberia Siberia, Coppelia Siberia, la Fête chez Thérèse « « Déjanire « « Rigoletto, la Roussalka Déjanire, la Roussalka « « |
12.815 fr. 57 14.296 fr. 79 13.910 fr. 30 12.575 fr. 10 12.535 fr. 90 16.098 fr. 77 16.600 fr. 40 11.789 fr. 17 13.157 fr. 50 14.780 fr. 17 |
Ensuite : de 13.000 à 15.000 fr.
|
28 mars 1912
30 mars 1912 01 avril 1912 |
le Cobzar, les Deux pigeons
« « « « |
08.730 fr. 28 (Sans abonnement) 12.216 fr. 39 15.907 fr. 52 |
Ensuite : de 13.000 à 15.000 fr.
|
21 avril 1912 24 avril 1912 26 avril 1912 |
Roma « « |
12.761 fr. 42 19.211 fr. 97 16.179 fr. 69 |
Ensuite : de 16.000 à 18.000 fr.
|
27 octobre 1912 30 octobre 1912 02 novembre 1912 08 janvier 1913 11 janvier 1913
17 janvier 1913 |
les Bacchantes Salomé, les Bacchantes Siberia, les Bacchantes Fervaal «
« |
13.114 fr. 95 13.955 fr. 51 17.776 fr. 89 09.708 fr. 80 12.678 fr. 06 (Sans abonnement) 14.627 fr. 47 |
Ensuite : de 14.000 à 16.000 fr.
|
28 janvier 1913 29 janvier 1913 01 février 1913 |
le Sortilège, Namouna « « le Sortilège, Salomé |
08.842 fr. 85 11.075 fr. 11 15.836 fr. 79 |
Ensuite : de 10.000 à 12.000 fr.
|
09 septembre 1913 12 septembre 1913 15 septembre 1913 |
les Joyaux de la Madone « « |
13.105 fr. 20 17.590 fr. 59 15.814 fr. 19 |
Ensuite : de 11.000 à 15.000 fr.
|
01 janvier 1914
06 janvier 1914
08 janvier 1914
19 janvier 1914
|
Parsifal
«
«
«
|
48.526 fr. 50 (Hors série) 36.956 fr. 70 (Hors série) 39.942 fr. 10 (Hors série) 19.354 fr. 09 (Tarif normal) |
Ensuite : de 18.000 à 22.000 fr.
|
18 février 1914 23 février 1914 27 février 1914 03 mai 1914 06 mai 1914 08 mai 1914 13 mai 1914 23 mai 1914
29 mai 1914 22 juin 1914 26 juin 1914 01 juillet 1914 31 juillet 1914 |
Rigoletto, Philotis Samson et Dalila, Philotis Rigoletto, Philotis Scemo « « Monna Vanna, le Vieil Aigle « «
« « Samson et Dalila, Hansli le Bossu les Joyaux de la Madone, Hansli le Bossu « « Faust |
11.228 fr. 25 16.688 fr. 54 10.485 fr. 97 08.112 fr. 30 09.670 fr. 47 11.965 fr. 19 12.752 fr. 50 10.056 fr. 08 (Sans abonnement) 11.136 fr. 67 14.112 fr. 64 13.397 fr. 62 09.680 fr. 70 12.437 fr. 89 |
C'était une fort bonne idée que de remettre à la scène un opéra de Rameau. Aucune musique, mieux que la sienne, n'était indiquée pour l’état où se trouvait la nôtre, et la cure de clarté qui lui était nécessaire. Un de nos musiciens, qui était aussi le plus grand de tous, l'avait compris depuis longtemps. Le 22 juin 1904, Claude Debussy assistait à une représentation d'une pastorale de Rameau, la Guirlande, qui avait lieu dans la cour de la Schola cantorum de la rue Saint-Jacques, et on l'avait vu se lever de l'escalier de bois où il était assis pour crier : « Vive Rameau ! A bas Gluck ! » Depuis lors, il avait affirmé à plus d'une reprise son admiration pour Rameau dans ses conversations, ses lettres particulières, ses articles (92), pour finir par la mettre en musique, sous la forme d'un Hommage à Rameau qui est une de ses plus nobles et plus touchantes inspirations. J'étais entièrement d'accord avec lui sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres (93), mais nous n'étions guère écoutés.
(92) L'un de ces articles a été recueilli dans Monsieur Croche antidilettante, page 77.
(93) Ainsi qu'en témoigne mon article sur cette représentation de la Guirlande, publié dans la Revue musicale du 1er juillet 1904, page 307, et mon livre sur Rameau, dont la première édition est de 1908.
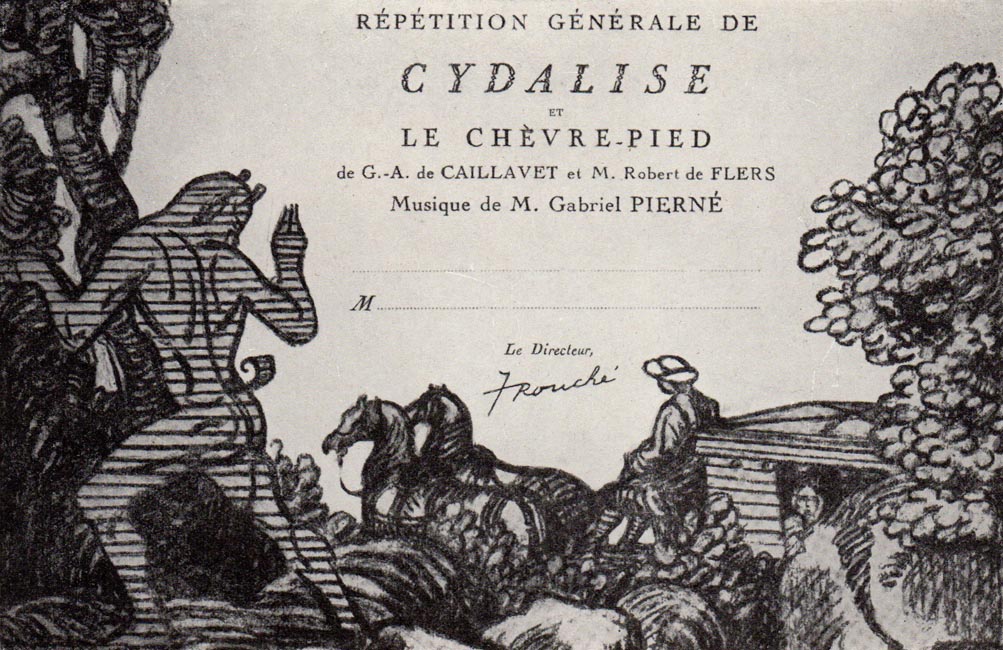
invitation pour la répétition générale de Cydalise et le Chèvre-Pied
Les jeunes musiciens qui passaient alors pour continuer Debussy, et dont quelques-uns croyaient le dépasser, n'aimaient pas Rameau. Ils le trouvaient trop simple, et montraient ainsi combien ils étaient éloignés du goût français dont Rameau était le plus bel exemple au dix-huitième siècle, comme Debussy au début du vingtième. Occupés constamment à raffiner sur l'harmonie, ils étaient devenus incapables de comprendre un style qui comme celui de Rameau s'appliquait à ne garder que l'indispensable. Comme ils trouvaient toujours sans difficulté l'explication de l'harmonie de Rameau, ils disaient que c'était une harmonie de professeur. Ils ne savaient pas, ils ne savaient plus que les émotions les plus vives et les impressions les plus subtiles gagnent encore en vivacité et en subtilité quand on parvient à les exprimer en un langage intelligible ; ils ne semblaient avoir d'autre ambition que de se poser des énigmes les uns aux autres, et des devinettes à leurs auditeurs. Comment auraient-ils pu goûter un artiste qui ne procède que par retranchement de matière, pareil à un de ces sculpteurs en pierre dure qui ont pour outil le ciseau et la bouterolle ? Ils ne faisaient, au contraire, qu'ajouter encore un dièse, encore un bémol, à une agglomération de notes aussi hérissée de retouches et chargée de coups de pouce qu'une maquette de cire. Mais Debussy, lui aussi, taillait ses œuvres dans le jade ou le cristal de roche. Ils n'entendaient donc pas mieux sa musique que celle de Rameau. C'est par la méthode allemande d'accumulation qu'ils travaillaient la leur. Ils étaient wagnériens bien plus qu'ils ne le pensaient eux-mêmes, et on put bientôt s'en convaincre quand éclata leur admiration pour la Salomé de Richard Strauss, le plus authentique héritier de Wagner.
La Schola Cantorum, qui défendait toutes les traditions, prétendait rendre justice à Rameau. Mais on l'y admirait comme Gluck, et pour les mêmes raisons. Charles Bordes n'eût pas commis cette erreur : le choix même d'une production aussi légère que la Guirlande atteste que ce délicat et sensible musicien était capable d'apprécier l'élégance unie au naturel et la netteté dans la grâce, que Gluck n'a jamais connues et qui sont le privilège de Rameau. Mais il venait alors de quitter, bien malgré lui, sa chère Schola qu'il avait fondée et fait vivre au détriment de son repos et de sa santé, pour aller à Montpellier, en établir une autre. M. Vincent d'Indy, désormais seul directeur de la maison de Paris, y fit prévaloir un esprit doctrinaire et fortement imbu des théories wagnériennes. Les critiques qui lui étaient dévoués renchérirent encore sur la rigueur de la consigne, qui était de tenir Rameau pour un maître de la musique vocale et de l'expression dramatique.

décor pour Hippolyte et Aricie. Premier Acte (Bibliothèque de l'Opéra)
Il semblait que si on déniait toute compétence à un musicien ou à un historien moderne pour juger Rameau, on devait cependant tenir compte de l'opinion de ses contemporains : amis ou adversaires, tous sont d'accord pour reconnaître que s'il y a des parties faibles dans ses récitatifs et dans ses airs de chant, il est, comme symphoniste d'opéra, sans modèle et sans rival (94), et que « ses airs de danse dureront éternellement » (95). Il semblait aussi qu'avant d'entreprendre de nous intéresser à une des tragédies mises en musique par Rameau, il eût fallu se donner la peine de la lire. Une seule contient une situation émouvante et de beaux caractères : c'est Castor et Pollux. C'est pourquoi Bordes, à Montpellier, et plus tard l'Opéra, ont arrêté leur choix sur cet ouvrage. Mais Hippolyte et Aricie n'offrait au musicien que la plus fade galanterie, et avec la meilleure volonté du monde il lui était impossible de prendre part aux malheurs d'Aricie ou de prêter un accent vigoureux au désespoir d'une Phèdre sans remords, à la malédiction d'un Thésée qui oublie qu'il est père. Comment ne pas voir que Rameau a mis en musique les vers de l'abbé Pellegrin comme il eût fait, selon un mot souvent cité, d'un article de la Gazette de Hollande, et ne se sent à l'aise que dans l'instant où les chanteurs se taisent et les bergers, les prêtresses, les chasseurs ou les démons font leur entrée ? Mais alors, quel changement soudain ! Et cette émotion que les personnages indiquaient par des froids discours, comme elle trouve, avec ces danses et ces cortèges que la musique fait surgir, son expression figurée dans les plus précises nuances de la tendresse, du plaisir, du deuil ou de la terreur !
(94) Chabanon, Eloge de Rameau.
(95) Diderot, le Neveu de Rameau.
Mais on ne l'entendait pas ainsi, à la Schola. Sur les avis donnés par ce docte cénacle, on abrégea considérablement, dans Hippolyte et Aricie, les entrées de ballet, parce qu'il était convenu, une fois pour toutes, qu'un ballet n'était qu'un hors-d’œuvre, un divertissement qui ralentit le cours de l'action. Au contraire, on garda la pièce intacte, en vertu du raisonnement suivant : Rameau est un grand musicien de théâtre ; un grand musicien de théâtre est celui qui met au premier plan ses personnages et ne s'attache qu'à l'expression directe de leurs sentiments ; donc Rameau procède ainsi. Les résultats de ce contre-sens ne se firent pas attendre : le public fut déçu ; Hippolyte et Aricie ne put avoir que six représentations, et l'entrée de Rameau au répertoire de l'Opéra fut retardée de dix ans.
M. André Messager avait laissé faire. Ce n'est pas lui qui dirigeait l'orchestre. C'est grand dommage, car personne n'était mieux qualifié pour introduire Rameau à l'Opéra, comme Debussy à l'Opéra-Comique. Aucune confusion n'était à craindre de son esprit clair, de son goût sûr, et admirant chaque ouvrage pour les beautés qu'il y sentait, non par raisonnement de théorie, il eût aussi fortement, aussi exactement mis en valeur la netteté de Rameau et sa concision rigoureuse que la puissance progressive de Wagner. Pour des motifs d'ordre intérieur, que je n'ai pas à élucider ici, c'est à Wagner, non à Rameau, que ses soins furent réservés. C'est lui qui dirigea successivement le Crépuscule des dieux, l'Or du Rhin, et enfin, le jour même où l'ouvrage jusque là réservé à Bayreuth tombait dans le domaine public, Parsifal, pour une série de représentations à tarif spécial dont les recettes furent magnifiques, mais venaient trop tard pour combler le déficit et conjurer l'imminente ruine.
Après Wagner, c'est Richard Strauss qui donna à l'Opéra ses meilleures recettes avec Salomé, dont l'interprétation réunissait mademoiselle Mary Garden, Muratore et Dufranne. On sait comment le musicien allemand, prenant au tragique une fantaisie toute littéraire d'Oscar Wilde, l'avait exaspérée d'une musique qui renchérissait encore sur celle de Wagner pour la recherche des combinaisons et trouvait des effets d'orchestre fort curieux, mais se contentait d'idées sans intérêt, dont l'emphase accusait encore la banalité. Tous ceux qui, musiciens ou amateurs, subissaient encore le prestige de Wagner furent, comme il fallait s'y attendre, émerveillés par un art sans secret dont la mécanique leur apparaissait à découvert et se laissait démonter pièce à pièce.

Chaliapine dans Mefistofele (photo Bert)
Boris Godounov, de Moussorgski, pouvait seul combattre l'influence de Wagner et de Strauss. On en avait entendu des fragments dès la fin de la direction précédente, le 19 mai 1907, dans l'un des concerts organisés à l'Opéra par M. de Diaghilev et qui furent la première de ces saisons russes, si instructives et si fécondes. Le 19 juin 1909, une représentation de Boris Godounov, abrégé et remanié pour la circonstance, était donnée à l'Opéra par la même entreprise, en langue russe et avec une interprétation de choix qui réunissait Chaliapine, Smirnov, Kastorski, Charonov, Altchevski, Tchouprinnikov, mesdames Ermolenko, Tougorinova, Petrenko, Renina, sous la direction du chef d'orchestre Blumenfeld. C'est au sortir de cette représentation que Charles Bordes, descendant de l'un des amphithéâtres supérieurs et sous le coup de la plus vive émotion, m'interpellait dans la foule pour me dire : « C'est le grand-père de Pelléas, n'est-ce pas ? ».
Boris Godounov contient en effet, comme Pelléas, une musique pure, toute d'invention et sans calcul, dont l'action est immédiate, et plus puissante encore, parce qu'elle va droit au fait, sans ces détours, ces affectations, ces mièvreries de l'expression verbale qui laissent subsister dans Pelléas des traces de littérature. Le grand-père parle plus net que le petit-fils, et ce qu'il dit a plus de sens. C'est pourquoi on l'écoute avec plus de docilité encore. Le succès de Boris Godounov fut unanime et sans discussion. Les wagnériens les plus fervents y furent pris comme les autres.
Dès cette époque l'ouvrage pouvait donc être annexé avec avantage au répertoire de l'Opéra. Les directeurs paraissent avoir eu cette intention, puisqu'ils avaient acheté à leur collègue russe les décors de Golovine. Ensuite, je ne sais pourquoi, ils y renoncèrent, et les décors furent revendus à un théâtre d'Amérique. Boris Godounov fut joué une fois encore, en 1913, sur le théâtre des Champs-Elysées, et ce n'est que la direction actuelle qui l'a enfin inscrit, avec le succès que l'on sait, au nombre des œuvres données chaque année à l'Opéra.
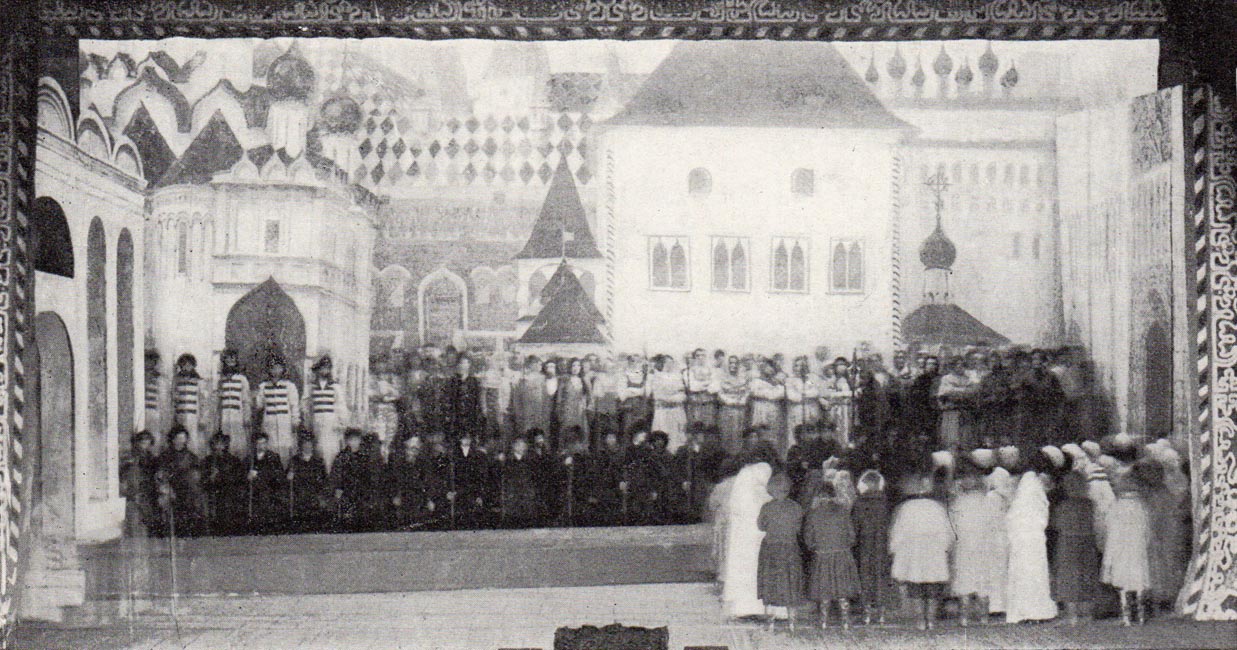
décor pour Boris Godounov. Premier acte, premier tableau
Il n'y a pas lieu d'insister sur les autres opéras qui furent montés par cette direction, puisque aucun n'a réussi alors, pas même Monna Vanna, de M. Henry Février, sur une pièce de M. Maurice Maeterlinck spécialement aménagée pour la musique, dont le succès bien mérité ne s'est affirmé que par la suite ; pas même le Bacchus de Massenet, sur un grandiloquent livret de Mendès ; pas même Roma du même auteur, d'après le drame de Parodi Rome vaincue, arrangé par Henri Cain, où l'on trouve pourtant des pages émouvantes ; pas même Fervaal de M. Vincent d'Indy, que l'Opéra adoptait bien tardivement, après la Monnaie de Bruxelles et l'Opéra-Comique ; ni la Forêt de Savart, ni le Miracle de M. Georges Hüe, ni Déjanire de Saint-Saëns, sur un livret de Gallet donné d'abord à Béziers le 28 août 1898, ni Scemo, de M. Alfred Bachelet, sur un poème dramatique de M. Charles Méré, ni le Sortilège de MM. André Gailhard et Maurice Magre, ni le Cobzar de madame Gabrielle Ferrari, donné à Monte-Carlo en 1909 et dont le poète était M. Paul Milliet, ni les Joyaux de la Madone, de Wolf-Ferrari, dont M. René Lara avait rédigé l'adaptation française et qui venait à l'Opéra après une assez brillante carrière sur les scènes de Vienne, Berlin, Munich, Venise et Londres. Parmi les ballets donnés durant la même période, seule la Fête chez Thérèse de M. Reynaldo Hahn, sur un scénario de Mendès, a été repris récemment avec succès. Javotte, de Saint-Saëns, sur un scénario de J.-L. Croze, qui est une charmante paysannerie, avait été dansée d'abord à Lyon le 3 décembre 1896, puis à l'Opéra-Comique le 23 octobre 1899, et n'est entrée à l'Opéra que pour y trouver, bien injustement, son tombeau. España, ballet arrangé sur la musique du morceau symphonique de Chabrier, la Roussalka, ballet de M. Lucien Lambert, sur un scénario de MM. Le Roux et de Dubor, les Bacchantes, de M. Alfred Bruneau, dont Félix Naquet fut le collaborateur pour le scénario, Philotis, de MM. Philippe Gaubert et Gabriel Bernard, Hansli le Bossu de MM. Noël et Jean Gallon pour la musique, Cain et Adenis pour le scénario, ont disparu de même et méritaient peut-être un meilleur sort. Mais on m'excusera de n'accorder pas même un regret de courtoisie à Siberia, de Giordano, ni au Vieil Aigle de M. Raoul Gunsbourg, dont l'Opéra pouvait bien se passer ; ou s'il avait des raisons pour les jouer, on peut affirmer qu'elles n'étaient pas d'ordre artistique. Quant à la Damnation de Faust, si elle a pu être reprise de nos jours, ce n'est pas, comme le croit peut-être M. Gunsbourg, à cause de son arrangement scénique, c'est malgré cet arrangement, et parce que la musique de Berlioz est de force à y résister.
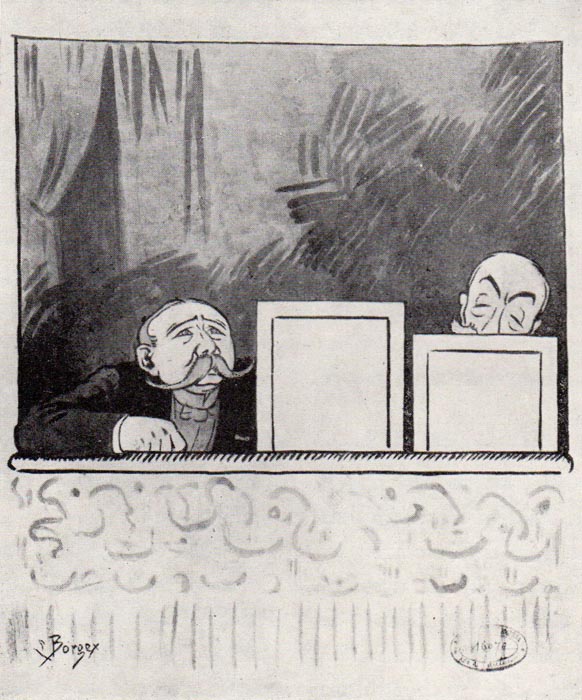
la loge directoriale de l'Opéra. MM. Broussan [à gauche] et Messager. Caricature de Borgex (musée de l'Opéra)
Cependant les Ballets russes donnaient en 1910, sur la scène de l'Opéra, l'Oiseau de feu de Stravinski, Shéhérazade, sur la musique de Rimski-Korsakov, les danses polovtsiennes du Prince Igor de Borodine ; en 1912, c'est sur la scène du Châtelet que paraissaient Petrouchka de Stravinski et Daphnis et Chloé de M. Maurice Ravel ; en 1913, Claude Debussy sollicité à son tour donnait le ballet de Jeux, créé au théâtre des Champs-Elysées ; l'année suivante, de retour à l'Opéra, les Ballets russes y faisaient connaître, le 14 mai 1914, la Légende de Joseph de Richard Strauss, et le 26 juin le Rossignol de Stravinski. L'immense succès des Ballets russes devait donner beaucoup à penser, non à la foule frivole qui s'en laissait naïvement éblouir, mais à ceux qui savaient réfléchir après le spectacle et en tirer la moralité. Boris Godounov avait montré qu'il était possible de mettre sur la scène lyrique un grand sujet sans recourir pour le traiter aux procédés de Wagner, et que dans la musique comme partout ailleurs la plus haute noblesse se reconnaissait à une perfection de naturel, d'aisance et de simplicité. Les ballets enseignaient que la magnificence du spectacle n'était pas incompatible avec le goût le plus raffiné, et qu'un ballet devenait une œuvre d'art, quand un grand musicien et un grand peintre lui accordaient une collaboration qui n'entraînait pour eux aucune déchéance, car un artiste digne de ce nom élève tout ce qu'il touche et ne s'abaisse jamais. Comme de plus les Ballets russes recrutaient leurs danseurs et leurs maîtres de ballet dans les théâtres impériaux, où la danse de théâtre à la manière française, introduite au début du dix-neuvième siècle par des maîtres tels que Petipa, s'était conservée intacte et avait su notamment garder ses danseurs, presque entièrement dépossédés à Paris par les danseuses, on peut dire que les traditions de l'ancien opéra n'étaient plus représentées, au début de ce siècle, que par les Ballets russes. Cette constatation ne diminue en rien le mérite de M. de Diaghilev et des artistes qu'il sut intéresser à son œuvre : une tradition, pour revivre ou seulement pour continuer à vivre, doit trouver des forces nouvelles que seul peut lui fournir un génie créateur.

décor pour Daphnis et Chloé par Bakst
Ces traditions dont les Ballets russes s'étaient si heureusement inspirés à leur manière, n'y avait-il pas moyen d'en tirer encore un tout autre parti, en les réintégrant dans le théâtre même où elles avaient pris naissance ?
Telle était, depuis longtemps déjà et avant la fondation des Ballets russes, l'opinion de M. Jacques Rouché ; telle l'expérience qu'il était prêt à tenter. Il se trouva que le ministre de l'Instruction publique était alors M. Louis Barthou, qui joint aux talents de l'homme d'état et de l'orateur le goût le plus délicat et le plus cultivé pour les lettres et les arts. Il ne se laissa pas gagner, comme peut-être certains parlementaires, qui n'auraient été que des parlementaires, eussent fait à sa place, par les recommandations politiques dont s'appuyaient d'autres candidatures, et le 25 novembre 1913, c'est M. Rouché qui était désigné pour prendre la direction de l'Opéra à l'expiration du privilège en cours, c'est-à-dire au 1er janvier 1915. En juillet 1914, M. Rouché acceptait, à la demande du ministre, d'entrer en fonctions dès le 1er septembre, MM. Messager et Broussan étant démissionnaires à cette date.
VIII
Direction intérimaire de M. Jacques Rouché.
(1er septembre 1914 - 16 janvier 1919)
Le nouveau directeur de l'Opéra était le fils du mathématicien, connu par ses travaux sur plusieurs points d'algèbre et en particulier sur la théorie des déterminants, où un théorème fondamental, dont il est l'auteur, est désigné d'ordinaire par son nom. Elève lui-même de l'Ecole polytechnique, M. J. Rouché s'était dès sa première jeunesse intéressé à l'art du théâtre au point de suivre le cours de mise en scène au Conservatoire. Son premier livre est une Histoire de la Section de déclamation dramatique au Conservatoire. Placé ensuite à la tête d'une grande industrie, il ne cessa de consacrer les loisirs qu'elle lui laissait à ses études préférées, se constituant une précieuse collection de livres anciens et modernes sur le décor et la mise en scène. En 1906, il prenait la direction de la Grande Revue et savait s'y assurer la collaboration d'écrivains et d'artistes dont plusieurs étaient déjà ses amis. En 1909, il devenait directeur du théâtre des Arts, et c'est sur cette modeste scène qu'il fit ses premiers essais de rénovation. La même année, il entreprenait un voyage en Europe afin de voir sur place les résultats des différents systèmes proposés alors pour résoudre le problème de la mise en scène, c'est-à-dire de l'adaptation du spectacle au mouvement et au sentiment de l'ouvrage. Ce problème depuis quelques années s'était posé à l'esprit de plusieurs artistes tels que Gordon Craigh en Angleterre, Stanislavski en Russie, Georg Fuchs, Fritz Erler, Adolphe Appia en Allemagne, et devait en effet se poser à une époque où les conditions de la mise en scène étaient modifiées si profondément par l'introduction de la lumière électrique. C'est ce nouveau procédé qui, en tenant à la disposition du metteur en scène une variété jusque là inconnue de coloris, de distribution et d'intensité lumineuse, a rendu possibles des effets soit de somptuosité et de magnificence, soit au contraire de simplification et d'effacement, dont chaque artiste, selon le tour de son esprit, a cherché à se faire un style. Les poètes eux-mêmes ont été encouragés, par ces nouveaux moyens, à créer plus librement un monde de fantaisie dont la scène ne se refusait plus à présenter les apparences chimériques et changeantes, et c'est ainsi que l'art entier du théâtre, vers le début de ce siècle, se dégageait du réalisme, à quoi l'asservissaient les rampes à gaz éclairant uniformément les décors en panorama, pour évoquer, à l'aide de toiles peintes et de tulles où se joue la lumière, des paysages aussi émouvants que ceux des peintres, ou des palais hantés de fantômes. Le décor, jusque là inerte et figé, s'animait et devenait capable soit d'attirer à soi les personnages et de les confondre dans une harmonie de couleurs dont ils n'étaient plus qu'un élément, soit de reculer à leur approche pour les laisser seuls en scène, détachés seulement sur le fond le plus favorable à leur évidence.
Ce progrès nécessaire n'avait pas encore commencé en France. Les mises en scène du théâtre réaliste y paraissaient le dernier effort de l'art, et quand il s'agit de monter à l'Opéra-Comique Pelléas et Mélisande, on présenta encore cette poétique légende en des décors chargés de détails, et d'une crudité contraire à l'esprit de l'ouvrage. Mais comme on y remarquait quelques éclairages à contre-jour, le public qui n'avait jamais rien vu de pareil jusque là cria au miracle.

M. Jacques Rouché, Directeur de l'Opéra
M. J. Rouché publiait en 1910, sous le titre de l'Art théâtral moderne, les résultats de son enquête et s'expliquait, dans la préface de ce livre, sur son dessein qui était de susciter en France, par l'étude et l'émulation, un mouvement non pas semblable, mais parallèle à ceux qui se manifestaient dans les autres pays :
Depuis une dizaine d'années, tout un ensemble de recherches du plus grand intérêt se poursuivait à l'étranger, sur un certain nombre de théâtres et dans des milieux différents. On les ignorait presque, car il fallait pour s'initier, ou bien aborder les ouvrages disséminés qui ne sont pas encore traduits dans notre langue, ou bien aller jusqu'à Florence, Munich, Berlin, voire jusqu'à Pétersbourg et Moscou, et s'y documenter laborieusement sur place. Peu à peu, cependant, quelques idées nouvelles ont pénétré et l'attention du public lui-même a été, par les représentations des ballets russes à l'Opéra, violemment attirée vers les ensembles, inédits chez nous, de coloration... M. de Diaghilev, avec la collaboration d'artistes délicats comme MM. Bakst et Benois, nous a montré d'admirables variations sur les couleurs. Mais il ne faut pas croire que cet ensemble de décors et de costumes constitue uniquement la rénovation théâtrale. En Russie même, d'autres réformes, tout aussi puissantes, ont été étudiées : Mme Komissarjevska, MM. Stanislavksi, Dantchenko, Meyerhold, ont scruté la théorie des sons, des lumières, sont arrivés à des réalisations merveilleuses. On connaît le succès de l'Oiseau bleu de Maurice Maeterlinck. MM. Fuchs, Litmann, Erler, Reinhardt, ont établi en Allemagne de belles simplifications de décor. Enfin M. Gordon Craig cherche, depuis quinze ans, la stylisation, la parure, le rythme, qui conviennent à la beauté scénique.
Entre ces différents principes il appartient à l'artiste de choisir :
Il ne peut s'agir d'édicter un code de règles absolues... Le seul reproche qu'on puisse adresser à certains réformateurs, c'est d'avoir imposé une discipline trop sévère. Quel cadre uniforme que cette plantation du Kuenstler-Theater avec ses tourelles et son mur immuables, qui empêche toute bonne exécution de plantation réaliste ! Nous ne pouvons oublier, nous autres Français, la perfection que MM. Antoine et Albert Carré ont atteinte dans ce genre et la gloire mondiale qui en a rejailli sur notre théâtre. La mise en scène, à notre avis, peut être réaliste, fantaisiste, symbolique ou synthétique, comporter des éléments plastiques ou peints... Nous réclamons pour le metteur en scène toute liberté, à condition que les moyens employés soient artistiques.
M. J. Rouché s'était tout naturellement entouré, au théâtre des Arts, de ses amis et collaborateurs de la Grande Revue, mais fidèle au libéralisme dont il venait de se déclarer l'adepte fervent, il ouvrit son théâtre à tous les ouvrages qui lui paraissaient présenter un intérêt artistique, et c'est ainsi qu'on y représenta tour à tour des drames comme le Carnaval des enfants de M. Saint Georges de Bouhélier, les Frères Karamazov de MM. Jacques Copeau et Croué, d'après Dostoïevski, le Chagrin dans le palais de Han, de M. Louis Laloy, d'après le drame chinois qui porte le même titre, Nabuchodonosor de Maurice de Faramond ; des comédies-ballets comme le Sicilien de Molière, des ballets comme les Dominos de Couperin, les Fêtes d'Hébé de Rameau, Dolly de M. Gabriel Fauré, le Festin de l'Araignée de M. Albert Roussel, des comédies comme la Profession de madame Warren de Bernard Shaw, des tragédies lyriques comme le Couronnement de Poppée de Monteverdi, le prologue de Thésée de Lully, Idoménée de Mozart, des opéras-comiques ou des opérettes comme les Dames de la Halle d'Offenbach, les Vieilles gardes de Delibes, l’Education manquée de Chabrier. Chacun de ces ouvrages était monté dans les conditions qui paraissaient le mieux appropriées à son caractère, grâce au concours d'artistes tels que MM. Maxime Dethomas, Drésa, Piot, Guérin, désignés tour à tour pour en établir les décors. On observait ensuite le résultat de l'expérience : il y eut de brillants succès, il y eut aussi des déceptions. On pouvait s'y attendre, car un bon peintre n'est pas nécessairement un bon décorateur. Mais le seul moyen de s'en assurer, c'est de le mettre à l'épreuve. Les spectacles les moins réussis du théâtre des Arts n'étaient jamais indifférents. Ils comportaient un enseignement, donnaient lieu à des discussions. Le public lettré et artiste tenait à les voir, pour se faire une opinion. C'est ainsi que cette salle devint, durant quatre ans, le centre de travail où s'élaborait le nouvel art du théâtre. C'est là que MM. Jacques Copeau et Charles Dullin ont fait, l'un comme auteur, l'autre comme acteur, leurs débuts. Et M. Gémier, à cette époque, se contentait de sa renommée, bien méritée déjà, d'excellent comédien.
En prenant la direction de l'Opéra, M. J. Rouché voulait y introduire les mêmes méthodes d'adaptation. Entre les trois éléments dont se compose un opéra, qui sont l'action, la musique et le spectacle, il s'agissait de retrouver une formule d'équilibre appropriée au goût et aux moyens des temps modernes. Formule qui devait conduire, selon les cas, à différentes solutions, car il n'est jamais entré dans les intentions de M. Rouché d'imposer une interprétation uniforme à des œuvres du dix-huitième, du dix-neuvième et du vingtième siècle, à des drames, à des comédies lyriques ou à des divertissements dansés. Certains de nos réformateurs, venus après lui, n'ont pas su comme lui se garder du dogmatisme.
Il semblait qu'un pareil programme dût réunir tous les suffrages. Aucune direction cependant n'a rencontré, à ses débuts, plus de difficultés. Aucune non plus n'a été récompensée ensuite de son patient effort par un succès plus complet. L'Opéra connaît aujourd'hui une prospérité dont on avait perdu l'espoir, depuis quatre-vingts ans. Il faut en effet remonter jusqu'au temps où les opéras de Meyerbeer, depuis Robert le diable (21 novembre 1831) jusqu'au Prophète (16 avril 1849), étaient les grands événements de la vie artistique, pour retrouver des soirées aussi brillantes. Résultat d'autant plus appréciable, qu'il est obtenu avec un répertoire varié, où Meyerbeer n'est plus pour rien. Mais pour y parvenir, que de luttes, que d'oppositions à vaincre, que d'intrigues à déjouer !
Tout d'abord, il y a eu la guerre. Mais pendant la guerre, et surtout à son début, les autorités supérieures n'ont guère facilité la tâche du nouveau directeur ni répondu à sa bonne volonté. Après la guerre, le renchérissement considérable de tous les objets de commerce rendait l'exploitation fort difficile. La subvention pourtant ne fut pas augmentée. Les ministres qui se sont succédé n'ont pu témoigner au directeur qu'une bienveillance toute sentimentale. Le personnel, docile aux suggestions de quelques cerveaux brûlés, ne se tenait jamais pour satisfait des augmentations d'appointements qui lui étaient accordées progressivement, et ne se montrait jamais disposé à donner un peu plus de travail, de manière à diminuer l'énormité du déficit. « Il est, disait-on, assez riche pour payer », en commettant une confusion entre le fini et l'infini dont on ne se fait guère scrupule, quand il s'agit d'autrui. Le public, depuis la guerre, était composé en majorité de nouveaux venus qui allaient à l'Opéra par curiosité et connaissaient à peine le nom du directeur. Quelques vieux Parisiens demeuraient à leur poste ; mais ceux-là étaient trop bien informés. Tous les deux ou trois mois, la nouvelle se répandait parmi eux que le directeur lassé allait se retirer. Ils y ajoutaient foi aussitôt, par cette même affectation de scepticisme qui pendant la guerre a pris le nom de défaitisme, et parce que rien n'est plus difficile à comprendre, pour le commun des hommes, qu'une action désintéressée.
L'Opéra avait fermé ses portes le jour où paraissait le décret de mobilisation générale, qui était le samedi 1er août. La veille au soir, on avait joué Faust, pour la dernière fois avant longtemps. Le 1er septembre, M. Rouché était reçu par le sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts, M. Dalimier (96). D'un commun accord, le contrat spécial pour l'entrée en fonctions anticipée du nouveau directeur était annulé, en raison des événements. De plus le sous-secrétaire d'Etat faisait connaître au directeur la décision qu'il avait prise de répartir la subvention entre tous les artistes, employés et ouvriers de l'Opéra, à l'exception des artistes du chant et des étoiles de la danse. Chacun des bénéficiaires devait recevoir ainsi une somme de 98 francs par mois, notoirement insuffisante, même à cette époque, pour assurer la subsistance d'un homme, à plus forte raison d'une famille. Quant aux artistes du chant et de la danse, on supposait sans doute qu'ils avaient tous des rentes. M. J. Rouché, conscient de son devoir, chercha les moyens d'améliorer cette situation, mais il dut bientôt se convaincre qu'il était impossible de reprendre les représentations régulières de l'Opéra : les deux tiers des musiciens, un quart des choristes, la moitié des machinistes, et parmi les artistes du chant plusieurs chefs d'emploi, notamment dans le groupe des ténors, étaient mobilisés. Le 19 décembre, il adressait donc au ministre une lettre où il déclarait son intention de ne pas se dérober à sa tâche et d'assurer de son mieux, en toute circonstance, la subsistance de l'Opéra et de son personnel. Pour l'instant, voici ce qu'il proposait :
Je ne pense pas qu'il soit possible de songer avant la fin de la guerre à l'exploitation régulière de l'Opéra. A l'heure actuelle, le personnel compte un trop grand nombre de mobilisés parmi les danseurs, les chanteurs, les choristes, musiciens et machinistes. Il faudra sans doute, pendant un laps de temps indéterminé, se borner à organiser, avec le concours bénévole d'artistes disponibles, des représentations spéciales ou des concerts, consacrés uniquement à des œuvres de charité et de bienfaisance.
(96) Les documents qui suivent sont empruntés à la publication de la Société de l'histoire du Théâtre intitulée le Théâtre pendant la guerre, pages 1 à 12.
Considérant cependant qu'un jour ou l'autre on pourrait rouvrir l'Opéra, il demandait que pour remplacer les œuvres de Wagner, proscrites depuis le début de la guerre, on lui comptât comme des créations les reprises d'œuvres de maîtres anciens de la musique française tels que Berlioz ou Rameau. Il attirait aussi l'attention du ministre sur le délabrement de l'édifice et l'urgence de certaines réparations.
En réponse à cette lettre, il recevait une convocation du sous-secrétaire d'Etat. L'entretien eut lieu le 26 décembre. M. Dalimier s'y montra fermement décidé à ne rien décider. « A quoi bon, disait-il, modifier dès maintenant le cahier des charges quand nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve ? » Et comme M. Rouché proposait de fixer le début de son exploitation régulière à trois mois après la fin des hostilités, son interlocuteur entreprit de le convaincre qu'il était de son intérêt de ne s'engager à rien, de manière à garder toute sa liberté d'action. Une lettre datée du 30 décembre 1914 et signée du ministre de l'Instruction publique, M. Albert Sarraut. enregistrait le résultat négatif de cette entrevue :
Nous sommes d'accord avec vous pour reconnaître que les événements actuels ne vous permettent pas d'exploiter l'Opéra dans les conditions prévues et arrêtées par le cahier des charges. Cette impossibilité vous met dans l'obligation d'ajourner le début de votre contrat de sept ans à une date ultérieure. Cette date sera fixée d'un commun accord dès que les événements le permettront.
Tout se passait comme si on eût voulu décourager le nouveau directeur en lui ôtant la certitude du lendemain. Mais c'était mal connaître une calme et froide ténacité dont il devait par la suite donner d'autres preuves encore. Le 6 janvier 1915, il réunissait à l'Opéra les artistes titulaires des principaux emplois : mesdemoiselles Bréval, Gall, Lapeyrette, Boni (en l'absence de Mlle Zambelli), messieurs Franz, Delmas et Noté. Après les avoir mis au courant de la situation, il leur faisait part d'un projet, aussitôt adopté, et soumis à l'approbation du ministre par une lettre en date du 11 janvier, en ces termes :
Comme la subvention est intégralement répartie entre le petit personnel, les artistes du chant et les étoiles de la danse n'ont droit à aucune allocation. En présence d'une situation particulière qui peut durer quelques mois, j'ai jugé nécessaire d'organiser pour ces artistes des manifestations musicales dans d'autres salles que celle de l'Académie Nationale de musique et de danse. Je souhaiterais donner le dimanche en matinée, à partir de février, des concerts de musique et de danse dont les programmes comprendraient des fragments d'œuvres lyriques anciennes constituant les assises d'une histoire de l'Académie de musique. Vous avez bien voulu me promettre de m'autoriser à donner ces manifestations lyriques dans la salle de l'ancien Conservatoire, rue du Conservatoire ; je vous serais obligé de vouloir bien me confirmer cette autorisation. Si je me permets de vous demander de le faire dans un bref délai, c'est parce que j'ai la conviction que vous tiendrez à manifester, par la spontanéité de votre bienveillance, l'intérêt particulier que vous portez aux artistes.
Bientôt de nouvelles difficultés surgirent. La salle du Conservatoire manquait des aménagements nécessaires. On avait pensé alors au théâtre de la Gaîté-Lyrique, mais les conditions proposées pour la location étaient trop onéreuses. Le 12 janvier, les délégués du personnel, réunis à l'Opéra, émettaient la prétention de toucher, en plus de leur part de subvention, un cachet fixe et garanti pour chaque représentation ou répétition. Ainsi les artistes du chant, qui déjà ne recevaient rien sur la subvention, devaient en outre renoncer à une partie des bénéfices éventuels en faveur de leurs collègues plus favorisés. Ceux-ci ne voulurent rien entendre, et ajoutèrent que d'ailleurs les musiciens et les choristes n'étaient pas libres le dimanche, qui était le seul jour où l'on pût espérer des recettes.

Mademoiselle Fanny Heldy
Le 14 janvier, le directeur accompagné de messieurs Delmas, Noté, mesdemoiselles Bréval, Gall, Lapeyrette, Le Senne et Boni, était reçu par M. Dalimier qui leur promettait d'insister auprès des délégués des chœurs et de l'orchestre pour obtenir leur concours gratuit, même le dimanche.
Le 18 janvier, fort de cette promesse, M. Rouché proposait aux artistes de donner des matinées au Trocadéro et déjà on étudiait les moyens d'y représenter des œuvres comme Faust, Roméo et Juliette, Samson et Dalila. Mais le 27, le directeur était appelé chez le sous-secrétaire d'Etat et apprenait un revirement imprévu. Ayant reçu les délégués de l'orchestre et des chœurs, au lieu de les persuader, c'est lui qui s'était laissé convaincre et soutenait maintenant leurs prétentions. Il n'y avait qu'à s'incliner. Avant tout prélèvement en faveur des artistes, un cachet fut assuré aux musiciens et aux choristes. « Mais, avait demandé un artiste à la réunion du 14 janvier, s'il n'y a pas de bénéfice, qui donnera ce cachet ? » Le sous-secrétaire d'Etat avait répondu : « Les artistes ». Sur quoi les artistes présents avaient levé la séance. Ils furent rejoints dans la rue de Valois par le directeur qui leur dit : « J'arrangerai cela ». En effet. il fut convenu que les pertes seraient à la charge du directeur (97).
(97) Je dois ces détails à l'un des artistes qui assistaient à la réunion.
Comme d'autre part on ne pouvait jouer le dimanche, on se résigna à ne donner les matinées qu'aux jours fériés du 16 février (mardi gras), 11 mars (mi-carême), 5 avril (lundi de Pâques). Une quatrième matinée eut lieu le 29 avril.

Mademoiselle Demougeot
Le premier concert, donné le 16 février, comprenait des fragments d'Hamlet, de Rigoletto, de Salammbô, de Thaïs, de Samson et Dalila, de Fervaal, de l'Etranger, de Hulda (98), de Henry VIII et de Faust, chantés par mesdemoiselles Henriquez, B. Mendès, Bonnet-Baron, Demougeot, Bugg, Lapeyrette, Bourdon, Daumas, Mérentié, Gall, messieurs Lestelly, Laffitte, Noté, Delmas, Cerdan, et des danses anciennes de Rameau exécutées par mesdemoiselles Zambelli, Boni, Meunier, Piron. Au deuxième, le 11 mars, paraissaient deux œuvres complètes, le ballet de Ma mère l'Oye de M. Maurice Ravel, monté en 1912 sur la scène du théâtre des Arts, et dansé par mesdemoiselles Barbier, Piron, Schwarz, Aveline, G. Franck, Delsaux, et l'Offrande à la liberté, de Gossec, remise à la scène en des circonstances analogues à celles de sa création en 1792, après l'arrêt de la première invasion prussienne ; mesdemoiselles Lapeyrette, Bugg, Daumas, Laute-Brun, messieurs Noté, Lestelly, pour le chant, mademoiselle Urban et M. Staats, pour la danse, furent les principaux interprètes de cette « scène patriotique » dont le succès fut émouvant. L'Offrande à la liberté fut encore mise au programme du troisième concert, après Rigoletto et le deuxième acte de Coppelia. Au quatrième concert, on parvenait à donner Faust en entier, avec mesdemoiselles Bugg, Courbières, Doyen, messieurs Laffitte, Gresse, Lestelly dans les rôles chantés, mesdemoiselles Johnsson, Barbier, Schwartz, Piron, Sirède dans le ballet. Un grand effort fut ainsi accompli dans les conditions aussi défavorables que possible. Les dépenses se montèrent à 30.606 fr. 80 qui se décomposent ainsi :
|
Droits des pauvres et versements à la Fraternelle des artistes Location de la salle, affichage et frais divers Cachets de l'orchestre, des chœurs, du ballet, de la figuration, des accessoiristes et gratification au petit personnel |
5.799 fr. 00 13.635 fr. 55
11.172 fr. 25 |
Les recettes ne produisirent un excédent que pour deux concerts :
|
16 février 11 mars 05 avril 29 avril Total |
Bénéfice 1.875 fr.
3.127 fr.
5.002 fr. |
Déficit
4.290 fr.
2.540 fr. 6.830 fr. |
Suivant les conventions, les pertes furent supportées par le directeur. La somme de 5.002 francs, répartie entre les artistes, ne laissait à chacun d'eux qu'une allocation de 60 francs, portée à 90 francs pour ceux qui avaient pris part aux représentations. Il était clair qu'on ne pouvait continuer ainsi.
(98) Hulda est un opéra de César Franck, joué au théâtre de Monte-Carlo en 1894 ; à ce concert, la première scène fut chantée par mesdames Bourdon et Daumas, sous la direction de M. Vincent d'Indy.
Le 25 août 1915, M. J. Rouché demandait au ministre l'autorisation de rouvrir l'Opéra pour y donner, à partir du mois d'octobre, les jeudis et dimanches, des matinées accessibles au grand public et à la jeunesse. Le ministre, qui était alors M. Painlevé, donna presque aussitôt une réponse favorable. Il fut convenu que sur les 800.000 francs de la subvention, 723.000 seraient répartis comme précédemment entre le personnel du théâtre, mais sous la réserve que chacun des bénéficiaires apporterait sa part de collaboration à l'entreprise. Les 72.000 francs restant seraient affectés aux dépenses d'exploitation. Les bénéfices seraient distribués aux artistes. Le prix des places fut fixé de 1 franc pour les cinquièmes loges à 8 francs pour les fauteuils d'orchestre. L'institution de ces matinées fut portée à la connaissance du public par la circulaire suivante, où paraissait pour la première fois un médaillon dessiné par M. Maxime Dethomas :

Paris, le 1er décembre 1915
Un trop grand nombre de familles françaises sont menacées ou frappées dans leurs plus chères affections pour que l'Académie Nationale de Musique et de Danse puisse recommencer encore ses représentations du soir. C'est à des jours moins troublés que nous remettons le soin de décider la date de notre réouverture.
Dès maintenant cependant il nous a semblé qu'un effort devait être tenté pour améliorer la situation des artistes privés du contact avec le public qui leur est nécessaire, pour ajouter une preuve à toutes celles que la France a déjà données de son énergie réparatrice et de sa confiance, enfin pour rendre au public et particulièrement à la jeunesse des spectacles qui ont leur valeur éducatrice comme ils ont leur beauté. L'Opéra est en effet une tragédie en musique, ses auteurs sont des classiques au même titre que ceux de la littérature ; son histoire se confond avec celle de la musique française qui est une des plus hautes manifestations de l'esprit et du goût de la nation ; sa gloire est un des trésors que nos armes défendent.
C'est pourquoi, nous accommodant aux circonstances, nous avons pour cet hiver conçu un projet de matinées qui seront données les jeudis et dimanches à partir du 9 décembre, et, qui consacrées à notre musique dramatique, en restitueront jusqu'à nos jours la tradition sans rivale. Chaque ouvrage sera mis à la scène, pour autant qu'on ne se heurtera pas à des difficultés insurmontables ; les airs détachés et les morceaux de symphonie seront donnés en concert. D'une façon générale, chaque programme comprendra avec costumes et décors un acte ancien ou moderne, un ballet et enfin la reconstitution d'un concert dont la série constituera comme une histoire de la musique d'Opéra.
Tous les artistes de l'Opéra présents à Paris devaient prêter leur concours à ces matinées : messieurs Delmas, Noté, Léon Laffitte, Sullivan, Cazenave, Lestelly, Couzinou, Gresse, Journet, mesdames Litvinne, Bréval, Delna, Gall, Demougeot, Mérentié, Hatto, Borgo, Lapeyrette, Lormont, Campredon, Mendès, Bugg, Laute-Brun, Henriquez, Bourdon, Daumas, Le Senne, Lubin, Gills, Charny, Bonnet-Baron ; mesdemoiselles Zambelli, Aïda Boni, Urban, les artistes de la danse et du corps de ballet.

Madame Campredon
La réouverture de l'Opéra eut lieu le jeudi 9 décembre 1915, pour une représentation au bénéfice de la Croix-Rouge de Belgique, dont la recette fut de 22.154 fr. 70. En voici le programme.
I Marche de Hulda (César Franck)
Les artistes de la danse.
II Chants nationaux de la Belgique, du recueil de Closson
Mesdames Delna, Demougeot, Litvinne, Bréval.
Messieurs Lestelly, Noté, de Max.
Les artistes des chœurs.
III Danses anciennes (Rameau)
Mesdemoiselles Zambelli, Urban, Johnsson, Barbier, Meunier, Schwarz.
IV Eugène Onéguine (2e et 3e tableaux du 1er acte) (Tchaïkovski)
Mesdames Yvonne Gall, Lapeyrette.
Messieurs Laffitte, Lestelly.
V Hamlet (2e tableau du 4e acte) (A. Thomas)
Madame Barrientos.
VI Patrie ! (4e acte) (Paladilhe)
Messieurs Laffitte, Delmas, Gresse, Couzinou, Narçon.
Orchestre sous la direction de MM. Camille Chevillard, Henri Büsser, Bachelet, Gabriel Grovlez.

Edouard Rouard
Le dimanche 12, la première matinée offrait au public deux tableaux d'Eugène Onéguine, le deuxième tableau du deuxième acte et le ballet du Cid. Le 16 on entendait le quatrième acte de Patrie !, les scènes d'Eugène Onéguine, l'ouverture de Stellus, de M. Louis Dumas, et Mademoiselle de Nantes, divertissement sur la musique de Lully et Charpentier. Ainsi s'affirmait la double intention de faire connaître, par des fragments choisis, les ouvrages nouveaux des jeunes musiciens français, et ceux des anciens maîtres. C'est ainsi que l'on entendit successivement à ces matinées, outre des extraits des œuvres appartenant au répertoire, le deuxième acte d'Œdipe à Colone, de Sacchini, le troisième acte d'Iphigénie en Tauride de Gluck, le troisième acte d'Ossian, de Le Sueur, le quatrième acte du Trouvère, de Verdi, le troisième acte du Roi Arthus, de Chausson, le deuxième tableau du Chant de la cloche, de M. Vincent d'Indy, le quatrième acte des Girondins, de M. Fernand Leborne, le troisième acte des Amants de Rimini, de M. Max d'Ollone, le deuxième acte de Graziella, de M. Mazellier, le cinquième acte de Myrialde, de M. Léon Moreau. Quant à Mademoiselle de Nantes, c'était le premier exemplaire d'une suite de spectacles dont l'idée, selon les explications du programme, était « de réunir, sous le prétexte d'une fête ou d'un concert, quelques exemples de ce que la musique de théâtre a produit de plus remarquable aux diverses époques de son histoire ».
L'époque ici était celle de Louis XIV, le prétexte un divertissement offert aux enfants de Louis XIV et de Madame de Montespan, le duc du Maine, le comte de Toulouse, mesdemoiselles de Nantes et de Blois. En un décor de M. Maxime Dethomas, d'une majesté calme et claire, on vit ainsi les jeunes princes et ces petites princesses battre des mains aux airs de Cadmus et Hermione, d'Armide, de Thésée, à l'entrée des Cyclopes dans Acis et Galatée, enfin se mêler à la danse, sur les airs de ballet d'Alceste et de Persée, ce qui n'avait rien que de fort vraisemblable, puisque nous savons qu'en 1681 mademoiselle de Nantes, âgée de huit ans, avait dansé à la Cour dans le ballet du Triomphe de l'Amour et obtenu le succès qu'on pouvait attendre.
Sur le même modèle que Mademoiselle de Nantes, on construisit les Virtuosi de Mazarin, dont la première représentation eut lieu le 6 janvier 1916, le Roman d'Estelle (9 mars) et Carême prenant (16 avril), où les scénarios de M. Funck Brentano faisaient entrer des airs de danse et de chant de l'époque romantique et du temps de Louis XIII, et Une fête chez La Pouplinière, où la musique du début du dix-huitième siècle fut présentée par les soins de M. Henry Prunières (25 mai 1916).
Les ballets russes, sur la fin de décembre, furent de nouveau les hôtes de l'Opéra avec leur succès accoutumé : le 29 décembre, leur recette, pour une représentation au bénéfice de la Croix-Rouge britannique, était de 56.819 francs.

Vanni-Marcoux
Quant aux matinées, quelques chiffres en indiqueront le résultat financier :
|
12 décembre 1915 16 décembre 1915 26 décembre 1915 06 janvier 1916 20 janvier 1916 27 février 1916 09 mars 1916 30 mars 1916 13 avril 1916 16 avril 1916 25 mai 1916 25 juin 1916 |
Eugène Onéguine, Hamlet, le Cid Eugène Onéguine, Mademoiselle de Nantes, Patrie ! Mademoiselle de Nantes, Aïda, Guillaume Tell Samson et Dalila, les Virtuosi de Mazarin, Sigurd la Favorite, le Miracle, le Chant de la Cloche, les Virtuosi de Mazarin Œdipe à Colone, le Trouvère, Coppelia la Favorite, les Amants de Rimini, Roméo et Juliette, le Roman d'Estelle les Amants de Rimini, le Roi Arthus, Suite de danses l'Etranger, Coppelia Carême-prenant, Rigoletto Myrialde, Ossian, Roméo et Juliette, Une fête chez La Pouplinière Thaïs |
10.009 fr. 00 5.135 fr. 90 4.050 fr. 20 5.834 fr. 40 3.017 fr. 30 7.844 fr. 10 3.126 fr. 20 2.668 fr. 60 8.713 fr. 10 12.081 fr. 30 3.141 fr. 60 9.565 fr. 60 |
Ces chiffres indiquent avec toute la netteté désirable la préférence du public pour les représentations où on lui donnait un ouvrage complet, que cet ouvrage fût d'ailleurs l'Etranger, Rigoletto ou Thaïs. C'est pourquoi, après avoir terminé sur la représentation de Thaïs cette série de matinées, le directeur demanda et obtint la permission de rouvrir l'Opéra à l'automne pour des représentations du soir, pareilles à celles du régime normal, mais au nombre de trois seulement par semaine et fixées aux jeudi, samedi et dimanche, qui paraissaient des jours plus favorables que ceux de l'abonnement, d'ailleurs suspendu depuis le début des hostilités. Durant l'été, tenant enfin une promesse si souvent faite par les directeurs précédents, il supprimait les loges sur la scène.

Grisélidis. Rideau de scène
Le 4 novembre 1916, pour la première fois depuis le début de la guerre, l'Opéra jouait le soir. Le programme comprenait Briséis, sous la direction de M. Chevillard et avec mesdemoiselles Gall, Demougeot, messieurs Laffitte, Gresse, Lestelly dans les principaux rôles, et la Korrigane, que M. Widor avait consenti à venir diriger, et que dansèrent mademoiselle Zambelli, monsieur Albert Aveline, mesdemoiselles Léa Piron, Anna Johnsson, Jeanne Barbier. Ce programme fut très favorablement apprécié par la critique, mais beaucoup moins par le public. La recette qui était de 9.941 fr. 55 pour la première représentation, tomba ensuite, les 16, 25 novembre et 21 décembre à 5.126 fr., 4.912 fr. 60 et 2.904 fr. L'Etranger suivi de Coppelia ne fut guère mieux partagé, le 16 décembre, avec 5.805 fr. 40 de recette. Les autres soirées, où l'on jouait Roméo et Juliette, Guillaume Tell, Samson et Dalila, Thaïs, obtinrent des recettes de 6.000 à 12.000 francs, et Faust, le 12 novembre, prenait la tête avec 14.815 fr. 90. Le public de l'Opéra, privé de presque toute son élite, se montrait moins que jamais capable d'apprécier les œuvres nouvelles ou simplement récentes. La direction n'hésita cependant pas à lui proposer, le 10 janvier 1917, les Abeilles, de M. Stravinski, le 22 février une reprise de Messidor, le 7 avril Adélaïde ou le langage des fleurs, de M. Maurice Ravel, exécuté en 1912 à la saison de danse de mademoiselle Trouhanova sur la scène du Châtelet, et le 17 mai Prométhée, le drame lyrique de Jean Lorrain et Ferdinand Herold, avec musique de M. Gabriel Fauré, donné dix-sept ans plus tôt aux arènes de Béziers.
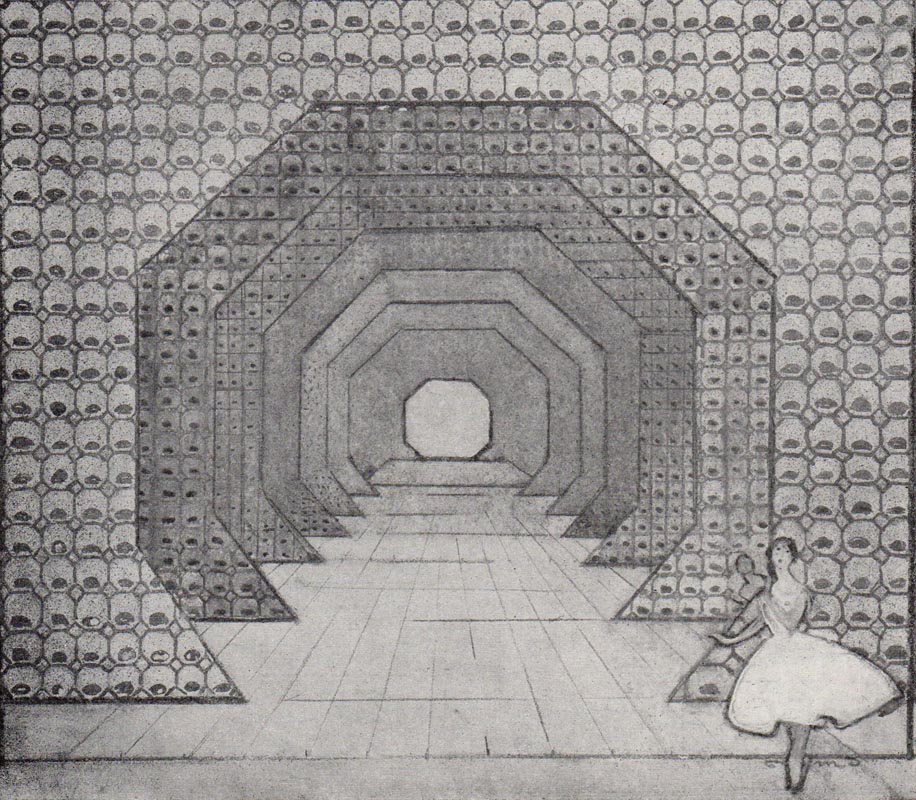
décor pour les Abeilles par M. Maxime Dethomas
Les Abeilles sont un ballet dont M. Stravinski avait adapté lui-même le scénario à une de ses compositions antérieures, intitulée Scherzo fantastique, mais déjà, comme l'indiquait le sous-titre, inspirée par la Vie des abeilles de M. Maeterlinck. Ce fut la première création, fort remarquable et significative, de la direction nouvelle. Le décor de M. Dethomas, d'une pureté géométrique et lumineuse, les costumes volontairement exempts de tout accessoire imitatif, les évolutions des danseuses représentant la reine, les ouvrières, les bourdons, réglées selon un tracé rigoureux d'arabesque, le scénario sans autre épisode que le vol nuptial terminé par la mort du mâle et la reprise du patient travail, tout concourait à l'harmonie de ce spectacle et justifiait cette déclaration du programme : « pas plus que la musique, la représentation scénique ne prétend à l'exacte imitation des formes ni des gestes, mais dans l'éclat de la ruche c'est par la figure humaine et les mouvements traditionnels de la danse qu'est cherchée l’évocation des sentiments ». Les Abeilles, dont la chorégraphie avait été réglée par M. Léo Staats, eurent mesdemoiselles Zambelli, Barbier, H. et J. Laugier, Schwarz pour interprètes principales. La première représentation fut une représentation de bienfaisance, donnée Pour le front, et produisit un bénéfice de 120.638 francs. Le 18 janvier avec Rigoletto, et le 27 avec Samson et Dalila, les Abeilles contribuaient pour leur part à d'honorables recettes de 7.287 fr. 50 et 7.692 fr. 30.
Les 22 février, 1er et 18 mars, Messidor, où cependant le ballet avait repris sa place en un décor de M. René Piot, n'atteignait que 5.140 fr. 30, 6.288 fr. 70 et 4.434 fr. 10. Les 7, 19 avril et 6 mai, Adélaïde ajouté à Samson et Dalila ou à Rigoletto donnait 10.534 fr. 70, 9.956 fr. 10 et 5.322 fr. 90. Le 17 mai, Prométhée, joué avec le concours d'artistes de la Comédie-Française, et suivi d'Une fête chez la Pouplinière, produisait 5.910 fr. 30. Le 31 mai, avec le même ouvrage, et le 16 juin, avec Adélaïde, les recettes de Prométhée étaient de 3.677 fr. 50 et de 2.575 fr. 10. La dernière représentation de cette saison avait lieu le 30 juin 1917 avec Faust, dont la recette fut de 12.512 fr. 60.
Durant l'été, le directeur commença à ses frais, la réfection de la machinerie, où rien n'avait été changé depuis 1875. La manœuvre s'y faisait au cabestan. A ces primitifs appareils on a substitué progressivement, en commençant par le côté cour, des treuils électriques et des équipes à contrepoids.

Mademoiselle Lapeyrette
L'Opéra rouvrait ses portes le 1er décembre, pour une représentation de Henry VIII, avec le concours de l'illustre baryton Battistini, qui produisait 16.415 fr. 30. Se rapprochant de plus en plus de son activité normale, il donnait quatre représentations par semaine, les mardi, jeudi, samedi et dimanche, en soirée. M. Maurice Renaud, qui venait de faire brillamment son devoir de soldat, allait revenir sur cette scène ainsi que mademoiselle Marthe Chenal, heureuse malgré tout de paraître en d'autres rôles que celui de la Marseillaise, sous d'autres costumes que le drapeau tricolore, et de reprendre sa place en une compagnie d'artistes qui comprenait alors mesdames L. Bréval, Demougeot, Bourdon, Borgo, Y. Gall, Campredon, Bugg, Berthon, Lapeyrette, Bonnet-Baron, Montazel, Laute-Brun, Arné ; messieurs Laffitte, Sullivan, Dubois, Noté, Lestelly, Couzinou, Delmas, Gresse, Huberty, Narçon.
Aux ouvrages du répertoire devaient s'ajouter Patrie !, de M. Paladilhe, Messidor, de M. Bruneau, Othello de Verdi, Monna Vanna de M. Février, enfin Castor et Pollux de Rameau, dont la première représentation à l'Opéra avait eu lieu le 24 octobre 1737, et qui n'y avait plus été joué depuis 134 ans : cette reprise était une véritable résurrection.

carte d'invitation pour la reprise de Castor et Pollux
Elle eut lieu le jeudi 21 mars 1918, en matinée, à cause des bombardements nocturnes, de plus en plus fréquents à cette époque. La révision de l'orchestre et l'instrumentation des récitatifs avait été confiée à M. Alfred Bachelet, chef d'orchestre désigné pour cet ouvrage. Les récitatifs étaient, au temps de Rameau, accompagnés par le clavecin et quelques instruments à cordes, qui pouvaient suivre le chanteur. L'orchestration leur a donné une rigidité qui certainement est un défaut. Mais les sons du clavecin sont bien maigres, dans la salle de l'Opéra. Le problème du récitatif dans l'ancien opéra est posé. Mais la solution est encore à trouver. C'est pourquoi, malgré le réel intérêt de la tragédie de Castor et Pollux, dont l'auteur est Gentil-Bernard, malgré le talent des artistes du chant qui furent pour les principaux rôles mesdemoiselles Lubin et Vallandri, messieurs Plamondon, Lestelly, Gresse, malgré même les accents pathétiques que Rameau a su trouver surtout dans les rôles des deux frères rivaux en générosité, les parties dramatiques parurent assez froides, faute d'une variété dans le mouvement dont les privait la baguette régulière du chef. Par contre, le spectacle, dont on n'avait pas commis la faute de rien retrancher, fut un enchantement. M. Drésa, d'accord avec M. Rouché, avait conçu décors et costumes dans le style du dix-huitième siècle, librement interprété, écartant avec raison le costume grec, aussi peu approprié aux déclarations amoureuses de la tragédie qu'aux menuets, gavottes et rigaudons de la danse. Chacun des actes, amenant ses entrées de ballet caractéristiques, en reçut sa couleur, rose pour les plaisirs qui au second acte ne peuvent amollir le courage du héros, blanche pour les ombres heureuses du quatrième, noire au premier avec de brusques échappées de vert et de rouge en appels de trompettes, fuligineuse devant l'entrée des Enfers, au troisième, éclatante de rayons dorés pour l'apothéose solaire qui termine l'ouvrage. On y applaudit tour à tour, en leurs costumes chamarrés, fanfreluchés, empanachés, mesdemoiselles Aïda Boni, Anna Johnsson, Jeanne Dumas, Schwarz, Lequien, M. Albert Aveline. Les bondissantes Furies conduites par mademoiselle Yvonne Daunt, au troisième acte, firent grand effet, de même que les authentiques lutteurs, marins entraînés par la méthode du commandant Hébert et conduits par un de ses moniteurs, dans les combats du premier acte.

décor pour Castor et Pollux par Drésa - Acte I. Le mausolée de Castor
Ce beau jour n'eut pas de lendemain. Le samedi 23 mars, au matin, le bombardement de Paris par l'artillerie à longue portée commençait. L'Opéra qui devait jouer ce soir là Rigoletto et Coppelia fit relâche. Les représentations reprirent le lendemain avec Faust, qui donnait 8.262 fr. 10 de recette. Mais dans la crainte d'une alerte et de l'encombrement que pouvaient produire, en se pressant aux portes, les robes à panier, on décida de ne plus donner Castor et Pollux. Le 25 mai, on mettait encore à la scène une œuvre nouvelle, Rébecca, de César Franck, sous la direction de M. Camille Chevillard, avec madame Bugg et monsieur Lestelly dans les deux rôles chantés. Accompagnée de Rigoletto, cette scène lyrique produisit 4.236 fr. 10 de recettes, qui tombèrent, le 6 juin, à 2.937 fr. Le 9 juin, l'Opéra donnait la dernière représentation de cette saison, avec Faust, qui n'atteignait que 6.337 fr. 10.
La réouverture eut lieu le 3 novembre 1918 avec Thaïs, qui produisit une recette de 24.650 fr. 25. Ce chiffre seul indique combien les temps étaient heureusement changés. Le 11 novembre, la Marseillaise était chantée, au balcon du foyer [en réalité en haut des marches de l'Opéra], par mademoiselle Chenal, devant une foule immense. Le 12 décembre, on donnait la deuxième représentation de Castor et Pollux, le 21 décembre la troisième, avec des recettes de 22.602 fr. 15 et de 21.412 fr. 95.
D'accord avec le ministre, la reprise de l'abonnement et le début du privilège régulier étaient fixés au 17 janvier 1919.
Depuis l'automne, grâce à l'initiative du directeur, une société coopérative et un restaurant coopératif à l'usage du personnel fonctionnaient à l'Opéra, ainsi qu'un service gratuit de consultations médicales.
Les sommes touchées par le personnel de l'Opéra, pendant la durée de la guerre, à titre d'appointements ou de cachets, sans compter les allocations sur la subvention, se sont élevées à 2.885.321 francs 95.

Mademoiselle Aïda Boni dans Castor et Pollux
IX
M. J. Rouché, Directeur de l'Opéra.
(17 janvier 1919)
C'est encore Castor et Pollux qui fut donné à cette soirée inaugurale du 17 janvier 1919, où la salle reprenait son éclat de jadis. La recette fut de 23.221 fr. 15. Alfred Capus, dans le Figaro du lendemain, appréciait en ces termes cet événement de la vie parisienne et française :
La reprise des abonnements à l'Opéra, c'est l'élégance parisienne retrouvant un de ses cadres préférés et affirmant par cette manifestation qu'elle se sait impérissable.
Le mot élégance est celui qui marque le mieux le caractère de cette rentrée. Car l'élégance n'est ni la frivolité, ni l'insouciance ; elle se combine merveilleusement en France, non seulement avec le plaisir, mais encore avec la tristesse et le deuil. Elle élève la joie au-dessus de la vulgarité : elle met dans la douleur la noblesse des lignes et une sorte d'apaisement. C'est ainsi que Paris est capable, au lendemain de la guerre, dans la secousse encore des plus tragiques bouleversements, de se livrer aux belles récréations de l'art. Tel est le prodige de l'élégance.
Mais il fallait, pour que ce dessein pût se réaliser, un cadre juste et un esprit délicat. Or, quel milieu plus approprié à ce renouveau que l'Académie Nationale de Musique et de Danse, avec ses souvenirs, son atmosphère et ses traditions ? Il ne reste qu'à l'animer, à le faire valoir, à le toucher de la baguette magique.
Je ne crois pas qu'aujourd'hui un homme y soit plus apte que M. Jacques Rouché. Il a, durant toute la guerre, à son poste et dans sa fonction, montré une volonté ferme. Certains, à ses débuts, le croyaient un peu timide et inégal, et au contraire, parmi les difficultés grandissantes, il s'est révélé, dans son coin, un vrai chef, énergique et équitable. Il s'est solidement maintenu, au milieu de la tempête, en attendant les jours meilleurs ; il n'a pas fléchi un instant, il s'est préparé au travail, il a prévu l'initiative qui allait s'imposer à tous les citoyens après la guerre. Il a fait son devoir et le public va l'en récompenser.
Le programme de la soirée contenait ce tableau commémoratif, plus éloquent que tous les discours :
| MORTS AU CHAMP D'HONNEUR MM. JENCK, ROUSSEAU, GIRARD, PORTET, LANGEVIN, DE FÉLICIS, LAMOURET, BAILLEUX, Artistes de l'Orchestre. CLAUDIN fils, Louis PONS, TRAMASSET, Oswald COTTEL, GILLET, Artistes des Chœurs. CRUCHET, Service de l'Habillement. VERRONS, Service du Contrôle. PICHOT, MAHYEUX, LE MENDUT, Pompiers civils.
BLESSÉS MM. BLANCHARD, Secrétaire de la Direction. MARNEFF, DUPUY, LIMONOT, GIBIER, Artistes de l'Orchestre. GAILLARD dit RAYNALD, BORGNET, COTTEL, RENAULT, Artistes des Chœurs. AVELINE, FRIANT, LEBLANC, PÉRICAT, FRAISSÉ, Artistes de la Danse. MONTBAZET, VILLEMINOT, BOUFFORT, MENUT, Service de l' Habillement. CHAPLIN, GUYOT, THOMAS, VALAT, Machinistes. SAMSON, BOISSY, CADIOT, BAILLY, LOURDIN, Service du Contrôle.
PRISONNIERS MM. HAMELIN, PRIEM, Artistes des Chœurs. BRIEU, VALAT, Machinistes.
LÉGION D'HONNEUR MM. Maurice RENAUD, Marius CHAMBON, Artistes du Chant. GAUCKLER, Artiste de l'Orchestre. GAILLARD dit RAYNALD, Artiste des Chœurs.
MÉDAILLE MILITAIRE MM. BORGNET, Artiste des Chœurs. MONTBAZET, Service de l'Habillement. BAILLY, LOURDIN, Service du Contrôle.
CROIX DE GUERRE MM. BLANCHARD, Maurice RENAUD, Marius CHAMBON, GAILLARD, BUISSON, MEUNIER, GIBIER, TUDESQ, BORGNET, CLAUDIN, PONS, MONTBAZET, E. RICAUX, GUYOT, THOMAS, BAILLY, LOURDIN, MARCHAIS, BOISSY, CADIOT, Léon MARIE, LAMOURET, F. GILLET, BOUFFORT.
|
M. Rouché avait constitué son administration ainsi qu'il suit :
MM.
Chef des études musicales : Camille Chevillard, décédé le 29 mai 1923.
Chef des services artistiques : Maxime Dethomas.
Secrétaire général : Louis Laloy.
Administrateur : Paul Blondot.
Chef de l'abonnement : Eugène Maillart.
Secrétaire de la direction : Blanchard.
Régisseur général : Merle-Forest, suppléé temporairement par Léo Devaux, puis Pierre Chereau (1922).
Régisseur de la scène : Reffet.
Maître de ballet : Léo Staats.
Régisseur de la Danse : Tisserand.
Chefs d'orchestre : Rühlmann, puis Ph. Gaubert, H. Büsser, G. Grovlez.
Chefs des chœurs : Leroux, Chadeigne.
Chefs de chant : Lauteman, Delacroix, Lepitre, Viseur, Mme Krieger.
Chef de l'habillement : Remion.

Madame Héglon
Le 11 novembre 1918, l'orchestre de l'Opéra se trouvait en grève, et sans un accord immédiatement intervenu, la représentation du lendemain n'aurait pas eu lieu. Il y eut encore quelques incidents de ce genre en 1919, et en 1920 une grève générale qui cette fois se heurta à une résistance énergique, la dernière limite des concessions ayant été atteinte. L'Opéra resta fermé du 12 octobre au 3 décembre. M. René Dumesnil (99) apprécie ainsi le régime institué après ce dernier conflit :
Les syndicats avaient pris l'habitude de conduire la direction. Les machinistes, par exemple, ne rêvaient que d'heures supplémentaires, et tout leur était prétexte pour les obtenir. Les musiciens rechignaient aux répétitions. Bref, un malaise général pesait sur l'Opéra. Une sorte de main noire venait sans cesse entraver tout le travail et prétendait substituer son autorité à celle des chefs de service responsables. La grève a eu pour heureuse conséquence de liquider la situation : il y avait pléthore de personnel dans certains emplois, encombrés d'incapables ou de gens vieillis qui ne voulaient pas prendre leur retraite et qu'on n'osait renvoyer ; et, naturellement, c'étaient ces inutiles et ces inutilisables qui avaient le moins bon esprit. La grève a permis d'éliminer les incapables et les mauvais éléments, soit 33 % de l'ancien personnel.
Ceux qui restent sont reconnaissants d'avoir été maintenus à leur poste ; les autres sont des jeunes qui n'ont été admis définitivement qu'après avoir donné des preuves de leur capacité et de leur bon vouloir. Enfin l'expérience a montré aux syndicalistes qu'il était préférable de travailler consciencieusement et en paix plutôt que d'écouter les beaux parleurs, et que le meilleur moyen d'améliorer leur position personnelle était de concourir à ce que la situation du théâtre s'améliorât elle-même. Désormais donc la bonne volonté règne, et la preuve, c'est que le directeur a pu obtenir, ô prodige incroyable, que les choristes consentissent le sacrifice de leurs moustaches ! Il n'a donc pas été vain de faire appel aux sentiments de dignité et d'amour du métier. L'ordre est rétabli dans les services, on est assidu aux répétitions, on donne un « coup de collier » quand il faut le donner.
La grève a produit les mêmes effets et permis d'atteindre les mêmes résultats en ce qui concerne le personnel de la danse. D'autre part, on a fait, aux examens de fin d'année, avancer d'une ou deux classes les élèves les mieux douées et les plus méritantes dont les progrès permettaient cet avancement. On a congédié toutes celles qui étaient insuffisantes. Et tout cela s'est fait par le moyen de concours dont la publicité est une garantie de justice, puisque chacune des candidates dispose de plusieurs cartes d'entrée et invite qui elle veut, et, puisque les abonnés assistent à ces épreuves. Evidemment ces réformes, qui s'imposaient, n'ont pu être réalisées sans causer quelques mécontentements parmi les sujets les plus intéressés au maintien des anciens errements. Mais ces récriminations étaient inévitables, et de ce côté-là aussi tout est rentré dans l'ordre à l'heure actuelle. Enfin, la caisse de retraites, dont le fonctionnement avait été interrompu sous la direction Gailhard, a été réinstituée, non sans difficultés, puisqu'il a fallu dès le début liquider plusieurs retraites pour lesquelles la direction a dû faire des avances.
(99) Le Correspondant, 15 avril 1924.
|
|
|
|
2e décor de la Flûte enchantée
|
6e décor de la Flûte enchantée
|
L'accroissement des charges était cependant considérable. Un choriste et un musicien qui gagnaient de 1.500 francs à 3.000 francs avant la guerre, en gagnent sous la direction actuelle, de 10.000 à 12.000. Le prix de toutes les matières premières s'est élevé de telles sorte qu'il faut prévoir 250.000 francs de frais pour un grand ouvrage inédit. Moins heureux que la Comédie-Française et l'Opéra-Comique, l'Opéra n'a obtenu aucune augmentation de la subvention. Elle a même été diminuée, puisque l'Etat, par le moyen des taxes sur les spectacles, reprend d'une main ce qu'il donne de l'autre.
Pour tenter d'équilibrer ce budget ruineux, il fallait à tout prix améliorer les recettes. Le prix des places a été augmenté, dans une proportion assez faible d'ailleurs. Les représentations sont plus fréquentes. L'Opéra joue les lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche en soirée, et depuis l'automne de 1921 les dimanches en matinée pendant l'hiver. Les abonnés des trois soirs sont revenus aussi nombreux qu'aux plus beaux jours, et pour gagner un autre public d'habitués, un nouvel abonnement a été institué en 1921. Il est établi par quinzaine, d'octobre à juin, pour les fauteuils d'orchestre et de balcon et donne droit, en seize soirées, à seize spectacles différents. Il a été recommandé par cette lettre, revêtue de signatures qui attestent les sympathies acquises à l'Opéra :
Un effort considérable vient d'être accompli par M. Jacques Rouché pour accroître l'activité artistique de l'Opéra, et maintenir aux représentations de ce théâtre leur éclat traditionnel.
La brillante saison du mois de juin a été la récompense de cet effort, d'autant plus méritoire qu'il fallait vaincre des difficultés matérielles sans précédent.
Admiratrices sincères des spectacles de l'Opéra, persuadées de leur importance pour la gloire de nos arts et le triomphe de notre goût, nous venons vous demander aujourd'hui de vous joindre à nous, en profitant des facilités que vous offrent les nouveaux abonnements qui viennent d'être créés.
Notre dessein est de nous grouper autour de la Direction afin d'assurer notre appui à toutes les manifestations d'art organisées à l'Opéra, et d'apporter à celles-ci le bénéfice de nouvelles adhésions parmi le public capable de les apprécier.
Nous serons particulièrement heureuses si vous voulez nous aider en cette tâche de patronage et de propagande dont l'intérêt ne saurait vous échapper.
Veuillez recevoir, Monsieur, l'assurance de nos sentiments les plus distingués.
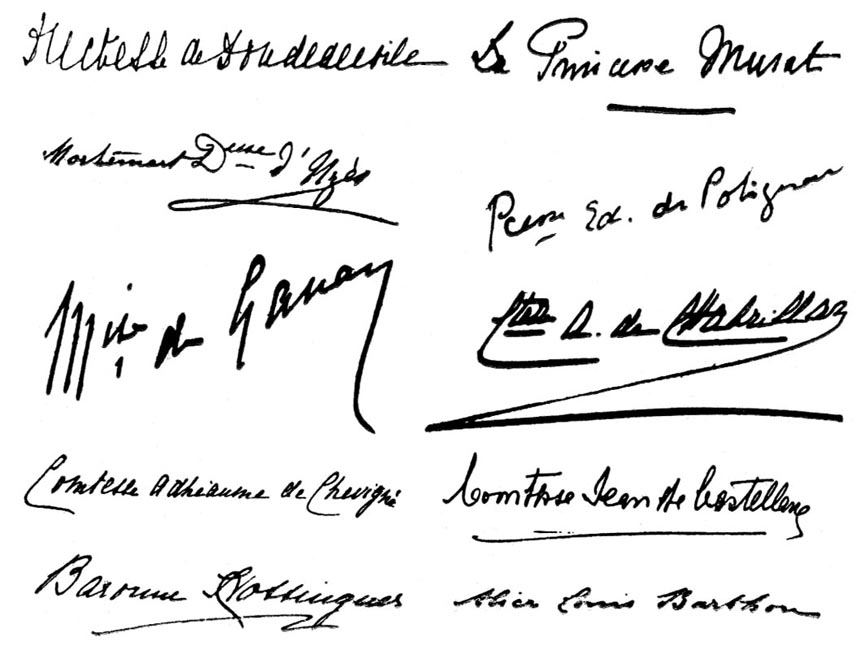
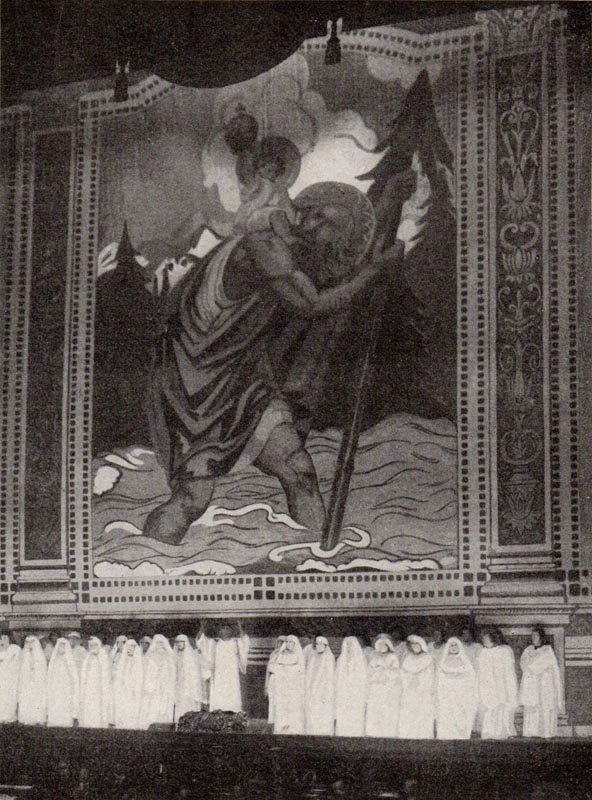
Légende de saint Christophe. - Décor pour le Prologue
Mais ce qui importait le plus, c'est d'enrichir le répertoire. Wagner en était exclu. Ce n'est que le 5 janvier 1921, que l'interdit enfin levé, la reprise de la Walkyrie, sous la direction de Camille Chevillard, fit reparaître sur l'affiche de l'Opéra ce nom glorieux. Il n'y eut aucun incident. Comme je descendais l'escalier, un peu avant le début du spectacle, attiré par une rumeur qui venait de l'entrée, un ami qui montait me dit au passage : « Rassurez-vous, ce ne sont que des amateurs qui réclament parce qu'il n'y a plus de places ». En effet, l'affluence du public dépassa toutes les prévisions et se traduisit par une recette de 35.977 francs. Depuis lors, les reprises de Siegfried (18 mars 1921), de Lohengrin (17 mai 1922), des Maîtres Chanteurs (5 mars 1923), de l'Or du Rhin (7 octobre 1921), de Parsifal (12 avril 1924), ont eu un pareil succès. Mais Wagner n'est plus seul à faire salle comble. Mozart et Moussorgski n'ont pas de moins fervents adeptes, et l'on a vu, au cours de ces dernières années, ce qu'on n'avait plus vu depuis bien longtemps à l'Opéra : un ouvrage nouveau y réussir d'emblée et demeurer au répertoire. La liste qui suit donnera une idée de l'effort accompli, et de ses résultats. Conformément au principe énoncé plus haut, on s'est attaché à réaliser dans chaque cas, la plus complète harmonie entre l'interprétation musicale, dramatique et scénique.

Décor de la Légende de saint Christophe
01 avril 1919 Représentation donnée par le syndicat de la presse pour les enfants des régions libérées. Monsieur Choufleuri restera chez lui le… ; Intermède (musiques de l'époque romantique). — La Tragédie de Salomé, ballet de M. Florent Schmitt sur un poème de M. Robert d'Humières, précédemment donné au Théâtre des Arts. Décors et costumes de M. René Piot. Mesdames Ida Rubinstein, Christine Kerf, Monsieur Georges Wague. Orchestre : M. Camille Chevillard.
|
01 avril 1919
|
Représentation donnée par le syndicat de la presse pour les enfants des régions libérées. Monsieur Choufleuri restera chez lui le… ; Intermède (musiques de l'époque romantique). — La Tragédie de Salomé, ballet de M. Florent Schmitt sur un poème de M. Robert d'Humières, précédemment donné au Théâtre des Arts. Décors et costumes de M. René Piot. Mesdames Ida Rubinstein, Christine Kerf, Monsieur Georges Wague. Orchestre : M. Camille Chevillard. |
|
|
04 avril 1919 07 avril 1919 16 avril 1919 06 juin 1919 16 juin 1919 20 juin 1919
|
Rigoletto, la Tragédie de Salomé Monna Vanna, la Tragédie de Salomé Rigoletto le Retour, de M. Max d’Ollone. Mme Lubin, MM. Gresse, Noël, Rambaud , Narçon. Orchestre : M. Rühlmann. — Coppelia le Retour, Coppelia Rébecca. — Hélène, poème lyrique de C. Saint-Saëns, donné à l'Opéra-Comique, le 18 janvier 1905. Mmes Demougeot, Bugg, Lapeyrette, M. Franz. Orchestre : M. Chevillard. — Coppelia |
24.047 fr. 05 24.529 fr. 38 26.058 fr. 25 16.126 fr. 75 12.785 fr. 50
15.794 fr. 85 |
|
30 juin 1919 01 juillet 1919
|
Rigoletto, Hélène Salomé, de M. Mariotte, sur le drame d'Oscar Wilde. Mmes Bréval, Lapeyrette, Courbières, MM. Gresse, Cerdan, Louis Marie, Narçon, Ezanno, Mlle Delsaux. Orchestre : M. Rühlmann. |
17.840 fr. 20
21.393 fr. 50 |
|
14 juillet 1919
|
Matinée gratuite. Fête triomphale, de M. Saint-Georges de Bouhélier, musique de M. Reynaldo Hahn. Mmes Chenal, Zambelli, MM. Gémier, Leitner, Bernard. Orchestre : M. Reynaldo Hahn. |
|
|
15 juillet 1919 25 juillet 1919 17 décembre 1919 |
Salomé, Fête triomphale Salomé, Fête triomphale Goyescas, drame lyrique d'Eduardo Granados (tué sur le Sussex, le 24 mars 1916), poème de Periquet, traduit par Louis Laloy. Mmes Chenal, Lapeyrette, MM. Laffitte, Cerdan, Mme Amalia Molina. Décors et costumes de MM. Maxime Dethomas et Zuloaga. Orchestre : M. Chevillard. — Salomé |
24.365 fr. 20 21.548 fr. 25
27.865 fr. 35 |
|
22 décembre 1919 26 décembre 1919 19 décembre 1919 29 décembre 1919 28 janvier 1920 09 juin 1920 |
Goyescas, Salomé « « Hélène. — Sylvia, de Léo Delibes (reprise). Mlles Zambelli, C. Bos, MM. Léo Staats, Albert Aveline. Décors et costumes de M. Maxime Dethomas. Orchestre : M. Camille Chevillard. Hélène, Sylvia Rébecca, Sylvia la Légende de Saint Christophe, de M. Vincent d'Indy. Mme Lubin, MM. Franz, Delmas, Rouard, Rambaud, Huberty, Narçon. Décors et costumes de M. Maurice Denis. Orchestre : M. Fr. Rühlmann. |
26.108 fr. 30 24.824 fr. 15 21.606 fr. 50 19.435 fr. 10 13.356 fr. 70
28.412 fr. 25 |
|
11 juin 1920 15 juin 1920 |
la Légende de Saint Christophe « |
39.418 fr. 85 23.314 fr. 35 |
Ensuite : de 17.000 à 21.000 fr.
|
10 juillet 1920 14 mars 1921 |
Rigoletto. — les Sept chansons, de M. Malipiero. Décors et costumes de M. Valdo Barbey. Orchestre : M. Rühlmann. Antar, drame lyrique de Gabriel Dupont (mort le 3 août 1914), poème de M. Chekri-Ganem. Mmes Fanny Heldy, Courso, MM. Franz, Rouard, Delmas, Noté, Rambaud, Mlles C. Bos, Y. Daunt, Delsaux. Décors et costumes de M. Dufrenne. Orchestre : M. Camille Chevillard. |
16.746 fr. 20
31.164 fr. 00 |
|
16 mars 1921 21 mars 1921 |
Antar « |
24.171 fr. 00 20.501 fr. 00 |
Ensuite : autour de 20.000 à 30.000 fr.
|
20 avril 1921 25 avril 1921 10 juin 1921 13 juin 1921 17 juin 1921 |
Rigoletto. — Maïmouna, ballet de M. Gabriel Grovlez, sur un scénario de M. André Gérard. Mlles Aïda Boni, Bos, Marthe Lequien, M. Ricaux. Orchestre : M. Grovlez. Monna Vanna, Maïmouna les Troyens, de Berlioz. Mmes Isnardon, Gozategui, MM. Franz, Rouard. Décors et costumes de M. René Piot. Orchestre : M. Ph. Gaubert. les Troyens « |
32.248 fr. 00 18.026 fr. 00 35.473 fr. 00 23.016 fr. 00 23.754 fr. 00 |
Ensuite : de 19.000 à 23.000 fr.
|
20 juin 1921
|
Daphnis et Chloé, ballet de M. Maurice Ravel, sur un scénario de M. Fokine, donné en 1911, au Châtelet. Mlles Zambelli, C. Bos, M. A. Aveline. Décors et costumes de M. Léon Bakst. Orchestre : M. Ph. Gaubert. — la Péri, de M. Paul Dukas, précédemment donnée au Châtelet. Décors et costumes de MM. René Piot. M. Léo Staats, Mlle J. Bourgat. Orchestre : M. Rühlmann. — Castor et Pollux |
31.996 fr. 00 |
|
22 juin 1921 24 juin 1921 19 novembre 1921 23 novembre 1921 05 décembre 1921
|
Daphnis et Chloé, la Péri, Castor et Pollux « « « Reprise d'Ascanio, sous la direction de M. Reynaldo Hahn. Sylvia. — Reprise de l'Enlèvement au sérail, sous la direction de M. Reynaldo Hahn. l'Heure espagnole, comédie musicale de M. Maurice Ravel, sur le poème de M. Franc-Nohain, précédemment donnée à l'Opéra-Comique. Mme Fanny Heldy, MM. Fabert, G. Dubois, Couzinou, Huberty. Décors et costumes de M. André Maré. Orchestre : M. Ph. Gaubert. — Daphnis et Chloé. — Taglioni chez Musette. Mlle Zambelli, M. Aveline. |
32.727 fr. 00 35.306 fr. 00 19.697 fr. 80 27.098 fr. 80
21.663 fr. 50 |
|
09 décembre 1921 16 décembre 1921 24 décembre 1921 30 janvier 1922
|
Rébecca, l'Heure espagnole, la Fête chez Thérèse « « « Hérodiade. Mmes Fanny Heldy, Charny, MM. Franz, Rouard, Journet. Orchestre : M . Ph. Gaubert. la Mégère apprivoisée, comédie musicale de M. Silver, sur le poème de MM. Cain et Adenis, d'après Delair, inspiré lui-même par Shakespeare. Mmes Chenal, Monsy, MM. Rouard, Rambaud, Huberty. Orchestre : M. Büsser. |
23.300 fr. 50 27.616 fr. 60 64.736 fr. 00
20.770 fr. 20 |
|
03 février 1922 06 février 1922 08 mars 1922
|
la Mégère apprivoisée « Boris Godounov de Moussorgski, traduction nouvelle de M. Louis Laloy. M. Vanni-Marcoux, Mmes Lubin, Lapeyrette, Courso, Laval, Montfort, MM. Dutreix, Fabert, Huberty, Rambaud, Soria, Dubois. Orchestre : M. Serge Koussevitzky. |
23.025 fr. 50 17.117 fr. 20
34.626 fr. 00 |
|
10 mars 1922 13 mars 1922 |
Boris Godounov « |
37.355 fr. 40 40.126 fr. 20 |
Ensuite : vers 45.000 fr.
|
03 avril 1922 07 avril 1922 12 avril 1922 28 avril 1922 01 mai 1922
|
Falstaff, de Verdi. M. Huberty, Mmes Lapeyrette, Allix, Arné, Laval, MM. Teissié, Rambaud, Dubois. Orchestre : M. Arturo Vigna. Falstaff « Falstaff. — Artémis troublée, ballet de M. Paul Paray. Mme Ida Rubinstein, M. Svoboda, Mlle Jasmine. Décors et costumes de M. Léon Bakst. Orchestre : M. Chevillard. Salomé, l'Heure espagnole, Artémis troublée. — Frivolant, ballet de M. Jean Poueigh, sur un scénario de M. Pierre Hortala. Mlle Johnsson, M. Léo Staats, Mlle Daunt, M. Ryaux. Décors et costumes de M. Dufy. Orchestre : M. Ph. Gaubert. |
19.698 fr. 00 23.829 fr. 80 23.385 fr. 00 25.819 fr. 30
21.667 fr. 00 |
|
31 mai 1922 19 juin 1922
|
Matinée de danses cambodgiennes, par les artistes du ballet de la Cour. le Martyre de Saint Sébastien, de Claude Debussy, sur le poème de Gabriele d'Annunzio. Mme Ida Rubinstein, Mmes Courso, Laval. Décors et costumes de M. Léon Bakst. Orchestre : M. Gaubert. |
11.517 fr. 00
26.134 fr. 70 |
|
20 juin 1922 21 juin 1922 27 octobre 1922 30 octobre 1922 06 novembre 1922 29 novembre 1922
|
le Martyre de Saint Sébastien « la Fille de Roland, de M. Henri Rabaud. Mmes Lubin, MM. Franz, Rouard, Delmas. Orchestre : M. Rühlmann. la Fille de Roland « Grisélidis, de Massenet, précédemment donnée à l'Opéra-Comique. Mmes Davelli, Haramboure, Laval, MM. Ansseau, Couzinou, Bordon, Narçon. Décors et costumes de MM. Legueult et Brianchon. Orchestre : M. Ph. Gaubert. |
15.002 fr. 00 18.820 fr. 90 22.952 fr. 20 20.160 fr. 60 21.620 fr. 90
31.421 fr. 60 |
|
04 décembre 1922 11 décembre 1922 22 décembre 1922 25 décembre 1922 27 décembre 1922 15 janvier 1923
|
Grisélidis « la Flûte enchantée de Mozart. Mmes Ritter-Ciampi, Monsy, Davelli, MM. Rambaud, Fabert, Huberty, Narçon. Décors et costumes de M. Drésa. Orchestre : M. Reynaldo Hahn. la Flûte enchantée « Paillasse. — Cydalise et le Chèvrepied, ballet en trois actes de M. Gabriel Pierné, sur le scénario de G. A. de Caillavet et de M. R. de Flers. Mlle Zambelli, M. Albert Aveline. Décors et costumes de M. Maxime Dethomas. Orchestre : M. Ph. Gaubert. |
26.752 fr. 40 25.183 fr. 60 42.651 fr. 90 40.435 fr. 60 45.136 fr. 00
27.659 fr. 80 |
|
17 janvier 1923 22 janvier 1923 13 avril 1923 18 avril 1923 23 avril 1923 01 juin 1923
|
Paillasse, Cydalise et le Chèvrepied l'Heure espagnole, Cydalise et le Chèvrepied la Khovanchtchina, de Moussorgski, traduction de M. Eugène d'Harcourt. Mmes Lyse Charny, Cros, Laval, MM. Goffin, Fabert, Huberty, Duclos. Orchestre : M. Koussevitzky. la Khovanchtchina « Padmâvati, opéra-ballet de M. Albert Roussel, sur un poème dramatique de M. Louis Laloy. Mlle Lapeyrette, MM. Franz, Rouard, Fabert, Narçon, Mlles Johnsson, Schwarz, Lorcia, J. Bourgat, M. G. Ricaux. Décors et costumes de M. Valdo-Barbey. Orchestre : M. Ph. Gaubert. — l'Heure espagnole |
27.090 fr. 80 29.430 fr. 30 36.274 fr. 60 33.553 fr. 20 34.151 fr. 90
32.232 fr. 20 |
|
06 juin 1923 13 juin 1923 31 octobre 1923
|
Padmâvati, l'Heure espagnole Padmâvati. — Chimères, de Mme Armande de Polignac. Exécution scénique de Mme Loïe Fuller. Orchestre : M. Ph. Gaubert. le Jardin du Paradis, comédie lyrique de M. Alfred Bruneau, sur le poème de G. A. de Caillavet et de M. R. de Flers. Mmes Fanny Heldy, Yvonne Gall, Lapeyrette, MM. Franz, Rouard, Fabert. Décors et costumes de M. Drésa. Orchestre : M. Ph. Gaubert. |
32.299 fr. 80 31.855 fr. 20
34.514 fr. 60 |
|
05 novembre 1923 09 novembre 1923 12 novembre 1923
|
le Jardin du Paradis « Fresques, de M. Ph. Gaubert, sous la direction de l'auteur. Mlles Y. Franck et A. Bourgat. — l'Enlèvement au sérail. — la Nuit ensorcelée, ballet de M. Léon Bakst, sur la musique de Chopin, choisie par M. Emile Vuillermoz et orchestrée par M. Louis Aubert. Mlle Zambelli, M. Léo Staats. Décors de M. Léon Bakst. Orchestre : M. Ph. Gaubert. |
30.983 fr. 00 33.920 fr. 00
29.262 fr. 10 |
|
21 novembre 1923 30 novembre 1923 01 décembre 1923 24 décembre 1923 |
Padmâvati, la Nuit ensorcelée « « Reprise de Sigurd, sous la direction de M. Fr. Rühlmann. Esclarmonde, de Massenet, donnée à l'Opéra-Comique, le 15 mai 1889. Mlle Fanny Heldy, MM. Franz, Rouard, Delmas. Orchestre : M. Ph. Gaubert. |
34.749 fr. 10 34.611 fr. 50 44.446 fr. 00 73.840 fr. 70 |
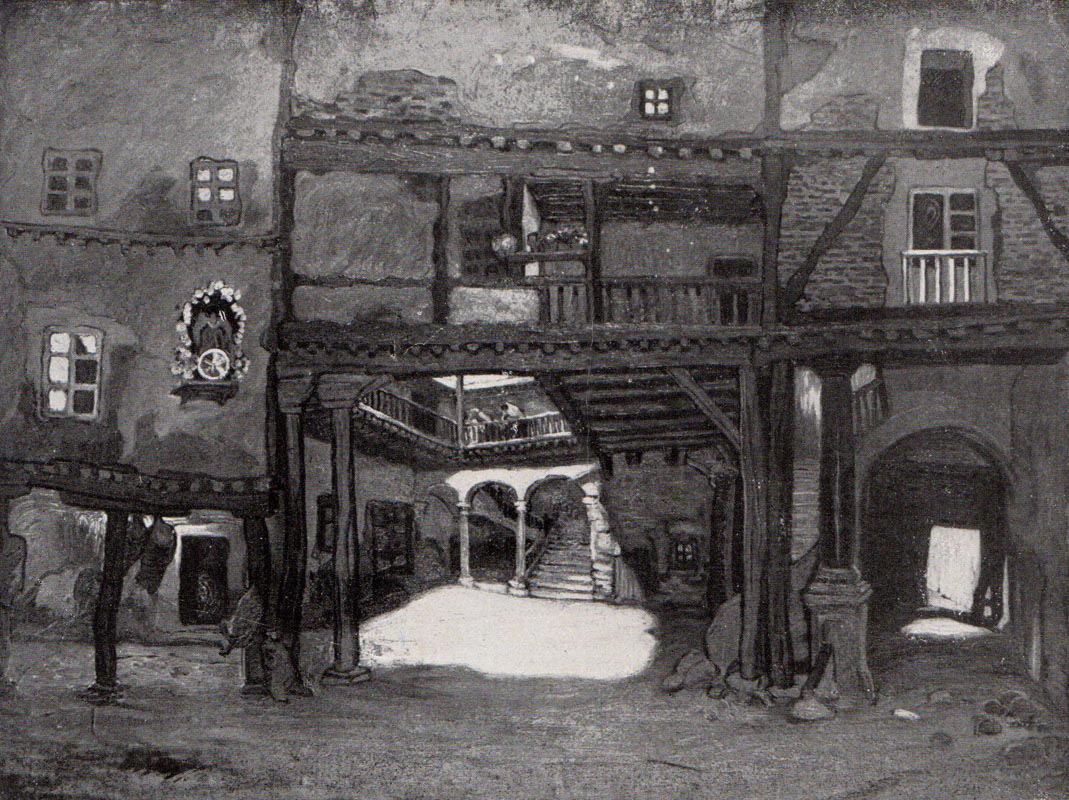
Goyescas. Décor
Les cinq premières années de la direction de M. J. Rouché ont donné, au total, les résultats suivants :
|
Années 1919 1920 1921 1922 1923 |
Total des recettes 4.404.068 fr. 60 5.528.443 fr. 30 6.926.453 fr. 80 7.770.489 fr. 40 9.145.453 fr. 10 |
Moyenne par représentation 23.057 fr. 95 25.359 fr. 83 25.653 fr. 53 26.340 fr. 64 31.645 fr. 10 |
Cette progression constante montre que l'intérêt artistique et les intérêts matériels ne sont pas aussi opposés qu'on le dit d'ordinaire, et que le public est moins sot qu'on ne croit. Si certains théâtres sont esclaves de la routine, ce n'est pas la faute du public, c'est celle de leurs directeurs. Un directeur artiste est sûr de réussir, s'il peut attendre, c'est-à-dire s'il a des ressources financières et de la patience. L'expérience tentée au théâtre des Arts a eu son plein succès à l'Opéra. Musiciens, poètes, peintres, artistes du chant et de la danse travaillent aujourd'hui à l'envi pour ce théâtre, sûrs d'y trouver devant un public assidu et choisi la récompense de leurs efforts, et l'Opéra est redevenu, après la guerre de 1914, ce qu'il était avant celle de 1870, la scène d'élection où la musique unie à la poésie et aux arts du théâtre se manifeste, sous des formes appropriées au goût du temps et au talent des auteurs, avec le plus d'éclat, de puissance, et de variété. Sans préjuger de ce que l'avenir nous réserve, on peut affirmer, sur les exemples qui précèdent, la renaissance de ce genre qu'on croyait sur le point de disparaître après deux siècles de gloire, mais dont l'existence n'est plus menacée aujourd'hui.
Louis LALOY.

décor pour Padmâvâti par Baldo Barbey