
THÉÂTRE-LYRIQUE

le Théâtre-Lyrique vers 1871
Le Théâtre-Lyrique occupa une première salle (boulevard du Temple) de 1852 à 1862, puis la seconde (place du Châtelet) de 1862 à 1871. Ce nom fut repris par la suite : le Théâtre-Lyrique-National, installé 17 rue Scribe (d'abord appelé Athénée en 1866, puis Théâtre-Lyrique le 11 septembre 1871), de mars à juin 1872 ; le Théâtre-National-Lyrique (appelé aussi Opéra-National-Lyrique ou Théâtre-Lyrique-National) installé au théâtre de la Gaîté du 05 mai 1876 au 02 janvier 1878 ; le Théâtre-Lyrique installé au théâtre du Château-d'Eau du 13 octobre 1888 au 05 mars 1889 ; celui installé à l'Eden-Théâtre par Henry Verdhurt durant l'année 1890 ; celui installé au théâtre de la Renaissance de janvier à mars 1893. Les frères Milliaud installent leur Théâtre-Lyrique à la Porte-Saint-Martin en 1897, aux Variétés en 1898, puis à la Renaissance de mars 1899 à mars 1900.
|
salles |
directeurs |
||
| 1847 | 15 novembre | Inauguration de l'Opéra-National (salle du Cirque Olympique, 66 boulevard du Temple) |
15/11/1847 - 29/03/1848 — Adolphe ADAM et Achille MIRECOUR |
| 1848 | 29 mars | Fermeture de l'Opéra-National | |
| 1851 | 27 septembre | Réouverture de l'Opéra-National (salle du Théâtre-Historique, 72 boulevard du Temple) |
27/09/1851 - 28/02/1852 — Edmond SEVESTE |
| 1852 | 01 mars |
01/03/1852 - 30/06/1854 — Jules SEVESTE |
|
| 12 avril | L'Opéra-National devient Théâtre-Lyrique | ||
| 1854 | 26 juillet |
26/07/1854 - 26/09/1855 — Emile PERRIN |
|
| 1855 | 26 septembre |
26/09/1855 - 20/02/1856 — Pierre PELLEGRIN |
|
| 1856 | 20 février |
20/02/1856 - 01/04/1860 — Léon CARVALHO |
|
| 1860 | 01 avril |
01/04/1860 - 04/10/1862 — Charles RÉTY |
|
| 1862 | 31 mai | Démolition du Théâtre-Lyrique du boulevard du Temple | |
| 07 octobre |
07/10/1862 - 04/05/1868 — Léon CARVALHO |
||
| 30 octobre | Réouverture du Théâtre-Lyrique (salle de la place du Châtelet, à l'emplacement de l'actuel Théâtre de la Ville) | ||
| 1868 | 01 septembre | Reprise des spectacles le 24 octobre 1868 |
01/09/1868 - 01/02/1870 — Jules PASDELOUP |
| 1870 | 01 février |
01/02/1870 - 31/05/1870 — les Artistes en Société |
|
| 01 juin |
01/06/1870 - 06/06/1872 — Louis MARTINET |
||
| 1871 | 24 mai | Incendie du Théâtre-Lyrique de la place du Châtelet |
|
Administration du Théâtre-Lyrique (alors Opéra-National) au 1er janvier 1852
Edmond SEVESTE, directeur GRIGNON père, régisseur général FOSSE, régisseur Arsène MICHOT dit ARSÈNE, régisseur (Pontoise, Seine-et-Oise, auj. Val-d'Oise, 21 décembre 1820 - Paris 5e, 22 juillet 1870* ; enterré au cimetière de Pontoise) RÉJUS, contrôleur en chef GRIMAUDE, secrétaire général
Pierre-Joseph-Alphonse VARNEY, 1er chef d'orchestre (Paris, 01 décembre 1811 - Paris, 07 février 1879) Auguste Francisque PLACET, 2e chef d'orchestre (15.Les Ternes, 14 octobre 1816 - décembre 1888) Philippe HOSTIÉ, 3e chef d'orchestre
Louis Joseph Arnaud CROHARÉ, chef du chant et accompagnateur (Paris, 27 février 1820 - Paris, 21 janvier 1895) TARIOT, directeur des chœurs Jules TARIOT, accompagnateur
|
Administration du Théâtre-Lyrique au 1er janvier 1853
Jules SEVESTE, directeur GRIGNON père, régisseur général ARSÈNE, régisseur RÉJUS, contrôleur en chef GRIMAUDE, secrétaire général
Auguste Francisque PLACET, 1er chef d'orchestre Philippe HOSTIÉ, 2e chef d'orchestre
Louis Joseph Arnaud CROHARÉ, chef du chant et accompagnateur TARIOT, directeur des chœurs Jules TARIOT, accompagnateur
|
Administration du Théâtre-Lyrique en 1855
GRIGNON père, régisseur général QUINCHEZ, régisseur général ARSÈNE, régisseur général
Adolphe DELOFFRE, 1er chef d'orchestre LIBERT, 2e chef d'orchestre Charles BUZIAU, 3e chef d'orchestre
|
Administration du Théâtre-Lyrique en 1863
Léon CARVALHO, directeur DELORE, secrétaire de l'administration [en 1864] ARSÈNE, régisseur général
Adolphe DELOFFRE, 1er chef d'orchestre Charles BUZIAU, 2e chef d'orchestre SARRAZIN, 3e chef d'orchestre
Léo DELIBES, chef du chant Hector SALOMON, chef du chant BOUSQUET, chef des chœurs BLEUZE, chef des chœurs [en 1864]
|
Administration du Théâtre-Lyrique en 1865
Léon CARVALHO, directeur DELORE, secrétaire de l'administration Jules RUELLE, secrétaire [en 1867] ARSÈNE, régisseur général
Adolphe DELOFFRE, 1er chef d'orchestre Edouard MANGIN, 2e chef d'orchestre SARRAZIN, 3e chef d'orchestre BLANC, chef d'orchestre [en 1867]
BLEUZE, chef du chant Hector SALOMON, chef des chœurs
MANGIN et REMBIELINSKI, accompagnateurs [en 1867]
Les choeurs comprennent jusques à 100 artistes, ténors, sopranes et basses. |
=> Œuvres représentées au Théâtre-Lyrique
=> Artistes du chant du Théâtre-Lyrique

une représentation à l'Opéra-National en 1847
|
Histoire du Théâtre-Lyrique
En 1847, Adolphe Adam obtint avec Achille Mirecour*, le privilège d'un théâtre qui prendrait le titre d'Opéra-National. Ce théâtre s'établit à Paris sur le boulevard du Temple, dans la salle de l'ancien Cirque-Olympique ; le 15 novembre 1847, il ouvrait ses portes. La révolution de 1848 l'obligea à les fermer, après quatre mois d'existence.
En 1851, Edmond Seveste, alors directeur des petits théâtres de la banlieue, obtint un nouveau privilège de l'exploitation de l'Opéra-National, loua la salle du Théâtre-Historique pour y jouer des opéras, et en fit l'ouverture le 27 septembre 1851 par Mosquita la sorcière de Boisselot. Après la mort d'Edmond Seveste, le 28 février 1852, son frère Jules obtint le privilège et donna à l'Opéra-National le nom de Théâtre-Lyrique ; mais il ne tarda pas à mourir à son tour, le 30 juin 1854, et Emile Perrin, déjà directeur de l'Opéra-Comique, eut l'idée de réunir dans ses mains la direction des deux grandes scènes lyriques secondaires et obtint le privilège devenu vacant du Théâtre-Lyrique ; mais cet administrateur ne tarda pas à s'apercevoir qu'il était impossible de mener de front deux entreprises de ce genre, et, à la fin de la saison de 1855, il abandonna le Théâtre-Lyrique à Pierre Pellegrin, ancien directeur du Grand-Théâtre de Marseille. Celui-ci culbuta au bout de peu de temps, dut donner sa démission le 20 février 1856, et enfin le Théâtre-Lyrique, dont l'existence avait été jusqu'alors fort tourmentée, tomba entre les mains de Léon Carvalho, ex-artiste secondaire de l'Opéra-Comique et mari de Mme Miolan-Carvalho, qui devait l'élever à un degré inouï de prospérité artistique, sinon financière.
La première période directoriale de Carvalho,
qui s'étendit du 20 février 1856 au mois d'avril 1860, a été certainement un
coup de fortune pour le Théâtre-Lyrique, dont cet administrateur a fait
immédiatement connaître le chemin à la foule, et un grand bonheur pour
l'avenir de l'art musical en France. C'est avec lui que le Théâtre-Lyrique
devint le rival de l'Opéra et de l'Opéra-Comique. En effet, dans l'espace de
quatre années, Carvalho a trouvé le moyen de produire avec éclat quelques
ouvrages de compositeurs avantageusement connus déjà, tels que la
Fanchonnette de Clapisson ; la Reine Topaze et la Fée
Carabosse de Victor Massé ; les Dragons de Villars de Maillart ;
le Médecin malgré lui et Faust de Gounod ; de faire applaudir
plusieurs partitions de musiciens encore inconnus, entre autres les Nuits
d'Espagne et la Demoiselle d'honneur de Semet ; Broskovano
et les Petits violons du roi de Deffès ; enfin, de faire admirer au
public un certain nombre des grands chefs-d'œuvre dramatiques de l'école
allemande, inconnus jusqu'ici chez nous ou inintelligemment représentés :
Oberon, Euryanthe, Preciosa, de Weber ; les Noces de
Figaro et l'Enlèvement au sérail, de Mozart ; Orphée, de
Gluck, etc. Au bout de quatre années, cependant, Carvalho céda son exploitation à Charles Réty, son secrétaire ; mais celui-ci fit de mauvaises affaires et donna sa démission le 4 octobre 1862. Pendant ce temps, un grand changement se préparait dans l'existence de tous les théâtres situés sur le boulevard du Temple. Tous ces théâtres étaient expulsés pour faire place au boulevard du Prince-Eugène, et on construisit, place du Châtelet, deux salles nouvelles, placées l'une en face de l'autre. Ces salles étaient destinées au Théâtre-National, qui prenait le nom de théâtre du Châtelet, et au Théâtre-Lyrique. La nouvelle salle du Théâtre-Lyrique fut inaugurée le 30 octobre 1862, jour où Carvalho, succédant à son tour à son successeur, reprenait la direction de ce théâtre. Peu de temps après, une subvention annuelle de 100.000 francs lui était accordée, et cet établissement prenait le titre de Théâtre-Lyrique impérial. Carvalho resta cette fois près de six ans à la tête de son administration ; mais ses affaires s'embrouillèrent, et au commencement de 1868 il fut déclaré en faillite et contraint d'abandonner l'entreprise. Ce fut Jules Pasdeloup, l'heureux fondateur des concerts populaires, qui lui succéda. Mais, au mois de février 1870, obligé de renoncer à l'entreprise, il donna sa démission et laissa ses artistes terminer la saison en société. Louis Martinet**, directeur du théâtre de l'Athénée, était désigné pour succéder à Pasdeloup ; pendant qu'il organisait sa troupe, la terrible guerre de 1870 éclata et les artistes furent eux-mêmes obligés de fermer les portes du théâtre. Le 24 mai 1871, le monument était en partie incendié et la salle complètement détruite.
Lorsqu'on le remit en état en 1874, il servit
successivement à plusieurs théâtres, jusqu'au jour où l'Opéra-Comique vint
s'y installer, après le terrible incendie de la salle Favart en 1887 ; il y
resta onze ans et demi environ. En 1899, Sarah Bernhardt loua l'immeuble qui
devint le théâtre Sarah-Bernhardt. Parmi les chanteurs qui se sont distingués au Théâtre-Lyrique, nous citerons MM. Monjauze, Léon Achard, Puget, Colson, Grignon, Bouché, Chollet, Meillet, Michot, Junca, Rousseau de Lagrave, Pujol, Ribes, Dulaurens, Prilleux, Ismaël, Lutz, Depassio, Troy, Wartel, Fromant, Barré ; Mmes Marie Cabel, Colson, Miolan-Carvalho, Duprez, Marimon, Ugalde, de Maësen, Marie Sax, Nilsson, Deligne-Lauters (devenue Mme Gueymard), Rouvray, Vadé, Meillet, Daram, Girard, Bourgeois, Garnier, Pannetrat, etc.
***
*Achille Tranchant dit Achille Mirecour, acteur de l'Odéon, frère du comédien Adolphe Tranchant dit Mirecour (14.Condé-sur-Noireau, 06 septembre 1806 – Paris, 01 mars 1869).
**Louis Martinet (75010.Paris, 19 mars 1814 – 78.Le Vésinet, 05 janvier 1895), peintre. Cette semaine est mort au Vésinet, à l'âge de 82 ans, un brave et excellent homme qui avait bien tout le tempérament d'un artiste, et qui en avait donné plus d'une preuve. Je veux parler de Louis Martinet, cet ancien élève de Gros, devenu plus tard inspecteur des Beaux-Arts, peintre non sans talent et dessinateur très habile, qui, plus tard encore ouvrit dans le local où se trouvent aujourd'hui les Nouveautés, une exposition de peinture et de musique à laquelle il substitua ensuite un théâtre, le gentil théâtre des Fantaisies-Parisiennes, qui rendit de véritables services. C'est là qu'il remonta d'anciens ouvrages lyriques : le Calife de Badgad, le Nouveau Seigneur et la Fête du village voisin, de Boieldieu, les Rosières et le Muletier, d'Herold, l'Arbre enchanté, de Gluck, le Sorcier, de Philidor, le Maître de chapelle, de Paer ; c'est là qu'il monta des ouvrages inédits de Duprato, de MM. Deffès, Jonas, Delandres et bien d'autres ; c'est là qu'on vit commencer nombre d'artistes, comme M. Engel, le "ténor terre-neuve", M. Barnolt, de l'Opéra-Comique, Mlle Arnaud, qu'on vit plus tard à l'Opéra.
A la retraite de Pasdeloup, Martinet s'empara
du Théâtre-Lyrique : mais la Commune lui brûla son théâtre, qu'il dut
transporter dans la salle de l'Athénée, aujourd'hui disparue. Il
voulut faire grand dans cette salle mignonne, monta les Brigands (i
Masnadieri) de Verdi, une Folie à Rome, de Ricci, mais il avait
trop présumé de ses forces, et dut passer la main. Malgré tout, depuis vingt
ans il n'avait cessé de rêver la résurrection de son théâtre, et on se
rappelle qu'il y a quelques semaines il avait donné de la publicité à un
projet en ce sens. Comme j'avais été mêlé très étroitement naguère à son
affaire des Fantaisies-Parisiennes, il m'écrivait, il y a peu de
temps encore, pour me prier de l'aller voir afin de lui fournir quelques
dates qu'il avait oubliées et dont il avait besoin pour la rédaction de ses
Mémoires, qu'il avait entrepris d'écrire. Il était toujours vert,
toujours droit, toujours souriant, en dépit de son âge, et je ne me doutais
pas, hélas ! que je le voyais pour la dernière fois. (Arthur Pougin, le Ménestrel, janvier 1895)
|
|
Opéra-Populaire
Nous groupons sous ce titre toutes les documents relatifs à la question du Théâtre-Lyrique, c'est-à-dire d'une scène plus accessible et au public et aux jeunes compositeurs que celle du Grand-Opéra ou de l'Opéra-Comique. On se plaint amèrement qu'il ne soit pas permis, à un public de ressources modestes, de jouir des satisfactions données par le grand art musical. D'autre part, on se désespère que les auteurs d'opéras soient obligés de les garder indéfiniment dans leurs cartons : « Pas de Théâtre-Lyrique, pas de musique dramatique en France ! » Ainsi M. Victorin Joncières formule sa conclusion. Ces doléances reposent donc sur ces deux aphorismes : ‑ Il y a, à Paris, un public nombreux qui souffre de ne pouvoir satisfaire ses goûts musicaux. ‑ Il y a, en France, nombre de compositeurs de talent prêts à enfanter des chefs-d'œuvre. Ce fut cette double idée qui présida à la création, en 1851, du Théâtre-Lyrique du boulevard du Temple, ancien Théâtre-Historique, sous la direction de M. Edmond Seveste, qui fit jouer Mosquita la sorcière, de Boisselot ; la Perle du Brésil de Félicien David, et mourut l'année suivante. Son frère lui succéda, et après lui M. Perrin, alors directeur de l'Opéra-Comique (1854), et M. Pellegrin, ancien directeur du théâtre de Marseille. Ce dernier fit de mauvaises affaires et fut remplacé, le 20 février 1856, par M. Carvalho. Dès lors le Théâtre-Lyrique était fondé dans les meilleures conditions possibles : M. Carvalho, dont l'intelligence et l'habileté administrative sont hors de pair, fit jouer la Fanchonnette, de Clapisson ; les Dragons de Villars, de Maillart ; Oberon, Euryanthe, de Weber ; le Médecin malgré lui, Faust, Philémon et Baucis, de Gounod ; les Noces de Figaro, de Mozart ; les Troyens de Berlioz. Par suite de la démolition du boulevard du Temple, le théâtre avait été transporté au Châtelet. En 1868, M. Carvalho faisait faillite. Vinrent la guerre, la Commune. Le Théâtre-Lyrique disparut et pendant plusieurs années on s'efforça en vain de le faire revivre. En 1874 et en 1875, l'Assemblée nationale, sur la proposition du comte d'Ormoy, vota une subvention pour sa réorganisation. Il rouvrit d'abord à la salle Ventadour. Échec complet. M. Arsène Houssaye fut nommé directeur avec 100,000 francs de subvention, mais n'ayant pu trouver de salle disponible, il donna sa démission et le titre ; échut à M. Campocasso, ancien directeur de la Monnaie de Bruxelles, qui se désista également peu de temps après. Enfin, M. Vizentini ayant pris, après la mort d'Offenbach, le théâtre de la Gaîté, posa sa candidature et fut agréé (1875). L'existence du Théâtre-Lyrique semblait assurée. Le 5 mai 1876, il ouvrait ses portes avec la première représentation de Dimitri, de M. Victorin Joncières. Pour le lendemain, M. Vizentini monta le Bourgeois gentilhomme, avec musique de Lully. Vinrent ensuite les Erinnyes, de M. Leconte de Lisle (15 mai) ; avec musique de Massenet ; le Magnifique, musique de M. Philippot ; Oberon, de Weber. La subvention fut portée à 300,000 francs. Le 12 octobre, on reprend la Giralda, d'Adolphe Adam et, le 5 novembre, la toile se lève sur la première représentation de Paul et Virginie, de M. Victor Massé, chanté par Capoul et Mlle Ritter. L'année se ferme sur une reprise du Barbier de Séville, de Rossini. Paul et Virginie réalisa, pendant les vingt-cinq premières représentations, une moyenne de 11,000 francs de recettes. Cependant, dès les premiers jours de 1877, il fallut accorder au Théâtre-Lyrique une avance sur la subvention. Après une reprises de Martha, de Flotow, M. Vizentini donna, le 13 février, le Timbre d'argent, opéra fantastique en 4 actes et 8 tableaux, de M. Camille Saint-Saëns ; le 18 avril, le Bravo, opéra en 3 actes et 4 tableaux, de M. Salvayre ; le 13 septembre, Graziella, drame lyrique en 2 actes, de M. Antony Choudens, l'Aumônier de régiment, de M. Hector Salomon ; le 14 septembre, la Clé d'or, comédie lyrique en 3 actes, de M. Eugène Gautier, et reprit, le 7 novembre, Si j'étais roi !, d'Adam. Mais déjà les plus sinistres nouvelles circulaient. L'entreprise succombait sous les frais, et les dettes, et M. Vizentini se décida à reprendre... Orphée aux Enfers, d'Offenbach ! mais M. Vizentini était réduit aux dernières extrémités. Gilles de Bretagne, de M. Henri Kowalski, lui porta le dernier coup. Il essaya en vain d'obtenir encore l'aide du gouvernement, et donna, le 1er janvier 1878, sa démission de directeur du Théâtre-Lyrique. L'entreprise avait reçu de l'État la modique somme de quatre cent soixante-dix-sept mille francs ! et les recettes réalisées avaient été de 1,400,000. francs. La Gaîté était rendue à la féerie et à l'opérette. Loin de se décourager, les partisans du Théâtre-Lyrique, plus intrépides que jamais, réclamèrent le maintien de la subvention de 200,000 francs. M. Léon Escudier obtint la direction à la salle Ventadour. Le 18 avril 1878, le théâtre ouvrait par une ode symphonie en trois parties, paroles de M. Alexandre Parodi, musique de M. Samuel David. Insuccès complet. Le 2 juillet, première représentation du Capitaine Fracasse, opéra-comique en 3 actes et 6 tableaux, de M. Catulle Mendès, musique de M. Émile Pessard, Dès ce moment, on ne parle déjà que de la déplorable situation contre laquelle se débat le directeur du Théâtre-Lyrique, qui monte Aïda, de Verdi, en langue française. M. Escudier remettait, le 1er septembre, sa démission de directeur entre les mains du ministre. Cette tentative avait duré cinq mois. M. Capoul loua aussitôt la salle Ventadour et donna, le 12 octobre, les Amants de Vérone, de M. le marquis d'Ivry. 28 représentations après lesquelles la salle Ventadour est démolie et cédée à une société financière. Pendant les premiers mois de 1879, un impresario américain, M. Maurice Grau, donna une série de représentations populaires des Amants de Vérone ; puis M. Kowalski donna encore quelques représentations de son Gilles de Bretagne. La Gaîté rouvre ses portes sous le titre d'Opéra-Populaire sous la direction de MM. Husson et Martinet, qui eux-mêmes cédaient à M. Merelli la salle trois fois par semaine, du 14 février au 5 mai 1880, pour les représentations d'Adelina Patti. La subvention de 200,000 francs était supprimée. La nouvelle direction débuta par une reprise de Guido et Ginevra, d'Halévy, puis donnait Lucie de Lammermoor, Rita, de Donizetti et remontait Paul et Virginie, de Victor Massé. L'année clôturait sur une reprise du Farfadet, d'Adolphe Adam. En 1880, le 11 février, était exécuté, pour la première fois à Paris, Pétrarque, opéra en 5 actes et 6 tableaux de M. Hippolyte Duprat. Puis, c'en était fait, encore une fois de l'Opéra-Populaire, MM. Husson et Martinet se retiraient et une direction nouvelle reprenait le drame du Courrier de Lyon. Notons enfin, en 1884, une dernière tentative au théâtre du Château-d'Eau, également infructueuse. L'expérience n'était-elle pas faite et décisive ? Depuis la direction Carvalho jusqu'à celle de M. Vizentini, les plus louables et les plus courageux efforts ont été faits pour ouvrir au public et aux compositeurs cet eldorado tant vanté d'un Théâtre-Lyrique. La faillite a brisé toutes les espérances ; en vain on a prodigué l'argent, les subventions. Le conseil municipal lui-même s'était laissé fléchir, en 1884, et avait accordé un subside important. Toutes ces sommes ont été dépensées en pure perte. Qu'en faut-il conclure, sinon la vérité, c'est-à-dire que les Parisiens ne sont pas musiciens ; que l'Opéra, l'Opéra-Comique et les théâtres d'opérettes leur suffisent ? L'Opéra les attire par le luxe du bâtiment et de la mise en scène. Et encore voyons-nous aujourd'hui que, malgré l'énorme subvention, l'Académie nationale de musique est en perte. Il est singulier que Paris tienne avant tout à des apparences de dilettantisme que rien ne justifie. Il faut cependant bien se rendre à l'évidence : il n'y a pas de public pour un Opéra-Populaire. Toutes les entreprises ont échoué et selon toutes apparences échoueront encore. Le peuple n'ira jamais entendre ‑ par simple dilettantisme – les opéras, s'appelleraient-ils les Huguenots, Guillaume Tell ou les Noces de Figaro. On ne peut tout avoir. Nous ne sommes pas des rêveurs, et le moindre grain de bon sens et de gaîté nous plaît mille fois mieux que la plus savante des harmonies. Ainsi sommes-nous faits. Il faut en prendre son parti... ce qui n'empêchera pas qu'on revotera des subventions, qu'on refondera des Théâtres-Lyriques et qu'il y aura encore de beaux jours pour les syndics de faillite.
(Jules Lermina, Dictionnaire universel illustré de la France contemporaine, 1885)
|
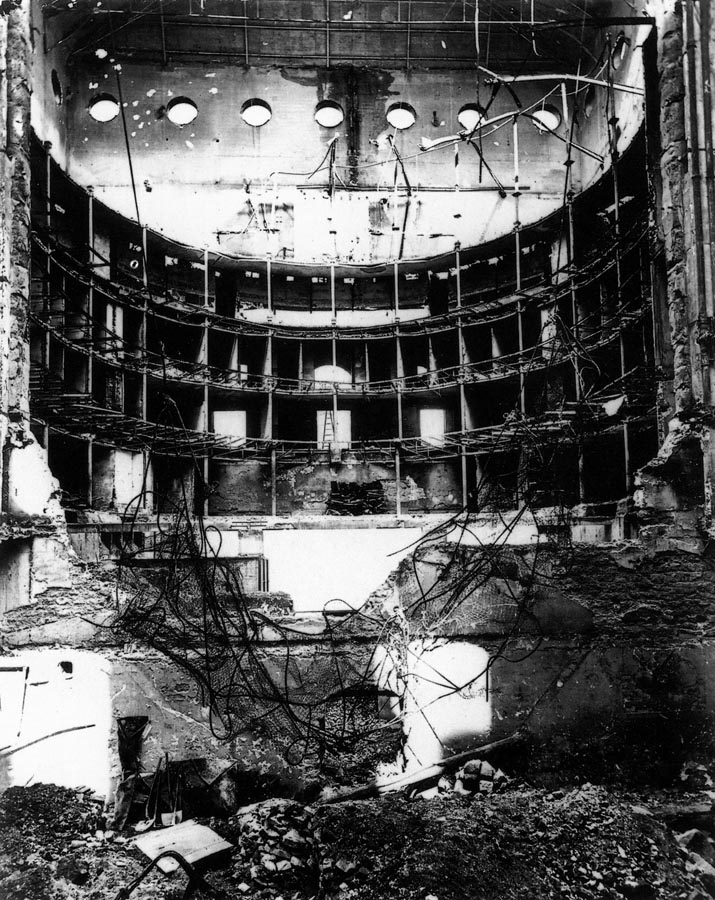
le Théâtre-Lyrique incendié par les Communards, photo d'Alphonse Liébert, 1872
|
Mémorial du Théâtre-Lyrique
Catalogue raisonné des cent quatre-vingt-deux opéras qui y ont été représentés depuis sa fondation jusqu'à l'incendie de sa salle de la place du Châtelet (Albert de Lasalle, 1877)
Le Théâtre-Lyrique a été inauguré le lundi 15 novembre 1847, dans la salle du Cirque, au boulevard du Temple. Ses directeurs, Adolphe Adam et Achille Mirecour, lui avaient donné le nom sonore d'Opéra-National. Il affichait comme spectacle d'ouverture un prologue intitulé les Premiers Pas ou les Deux Génies, suivi de Gastibelza, drame lyrique en trois actes. Les bailleurs de fonds de l'aventureux théâtre, gens d'une audace héroïque, et dont le nom doit appartenir à l'histoire, étaient M. Beudin, député, avec un apport de 300,000 fr. ; M. Châle, agréé au Tribunal de Commerce, qui donnait 260,000 fr. ; et M. Joseph Perrin, versant 30,000 fr. Ces 590,000 fr. joints à ce qu'Adolphe Adam prit sur ses économies, formèrent le capital de fondation du Théâtre-Lyrique. Mais on se doute bien que les choses ne marchèrent point du train paisible dont nous menons notre récit, et que la création, à Paris, d'une troisième scène musicale dut être laborieuse sous le régime des privilèges de théâtre et du bon plaisir administratif. Ce que l'on comprend plus difficilement, c'est qu'un ministre ait mieux aimé refuser longtemps un débouché nécessaire aux produits de l'art national que de laisser se ruiner quelques particuliers de bonne volonté. Sa résistance équivalait à cette déclaration que, certainement, il n'eût osé signer : « Périsse la jeune musique française dont je suis le protecteur officiel, plutôt que des intérêts privés dont je n'ai pas la garde ! » Mais il en allait ainsi dans ces temps déjà fabuleux. La lutte fut donc assez vive entre le ministère et les musiciens ; elle se prolongea durant plusieurs années par une série d'escarmouches. En mai 1842, un premier mémoire est présenté à l'autorité supérieure, demandant pour le théâtre du Gymnase le droit de donner des opéras. La supplique, qui ne fut point exaucée, était Signée : Ad. Adam, Halévy, Berlioz, Ambroise Thomas, etc. Deux ans plus tard, nouvelle pétition rédigée par tous les prix de Rome alors militants. Même réponse. Vers 1846, une autre combinaison fut proposée : Ad. Adam et Crosnier associés, prenaient le théâtre de la Porte Saint-Martin, et y donnaient pour commencer tous les chefs-d'œuvre du vieux répertoire, dédaignés par l'Opéra et l'Opéra-Comique. L'affaire resta encore sans suite. Le ministère se défendait en opposant cet argument : que depuis 1807, date du décret qui réduisait à deux les théâtres de musique, toutes les tentatives faites pour sortir d'un cadre si étroit avaient échoué. En effet, dès 1820, et par privilège spécial, on chantait au Gymnase : l'Epreuve villageoise, la Maison en loterie, etc... — à l'Odéon (1824-1829) : le Barbier de Séville, Othello, les Noces de Figaro, Don Juan, Robin des bois, etc... — aux Nouveautés de la place de la Bourse (1827-1831) : l'Italienne à Alger, le Coureur de Veuves, Caleb, etc. — à la Renaissance-Ventadour (1838-1840) : Lady Melvil, l'Eau merveilleuse, Lucie de Lammermoor, etc... Et il était vrai de dire que ces quatre théâtres avaient été obligés de renvoyer leurs violons. Mais les temps étaient autres, et le goût de la musique, en se propageant, assurait aux scènes lyriques une clientèle plus nombreuse. M. Duchâtel, ministre de l'Intérieur, finit donc par se résigner. Il octroya le bienheureux privilège à Adolphe Adam, auteur populaire du Chalet et de Giselle, ayant pour co-directeur Achille Mirecour, frère du pensionnaire du Théâtre-Français, comédien lui-même, et homme entendu aux affaires de théâtre ; il avait notamment donné des preuves de capacité, lors de la réorganisation de l'Odéon. Cette petite guerre qui se termina par une capitulation, mériterait d'être racontée en détail et dans le style pince-sans-rire du Lutrin. Nous n'avons voulu qu'indiquer les phases principales qu'elle a traversées, et en gardant le ton placide qui convient à de courtes annales. Ce qui est certain, c'est que, malgré sa fière altitude, le ministère devait succomber sous la pression du nombre. Il se trouvait serré de près par la foule toujours grossissante des prix de Rome, des lauréats du Conservatoire, des musiciens sans livret, des librettistes en quête d'un musicien, des chanteurs en retrait d'emploi, des jeunes de tous les âges, des impatients qui piaffent à la porte des théâtres, des inédits enfin, que l'appétit de la célébrité taquine et rend taquins. Accorder le Théâtre-Lyrique à ces âmes en peine, c'était leur ouvrir la porte du purgatoire qui donne directement sur le paradis.
SALLE DU CIRQUE OLYMPIQUE
Le spectacle équestre, introduit en France par Astley, dans les premières années du règne de Louis XVI, puis bientôt perfectionné par Franconi, avait longtemps erré dans divers quartiers de Paris. Enfin, il s'était installé au boulevard du Temple, en un logis superbe et définitif, dont il avait pris possession le 3 mars 1827. Cette salle était disponible au commencement de l'année 1847. Adolphe Adam et Mirecour l'achetèrent de M. Dejean pour la somme de 1,400,000 fr., bien qu'elle en eût coûté 1,700,000 à bâtir, et ils y mirent aussitôt les maçons et les décorateurs. L'architecte Charpentier n'en garda guère que les quatre murs ; et moyennant une dépense de 180,000 fr., il put, en quelques mois, l'approprier à sa nouvelle destination. En effet, tout y était à refaire. Outre qu'elle laissait beaucoup à désirer sous le rapport de l'acoustique, elle présentait des dispositions générales qui ne pouvaient convenir à un théâtre de musique. Par exemple, la scène y communiquait par deux plans inclinés, avec une piste qui occupait la place du parterre et des fauteuils d'orchestre. Si bien que les chevaux descendaient du théâtre ou y remontaient, évoluaient en deçà ou au delà de la rampe, suivant les besoins de la pièce. La salle du Cirque, devenue salle de l'Opéra National, était meublée au rez-de-chaussée de fauteuils d'orchestre et de banquettes de parterre, le tout encadré par deux pourtours, et une rangée de quatorze baignoires de face. Au premier étage se trouvait une galerie à cieux rangs de sièges et quatorze loges découvertes à salon. Le deuxième était presque tout en galerie, et on n'y trouvait plus que huit loges, quatre de chaque côté. Au troisième, une galerie. Au quatrième, un immense amphithéâtre. Les loges d'avant-scène soutenues par des cariatides s'étageaient jusqu'à la hauteur de la troisième galerie. Le plafond représentait des groupes allégoriques de la musique, de la poésie et de la danse, jetés dans un fouillis de fleurs et d'attributs divers. Le foyer, convenablement orné, ne faisait qu'un avec le corridor des premières. Ses fenêtres donnaient sur le boulevard du Temple qui avait encore dans ce temps-là, et par tradition, l'aspect joyeux d'une foire ou d'une kermesse. Notons encore que le plancher de la scène s'avançait notablement, et plus qu'il n'est d'usage, du côté du public, disposition favorable aux effets de la voix. Il est vrai que la troupe chantante de l’Opéra-National était composée de plus d'accessits que de premiers prix du Conservatoire. Nous allons la voir bientôt à l'œuvre. L'orchestre comptait 70 musiciens, conduits par MM. Georges Bousquet et Eugène Gautier ; les chœurs, 54 exécutants, dirigés par M. Cornette, et le corps de ballet, 28 personnes obéissant a M. Lerouge. Le directeur de la scène était M. Leroy ; le régisseur général, M. Thieblemont ; les deux autres régisseurs, MM. Fosse et Lecour ; le secrétaire général, M. Lormier.
[présentation des opéras représentés dans la salle du Cirque Olympique]
Ici prend fin la première période d'exploitation du Théâtre-Lyrique. Elle se solde par huit opéras, donnant seize actes, joués en cent-douze jours (exactement un acte tous les sept jours). Encore nous n’inscrivons pas au répertoire, parce qu'ils sont de trop minime importance, plusieurs intermèdes de chant ou de danse, tels que : Une Chinoiserie, la Jardinière, Don Quichotte, etc., véritables parades montées pour amuser l'entr'acte pendant la saison du carnaval. — La situation financière du Théâtre-Lyrique avait été jusque là prospère. (1,500 fr. de frais quotidiens, contre une recette moyenne de 1,800 frs.) Mais le mois de mars de 1848 ne fut que l'expiation de ce premier temps de fortune. Il fallut alors, et par tous les moyens, lutter contre la faillite menaçante. On fit jouer aux chanteurs un drame sans musique (la Révolution, deux actes de Labrousse et Mailhan) ; on entama des pourparlers avec le Vaudeville de la place de la Bourse pour la cession de sa salle ; on modifia le régime administratif en appelant tout le personnel au partage de la recette. Mais, hélas ! on n'encaissait pas 300 fr. par soirée. Aussi, après quelques jours de cette misère, les musiciens de l'orchestre refusèrent tout service. Ou dut alors faire relâche... pendant près de quatre ans. * Au moment de sa fermeture le Théâtre-Lyrique répétait : les Monténégrins de M. Limnander, pour les premiers débuts de Mme Ugalde, et les Deux Bambins, de M. Bordèse. L'une et l'autre de ces partitions ont été chantées depuis à l'Opéra-Comique. C'était encore pour un avenir prochain la Fille du soldat de Varin et Tariot ; le Prétendant et le Prétendu, de Commerson et Pilati ; enfin un acte d'un jeune violoncelliste nommé Offenbach, qui avait déjà déclaré ses prétentions de compositeur dramatique en faisant jouer, au Théâtre de la Tour-d'Auvergne, un petit opéra-comique intitulé l'Alcôve (avril 1847). Cependant le sort capricieux décida qu'après avoir voulu faciliter à M. Offenbach l'entrée de la carrière, Adolphe Adam terminerait la sienne par les Pantins de Violette, représentés aux Bouffes-Parisiens, sous les auspices du même M. Offenbach. * Note à prendre : dans l'année qui suivit le désastre du Théâtre-Lyrique, Mme Petit-Brière, Joseph Kelm, Junca, Chenetz et autres naufragés se réfugièrent sur le radeau du Théâtre-Beaumarchais qu'ils intitulèrent Opéra-Bouffe-Français. Leurs représentations commencèrent, le 11 juin 1849, par le Vieux Prix de Rome (musique de M. Henri Potier, fils du célèbre comédien), et le Marin de la Garde (de M. Eugène Gautier). Vinrent ensuite : le Cousin de Denise (Pâris), et la Saint-André (Bazzoni). L'orchestre, composé de vingt-huit musiciens, était conduit par M. Pilati. Mais cette tentative désespérée n'eut pas de suite, et on ne peut l'enregistrer, croyons-nous, qu'eu marge des annales du Théâtre-Lyrique.
SALLE DU THÉÂTRE-HISTORIQUE
Après trois ans et demi d'un état de léthargie qui pouvait entraîner la mort, le Théâtre-Lyrique retrouva vie et santé. Il avait clos ses exercices à la salle du Cirque, en mars 1848 ; il les reprit, en septembre 1851, à la salle du Théâtre-Historique. Mais il conservait encore son titre primitif d' « Opéra national » ; ce n'est en effet que le 12 avril de l'année suivante qu'il le changea contre celui de « Théâtre-Lyrique ». L'adjectif « national » n'était plus de mode en 1852 ; sans être par décret rayé du dictionnaire, il avait perdu en grande partie sa signification sous le nouveau gouvernement. Le Théâtre-Historique, fondé par Alexandre Dumas, avait été inauguré le 22 février 1847. Nous en devons la description au lecteur, surtout s'il est jeune et que ses souvenirs ne portent pas au-delà de l'année 1863, date de la démolition. Ce ne sera d'ailleurs pas abandonner notre sujet, puisque la salle de la Reine Margot, toute neuve lorsqu'elle fut livrée aux chanteurs de Mosquita la Sorcière, ne fit que changer de genre, sans subir d'autre modification matérielle. Elle était enclavée dans ce groupe de théâtre que nous avons vus rangés en hémicycle sur le boulevard du Temple, et qui occupaient la place du rempart élevé par François Ier pour préserver Paris des attaques des Flamands. Le terrain où a tant prospéré l'art dramatique, était encore en culture maraîchère du temps de la Régence. On ne commença à y élever des constructions qu'il partir du moment où le sieur Chavanne, procureur du roi, en eut fait l'acquisition pour le revendre par lots. Et comme il s'en était réservé une portion notable, il y avait fait lui-même bâtir une très somptueuse maison pour son usage personnel. Cet hôtel Chavanne, qui passa dans les mains de plusieurs propriétaires, a ôté connu jusque dans ces derniers temps sous le nom d'hôtel Foulon, pour avoir appartenu à Foulon de Morangis, ministre de Louis XVI, et, l'une des premières victimes de la Révolution. C'est sur son terrain, déblayé en 1846, que l'architecte de Dreux, secondé par Sechan, décorateur, construisit le Théâtre-Historique, depuis Théâtre-Lyrique. Pour mieux préciser, nous pouvons supposer un promeneur qui, sortant de la rue du Faubourg-du-Temple, se fût dirigé vers la Bastille en suivant le boulevard. Il eût d'abord passé devant le café Hainsselin, fondation datant d'un siècle et demi, et qui était toujours restée dans la même famille ; ensuite devant une maison bourgeoise moderne et absolument quelconque ; enfin il lût arrivé au perron du Théâtre-Historique. En continuant sa route, il eût successivement rasé les portes du Cirque-Olympique, ou National, des Folies-Dramatiques, de la Gaîté, des Délassements-Comiques, des Funambules et du Petit-Lazari. La façade du Théâtre-Historique avait cela d'original qu'elle était haute comme une maison de cinq étages, et qu'elle n'avait que huit mètres de largeur. Son rez-de-chaussée ne se composait que de la porte, laquelle était encadrée par deux cariatides de Klagmann, symbolisant la tragédie et la comédie. Au-dessus se trouvait une loggia communiquant avec le foyer, et dont le fond, disposé en rotonde, était orné d'une fresque visible du dehors. Le peintre (M. Guichard, élève d’Ingres) avait pris pour sujet une sorte d'Olympe on tous les dieux du théâtre étaient assemblés, depuis Sophocle jusqu’à Marivaux, sans oublier Shakespeare, Corneille, Molière, Mozart... Des deux côtés de la loggia, et pour terminer son balcon, se trouvaient deux groupes sculptés par Klagmann, représentant Hamlet et Ophélie d'une part, et de l'antre le Cid et Chimène. La salle proprement dite était, orientée de telle sorte que la rampe prolongée fût tombée perpendiculairement sur la chaussée du boulevard. On y entrait donc par le « côté-cour », comme on dit en style de coulisses ; autrement, l'acteur en scène, et regardant le public, avait la figure tournée vers l'ouest. L'ornementation générale était rouge et or, suivant la formule le plus communément adoptée, et qui est devenue banale. En revanche le plafond, peint par Despléchin, Diéterle et Sechan, était d'une magnificence rare ; il avait pour motif principal Apollon, dieu des arts, conduisant son quadrige à travers un ciel inondé de lumière. (Le lecteur curieux de plus de détails pourra consulter les gravures et le texte publiés par le journal l'Illustration, dans ses numéros du 26 décembre 1816 et des 23 et 30 janvier 1847.) Mais la particularité la plus remarquable du théâtre construit par M. de Dreux était encore sa forme elliptique, avec la scène placée parallèlement au grand diamètre de l'ovale. Ainsi la salle, qui avait une largeur de vingt mètres, n'en comptait que seize en profondeur. Disposition heureuse en ce que la majeure partie des loges étaient de face. L'idée pourtant n'en était pas nouvelle, si elle était réalisée pour la première fois. Elle appartenait à un artiste du siècle dernier. (Voir « Projet d'une salle de spectacle pour la comédie » par Cochin, Paris, 1765, in-12, avec figures.) Une autre singularité : le cartouche qui, ordinairement attaché au-dessus du rideau, renseigne le public sur la forme de son gouvernement, se trouvait remplacé par une horloge lui apprenant aussi utilement l'heure qu'il était. Il y avait au Théâtre-Historique ou Lyrique cinq rangs de loges, de galeries et d'amphithéâtres. Les loges de premières étaient à salon. Le foyer, grande pièce banale, était situé au second étage ; un papier rouge-brun, imitant le damas, recouvrait ses murs ; et il n'avait guère pour mobilier qu'un piano à queue sur lequel était placé le buste colossal de Weber. Les jours « de service », la critique tenait ses conciliabules dans le couloir des premières loges. Enfin le Théâtre-Lyrique, comme les six autres théâtres voisins, avait sa porte des coulisses sur la rue des Fossés-du-Temple, dont la courbe suivait parallèlement celle du boulevard. Prix des places du Théâtre-Lyrique au moment de son emménagement : Avant-scènes, 6 fr. ; premières loges, 5 fr. ; orchestre et première galerie, 4 fr. ; stalles d'orchestre, 3 fr. ; parterre, 1 fr. 50..., etc. Et maintenant que nous avons décrit la cage, voyons ce qu'y chantaient les oiseaux.
[présentation des opéras représentés dans la salle du Théâtre-Historique]
Ici finissent les travaux du Théâtre-Lyrique dans la salle du Théâtre-Historique ; ils se soldent par un répertoire de cent vingt-huit opéras, tant anciens qu'inédits.
SALLE DE LA PLACE DU CHÂTELET
Le Grand-Châtelet était une forteresse, élevée de temps immémorial sur la rive droite de la Seine, et défendant l'entrée du « pont aux Eschangeurs », qui menait à la Cité. Le général Bonaparte fit démolir en 1802 cette bastille devenue inutile. Mais la pioche entama aussi quelques maisons environnantes, qui appartenaient aux rues Saint-Leufroy, de la Joaillerie, Trop-va-qui-dure et autres, dont, l'alignement tortueux relevait d'une géométrie indépendante de la règle et du compas. Le terrain déblayé devint celui de la place du Châtelet. A prendre ce grand espace vide dans l'état où il était encore il y a vingt ans, et en nous postant à son point central, la figure tournée du côté de la Seine, nous avons : A notre droite, le restaurant du « Veau qui tette », où, en 1823, Rossini, traversant Paris pour la première fois, fut fêté dans un banquet auquel assistèrent Herold, Auber, Lesueur, Boieldieu, Horace Vernet, Talma, Ciceri ; Mlle Mars, Mlle George, Mlle Cinti, et tous les grands noms de l'art contemporain. A notre gauche, un pâté de maisons difformes que traverses dans un sens parallèle au quai de Gesvres, le cloaque sinistre où s'est suicidé Gérard de Nerval, la ruelle fangeuse mais pittoresque de la Vieille-Lanterne, laquelle est coupée à angle droit par la rue Saint-Jérôme, venant de la rivière et aboutissant à la Vieille-Place-aux-Veaux. C'est sur la croix formée par les rues Saint-Jérôme et de la Vieille-Lanterne, que devait s'élever la troisième salle du Théâtre-Lyrique, lorsque l'édilité eut le caprice regrettable de supprimer la foire perpétuelle du boulevard du Temple. Il fut donc décidé que le nouveau théâtre aurait sa porte principale sur la place du Châtelet ; ses façades latérales, dans l'alignement du quai de Gesvres et de l'avenue Victoria ; enfin, son quatrième mur extérieur, sur une rue à créer, qui serait baptisée Adam, pour perpétuer le souvenir du fondateur de la maison. Cette rue existe, en effet, mais sous le nom d'Adam, tout court ; ce qui laisserait croire qu'elle a été édifiée en l'honneur de notre premier père. Le prénom d'Adolphe, oublié à tort, eût suffit, et amplement, à éviter toute confusion. C'est vers la fin de l'été de 1862 que les travaux de construction du Théâtre-Lyrique furent terminés et livrés au propriétaire, qui était la Ville de Paris. L'architecte achevait en même temps le théâtre du Châtelet, faisant pendant de l'autre côté de la place, là même où Rossini avait reçu l'étrenne de ses triomphes parisiens. L'œuvre de M. Davioud n'excita pas un grand enthousiasme. La lourdeur, le prosaïsme, l'aridité de ses lignes extérieures ne répondaient pas, en effet, aux conditions exigées d'un monument devant faire point de vue à la fois : sur un quai, un pont, une place, un boulevard et un square. Toutes les critiques furent résumées par un plaisant, armé de raison, prétendant que cette masse carrée, avec le campanile du ventilateur qui la couronne, ressemblait à une immense malle de voyage, surmontée d'un carton à chapeau. Quant à l'idée mesquinement bourgeoise de pratiquer de petites boutiques au rez-de-chaussée de l'édifice, afin de s'en faire de petites rentes, elle n'eût été pardonnable qu'à une sous-préfecture besogneuse, et non à la capitale la plus fastueuse du monde et la plus prodigue. Il y avait plus à louer dans l'intérieur du monument, bien que l'on sentît partout la lutte engagée par l'architecte contre l'étroitesse du terrain concédé. Le vestibule, trop exigu pour le style dans lequel il était traité, avait cependant bon air avec sa double rampe d'escalier taillée dans la pierre. La salle proprement dite était aussi d'une grande richesse, et les ornements néo-grecs qui couraient sur les balustrades de ses cinq rangs de loges, formaient d'heureux entrelacements de lignes. Les avant-scènes pourtant ne présentaient qu'un amoncellement d'attributs dorés, où l'œil avait peine à trouver son chemin. Mais les spectateurs de ces places enviées souffrent trop de ne voir le spectacle que de profil, de n'entendre qu'une moitié de l'orchestre, de se brûler les yeux au feu de la rampe ; aussi est-ce bien le moins qu'on leur donne des dédommagements d'amour-propre, en encadrant leurs personnes comme des tableaux de prix. En somme, et malgré plus d'un détail bien trouvé dans le dessin de ses ornements, le Théâtre-Lyrique affichait ce luxe vaniteux dans lequel se complaisait la société d'alors, et plus particulièrement les nouveaux enrichis de Paris haussmannisé. On jugerait mal de ses splendeurs criardes d'après la toilette plus modeste qui lui a été faite depuis l'incendie, où il a péri en 1871. Mais les amateurs de spectacle eussent donné tout l'or du monde, y compris celui qui étincelait aux balustrades des loges, pour être assis plus à l'aise, car l'ébéniste qui avait fabriqué les fauteuils ne possédait, à coup sûr, aucune notion d'anatomie humaine. La scène, au bas du rideau, était large de 11 m. 50. C'était exactement la dimension de celle du Théâtre-Historique, soit un mètre de moins que celle du Cirque-Olympique. Et comme l'œil se trompe souvent dans l'appréciation de ces mesures, il est peut-être utile de rappeler que le rideau de l'Opéra a une largeur de 15 m. 60. Celui de l'Opéra-Comique a 11 m. ; celui de la Comédie-Française, 12 ; celui du Gymnase, 9 ; etc. Ce qu'il y avait encore de plus particulier dans la salle de M. Davioud, c'était le plafond, fait d'un vitrage diversement coloré, et au travers duquel filtrait la lumière de quelques centaines de becs de gaz, placés dans les combles. Cette innovation ne fut pas du goût de tout le monde ; elle avait cependant pour avantage principal de supprimer le lustre et la chaleur qui en provient. Les plafonds lumineux n'ont clone pas fait fortune, et il n'en reste plus aujourd'hui qu'un spécimen qui fonctionne au Théâtre du Châtelet. Le foyer du Théâtre-Lyrique, décoré de peintures arabesques d'un goût très sobre, communiquait à ses extrémités, avec deux salons carrés, meublés sans aucune apparence de faste. C'est le jeudi 30 octobre 1862 que la nouvelle salle fut inaugurée. Il y eut ce soir-là non pas une représentation, mais un festival dans lequel furent chantés les meilleurs morceaux du répertoire de la maison. Nous nous souviendrons toujours d'avoir vu rangées sur le premier plan de la scène, Mmes Viardot, Miolan-Carvalho, Vendenheuvel-Duprez, Cabel, Faure-Lefebvre, et Girard, une constellation d'étoiles. Pendant les semaines qui suivirent et jusqu'à la fin de l'année, les affiches du Théâtre-Lyrique ressemblèrent à ces drapeaux de régiment sur lesquels sont inscrits des noms de victoires. On y vit écrits tour à tour : Orphée, l'Enlèvement au Sérail, Robin des Bois, etc... Victoires, en effet, et dont M. Carvalho se plaisait à dresser la liste au moment où il entrait de nouveau en campagne.
[présentation des opéras représentés dans la salle de la place du Châtelet]
Nous ne pousserons pas plus loin cet inventaire. La date à laquelle nous sommes parvenu est celle d'événements d'un autre ordre... (!!) Après être resté fermé durent tout le siège de Paris, et avoir été incendié pendant la guerre civile de 1871, le Théâtre-Lyrique (qui est aujourd'hui reconstitué) a eu des résurrections partielles. Mais ces faits sont encore trop récents pour qu'il soit nécessaire de les étudier en détail. Nous ne pouvons qu'en donner le croquis dans le chapitre qui va suivre.
APPENDICE
Depuis sa fondation jusqu'à sa fermeture et à l'incendie de sa salle de la place du Châtelet (de novembre 1847 à la guerre et à la Commune), le Théâtre-Lyrique a représenté cent quatre-vingt-deux opéras, donnant un total de quatre cent cinq actes.
Salle du Cirque 8 opéras Salle du Théâtre-Historique 128 opéras Salle de la place du Châtelet 46 opéras 182 opéras inédits 121 = 249 actes anciens 61 = 156 actes 405 actes
En classant ces opéras par genres, nous avons :
Grands opéras 24 Opéras-comiques 112 Opéras-ballets 4 Levers-de-rideau, prologues, etc. 42
Mais les trois salles exploitées par le Théâtre-Lyrique sont échelonnées chronologiquement suivant un ordre décroissant de fertilité.
Il a été monté (approximativement) :
1 acte par 7 jours à la salle du Cirque ; 1 acte par 12 jours à la salle du Théâtre-Historique ; 1 acte par 18 jours à la salle de la place du Châtelet.
Cependant il convient de remarquer que le manque d'activité d'un théâtre peut provenir de la constance et de la longévité de ses succès. *** Ce répertoire a été partagé ainsi entre les auteurs : Compositeurs : Ad. Adam, 14 pièces ; — Weber, 6 ; — M. Eugène Gautier, 6 ; — Mozart, 5 ; — Clapisson, 5 ; — M. Gounod, 5 ; — M. Verdi, 4 ; — Grisar, 4 ; — etc. (N'ont eu qu'un opéra de représenté : Beethoven, Boieldieu, Monsigny, Auber, Mendelssohn, Félicien David, M. Ambroise Thomas, etc.) Librettistes : Michel Carré, 22 pièces ; — M. de Leuven, 21 ; — M. Jules Barbier, 19 ; — de Saint-Georges, 14 ; — Brunswick, 11 ; — M. Nuitter, 9 ; — M. Dennery, 7 ; — M. Arthur de Beauplan, 5 ; —M. Deforges, 4 ; — Scribe, 4 ; — M. Philippe Gille, 3 ; — etc. *** Le Théâtre-Lyrique a été un centre très actif de production ; il a fait honneur à son programme qui était de ressusciter les morts, sans tuer les vivants. Et parmi les compositeurs contemporains, dont il a ouvert ou facilité la carrière, on peut citer : MM. Barthe, Cherouvrier, Félicien David, Dautresme, Debillemont, Deffès, Delibes, Diaz, E. Gautier, Gevaert, Gounod, Hignard, Joncières, de Lajarte, Maillart, Poise, Reyer, Semet, Varney, Vogel, Weckerlin, etc. *** Si nous classons par nationalités les compositeurs inscrits au répertoire du Théâtre-Lyrique, nous avons : Musiciens anglais 1 opéra. « hollandais 1 « « belges 9 « « italiens 15 « « allemands 18 « « français 138 « 182 *** La plupart de ces noms sont connus du lecteur. Nous n'avons pas à revenir sur ce que nous avons déjà dit d'Adolphe Adam et d'Achille Mirecour, fondateurs du Théâtre-Lyrique. Les frères Seveste avaient eu longtemps l'entreprise de tous les petits spectacles de la banlieue. M. Emile Perrin, nanti du privilège de l'Opéra-Comique en 1848, ne s'en est point dessaisi pendant sa direction du Théâtre-Lyrique ; il a été depuis, comme l'on sait, directeur de l'Opéra, et il est aujourd'hui administrateur général de la Comédie-Française. M. Carvalho, élève des classes de chant du Conservatoire, avait chanté l'emploi des barytons à l'Opéra-Comique ; il vient de rentrer à ce théâtre comme directeur. M. Rety était secrétaire de M. Carvalho du temps de sa première direction ; il est aujourd'hui rédacteur au Figaro. M. Pasdeloup a attaché son nom à la belle et utile création des « Concerts populaires de musique classique », qui, depuis 1860, justifient leur nom par l'empressement que met le public à s'y porter. M. Martinet avait fondé la petite scène musicale des Fantaisies-Parisiennes, au boulevard des Italiens, puis l'avait transportée dans le théâtre souterrain de l'Athénée, situé rue Scribe. Il venait d'obtenir le privilège du Théâtre-Lyrique, avec une subvention de 100,000 francs, lorsque la guerre éclata. Pendant toute la durée du siège, le Théâtre-Lyrique resta fermé, obéissant à un arrêté que la Préfecture de police avait pris dès les premiers jours de septembre. Mais aussitôt l'armistice signé (28 janvier 1871), M. Martinet reprit possession de ses droits. Il rassembla une troupe et mit en répétition : la Dame Blanche, Si j'étais roi !, l'Esclave, de M. Membrée, et les Brigands de Verdi, avec l'excellente traduction française que M. Jules Ruelle en avait déjà donnée à l'Athénée. La réouverture était affichée pour le 2 avril... quand survint la révolution du 18 mars. Il semblait que M. Martinet, avec un titre officiel dans sa poche, ne dût jamais régner, empêché par les événements, et qu'il serait le Louis XVII du Théâtre-Lyrique. *** Pendant la Commune, la salle de la place du Châtelet entrebâilla plusieurs fois sa porte ; « la Fédération artistique » y donna quelques concerts. Enfin, c'est le mercredi 24 mai 1871 que l'édifice bâti par M. Davioud, et qui avait coûté trois millions à la Ville, périt dans les flammes. Il était environ neuf heures du matin. La lutte était engagée dans les rues depuis le lundi. Déjà les troupes régulières s'étaient emparées de la partie ouest de Paris, depuis la porte Maillot jusqu'à la Bourse. Le corps du général de Cissey s'avançait sur la rive gauche et menaçait Notre-Dame ; celui du général Vinoy, au centre, avait dépassé le Louvre ; et celui du général Douay prenait position à la Pointe Saint-Eustache. Une attaque était imminente sur le quartier du Châtelet ; les projectiles y tombaient depuis le matin. Les choses en étaient là lorsque (d'après nos renseignements pris sur place) une épaisse fumée sortit du Théâtre-Lyrique par la dernière fenêtre de droite de sa façade. Le feu venait de se déclarer dans le petit salon qui occupe le coin du bâtiment formé par le boulevard de Sébastopol et le quai de Gesvres. Ce jour-là, justement, le vent soufflait du sud-ouest. Bientôt le fléau gagna le foyer du public, s'arrêtant à l'avant-dernière fenêtre du côté nord. Puis la flamme, traversant le couloir des premières loges, envahit la salle, la scène et ses dépendances, qu'elle anéantit complètement. M. Martinet, qui avait déjà meublé en cabinet directorial, fit des pertes sensibles. Sa bibliothèque et plusieurs tableaux de prix furent brûlés. Mais, par un hasard singulier, le feu ne pénétra pas dans la partie des combles située du côté de la rivière, et qui contenait, avec le magasin des costumes, toutes les archives du théâtre, partitions, brochures, registres et papiers d'administration. Pas un verre d'eau ne fut jeté sur le brasier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ici nous pourrions clore la série de ces notes ; mais un incendie n'est pas une apothéose finale ; et d'ailleurs nous retrouvons encore sur notre carnet quelques renseignements qui, tout en étant agréés du lecteur, pourront devenir des matériaux pour l'historien définitif du Théâtre-Lyrique, si jamais il se met à la besogne. *** Après le sinistre, M. Martinet, qui ne s'était point dessaisi de son privilège, se mit en quête d'une salle où il pût l'exploiter. Celle de l'Ambigu était disponible ; des pourparlers furent engagés ; mais le bail ne se signa pas, et M. Martinet, avec une subvention réduite à 60,000 francs, dut retourner dans les catacombes de l'Athénée, où gisaient déjà les restes inanimés de tant de partitions. Il joua Sylvana, de Weber ; le Docteur Crispin, des frères Ricci ; reprit Martha, de M. de Flotow ; Ne touchez pas à la Reine, de M. X. Boisselot, etc. Mais après cette campagne, aussi honorable qu'elle fut peu fructueuse, il abandonna son théâtre à M. Jules Ruelle. *** Sans être officiellement directeur du Théâtre-Lyrique, M. Ruelle toucha du ministère un subside mensuel de 6,000 francs pendant les six premiers mois de sa gestion. Dès la seconde année, il fut livré à ses propres forces et dut lutter contre des difficultés sans nombre. Après quoi il tomba, pour s'être obstiné à donner des opéras-comiques sur une scène que ses dimensions semblent réserver à l'opérette. Aucune entreprise théâtrale ne fut d'ailleurs plus hospitalière aux musiciens militants, et dans un temps aussi court n'en présenta un plus grand nombre au public. Pour ne citer que les lauréats de l'Institut, M. Ruelle accueillit M. Ernest Guiraud qui lui apportait Madame Turlupin ; M. Dubois avec la Guzla de l'Émir ; M. Ch. Constantin avec Dans la forêt ; M. Deslandres, avec Dimanche et lundi... Ensuite devaient venir trois actes de M. Danhauser, un acte de M. Puget, et Don Mucarade, de M. E. Boulanger, qui a été joué depuis à l'Opéra-Comique. Si le public avait voulu soutenir M. Ruelle et partager ses généreuses illusions lorsqu'il avait entrepris de tirer au clair toute la musique contemporaine, la race pullulante des compositeurs inédits serait aujourd'hui éteinte. *** Mais nous avons vu que si le Théâtre-Lyrique tombe quelquefois en prostration, il ne meurt jamais, et qu'on est toujours sûr de le voir réapparaître dans quelque coin de Paris, au moment où l'on s'y attend le moins. Donc, en janvier 1873, M. Bagier, directeur du Théâtre-Italien, essaya de donner des représentations françaises dans la salle Ventadour, où elles devaient alterner avec les représentations italiennes. Il y eut un commencement d'exécution : le Freyschutz fut chanté par Jourdan et Giraudet ; Mlles Reboux et Sablairolles. Le répertoire qui devait suivre était en partie celui du Théâtre-Lyrique. Mais la combinaison ne réussit pas Elle avait déjà été tentée en 1868, sur les mêmes planches, et d'ailleurs avec le même insuccès. Les Parisiens sont gens d'habitude, et l'on dirait qu'ils se sentent déroutés lorsqu'ils comprennent les paroles des opéras qu'on leur chante à Ventadour. *** Voici maintenant « l'Opéra-Populaire » (en bon français le Théâtre-Lyrique) qui fait son ouverture, au mois de novembre 1874, dans la salle du Châtelet, située vis-à-vis des ruines de la salle incendiée en 1871. On y donne, avec un grand déploiement de décors et de figuration, le Paria, de M. Membrée, chanté par Prunet, Petit, et Mme Furchs-Madier. Pour les lendemains, la reprise des Amours du Diable, de Grisar, avec Nicot et Mlle Reboux. Mais avant un mois écoulé, le drame et la féerie reprirent possession de leur domaine ordinaire. *** Enfin notre vaillant et très vivace Théâtre-Lyrique vient de s'installer, avec 200,000 francs de subvention, dans la salle de la Gaîté, au square des Arts-et-Métiers. C'est sa cinquième résurrection, depuis cinq ans. Et cette fois, comme ce n'est pas la coutume constante, il est aux mains d'un directeur sachant lire et écrire la musique et qui, par tradition de famille, s'entend à la triture des affaires théâtrales. M. Albert Vizentini, titulaire du nouveau privilège, est lauréat du Conservatoire de Bruxelles pour le violon et la composition ; il a été violon solo aux Bouffes-Parisiens et au Théâtre-Lyrique ; il a conduit l'orchestre des théâtres d'Anvers, de la Porte-Saint-Martin et de la Gaîté. De plus il a collaboré, comme écrivain, à l'Art musical, au Charivari, au Journal amusant, au Grand Journal..., et on lui doit encore un volume de révélations sur la vie des coulisses, intitulé : Derrière la toile. Il y avait déjà, comme on pourrait dire, de la graine de musique dans le théâtre de la Gaîté quand M. Albert Vizentini en était le chef d'orchestre et l'administrateur général. Mais depuis qu'il en a pris la direction, en juillet 1875, il n'a cessé de développer ces germes, pour arriver jusqu'à la floraison et faire prospérer l'opéra sur le terrain de la féerie-opérette. Ce qui manquait le plus à la Gaîté lors de sa transformation, c'était une troupe de sujets chantants. Aujourd'hui l'on peut lire sur les affiches du Théâtre-Lyrique les noms de Capoul, Duchesne, Michot, Bouhy, Melchissédec, Petit, Sotto..., de mesdames Sasse, Marimon, Engally, Dalti, Singelée, Girard, etc... Ainsi entouré, et ayant sous la main un orchestre, des chœurs et un corps de ballet nombreux ; disposant d'une salle spacieuse et sonore ; possédant un matériel de scène très varié, M. Albert Vizentini fut en état d'ouvrir son nouveau théâtre le 5 mai 1876. Cependant, pour faire droit à un caprice de son propriétaire, qui est la Ville de Paris, il dut écrire sur sa porte ce pléonasme, en belles lettres de feu : Opéra-National-Lyrique. Le soir de l'inauguration on donna Dimitri, grand opéra de M. V. Joncières ; puis vinrent coup sur coup : Obéron ; le Sourd ; le Magnifique ; Giralda ; les Troqueurs ; les Charmeurs ; les Erynnies ; le Maître de chapelle ; Une heure de mariage ; les Rendez-vous bourgeois ; le Bouffe et le Tailleur ; le Tableau parlant ; Paul et Virginie, etc. Et sur le programme d'un avenir prochain sont encore inscrits, à côté des noms des compositeurs vivants, ceux de Gluck, de Mozart, de Monsigny, de Grétry, de Méhul, de Boieldieu, d'Herold, de Rossini, de Bellini, de Donizetti, de Verdi, d'Auber, d'Adolphe Adam, d'Halévy, de Félicien David, etc. Autant dire le panthéon des musiciens. (Albert de LASALLE [72.Le Mans, 1833 - Paris, 24 mars 1886], Mémorial du Théâtre-Lyrique, 1877)
|
=> la Question du Théâtre-Lyrique par Louis Gallet (Nouvelle Revue, 15 mai 1880)
|
Heureusement, diront ceux qu'une espérance console vite des rigueurs du présent, on reconstruit l'Opéra-Comique, et nous aurons ainsi, en un délai de trois ans, ce nouveau théâtre de musique tant de fois réclamé ; et nous l'aurons dans les conditions les plus sérieuses de durée !
C'est la grâce qu'il faut souhaiter à nos compositeurs qui trouveront, place Favart, l'idéal Théâtre-Lyrique, car il faut bien compter que l'Opéra-Comique restera place du Châtelet, où il a réuni une clientèle rappelant à ce point celle des anciens jours du genre, que c'est toujours, de préférence aux nouveautés, vers les œuvres du répertoire qu'elle se porte en foule.
II faut une attraction spéciale, comme celle d'un Falstaff, pour qu'elle déroge à ses habitudes quasi classiques ; mais alors, est-il permis de dire, tout le public habituel se grossit de celui qui, couramment, va plutôt aux pièces modernes qu'aux anciennes et aux affinités duquel répond surtout le Théâtre-Lyrique ; un tel succès donc ne saurait servir de règle.
En furetant dans les rayons d'une bibliothèque de vieux livres, il m'est arrivé naguère de mettre la main sur un travail analytique présentant une sorte de monographie rapide de ce que fut jadis le vrai Théâtre-Lyrique, depuis sa création jusqu'à l'incendie de mai 1871, c'est-à-dire durant cette brillante période où s'épanouirent, sous la jeune et vaillante direction de M. L. Carvalho, des œuvres telles que Faust et Roméo.
C'est le Mémorial du Théâtre-Lyrique, par Albert de Lasalle, publié en 1877, à la Librairie Moderne, avec le sous-titre « Catalogue raisonné des cent quatre-vingt-deux opéras qui y ont été représentés depuis sa fondation. »
La rencontre de ce petit livre est assez lointaine ; il est donc possible que j'en aie déjà parlé, mais ce n'a pu être que très légèrement. Il ne déplaira peut-être pas — en ces jours de vacances — aux lecteurs de la Nouvelle Revue de remonter un peu dans le passé et, aidés de ce guide très consciencieusement rédigé, de suivre l'histoire de ce théâtre qui a été si bienfaisant à ceux de notre école française, qu'on ne saurait souhaiter plus heureuse fortune aux producteurs contemporains quand s'ouvrira enfin devant eux une scène créée et dirigée selon le même esprit, si tant est qu'ils doivent jamais voir ce prodige.
Il y a un enseignement pratique à tirer de cette rétrospective revue, tant pour ceux qui travaillent pour se faire une place au théâtre, notamment pour ceux qu'on envoie à la villa Médicis se préparer plus particulièrement à cette dure conquête, que pour les représentants de l'État dont la fonction, comme le devoir, est de les y encourager officiellement.
Le Théâtre-Lyrique, inauguré le lundi 15 novembre 1847, ouvrit ses portes au public sous le titre d'Opéra national, se plaçant ainsi, comme instinctivement, à la veille de la Révolution de 1848, sous un vocable tout à fait populaire.
Adolphe Adam et Achille Mirecour en étaient les directeurs — aidés par un syndicat d'amateurs de musique dont la confiance et la sympathie s'affirmèrent par une commandite de plus d'un demi-million, augmentée des économies d'Adolphe Adam lui-même.
Si l'idée fut généreusement adoptée, soutenue et courageusement servie, les difficultés furent grandes et quand le rideau se leva pour la première fois sur les Deux Génies et Gastibelza, les organisateurs luttaient depuis 1842 pour le triomphe de cette idée à laquelle la protection officielle n'était pas particulièrement acquise.
Enfin, le ministère, serré de près par les influences, ému des récriminations des prix de Rome, avait cédé et accordé le privilège, faute duquel alors aucune scène ne pouvait être ouverte.
C'est dans l'ancien Cirque olympique, du boulevard du Temple, convenablement aménagé en vue de sa nouvelle destination, que la musique dramatique s'installa, riche d'espérances plus que de ressources, mais animée de cette foi profonde, de cette vaillante ardeur que donne seule la jeunesse.
Ses éléments de succès étaient honorables, sinon supérieurs. « Plus d'accessits que de premiers prix », dit, à ce propos, l'auteur de la plaquette à laquelle j'emprunte ces détails. L'orchestre avait soixante-dix musiciens, ce qui serait encore à notre époque un joli chiffre ; il y avait deux chefs, Georges Bousquet et Eugène Gautier. Ce dernier ne fut pas seulement un musicien aimable, fidèle conservateur des traditions du genre de l'opéra-comique et pourtant épris déjà de modernisme, mais encore un parfait homme d'esprit.
Huit ouvrages composant seize actes furent donnés dans cette première salle, en cent douze jours d'occupation, sans compter divers intermèdes. Je ne vois, parmi ces œuvres, que le Brasseur de Preston dont le public actuel ait pu garder le souvenir, entretenu d'ailleurs par une reprise faite vers 1868, sur la scène du Châtelet et où se firent remarquer Meillet et Mlle Daram, dans les rôles créés à l'origine par Chollet et Mlle Prévost.
Le Gastibelza, d'Aimé Maillart, évocation de la ballade de Victor Hugo, peut également être noté au passage. Comme aussi la reprise du célèbre et vieil ouvrage de Berton : Aline, reine de Golconde.
En mars 1848, l'entreprise s'arrête et l'Opéra national demeure silencieux jusqu'au 27 septembre 1851, c'est-à-dire pendant plus de trois ans. C'est seulement l'année suivante, le 12 avril 1852, qu'il épouse définitivement le titre de Théâtre-Lyrique. « L'adjectif « national » n'était plus de mode en 1852 », remarque A. de Lasalle.
Le Théâtre-Lyrique s'installa dans la salle du Théâtre historique, fondé par Alexandre Dumas en 1847, ajoutant ainsi l'élément musical à ce groupe de théâtres dramatiques ou comiques qui s'alignaient le long du boulevard du Temple, précisément, dit notre annaliste, à la place du rempart élevé par François Ier pour préserver Paris des attaques des Flamands.
Elle était belle, cette salle, ou du moins mes souvenirs de jeunesse me la font voir sous un assez somptueux aspect, avec son ornementation rouge el or et son plafond triomphal où Desplechin, Dieterle et Séchan avaient peint Apollon, conduisant son quadrige à travers un ciel resplendissant.
Depuis le 27 septembre 1851 jusque 1863, que d'ouvrages ont défilé là, les plus marquants sous la direction de M. Léon Carvalho, dont le nom est désormais inséparable de la fortune de ce théâtre et qui aurait de bien curieux souvenirs à raconter, sans doute, sur les hommes et les œuvres de ce temps, si on avait la bonne fortune de feuilleter en sa compagnie le mémorial que j'ai sous les yeux !
Il ne faut parler, parmi ces œuvres, que de celles qui y virent le jour et non point des reprises parfois importantes et presque toujours intéressantes. Les petits actes nouveaux, aujourd'hui si dépréciés, du moins si dédaignés, y étaient alors nombreux et on leur accordait une assez sérieuse attention. Très peu sont restés pourtant ; mais des auteurs tels qu'Eugène Gautier y ont trouvé fréquemment la satisfaction de leur modeste ambition et y ont multiplié ces échantillons en un acte de leur savoir-faire.
Là, en 1851, Félicien David a donné son premier ouvrage dramatique : la Perle du Brésil, opéra en trois actes où le poète musical du Désert s'était retrouvé dans ces pays du soleil toujours cher à son imagination.
Là, on a fêté Si j'étais roi !, d'Adolphe Adam, qu'on revoit encore de loin en loin sur les affiches départementales et parfois sur celles de Paris ; là ont, été applaudis les Amours du Diable, de Grisar, et ce Bijou perdu, encore d'Adolphe Adam, que le populaire couplet des Fraises a assuré contre l'oubli. Là aussi, M. Reyer a débuté avec un petit acte charmant, Maître Wolfram. Jaguarita l'Indienne y a été la brillante part de F. Halévy. L'éminent directeur actuel du Conservatoire de Bruxelles y a marqué son passage par un ouvrage de demi-caractère, les Lavandières de Santarem ; la Fanchonnette de Clapisson y a eu ses jours de gloire, grâce au début sensationnel de Mme Miolan-Carvalho ; les Dragons de Villars, d'Aimé Maillart, y ont été un des ouvrages à succès de l'année 1856, ainsi que la Reine Topaze de Victor Massé.
Enfin, en 1858, Gounod y faisait sa première apparition avec ce chef-d’œuvre d'esprit et de bonne humeur qui est le Médecin malgré lui et que devait suivre, un an après, le glorieux Faust, alors jugé avec une sévérité faite pour rendre philosophes ceux de nos contemporains à qui le succès ne sourit pas dès leur première rencontre avec le public ou la critique et qui, pourtant, sont conscients de leur réelle force. Philémon et Baucis, en 1860, continuait la série des ouvrages du maître. Accueil encore froid, partition classée depuis à son véritable rang et qui ne quitte plus le répertoire. La Statue de M. Ernest Reyer brille au tableau de 1861. C'est une œuvre d'un coloris charmant et d'une exquise poésie ; elle n'a jamais eu le succès qu'elle mérite. On trouve enfin, avant, la migration du Théâtre-Lyrique vers la place du Châtelet où sa fortune devait s'achever, la Chatte merveilleuse d'Albert Grisar, qui, démodée sans doute aujourd'hui sur la même scène, ferait peut-être encore la fortune d'un théâtre musical de genre comme la Gaîté.
Sur la scène toute neuve de la place du Châtelet, le début fut, sans éclat avec l'Ondine de Semet ; mais bientôt une constellation brillante se lève dans ce ciel nouvellement ouvert. Et voici les Pêcheurs de perles, de Bizet, les Troyens, de Berlioz, et Mireille, et Roméo et Juliette de Gounod ! L'année 1869 voit la première représentation du Rienzi de Wagner. Gros événement que l'apparition de cet ouvrage désavoué par les fanatiques du maître, et où de larges coupures furent pratiquées pourtant « pour le rendre plus digestible ». Depuis, nous en avons vu bien d'autres, et bien des conversions se sont faites de gens qui, en 1869, se disaient inébranlables dans leur foi ancienne.
Avec la reprise de Charles VI donnée le 6 avril 1870, se termine l'existence du Théâtre-Lyrique de la place du Châtelet. Il fut glorieux et sa disparition reste à jamais regrettable. De 1871 à 1894, vingt-trois années écoulées ; vingt-trois années perdues pour les militants de l'école française !
|
|
Histoire du Théâtre-Lyrique, 1851-1870
(Albert Soubies, 1899)
PRÉFACE
Nos précédentes études sur les grandes scènes parisiennes ont été consacrées à l'Opéra, à l'Opéra-Comique et à la Comédie-Française, théâtres bien vivants et en pleine possession de la faveur publique. On s'étonnera peut-être que dans cette série de monographies d'un nouveau genre nous donnions place aujourd'hui au Théâtre-Lyrique qui, ouvert le 27 septembre 1851, a été définitivement fermé le 31 mai 1870. C'est qu'un tel sujet, pour rétrospectif qu'il paraisse, n'en est pas moins « actuel ». Il ne se passe guère en effet de saison où ne surgisse quelque projet de Théâtre-Lyrique, conçu presque toujours d'après un plan exclusif et incomplet, mais intéressant à plus d'un titre et correspondant à une préoccupation constante et générale. D'ailleurs, en dehors de la période dont nous nous occupons spécialement ici, le Théâtre-Lyrique, sous des formes variées, dans des emplacements divers, a souvent essayé de vivre ; on pourrait presque dire, tant ces essais ont été nombreux, qu'il n'a jamais cessé d'exister. Antérieurement à 1851, on le trouve à l'état rudimentaire, au Gymnase en 1820, à l'Odéon en 1824, aux Nouveautés en 1827, à l'Ambigu en 1830, à la Renaissance en 1838, à Beaumarchais en 1848, au Cirque Olympique en 1847. Cette dernière tentative, la plus digne d'attention, fut précaire. Par une espèce d'ironie du sort, ce qui l'interrompit ce furent justement les événements révolutionnaires qu'on avait fêtés tout d'abord sur cette scène avec un à-propos intitulé les Barricades. Cette entreprise, où Adam perdit sa fortune, a été confondue par certains auteurs (par Albert de Lasalle, notamment, dans son utile et souvent amusant Mémorial), avec le « vrai » Théâtre-Lyrique qui fut ouvert peu de temps après. Depuis la guerre, on a vu, dans le même sens, nombre d'autres ébauches à la Salle Ventadour et à la Gaîté, au Châtelet et à la Renaissance, au Théâtre des Nations et à la Porte-Saint-Martin, aux Menus-Plaisirs, à Beaumarchais, à l'Eden, au Nouveau-Théâtre, à l'ancien Athénée, aux Variétés, à la Salle Taitbout, et même au minuscule établissement de la Galerie- Vivienne où, en dépit de l'exiguïté de la scène, on n'a pas craint de monter de grands opéras tels que Norma et Lucie, enfin et surtout au Château-d'Eau, domicile d'élection pour ce que l'on pourrait appeler « le Théâtre-Lyrique intermittent ». Sur tout cela il y aurait un livre à faire, livre jadis esquissé par M. Pougin dans une suite d'intéressants articles. Si nous nous bornons, quant à nous, à la période comprise entre 1851 et 1870, c'est parce que c'est la seule où la troisième scène lyrique parisienne ait fonctionné sans aucune interruption ; avec l'appui, pendant quelques années du moins, de l'État, ce qui ne veut pas dire que la subvention reçue fût suffisante ; sous la direction enfin d'hommes exercés, capables, qui successivement ont fait, dans leur gestion, prévaloir les différents systèmes mis en avant toutes le fois qu'il s'est agi de constituer cet organe essentiel de la vie artistique. Ajoutons que si ces directeurs ont recueilli moins de profit que d'honneur, si même quelques-uns furent malheureux, ils ont été tous animés d'un zèle esthétique véritablement élevé, ils ont consciencieusement servi la cause de l'art, et ont laissé, à cet égard, une trace profonde. L'histoire du Théâtre-Lyrique de 1851 à 1870 est incontestablement le plus intéressant de tous les chapitres que l'on puisse consacrer au mouvement et à l'évolution du théâtre musical à Paris, sous le Second Empire.
PREMIÈRE PARTIE LA SALLE DU BOULEVARD DU TEMPLE
Alexandre Dumas avait, en 1847, fondé, au boulevard du Temple, le Théâtre-Historique. Cette salle devint celle du Théâtre-Lyrique, inauguré le 27 septembre 1851. Remarquons, tout d'abord, que le nom de « Théâtre-Lyrique » ne fut adopté, pour cette entreprise, que le 12 avril de l'année suivante. A l'ouverture, l'appellation choisie fut celle d'Opéra-National, qui avait déjà servi, en 1847, pour la tentative d'Adam au Cirque Olympique. « Opéra-National », d'ailleurs, ne valait pas « Théâtre-Lyrique », dénomination si heureuse qu'elle a prédominé depuis pour la plupart des essais analogues, et qu'elle peut être utilisée pour l'histoire de toutes les restaurations, accomplies ou projetées, d'une troisième grande scène musicale parisienne. Il avait été un moment question d'installer le théâtre naissant à la Porte-Saint-Martin. Le Théâtre-Historique, définitivement préféré, présentait à l'extérieur un aspect caractéristique, en ce que sa hauteur était considérable, alors que sa largeur ne dépassait pas huit mètres. On l'avait complètement remis à neuf. A cette occasion, les statues de Corneille et de Molière, qui auparavant ornaient les deux avant-scènes, avaient été remplacées par celles de Lulli et de Gluck. Au-dessus du rideau, à la place du cartouche central traditionnel, figurait une horloge autour de laquelle, par une association assez bizarre, se lisaient les noms singulièrement inégaux de Dalayrac, de Cherubini, de Grétry, de Mozart. Pour la direction l'on s'était trouvé en présence de plusieurs candidatures, en particulier celle de M. Basset, ancien directeur de l'Opéra-Comique. Celui qui l'emporta fut Edmond Seveste, administrateur depuis quelques années des petits théâtres de la banlieue. Il eut parmi ses collaborateurs M. Croharé, accompagnateur, (depuis l'un des chefs de chant de l'Opéra), et M. Varney, le père du compositeur des Petits Mousquetaires, auteur lui-même du Chant des Girondins, un instant populaire. « Les premiers pas », s'il est permis d'adapter à la circonstance le titre du prologue joué en 1847 à l'ouverture de l'Opéra-National, les premiers pas donc furent assez heureux. Dès le début M. Edmond Seveste avait compris la principale difficulté de sa tâche, celle de concilier le goût du public, de sa nature assez méfiant, prompt à s'effaroucher de ce qui est hardi, et les aspirations, généralement contraires, des jeunes compositeurs. Il importait d'abord de créer un répertoire capable d'alimenter le théâtre d'une façon lucrative, de remplir avantageusement l'interstice entre deux ouvrages inédits ; ensuite, dans le choix des pièces nouvelles, il fallait, tout en ménageant une place aux débutants, ne pas négliger les artistes arrivés, dont la réputation, propre à attirer les auditeurs, fût un gage de succès. C'est ainsi que, dès l'origine, Seveste s'occupa de se constituer un répertoire français avec des reprises du Maître de chapelle, des Rendez-vous bourgeois, (ils ne se maintinrent pas longtemps à ce théâtre et revinrent bientôt à l'Opéra-Comique, leur vrai cadre), de Ma Tante Aurore, avec son fameux air de trente-six mesures sur trois notes, de Maison à vendre, d'Ambroise et des Travestissements. En ce qui concerne l'étranger, c'est alors que fut créée la tradition d'après laquelle le Théâtre-Lyrique devait faire une part importante aux traductions, négligées en principe à l'Opéra-Comique, et travailler à rendre populaires certains chefs-d’œuvre plus malaisément accessibles pour la foule à l'Opéra ou aux Italiens. Se conformant à ce plan, Seveste avait, pour second spectacle, préparé une reprise du Barbier qui, dans une double carrière poursuivie d'abord au boulevard du Temple puis à la place du Châtelet, était destiné à fournir, au Théâtre-Lyrique, cent vingt-six représentations. La veille de la mise à la scène du Barbier, on avait donné Mosquita la Sorcière, opéra-comique de Boisselot, en ce temps-là encore presque un débutant ; un autre ouvrage de lui Ne touchez pas à la Reine, avait, à la salle Favart, obtenu un accueil très favorable. L'œuvre nouvelle ne se maintint pas longtemps sur l'affiche. A Mosquita, à un mois d'intervalle succéda Murdock le Bandit, un acte d'Eugène Gautier, depuis professeur d'histoire de la musique au Conservatoire, et qui donna de nombreux petits ouvrages durant les premières années d'existence du Théâtre-Lyrique. Vers la même date, enfin, on joua une œuvre plus saillante, la Perle du Brésil. L'auteur était Félicien David, rendu célèbre par ses odes-symphonies, principalement par le Désert, — ce Désert que, par parenthèse, quelques années après, il fut question de jouer avec décors et costumes, comme on l'a fait récemment à Monte-Carlo pour la Damnation de Faust. Ainsi, dans un court espace de temps, s'étaient à peu près réalisées toutes les conditions du programme qu'avait conçu Seveste, programme qui, il faut l'ajouter, s'impose à tout directeur d'un Théâtre-Lyrique en état de durer. Sans être étourdissant, le succès suffisamment brillant de la Perle du Brésil s'affirma, de 1851 à 1853 et de 1858 à 1864, par deux séries de soixante-huit et de soixante-seize représentations. L'interprète du principal rôle était Mlle Duez, déjà fort appréciée dans Rosine. On y vit paraître par la suite Mmes Carvalho et Marimon. La Perle du Brésil, mentionnons-le en passant, est la première en date, entre les pièces jouées d'origine au Théâtre-Lyrique, qui ont enrichi plus tard le fonds d'une autre scène. Un début de gestion présente des difficultés presque insurmontables, quand on n'a pas de vastes ressources et une réserve sérieusement assurée. Pour les commencements, peu sensationnels, de l'année 1852, nous ne trouvons que la reprise des Visitandines, bizarrement réintitulées, par un scrupule peu explicable, le Pensionnat de jeunes demoiselles, et trois pièces nouvelles, dont deux en un acte. L'une de ces dernières, la Poupée de Nuremberg, se joue encore. Mais les meilleurs levers de rideau influent peu sur la recette. Le 28 février la mort enleva Edmond Seveste, à la mémoire de qui le baron Taylor devait, deux ans plus tard, consacrer ces lignes émues : « Il mourut à la tâche, on peut le dire, emportant la réputation d'un administrateur intègre, mais en laissant sa veuve et ses enfants sans ressources et sans aucun moyen de satisfaire à des dettes considérables, inévitable résultat des calamités (ce mot seul était un peu trop fort) de sa gestion. Aucun moyen, disons-nous ? Nous nous trompons. Il en était un, un seul, mais qu'un noble cœur pouvait seul réaliser. Jules Seveste sollicita et obtint la direction vacante, et, au premier succès, son premier acte administratif fut d'acquitter les dettes qu'avait contractées son frère. » Ce premier succès ne se produisit qu'au début de la saison musicale suivante. La fin de celle qu'avait attristée la mort d'Edmond Seveste n'avait été remplie que par une traduction de la Gazza ladra (la Pie voleuse), insuffisamment interprétée, et la mise à la scène, à Paris, d'une pièce en trois actes antérieurement montée à Bruxelles, Joanita ; pour cet ouvrage, par une particularité digne de remarque, le nom de Duprez figurait trois fois sur l'affiche ; en effet, tandis que la musique était de Gilbert Duprez, le célèbre chanteur, les paroles avaient pour auteur Edouard Duprez, son frère, et Mlle Caroline Duprez personnifiait l'héroïne de la pièce. Les premières semaines de la saison 1852-1853 furent signalées par une réussite éclatante et durable, celle de Si j'étais roi ! d'Adolphe Adam. Nous n'avons eu jusqu'ici à citer son nom qu'à propos du gentil petit acte de la Poupée de Nuremberg. Disons tout de suite qu'il lui était réservé d'être le compositeur le plus souvent joué au Théâtre-Lyrique, où il arriva à un total de huit cent soixante-dix-neuf représentations, avec cinq partitions empruntées à l'Opéra-Comique : le Postillon et le Roi d'Yvetot, reprises où l'on entendit le créateur de ces deux personnages, Chollet, la Reine d'un jour, le Brasseur de Preston, le Sourd ; — et huit nouveautés, la Poupée et Si j'étais roi ! mentionnés ci-dessus, puis le Roi des halles, le Bijou perdu, le Muletier de Tolède, A Clichy, Falstaff et Mam'zelle Geneviève. Dans un volume, devenu très rare, des frères de Goncourt, les Mystères des théâtres, on trouve de Si j'étais roi ! un compte rendu qui est un excellent spécimen d'un genre alors très à la mode, celui d'une sorte de fantaisie à la fois spirituelle et laborieuse, où une érudition un peu factice se rehausse d'un badinage non exempt de préciosité. La réussite très vive de cet opéra-comique s'est renouvelée à Paris, lors de la reconstitution éphémère du Théâtre-Lyrique à la Gaîté et au Château-d'Eau. En province, le succès se soutient encore. A l'origine ce fut de l'engouement, et, pour ménager les interprètes, en prévision d'une série de représentations dont on n'apercevait pas la fin, on fit jouer l'ouvrage par une double troupe, alternant d'une soirée à l'autre. La vogue de Si j'étais roi ! n'empêcha pas Jules Seveste d'effectuer avant la fin de l'année deux reprises, celles du Postillon et des Deux Voleurs, de Girard. En même temps il mettait à la scène cinq petites pièces nouvelles en un ou deux actes. L'une dépassa la centième. C'était Flore et Zéphyre, musique d'Eugène Gautier, sorte d'imitation des Vieux Péchés, où nous nous souvenons d'avoir vu Bouffé et Mlle Pierson. Un autre de ces petits ouvrages, Tabarin, avait pour auteur Georges Bousquet, qui mourut jeune. A Rome il avait été le camarade de Gounod, auquel Fanny Mendelssohn, qui n'avait du reste entendu de lui qu'un scherzo sans importance, n'était pas très éloignée de préférer son compagnon ; une cantate de ce dernier lui plaisait beaucoup. Outre les Amours du Diable, de Grisar, très favorablement accueillis, et qu'on a revus plus tard à l'Opéra-Comique, au Châtelet et au Château-d'Eau, l'année 1853, comme pendant à Si j'étais roi ! nous présente le triomphe populaire du Bijou perdu que l'on répéta sous le titre de la Jardinière. Tout Paris courut applaudir les couplets des « fraises » chantés par Mme Marie Cabel, que le directeur venait d'avoir la bonne inspiration d'engager. Comme particularité de cette même année, il convient de citer divers essais tentés pour acclimater au Théâtre-Lyrique un genre auquel on renonça promptement, l'opéra-ballet. Malgré les talents chorégraphiques déployés par Mme Guy-Stephan dans le Lutin de la vallée et par Mlle Nathalie Fitz-James dans le Danseur du Roi, malgré la virtuosité fantaisiste dont Saint-Léon fit preuve, sur le violon, dans ces deux pièces, elles n'eurent qu'une courte existence. Il en fut de même, l'année suivante, pour les Étoiles, de Pilati. Nous renvoyons à notre tableau pour le détail des autres pièces données ou reprises en 1853. Une seule s'imposa de façon durable, l'amusant petit acte de Bonsoir Voisin, dont le sujet avait été suggéré aux auteurs, Brunswick, Arthur de Beauplan et Poise, par un dessin de Gavarni, et au service duquel Meillet et sa femme avaient mis leur verve, leur sûr et souple talent. Relevons au passage l'apparition sur l'affiche de noms nouveaux et intéressants, celui de Jules Verne, auteur avec Michel Carré du livret de Colin-Maillard, dont la musique était d'Aristide Hignard, celui de Weckerlin (l'Organiste dans l'embarras), celui de Gevaert (Georgette). Dans une reprise du Diable à quatre, de Solié, mentionnons le début de Mme Girard, la mère de l'accorte et piquante divette si souvent applaudie sur nos scènes de genre. Notons enfin la représentation, avec une fortune médiocre, d'un opéra posthume de Donizetti, Élisabeth. En 1854, du 1er janvier à la clôture annuelle d'été, il convient de signaler la continuation des productives représentations du Bijou perdu, puis trois reprises : le Panier fleuri, la seule pièce d'Ambroise Thomas qui ait figuré au répertoire du Théâtre-Lyrique, la Reine d'un jour et le Tableau parlant. Deux nouveautés méritent de n'être pas laissées de côté : d'abord la Promise, la deuxième création de Mme Cabel. C'était le début au Théâtre-Lyrique de Clapisson, dont un critique autorisé, G. Héquet, louait « l'orchestration très recherchée ». La seconde des deux œuvres auxquelles nous venons de faire allusion est Maître Wolfram, le premier essai dramatique de M. Reyer, connu seulement jusque-là par la partition colorée du Sélam. Nous avons raconté ailleurs l'histoire de Maître Wolfram, que créèrent Laurent, Talon, Grignon et Mme Meillet. Encouragé par le succès, le compositeur se remit au travail. Deux ans après, on annonçait au Théâtre-Lyrique la représentation d'une autre œuvre de lui, Erostrate. Mais il était écrit que les Parisiens n'entendraient Erostrate qu'en 1871, à l'Opéra, et, — coïncidence étrange, étant donné le dénouement de la pièce, l'embrasement du temple d'Éphèse, — quelques mois après l'incendie des Tuileries et de l'Hôtel de Ville. Maître Wolfram avait été joué le 20 mai. Six semaines plus tard, le 30 juin, Jules Seveste mourait subitement à Meudon. Cette fin prématurée le surprenait au moment où la fortune commençait à lui sourire. Sa dernière année de gestion avait été, matériellement, heureuse. Quinze jours avant de succomber il avait renouvelé son bail pour dix ans, et il avait reçu la promesse formelle d'une subvention officielle, subvention toujours si ardemment sollicitée, mais, disons-le, plus dangereuse que réellement utile quand elle n'est pas largement calculée, et qui d'ailleurs ne fut touchée qu'en 1864, par Carvalho. Nous avons rapporté plus haut les éloges par lesquels le baron Taylor avait, chez Jules Seveste, vanté les qualités de l'homme. L'administrateur, en lui, n'était pas moins méritant. Sans doute, si l'on excepte quelques artistes pour la plupart nommés déjà dans les pages qu'on vient de lire, Mme Cabel en tête, et auxquels on pourrait joindre Junca, Leroy, Dulaurens, Philippe, Bouché, Coulon, Mmes Colson, Petit-Brière, la troupe qu'avaient formée les frères Seveste se recommandait plutôt par l'homogénéité que par l'éclat et le nombre des « étoiles ». Sans doute aussi, en dépit des louanges un peu libéralement accordées par les Goncourt, dans le trop scintillant article cité plus haut, à la mise en scène de Si j'étais roi ! qui les avait facilement éblouis, les pièces étaient en général montées d'une façon simple, parfois même rudimentaire ; à la première de la Butte des Moulins, d'Adrien Boieldieu, on s'était étonné à bon droit, par exemple, de voir un superbe palmier s'étaler au milieu d'une place parisienne. Il faut d'ailleurs, pour porter sur tout cela une appréciation juste, se rappeler la situation du Théâtre-Lyrique d'alors, un théâtre de boulevard ; le prix des places (le taux des plus coûteuses ne dépassait pas cinq francs) ; les exigences d'un public passablement vorace, avec lequel la qualité, sans qu'il en fût insoucieux, ne pouvait dispenser de la quantité. Certain soir, à une représentation commençant à cinq heures trois quarts et composée de six actes, parmi lesquels comptaient les trois longs actes de Si j'étais roi ! le directeur ayant cru pouvoir, pour économiser le temps, supprimer l'ouverture de la pièce d'Adam, l'auditoire protesta avec tant d'insistance qu'il fallut, le rideau déjà levé, se décider à jouer cette ouverture. Après tout, grâce à la réelle habileté dont la direction avait fait preuve, le théâtre avait vécu. En moins de trois ans les deux frères Seveste avaient joué, ou plus exactement monté, puisque le théâtre était leur création, quatre-vingt-douze actes et quarante-six pièces, dont vingt-neuf nouvelles, ces dernières dues, dans une très forte proportion, à des débutants. En somme ils avaient compris la double obligation, en apparence contradictoire, qui incombe au chef d'un théâtre de ce genre : servir l'art tout en le mettant à la portée de tous, plaire au public tout en assurant un large débouché aux jeunes compositeurs. *** Le Théâtre-Lyrique avait clos ses portes le 2 juin : il les rouvrit, le 30 septembre, avec la suite des représentations de la Promise. Le directeur nouveau était M. Perrin. Il réalisait ainsi le projet, que, toute sa vie, il ne cessa de caresser : celui de réunir, sous une même administration, deux théâtres, littéraires ou musicaux. Les choses, d'ailleurs, pour arriver à ce but, n'avaient point, comme l'on dit, marché toutes seules. La Société des Auteurs présentait des objections. Un instant, M. Perrin avait été démissionnaire ; toutefois on aboutit à une entente. La véritable « entrée de jeu » fut, le 7 octobre, le Billet de Marguerite, de M. Gevaert, où un joli duo, en particulier, fixa l'attention des connaisseurs. Il avait pour interprètes deux artistes jeunes dont les noms étaient destinés à acquérir au théâtre une grande notoriété. C'étaient Léon Achard, chanteur fort distingué, excellent comédien, dont la carrière a été si remplie, et Mme Deligne-Lauters (plus tard Mme Gueymard), dont on se rappelle encore la voix chaude et colorée, les dons accusés de tragédienne, et la supérieure habileté de cantatrice. Avec de telles recrues le Théâtre-Lyrique changeait un peu de nature ; au reste, du moment où Mme Cabel avait été engagée, la métamorphose avait commencé ; il ne s'agissait plus, dès lors, de la simple scène « du boulevard », peu mondaine, peu parisienne, à propos, de laquelle un critique, parlant des heureux débuts de Junca, cité plus haut, avait pu dire : « Il voulait venir à Paris ; il n'est arrivé qu'au boulevard du Temple ». Ce mouvement ascendant allait s'accentuer. Graduellement, le Théâtre-Lyrique tendait à devenir l'un des organes principaux de la vie artistique. En même temps que la troupe s'augmentait, s'enrichissait d'éléments précieux, on déployait une activité soutenue : outre le Billet de Marguerite on monta, avant le 31 décembre, cinq pièces, dont une en trois actes, le Muletier de Tolède, d'Adam, ouvrage faible, mais auquel le talent de Mme Cabel prêta assez de vie pour lui assurer cinquante-quatre représentations. Une autre de ces pièces, A Clichy, due au même compositeur, fut jouée quatre-vingt-neuf fois. C'était une sorte de pochade d'atelier, une esquisse amusante à trois personnages d'hommes. Deux grands succès devaient signaler tout ensemble la direction Perrin et l'année 1854, la reprise de Robin des Bois et la création de Jaguarita l'Indienne, qui, dans les journaux à caricatures de l'époque, devint un moment « l'Indienne mauvais teint ». Robin des Bois avait jadis été le plus vif succès musical de l'Odéon, dans la période où la musique y alternait avec la littérature. Il était évidemment bizarre, de la part de Castil-Blaze, d'avoir imposé ce titre anglo-écossais à une œuvre si foncièrement germanique. De plus, Robin des Bois différait du Freischütz original non seulement par les fantaisies introduites dans le livret, mais encore par les coupables libertés prises aux dépens de la partition de Weber. Conservant néanmoins une bonne part de ses attractions magistrales, fort bien chantée, surtout par les femmes, Mmes Deligne-Lauters et Girard, mise en scène avec le goût et l'art par lesquels se distinguait Émile Perrin, l'œuvre, sous ce pseudonyme injustifié de Robin des Bois, arriva, tout compte fait, à cent vingt-huit représentations. Redonnée plus tard, en 1866, sous son titre authentique : le Freischütz, et cette fois conformément au texte vrai, avec Mme Carvalho, comme protagoniste, elle fut encore jouée soixante-treize fois. Rappelons que le nom de « Robin des Bois », héros de chasses légendaires, avait été un sobriquet donné à Charles X, passionné, on le sait, pour ce plaisir, auquel il se livrait souvent, en grand apparat, escorté de gardes du corps et d'autres détachements de sa maison militaire. Une réussite également très vive, nous l'avons dit, fut celle de Jaguarita, précédée pendant quelque temps, en guise de lever de rideau, d'un acte, l'Inconsolable, signé Alberti (lisez : Halévy). Dans Jaguarita Mme Cabel, qui devait reprendre ce rôle quatorze ans plus tard à l'Opéra-Comique, avait pour partenaire un ex-jeune premier de l'Odéon, Monjauze, ténor à la voix métallique, dont la carrière a longtemps été brillante. Il faut indiquer aussi comme ayant, vers cette date, plu au public, une petite pièce, les Charmeurs, de Poise, remontés, en 1876, â la Gaîté. Mentionnons pareillement la reprise de la Sirène, le 19 juin, avec Achard, Dulaurens, Colson, Prilleux, et une débutante, Mlle Pannetrat. On remarquera que la Sirène est, entre les œuvres d'Auber, la seule qui ait été jouée sur cette scène, où le répertoire d'Adam fut si largement représenté. Cela s'explique peut être par le caractère plus franchement populaire de ce dernier, tandis qu'Auber, plus élégant, plus aristocratique, était davantage chez lui sur une scène voisine de ces quartiers que Balzac désigne sous le nom approximatif et générique de « la Chaussée d'Antin ». Nous ferons observer en passant que, parmi les musiciens de valeur qui durant la période comprise entre 1851 et 1870 ont eu une ou plusieurs œuvres représentées à l'Opéra-Comique, six seulement n'ont jamais paru sur l'affiche du Théâtre-Lyrique : avec Meyerbeer, le plus illustre de tous, ce sont Bazin, Reber, Duprato, Offenbach et M. Massenet. Il est à certains égards surprenant que, malgré le succès de Robin des Bois et de Jaguarita, malgré l'ouverture de l'Exposition Universelle, les portes du Théâtre-Lyrique se soient, en 1855, fermées le 30 juin pour ne se rouvrir que le 1er septembre. Moins de deux mois après, Perrin se retirait, après une reprise de Marie, le joli ouvrage d'Herold, chanté par Mlle Bourgeois, MM. Achard et Leroy. M. Perrin d'ailleurs n'avait pas eu, autant qu'il l'espérait, à se féliciter des résultats de sa double entreprise. L'Opéra-Comique souffrait de ce cumul. Instruit par l'expérience, le directeur passa la main à Pellegrin, organisateur des représentations théâtrales au camp de Châlons. Celui-ci ne fut pas chanceux avec sa première nouveauté importante, les Lavandières de Santarem, de M. Gevaert. Le mémorial, pour la fin de l'année 1855, se complète par une reprise infructueuse du Solitaire, de Carafa, et trois petits actes ; l'un d'eux, le Secret de l'Oncle Vincent, de Lajarte, a passé par la suite au répertoire de l'Athénée. L'année 1856 débuta, pour Pellegrin, par deux pièces d'Adam, le Sourd, emprunté à l'Opéra-Comique, et Falstaff, avec Hermann-Léon, qui, à la salle Favart, avait déjà, dans le Songe d'une nuit d'été, incarné le héros de Shakespeare. En remplacement de Mme Cabel qu'Émile Perrin avait emmenée avec lui, le directeur du Théâtre-Lyrique venait de contracter un engagement « sensationnel », celui de Mme Carvalho, — originairement Mlle Miolan, — si applaudie à la salle Favart, la créatrice de Giralda et des Noces de Jeannette, Mais Pellegrin n'eut pas le temps de recueillir le bénéfice de cette initiative heureuse. Comme Anténor Joly à la Renaissance, faisant faillite au moment où il se disposait à monter l'Ange de Nisida, qui devint la Favorite, Pellegrin fut contraint de déposer son bilan à la veille du jour où la fortune allait lui sourire. Les artistes du théâtre essayèrent de se constituer en société ; ils n'y arrivèrent pas. C'est alors que les auteurs de la Fanchonnette résolurent de s'adresser au mari de la diva récemment engagée, en lui demandant de se charger de la direction. M. Carvalho accepta, et le 1er mai 1856 eut lieu la première représentation de cette Fanchonnette, par laquelle devait s'ouvrir une série de grands succès. *** En se reportant par la pensée à l'époque où fut donnée la Fanchonnette, en tenant compte du goût alors régnant, on s'explique sans peine l'éclatante réussite qu'obtint l'ouvrage de Clapisson. L'œuvre, au reste, du moins pour la foule, conserve de la saveur et figure presque constamment au programme des entreprises plus ou moins lyriques que l'on voit se produire au Château-d'Eau. Il faut songer qu'en 1855, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, on félicitait couramment Clapisson pour l'élégance, la recherche savante de son orchestration. On se souciait peu de Wagner ; si par hasard on s'occupait de lui dans un journal, c'était sur un ton cavalier, irrévérencieusement ironique, comme en cette note, découpée dans la Gazette musicale, vers cette date : « M. Richard Wagner a quitté Londres au lendemain même du dernier concert de la Société Philharmonique, enchanté sans doute de s'éloigner précipitamment d'une ville si enfoncée dans les impénétrables ténèbres du présent, et si sourde à la voix prophétique de l'avenir. » De plus, indépendamment de son relatif mérite musical, la Fanchonnette offrait l'attrait d'un livret agréable ; le tableau populaire du premier acte avait paru amusant, pittoresque ; ces scènes où il y a de l'entrain, une couleur franche, se trouvaient bien à leur place au boulevard du Temple. C'était là, toute proportion gardée, une sorte de Fille de Madame Angot. Enfin et surtout la pièce bénéficiait de la présence de Mme Carvallo, alors dans toute la fleur de son jeune talent ; de celle qui, après avoir chanté délicieusement les rôles légers de l'opéra-comique, allait bientôt, dans son effort ascensionnel, réaliser de façon supérieure le Chérubin de Mozart, puis incarner Marguerite et Baucis, Mireille et Juliette ; de celle qui représente peut-être le plus complètement l'art vocal français dans cette partie du siècle ; de celle, en un mot, qui devait être dorénavant, en quelque sorte, l'âme du Théâtre-Lyrique, puisque son absence, de 1860 à 1862, et son départ définitif pour l'Opéra, en 1868, furent le signal de périodes néfastes dans l'histoire du théâtre qu'elle abandonnait. A la Fanchonnette, à quelques semaines d'intervalle, succédait, en échouant d'ailleurs devant le public, Mam'zelle Geneviève, d'Adam, sa dernière œuvre, la dernière du moins au Théâtre-Lyrique, car il devait encore donner, aux Bouffes-Parisiens, les Pantins de Violette, gentille bagatelle qu'il avait originairement composée pour amuser sa fille. Producteur infatigable, Adam succomba, on peut le dire, à la peine. Ruiné et endetté par suite de la fermeture de l'Opéra-National, il ne goûta un peu de repos qu'après avoir dédommagé tous ses créanciers. Il convient de saluer au passage ce parfait honnête homme, cet artiste doué d'une imagination si féconde, qui fut en outre un critique instruit, accessible aux idées de progrès, impartial, indulgent et spirituel. Adam était mort subitement le 3 mai. Ce n'est point le quitter tout à fait que parler de la reprise, effectuée le 23 mai, de Richard, interprété par Meillet, Michot et Mlle Girard. Personne en effet n'ignore que l'orchestration retouchée de Richard était due à l'auteur de Si j'étais roi ! Notons que le chef-d'œuvre de Grétry, par ses trois cent deux représentations, a été, au Théâtre-Lyrique, la pièce la plus souvent exécutée après Faust qui arrive au total de trois cent six. Mais la Fanchonnette et la brillante reprise de Richard ne furent pas les seuls événements dignes de mémoire en cette année exceptionnelle. Il nous faut citer encore deux pièces nouvelles, les Dragons de Villars avec une débutante à la voix agile et au jeu plein de verve, Mlle Borghèse qui ne fit que passer, et la Reine Topaze avec Mme Carvalho. Ces ouvrages, l'un et l'autre en trois actes, et dont le premier se joue encore à l'Opéra-Comique, émanaient de compositeurs jeunes et dans toute la force de leur talent. La musique des Dragons de Villars est plus saillante que celle de la Fanchonnette. Mais ce que nous avons dit de l'une s'applique en partie à l'autre. Peut-être a-t-on quelque tendance à juger aujourd'hui avec trop de sévérité la partition de Maillart. Sans rappeler tant de morceaux devenus promptement célèbres, tels que la romance fameuse « Ne parle pas » et le grand air de la fin, le « Moi jolie » du deuxième acte, si délicat, si candidement ingénu, avec son rayon de poésie douce et vraie, suffirait seul pour désigner l'auteur comme un musicien de mérite. Détail plaisant : Maillart, installé à Bougival, et pressé par M. Carvalho d'envoyer son orchestration qu'il ne se hâtait pas de finir, en confiait les fragments à un de ses amis, chasseur d'Afrique, dont l'arrivée à cheval au théâtre faisait régulièrement sensation. On sait, d'autre part, que la pièce avait été refusée à l'Opéra-Comique parce que le sujet avait paru « trop noir ». Le succès de la Reine Topaze, moins durable que celui des Dragons de Villars, fut tout d'abord encore plus éclatant : cent treize représentations en 1857 ! Tout Paris fredonna la « chanson de l'abeille », dont les vers étaient d'Hégésippe Moreau. Il n'était point d'ailleurs nommé sur l'affiche. La collaboration de MM. Philippe Gille et Camille du Locle demeura également anonyme. Ce n'était pas seulement par Mme Carvalho que l'interprétation de l'œuvre de Victor Massé pouvait attirer l'attention. A côté d'elle on applaudit Monjauze, Meillet, et, dans des rôles épisodiques et divertissants de « tire-laine », deux débutants appelés, le second surtout, à se faire une grande place à ce théâtre : le ténorino Fromant, et le créateur de Méphistophélès, Balanqué. Aux pièces énumérées ci-dessus comme montées par M. Carvalho depuis sa nomination de directeur, il faut joindre un petit acte, le Chapeau du Roi, remarquable uniquement par le nom du librettiste, l'érudit Édouard Fournier, qui avait fait par hasard cette incursion dans un genre qui n'était pas le sien. Ces cinq œuvres appartenaient foncièrement au genre de l'opéra-comique, c'est-à-dire, avec une analogie poussée jusqu'à l'identité, au genre qui florissait à la salle Favart. La rivalité entre les deux théâtres pouvait devenir funeste à l'un et à l'autre : à tout le moins il y avait double emploi. Émile Perrin, malgré sa rare habileté, en avait, dans une certaine mesure, eu à souffrir. Quant aux frères Seveste, pressentant, nous l'avons dit, le danger, ils s'étaient orientés, d'une part vers les traductions d'œuvres étrangères qu'ils voulaient populariser, de l'autre vers les ouvrages comme la Perle du Brésil, Élisabeth, la Moissonneuse de Vogel, confinant au genre de l'opéra, au moins sous la forme de ce que l'on devait nommer plus tard l'opéra de demi-caractère. A son tour M. Carvalho s'imposa ce double objectif. Pour commencer il se tourna du côté des traductions, et, en s'arrêtant au choix d'Obéron, il débuta par un coup de maître. Le succès égala presque celui qu'avait remporté Robin des Bois. L'interprétation rassemblait les noms de Michot, Guillon, Fromant, de Mme Rossi-Cassia, la créatrice des Diamants de la Couronne, de Mmes Borghèse et Girard. Soixante-huit représentations n'épuisèrent pas, en l'année 1857, la curiosité du public. A Obéron, un peu trop précipitamment peut-être, M. Carvalho voulut donner un pendant avec un autre joyau du répertoire de Weber, Euryanthe. Mais ici les destinées de la musique furent compromises par le livret, maladroitement arrangé, ou plutôt défiguré, additionné d'un fâcheux élément comique qui fut peu goûté. Nous touchons là du doigt un des inconvénients qui se présentent avec les traductions : l'insuffisance ou la bizarrerie du livret primitif, défauts auxquels on croit remédier par des combinaisons parfois plus malencontreuses encore. Il est vrai que, dans la suite, on vit triompher la Flûte enchantée, nonobstant la transformation du poème original. En revanche, l'exquis Cosi fan tutte, adapté tant bien que mal à un scénario emprunté à Shakespeare, celui de Peines d'amour perdues, ne put résister à cette épreuve. Citons pour mémoire, toujours en 1857, deux opéras de Semet, les Nuits d'Espagne et la Demoiselle d'honneur ; (O fortunatos nimium... Heureux les jeunes compositeurs qui, en ce temps de préhistoire, pouvaient, dans la même année, faire jouer deux œuvres développées !) ; — puis l'aimable Maître Griffard, de Léo Delibes, son début sur une scène importante ; — puis un ouvrage de Clapisson, Margot, dont l'ouverture campagnarde reproduisait les cris des animaux. Cette Margot, aussi médiocre que rustique, séduisit peu l'auditoire ; c'était, au Théâtre-Lyrique, l'avant-dernière production du compositeur ; la dernière, Madame Grégoire, quatre ans après, n'eut pas un meilleur destin. Six cent quatre-vingt mille neuf cents soixante-deux francs soixante-quinze centimes, voilà la somme à laquelle s'étaient, en 1856, élevées les recettes du théâtre, supérieures de plus de cent mille francs aux plus fortes que jusqu'alors on dit annuellement encaissées. En 1857 on monta à 831 .211 fr. 95 c. On allait, en 1858, atteindre 849.214 fr. 60 c., grâce d'abord au répertoire courant, puis à la vogue si justifiée des Noces de Figaro. L'année 1858, en effet, pourrait, dans l'histoire du Théâtre-Lyrique, s'appeler l'année des Noces. Notons, en ce qui concerne le texte français de l'ouvrage, versifié par Michel Carré et M. Jules Barbier, que, par un incompréhensible scrupule, les héritiers de Beaumarchais, moins intraitables pour le Barbier, prétendirent empêcher tout emprunt à la prose originale du maître. La première, le 8 mai, fut un triomphe. Meillet était un Figaro accompli ; Balanqué, un peu vulgaire pour représenter Almaviva, se montrait du moins, dans ce rôle, excellent chanteur. Satisfaisante à l'égard des hommes, l'interprétation, du côté féminin, était tout à fait supérieure. Personne peut-être n'a, dans Chérubin, égalé Mme Carvalho, et n'a rendu avec plus de grâce et de style la célèbre romance « Mon cœur soupire ». La distinction rare de Mme Vandenheuvel-Duprez l'avait désignée pour le personnage élégant de la comtesse. La Suzanne « toujours riante, verdissante, pleine de gaîté, d'esprit, d'amour et de délices » qu'avait rêvée Beaumarchais, se trouvait incarnée à souhait par Mme Ugalde, la créatrice du Caïd et de Galathée, l'artiste nomade et fantaisiste qui, entre temps, allait jouer les Trois Sultanes aux Variétés. On dut, en cette année, donner quatre-vingt-neuf fois les Noces qui, l'an d'après, furent chantées quarante-sept fois, pour aboutir, avec la reprise de 1863, à un total de deux cents soirées. Peu de mois avant l'apparition du nom prestigieux de Mozart sur le programme du Théâtre-Lyrique, cette scène s'était ouverte pour un des plus fervents admirateurs du maître, pour Gounod, destiné à y laisser, lui aussi, une trace lumineuse. Il s'y présentait d'ailleurs d'une façon assez modeste, avec le Médecin malgré lui donné le 15 janvier, pour l'anniversaire de la naissance de Molière, dont le nom, comme auteur, sans désignation d'aucun adaptateur ou librettiste, figurait seul en regard de celui du musicien. Créé par Meillet — il devait être plus tard repris par Sainte-Foy durant son court passage au Lyrique, puis par Ismaël, — le Médecin malgré lui fut accueilli favorablement, mais sans réaliser de grosses recettes ; ses proportions réduites ne l'eussent, du reste, guère permis. L'année théâtrale, en 1858, se complète par la mise à la scène du charmant acte de Weber, Preciosa ; par deux reprises, la Perle du Brésil, avec Mme Carvalho, et Gastilbelza, l'œuvre de Maillart qui avait inauguré l'Opéra-National en 1847 ; enfin par quatre petites pièces nouvelles dont une en deux actes, Broskowano, de M. Deffès. Ce sujet a été repris et remis en musique par l'auteur, populaire en Allemagne, de la Croix d'or, Ignace Brüll. Cette année 1858 marque le point culminant de la première direction Carvaiho. En 1859, les recettes allaient baisser de 160.000 francs. Ce fut pourtant durant cet exercice que l'on vit se produire le Faust de Gounod, l'œuvre qui, par la suite, nous l'avons déjà fait remarquer, devait être la plus jouée au Théâtre-Lyrique, l'œuvre dont le succès, parmi les succès français de cette deuxième partie du siècle, a été le plus brillant, le plus durable, le plus soutenu. Il n'est pas exact, hâtons-nous de le dire, que Faust ait eu tout d'abord la chute qu'on lui a si souvent attribuée. Représenté pour la première fois le 19 mars, l'opéra de Gounod obtint dans l'année cinquante-sept représentations, non sans une moyenne très satisfaisante de recettes. L'histoire de cet ouvrage est encore à écrire. Celui qui entreprendra cette tâche aura à détruire bien des légendes trop complaisamment accréditées et dont quelques-unes sont imputables à l'auteur lui-même, mal servi par ses souvenirs. Aussi bien, comme nous l'écrivait un jour un spirituel compositeur d'opérettes, pris en flagrant délit d'inadvertance ou d'oubli relativement à l'une de ses œuvres : « Les musiciens tracent tant de notes qu'ils omettent d'en prendre ». On devra faire justice également d'anecdotes plaisantes et devenues en quelque sorte classiques, mais d'une authenticité des plus douteuses : celle, par exemple, de M. Choudens, éditeur de la partition, menaçant ses enfants, s'ils étaient turbulents, de les mener revoir Faust ; terrifiés, à cette perspective, ils s'apaisaient, prétendait-on, aussitôt. Il est également inexact que Faust ait été sacrifié à la Fée Carabosse, de Massé, représentée quelques semaines auparavant, et qui échoua. Le voisinage dont Faust put avoir à souffrir, ce fut celui de Mozart, en pleine réussite par les Noces et bientôt après par l'Enlèvement au sérail, et celui de Gluck dont l'Orphée, le 10 novembre suivant, devait, en partie grâce à Mme Viardot, remporter un éclatant succès. A propos de Faust indiquons encore quelques particularités. L'un des librettistes, Michel Carré, avait donné antérieurement un drame en trois actes, Faust et Marguerite, dont il se servit pour son nouveau travail. Parmi les opéras reçus à l'Académie de Musique, l'Almanach Barba signale, en 1827, sans désignation du nom de l'auteur (qui était Béancourt), un Faust qu'on renonça à monter sur notre première scène. Enfin, lorsque Faust apparut, le sujet était, pour ainsi dire, « dans l'air ». Dès le mois d'avril 1858 on l'annonçait au Théâtre-Lyrique avec Mme Ugalde comme protagoniste, et, au mois d'octobre suivant, d'Ennery, toujours habile à sentir d'où venait le vent, et désireux d'arriver bon premier, faisait jouer à la Porte-Saint-Martin un Faust luxueusement mis en scène et remarquablement interprété par Rouvière, Dumaine et Mlle Luther. Rappelons aussi que le rôle de Faust, distribué à Guardi, créé en définitive par Barbot, eut bientôt pour interprète Michot ; que la créatrice du « travesti » de Siebel fut Mlle Faivre, qui, plus tard, devait épouser le successeur de Carvalho, Charles Réty, et que ce fut seulement en 1867 que le rôle de Marguerite cessa d'avoir pour unique titulaire Mme Carvalho. Il fut successivement confié, au Théâtre-Lyrique, à Mmes Duprez, Schrœder et Sallard. Certains biographes de Gounod ont donc dit à tort qu'avant Mlle Nilsson, qui reprit le rôle à l'Opéra, le 3 mars 1869, on n'avait entendu à Paris aucune autre Marguerite que Mme Carvalho. L'œuvre elle-même est trop universellement connue pour que nous ayons sur elle aucune appréciation à émettre. M. Carvalho l'avait entourée de tout le soin, de tout le luxe désirables. En la montant, il réalisait un rêve persistant, celui de jouer l'opéra, car, en dépit du dialogue « parlé », l'ouvrage de Gounod était un opéra véritable. Le résultat, somme toute, ne fut point tel que, pour beaucoup de raisons, on l'avait espéré. La réussite attendue s'était plutôt produite avec une traduction de l'Abou-Hassan, de Weber, où chantait Mlle Marimon, et une autre traduction, déjà mentionnée, celle de l'Enlèvement au sérail délicieusement rendu par Battaille (pour ses débuts au Lyrique), Michot, Fromant, Mmes Ugalde et Meillet. Mais, de brèves dimensions, ce charmant ouvrage ne pouvait compter que comme appoint au spectacle. Le sujet, l'on s'en souvient, est extrait d'un drame de Bretzner, Belmont et Constance. L'auteur n'avait point accordé son autorisation, et très mécontent, il déclara dans le Journal de Leipzig avoir déposé une plainte contre « un certain Mozart qui s'était permis de tirer un poème pour musique de son drame ». Pas plus que Faust nous n'avons à juger Orphée, sur lequel tout est dit. En ce qui concerne Mme Viardot, on sait quelle émotion fut alors causée par cette interprétation si personnelle, si noble, si saisissante. On ne parlait que des trois façons dont la cantatrice faisait alternativement valoir la phrase célèbre « J'ai perdu mon Eurydice ». Peut-être aujourd'hui ne serait-il plus permis d'introduire au premier acte les vocalises qui figurent dans la partition « conforme à la représentation » que nous avons sous les yeux. C'était une concession au goût de l'époque. En somme, l'ensemble était de premier ordre. Une belle Eurydice, Mlle Moreau, secondait de façon satisfaisante Mme Viardot. La pièce était encadrée dans des décors d'un style et d'un coloris tout virgiliens. Le succès fut très grand. En cinq années (c'est dans ce rôle que Mme Viardot fit ses adieux aux habitués du Théâtre-Lyrique), en cinq années Orphée atteignit un total de cent quarante-cinq représentations. Toutefois l'on comprend qu'un spectacle aussi sévère ne pouvait exercer sur la foule une attraction comparable à celle d'Obéron, du Freischütz ou des Noces. Ajoutons que les frais étaient considérables. Bien que fort loin d'égaler le taux d'aujourd'hui, — Mme Viardot même ne touchait que trois mille francs par mois, — les appointements des artistes, additionnés les uns aux autres, ne laissaient pas de former un chiffre élevé. En outre, plus qu'aucun de ses prédécesseurs, M. Carvalho avait habitué le public à la richesse de la mise en scène, au développement de la figuration, nécessités d'ailleurs par les pièces de large envergure vers lesquelles le portaient ses préférences. Actif, énergique, toujours intrépide dans la lutte contre les chances adverses, M. Carvalho voulut, une fois encore, frapper un grand coup. Après Ma Tante dort, spirituel petit acte de Crémieux et Caspers où Mme Ugalde fit, à son ordinaire, admirer son talent d'adroite et ingénieuse comédienne, il donna Philémon et Baucis, sujet qu'Haydn avait autrefois traité pour marionnettes. L'échec fut complet. Malgré l'attrait d'une interprétation supérieure groupant les noms de Mme Carvalho, de Battaille, Balanqué et Fromant, on goûta médiocrement le premier et le troisième actes ; on trouva monotone le deuxième, supprimé depuis, qui représentait une scène d'orgie antique. Cet ouvrage destiné, sous sa forme réduite en deux actes, à être joué si fréquemment à l'Opéra-Comique, ne compta alors que treize représentations. Nous ne devons pas oublier, au commencement de 1860, Gil Blas, agréable ouvrage de Semet, le meilleur qu'il ait signé ; personnellement, Mme Ugalde y réussit beaucoup, surtout dans certaine sérénade, objet de l'engouement général, et rapidement devenue populaire. Dans le genre de l'opéra-comique, Gil Blas est la seule œuvre en cinq actes que l'on ait jouée au Théâtre-Lyrique ; à la salle Favart, la Figurante de Clapisson représente la même exception. Découragé, guettant peut-être d'autre part la succession, qui semblait devoir être ouverte à bref délai, de Roqueplan à l'Opéra-Comique, M. Carvalho se retira. Le 1er avril 1860 il cédait la place à Charles Réty, qui, depuis quatre ans, remplissait auprès de lui les fonctions de secrétaire-général. Ce dernier poste allait être dorénavant occupé par M. Philippe Gille.
***
Dans l'exercice des fonctions, pour ainsi dire préparatoires, auxquelles, afin de prendre la direction, il venait de renoncer, Charles Réty, dont la réputation de compétence, de goût, de courtoisie, était légitimement établie, avait appris à connaître le fort et le faible du théâtre. C'était là pour lui, dans la nouvelle tâche qu'il assumait, une aide puissante. Mais les difficultés et les dangers étaient multiples. Sans témoigner autant d'empressement que l'eût vraisemblablement souhaité le préposé à la caisse, le public, nous l'avons dit, très « gâté », sous la gestion précédente, s'était habitué aux interprétations hors ligne, aux mises en scène relativement coûteuses. Or, il semblait dorénavant indispensable de réduire les frais de l'exploitation. D'ailleurs Mme Carvalho partait. Comment la remplacer ? Elle avait, en 1856, succédé à Mme Cabel ; celle-ci, à son tour, lui succéda. On reprit pour elle le Bijou perdu et Jaguarita. Mais le temps avait marché. Si la cantatrice avait conservé sa voix d'une agilité surprenante, le public, lui, s'était accoutumé à un style plus pur, plus sévère, et la présence de cette habile chanteuse ne constituait plus pour les auditeurs une attraction irrésistible. En vue de triompher des divers obstacles que lui créaient les circonstances, M. Réty s'arrêta, en somme, au système le plus rationnel reprendre quelques œuvres classées, dont la réussite ne pouvait faire question, et surtout en produire un très grand nombre d'inédites. Parmi ces dernières, ne pouvait-on rencontrer l'ouvrage privilégié qui amènerait à sa suite l'opulence ? Par malheur, comme nous le verrons ci-après, la fortune ne se montra que médiocrement bienveillante. M. Carvalho avait, on s'en souvient, réservé une place très importante aux traductions. A cet égard un seul ouvrage — un chef-d'œuvre, il est vrai, — Fidelio, figure au mémorial de la direction Réty. Encore convient-il d'ajouter que cette reprise, si nous ne nous trompons, avait été étudiée par Carvalho, qui s'était occupé de la distribution des rôles. Ainsi qu'Euryanthe, la pièce eut à souffrir de la gaucherie des adaptateurs. Mme Viardot, malgré le talent dramatique qu'elle déploya dans le rôle principal, ne retrouva point l'extraordinaire succès d'Orphée, et l'ouvrage ne parcourut qu'une très courte carrière. La revanche, sur une autre scène parisienne, fut éclatante lorsque, dix années plus tard, Fidelio fut interprété à la Salle Ventadour par Fraschini et Mme Krauss, en de mémorables soirées qui marquèrent une date dans les souvenirs de tous les amateurs du grand art. Quant à l'artistique reprise du chef-d'œuvre de Beethoven effectuée à l'Opéra-Comique, par les soins de M. Albert Carré, avec une version française nouvelle de M. Antheunis et l'adjonction de récitatifs dus à M. Gevaert, elle est trop récente pour que nous puissions faire plus que la mentionner. M. Réty devait être mieux traité par le sort en consacrant ses soins à des reprises d'œuvres de compositeurs nationaux précédemment jouées en France sur d'autres théâtres. Nous ne ferons que signaler, sans y insister autrement, une petite pièce de M. Debillemont antérieurement montée à Dijon ; mais le joli opéra-comique d'Herold, les Rosières, obtint trente représentations. Joseph dépassa un peu ce chiffre. Le principal interprète était un amateur, M. Buzin, inscrit sur l'affiche sous le pseudonyme de Giovanni ; il avait pour partenaires M. Petit (Jacob) et Mlle Faivre (Benjamin). La reprise la plus fructueuse fut celle du Val d'Andorre qui trouva un sérieux regain de succès avec Battaille dans le rôle du vieux chevrier, sa plus brillante création à la salle Favart, Meillet, Monjauze, Fromant, Mme Meillet, et, dans le personnage de Georgette, Mlle Roziès ; cette dernière, dont on avait récemment remarqué les débuts dans les Dragons de Villars, était originaire d'une petite ville du Midi, Beaumont de Lomagne, à laquelle un souvenir est bien dû par celui qui a signé « B. de Lomagne » tant d'articles de critique. Nous arrivons aux nouveautés. Leur nombre n'est pas médiocre, puisqu'il s'agit de trente-cinq actes répartis entre vingt-deux pièces dont quinze appartenaient à des auteurs non admis jusqu'alors au Théâtre-Lyrique. Nous signalerons parmi ceux-là Louis Lacombe et sa Madone, dont la valeur musicale était réelle ; suivant une disposition renouvelée plus tard par Hignard dans Hamlet et par M. Massenet dans Manon, le dialogue parlé y était soutenu par un dessin instrumental continu. Nous citerons aussi le prince Poniatowski, représenté par Au travers du mur que reprit, quelques mois après, l'Opéra-Comique ; — Ymbert et ses Deux Cadis, dont l'amusant livret était dû à M. Philippe Gille qui s'essayait ainsi comme librettiste d'opéra-comique ; — Sellenick, chef accompli d'orchestres militaires ; — M. Gastinel et son Buisson vert ; — M. G. Douay qui, depuis, a écrit de nombreux levers de rideaux pour les théâtres d'opérettes ; — le neveu de Meyerbeer, Jules Beer, et sa Fille d'Égypte ; — Dautresme, destiné à devenir ministre du Commerce sous la troisième République ; — enfin deux femmes, Mlles Rivay et Pauline Thys. Leurs ouvrages, joints à ceux de Mmes de Grandval et Pilté constituent le « quadrilatère » d'œuvres féminines chantées au Théâtre-Lyrique. Mais, en réalité, deux productions nouvelles, fort différentes, devaient seules marquer durant cette direction : la seconde en date, la Chatte merveilleuse, de Grisar, avec Mme Cabel comme principale interprète, obtint un succès prolongé, assez lucratif, mais disparut sans laisser, par la suite, aucune trace. Sur la première de ces deux œuvres, la Statue, il convient de s'arrêter un peu plus, ne serait-ce que pour rectifier quelques erreurs, trop généralement répandues, sur l'histoire du remarquable opéra de M. Reyer. Et d'abord, la Statue n'eut pas la minime quantité de représentations à laquelle paraissait faire allusion le compositeur lui-même dans une lettre écrite à ce sujet. Elle ne fut pas jouée moins de cinquante-neuf fois, chiffre considérable pour l'époque ; elle l’eût même été davantage sans l'intervention de l'auteur ; en effet, pour éviter qu'elle ne fût donnée dans des conditions, selon lui, insuffisantes, M. Reyer, en 1863, fit judiciairement défendre à M. Carvalho, redevenu directeur, de maintenir son ouvrage sur l'affiche. A M. Carvalho, du reste, revenait l'honneur d'avoir reçu la Statue ; Charles Réty, disposé à la renvoyer à une date indéterminée, ne se décida à la monter qu'après injonction de la Société des Auteurs, dont l'arbitrage avait été sollicité. Il s'exécuta alors de fort bonne grâce et n'épargna rien pour le succès. Répétée sous le titre provisoire des Ruines de Balbek, la pièce était encadrée dans des décors très pittoresques, d'après des photographies et d'autres documents rapportés d'Orient par un grand ami du compositeur, Maxime du Camp. La principale interprète était Mlle Baretti, artiste distinguée bien qu'un peu froide, qu'on a, depuis, revue à l'Opéra-Comique ; elle avait récemment débuté dans les Pêcheurs de Catane, de Maillart, ouvrage qui n'avait guère réussi. Pour le surplus, la Statue était chantée par Monjanze, Balanqué, Wartel et Girardot. Le soir de la première, M. Deloffre, le vaillant « conducteur » de la « phalange instrumentale », trouva sur son pupitre un bâton de chef d'orchestre portant cette inscription : « Les auteurs de la Statue à M. Deloffre. » A dater de cette soirée, M. Reyer fut définitivement classé parmi les artistes les plus en vue de la jeune école musicale française. Rappelons qu'en 1865 il fut question de reprendre la Statue ; on confiait le personnage de Margyane à une chanteuse, Mme Saint-Urbain, que l'on avait applaudie aux Italiens. Ce projet n'aboutit point. Cependant les recettes avaient sensiblement baissé. En 1860 elles étaient de cent mille francs inférieures à celles de 1859, déjà en diminution sur l'année précédente. En 1861, elles subirent encore une dépression de cent vingt mille francs. M. Réty, néanmoins, déployait dans la lutte une ténacité que rien ne pouvait décourager. La liste serait curieuse à établir de toutes les œuvres dont il méditait la représentation. Indiquons d'abord le dessein que, dans son désir d'encourager les jeunes, il avait formé celui de confier un livret d'opéra-comique en cinq actes à cinq compositeurs qui eussent écrit chacun la musique d'un de ces actes. De plus il voulait donner Noé, œuvre posthume d'Halévy, inachevée, et qu'aurait, dans cette hypothèse, terminée Ambroise Thomas ; ce travail, on le sait, échut plus tard au gendre du musicien de la Juive, Bizet ; mais l'ouvrage ainsi mis au point n'a jamais été joué qu'en Allemagne. M. Réty songeait aussi à monter le Roland à Roncevaux de Mermet, si l'on en juge par la brillante fortune de l'œuvre à l'Opéra, il eût peut-être trouvé là l'occasion de la revanche si ardemment souhaitée. Il importait de gagner du temps, de tenir jusqu'à l'ouverture de la nouvelle salle. En effet, le bâtiment où allait s'installer le Théâtre-Lyrique était presque prêt. Son imminente ouverture présentait au directeur en exercice une perspective des plus séduisantes. Stimulé par l'espoir d'un aussi avantageux « déménagement », M. Réty, en s'adressant à ses collaborateurs divers, compositeurs, instrumentistes, décorateurs, aurait pu, dans son théâtre vermoulu que désertait la foule, s'approprier en quelque manière la harangue de Masaniello au peuple, dans le vieil opéra de Carafa : Hélas ! quand je devrais Dans la terre promise Ne pénétrer jamais, Je marche à votre tète, Je m'expose pour vous aux coups de la tempête. Il n'abandonna pas son poste : jusqu'au dernier moment il résista « aux coups de la tempête » ; mais il était, parait-il, écrit qu'il ne pénétrerait pas dans la « terre promise », qu'il ne dépasserait pas le mont Nébo. C'est M. Carvalho qui, réintégré dans ses fonctions de directeur, devait, le 4 octobre 1862, étrenner la nouvelle salle.
DEUXIÈME PARTIE LA SALLE DE LA PLACE DU CHATELET
Nous n'avons pas à décrire le Théâtre-Lyrique de la place du Châtelet, peu élégant à l'extérieur, mais, intérieurement, spacieux, bien distribué, de proportions heureuses. En dépit de l'incendie partiel de 1871, on a pu, de notre temps, le voir à peu près tel qu'il fut à l'origine, moins luxueux toutefois, et différent par un point : l'absence du plafond lumineux substitué au lustre traditionnel, et analogue à celui qui existe encore au théâtre d'en face. Mais, uniformément jaune au Châtelet, il était, au Lyrique, diversement coloré. Lors de l'ouverture, la question de ce mode d'éclairage fut controversée chaudement ; le mot est de circonstance, puisque, à cette époque où l'emploi de l'électricité était encore exceptionnel, il s'agissait d'un appareil à gaz. Les spectateurs des hautes places, en tout cas, ne se plaignirent point de cette innovation ; ils voyaient beaucoup mieux. D'une manière absolue, surtout en considération de la mode, qui nous vient de Bayreuth, de laisser la salle dans la pénombre pendant qu'on joue, ce système, à notre avis, est véritablement préférable. La soirée d'inauguration eut lieu le jeudi 30 octobre, avec un spectacle assez court, où ne figurait qu'une seule œuvre inédite, un Hymne à la musique, de Gounod, et où, par une sorte de coquetterie directoriale, M. Carvalho avait voulu grouper sous les yeux du public la troupe tout entière du théâtre. En particulier, l'élément féminin était brillamment représenté : au premier rang avait pris place Mme Carvalho, à qui, pour saluer sa rentrée, on fit, après l'air de « l'abeille », une ovation enthousiaste. Auprès d'elle on applaudit Mmes Viardot et Cabel, Mme Faure-Lefebvre, la piquante et spirituelle soubrette si longtemps appréciée à l'Opéra-Comique et qui bientôt allait se distinguer dans une reprise de l'Épreuve villageoise, Mmes Girard, Moreau, Faivre, etc. Quelques-unes, Mme Viardot en tête, n'allaient point tarder à disparaître ; mais M. Carvalho, l'on en pouvait avoir la certitude, était homme à les remplacer de façon satisfaisante. Parmi les chanteurs nous citerons Battaille, appelé, lui aussi, à se retirer prochainement, après sa création de l'Ondine, de Semet, le premier ouvrage monté par la direction nouvelle, œuvre toute d'actualité, comme on le fit plaisamment remarquer, puisque le choix de ce sujet aquatique coïncidait avec l'émigration du théâtre sur les rives de la Seine. Nous nommerons encore Sainte-Foy, qui devait également se retirer bientôt et rentrer au bercail, c'est-à-dire à l'Opéra-Comique, après une reprise du Médecin ; Balanqué, Reynal, le créateur de Valentin, Monjauze, Morini, Petit, si souvent chargé, par la suite, du rôle de Méphistophélès. N'oublions pas les excellents titulaires des petits emplois, déjà engagés ou sur le point de l'être : Mlle Albrecht, le gentil Antonio de Richard, Mmes Dubois, Vilhème, Duclos, la « dame Marthe » de Faust, puis Legrand, Bonnet, Wartel, Gabriel, le légendaire petit père Bonheur de la Fanchonnette, Girardot, Leroy, Gerpré, qui, au Cirque Olympique, avait été un amusant prince de féerie. La fin de l'année 1862 fut remplie par le répertoire et par la remise à la scène de deux ouvrages, Robin des Bois et surtout Faust, qui, maintenant objet de l'engouement, allait devenir l'une des sources les plus constantes de prospérité du Théâtre-Lyrique. Cette reprise eut lieu le 18 décembre. Peu d'ouvrages, nul ne l'ignore, ont eu, autant que Faust, à subir, au cours de leur carrière, des modifications de détail : substitution ou interversion de tableaux, pages tantôt ajoutées et tantôt supprimées. Cette fois l'on regretta la disparition d'un curieux effet scénique qui, à l'origine, avait beaucoup porté sur le public. La « scène de l'église », alors, ne se passait pas dans l'église, par suite d'une disposition peut-être plus acceptable. Cet épisode se déroulait au seuil du sanctuaire. Seulement, à la fin, par un truc ingénieux, les murs s'ouvraient lentement, de manière à laisser apercevoir la nef dans toute sa profondeur. En dehors de deux levers de rideau inédits dont l'un portait la signature de Léo Delibes, nous ne rencontrons, dans les trois premiers mois de l'année 1863, que trois pièces déjà signalées, qui ne tinrent pas longtemps l'affiche : l'Ondine, Peines d'amour et la reprise de l'Épreuve villageoise. C'est à la fin de l'année que M. Carvalho, accusant, plus encore que dans sa première direction, ses préférences pour l'opéra, allait donner coup sur coup deux nouveautés très importantes qui, hélas ! n'obtinrent pas le succès qu'elles méritaient : les Pêcheurs de perles et les Troyens. L'histoire de ces deux œuvres a été souvent racontée en grand détail ; on leur a même consacré des monographies spéciales très étendues. Nous considérons donc comme inutile de trop insister. Notons toutefois, à propos des Pêcheurs de perles, une anecdote peu connue. Michel Carré, l'un des librettistes, ne savait, aux répétitions, quelle forme définitive donner au troisième acte, qui ne satisfaisait personne. Il faisait continuellement pare de ses hésitations au directeur, qui finit par lui dire un jour : « Mettez-le au feu ! » Ce mot de « feu » qui, dans Mignon, prononcé, au cours de ses imprécations, par la petite héroïne, détermine Lothario à livrer aux flammes le château du comte, produisit sur le librettiste une impression analogue, mais heureusement plus inoffensive. Il lui suggéra, dit-on, l'idée de placer au dénouement un incendie. Rappelons aussi certaine exclamation, tout ensemble ingénue et flatteuse pour le compositeur, poussée par le collaborateur de Michel Carré, à l'issue de la première représentation : « Si nous avions connu le talent de M. Bizet, nous ne lui aurions jamais donné cette pièce ! » Au sujet de l'un et l'autre ouvrage il serait oiseux de remémorer toutes les billevesées qu'ils inspirèrent à la critique, relativement à la prétendue influence de la musique de l'avenir. « Un fortissimo en trois actes », c'est ainsi qu'un feuilletoniste définissait les Pêcheurs de perles, dont l'émouvant duo d'hommes, d'un style si grave et si pur, adapté à d'autres paroles, fut chanté aux funérailles de l'auteur lui-même. Cent onze ans auparavant on avait, lors de l'enterrement de Rameau, procédé de semblable façon, en exécutant des fragments de Castor et Pollux, fragments qui, d'après un narrateur contemporain, « firent verser des larmes en rappelant les talents de l'homme illustre que la nation venait de perdre ». L'échec des Troyens fut plus lamentable encore que celui des Pêcheurs. Les rôles avaient été confiés à d'excellents interprètes, à Mme Charton-Demeur, une très émouvante Didon, à Monjauze, Petit, au tenorino Cabel, à qui, après quelques représentations, on supprima la jolie cantilène du matelot Hylas. Nombre d'autres coupures avaient été du reste effectuées, celle notamment du fameux intermède de la chasse, qu'avait motivée non seulement l'attitude hostile du public, mais un accident qui pouvait avoir des suites graves. Profitant du voisinage de la Seine, M. Carvalho avait imaginé, pour l'épisode de l'orage, un très pittoresque effet d'eau. Mais un signal malencontreusement donné faillit provoquer une inondation véritable, et on jugea prudent de ne pas renouveler l'expérience. L'ouvrage était du reste monté avec un grand luxe ; le bruit courut même, à tort, d'après ce que nous a affirmé M. Henri Carvalho, qu'à cet effet un anonyme, admirateur de Berlioz, avait envoyé trente mille francs au directeur. Malgré ces conditions favorables on vit sombrer, comme le vaisseau d'Enée, cette belle œuvre, dans l'analyse de laquelle nous n'avons pas ici à entrer. Pour se relever, M. Carvalho donna, avec Mme Carvalho dans le rôle principal, une reprise de la Perle du Brésil, une perle, semblait-il, plus facile à faire valoir que celles des « Pêcheurs » de Bizet. Mais surtout, à la fin de l'année, il allait frapper un coup de maître en montant Rigoletto, l'ouvrage qui, après Faust et Richard, devait, au Théâtre-Lyrique, obtenir le plus gros chiffre de représentations. Sans parler de Monjauze dans le duc de Mantoue, les deux principaux rôles étaient brillamment tenus par Mlle de Maësen, de taille élégante, d'allure distinguée, douée d'une voix agile au timbre clair, et par Ismaël, ancien tailleur d'Agen, déjà un peu sur le retour, mais solide chanteur, et acteur pourvu d'un très vif sentiment de l'expression dramatique. Ces deux artistes avaient débuté ensemble dans les Pêcheurs de perles. La mise à la scène de Rigoletto constituait une tentative d'ordre nouveau dont le succès eut une forte influence sur la suite de la gestion de M. Carvalho. Précédemment, les directeurs successifs du Théâtre-Lyrique s'étaient attachés à jouer, en fait de traductions, des œuvres un peu oubliées ou rarement représentées ailleurs. Avec Rigoletto M. Carvalho popularisait, « francisait » un ouvrage qui, à la Salle Ventadour, mais chanté en italien, était en pleine vogue. L'entreprise était hardie. Elle réussit entièrement, grâce à la haute valeur de cette musique, grâce aussi, nous l'avons dit, au mérite de l'interprétation. L'année suivante, M. Carvalho ne fit pas moins de trois essais dans le même sens. Le premier fut franchement mauvais avec Norma, beaucoup trop hâtivement montée. On avait voulu à tout prix devancer la Porte-Saint-Martin, où, à la faveur de la liberté des théâtres récemment décrétée, une reprise du même ouvrage avait été décidée ; Mlle de Maësen ne possédait pas l'ampleur tragique qu'exigeait le rôle principal ; celui de Pollion était également trop lourd pour M. Puget qui, tant de fois alors, dans Blondel, déploya une chaleur et une conviction presque excessives. Une seconde tentative fut plus heureuse avec Don Pasquale, où débuta, après avoir passé par la salle Favart, un artiste appelé à rendre de grands services, Troy, le frère de celui qui est encore, à l'heure présente, pensionnaire de l'Opéra-Comique. Pour la première fois alors, l'œuvre charmante de Donizetti fut jouée en costumes Louis XV et non en ajustements contemporains ; pareille modification fut, si nous ne nous trompons, apportée à la mise en scène traditionnelle de la Somnambule lorsque, trois ans après, M. Carvalho remonta l'opéra de Bellini ; on cessa notamment de représenter l'officier à qui l'héroïne du drame fait son involontaire visite nocturne, revêtu, comme aux Italiens, de la plus actuelle tenue d'ordonnance de l'infanterie de ligne. Si Don Pasquale n'obtint, en définitive, qu'une demi-réussite, un succès triomphal était réservé à la Traviata, ou plutôt à Violetta, dénomination adoptée au Théâtre-Lyrique. Il est vrai que, dans la distribution, à côté de Monjauze et d'une recrue récente et excellente, le baryton Lutz, figurait Mlle Nilsson, la cantatrice suédoise dont depuis longtemps on annonçait l'apparition, en estropiant plus ou moins son nom, que tour à tour on orthographiait Nielson, Nelson ou Nilson. Elle était alors d'une beauté étrange, avec sa figure intéressante si propre à éveiller la rêverie, ses yeux pleins de lumière et de mystère où semblait se jouer le reflet des lacs de sa patrie, ses cheveux d'or de princesse légendaire, son expression troublante et énigmatique. A ces charmes se joignait celui d'une voix exceptionnelle, d'une de ces voix « argentées » dont parle Rousseau, d'un organe où se mêlaient les sonorités du métal pur et du plus fin cristal. Nulle artiste n'a peut-être réalisé comme elle certains traits vocaux d'une audace inouïe, presque impossibles à rendre, ceux, par exemple, de la reine de la Nuit dans la Flûte enchantée. Violetta avait terminé cette année avec éclat, comme Rigoletto avait clos l'année précédente. En cette double circonstance, la réussite des œuvres françaises inédites avait été dépassée par celle des œuvres étrangères connues. Et cependant, en laissant de côté trois petits actes, dont deux, Bégaiements d'amour de Grisar et le Cousin Babylas de Caspers, se sont maintenus assez longtemps sur l'affiche, c'est en 1864 qu'avait été créée Mireille. On l'avait montée avec le plus grand soin, en confiant les rôles à des artistes de choix parmi lesquels brillait Mme Carvalho. D'autre part la vogue croissante de Faust avait presque complètement dissipé les préventions qui pendant assez longtemps avaient existé contre Gounod. La direction était donc en droit de compter sur un succès. Pourtant, cette œuvre si charmante, si personnelle, ne réussit ni sous sa forme originaire (19 mars), ni réduite en trois actes (15 décembre), avec la suppression, entre autres passages sacrifiés, du fameux défilé des noyés qui naguère avait soulevé une hilarité d'autant plus inattendue qu'il avait inspiré au compositeur de fort belles pages musicales. Cette coupure a été maintenue à l'Opéra-Comique, où l'ouvrage, comme l'on sait, est l'un des plus couramment joués du répertoire. Nous avons raconté ailleurs en détail les transformations successives qu'eut à subir Mireille. De même qu'Emile Augier, son collaborateur pour Sapho, son ami pour toute la vie, Gounod ne cessait de retoucher ses ouvrages. Signalons seulement, à propos de Mireille, une singularité. A la reprise, si le nombre des scènes avait décru, celui des interprètes avait augmenté. Lors de la création, Mme Faure-Lefebvre tenait à la fois les rôles de Taven et d'Andrelou ; elle ne garda que le dernier ; l'autre fut pris par Mme Ugalde. Enfin, Morini avait été avantageusement remplacé par Michot. Le bilan de l'année 1864 aurait dû s'augmenter d'un opéra en trois actes, la Captive, de Félicien David. La pièce avait été répétée durant plusieurs semaines, mais, — particularité peut-être unique dans l'histoire du théâtre contemporain, — compositeur et directeur se trouvèrent d'accord, la veille de la première représentation qui devait avoir lieu le 27 avril, pour ne pas affronter le verdict du public. La pauvre Captive fut réintégrée dans les cartons d'où elle ne devait plus sortir, et c'est à peine si quelques revues spéciales mentionnèrent un incident qui, aujourd'hui, vu l'importance de l'œuvre et le nom de l'auteur, susciterait mille commentaires. Que les temps sont changés ! En 1865 les nouveautés furent plus nombreuses qu'en 1864, mais non plus heureuses. Dans ce groupe de quinze actes constitués par sept pièces, nous n'appellerons l'attention que sur le Roi Candaule, la première œuvre de Diaz, avec Mlle Daram, aujourd'hui professeur au Conservatoire de Toulouse, qui avait récemment, non sans succès, débuté dans Chérubin, et sur la Fiancée d'Abydos, de Barthe, pièce couronnée à la suite d'un concours ouvert par la direction du Lyrique entre tous les prix de Rome non encore joués au théâtre. De cet ouvrage, froidement accueilli, il est resté un duo que faisaient bisser Lutz et Mme Carvalho et que l'on entend encore dans les concerts. N'omettons point un petit acte, le Mariage de don Lope, dû à un Hollandais, M. de Hartog. Le nom de ce compositeur évoque une particularité bien peu connue ; nous la signalons aux curieux qui seraient tentés de dresser une liste complète des productions d'Émile Augier. M. de Hartog, en collaboration avec lui, était l'auteur d'une certaine Portia, fragmentairement exécutée à un concert de la Société de Sainte-Cécile en 1853, et dont nous n'avons retrouvé aucune autre trace. Pour en finir avec les œuvres nouvelles produites durant cette période, disons immédiatement qu'en 1866 M. Carvalho, découragé par ces insuccès répétés, n'en donna que deux en un acte. C'était, soit par le répertoire, soit grâce aux traductions, que le théâtre avait prospéré en 1865 et 1866. Nonobstant une clôture de deux mois en 1865, d'un mois en 1866, les recettes s'élevèrent à 903.308 fr. 25 c. pour la première de ces deux années, et pour la seconde, à 1.000.448 fr. 60 c. De pareils totaux auraient bien surpris les premières directeurs du Théâtre-Lyrique, mais, même en les atteignant, leur successeur ne s'enrichissait point, par suite des exigences toujours grandissantes du public en fait de mise en scène, et, de plus, à cause du prix, d'année en année plus fort, auquel revenaient les émoluments de la troupe. Mais aussi quels interprètes réunissait alors le Théâtre-Lyrique ! A cet égard il n'y a qu'à se rappeler la distribution de la Flûte enchantée, œuvre d'une supériorité si transcendante, la plus allemande, comme on l'a justement remarqué, de toutes les productions dramatiques de Mozart. Il y avait là tous les éléments d'une véritable représentation modèle. Sur cette liste, à reproduire tout entière, figuraient Mme Carvalho (Pamina), Mlle Nilsson (la reine de la Nuit), Mme Ugalde (Papagena), Mmes Albrecht, Fonti et Estagel, Mmes Daram, Wilhème et Perret, dans les deux groupes, opposés avec tant de grâce et de finesse, des fées et des génies ; Michot (Tamino) et Troy (Papageno), Depassio, dont la voix était si extraordinairement profonde (Sarastro), Petit (Manès), Lutz (le noir Monostatos), Fromant (Psammis), Gerpré (Bamboloda), et dans les deux hommes d'armes, Gillant et Péront. Ce fut une vraie révélation pour le public, enfin « initié », pour parler le langage de la pièce elle-même, aux beautés délicates de celte merveilleuse partition. L'immense succès artistique se doubla d'un non moins notoire succès d'argent. Nous avons dit quelle place avaient tenue les Noces lors de la première direction Carvalho. Dans la deuxième, la Flûte, avec plus d'éclat peut-être encore, occupe un rang analogue. Si la Flûte a laissé, en cette année 1865, une trace étincelante, ce n'est point le seul ouvrage d'origine étrangère qu'il convienne d'y signaler. Nous glisserons rapidement sur le Macbeth de Verdi. En dépit de passages âprement énergiques, d'un gracieux ballet écrit tout exprès par l'auteur, malgré le talent de Mme Rey-Balla, l'ouvrage ne se maintint pas sur l'affiche. Il en fut de même de la Lisbeth de Mendelssohn, pour laquelle on avait engagé spécialement un acteur aimé au public des Variétés, Charles Potier. Mais comment oublier Martha, avec son parfait quatuor d'interprètes, Michot et Troy, Mme Dubois et Nilsson ? Le rôle confié à cette dernière, et où elle obtint tant d'applaudissements, avait d'abord dû être chanté par Mlle de Maësen, puis par Mme Carvalho. Comme dans la Flûte, Mmes Carvalho et Nilsson, allaient, en 1866, dans Don Juan, figurer ensemble, avec une tragique dona Anna, Mme Charton-Demeur, et, comme partenaires masculins, Barré (don Juan pour ses débuts), Michot, Troy et Depassio. Cette année fut celle « des trois Don Juan », l'Opéra et les Italiens ayant, en même temps que le Lyrique, repris l'ouvrage de Mozart. Le succès, pour le théâtre qui nous occupe, fut très grand sans doute, moins éclatant toutefois que celui de la Flûte. L'interprétation, par certains côtés, l'emportait sur celle des Italiens, ou pourtant brillaient la Patti, Delle-Sedie, Mmes Penco et de Lagrange, et sur celle de l'Opéra ; mais l'Opéra, néanmoins, devait finalement triompher, grâce à Faure qui, de nos jours, est devenu l'incarnation la plus irréprochable et la plus haute du personnage principal. On peut se demander, d'ailleurs, s'il convenait qu'un théâtre subventionné tel que le Lyrique, entamât cette sorte de lutte avec un autre théâtre avant le même caractère officiel. Une rivalité analogue entre ces deux scènes devait, dans le cours de l'année, se produire, par une reprise, à la place du Châtelet, du vrai Freischütz, remarquablement chanté, du reste, par Mmes Carvalho et Daram, MM. Michot et Troy. N'eût-il pas mieux valu, comme on le projeta un instant, monter Armide avec Mme Charton-Demeur, ou Lohengrin (le directeur y songea sérieusement alors) avec une certaine Mlle Hebbé, appelée tout exprès d'Allemagne ? Après avoir été sur le point de créer, dans le Sardanapale de M. Joncières, le grand rôle féminin échu en définitive à Mlle Nilsson, cette cantatrice partit pour Varsovie, sans avoir eu l'occasion de se faire entendre à Paris. Entre temps, durant cette année, M. Carvalho avait donné une autre œuvre étrangère, populaire encore aujourd'hui en Allemagne, les Joyeuses commères de Windsor de Nicolaï. Malgré son incontestable valeur l'ouvrage n'obtint pas de succès. Peu importait, en somme. Cela ne changeait rien au résultat significatif, déjà indiqué par nous : en 1865 et en 1866, comme dans les années précédentes, depuis la prise de possession du théâtre par M. Carvalho, le succès des traductions d'ouvrages étrangers avait fortement primé celui des œuvres françaises nouvelles. Certes, deux d'entre celles-ci, Mireille et les Pêcheurs de perles, devaient, par la suite, devenir une source de revenus considérables. Mais il était dans la destinée de M. Carvalho, dont le sort, en cela, ne différait point de celui de la plupart des impresarios lyriques, de semer pour que d'autres récoltassent après lui. N'est-ce pas en vertu de cette loi que lui-même avait, autrefois, tiré profit de la Fanchonnette, reçue par le malheureux Pellegrin ? Au moins une nouveauté française, Roméo et Juliette, allait, en 1867, l'année de l'Exposition, éclipser la seule adaptation d'un ouvrage étranger que l'on tenta cette année-là, la Somnambule, déjà mentionnée, et insuffisamment interprétée par Mlle Jeanne Devriès. Quant à Roméo, nous n'avons point à en refaire l'histoire. Elle est beaucoup plus simple que celle des partitions antérieures de Gounod, bien que celle-là aussi ait été retouchée, augmentée d'un grand ensemble et d'un ballet, lors de son passage à l'Opéra. On sait que le rôle de Roméo, créé par Michot, avait été destiné à Capoul. Le succès fut des plus vifs et se marqua, en cette seule année 1867, par quatre-vingt-neuf représentations très productives. L'ensemble excellent de la distribution unissait au nom Michot ceux de Mmes Carvalho, Daram, de MM. Troy, Cazaux et Barré. En 1867, à la différence de 1866, les nouveautés furent nombreuses. Ne mentionnons que pour mémoire une malencontreuse Déborah, montée hâtivement ; on y vit un bal masqué qui mit la salle en joie ; les habitués, en effet, se divertissaient beaucoup en reconnaissant les costumes de tous les ouvrages du répertoire. Nous signalerons le Sardanapale de M. Joncières, son début au théâtre, dont il a subsisté un air de basse, d'une gravité non dépourvue de noblesse, que l'excellent chanteur Cazaux interprétait avec autorité ; — les Bluets, de Jules Cohen, la dernière création au Théâtre-Lyrique de Mlle Nilsson ; Cardillac, de Dautresme ; — enfin la Jolie Fille de Perth, de Bizet, ouvrage inégal, mais renfermant des scènes de premier ordre, et où Lutz, dans le rôle de l'amoureux sacrifié, obtint la plus belle réussite de sa carrière théâtrale. Avec la Jolie Fille de Perth se termine la partie active de la seconde direction Carvalho. Chose curieuse ! L'an 1867 avait fourni un total de recettes énorme : 1.396.834 fr. 35 c. M. Carvalho paraissait à l'apogée, et en même temps il se sentait au déclin. Nous avons déjà indiqué quelques-unes des causes de cette situation ; il y en avait encore d'autres. La provision des œuvres d'origine étrangère, anciennes ou modernes, susceptibles d'alimenter lucrativement le répertoire, était à peu près épuisée ; avec les ouvrages des jeunes on aboutissait à des déceptions. Puis, cette subvention tant souhaitée par M. Carvalho, cette subvention de cent mille francs, non sans peine obtenue, l'avait plutôt, en somme, embarrassé que servi. On lui demandait de rendre beaucoup plus qu'il ne recevait ; encore avait-il trop souvent esquivé l'exécution d'une des clauses, celle en vertu de laquelle il devait monter chaque année un ouvrage en trois actes d'un compositeur non joué jusque-là. Gautier n'avait peut-être pas tout à fait tort lorsqu'il soutenait plaisamment que l'on devrait subventionner les auteurs et non les directeurs. Pour ces derniers, surtout lorsqu'ils sont placés à la tête d'un « théâtre-lyrique », c'est-à-dire un théâtre d'essai qui, par la nature même des œuvres qu'il accueille, s'expose à de grands risques, cent mille francs ne suffisent en aucune manière ; il faudrait le double ou le triple. Dès les premiers mois de 1868 les recettes s'abaissèrent. Une sorte de découragement s'était emparé du directeur, qui, jusqu'au 7 mai, date de la clôture, se borna à effectuer une reprise de la Fanchonnette avec Mme Carvalho, sans donner une seule nouveauté ! On réalisait ainsi cette condition extraordinaire jadis imposée à un directeur de l'Odéon par un ministre original, « lui interdisant de jouer des œuvres nouvelles ». Il est vrai que M. Carvalho avait toutes sortes de projets en tête. On s'était mis à répéter Lohengrin. On méditait de monter le Timbre d'argent, de M. Saint-Saëns, avec Mlle Schrœder, qui avait fait d'heureux débuts dans Rigoletto, Mlle Irma Marié et Troy. Enfin, et surtout, profitant de la position difficile du Théâtre-Italien, il vint à Carvalho l'idée que Perrin avait eue et réalisée sans succès. En conservant la direction subventionnée du Théâtre-Lyrique, il réserverait exclusivement cette scène, avec diminution du prix des places, aux œuvres françaises du répertoire, aux productions des jeunes auteurs dans le domaine de l'opéra-comique, tandis que les grands opéras et les traductions émigreraient à la Salle Ventadour. Celle-ci prenait, pour la deuxième fois, le nom de « Théâtre de la Renaissance », du moins trois fois par semaine, les autres soirs demeurant affectés à la troupe italienne. Le 16 mars eut lieu l'ouverture de cette « Renaissance » avec Faust, interprété par Mme Carvalho, Massy, un ténor vigoureux remarqué dans la Jolie Fille de Perth, et, pour le rôle de Méphistophélès, M. Giraudet, destiné à se créer une belle situation de chanteur. Par suite de l'insuffisance des appareils de chauffage, la salle était glaciale ; l'impression des spectateurs s'en ressentit. Au bout de quelques représentations, M. Carvalho renonça à cette double tâche. La clôture des deux théâtres se fit presque simultanément. A la salle de la place du Châtelet on ferma le 4 mai. M. Carvalho ne devait y rentrer que vingt-trois ans plus tard. Mais même alors, en dépit du changement de dénomination, — cette scène était devenue l'Opéra-Comique, — il en fit, conformément à la marche qu'il avait déjà suivie à la place Favart, un vrai Théâtre-Lyrique, où de véritables opéras tinrent une grande place dans le répertoire, et où il se trouva amené à rejouer nombre de pièces, étrangères ou françaises, qu'il avait montées jadis quand il présidait aux destinées du Théâtre-Lyrique proprement dit, depuis les Dragons, le Médecin et Philémon jusqu'aux Troyens, à Mireille et aux Pêcheurs de perles, depuis les Noces et Orphée, jusqu'à la Flûte enchantée et à la Traviata. *** Les mêmes causes, quelle que soit la diversité des circonstances, engendrent les mêmes effets. La seconde fois comme la première, la succession de Carvalho était lourde à recueillir. Il semblait encore qu'il fallût, en le remplaçant, faire autrement que lui, et tout d'abord paraissait s'imposer inévitablement la nécessité de l'économie, obligation pénible à remplir avec un public que des distributions de premier ordre avaient rendu exigeant, un public auquel on avait donné l'accoutumance des étoiles et même des constellations. Cependant les compétiteurs ne faisaient point défaut : si ingrate que soit une tâche de cette nature, il en est généralement ainsi. Au premier rang de ces téméraires figurait M. Martinet, dont nous retrouverons le nom à la fin de notre étude. Entre les prétendants on comptait aussi Pasdeloup. Ce fut ce dernier qui l'emporta, malheureusement pour lui, car il devait traîner toute sa vie le poids dont le chargea cette malchanceuse gestion. Aucune candidature, du reste, ne pouvait rencontrer plus de sympathies. L'éloge de Pasdeloup n'est plus à faire. Sur ce point il y a unanimité. Il a rendu à l'art un service impossible à oublier, et d'une importance extrême, par la création des Concerts Populaires. Dans les programmes si variés de cette belle entreprise, il montra le plus intelligent et le plus louable éclectisme. Des milliers d'auditeurs ont, grâce à lui, fait une connaissance intime avec les chefs-d'œuvre classiques. D'autre part il a vaillamment lutté, et non sans succès, pour Berlioz et pour Wagner. Il a mis leurs ouvrages, ignorés ou contestés, en contact avec le public. Parallèlement, il a « lancé » tous les jeunes de l'époque, Massenet et Saint-Saëns, Guiraud et Bizet, etc. Aussi, comprenant toute la valeur, toute la portée de l'œuvre à laquelle s'était voué Pasdeloup, lui a-t-on récemment décerné, d'une manière un peu tardive, sans doute, un hommage mérité et point banal. On a fait mieux que donner son nom à une place ; on a inventé une place pour lui donner son nom. Si, malgré son indéniable capacité, Pasdeloup, dans son exploitation théâtrale, ne réussit pas, il n'y a pas lieu de trop s'en étonner. De multiples difficultés étaient d'abord inhérentes à la situation elle-même. Et puis, la direction d'un concert et celle d'un théâtre sont choses fort distinctes. Ces deux fonctions impliquent des aptitudes différentes. Pasdeloup, comme impresario théâtral était inexpérimenté. Il tâtonna. Or l'hésitation ne pouvait être de mise dans la position tendue, critique, que lui avaient préparée les événements. On doit songer que si l'année 1867 avait rapporté plus de treize cent mille francs, la somme encaissée en 1868, avec cinq mois et demi de clôture, il est vrai, ne s'éleva, en additionnant les recettes perçues sous les deux gestions successives, qu'à 387.968 francs. Les pièces nouvelles montées par Pasdeloup, et toutes données en 1869, ne dépassent point le chiffre de trois : un petit acte de Guiraud, En prison, qui, depuis plusieurs années, dans la paix des cartons, attendait tranquillement son tour ; — un opéra-comique en trois actes, dû à l'indissoluble collaboration de M. Jules Barbier et de Michel Carré, Don Quichotte, livret qui après avoir passé par les mains d'Offenbach, avait finalement été mis en musique par M. Boulanger ; cet ouvrage, où l'on distingua quelques passages bien venus, fut interprété par une charmante artiste Mlle Priola, dont nous reparlerons tout à l'heure, par Meillet, un Sancho réjouissant, et par Giraudet, dont le physique s'appropriait merveilleusement au chevalier de la Triste Figure ; — enfin, le Dernier Jour de Pompéi, de deux librettistes non moins inséparables, Nuitter et Beaumont, musique de M. Joncières. Lorsque cette dernière œuvre arriva devant la rampe, Pasdeloup était malade. On s'en aperçut le soir de la première, dont nous avons déjà conté les péripéties plaisantes, — pour tout le monde hormis pour l'infortuné compositeur. Afin de compenser cette parcimonie relative dans les productions nouvelles, Pasdeloup procéda à de nombreuses reprises, et surtout il monta quelques ouvrages étrangers, curieux à un titre quelconque, ou qui, étant totalement oubliés, équivalaient, par le fait, à des nouveaux. En un mot, par des moyens divers, il essaya, ce qui, après tout, était digne d'approbation, d'enrichir et de transformer quelque peu le répertoire. Il était d'ailleurs artistement secondé dans la direction de l'orchestre qu'il s'était réservée au lieu et place de Deloffre, par M. Mangin, à qui, par parenthèse, fut confiée la musique d'un à-propos, la Fête de la France, joué le 15 août 1869. La première reprise à laquelle Pasdeloup donna ses soins fut celle du Val d'Andorre, avec une débutante, Fidès Devriès, qui fut par la suite, à l'Opéra, une « grande favorite ». Encore bien inexpérimentée, elle fit du moins beaucoup apprécier sa rare beauté, sa distinction, le charme exquis, la grâce chaste dont son allure était empreinte. Ensuite on joua tour à tour le Barbier de Séville qui avait déserté l'affiche depuis dix ans, l'Irato qui, mal chanté, n'obtint qu'une représentation, le Maître de chapelle et le Brasseur de Preston qui n'avait jamais figuré au programme du Théâtre-Lyrique ; Mlle Daram et Meillet s'y firent beaucoup applaudir, et la pièce fut donnée soixante fois. A ces quatre reprises, avant la fin de l'année 1868, s'en ajouta une autre, tout à fait intéressante, celle d'Iphigénie en Tauride, le dernier et peut-être le plus parfait des chefs-d'œuvre de Gluck. Par malheur, avec Mme Lacaze, Bosquin alors débutant, et M. Aubéry, l'interprétation n'était que suffisante, ce qui, en français, selon la malicieuse remarque de Banville, veut dire qu'elle ne suffisait pas. Il eût fallu quelque chose de plus, afin de forcer l'attention et l'admiration du public mis en face de cette œuvre si grande mais si austère. Ce n'était là, pour Pasdeloup, que des combats préliminaires. Après deux représentations du dernier acte de Roméo et Juliette, de Vaccaj, après la pièce déjà citée de Guiraud, En prison, après la reprise de la Poupée de Nuremberg, ce fut seulement le 6 avril 1869 que le directeur risqua une importante bataille avec le Rienzi de ce Wagner qu'il semblait avoir juré de révéler et de faire aimer à la France. Nous n'avons point perdu la mémoire de cette soirée. La place que nous réussîmes à nous procurer au quatrième étage, nous l'avions bien gagnée en faisant queue depuis onze heures du matin, en compagnie notamment de deux amateurs non moins convaincus que nous, Ménard-Dorian et Stoullig. On s'attendait à ce qu'un des plus graves écrivains de notre temps a osé nommer « du boucan ». Il n'y en eut pas. On écouta la pièce attentivement, et, selon l'expression de M. Loyal, de Molière, « sans passion ». Peut-être eût-il mieux valu moins de tiédeur. L'interprétation pouvait être tenue pour satisfaisante. Elle comprenait les deux ténors Monjauze et Massy, Lutz, Giraudet, Mmes Sternberg, Borghèse, la créatrice des Dragons, bien fatiguée, et Mlle Priola qui, dans le rôle charmant, si purement dessiné, du messager de paix, enchanta et conquit son public. Une espèce d'indifférence peu justifiée répondit à la tentative, hardie en somme et intéressante, de Pasdeloup. Il essaya de se dédommager avec la traduction française du Bal masqué ; mais dans la distribution, quoique bonne, manquait, comme précédemment, l'élément supérieur; il y avait trop notable infériorité en comparaison de la troupe que les Italiens avaient mise ou mettaient encore au service de l'élégante et dramatique partition de Verdi. Pasdeloup recourut aussi à un opéra dont il avait été maintes fois question : la Bohémienne de Balfe. On y constata la décadence de Mme Wertheimber qui jadis avait, la première, incarné Pygmalion dans Galathée ; en revanche, ce fut un des plus brillants succès que rencontra dans sa carrière Mme Brunet-Lafleur, qui arrivait de l'Opéra-Comique. La pièce, célèbre dans toute l'Europe, était, on le sait, d'origine anglaise. C'est la seule de cette provenance que l'on ait montée au Théâtre-Lyrique, puisqu'on y avait renoncé au projet, un instant débattu, de donner un ouvrage de Benedict, anglais d'ailleurs à peu près au même titre que Händel, et que, l'année suivante, on ne se décida pas davantage, après y avoir pensé, pour la Lurline, de Wallace. La plupart des œuvres précitées, nouvelles ou non, françaises ou étrangères, avaient, à des degrés divers, intéressé les amateurs, mais aucune n'avait positivement rempli la caisse du théâtre. Les recettes de 1869, avec trois mois de clôture, n'allaient guère au delà de 400.000 francs. Le 1er février 1870, le pauvre Pasdeloup se voyait contraint d'abandonner la partie. La succession fut briguée par plus d'un aspirant, entre autres, fait assurément imprévu et assez bizarre, par Carvalho lui-même. Mais, en définitive, les artistes décidèrent de se constituer en Société. Nous arrivons à la période suprême. Plusieurs pièces furent alors mises à l'étude : la Chaste Suzanne, de Monpou, autrefois créée à la Renaissance ; l'Ombre, ouvrage nouveau de Flotow, dont la première représentation, annoncée, puis retardée du fait de Mme Cabel, eut lieu sur une autre scène, à l'Opéra-Comique. La clôture s'effectua le 31 mai par un spectacle coupé, où l'on fit 7.400 francs de recette ; de tels chiffres étaient hélas ! inconnus depuis longtemps. Jusqu'à cette fermeture on ne donna aucune nouveauté ; quant aux reprises, il n'y en eut qu'une, intéressante d'ailleurs, celle de Charles VI, d'Halévy, où Mlle Bloch, obligeamment prêtée par M. Perrin, se substitua au dernier moment à Mme Brunet-Lafleur, tandis que Mlle Daram prenait la place de Mlle Schroeder qui avait répété le rôle d'Isabeau. Les autres interprètes étaient MM. Lutz, Massy, très en voix, Giraudet, Caillot, Coppel, Legrand, Bacquié et Jalama. Quand on songe que la guerre, ayant pour conséquence les désastres et l'invasion, allait éclater quelques semaines plus tard, il est trop aisé de remarquer ce qu'après coup certains vers de Charles VI pouvaient paraître avoir contenu d'allusions prophétiques, ceux-ci par exemple : Un jour voit mourir une armée Mais un peuple ne meurt jamais. *** Nous sommes parvenu au terme de notre travail. Nous n'entrerons point dans le détail des réflexions qu'il peut suggérer aux lecteurs attentifs. Nous nous bornerons à une seule observation. Les événements de 1870-71 — nous avons eu, en divers ouvrages, maintes occasions de le faire observer — n'eurent pas immédiatement, sur l'évolution du théâtre en France, l'influence qu'ils auraient semblé devoir exercer. Ils ne diminuèrent pas notre prédilection pour l'art dramatique, et les pièces représentées au lendemain de nos épreuves se distinguèrent peu de celles que l'on jouait à la veille de la guerre. Sur un point, cependant, il y eut, presque tout de suite, modification dans les goûts régnants. Par une transformation assez inattendue au lendemain d'une lutte avec l'Allemagne, Wagner gagna rapidement du terrain, lui dont le Rienzi , un peu auparavant, avait été, on l'a vu, accueilli sans protestation mais aussi sans vif enthousiasme. Sous l'influence des théories et des œuvres wagnériennes, il se produisit parmi les amateurs et même dans la masse du public une aspiration vague mais générale vers une formule nouvelle. Sans doute l'idée que l'on se faisait alors du « drame lyrique », si à la mode aujourd'hui, n'était pas très précise ; elle existait néanmoins à l'état embryonnaire. Or, dans la crise que nous traversâmes, un seul théâtre disparut, et il se trouva que ce fut précisément celui où aurait pu le mieux se satisfaire et se réaliser la tendance que nous venons de signaler. Ce théâtre disparut, disons-nous, car il est impossible de considérer comme sérieuse la tentative faite par M. Martinet après la Commune, après l'abandon des locaux, d'ailleurs incendiés, du Châtelet, pour continuer, dans les sous-sols de l'Athénée, avec une subvention réduite, une exploitation devenue, en ces conditions, désavantageuse et même impraticable. Quant à l'Opéra-Comique, ainsi que nous l'avons déjà expliqué, autant par les préférences artistiques de ses directeurs que par l'irrésistible force des choses, il devint, il est vrai, dans une certaine mesure, l'héritier du Théâtre-Lyrique, mais ce fut au détriment du genre déterminé qui constituait sa raison d'être. En résumé, là où il y avait eu, antérieurement, deux théâtres, il n'y en eut plus qu'un, et cela, juste au moment où la coexistence de deux scènes lyriques distinctes, parallèles au grand Opéra, apparaissait comme plus particulièrement nécessaire. Mars 1899.
=> ouvrages représentés du 27 septembre 1851 au 01 juin 1870 (tableau 1) => ouvrages représentés du 27 septembre 1851 au 01 juin 1870 (tableau 2)
(Emile Jean Albert SOUBIES [75002.Paris, 10 mai 1846 - Paris, mars 1918], Histoire du Théâtre-Lyrique, 1851-1870, 1899)
|