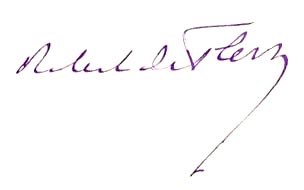Robert de FLERS

Robert de Flers en 1921
Marie Joseph Louis Camille Robert de LA MOTTE-ANGO, comte DE FLERS, dit marquis Robert de FLERS
auteur dramatique français
(Hôtel de la Sous-préfecture, Pont-l'Evêque, Calvados, 25 novembre 1872* – Vittel, Vosges, 30 juillet 1927)
Fils de Jean Robert Raoul de LA MOTTE-ANGO, comte de FLERS (1846 –), sous-préfet, et de Marie Louise Marguerite de ROZIÈRE (1851 –) [fille de Marie Louis Thomas Eugène de ROZIÈRE (Paris, 03 mai 1820 – Paris, 18 juin 1896), homme politique].
Epouse à Paris 8e le 22 juin 1901* Geneviève Marie Evélina SARDOU (Marly-le-Roi, Seine-et-Oise [auj. Yvelines], 24 mai 1875* – Paris 16e, 31 mars 1958*), fille de Victorien SARDOU, auteur dramatique.
Il fit paraître en 1896 une courte nouvelle, la Courtisane Taïa et son singe vert, et vers la même époque un volume d'impressions, Vers l'Orient, que suivirent un conte Ilsée, princesse de Tripoli (1898), un recueil de nouvelles, Entre cœur et chair (1899). Puis il se consacra au théâtre, où il donna, en collaboration avec Gaston Arman de Caillavet, une série de pièces d'une gaîté et d'une fantaisie étincelantes. Les deux auteurs commencèrent par des opéras bouffes à intentions parodiques : les Travaux d'Hercule (1901) ; le Sire de Vergy (1903) ; Monsieur de La Palice (1904) ; Pâris ou le Bon juge (1906) ; puis ils abordèrent la comédie de mœurs, fustigeant sans âpreté et avec une verve souriante les ridicules de leur temps. Les Sentiers de la vertu (1903) ; l'Ange du foyer (1905) ; Miquette et sa mère (1906) ; l'Amour veille (1907) ; l'Eventail (1907) ; le Roi, avec E. Arène (1908) ; l'Ane de Buridan (1909) ; le Bois sacré (1910) ; Papa (1911) ; Primerose (1911) ; la Belle aventure, avec E. Rey (1913) ; l'Habit vert (1913) ; Monsieur Brotonneau (1914), forment une suite d'œuvres divertissantes, assez diverses de ton, mais caractérisées par une grande légèreté de composition, une inépuisable fantaisie et un jaillissement perpétuel de mots d'esprit. L'observation manque peut-être de profondeur, et le caractère des personnages est souvent bien artificiel ; mais ces défauts disparaissent dans le mouvement général de ces comédies, qui dénotent une extraordinaire habileté de main, et abondent en trouvailles joyeuses ou délicates. On doit aussi aux deux collaborateurs une pièce historique : la Montansier (1904).
Après la mort de Caillavet (1915), de Flers prit pour collaborateur Francis de Croisset, et écrivit avec lui le Retour (1920) ; les Vignes du Seigneur (1923) ; Romance (1923) ; les Nouveaux Messieurs (1925) ; le Docteur Miracle (1926), ainsi que le livret de Ciboulette, opérette, musique de Reynaldo Hahn (1923).
Il fut nommé chevalier (13 janvier 1907), officier (07 août 1913), puis commandeur (22 août 1926) de la Légion d'honneur. Elu à l'Académie française le 03 juin 1920, il était depuis 1921 directeur littéraire du Figaro, où il rédigeait également le feuilleton dramatique.
Il habita 70 boulevard de Courcelles à Paris 17e. En 1905, il habitait 4 avenue Hoche à Paris 8e. Il est décédé en 1927 à cinquante-quatre ans.
|
livrets
l'Heure du berger, ballet en 1 acte et 6 tableaux, avec Gaston Arman de Caillavet, musique de Louis Ganne (Palais de la Danse, 1900, chorégraphie de Mariquita) les Travaux d'Hercule, opéra bouffe en 3 actes, avec Gaston Arman de Caillavet, musique de Claude Terrasse (Bouffes-Parisiens, 16 mars 1901) Chonchette, opéra bouffe en 1 acte, avec Gaston Arman de Caillavet, musique de Claude Terrasse (Capucines, 12 avril 1902) le Sire de Vergy, opérette bouffe en 3 actes, avec Gaston Arman de Caillavet, musique de Claude Terrasse (Variétés, 16 avril 1903) Monsieur de La Palisse, opéra bouffe en 3 actes, avec Gaston Arman de Caillavet, musique de Claude Terrasse (Variétés, 02 novembre 1904) Pâris ou le Bon juge, opéra bouffe en 2 actes, avec Gaston Arman de Caillavet, musique de Claude Terrasse (Capucines, 01 mars 1906) Fortunio, comédie musicale en 4 actes, avec Gaston Arman de Caillavet, musique d'André Messager (Opéra-Comique, 05 juin 1907) => fiche technique la Veuve joyeuse, opérette en 3 actes, version française avec Gaston Arman de Caillavet, musique de Franz Lehar (Apollo, 28 avril 1909) la Vendetta, drame lyrique en 3 actes, avec Gaston Arman de Caillavet, musique de Jean Nouguès (Opéra de Marseille, 27 janvier 1911) le Comte de Luxembourg, opérette en 3 actes, version française avec Gaston Arman de Caillavet, musique de Franz Lehar (Apollo, 13 décembre 1912) Béatrice, légende lyrique en 4 actes, avec Gaston Arman de Caillavet, musique d'André Messager (Monte-Carlo, 21 mars 1914 ; Opéra-Comique, 23 novembre 1917) => fiche technique Cydalise et le Chèvre-pied, ballet en 2 actes et 3 tableaux, avec Gaston Arman de Caillavet, musique de Gabriel Pierné (Opéra de Paris, 15 janvier 1923) Ciboulette, opérette en 3 actes, avec Francis de Croisset, musique de Reynaldo Hahn (Variétés, 07 avril 1923 ; Opéra-Comique, 13 mars 1953) le Jardin du Paradis, comédie lyrique en 4 actes, avec Gaston Arman de Caillavet, musique d'Alfred Bruneau (Opéra de Paris, 23 octobre 1923) le Diable à Paris, opérette en 3 actes, avec Francis de Croisset et Albert Willemetz, musique de Marcel Lattès (Théâtre Marigny, 21 octobre 1927) |

Robert de Flers en 1907
|
Il faudrait remonter très haut pour atteindre aux origines de la famille du nouvel académicien, dont les aïeux ont été, au cours des divers siècles, mêlés de très près à notre histoire nationale, sous les figures successives d'un compagnon de Clovis, d'un frère de Jeanne d'Arc, d'un corsaire — le fameux Jean Ango, — d'un des chefs de la Ligue — le cardinal de Pellevé, — d'un général de la Révolution, et enfin, aux époques plus récentes, de juristes, d'administrateurs, d'archéologues. Le grand-père maternel de R. de Flers, Eugène de Rosière, professa à l'école des Chartes, et siégea à l'Institut ; quant à son père, le marquis Camille de Flers, il laissa le souvenir d'un homme du monde et d'un causeur charmant, qui s'intéressait également à la politique et aux lettres, et qui écrivit, entre autres ouvrages, une Vie anecdotique de Louis-Philippe. En présence d'un atavisme si compliqué, il est malaisé de déterminer ce que R. de Flers doit à ses ancêtres ; ils sont trop ! Pourtant, un partisan résolu de l'hérédité ne manquerait pas de voir dans cette multiplicité même une condition éminemment propice à la formation d'un auteur dramatique, puisque le propre de l'homme de théâtre est précisément de revêtir tour à tour les personnalités les plus diverses, ce qui est particulièrement facile quand on a derrière soi une lignée d'ancêtres aptes à vous fournir de caractères et de sentiments variés. A l'appui de cette thèse, on pourrait faire valoir le goût précoce que R. de Flers marqua pour le théâtre, le plaisir qu'il prenait, tout enfant, à composer et à représenter de naïves piécettes, les succès qu'il remporta, adolescent, à jouer la comédie de salon, enfin la part qu'il fit au théâtre dans sa vie sentimentale, en épousant la fille d'un des maîtres de la scène française, Victorien Sardou. Si impérieuse que fût cette vocation, elle ne se manifesta pas tout de suite. Après avoir fait au lycée Condorcet d'honorables études, R. de Flers suivit jusqu'à la licence les cours de l'Ecole de droit, et prit également à la Faculté des lettres sa licence d'histoire. Alors seulement se tourna-t-il vers la littérature. Une croisière dans le bassin méditerranéen fut l'occasion de son premier livre, Vers l'Orient (1896), où, dans d'aimables descriptions de Naples, de l'Egypte et de la Grèce, se joue la grâce d'un esprit charmant et d'un dilettantisme délicat, dont le modernisme rajeunit agréablement la vision de ces terres antiques. Ces qualités s'attestent aussi dans un petit conte : la Courtisane Taïa et son singe vert paru la même année, dans un volume Entre cœur et chair publié en 1899, et dans un livre d'Essais de critique (1900) qui permit d'apprécier la souplesse de talent du jeune écrivain. Entre temps, R. de Flers était entré à la rédaction du « Soleil », d'où il devait passer à celle du « Figaro ». C'est là qu'il fit la rencontre d'Arman de Caillavet ; entre les deux jeunes gens se noua une amitié profonde, bientôt doublée d'une association intellectuelle des plus fécondes et des plus prospères, qui se poursuivit sans heurts pendant de longues années, se marqua par plus de vingt ouvrages, et ne se rompit qu'à la mort d'Arman de Caillavet (1913). A cette date, d'ailleurs, la guerre avait donné à l'activité de R. de Flers une autre direction. Mobilisé dès le début des hostilités, il fut attaché ensuite à l'armée roumaine comme officier de liaison ; il y remplit plusieurs missions périlleuses et fut l'objet de quatre citations. La guerre terminée, il reprit au « Figaro » ses fonctions de rédacteur en chef, aux côtés d'A. Capus. En 1921, pour des raisons d'administration intérieure, ils donnèrent l'un et l'autre leur démission, et passèrent au « Gaulois », où R. de Flers tient le feuilleton dramatique. Il est en outre président de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, et membre de l'Académie française depuis le 3 juin 1920. Sa réputation d'homme d'esprit l'a fait choisir pour prendre la parole à Versailles, le 27 juin 1921, devant le roi d'Espagne, qui visitait une intéressante exposition organisée par les Amis de Versailles. A cette occasion, R. de Flers a fait une conférence pleine de verve, d'érudition et de goût, sur l'Esprit de mots en France au XVIIIe siècle. C'est au théâtre, que R. de Flers a conquis sa notoriété, et son nom y est inséparable de celui d'Arman de Caillavet. Les deux écrivains ont réalisé une « raison sociale » qui prendra place, dans l'histoire littéraire, à côté de celles d'Erckmann-Chatrian et de Meilhac et Halévy. Pendant seize ans, en effet, ils ont travaillé en commun, associant non seulement leur labeur mais aussi leurs goûts, leurs opinions, et cela de façon si étroite qu'il est très difficile de déterminer dans leurs œuvres la part de chaque collaborateur. Tout au plus pourrait-on hasarder une timide induction. Depuis la mort de son associé, R. de Flers n'a donné au théâtre qu'une œuvre, le Retour, signée avec Fr. de Croisset. On y retrouve le même esprit, la même gaieté adroitement additionnée d'une sentimentalité à fleur d'âme ; il y manque cependant ce débordement de verve fantaisiste, ces trouvailles cocasses qui, du Sire de Vergy à l’Habit vert, marquaient toutes les œuvres des deux auteurs. Faut-il en conclure que c'était là l'apport personnel de Caillavet, et qu'il aurait été le Meilhac de cette association ? Simple hypothèse, qu'il ne convient de suggérer qu'avec prudence. C'est en 1901, que de Flers et Caillavet abordèrent le théâtre, avec les Travaux d'Hercule. C'était une tentative audacieuse, que de remettre à la scène ce genre de parodie mythologique qui, depuis la Belle Hélène et Orphée aux enfers, paraissait quelque peu usé. Mais les deux auteurs, s'étant proposé pour modèles Meilhac et Halévy, se devaient d’imprimer à leur carrière la même courbe, et de préluder à la comédie par l'opérette. Du moins, eurent-ils l'art de rajeunir une formule un peu vieillotte, par la gaieté et l'esprit très moderne dont ils assaisonnèrent leur sujet d'ailleurs ingénieusement conçu (Hercule était présenté comme un lourdaud incapable et paresseux, se bornant à recueillir la gloire des exploits accomplis par un rival qui, lui ayant enlevé sa femme, lui avait en outre emprunté son costume) ; bref, ils réussirent là où plus d'un avant eux avait échoué. Il est vrai de dire qu'ils avaient rencontré en Cl. Terrasse un musicien dont la verve amusante rappelait celle d'Offenbach. On put croire à une résurrection de l'opéra bouffe. Le Sire de Vergy (1903) et Monsieur de La Palisse (1904) confirmèrent ces espoirs. On trouvait dans la première de ces pièces une outrance de parodie poussée jusqu'au burlesque, mais exempte cependant de toute grossièreté. Cette « charge » du moyen âge, malgré l'extravagance des situations, demeurait pleine de finesse et d'une divertissante fantaisie. Monsieur de La Palisse, sans rien perdre de sa force comique, témoignait de plus de mesure : la bouffonnerie s'y teintait volontiers d'ironie ; on sentait que les auteurs s'assagissaient, et évoluaient vers une forme de comédie plus relevée, dont ils venaient du reste de donner un exemple avec les Sentiers de la Vertu (1903). De fait, à part une dernière incursion dans l'opéra bouffe avec Pâris ou le Bon Juge (1906), de Flers et Caillavet abandonnèrent définitivement ce genre. Toutefois, ils ne renoncèrent jamais entièrement à leur humeur parodique qui, adroitement transposée et appliquée à la vie contemporaine, continue à circuler à travers toutes leurs pièces et constitue en définitive un des traits distinctifs de leur talent. N’est-ce pas elle qui inspire ces divertissants paradoxes sur lesquels ils aiment à fonder le sujet de leurs pièces et que l'on trouve dès leur première comédie ? Les Sentiers de la Vertu tendraient à démontrer — si l'on peut toutefois parler de démonstration — que la vertu poussée trop loin offre des inconvénients. Certes, Molière avait déjà enseigné, dans le Misanthrope, que La parfaite raison fuit toute extrémité Et veut que l'on soit sage avec sobriété. Mais comme nous sommes loin ici de l'âpreté de notre grand comique ! Pour avoir giflé un audacieux qui la serrait de trop près, la vertueuse Cécile Gerbier a déchaîné un véritable scandale ; l'hypocrisie mondaine ne lui pardonne pas cette manifestation outrancière de vertu. Tout rentrera dans l'ordre, et Cécile retrouvera sa considération, lorsqu'elle aura cédé à un autre soupirant. On sent bien tout ce qu'il y a d'ironie cachée sous un tel sujet, et l'on y pourrait voir le procès d'une société accueillante au vice pourvu qu'il conserve des dehors de respectabilité. Mais les auteurs n'ont garde d'appuyer : ils dissimulent soigneusement ce qu'il y a d'amer dans leur observation ; ils s'arrêtent à la surface des sentiments et des caractères, et ne laissent paraître jamais qu'une indulgence amusée. Ayant une fois adopté cette attitude, les deux auteurs s'y tinrent dans toute la suite de leurs œuvres ; ce n'est pas que celles-ci manquent de variété. Tout au contraire, le théâtre de R. de Flers et Caillavet témoigne de leur part d'un constant et louable effort pour se renouveler. Sans parler de la Montansier (1904), pièce historique à spectacle, où il ne faut voir qu'un acte de déférence du gendre de Sardou envers son beau-père, on peut dire qu'ils ont abordé toutes les formes de comédies. Si l'Ange du foyer (1905), et Miquette et sa mère (1906) sont encore d'aimables fantaisies, qui découlent de la même veine que les Sentiers de la Vertu, ne touchons-nous pas, avec l'Amour veille (1907), l'Eventail (1907), l'Ane de Buridan (1909), à la comédie de caractère ? Papa (1911), Primerose (1911), la Belle Aventure (1913) — écrite en collaboration avec E. Rey — appartiennent au genre de la comédie sentimentale, tandis que le Roi (1908) — écrit avec E. Arène, — le Bois Sacré (1910), l’Habit Vert (1913) sont des comédies satiriques qui se rattachent à la tradition aristophanesque. Pourtant, il ne faudrait pas mettre trop de rigueur dans cette classification. De Flers et Caillavet sont des esprits trop indépendants et trop légers, pour s'enfermer dans une formule étroite et rigoureuse ; la souplesse de leur talent leur permet d'évoluer parmi la diversité des genres, sans s'attacher à aucun et en les mêlant même le plus souvent. Dans leurs pièces les plus folles, ils savent mettre en temps voulu la petite note émue ou naïve qui tempère agréablement le rire. Leurs comédies de caractère nous mirent des esquisses plutôt que des portraits ; le dessin des figures est, de parti pris, on le sent, à peine indiqué. Leurs comédies sentimentales ne cherchent pas leur source d'émotion dans la violence des faits, mais dans le heurt de sentiments très simples, et se déroulent dans une atmosphère de gaieté rassurante. Ce sont de « petits orages qui ne se terminent que par un arc-en-ciel ». Enfin, ce qu'il y a de cinglant et d'âpre dans leurs comédies satiriques est atténué non seulement par un débordement intentionnel de bouffonnerie et d'extravagance, mais par l'orientation même de leur satire qui évite les personnalités, et porte uniquement sur les mœurs. C'est là peut-être un défaut, et certains critiques ont parfois reproché aux deux auteurs de n'avoir pas donné l'entière mesure de leur talent, et de nous laisser seulement entrevoir tout ce dont ils seraient capables. Est-ce coquetterie de leur part, comme chez ces femmes qui mesurent parcimonieusement leurs faveurs pour se faire désirer davantage ? Peut-être ; mais, au fond, la vraie raison c'est que de Flers et Caillavet ne reconnaissent d'autre loi que celle de leur fantaisie. Sans doute, leurs comédies offrent une part incontestable d'observation. Leur théâtre — et c'est ce qui explique en partie leur contant succès — est une peinture de notre société contemporaine : nous y rencontrons des types que nous coudoyons tous les jours ; le ton du dialogue est — avec infiniment plus d'esprit, cela va sans dire — celui-là même des conversations mondaines. Des pièces comme le Roi ou le Bois sacré nous présentent, des milieux parlementaires ou littéraires, une peinture dont la justesse apparaît derrière l'outrance de la caricature. Mais outre que cette observation est assez superficielle, saisissant plus volontiers les mœurs que les caractères, elle s'égare bien vite dans la fantaisie, qui est le seul terrain où se plaisent de Flers et Caillavet. Trouvent-ils dans la réalité un sujet de pièce comme le Roi, le Bois sacré, l'Habit vert, au lieu de s'en tenir aux données de l'observation ils se transportent aussitôt dans le domaine de l'irréel ; ils outrent à plaisir les caractères, imaginent les situations les plus cocasses, déploient dans le dialogue une verve extraordinaire, bref, font d'une satire impertinente et audacieuse une divertissante folie, dont le spectateur étourdi ne saisit que plus tard la portée. Quant aux comédies qui, comme l'Ane de Buridan, Papa, Primerose, semblent par leur allure et leur ton plus voisines de la vie courante, qu'on ne s'y trompe point : ce n'est là qu'une apparence. En fait, les auteurs, par un procédé contraire, se sont amusés à donner une apparence de vérité à une œuvre de pure imagination. Ils ont d'ailleurs la loyauté de nous en avertir, tant par la légèreté de la composition, où la logique n'est pas toujours observée, que par le caractère un peu artificiel des personnages, qui ne se manifestent que dans la mesure où le veulent bien les auteurs, et par les mots dont étincelle le dialogue, et qui trahissent, à travers les répliques des acteurs, la voix même de de Flers et de Caillavet. Mais tout cela est si adroitement conduit, si habilement dosé et d'un mouvement si vif, que le spectateur, en dépit des avertissements, reste dupe et prend pour de la vie réelle ce qui n'est que le jeu de deux charmants esprits. Présenter la vérité sous le couvert de la fantaisie, donner à la fantaisie les couleurs de la vérité, telle est la double veine d'où dérive tout le théâtre de Robert de Flers et Arman de Caillavet. Faute de ne pas serrer d'assez près la réalité, leurs pièces perdent peut-être en vigueur, mais on ne peut nier qu'elles ne gagnent en agrément. Cela permet en effet aux auteurs d'aborder avec un égal bonheur des sujets qui, traités par d’autres, ou autrement, apparaîtraient trop hardis ou même pénibles. Qu'un père, après vingt-huit ans d'indifférence, s'avise tout à coup de reconnaître son fils naturel, pour tomber peu après amoureux de la fiancée de celui-ci et finalement la lui ravir, voilà, n'est-il pas vrai, un sujet de drame cruel. Papa reste cependant une comédie gaie, parce que les auteurs nous marquent que leurs personnages ne prennent pas la vie au sérieux. Et c'est aussi pourquoi l'héroïne de la Belle Aventure, malgré la hardiesse de son équipée, garde son âme neuve de jeune fille, généreuse et innocente. A quoi bon s'effaroucher, puisqu'on sait que tout cela « c'est pour rire » ? Cette même fantaisie a encore heureusement servi les auteurs en leur permettant de renouveler les types du répertoire comique. Le plus divertissant chez eux est assurément celui de l'homme à bonnes fortunes, dont le succès n'a d'égal que la sottise, tel le Georges Boullains, l'Ane de Buridan, qui « a six cravates contre une idée, et de cerveau juste ce qu'il faut pour s'enrhumer ». Enfin, à leur fantaisie que rien n'entrave, de Flers et Caillavet doivent d'avoir déployé dans leur dialogue une verve d'une richesse et d'un éclat vraiment uniques. C'est un jaillissement perpétuel de mots drôles, une débauche d'esprit qui va du calembour à la blague, de la boutade au concetti. Tantôt c'est une plaisanterie imprévue : Provençal par ma mère, je suis anglo-saxon par un ami de mon père ; tantôt un mot qui peint plaisamment un caractère : Ah ! je l'ai bien aimé ! — Qui ça ? — Tous ; ou encore : Je ne puis réfléchir aux choses qu'après les avoir faites ; avant, on ne peut pas se rendre compte ; tantôt une pensée fine qui prend air de maxime : Aujourd'hui la vie va si vite, que la conscience ne peut pas suivre. La satisfaction du devoir accompli, c'est la satisfaction de ne plus avoir à l'accomplir. Le grand mérite de ce théâtre est donc d'être avant tout un théâtre gai. Il vaut moins par la hauteur des pensées ou la puissance de l'intrigue que par une extraordinaire habileté de main, une infinité de trouvailles joyeuses ou délicates, un dialogue toujours spirituel. Les auteurs n'ont pas porté à la scène de graves problèmes sociaux ou psychologiques ; dans le cadre d'aventures plaisantes et agréablement contées, ils se sont bornés à nous tracer une peinture souriante et moqueuse de la société d'aujourd'hui, et particulièrement de la société parisienne. D’aucuns peuvent même regretter qu'ils aient trop complaisamment sacrifié au parisianisme, et qu'affaiblissant par là leurs œuvres, ils leur aient ôté peut-être un élément de durée. Mais, outre que c'est déjà un rare mérite d'être à ce point représentatif de son époque, n'est-on pas assuré en France de l'immortalité quand on a de l'esprit ? D'ailleurs, si l'on y regarde bien, ces pièces d'allure légère et capricieuse enferment, sous l'artifice des mots, autant et souvent plus de pensée que bien d'autres œuvres plus prétentieuses. Philosophes aimables, qui considèrent d'un œil indulgent la comédie du monde, de Flers et Caillavet ne sont point dupes des sottises, des indélicatesses, des vilenies qui marquent le train ordinaire de la vie sociale. Ils les cinglent au passage, et si leur rire ne casse pas les vitres il les fait quand même un peu trembler. (F. Guirand, Larousse mensuel illustré, novembre 1921)
Depuis 1921, R. de Flers avait continué à partager son activité entre le théâtre et le journalisme. Directeur littéraire du Figaro, assumant dans ce même journal la tâche du feuilleton dramatique, il était, malgré sa grande puissance de travail, trop absorbé par cette double besogne, pour réserver à l'art dramatique autant de temps qu'il l'eût souhaité. Et puis, la mort de son fidèle collaborateur, Arman de Caillavet, survenue en 1915, l'avait laissé désemparé. Quand, pendant près de quinze ans, on a eu l'habitude de travailler en commun, par un échange constant d'idées et de répliques, où les mots jaillissent et s'engendrent, pour ainsi dire, les uns des autres, il est presque impossible de s'astreindre à la besogne d'une composition solitaire. Privé de Meilhac, Halévy n'écrivit plus pour le théâtre. Il est vrai qu'il avait aussi l'excuse de l'âge. Robert de Flers, dans la pleine maturité de son talent, ne pouvait songer à la retraite. Il chercha donc un nouveau collaborateur, et le trouva en Francis de Croisset, avec qui il écrivit et fit représenter : le Retour (1920), les Vignes du Seigneur (1923), Romance, d'après l'œuvre d’Edward Sheldon (1923), les Nouveaux Messieurs (1925), le Docteur Miracle (1926). R. de Flers et F. de Croisset écrivirent aussi le livret d'une opérette, Ciboulette, musique de Reynaldo Hahn (1923). Malgré le talent des deux auteurs et leur profonde connaissance du métier dramatique, cette association fut loin de valoir la précédente. Sans doute, leurs pièces étaient toujours amusantes, pleines d'observations fines, serties d'esprit et d'émotion ; mais il leur manquait — sauf peut-être dans les Vignes du Seigneur — cette drôlerie irrésistible, cette vis comica, qui avait valu au théâtre de Flers et Caillavet sa triomphale renommée. En outre, chacun des deux collaborateurs était venu à l'association avec son originalité propre, son talent déjà formé : malgré leur bon vouloir, leurs tendances personnelles se faisaient jour dans leurs œuvres, et créaient des disparates qui nuisaient à l'unité de l'ensemble. Pour la première fois même, dans sa carrière, R. de Flers ne recueillit, avec le Docteur Miracle, qu'un demi-succès. Nullement découragé, d'ailleurs, de Flers a été surpris par la mort alors qu'il venait d'achever, avec F. de Croisset, le livret d'une opérette : le Diable à Paris, et qu'il travaillait à une comédie : les Précieuses de Genève, qui devait être une satire de la diplomatie. L'émotion causée dans le monde des lettres et du théâtre par la mort de R. de Flers, les innombrables sympathies qui s'affirmèrent de toutes parts, témoignent que l'homme était aussi aimable et aimé que l'écrivain. C'est que, comme l'a fort bien dit H. de Régnier, « l'esprit et le cœur étaient chez lui d'une égale distinction ». Très grande était sa puissance de séduction, qu'il devait à sa parfaite courtoisie, à son inaltérable bonne humeur, à sa malice exempte de méchanceté et de rosserie, à sa sagesse indulgente faite d'ironie et de pitié. Ce sont, d'ailleurs, ces mêmes qualités qui se retrouvent dans son œuvre, et en font à la fois le charme et le prix. (F. Guirand, Larousse Mensuel Illustré, octobre 1927) |

Robert de Flers, photo H. Manuel, vers 1924