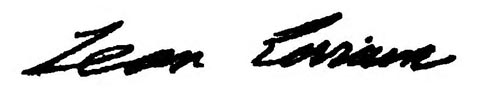Jean LORRAIN

Martin Paul Alexandre DUVAL dit Jean LORRAIN
écrivain français
(Fécamp, Seine-Inférieure [auj. Seine-Maritime], 09 août 1855* – 19 rue d'Armaillé, Paris 17e, 30 juin 1906*)
Fils d’Aimable Martin DUVAL (Fécamp, 13 mai 1815 – Fécamp, 02 février 1886), armateur, et d’Henriette Elisabeth Pauline MULAT (Doingt, Somme, 23 avril 1833 – Nice, Alpes-Maritimes, 18 mai 1926), mariés à Doingt le 09 octobre 1854.
Cet écrivain subtil, au style souple et vivant, est un analyste à l'esprit poétique, à la verve incisive et mordante. Il a collaboré au Mot d'ordre, au Courrier français, à l'Evénement, à Echo de Paris, au Journal, etc., et donné, sous le pseudonyme de RAITIF DE LA BRETONNE, des notes et impressions très évocatrices et curieuses. Outre des recueils de vers : le Sang des dieux (1882), Modernités (1885), les Griseries (1887), l'Ombre ardente (1897), on lui doit un grand nombre de nouvelles et de récits, entre autres : la Forêt bleue (1883) ; Viviane (1885) ; les Lépillier (1885) ; Très Russe (1886) ; Dans l'oratoire (1888) ; Songeuse (1891), un petit chef-d’œuvre ; les Buveurs d'âmes (1893) ; Sensations et souvenirs (1895) ; Un Démoniaque (1895) ; Monsieur de Bougrelon (1897) ; Loreley (1897) ; Une Petite Ville (1898) ; Princesse d'Italie (1898) ; Poussières de Paris (1899) ; Heures d'Afrique (1899) ; la Dame turque (1899) ; Histoires de masques (1900) ; Monsieur de Phocas (1901) ; etc. Enfin, il a donné au théâtre des pantomimes, des ballets et des œuvres plus importantes : Très Russe (1893), avec Méténier ; Yanthis (1894) ; Prométhée, tragédie lyrique, avec Herold, musique de Fauré (1900).
Il a continué sa collaboration au Journal, a écrit au Gil Blas (1903-1904) et à l'Auto (1904-1905) et a publié en librairie : Sensualité amoureuse (1902) ; Coins de Byzance, le Vice errant (1902) ; Princesses d'ivoire et d'ivresse (1902) ; Quelques hommes (1903) ; Fards et poisons (1904) ; la Maison Philibert (1904), œuvre d'observation exacte et aiguë ; Propos d'âmes simples (1904) ; l'Ecole des vieilles femmes (1905) ; Heures de Corse (1905) ; le Crime des riches ; Ellen. De plusieurs de ses nouvelles, Gustave Coquiot a tiré des pièces qui toutes ont été jouées sur des scènes parisiennes et éditées ensuite en volumes. Nous citerons : Une nuit de Grenelle (1 acte, 1903 ; théâtre Rabelais) ; Deux heures du matin..., quartier Marbeuf (2 actes, 1903 ; théâtre du Grand-Guignol) ; Hôtel de l'Ouest..., chambre 22 (2 actes, 1904 ; théâtre du Grand-Guignol) ; Sainte-Roulette (4 actes, 1904 ; théâtre Molière).
Jean Lorrain s’est complu à décrire en termes recherchés et brillants les ivresses mauvaises, les perversités savantes ; mais il est capable parfois d’une simplicité plus directe et assurément meilleure.
En 1897, il habitait 45 rue d’Auteuil à Paris 16e. Il est décédé en 1906, célibataire, à cinquante ans, domicilié 7 place Cassini à Nice.
=> Jean Lorrain par Ernest Gaubert (1905)
|
livrets
le Conte du Bohémien, lumino-conte, musique de scène de Charles Silver (Théâtre Minuscule, 02 décembre 1895) Brocéliande, conte en vers, musique de M. de Wailly (Théâtre de l'Œuvre, 07 janvier 1896) l'Araignée d'or, conte féerique en 2 tableaux, musique d'Edmond Diet (Folies-Bergère, 07 mars 1896) Rêve de Noël, pantomime-ballet en 1 acte et 3 tableaux, musique d'Edmond Diet (Olympia, 04 décembre 1896) la Princesse au sabbat, ballet, musique de Louis Ganne (Folies-Bergère, 25 janvier 1899) la Belle au cheveu d'or, ballet en 1 acte, musique d'Edmond Diet (Olympia, 02 mai 1900) Prométhée, tragédie lyrique en 3 actes, avec André Ferdinand Herold, musique de Gabriel Fauré (Théâtre des Arènes, Béziers, 26 août 1900 ; Opéra de Paris, 15 décembre 1907) Watteau, ballet en 1 acte, musique d'Edmond Diet (Olympia, 08 octobre 1900) Éros vainqueur, conte lyrique en 3 actes, musique de Pierre de Bréville (Monnaie de Bruxelles, 07 mars 1910 ; Opéra-Comique, 08 février 1932) |


|
Jean Lorrain
Les admirateurs de Jean Lorrain (*) lui érigent un monument et le fêtent, ce dimanche, à Fécamp, sa ville natale. Comme l'écrivait, à ce propos, Maurice Barrès à notre confrère Georges Normandy, promoteur de la manifestation : « ... Jean Lorrain disait du mal de lui-même. Maintenant qu'il s’est tu, ses amis et ses livres restent pour parler ; ils font son éloge. » Celui qu'on va lire est signé d'un de ses plus notoires et de ses plus fidèles amis : (*) Fils d'un armateur de Fécamp, Jean Lorrain s’appelait, de son vrai nom, Paul Duval. Né en 1855, il mourut en 1906.
L’homme et l’écrivain
Né à Fécamp, sur le rivage d'une mer nerveuse et tourmentée, parmi la descendance de ces cadets northmans qui s'en furent des fjords norvégiens, sur leurs barques, afin de chercher la fortune et les plaisirs jusque dans les ports byzantins de la Sicile, du Levant, Paul Duval avait gardé de sa terrible berceuse et de ses ancêtres aventureux le goût de l'étrange et du fabuleux. Quand il conte les choses de la vie provinciale, il les révèle terribles et angoissantes, non médiocres ni quotidiennes. Les vieilles qu'il évoque possèdent, la plupart, des influences de sorcières ; elles aiment les maléfices et les pratiquent, fût-ce sous le chapeau à bavolet. Rien d'irréel en cela. Balzac et Barbey d'Aurevilly nous découvrirent les drames affreux que masquent une façade verdie, les hautes fenêtres closes, l’honorabilité d'une réputation traditionnelle. C'est aux livres de ces deux maîtres que Paul Duval devait ajouter d'incomparables chapitres, lorsque, devenu Jean Lorrain, il se souviendrait d'une enfance moins timide qu'observatrice. Ce besoin de comprendre toute une société aux replis prudemment levés doua de bonne heure le jeune homme du sens critique, le sens de l'esthète. Amoureux des tableaux, des statues, des joyaux et des paysages autant que des âmes difficiles, il gagna vite le talent de discerner, entre toutes, la valeur des poètes, des peintres, des orfèvres. Vers 1887, ses brillantes chroniques de l'Evénement annoncèrent au monde les maîtres qui surgissaient. Je crois bien qu'il écrivit la première étude connue sur Henri de Régnier. Il le désigna pour le prince des écrivains nés aux environs de 1860. L'auteur de Yanthès pouvait, au reste, juger, sur le siège du pair, les poètes. L'auteur de Monsieur de Bougrelon pouvait de même élire ses préférés entre les nouvellistes et les romanciers. L'adaptateur de Prométhée eût pu, sans orgueil illicite, émettre son avis sur les pensées les plus hautes. Aussi, vingt ans fut-il, dans les grands journaux de Paris, l'apôtre écouté, l'apôtre ironique, agressif, perspicace et rieur, l'apôtre d'une vérité sévère illuminant le grouillis des médiocres et des hypocrites. Nul, en aucun siècle des lettres françaises, ne fixa, comme lui, sur de chatoyantes pages, l'existence cosmopolite de Paris, de ses banlieues, Trouville et Nice. Nul ne sut comme lui peindre en quelques traits de plume un groupe d'humains. On n'a pas oublié ses resplendissantes chroniques signées Raitif de la Bretonne. En celles-ci se manifesta l'apogée de son talent. Son prestige de très bel homme élégant et courageux, infiniment spirituel, facilita d'abord à l'écrivain l'accès de tous les mondes. Il les parcourut égayé, sans indulgence. Parfois même, il dit tout haut ce que l'on se chuchotait à la ronde. Et ce lui valut de féroces inimitiés. Plus tard, ceux qu'égratignait sa raillerie, ceux que méconnaissait le sens de sa critique, lui furent une troupe hostile et injuste. Sa parfaite indépendance et la franchise de ses goûts exaspérèrent aussi quelques-uns. Pour avoir été vaillamment lui-même, il eut à se défendre, et l'arme au poing, sur le terrain de duel. Mais la balle de l'adversaire ne l'émouvait pas plus que la diatribe. Tête haute, il attendait la mort, un sourire de dédain aux commissures des lèvres, sous une moustache poudrée d'or. Evidemment, on n'écrit pas, vingt années durant, au gré d'une verve infernale, ses idées brusques et ricaneuses, sans laisser parfois échapper quelque peu d'erreurs. On eut tort de lui garder rancune. Jean Lorrain ne sut jamais être méchant. Ceux qu'il chérissait pour leur talent, pour leur esprit, pour leur cœur, savent quel ami fidèle et loyal de leurs vies, quel incorruptible champion de leurs idées il fut toujours. (Paul Adam, les Annales, 28 juillet 1912)
le monument à Jean Lorrain, inauguré à Fécamp (oeuvre d'Alphonse Saladin)
Citons, de Jean Lorrain, ce délicieux poème en prose où il a chanté, de la plus touchante façon, son pays natal :
Regret du pays
Toute mon enfance m'est revenue en rêve, aujourd'hui, mon enfance à Freneuse, en Normandie, la Normandie pluvieuse et grasse. La ferme ! Les pièces étaient si hautes et si vastes à Freneuse, si claires aussi et d'une clarté si triste avec leurs larges portes-fenêtres et le moiré de leurs parquets luisants ! Toute la mélancolie du ciel, des plaines et des saisons changeantes pénétrait par ces fenêtres. Oh ! la sécheresse austère de leurs petits rideaux blancs ! Comme je m'y sentais seul dans l'hostilité des choses ! C'étaient, surchargés de têtes de lion, de bélier et d'attributs Empire, de grands meubles d'un style maussade et pesant. Je me heurtais toujours à leurs angles ; leur contact était froid et faisait mal. Je n'aimais point non plus les lourdes chaises d'acajou massif accroupies, on eût dit, contre les tentures... Les grands salons de Freneuse ! J'y grelottais même en plein été. Et les cimes d'arbres du parc, éternellement agitées dans la vitre claire des impostes, comme elles emplissaient de détresse ma petite âme d'enfant ! Aussi, au luxe froid de ces vastes pièces vides, combien je préférais l'égouttement sans fin des claies de la laiterie, la laiterie où se tassent les mattes, l'ombre poussiéreuse et parfumée des granges et la tiédeur étouffante de l'étable, où les vaches sentent bon ! La laiterie surtout ! O chaleurs de juillet, après-midi accablantes où l'odeur du lait caillé paraissait plus fraîche et d'une acidité si discrète, relents de crème un peu surie fermentant dans le courant d'air des croisées ouvertes, quelle étrange et puissant bien-être j'éprouvais à humer tout cela ! Oh ! les grands labours dans la plaine et les sillons fumants dans la brume aux premiers froids d'octobre, quand hommes et chevaux s'en reviennent plus las ! Chaque soir m'enivrait alors comme si je sentais l'odeur de la terre pour la première fois. J'aimais alors m'asseoir au revers d'un talus, à l'orée des champs, parmi les feuilles mortes, et, j'écoutais avec délices mourir au loin des voix, voix de laboureurs, bruit éteint de charroi. J'aimais aussi l'odeur des feuilles rouies, la fraîcheur de la pluie et des branchages mouillés, et mon âme défaillait toute, en regardant le soleil exténué se fondre à l'horizon pour y dormir. La chambre de ma mère ! Elle était toujours fleurie de lilas blancs, et l'on y faisait du feu en plein été, mais elle sentait l'éther, la créosote et une autre odeur encore qui, dès le seuil, me levait le cœur. Ma mère ! Je revois encore ses longues mains tout alourdies de bagues, des mains diaphanes et soignées où le bleu des veines s'avivait sous le derme ; elles étaient douces, caressantes et embaumaient ; elles s'attardaient longuement dans mes cheveux, s'amusaient un moment à chiffonner ma cravate, puis remontaient à mes lèvres et s'imposaient à mon baiser. La petite église de Freneuse ! J'y ai été baptisé ; j'y ai fait ma première communion. Et pourquoi, après tout, n'irais-je pas retrouver tout cela ? Qui sait si ce calme et cette mélancolie ne me seraient pas une cure ?... Oh ! laver toutes les hontes et toutes les souillures de ma vie dans l'eau lustrale des souvenirs ! O mon enfance ! O Normandie pluvieuse et triste... (Jean Lorrain)
|

Jean Lorrain d'après un dessin de Sem