
JEUNESSE DE LA MUSIQUE
Collection dirigée par Charles Oulmont
André MESSAGER
mon maître, mon ami
par
HENRY FÉVRIER
Préface de Jean MESSAGER
Le Livre Contemporain
Amiot-Dumont
21 rue de Messine, Paris
Table des matières
13 – Hyménée et brouillard sur Londres
19 – A l’Opéra. – Monsieur le Directeur
25 – L’opérette renaît par la chanson
Depuis bientôt vingt ans que mon père n'est plus, on m'a demandé à maintes reprises s'il existait un ouvrage relatant sa vie et commentant ses œuvres.
Or, jusqu'ici, personne ne s'était avisé de l'écrire. C'est que la tâche paraissait particulièrement malaisée.
En effet, par une sorte de pudeur, mon père se livrait peu, surtout vis-à-vis des siens et s'il se laissait aller à quelques confidences, c'était à de rares amis qu'il en faisait part. Parmi ceux-ci, presque tous l'avaient précédé ou le suivirent de près dans la tombe.
Je songeai, un moment, à combler cette lacune, mais ma position était assez délicate il me paraissait difficile d'entreprendre semblable pèlerinage — si doux fût-il pour moi — avec suffisamment d'indépendance pour qu'il restât objectif.
Henry Février, ayant vécu depuis son enfance dans le « sillage » de mon père, n'a cessé de rester fidèlement attaché à sa mémoire par ce goût de la musique que celui-ci avait su développer en lui.
Parmi les musiciens qui l'ont connu et approché, l'auteur de Monna Vanna était donc le plus apte à parler librement de lui et le plus qualifié pour tenter de le définir.
C'est pour ainsi dire pas à pas qu'il le suit à travers les diverses phases de sa vie : il avait à peine dix ans lorsqu'il assista à son mariage ; mon père en avait trente. Il s'est donc trouvé pendant près d'un demi siècle auprès d'André Messager.
Les liens d'amitié qui unissaient sa famille à la mienne, lui ont permis de pénétrer dans l'intimité du compositeur. Il eut ainsi l'occasion de voir naître plusieurs de ses partitions. Il en fut même souvent le premier auditeur.
Ils ont fréquenté tous deux les mêmes milieux artistiques dont le centre était le salon de Mme de Saint-Marceaux, si bien évoqué au cours de ce livre.
Quand parfois Henry Février risque certaines digressions ou parle de ses propres œuvres, c'est que, en fin de compte, la plupart se rattachent à la carrière artistique de son maître et ami, car on sait que Messager, en dehors de son activité de compositeur, fut étroitement mêlé au mouvement musical le plus important peut-être de l'Histoire de la Musique, qui va de Wagner au groupe des Six en passant par César Franck, Saint-Saëns, Fauré, Debussy, Ravel et Stravinsky.
« A trop vouloir vanter son héros, si glorieux soit-il, on le déforme et le rapetisse », écrit Henry Février. Aussi ne se livre-t-il pas qu'à des éloges dithyrambiques ! Il risque parfois des observations, sinon des critiques, qu'il m'eût été malaisé de formuler, même si elles m'eussent apparu justifiées. Lui, au contraire, pouvait s'y hasarder en toute indépendance et je me plais à reconnaître qu'elles sont toujours compensées par les sentiments de franchise et d'affection profonde qu'il éprouvait à l'égard de mon père.
Ses remarques sont donc précieuses et elles permettent de définir très exactement le caractère et le tempérament d'André Messager.
On apprendra que sa vie n'a pas été exempte de soucis moraux et matériels, quoique la chance lui ait presque toujours souri. On verra combien il s'est dévoué aux œuvres des autres, au point d'interrompre à plusieurs reprises sa propre production. Il apparaîtra que, en toutes occasions, ses actes artistiques ont été inspirés par son grand amour de la musique et que son éclectisme était dû à sa profonde connaissance des maîtres anciens et modernes chez lesquels il puisait le réconfort moral et trouvait l'élan de son inspiration musicale.
Ceux qui aiment Véronique, la Basoche, Fortunio ou toute autre de ses partitions, liront avec intérêt les souvenirs d'Henry Février.
Et dans l'avenir, ils feront, comme on dit « autorité en la matière », car leur auteur a pris son héros « sur le vif » et nous l'a montré tel qu'il l'a connu et aimé.
Jean MESSAGER.
Juin 1947.
OUVERTURE
C'est aux abords de Montivilliers, paisible petite ville normande à mi-route entre Le Havre et Etretat, que mes parents possédaient une demeure familiale. Ce coin verdoyant s'appelait « Les Rochers », vallon ombragé et étroit traversé par un petit cours d'eau, « la Clignarderie » qui prend sa source non loin de là, au village du Fontenay. Mes parents ont villégiaturé aux Rochers chaque été, plus d'un demi-siècle. Que de souvenirs pour moi ! — A flanc de coteau, la villa que mon père, architecte, construisit vers 1880 ; en face, sur l'autre versant, un verger assez escarpé. Devant la villa, des pelouses harmonieusement dessinées, sur le côté, près de la maison voisine — qui appartenait à la famille Cazavan, du Havre, et qu'habita plus tard Messager — d'étroites et longues allées ombragées, un tennis, des sources et des cascades avec de petites pièces d'eau où s'ébattaient des truites élevées avec soin, des fleurs — beaucoup de fleurs, — en massifs et en bordure des allées. Tout cela formait un lieu de repos rêvé, particulièrement propice à l'inspiration musicale. Aussi, quelle joie c'était de quitter Paris et sa fièvre pour arriver là en quelques heures, s'y reposer si l'on voulait, travailler s'il le fallait !
***
André Messager, il y a quelque soixante-cinq ans, ayant été appelé au Havre pour des concerts symphoniques où il jouait du piano en virtuose, épousait Mlle Edith Clouet, jeune fille havraise (qui sera la mère de Jean Messager). J'assistai, avec mes parents, à la messe de mariage qui eut lieu à l'église de Graville, dans la banlieue du Havre. C'est là où je le rencontrai pour la première fois, en habit et cravate blanche dans la sacristie, près de sa blonde jeune femme sous son voile de mariée. Il était souriant et heureux, svelte et distingué, l'œil vif, menton volontaire, bouche moqueuse, la moustache conquérante, les cheveux noirs déjà clairsemés, tel nous le verrons plus tard au pupitre de l'Opéra.
Quelques jours après, quelle fut notre surprise de le voir arriver aux Rochers avec sa jeune épouse ! Ma famille qui l'avait connu à Paris l'accueillit avec la plus cordiale amitié. J'étais alors un bambin assez insupportable qui ne pensait qu'à jouer de façon turbulente avec mon frère dans les prés et autour des pièces d'eau dans lesquelles nous tombions sans cesse. Vous pensez de quelle oreille distraite et impatiente j'entendais Messager lire au piano, avec ce don merveilleux du déchiffrage qu'il possédait entre tous, de sérieuses musiques qui m'attiraient bien peu auprès des ébats et des jeux de mon âge ! Mon bon professeur d'alors, Henry Woolett, s'en désolait et désespérait de jamais rien faire de moi en musique.
***
Après cette première visite à Montivilliers, Messager revint les étés suivants. Il avait pris goût à cette vie calme et douce qu'on menait là, car il possédait les aptitudes pour s'y complaire. Il adorait la lecture et savait choisir les meilleurs livres, s'intéressait à tout avec bon sens et curiosité. C'était un dilettante dans la meilleure acception du mot, sans snobisme ni paradoxes. Les heures qu'il consacrait à la composition étaient intermittentes — suivant l'urgence des circonstances — mais lorsqu'il s'y mettait c'était complètement. Je le vois encore cherchant au piano sa charmante musique dans des élans d'improvisation fertiles et aisés, sans jamais s'y griser ni s'y disperser, puis quitter le clavier pour écrire d'un trait, sans rature ni sans hésitation, ce que ses doigts heureux venaient de découvrir. Il nous jouait et nous chantait ces pages toutes fraîches, puis refermait le piano et ses papiers, oubliait ce qu'il venait de créer pour redescendre dans le domaine des réalités. Venait l'heure du repas, où la conversation courait d'un sujet à l'autre, agrémentée par son esprit alerte et primesautier. A ces dons heureux, il joignait une simplicité parfaite, exempte de toute vanité. Il ne parlait jamais de lui à moins qu'on ne l'en priât, et c'était là un trait particulier de son caractère.
Il aimait aussi la promenade dans la campagne et nous partions souvent sur les routes, avec lui, mon frère et moi, soit à pied, soit en tricycle d'abord (ce temps est loin !), à bicyclette ensuite, plus tard en automobile. Nous allions voir Cauville et sa falaise, Saint-Jouin et « La belle Ernestine », Etretat et ses célébrités, Harfleur et son clocher, et tous les coins verdoyants du voisinage. Il pleut souvent en Normandie... Mais cela importait peu à Messager qui trouvait en lui-même toutes les ressources pour braver les pires intempéries.
***
Messager écrivit d'abord à Montivilliers toute la partition d'Isoline dont nous reparlerons dans la suite et que l'on considère avec raison comme l'une de ses meilleures. Il y composa aussi la musique de scène d'Hélène et celle de la Montagne enchantée.
En 1895, après son veuvage, ayant épousé en secondes noces l'aimable compositrice anglaise Miss Hope Temple, il reviendra avec celle-ci à Montivilliers, ayant l'aspect d'un véritable gentleman, parlant l'anglais, fumant la pipe, vêtu en costume de sport. La vie de travail et de villégiature reprendra comme par le passé et je revois ces soirées d'automne où tous trois nous écrivions notre musique sur la grande table recouverte de toile de Jouy. Nous partîmes en Angleterre où il nous fit visiter les théâtres de Londres et apprécier les opérettes de Sullivan qu'il goûtait fort.
C'est encore à Montivilliers que Messager composera plus tard les Dragons de l'Impératrice et Fortunio. Ses collaborateurs Albert Vanloo et Duval, Robert de Flers et Caillavet, viendront l'y rejoindre et nous aurons la primeur de toutes ces musiques délicieusement françaises.
***
J'étudierai ici dans son ensemble, le moins techniquement possible, l'œuvre de Messager, je le suivrai pas à pas à travers les différentes phases de sa vie de compositeur, de chef d'orchestre et de directeur et j'essayerai de montrer la place importante qu'il a tenue dans le mouvement musical de son époque, autant que dans mes souvenirs personnels (*).
(*) Quelques-uns de ces souvenirs sont extraits de l'Echo des Concours avec l'autorisation de MM. Andrieu frères, éditeurs de musique, Paris.
GRANDES ORGUES
André Messager est né à Montluçon le 30 décembre 1853.
Son père était receveur des finances ; sa mère, Cornélie Lhôte de Selancy, appartenait à une famille dans laquelle se distinguèrent plusieurs officiers de carrière ; l'un de ses grands oncles, général de la Grande Armée, prit part aux principales campagnes napoléoniennes. Ainsi s'explique pourquoi, par cet atavisme, Messager avait l'allure juvénile d'un officier de cavalerie. Il en conserva jusqu'à la fin de ses jours l'élégance naturelle.
Enfant turbulent, on l'enferma à sept ans comme pensionnaire chez les Pères Maristes, au collège de Montluçon.
Dans son charmant livre, les Grands hommes quand ils étaient petits (*), où Jaboune donne des détails curieux, Messager raconte lui-même ses souvenirs d'enfance et comment se dessina sa vocation. Voici le dialogue :
(*) Publié chez Flammarion, Paris.
« Mon éducation musicale ?... C'est qu'on ne me destinait pas à la musique. On me destinait à passer mon baccalauréat. C'est hélas ! un métier que je n'ai jamais réussi ! Mon éducation musicale... Oui... évidemment... j'ai bien reçu, quand j'étais petit, quelques vagues leçons de musique. Mais la vocation y était déjà, vous savez, heureusement !
Mes parents ? Hélas ! Non. Personne n'était musicien dans ma famille. Il y avait bien ma sœur. Mais je n'ai pas dit qu'elle fût musicienne ; j'ai dit qu'elle apprenait le piano. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le seul avantage que j'aie retiré de ses études, c'est qu'il y avait un piano à la maison ; et c'est sur ce piano que j'ai pu m'exercer un peu, tout seul, dès que j'ai été assez haut pour atteindre les touches du bout des doigts.
Quand j'entrai chez les Pères Maristes, mon père demanda si l'on pouvait me donner quelques leçons. Sur une réponse affirmative, j'eus donc officiellement à ma disposition un maître de piano ou plus exactement un soi-disant maître de piano... C'était, en effet, un vieux monsieur tout à fait bien, mais qui n'était pas plus pianiste que je ne suis Grand Turc ; notez qu'il aurait peut-être très bien réussi comme pianiste, mais il s'en était toujours tenu au violon.
Le détail était d'ailleurs sans importance ; l'important c'était seulement, n'est-ce pas, que j'eusse un prétexte pour me rendre le plus souvent possible dans la petite salle du collège où je pouvais continuer librement à tapoter sur le piano. J'avais le prétexte. Et je ne manquais pas d'en profiter.
Plus tard, on me confia enfin à un professeur véritable, il s'appelait M. Albrecht et sortait de l'école Niedermeyer où je devais entrer. C'est M. Albrecht, le premier, qui me donna quelques notions sérieuses sur la musique. J'en avais réellement besoin. Et il fallut rattraper le temps perdu.
Je ne l'avais pas attendu, pourtant, pour composer mes premières œuvres. C'était, bien entendu, des essais informes, ridicules et sans aucune valeur et je ne vous en parle évidemment que pour mémoire.
Quoi qu'il en soit d'ailleurs, je produisais avec une intensité et avec une rapidité remarquables.
— Des opérettes, des opéras-comiques ? (demande son interlocuteur).
— Ah ! fi, monsieur, non pas. Je n'écrivais alors que de la musique religieuse : des messes surtout, des tas de messes. En un jour, je vous faisais une messe et il fallait voir — ou plutôt, il fallait entendre !
Cette prodigieuse fécondité ne m'empêchait pas, à vrai dire, de me livrer aux jeux les plus bruyants et les plus agités, et la vérité m'oblige même à avouer que je ne faisais de la musique que lorsqu'il m'était matériellement impossible de courir et de me dégourdir les jambes. La meilleure preuve, c'est que l'été, à la campagne, pendant mes deux mois de vacances, je préférais vagabonder dans les champs plutôt que de composer — même des messes.
Maintenant, j'ai beaucoup changé. J'adore encore la campagne, mais c'est là que je travaille le plus volontiers. Peut-être parce que je ne peux plus chasser les papillons.
Voilà, Monsieur, tout ce dont je peux me souvenir.
Dans un collège assez sévère — mais paternellement sévère — j'ai fait beaucoup de bêtises et beaucoup de musique. L'important, c'est que je n'ai continué que la musique. »
***
On découvre dans ces propos ingénieusement recueillis toute la spirituelle fantaisie et la finesse d'esprit du compositeur de Véronique.
Ils me divertissent particulièrement par certaines analogies avec ma propre enfance au lycée Janson-de-Sailly. Comme lui, je fus condamné à l'internat par ma famille, mais à dix ans seulement au lieu de sept — ce fut toujours trois ans de gagné ! — comme lui, mon seul bonheur était de m'échapper des classes pour courir m'enfermer furtivement dans la petite salle de musique où je retrouvais l'instrument de délices : le piano, avec lequel je dévorais toutes les musiques les plus variées que j'avais pu dérober chez mes parents les jours de sortie.
Mais lui du moins, eut la chance de n'être pas persécuté ! Il ne connut pas, comme moi, les instructions sévères données au surveillant général qu'on avait chargé de m'épier, de fouiller dans mes livres et dans mon pupitre pour y découvrir le coupable papier à musique sur lequel ma précoce inexpérience s'exerçait : des mélodies, des valses, des pièces instrumentales, des symphonies et des poèmes symphoniques, toute la lyre quoi !
Ces flots d'harmonie inexpérimentés m'emportaient bien loin des affreuses monotonies de l'internat et satisfaisaient ardemment le goût et l'attrait qui m'étaient venus soudain pour la musique, dans ma prison de la rue de la Pompe, comme lui dans son collège de Montluçon !
Je me souviens encore des dimanches de sortie, où, enfiévré par mes compositions, je rassemblais tout mon courage pour les montrer à Messager qui dînait là souvent. Suivant son humeur, fort capricieuse, il me rabrouait ou m'encourageait : « La musique est un art très difficile, me disait-il sans pitié, cela ne souffre pas l'imperfection ! » Et sa haine de l'amateurisme me remplissait d'épouvante. Je me jurais d'échapper à ses sarcasmes et je rentrais le soir dans ma geôle, enivré ou désespéré, suivant l'accueil auquel je m'étais aventureusement exposé en lui soumettant mes timides essais. Mais son mépris ou ses louanges m'avaient stimulé et j'y gagnai l'ardent désir de m'instruire.
***
Messager avait déclaré à son père qu'il voulait faire sa carrière de compositeur et, en digne fonctionnaire, celui-ci s'y était opposé formellement.
Le jeune homme s'était donc résigné à chercher une autre voie et comme il n'en trouvait pas à son gré, les circonstances, sans doute guidées par son bon génie, vinrent modifier les projets envisagés. Une crise de bourse ayant presque complètement ruiné ses parents, il dut quitter le collège des Maristes pour apprendre un métier.

André Messager à 13 ans
Ayant écrit tant de messes (!) celui d'organiste le tenta, et c'est ainsi qu'il vint à Paris pour entrer à l'école de musique religieuse fondée en 1853 par Niedermeyer.
C'était encore l'internat pour lui, mais un internat où le fond des études était consacré à la musique, c'est-à-dire qu'au lieu de s'endormir sur les humanités et d'apprendre tant de choses qu'on oublie tout de suite, on trouvait là, en même temps, un ensemble de cours concernant l'art musical enseigné par des maîtres de premier ordre.
Messager eut comme professeurs :
Eugène Gigoux qui lui enseigna le contrepoint ; Adam Laussel, le piano ; Clément Soret, l'orgue. Mais de son aveu même, c'est Gabriel Fauré qui eut la meilleure influence sur sa culture artistique, et lui ouvrit des horizons insoupçonnés. Voici comment :
La guerre et la Commune de 1871 étant survenues, les élèves de l'école Niedermeyer durent quitter Paris ; plusieurs d'entre eux s'installèrent à Lausanne sous la conduite du directeur Gustave Lefèvre, gendre de Niedermeyer. Parmi eux se trouvait Gabriel Fauré, un ancien élève, qui avait suivi l'exode en qualité de professeur. Tout de suite, les jeunes gens se lièrent de vive sympathie et Fauré — le plus âgé des deux — sut faire jaillir l'étincelle chez son compagnon d'exil. Leur amitié, née dans ces circonstances particulières ne se démentit jamais et ils restèrent unis dans la célébrité comme ils l'avaient été aux temps sombres de l'Année terrible.
A vingt-et-un ans, Messager quitta l'école Niedermeyer et, en 1874, devint organiste du chœur de Saint-Sulpice en remplacement de Gabriel Fauré qui venait de démissionner. Charles Widor y était déjà organiste du grand orgue et dans l'intéressante Notice que celui-ci a consacrée à la vie et aux œuvres de Messager et qu'il a lue à une séance publique annuelle de l'Académie des Beaux-Arts, on trouve ces lignes :
« Nous étions jeunes alors. Grand orgue et orgue du chœur se répondaient du tac au tac, saintement, liturgiquement, en parfaite harmonie. Souvent l'un proposait un thème que l'autre développait. Plus souvent j'interrogeais mon collègue du chœur, implorant sa critique sur l'interprétation d'une œuvre, son effet à distance, vu l'amplitude d'une nef de cent mètres de long... »
Messager, après Saint-Sulpice, fut aussi organiste au grand orgue de l'église Saint-Paul-Saint-Louis en 1881 et maître de chapelle en l'église Sainte-Marie-des-Batignolles de 1882 à 1884.
Telle fut sa carrière d'organiste. Nous verrons comment il parvint à s'émanciper, alors que Saint-Saëns, Fauré et Widor restèrent longtemps fidèles à leurs orgues.
***
Ses fonctions d'organiste ne lui procuraient que quelques ressources, aussi maigres que variables. — Cela pouvait aller entre cinq et dix francs par cérémonie ! — Un jour, alors qu'on tapissait de paille une rue voisine de l'église (c'était l'usage alors pour le repos des malades in extremis) le sacristain accourut, mystérieux, pour lui glisser à l'oreille l'heureux présage : en l'espèce, un « service » hors série, susceptible de faire monter jusqu'à quinze francs les émoluments de circonstance. Quelle aubaine !
D'autres fois il partait avec Fauré « faire un bal », engagés tous les deux pour la nuit chez des particuliers qui « quadrillaient » jusqu'à l'aube sous les doigts endiablés des deux futurs maîtres. (Ce n'était pas encore le quadrille sur la Tétralogie qu'ils improvisèrent plus tard ni celui sur Tristan et Yseult du joyeux Chabrier !) Aussi, en récompense de leur ardeur, les conduisait-on au départ vers l'office pour s'y rafraîchir avec des vins « d'appellation » ordinaire. Un pourboire ? Oui, un vrai cette fois.
OÙ LA CHANCE APPARAIT
C'est en 1876 que Messager fit ses débuts comme compositeur en écrivant, non plus une messe, mais bel et bien une Symphonie, couronnée par la Société des Compositeurs. Grande fut sa joie de l'entendre exécuter l'année suivante aux Concerts Colonne : presque une consécration et un grand pas de fait par lui ! Car tel est l'apanage de nos belles phalanges symphoniques de révéler les jeunes, compositeurs ou virtuoses. En l'occurrence ce fut André Messager qu'elles venaient de découvrir.
J'avais désiré souvent connaître cette Symphonie mais je ne pus obtenir d'en apercevoir le manuscrit. Quelques amis de Messager qui l'entendirent alors — dont Emmanuel Jadin, le peintre — m'ont assuré que la musique en était limpide et alerte, l'orchestration très mendelssohnienne, que toutes les qualités qui s'épanouirent dans la suite, chez Messager, s'affirmaient déjà dans cette première œuvre — œuvre de jeunesse il est vrai — mais qui n'en fut pas moins remarquée.
Le voilà parti vers la « grande musique »...
***
Pas encore ! Au même moment, il fait volte-face et se met à écrire des ballets... Par goût ? Par nécessité ? L'un et l'autre sans doute, car il fallait vivre ! Et voici que ces ballets, représentés aux Folies-Bergère, où il était chef d'orchestre, ont l'audace de réussir : le premier, Fleur d'Oranger, est joué plus de deux cents fois et son succès encourage Messager à tel point que deux autres, du même genre, suivent cette heureuse tentative.
Ainsi que le fera remarquer Jean Messager dans une causerie sur son père : « C'était une amusante ironie de la destinée de voir ce compositeur tel le Célestin Floridor de Mam'zelle Nitouche, organiste le matin et le soir faisant danser les ballerines des Folies-Bergère sur des rythmes alertes mais totalement dépourvus de toute pensée liturgique ! »
Ce qui prouve qu'il n'y a pas un tel abîme entre la musique religieuse et la musique profane !
***
Certes, le hasard a toujours joué un rôle prépondérant dans la vie de Messager. Il fut un « veinard » dans le sens exact du mot, j'ai pu souvent le constater. Dans les circonstances les plus critiques, alors que tout semblait pour lui désespéré, un événement fortuit et heureux surgissait soudain, et non seulement le tirait d'affaire, mais encore le ramenait vers des voies fécondes. Cependant, en y réfléchissant, on s'aperçoit que c'est plutôt la diversité de ses dons qui, selon les circonstances, lui permettra, en changeant son fusil d'épaule, de retomber toujours sur ses pieds.
En 1880, il saisit l'occasion, nullement préméditée, d'accepter un engagement pour inaugurer l'Eden-Théâtre de Bruxelles ; un simple music-hall où il s'assit de nouveau au pupitre ! Pouvait-on soupçonner à ce moment que ce modeste emploi serait le prélude d'une admirable destinée de Kappelmeister, si retardée qu'elle fût ?
Il m'a dit souvent que cet apprentissage au music-hall lui avait été fort utile ; c'est là qu'il avait appris « le métier ».
***
Une autre chance — et nous savons que le mot était impropre pour lui — décida d'une carrière qu'il devait rendre particulièrement féconde, puisque le bagage théâtral de Messager comprend plus de trente ouvrages : ballets, opérettes, pantomimes, opéras-comiques, comédies lyriques. Ecoutons-le narrer lui-même dans Musica l'heureux événement :
« De retour à Paris, le hasard — toujours lui ! — me mit à même d'aborder le théâtre lyrique. Cette fois ce fut un triste hasard : la mort de Bernicat qui laissait inachevée la partition de François-les-Bas-bleus. L'éditeur de Bernicat qui était aussi le mien, M. Wilhelm Enoch, voulut bien me confier cet ouvrage à terminer et le succès répondit à sa confiance. »
Voilà qui est fort modestement dit quand on songe à la célébrité de plusieurs morceaux : la Ronde, la Valse, la Leçon d'écriture... Qui les composa ? Bernicat ? Messager ? Mystère. Mais certains suivent singulièrement les contours mélodiques chers à notre auteur... En tout cas, depuis le 8 novembre 1883, jour où les Parisiens en eurent la primeur aux Folies-Dramatiques, ils n'ont cessé, à chaque coin de rue, de joyeusement les fredonner : « Espérance en d'heureux jours ! » c'est le refrain de l'un d'eux. N'était-ce pas celui de Messager lui-même ? (*)
(*) Ephémérides de l'époque (nov. 1883) : « Aux Folies-Dramatiques, François-les-Bas-bleus, opéra-comique en 3 actes dont la partition avait été laissée inachevée par feu Bernicat et terminée par Messager est jugée sévèrement par la presse ; par contre, le public fait un grand succès à cet ouvrage ».
***
Suivons notre compositeur décrochant la timbale du premier coup et s'affirmant dans un genre très apprécié à l'époque : l'opérette. Il a trouvé sa voie et s'y engage résolument ! Coup sur coup, d'autres suivent. Le 17 novembre 1885 c'est la Fauvette du Temple aux Folies-Dramatiques, un mois après, le 12 décembre 1885, la Béarnaise aux Bouffes-Parisiens.
La Fauvette du Temple (*) : « tambours et clairons » ornementés d'une fine musique, l'Algérie de Bugeaud, des arabes en burnous, des zouaves, une idylle, des couplets patriotiques. Partition charmante, sans vulgarité en dépit d'un sujet qui risquait d'y conduire. Opérette ou opéra-comique ? La fauvette chante mais ne le dit pas.
(*) Redevenue de circonstance et reprise à la Gaîté-Lyrique après la victoire de 1918 avec Mme Jeanne Marnac, MM. Vilbert et Henri Defreyn.
La Béarnaise (*) (même interrogation) musique aussi soignée mais moins « à effet » que la précédente, d'où succès moins populaire et plus restreint ; agréable scénario signé Leterrier et Vanloo, difficultés d'interprétation. A ce propos écoutons la chronique :
(*) Reprise plus tard au Trianon-Lyrique, direction Louis Masson, en 1926.
« La Béarnaise avait été distribuée et répétée lorsqu'à la veille de la générale l'actrice imposée par la directrice, Mme Ugalde et qui tenait le rôle principal, se montra à ce point insuffisante que, d'un commun accord, on décida de chercher immédiatement une autre interprète. Des amis du compositeur engagèrent vivement celui-ci à lire sa partition à Mme Jeanne Granier qui, depuis sa remarquable création du Petit Duc de Lecoq, était la grande étoile de l'opérette. A ce nom prononcé, le débutant qu'était Messager frémit... Mais son hésitation fut de courte durée et bravement il se rendit chez la diva et se mit à chanter sa partition. Le premier acte n'était pas achevé que Mme Jeanne Granier, musicienne comme la musique, acceptait avec joie de créer la Béarnaise. En huit jours elle apprit le rôle et la semaine suivante, on passait. »
Ces improvisations sont choses courantes au théâtre et leur hardiesse devient parfois un gage de succès.
Encore cette satanée chance !...
BALLERINES
Un jour de l'année 1885, Messager reçut la lettre suivante :
« Mon cher ami, j'ai profité de l'effusion qui suit une bonne première pour demander à Vaucorbeil de vous commander un ballet. Allez le trouver, il vous attend demain chez lui, rue de Miromesnil (*). »
(*) Vaucorbeil était alors directeur de l'Opéra.
Cette lettre était signée Saint-Saëns. Celui-ci lui avait donné à sa sortie de l'école Niedermeyer quelques leçons de piano et de fugue, et, frappé par son intelligence musicale, s'était particulièrement intéressé à lui. Le geste spontané de Saint-Saëns ne surprendra pas ceux qui ont connu l'illustre auteur de Samson et Dalila : sous des dehors brusques et parfois bourrus il cachait une sensibilité très vive qui se manifestait inopinément par des élans généreux où se révélait un cœur excellent, enclin à faire le bien...
J'eus moi-même l'occasion de m'en apercevoir à diverses reprises : une première fois à Alger en 1911, alors qu'on donnait simultanément à l'Opéra de cette ville l'Ancêtre et Monna Vanna. Il voulut bien s'intéresser à moi, suivit mes répétitions et assista à ma première. Plus tard, en 1913, alors qu'on donnait Carmosine à la Gaîté-Lyrique, quelle fut ma surprise et ma joie de le retrouver à une matinée du dimanche, venu tout exprès pour entendre mon ouvrage qu'il écouta près de moi, dans une loge, avec le regretté André Caplet qui s'était joint à nous.
Saint-Saëns, à ce moment, était ulcéré par la vogue de certains confrères dont il ne goûtait guère les tendances nouvelles. Je me souviens des encouragements qu'il me prodigua ce jour-là, m'exhortant à me garder de telles influences qu'au fond de moi je ressentais sans le lui dire, mais sans éprouver cependant le besoin de m'immoler devant elles.
Dirai-je que Massenet, lui aussi, m'a souvent tenu des propos analogues ? Et cela se conçoit. Chefs d'école l'un et l'autre, ils défendaient leur esthétique, n'étant pas sans redouter les perturbations qu'allaient apporter dans l'art musical les découvertes harmoniques et instrumentales qui se révélaient chaque jour et devaient bientôt triompher.
Messager, au contraire, ne s'est jamais insurgé contre l'évolution. Son dilettantisme sut toujours l'emporter bien au delà de sa propre forme, à laquelle cependant il resta fidèle jusqu'au bout. Ses fréquentations d'art ne le firent jamais dévier d'un pas dans son style personnel, il sut goûter avec délices à tout ce qui était nouveau. Il en fut récompensé car il ne connut jamais l'amertume, rançon des esprits ombrageux.
Qu'on me pardonne cette digression qui partant d'un mouvement d'élan de Saint-Saëns aboutit — en passant par Massenet — à mettre en relief l'altruisme de Messager dès qu'il s'agissait de son art.
***
Le résultat de la lettre écrite par Saint-Saëns à Vaucorbeil fut la commande du ballet des Deux Pigeons à l'Opéra, dont les portes s'ouvraient toutes grandes au compositeur. Mais Vaucorbeil étant mort entre temps, les Deux Pigeons ne furent représentés que le 8 octobre 1886, sous la direction Ritt et Gailhard.
Le sujet ? « Ils s'aiment, se séparent et se rejoignent ! » C'est l'idée de La Fontaine transposée sur le plan chorégraphique, à travers les péripéties d'un canevas pittoresque et animé (*).
(*) Le scénario des Deux Pigeons est signé Henry Régnier et Louis Mérante.
La musique ? Tout y pétille d'esprit et de verve rythmique, coloré de délicatesses harmoniques nouvelles ; danses, marche tzigane, thème et variations, orage et mimodrame s'y succèdent, tandis que Rosita Mauri (*), svelte et légère, s'envolait parmi les roucoulements des tourterelles, sous les ailes de l'oiseau fugitif. — Et cependant !
(*) Rosita Mauri, danseuse étoile qui créa l'ouvrage à l'Opéra.
Et cependant, il faudra vingt-cinq ans pour qu'il rentre au gîte le pauvret ! Vingt-cinq ans pour que Messager, devenu directeur de l'Opéra, ait enfin la joie de le ramener lui-même au pigeonnier !
Brillante reprise (en 1910) où la partition des Deux Pigeons, mise en valeur sous la baguette de l'auteur, apparut, plus lumineuse et plus vivante encore, sœur jumelle de Coppelia ou de Sylvia, de Léo Delibes.
***
La création des Deux Pigeons donna lieu à une curieuse innovation. Jusqu'alors, suivant la routine établie, les pas et les danses étaient étudiés et réglés au foyer sur le simple accompagnement d'un violon et d'un alto. Cette méthode, quoique rudimentaire, s'accommodait aisément aux musiques d'autrefois dont les rythmes souvent simplets ne donnaient lieu à aucune embûche pour les danseuses. Mais lorsqu'il s'agissait de partitions plus complexes, cela devenait scabreux ! Namouna, de Lalo, représentée quelques années auparavant avait donné du fil à retordre au maître de ballet : dès la première répétition avec orchestre, personne ne s'y était reconnu et on avait dû remettre tout sur le chantier. Les mêmes errements furent épargnés aux Deux Pigeons et l'on introduisit enfin dans les salles d'étude de la danse un piano qui, en réduisant clairement la partition, fut définitivement adopté pour accompagner les répétitions chorégraphiques. Ne semble-t-il pas qu'on aurait pu commencer par là ?
NUAGES ET FÉES
Six mois plus tard, en flânant, Messager remonte le boulevard, de l'Opéra aux Folies-Dramatiques, berceau de ses premiers succès. Il se sent attiré, il aime le changement ; quel amusant contraste avec l'Opéra ! Il entre. On l'accueille avec joie : c'est lui ! On l'attendait ! On le retrouve enfin ! Et le 6 avril 1887 il reparaît sur l'affiche des Folies-Dramatiques avec le Bourgeois de Calais, opéra-comique nouveau, composé aussi facilement que les précédents qui avaient si bien réussi !
Mais patatras ! Le destin se rit de son assurance et cette fois c'est « un four », un vrai !
En relisant cette partition, dont il n'est rien resté, et en parcourant le livret dépourvu de fantaisie autant que de gaîté, écrit sur un sujet trop sérieux, grave, historique et terne, on découvre aisément les causes de cet insuccès. N'avait-on pas espéré une autre « Fauvette du Temple », d'allure aussi militaire que patriotique ? Cette fois ce n'étaient plus les zouaves et les tourlourous de Bugeaud qui défilaient fièrement en scène, mais bien les soldats du Duc de Guise, en l'an de grâce 1558 ! Les fervents de Paul Déroulède, tout cocardiers qu'ils fussent en 1887, se souciaient peu de l'anglophobie de leurs ancêtres et n'y trouvaient plus leur compte ! Qu'un musicien comme Messager ait pu s'inspirer d'un pareil thème et d'un texte aussi « mirlitonesque », cela surprend. Il n'en reste pas moins que sa partition conserve une tenue qui, par la facture, rachète la pauvreté des idées qu'elle contient dont, somme toute, il n'était pas responsable.
***
J'ai le souvenir de vacances de Pâques passées à Montivilliers avec Messager, au lendemain de cette aventure. J'y fus témoin de ses préoccupations, de sa déconvenue et surtout d'un télégramme qu'il reçut pendant le déjeuner, lui annonçant que les représentations du Bourgeois de Calais étaient interrompues. Je le revois, sortant brusquement de table et prenant avec précipitation le premier train pour Paris avec l'espoir d'éviter encore le naufrage. Mais il ne put rien faire et jamais on ne revit sur l'affiche cet ouvrage infortuné...
***
C'est alors que parut Isoline.
Isoline ! « cette partition pleine des souvenirs de Montivilliers » ; ainsi s'exprime la précieuse dédicace que j'ai conservée et qui évoque pour moi les moments heureux où je la vis éclore, page par page, sous mes yeux.
Isoline ! conte de fées en dix tableaux, poème de Catulle Mendès, alors en pleine gloire, représenté au Théâtre de la Renaissance le 26 décembre 1888.
Le prologue, nimbé de chœurs invisibles, débute ainsi :
« Allons les jeunes gens heureux
Les belles et les amoureux
Pour la Cythère aux bois ombreux
Embarquez-vous sur la trirème !
Dans le parfum des lys éclos
Dans les harmonieux sanglots
De la brise errante et des flots
C'est à Cythère que l'on aime ! »
Cythère ! l'Ile d'amour ! Eros, Oberon, la Fée Titania, Daphnis et Chloé, Isolin et Isoline ! Et ce poignard, étincelant miroir, où la tendre enfant abusée par la fée voit rayonner dans la lame le mystère de sa jeune beauté retrouvée ! Rêve de poète aux rimes ingénieuses et entrelacées, juvéniles ardeurs, fictions délicieuses et un peu puériles qui ont su inspirer au musicien tant de musiques exquises où la mélodie coule à flot, comme une source limpide et fraîche !
Mais hélas ! la chance cette fois hésite. Le joli conte, le chimérique conte s'aventure, imprudent, sur une scène mal choisie, s'exposant aux vicissitudes d'une saison lyrique improvisée où le directeur Victor Silvestre s'effondre, passe la main au vaillant chef d'orchestre Paul Letombe qui maintient Isoline quelques semaines et se ruine à son tour ! Le méchant destin, cette fois, s'était prononcé.
Quoiqu'elle ne fût jamais reprise à Paris, Isoline reste présente au souvenir de tous. Reynaldo Hahn, quand il dirigeait le Casino de Cannes, la ressuscita le 19 février 1930, assisté de Romain Coolus et de Mme Catulle Mendès pour le poème. Le public de la Côte d'Azur put ainsi apprécier l'agrément de ce charmant ouvrage. S'il existait une justice au théâtre, Isoline aurait mérité une destinée meilleure que celle qu'elle connut ; souhaitons qu'elle reparaisse un jour, comme Messager l'espéra si souvent lui-même car, étant mort avant la reprise de Cannes, il n'en revit de son œuvre qu'un mirage éphémère.
LA RUE DU CAIRE
Vint l'Exposition de 1889, celle de la Tour Eiffel et de la rue du Caire. Ah, l'heureux temps !... Oui, heureux temps que celui-là, où, après avoir escaladé la Pyramide de métal, on venait se rafraîchir sous les platanes du Champ de Mars, au son de musiques exotiques, en croquant du nougat et des dattes !
On pouvait aussi entendre d'autres musiques, plus sérieuses, et nous gageons que le « Journal Officiel » de l'époque, pris sur le vif, n'aurait pas manqué de relater tel ou tel discours rédigé dans un style dont nous serions tentés d'imaginer l'échantillon suivant :
« Nul n'ignore qu'à chacune de ces manifestations de l'activité nationale et internationale les arts sont appelés à concourir au lustre général ; c'est ainsi que surgissent pour une durée éphémère — qu'on prolonge un peu chaque fois avant de tout démolir ! — des théâtres d'exception, des salons de peinture et de sculpture et autres somptuosités où la musique trouve son temple dans ces périodes de prestige et d'éclat. » Ouf ! (*).
(*) Le Journal Officiel imaginaire du ... 1889.
Messager, très intéressé par ces merveilles, tient à y participer de son mieux et il s'emploie à diriger quelques concerts au Trocadéro où il fait entendre les chefs-d’œuvre de l'école russe, ignorés du grand public (quoique révélés auparavant par Camille Chevillard aux Concerts Lamoureux). Ledit grand public acclame à son tour Shéhérazade, Sadko, Antar, le Prince Igor et cette splendide floraison de l'école slave qui, après l'épanouissement du wagnérisme, nous apportait tous les parfums de l'Asie ! Ce fut l'heureuse révélation des Cinq.
***
Soudain la grippe laisse passer son vilain nez enchifrené. Sans s'effrayer, Messager n'en donne pas moins aux Bouffes-Parisiens, le 18 décembre 1889, le Mari de la Reine. La première a lieu en pleine épidémie d'influenza. Tout Paris se mouchait et éternuait en grelottant de fièvre et les distractions théâtrales passaient bien inaperçues ! Cet opéra-comique contenait cependant de jolies pages (*), mais le sujet laissa le public indifférent. Il y était question, au départ, d'une course au cerf dont l'heureux gagnant, au jarret agile, devenait par la loi et pour un an l'époux de la souveraine. L'action se passait au « Kokistan », pays légendaire, dont Molière à l'encontre du ci-devant public, se serait sans doute fort diverti ! Ce fut un franc insuccès.
(*) La valse : « Si j'avais vos légères ailes », le trio-bouffe de la rue Rambuteau, etc.
Je possède une partition du Mari de la Reine avec cette dédicace : « En souvenir du meilleur de mes fours (*) ! » Cela est dit sans vergogne, de cette belle écriture harmonieuse et ordonnée de Messager à travers laquelle il me semble apercevoir son sourire, un peu pincé certes, mais teinté de sa bienheureuse insouciance !
(*) Le meilleur, assurément, par la qualité incontestable de la musique.
***
Il habitait à cette époque rue Gounod, avec sa première femme. Très friand d'entendre ses pièces je m'étais aventuré chez lui à l'heure du café, au lendemain de la première, pour lui mendier une place. Je n'ai pas oublié toute la consternation dont était empreint leur visage. Et cela s'expliquait fort bien, car outre sa déconvenue d'artiste, ils ne vivaient que de sa plume et leur existence matérielle dépendait uniquement du sort plus ou moins heureux de ses ouvrages. Dépensant sans compter et quoique confiant dans son étoile, il n'en éprouvait pas moins d'angoissantes inquiétudes quand les choses n'allaient pas à souhait pour lui. Mais là, comme pour le reste, il ne s'attardait pas : un bon livre, une heure de déchiffrage, une conversation avec un ami suffisaient pour changer le cours de ses idées. Et cela s'arrangeait fort bien chaque fois, de manière inattendue, avec « ce bon hasard » qui le sauvait toujours !
LA BASOCHE
Après tant de secousses qu'allait-il devenir ? Que faire maintenant ? Où porter ses pas ? — Une occasion se présente.
L'Opéra-Comique était dirigé à ce moment par un havrais, Louis Paravey, successeur intérimaire de Carvalho, lequel avait dû quitter son poste après l'incendie du théâtre, dont on l'avait rendu, à tort, responsable.
Messager, muni d'un brave homme de beau-père qui habitait Le Havre, flaire le vent, y part d'un trait, rencontre chez ce providentiel parent le nouveau directeur en mal d'air natal, l'entoure, le cajole, et l'ayant conquis obtient la commande d'un ouvrage pour l'Opéra-Comique. — Prologue adroitement mené. Pas de nuages ! La route est libre, ensoleillée, il ne reste maintenant qu'à trouver un livret.
Albert Carré, son ami, le lui apporte. La partition ?... C'est le plus facile ! Il l'écrit d'un trait et en quelques semaines c'est fait, la Basoche vient au monde.
***
Mais il y avait le Dante de Benjamin Godard, dont Paravey, versatile directeur, s'était engoué dans l'intervalle au point d'en oublier ses serments, peut-être même de les renier. Messager voit le danger, réclame, menace, apostrophe ! Paravey hésite, prend peur et commence les répétitions qui marchent « au ralenti ». Mais au théâtre, il faut se méfier des pronostics et les pièces dont on espère le plus donnent souvent le moins. Représenté le 13 mai 1890, le Dante, sur lequel Paravey fondait tant d'espoirs est un échec. On s'affole, on presse les études de la Basoche qui, passant trois semaines après, en fin de saison, remporte un succès éclatant.
***
Au lendemain de la première, j'accourus de nouveau chez notre compositeur, que je trouvai entouré des siens. La joie l'illuminait en l'attendrissant, on s'embrassait, la chance était revenue, la partie gagnée !
Heureux ouvrage qui réunissait toutes les conditions pour réussir : pièce bien faite sur un sujet bien choisi où Clément Marot, roi de la Basoche, survivant des derniers trouvères, tient la première place ; texte un peu archaïque — pas trop — dont la musique s'empare en fée dominatrice dans un style approprié à chaque intention, à chaque situation : un joli chef-d’œuvre, de belle tenue et d'importante dimension.
Interprétation de choix avec Soulacroix, Lucien Fugère, Carbonne, Mmes Landouzy et Molé-Truffier, cette dernière adorable Colette. Fugère y trouva l'une de ses meilleures créations de baryton-bouffe dans le rôle du duc de Longueville ; plus tard, âgé de 83 ans, il chantait encore à l'Opéra-Comique son air du troisième acte : « Elle m'aime, ô cœur féminin, curieux problème ! » avec un brio tel que le public en délire exigeait de lui des bis et des bis jusqu'à complet enrouement !
***
La Basoche, c'est là son meilleur titre de gloire, tient une place importante dans l'œuvre de Messager comme dans l'histoire de notre musique théâtrale. Elle fut en réalité le dernier des grands opéras-comiques français du XIXe siècle, « le Roi malgré lui » de Chabrier l'ayant précédée de peu.
Son horoscope ? — Un sommeil et une renaissance. — Un sommeil : elle marque pour une assez longue durée le déclin du genre ; une renaissance, puisque de nos jours sa tradition a été reprise par quelques-uns de nos meilleurs compositeurs avec des ouvrages de moyens et de style différents, mais auxquels Messager a montré, à son heure, la route à suivre. Citons les œuvres de style léger composées par Maurice Ravel, Jacques Ibert, Delvincourt, Roland Manuel, Delannoy, Rosenthal, Louis Beydts, Francis Poulenc, Auric, Sauguet, Tony Aubin et d'autres encore parmi lesquels nos jeunes prix de Rome dont les cantates sont souvent inspirées du meilleur Messager, qui maintenant fait école.
***
La presse de l'époque ne pouvait apercevoir cette destinée imprévisible mais à juste titre elle couvrit de fleurs la Basoche et son auteur : « Messager a gagné ses éperons d'or ! » écrivait-on. Elle avait été plus réservée envers ses « opérettes » antérieures, « François-les-Bas-bleus » et « la Fauvette du Temple », de moindres dimensions quoique de même souche et d'égale facture, mais qualifiées d' « œuvrettes » intitulées pompeusement « opéras-comiques » — disait-on — auxquelles on n'avait attaché que peu d'importance. L'Olympe fronçait le sourcil, on était tout à la « grande musique », dite sérieuse, dont les fervents, eux, ne plaisantaient pas !
Cependant, lui, l'érudit, le fin connaisseur, le wagnérien de la première heure, n'avait cessé d'écrire simplement, dans son clair langage. Résigné, mais un peu amer, il me confiait parfois : « Que veux-tu !... à notre époque on a toujours le droit d'être ennuyeux ! » Et il se consolait en relisant tout ce qu'il aimait — toute la musique — plus enclin à fréquenter celle des autres qu'à exalter la sienne. En souffrit-il ? Peut-être...
***
Bien à tort, sans doute ! puisque les appréciations se jouent souvent à pile ou face, gammes majeures ou mineures.
Intolérance ? Equité ? — Choisissons, mais avant de nous prononcer soyons perspicaces : tout verdict erroné risque de se retourner contre nous.
Péché par ignorance ? — Assez pitoyable... Accord tacite dans le silence ? — Trop visible stratagème…
S'efforcer d'être impartial ? — C'est honnête et prudent car le temps, grand redresseur de torts, souvent fait son œuvre et décide. Les « opérettes » de Messager sont là pour l'attester !
***
En revanche, quelques-uns parmi les meilleurs musiciens de son époque ne cessèrent en toute occasion de lui témoigner leur estime et leur encouragement. Nous l'avons vu pour Saint-Saëns et Fauré et c'est Chabrier — notre grand Chabrier lui-même — qui lui adressera à son tour en juillet 1891 de pittoresques félicitations pour la croix de la Légion d'Honneur qu'il vient d'obtenir :
« Bravo, jeune camarade. Tu sais que ton ami sera toujours très sensible à tes succès et à tes joies. Te voilà « quelqu'un » relativement vite, tu obtiens « el hocheto della vanitade » à l'âge où c'est en somme fort agréable et où, ce qui est mieux, tu le mérites « el dito hocheto » — ça fera plaisir à tous tes amis, ça fera faire un pif aux autres, tout est donc pour le mieux, cher petit légionnaire. Tu fais même la nique aux peintres, ce qui est très amusant et fort rare dans notre métier. Du reste leur décoration ne fait plus aucun effet. C'est un peu nous que l'on regarde actuellement et ce qui doit nous surprendre quelque peu c'est que le vigoureux d'Indy ne passe pas ! mais ça ne se porte jamais sur des plats d'or et je crois qu'il n'a pas abusé jusqu'ici des moleskines — ah ! ces moleskines !...
Fais toutes mes amitiés enthousiastes à ta chère femme que j'embrasse, ainsi que toi, de tout cœur.
Ton Emmanuel Chabrier. »
***
Vieil ami de nos familles, brave homme aussi affable qu'exubérant, Chabrier ne manquait pas de faire sauter les cordes du piano chaque fois qu'il venait nous faire entendre sa vibrante musique. C'était surtout avec España et la Fête polonaise du Roi malgré lui qu'il s'animait avec le plus de fougue, car pour le reste il savait rester délicieusement nuancé, selon les teintes de son adorable palette. A travers les termes pittoresques de sa lettre on aperçoit toute l'affection et l'estime qu'il ressentait pour Messager.
L'existence matérielle de Chabrier était peu brillante — il avait dû, pour vivre, prendre un emploi dans un ministère. On le traitait volontiers d'amateur. Il ne fut apprécié que sur le tard et la longue maladie qui devait l'emporter l'empêcha de recueillir le fruit de son effort. C'est seulement après sa mort que sa renommée grandit et que sa personnalité ne manqua pas d'influencer certains de ses admirateurs, parmi lesquels Maurice Ravel à ses débuts.
INTERMÈDE
Autrefois les pièces célèbres tirées des romans de Paul Féval, celles d'Adolphe Dennery et autres dramaturges en renom, étaient accompagnées assez sommairement par un médiocre orchestre qui soulignait tant bien que mal les situations et prétendait en intensifier l'effet : c'était le mélodrame, le bon vieux mélo de nos pères qui connut à l'Ambigu des succès inoubliés. Bizet avec l'Arlésienne rehaussa le genre par son admirable partition qui fait corps avec la pièce émouvante d'Alphonse Daudet. C'est à cet exemple que puisa Messager lorsqu'il écrivit la musique de scène d'Hélène, sur un drame de Paul Delair (musique qu'il termina et orchestra à Montivilliers). « Hélène » fut représentée au Vaudeville le 15 septembre 1891, sous la direction Albert Carré. Si la réussite resta moyenne elle n'en prouva pas moins une fois encore la souplesse du compositeur qui sut réaliser à souhait sa tentative. Une Suite fut extraite de la partition et Edouard Colonne la fit entendre à ses concerts du Châtelet.
Le dimanche qui précédait l'audition d'Hélène au concert, Messager très attentif, applaudissait à tout rompre chaque morceau du programme, principalement une œuvre nouvelle dont j'ai oublié le titre et même le nom de l'auteur. Quel fut notre étonnement quand le soir, en rentrant, il nous déclara que cette nouveauté était exécrable !...
Aussitôt sa femme, interloquée, s'exclame : « Alors, pourquoi tant applaudir ?... André, je t'ai vu ! » et lui, très agacé, vivement : — « Pourquoi ? Avec Mme Colonne en face de moi dans une loge et ma Suite d'Hélène qui passe dimanche prochain ! » Nous comprîmes aussitôt ce « pourquoi ? » subordonné à l'œil inquisiteur de la redoutable personne. Petite lâcheté assez fréquente mais surprenante de la part de Messager, habitué à exprimer crûment son opinion. Soyons francs ! qui de nous ne s'est vu contraint d'applaudir, ne serait-ce que par bienséance et pour ne pas se faire remarquer ? Il faut savoir prendre sur soi. Au théâtre comme au concert, la pratique des couloirs est une sévère école, tout y est connu, répété, amplifié, qu'on le veuille ou non. Un auteur en renom préférait, dit-on, éviter tout contact les jours de première : « Si la pièce est mauvaise, je m'ennuie, si elle est bonne, ça m'ennuie. »
***
Scaramouche ! Ce nom évoque en moi bien des souvenirs, le temps de mon adolescence, de mes premières sorties, de ce moment troublant où l'on cesse d'être un enfant sans être encore un homme. Scaramouche fut représenté au Nouveau Théâtre (l'actuel Théâtre de Paris) le 17 octobre 1891. Les spectateurs avaient la faculté de pouvoir pénétrer pendant les entr'actes dans la salle du Casino de Paris (*) qui, avec le Moulin-Rouge, se trouvait assidûment fréquentée par la jeunesse d'alors. Vous pensez avec quelle joie je profitais de cette occasion ! Double agrément pour moi : entendre une œuvre de Messager et connaître en même temps l'un des temples du plaisir !
(*) Les deux salles étaient contiguës.
On était alors tout aux pantomimes dont la plus célèbre était « l'Enfant prodigue » de Michel Carré et André Wormser. Félicia Manet y brillait en grande vedette dans un genre qui, sans procéder entièrement de la danse, en emprunte le rythme et le geste pour traduire une action dramatique dont le verbe est exclu. Messager, toujours en quête de nouveauté, se devait de suivre le mouvement. Aussi écrivit-il Scaramouche — en collaboration avec un compositeur bien oublié qui ne manquait pas de mérite : Georges Street — sur un scénario imaginé par Maurice Lefèvre, agréable conférencier du jour, secondé lui-même par M. Vuagneux, autre auteur. Ils étaient quatre : on en vit souvent de plus nombreux autour d'une pièce !... Les interprètes se nommaient Félicia Mallet, Cornelia Riva, Henry Kraus, Paul Clerget. Quant au chef d'orchestre qui dirigeait l'exécution, il venait de se faire connaître par des refrains populaires déjà célèbres et devait par la suite écrire, lui aussi, des opérettes dont le succès ne s'est pas démenti : c'était Louis Ganne l'auteur renommé du Père la Victoire, la Marche Lorraine, la Tzarine, et des Saltimbanques.
Tous les morceaux de Scaramouche sont restés gravés dans ma mémoire, j'en entends encore les rythmes francs et gracieux. Je les jouais sans cesse au piano. Le plus grand bonheur que je pouvais entrevoir c'était de parvenir un jour à en écrire d'aussi charmants.
***
Sur la même scène, on vit représenter peu après la Danseuse de corde, une autre pantomime interprétée par Félicia Mallet. Dans l'orchestre, qui était sans fosse et presque au niveau de la salle, on avait installé un piano à queue. Je ne me lassais pas d'entendre celui qui en tenait la partie. J'admirais ce virtuose modeste, corpulent, à la barbe fleurie, au nez aquilin surmonté d'un vaste binocle en écaille (*) qui ne le déparait pas, exécutant avec une facilité sans égale, voisine de l'improvisation, les arabesques les plus gracieuses. Il se mêlait aux sonorités de l'orchestre et prenait des teintes qui m'émerveillaient. J'amenai aussitôt mes jeunes camarades mélomanes au Nouveau-Théâtre pour leur faire entendre ce concerto-pantomime, son virtuose inconnu et surprenant. Il se nommait, paraît-il, Raoul Pugno. C'était l'auteur de la partition. Les gens du promenoir qui l'écoutaient ne se doutaient guère qu'il serait un jour l'un des plus remarquables pianistes de son temps ! J'eus plus tard la joie d'assister à sa révélation dans le Concerto de Grieg chez Colonne. Pouvais-je soupçonner qu'il deviendrait au Conservatoire mon premier maître d'harmonie, qu'il m'encouragerait, m'apprécierait et me guiderait avec autant de bonté que de mansuétude ?
(*) Il me confiera plus tard combien l'équilibre hasardeux de cet objet lui causait de transes dans les concerts où, assis au piano et les mains au clavier, il s'épouvantait de la voir glisser peu à peu sans pouvoir le redresser.
Quel contraste avec la rudesse et la sévérité capricieuse de Messager ! Je reconnais cependant que celui-ci savait être un ami et un maître bienveillant quand il le voulait. Mais cela dépendait beaucoup des influences qu'il subissait ; on le perdait et on le retrouvait avec la même facilité !
LA PAUVRE CHRYSANTHÈME
Léonce Detroyat ayant pris la dilection du Théâtre de la Renaissance ouvrit une saison musicale (autre périlleuse tentative !) le 30 janvier 1893 avec Madame Chrysanthème, comédie lyrique en quatre actes, d'après le roman célèbre de Pierre Loti adapté à la scène par G. Hartmann et A. Alexandre, sur laquelle Messager composa l'une de ses meilleures partitions, toute de grâce et de poésie. Il l'avait écrite en grande partie lors d'un séjour qu'il fit dans cette intention sur les lacs italiens, chez son ami l'éditeur Ricordi. Il se passionna sur son sujet et lui qui, jusqu'ici, s'était plutôt confiné dans le genre léger sut, s'attendrir et s'émouvoir ; la touchante héroïne de Loti l'attirait et c'est dans une teinte orientale apparentée aux couleurs de la Princesse Jaune de Saint-Saëns qu'il la peignit musicalement. Malheureusement les auteurs du livret commirent l'erreur de suivre de trop près les menues péripéties du roman de Loti qui contient plus de détails que d'action et Messager dut se contenter d'un schéma trop sommaire et sans mouvement.
L'expérience a prouvé maintes fois la nécessité d'une entente préalable entre le musicien et l'auteur du livret. Certes, les bons sujets lyriques sont rares et nul ne peut prétendre gagner chaque fois à cette loterie ! Autrefois — et demain peut-être ? — la tâche du musicien était nettement fixée, il n'avait qu'à se laisser guider par la structure précise du livret ; de nos jours, la forme du poème étant plus souple, l'orchestre souvent parle en maître, les scènes sont conduites symphoniquement, c'est lui, musicien, qui devient pilote et prend la barre. Wagner et Berlioz, d'Indy et d'autres ont tranché la question en écrivant eux-mêmes paroles et musique. Il y aura aussi le cas de Pelléas, de géniale unité (malgré la rupture accidentelle qui sépara les deux auteurs pour des raisons tout à fait étrangères à l'élaboration de leur œuvre — il s'agissait du choix d'une interprète).
Avec Madame Chrysanthème, Messager fut en partie victime de l'insuffisance de son scénario, de bonne tenue néanmoins, mais dépourvu de trouvailles scéniques autant que de dynamisme.
***
Nous avons dit dans quelles circonstances il avait écrit sa partition en Italie, à la Villa d'Este, chez l'éditeur Ricordi. L'auteur de la Vie de Bohème, Puccini, invité lui aussi par Ricordi, se trouvait là en même temps. Or, coïncidence étrange, quelque douze ans plus tard — le temps d'y réfléchir ! — Madame Butterfly, tragédie japonaise dudit Puccini, apparaîtra en Italie, calquée visiblement sur sa sœur aînée Chrysanthème : même sujet, même ambiance, mêmes personnages, démarquage évident du roman de Pierre Loti. Mais cette fois les auteurs italiens se garderont bien de retomber dans les errements de leurs devanciers ! Moins scrupuleux mais plus habiles, ils ne craindront pas d'agrémenter l'action scénique de ces incidents pittoresques et dramatiques qui tiennent le public en haleine ; on y verra voltiger l'enfant de l'héroïne comme le papillon autour d'une fleur et Chrysanthème deviendra Butterfly ! Autant d'occasions pour l'éclosion de ces pages-types dont Puccini avait le secret et qui ont fait sa réputation ainsi que la fortune de ses ouvrages. Aucune parenté toutefois entre la musique des deux compositeurs. Ils s'estimaient l'un l'autre et Messager était trop intelligent pour ne pas apercevoir les dons de Puccini ; à tel point qu'après ces fâcheux incidents, dont ils s'expliquèrent, il ne voulut pas rompre avec lui et continua à le voir, restant volontairement à l'écart de l'ostracisme dont Puccini était frappé par les musiciens de l'époque.
***
A ce sujet, je puis évoquer le souvenir d'un Vendredi chez Mme de Saint-Marceaux où notre aimable hôtesse avait accueilli fort courtoisement le compositeur italien, amené par Messager lui-même. Ce dernier ayant dû partir sitôt le dîner, Puccini fut prié, selon l'usage de la maison, de se mettre au piano pour jouer l'une de ses partitions. Nous étions là un certain nombre de jeunes musiciens, disciples de Fauré et de Vincent d'Indy, assis autour de lui. Un quart d'heure après, je m'aperçus que j'étais resté seul auprès du « maestro » à lui tourner les pages et à l'écouter, les autres s'étant subrepticement défilés dans les pièces voisines.
Des mêmes fenêtres du Boulevard Malesherbes, j'avais vu passer une autre fois les obsèques de Gounod. Foule recueillie et émue, des fleurs. Je puis assurer qu'on n'en jetait guère du balcon où j'étais et vous fais grâce des sarcasmes que j'entendis ce jour-là, proférés par d'autres musiciens déjà fameux.
Mais aujourd'hui, les pièces de Puccini se jouent toujours et Gounod auréolé sort de son tombeau. O musiciens mes frères !
***
La répétition générale de Madame Chrysanthème fut brillante et la presse s'associa sans réserve au succès de la partition. On affirmait, non sans raison, que Messager s'était élevé cette fois jusqu'aux sommets de la « Comédie lyrique » ; flatteur éloge que dans la suite il sut mériter mieux encore avec des partenaires plus avisés. J'entends encore, ce soir-là, l'excellent ténor Delaquerrière dans le rôle de Pierre — romanesque enseigne de vaisseau — son confident Yves le matelot, Mlle Jane Guy — Chrysanthème de faibles moyens — et je revois, au pupitre, Messager conduisant sa jolie musique. Avant la représentation nous avions dîné avec lui dans un restaurant du Boulevard. Il était inquiet : « Songez, nous disait-il, qu'un seul geste maladroit de ma part et tout est par terre ! » et il paraissait plus soucieux de diriger l'orchestre que de l'accueil réservé à son ouvrage.
C'était bien un autre début pour lui, puisque, sauf quelques ballets, il n'avait pas conduit au théâtre et qu'il savait combien, ici, la tâche est périlleuse (*) ! Il en connaissait tous les dangers : entrées manquées, chanteurs et chœurs en avance ou en retard, batteur qui fonctionne mal, rideau qui ne se lève pas ou descend trop tôt, et mille embûches qui vous guettent auxquelles il faut parer avec sang-froid et adresse d'un coup de baguette magique !...
Mais d'emblée il se révéla au pupitre et cette soirée fut pour lui l'annonce des temps futurs : Louise, Pelléas, Salomé, Parsifal...
(*) Autre souvenir personnel sur les mêmes inquiétudes : Ayant amené Maurice Ravel à une répétition d'orchestre de l'Ambigu — il s'agissait d'un drame, l'Autre France, pour lequel j'avais écrit de la musique de scène — alors que je m'élançais pour me substituer au chef d'orchestre rébarbatif, Ravel me retint par les basques, me disant : « Si vous n'avez jamais conduit, n'y allez pas, c'est trop dangereux ! »
***
Partie gagnée pour Messager chef d'orchestre et compositeur, incertitudes sur le sort de la pièce, tel était le bilan au lendemain de la première de Chrysanthème. Un autre bilan, celui de Détroyat, le téméraire directeur, se trouvait plus menaçant encore et le pauvre homme, en fait de saison lyrique, se voyait contraint, un mois plus tard, de fermer les portes de son théâtre !
Amer destin que celui de Madame Chrysanthème ! refusée d'abord par Carvalho à l'Opéra-Comique, aventurée sur une scène d'occasion (celle où déjà s'était risquée Isoline), travestie à l'étranger, puis écartée définitivement par Albert Carré qui, plus tard, ayant à choisir entre les deux partitions rivales opta pour Butterfly, qu'en bon mari il maintint sur l'affiche de l'Opéra-Comique avec une interprète de son choix, tandis que Chrysanthème en était définitivement écartée.
UNE PAUSE
Nous sommes en mai 1893. La saison de la Renaissance vient d'être interrompue. Grande est la tristesse de Messager ! Mais il a du ressort et ne s'attarde pas dans des regrets superflus ; il rebondit cette fois encore et cherche à s'absorber dans un travail salutaire. C'est Saint-Saëns qui lui apporte le précieux dérivatif, survenu à point.
Voici l'histoire : Détroyat qui fut le collaborateur de celui-ci pour son opéra Henry VIII lui avait demandé pour la Renaissance sa Phryné à laquelle l'auteur de Samson et Dalila travaillait alors. Mais Saint-Saëns était un homme fort occupé. Pressé par le temps il pria Messager d'orchestrer le premier acte d'après ses esquisses. Voici ce qu'il lui écrivait à ce sujet en février 1893 :
« Mon cher ami,
Voyez si, dans le final, il ne serait pas opportun de doubler par les premiers violons la partie vocale assez scabreuse. Et puis, vous savez, liberté complète, faites absolument tout ce que vous voudrez. Je suis bien content que ça vous plaise, d'abord parce que je redoute votre jugement, et puis parce que ce travail vous serait odieux si ce que j'ai fait ne vous plaisait pas.
Mais ne m'appelez plus maître, vous en êtes un autre ! et je vous vois grandir de plus en plus avec une joie où il y a un peu d'orgueil, car je m'imagine, peut-être à tort, avoir travaillé à votre éducation, comme Gounod jadis a travaillé à la mienne ! Seulement quand Gounod m'a vu grandir, ça ne lui a pas fait plaisir tout de suite, il a eu besoin de s'y faire. Je ne suis pas du même acabit.
Je vous embrasse cordialement.
Camille Saint-Saëns. »
A épingler, la petite pointe contre Gounod ! Quand on règne il faut savoir s'accommoder des héritiers du trône, éventuels usurpateurs...
***
Le voilà donc courbé sur ses feuillets, blotti dans son oasis, et mettant au point le travail que Saint-Saëns lui a confié. Sur ces entrefaites, Carvalho redevenu directeur de l'Opéra-Comique réclame à son tour la primeur de Phryné (virginité qui semblait tenter singulièrement les directeurs !) Il télégraphie à Saint-Saëns, qui est à Alger, pour qu'on hâte les noces dont les apprêts (ou plutôt les répétitions) vont commencer aussitôt.
Seconde lettre urgente de Saint-Saëns, datée du 11 mars 1893 :
« J'ai terminé mon deuxième acte le 5 dernier, mais je ne vous l'envoie pas parce que je vais l'orchestrer moi-même, pendant que vous finissez d'orchestrer le premier. Vous savez qu'on nous joue tout de suite, il n'y a donc pas de temps à perdre. Je vous laisserai seulement le final qui est composé de rappels du premier acte avec de légères modifications.
Quel dommage que votre ravissante Chrysanthème ait été ainsi sacrifiée ! Peut-être Phryné aura-t-elle le pouvoir de la faire revenir à l'Opéra-Comique : la presse a été unanime à en faire l'éloge et il est possible que vous n'ayez pas à vous repentir plus tard de cette équipée ; le théâtre est un drôle de pays !
J'espère que vous avez eu de l'agrément avec la Basoche ; on vient de jouer Samson à Venise.
Ça marche, ça marche ! Et vous grandirez, je n'en ai jamais douté ; quoique vous ne soyez pas Espagnol. Le meilleur moyen d'arriver à quelque chose, voyez-vous, c'est encore d'avoir du talent.
Je suis en train de rapprendre à jouer du piano et de l'orgue, à l'intention de la Hangleterre et de la mère-Ique. « Qui l'eût cru » ou « qui l'aurait jamais cru » comme on dit à l'Opéra !
Funeste résultat des Exposi-ti-ons
Qui font perdre la tête aux popula-ti-ons !
Et dire que si Christophe Colomb avait fait naufrage, je ne serais pas forcé de faire des gammes et des octaves ! — Assez de bêtises, je vous embrasse cordialement.
Camille Saint-Saëns. »
Toute la bonhomie et la jovialité de Saint-Saëns se trouvent contenues dans cette lettre. Lorsqu'il écrit : « Vous savez qu'on nous joue tout de suite, il aurait pu dire « on me joue tout de suite », mais c'eût été un peu égoïste et sans nuance pour celui qui venait de lui prêter son concours de manière si spontanée. — Plus loin il s'apitoie sur l'essor entravé de Madame Chrysanthème. Il l'appelle — avec raison — votre « ravissante Chrysanthème », juste hommage qui devait certainement consoler un peu Messager. Aussitôt, pour le consoler mieux encore, il lui laisse entrevoir que sa collaboration dans Phryné peut n'être pas inutile. Dans sa joie d'être joué à l'Opéra-Comique, il pense à Messager et associe le sort problématique de Chrysanthème à l'heureux destin de Phryné. Cela veut dire qu'il est soucieux de mettre en relief, une fois de plus, le talent de son disciple et ami. Procédant par similitude, il se réjouit du succès éventuel de la Basoche à Turin (*) autant que de celui de Samson à Venise. Il encourage Messager : « ça marche, ça marche ». Il entrevoit son ascension et rend hommage à son mérite. Pour terminer, quelques calembours joyeux et naïfs, agrémentés d'une constatation sur la nécessité de faire des gammes et des octaves — on sait qu'il fut pianiste toute sa vie —. Enfin, reprenant un ton sérieux : « Assez de bêtises », dit-il, et il l'embrasse cordialement.
Vous voyez bien que malgré ses boutades, Saint-Saëns était un brave homme !
(*) A Turin, Messager incité par l'éditeur Sonzogno — peu perspicace en l'occasion — à venir assister à la première de la Basoche fut hué et sifflé quand il vint saluer sur la scène, victime inconsidérée d'un de ces incidents diplomatiques coutumiers, auquel il était bien étranger !...
***
Si Phryné, courtisane grecque, fut jadis accusée d'impiété, c'est bien avec ferveur que Messager s'était mis à orchestrer l'œuvre de Saint-Saëns qui la célébrait.
Orchestrer ! c'était son plus grand délassement...
Il était de ceux qui, après l'effort souvent intense qu'exige la composition, sont heureux de fermer leur piano et de laisser reposer leur muse pour s'asseoir pendant de longs moments à leur table en se baignant dans les sonorités que découvrent leur plume et leur intuition.
A ce moment le musicien devient un peintre ; nul bruit autour de lui. Son œuvre chante en lui, son papier à musique est la palette d'où il tire ses teintes et ses couleurs. Il s'agit de les extérioriser et chaque feuille blanche contient son mystère. Mais là, les uns travaillent sans effort, les autres peinent et raturent. Question de métier ? — pas toujours ! mais plutôt affaire de nature et de spontanéité.
Messager était des premiers. Il s'installait sans apprêts devant son papier à musique et froidement, méthodiquement, sans hésitation, il ornementait ses feuilles dans un dosage immédiat et parfait. C'était toujours du premier coup la vérité lumineuse, celle que parfois on cherche et recherche avant d'y parvenir. On eût dit que Mozart et Mendelssohn guidaient sa plume. Détestant la surcharge, il s'irritait souvent contre ceux qui, disait-il, ont « l'horreur du papier blanc ». Non seulement il aimait écrire l'orchestre de sa musique, mais il se plaisait à s'assouplir dans des styles différents : il le fit pour Pugno dans Pour le drapeau, pour Chopin dans Suite de Danses (en s'adjoignant Paul Vidal) et le Concerto en fa mineur pour piano qu'il réorchestra à l'intention de Mme Marguerite Long, enfin pour Saint-Saëns avec Phryné.
***
Nous n'avons voulu relater ici qu'une exceptionnelle facilité de travail qui n'infirme en rien tout louable effort de perfectibilité, si ardu soit-il, et nous ne cherchons nullement à comparer la mozartienne sobriété d'orchestre de Messager avec les somptuosités instrumentales de nos modernes symphonistes. Chaque école a ses chefs-d'œuvre. Mais quel agrément que cette facilité pour qui la possède ! Témoin la confidence que me fit un jour Paul Dukas au moment de terminer son admirable instrumentation d'Ariane et Barbe-Bleue : « Je touche à la fin et jusqu'au bout c'est toujours aussi difficile. »
Heureux Messager !
LA PRÉTENTAINE
Après cette pause, il reparaît bientôt, pris d'une ardeur singulière. Il court la prétentaine, va d'une scène à l'autre, saisit toutes les occasions. Mais s'il fait feu des quatre pieds, il saura prendre garde de ne jamais se diminuer, car Euterpe, sa muse fidèle, veille sur lui jalousement. Suivons-le dans cette randonnée :
En 1893, après Madame Chrysanthème, il donne au Théâtre-Libre dirigé par Antoine une pantomime, Amants éternels, suite parodique à Roméo et Juliette...
Quatre jours après, au Nouveau-Théâtre, première représentation de Miss Dollar, opérette en trois actes comprenant un important ballet qu'il composera en quelques jours, auprès de nous, à Montivilliers.
Le 3 juillet 1894, au Savoy-Theatre de Londres, Mirette opéra-comique en trois actes (livret de Michel Carré) en collaboration avec Miss Hope Temple, la future et seconde Mme Messager.
Vient ensuite aux Folies-Dramatiques le 13 janvier 1896 une nouvelle opérette la Fiancée en loterie, sur un livret de Camille de Roddaz et Alfred Droan avec Jean Périer et Mlle Armande Cassive — jolie personne dont l'image n'était pas sans troubler les nuits de nos jeunes collégiens !
Cette opérette sera reprise à Cannes quelque trente ans après par Reynaldo Hahn.
Un peu plus tard, le 12 avril 1897, à la Porte-Saint-Martin, la Montagne enchantée, féerie en cinq actes et douze tableaux d'Emile Moreau et Albert Carré dont il se partage la composition avec Xavier Leroux.
Enfin, le 15 mai 1897, le Chevalier aux Fleurs pour l'inauguration des Folies-Marigny — un grand ballet d'après Armand Silvestre, en collaboration avec Raoul Pugno.
Tout cela d'excellente qualité musicale, dessiné de même plume alerte et facile — particulièrement Miss Dollar et la Fiancée en loterie — et comportant peu d'inégalité de facture sinon de succès.
Avouerai-je que ce Messager-là, vu sous cet aspect simple et nomade, se consacrant tout entier à sa musique dans une heureuse insouciance, est celui dont je conserve le plus intime souvenir ? Les hautes fonctions et les titres de noblesse qui l'attendent l'éloigneront bientôt de ceux qui l'aimaient et l'entouraient. Il ne leur appartiendra plus, il ne s'appartiendra plus lui-même ; en le montrant tel qu'il fut à cette époque, nous n'avons voulu que le prendre sur le vif.
A vouloir trop vanter son héros, si glorieux soit-il, on le déforme et le rapetisse.
***
Dans la Montagne enchantée, comme dans Pour le drapeau — partitions citées ci-dessus — la musique fut écrite par Messager en collaboration avec un autre compositeur. Comment, demandera-t-on, deux musiciens peuvent-ils s'y prendre en l'espèce ?
Les moyens sont variés mais peuvent se résumer succinctement :
Soit en travaillant séparément — ce qui est aisé lorsque la partition comporte des morceaux séparés et dans l'opérette surtout, où il n'y a guère de fils thématiques. Il suffit ici de maintenir l'unité d'écriture et de style indispensables, car sans cette précaution l'œuvre risque de devenir disparate, sinon défectueuse.
Soit en se mettant davantage en contact. Dans ce cas, il peut y avoir échange d'idées ; l'un prend un morceau que l'autre achève ; la qualité, le développement, la structure, la modulation, l'harmonisation même sont discutés en commun ; parfois l'un cherche au piano dans l'élan de l'improvisation, tandis que l'autre recueille sur le papier les idées ou les rythmes qui sont venus sous les doigts du premier ; on bâtit ensemble les morceaux et l'amalgame s'étend jusque dans l'orchestration ou le choix des timbres ; le dosage, l'écriture des instruments peuvent aller jusqu'à « la recherche du mieux » qu'on poursuit allègrement à deux, chacun mettant le meilleur de soi pour tenter de s'élever vers la vérité définitive, celle qui, enfin, s'impose et devient la meilleure récompense du créateur et de l'artiste (*).
(*) J'eus moi-même l'occasion de procéder ainsi avec mon regretté camarade Marc Delmas dans Sylvette, opéra-comique de René Peter, Claude Roland et Michel Carré, qui fut joué au Trianon-Lyrique en 1932 (direction Amic).
***
Les deux compositeurs de la Montagne enchantée — en l'occurrence Messager et Xavier Leroux — avaient décidé de signer séparément leurs morceaux. Ils témoignaient ainsi d'une défiance singulière l'un pour l'autre qui n'explique guère pourquoi ils avaient entrepris de mettre leur effort en commun ! Je les ai trop bien connus tous deux pour ne pas apercevoir la raison qui les poussait à agir ainsi : ils avaient des natures musicales profondément différentes. Xavier Leroux était tout feu tout flamme, ardent et spontané, tandis que Messager mesurait son élan, le dirigeait adroitement et tendait plutôt vers la grâce et la finesse. Bref, ils n'étaient nullement faits pour travailler ensemble ; ils le sentaient et c'est pourquoi ils tinrent à souligner chacun la paternité de leurs écrits. — Curieuse dualité !
***
Avec la Montagne enchantée on verra pour la première fois monter au pupitre un jeune musicien encore inconnu : André Caplet, élève de Leroux, l'un de mes meilleurs camarades, prématurément disparu et qui, étant havrais, venait souvent jusqu'à nous à Montivilliers.
Messager s'étonna de voir Caplet apporter plus de soins à l'exécution des morceaux de son maître Leroux qu'aux siens. Mais plus tard, quand l'Opéra-Comique donnera la Reine Fiammette, c'est Messager à son tour qui montera la pièce et conduira l'orchestre. Sans rancune d'aucune sorte, il oubliera ses susceptibilités d'auteur et concourra de son mieux à l'exécution de la partition de Leroux et à sa réussite.
AU MÂT DE COCAGNE
Ayant enfin passé mon baccalauréat, je pus me consacrer tout entier à la musique. Alors que je me débattais dans les difficultés souvent arides du contrepoint, je pris un jour mon courage à deux mains et j'allai trouver Messager en lui demandant avec instance de m'initier à ces travaux qui me semblaient ingrats. Il m'accueillit affectueusement comme il savait souvent le faire et pendant plusieurs mois je vins lui soumettre mes exercices qu'il revoyait avec le plus grand soin. Je lui montrai aussi quelques essais d'orchestration auxquels il voulut bien s'intéresser. Ses conseils me furent précieux ; son attitude d'autrefois, souvent sévère à mon égard, s'était complètement modifiée et il avait su reconnaître l'effort que j'avais fait dans mes études d'harmonie auprès de Raoul Pugno, au Conservatoire. Pugno m'aimait bien, il m'avait tout de suite encouragé et Messager semblait maintenant vouloir faire de même à son tour. M'ayant connu tout enfant et novice, il commençait à s'émouvoir devant mon labeur incessant jusqu'au jour, béni par moi, où il consentit à me prendre plus au sérieux. Mais il lui était agréable — sinon nécessaire — que d'autres, bien qualifiés, vinssent étayer sa conviction.
***
Une grande amitié unissait Pugno et Messager ; c'étaient, pourrait-on dire, deux « copains » — qui aimaient se retrouver, se tutoyaient, dînaient ensemble chez des amis de leur choix et se mettaient spontanément au piano pour leur plaisir et à la plus grande joie de leurs hôtes. Bien souvent ils se rencontraient à Paris, chez mes parents, et nous passions grâce à eux de délicieuses soirées. Chabrier, Massenet, Fauré, Victorin Joncières, Xavier Leroux, de Bréville, Weckerlin, Francis Thomé et bien d'autres vinrent aussi rue de la Terrasse. Ma jeunesse est remplie de leur souvenir et c'est dans cette ambiance que se développa mon éducation musicale.
Plus tard, mes jeunes camarades du Conservatoire reçurent à leur tour le même accueil. Ils s'appelaient : Maurice Ravel, Florent Schmitt, André Caplet, Roger Ducasse, Alfred Cortot, Georges Enesco, Pablo Casals, Marguerite Long, Nadia Boulanger, Jacques Thibaut, Henri Estienne, Marcel Labbé, Léon Moreau, Lucien Garban. Presque tous ont fait glorieusement leur chemin et Messager, quoique plus âgé, resta toujours le centre du groupe.
***
Dans le petit appartement qu'il habitait alors rue Marbeuf, j'aperçus un jour sur sa table la nouvelle partition à laquelle il travaillait avec assiduité : le Chevalier d'Harmental, tiré d'Alexandre Dumas. Après chaque leçon de contrepoint il se mettait au piano et consentait volontiers à me jouer les pages qu'il venait d'écrire. Comme tant d'autres parmi ses œuvres, je verrai naître celle-ci scène par scène et s'accumuler les innombrables épreuves d'orchestre que l'éditeur Choudens lui envoyait chaque jour. J'appris là combien ces corrections étaient minutieuses, comment il fallait prendre garde aux erreurs du copiste ou du graveur et savoir éviter que la flûte fut inscrite sur la partie du trombone ou celui-ci sur celle du piccolo !
***
Le Chevalier d'Harmental, reçu par Carvalho (qui venait de retrouver son fauteuil directorial) fut mis à l'étude en avril 1896. Je n'ai pas cité précédemment cet ouvrage, étant désireux d'en parler séparément ici.
J'en suivis les répétitions dans l'actuel théâtre Sarah-Bernhardt où l'Opéra-Comique donnait ses représentations en attendant la reconstruction de la Salle Favart. Le compositeur et le directeur étaient à couteaux tirés et ce dernier interrompait sans cesse les répétitions afin de mieux ulcérer sa victime. Il se plaignait tantôt des mouvements, tantôt des nuances, se permettant d'intervenir jusque dans des détails d'orchestration qui ne le concernaient en rien ! Messager, furieux et crispé, répondait sur le même ton et tout se passait dans une atmosphère d'hostilité, assez fréquente au théâtre, qui met les nerfs en pelote. Cela s'arrange souvent pour le mieux, mais ici les deux hommes se haïssaient cordialement et tout menaçait de mal finir. Pour ma part, Carvalho me surprit un jour à une répétition ; il demanda à Messager quel était cet intrus et je fus chassé incongrûment de la salle !
***
C'est le 5 mai 1896 que l'Opéra-Comique donna la première du Chevalier d'Harmental. L'ouvrage était découpé par Paul Ferrier en cinq actes et six tableaux. On connait le roman d'Alexandre Dumas et Auguste Maquet qui évoque l'époque galante de la Régence. Porté autrefois à la scène, il avait obtenu un vif succès ; mis en musique, le public n'y prit pas goût et ne dit pourquoi. Contre toute attente la pièce tomba lamentablement ainsi qu'en témoigne la lettre adressée par le chef d'orchestre Jules Danbé (*) à Messager, quinze jours après la première :
(*) Jules Danbé est le chef d'orchestre qui, au péril de sa vie, avait sauvé de l'incendie de l'Opéra-Comique l'unique partition manuscrite du Roi malgré lui, dont les représentations furent interrompues alors.
« Laissez-moi vous dire, mon cher Messager, combien je suis, combien nous sommes touchés de l'insuccès du Chevalier d'Harmental.
Votre partition est de tout premier ordre, intéressante au possible, que mon orchestre aime et que je conduis avec un plaisir constant.
Je ne vous ai pas vu tous ces temps-ci ; j'ignore donc si vous êtes venu nous entendre. Je vous assure que tout le fondu, les nuances... intermédiaires, la précision étaient jolies à entendre.
Je n'ai d'autre but, en vous écrivant ce mot, que de vous assurer du gros chagrin que nous éprouvons tous et de vous redire tout le bien que je pense de votre œuvre.
Croyez-moi, mon cher ami, bien affectueusement à vous.
J. Danbé. »
Découragé par cet échec, Messager jura de ne plus écrire une note de musique — heureusement il ne tint pas parole — ! Après un gros effort pour monter au mât de cocagne, il se sentait cette fois bien mal récompensé. Mais qui peut prétendre « décrocher la timbale » à chaque fois ?
***
J'eus maintes fois l'occasion de m'entretenir avec Reynaldo Hahn de cette partition dont rien n'est resté. Hahn, je l'ai dit, connaissait et appréciait mieux que nul autre les œuvres de Messager. Il me vantait souvent les qualités de d'Harmental, se complaisant à certaines scènes délicatement tournées que nous relisions ensemble.
L'opéra et l'opéra-comique historiques procèdent d'un genre qui a rarement obtenu la faveur du public. Le Chevalier d'Harmental, avec le Régent et la Conspiration de Cellamare, en relèvent directement, comme Henry VIII et plusieurs opéras de Saint-Saëns. Nous verrons cependant que si nul d'entre eux ne put conserver sa place au répertoire, Messager aura sa revanche plus tard avec Monsieur Beaucaire, grande opérette plutôt que comédie-lyrique, où le Duc d'Orléans tiendra encore la première place.
HYMÉNÉE ET BROUILLARD SUR LONDRES
Quelque temps après avoir perdu sa femme (dont la fin cruelle ne le laissa pas insensible) Messager avait épousé en secondes noces une séduisante anglaise, Miss Hope Temple, dont la vogue était grande en Angleterre.
La réputation musicale de celle-ci s'était faite sur d'aimables mélodies ou romances sentimentales dont elle écrivait la musique et qu'elle interprétait dans les salons de Londres. Fort jolie, elle ne manquait ni d'esprit, ni de répartie, voire même d'ironie ; spontanée et impulsive — quoique réfléchie — elle avait facilement l'esprit en flèche. Ah, ces flèches ! comme elle savait les décocher !... principalement à son mari qui lui en retournait d'autres, aussi aiguisées, d'où querelles, bouderies, ruptures ! Et cela durera des années jusqu'au jour où, las de ces chamailleries, ils se sépareront.
Elle n'en fut pas moins une compagne précieuse qui lui vint souvent en aide, lui ouvrit les portes de la société anglaise et resta associée aux bons jours comme aux mauvais.
***
Plus encore aux mauvais ! car pour les bons, le volage, grisé par le succès, ne se priva pas d'en cueillir les fruits, même ceux défendus. Et Dieu sait combien, jolie comme elle était, elle eût pu facilement, par réciprocité, se mettre au diapason ! Elle le voyait partir tantôt pour l'Irlande ou l'Ecosse, tantôt pour la Russie — il était à cet égard de goûts cosmopolites — puis revenir par Nice où il s'attardait volontiers et réapparaître à Paris où ses horizons étaient illimités.
Ah, l'heureuse vie !... (*) Résignée, elle s'entoura d'amis fidèles et consolateurs en s'employant à adoucir les angles entre eux et lui. Un souvenir entre mille :
(*) On assure que Gounod, parmi d'autres musiciens, appréciait aussi ce genre de fugues. Une fois, paraît-il, après un séjour très prolongé à Londres, il s'était présenté chez lui, las et solennel : « Madame, dit-il en s'inclinant humblement, je ne vous rapporte que mon buste ! »
Quand il devint directeur de l'Opéra, il maugréait chaque jour contre les innombrables solliciteurs qui déferlaient sans cesse dans son bureau directorial : « De quoi vous plaignez-vous ? lui disait-elle. Ils vous « embêtent » ?... mais vous êtes là pour çà, mon ami ! » Ironique réplique, soulignée par son amusant accent anglais, qu'il prenait fort mal et le laissait boudeur et courroucé.
Parmi les griefs qu'elle formulait contre lui quelques-uns, à son dire, étaient d'extrême importance : fréquemment elle le traitait d'oisif. Oisif ? lui ? quelle ironie ! Mais elle n'admettait pas que sa facilité de travail puisse lui laisser des loisirs qu'il se chargeait d'occuper selon ses goûts. D'autres fois, souvent même, elle lui reprochait d'avoir « étouffé » ce qu'elle appelait « son génie musical » ! — Je présume que pour elle, anglaise, les mots n'avaient pas exactement le même sens que pour nous... Mais elle lui eût pardonné plus volontiers ses fredaines et ses loisirs que l'humiliant effacement de sa personnalité !
***
Depuis longtemps nous ne l'avions pas revu et nous soupçonnions qu'après la perte de sa première femme, ses assiduités auprès de la seconde l'absorbaient au point d'en oublier ses amis.
Dans l'été de 1896, quel fut notre étonnement de le voir arriver un beau matin à Montivilliers avec celle-ci, tout fraîchement remarié ! Je revois encore la scène :
On sonne à la porte du jardin, la grille s'ouvre, une calèche contenant deux personnes monte cahin-caha jusqu'à la villa. Nous nous précipitons — c'est lui, c'est Messager ! Il saute de la voiture et comme si l'on s'était quittés la veille nous présente l'aimable personne qui l'accompagne : « Miss Hope Temple, la nouvelle madame Messager. »
Curieuse analogie ! Le même événement s'était déjà produit quelque douze ans auparavant, dans le même cadre, quand il vint à Montivilliers au lendemain de son mariage avec Mlle Clouet. L'agréable souvenir de sa première lune de miel l'incitait, nous n'en doutâmes pas, à revenir aux Rochers, comme autrefois, pour y goûter à nouveau les douceurs de la seconde !
Les nouveaux mariés venaient d'Angleterre et c'était pour eux leur manière de voyage de noces. Ils restèrent quelques jours auprès de nous, puis l'idée leur vint de ne pas repartir seuls et ils nous emmenèrent avec eux jusqu'à Londres, puis à Maidenhaed où, après un court séjour nous les laissâmes, — enfin seuls !
***
Après un hiver d'activité passé à Paris (1896-97) ils retournèrent sur les bords de la Tamise, dans ce Maidenhead où Miss Hope Temple possédait, parmi les élégants cottages de l'endroit, un home mignon agrémenté du meilleur confort britannique. C'est là qu'ils allaient pouvoir de nouveau apprécier les charmes d'une solitude à deux. Le croirait-on ? Voilà que cet isolement se met à leur peser lourdement ! Messager, pour chasser le spleen qu'il sent venir, dévore livres et partitions... pour lui aucune activité, nulle œuvre importante sur le chantier, des soucis matériels, pas d'horizons ! C'est assez pour que les heures lui deviennent longues et monotones ; pour un peu il s'ennuierait ! Le ciel est en grisaille, l'automne approche, Sœur Anne attend toujours.
Dans cet instant, la chance — sa chance — va de nouveau lui venir en aide. Quand elle paraît, il se jette dans ses bras, elle le saisit !
MICHU ET VÉRONIQUE
Cette chance nouvelle s'était présentée incognito sous la forme d'un rouleau fleurant le manuscrit que Messager avait d'abord mis de côté sans vouloir l'ouvrir. Geste fréquent chez les compositeurs ! Outre l'inégalité de travail matériel — pour s'exprimer les mots n'ont besoin que d'une ligne, le papier à musique en comporte beaucoup — il y a là, sauf le coup de foudre, une sorte d'offre de mariage (ou de liaison) qui n'est pas sans aléas où le musicien se doit d'y regarder à deux fois.
S'il se dérobe, le soupirant librettiste se croit méconnu, parfois s'en offusque, sans se rendre compte de l'importance de sa demande. Mais la réciproque existe et l'on peut voir un timide compositeur venir solliciter la collaboration de l'auteur en vogue ; ici les rôles se retournent : mêmes réticences, mêmes hésitations chez l'écrivain. Dans les deux cas, celui qui vient vers l'autre est en état d'infériorité et risque de n'être pas agréé.
***
Le livret que reçut ce jour-là Messager avait été déjà refusé par trois compositeurs et il se peut que, sans s'en souvenir, Messager ait été du nombre ! Il le feuilleta d'abord négligemment ; puis comme la pluie tombait de nouveau à Maidenhead et qu'il avait encore le spleen, il trouva une distraction à son ennui et se mit à le parcourir avec plus d'attention. Ce livret était celui des P’tites Michu. Il s'aperçut qu'il était fort bien tourné et sa gaîté le séduisit soudain. Renonçant à ses idées noires, il se mit à écrire avec un tel entrain qu'en quelques semaines l'ouvrage était terminé et joué à Paris, le 16 novembre 1897, au théâtre des Bouffes-Parisiens.
Réussite complète ! Messager venait de retrouver une fois encore sa véritable vocation : la musique légère. Bien souvent les circonstances l'en avait détourné, mais d'instinct il y revenait toujours, et le plus souvent avec succès.
Les librettistes auxquels nous devons ce « retour au bercail » du compositeur sont Albert Vanloo et Georges Duval ; le directeur également bien inspiré, M. Coudert (à qui Messager a dédié sa partition) et l'heureux éditeur, Paul de Choudens.
***
Encouragés par le succès des P’tites Michu, les mêmes auteurs se remirent au travail et un an plus tard, le 10 décembre 1898, sur la même scène, était créée Véronique, l'œuvre la plus populaire d'André Messager. Ce fut un véritable triomphe, auquel j'eus la joie d'assister.
Dès le premier acte, le public se trouva pris d'une allégresse singulière qui ne cessa plus un instant de la soirée. Joie d'art complète allant du rire à l'émotion.
Véronique ! incomparable album d'un Gavarni plus souriant, livre aimable et bien construit, sans remplissage, qui porte le musicien sans jamais le ralentir ni l'encombrer et lui suggère une suite ininterrompue de croquis dessinés de main de maître de la plus jolie manière qui soit.
L'élite la plus sévère et la plus orgueilleuse, par surprise, y trouva son compte ; tous aperçurent le joyau, le chef-d’œuvre du genre et les qualités si françaises de Messager prirent tout à coup un relief insoupçonné, même aux yeux de quelques importants retardataires. Et quelle interprétation ! Quel « coup de veine » fabuleux d'avoir pu réunir sur l'affiche des artistes, tels que Mariette Sully, Tariol-Baugé, Jean Périer, Regnard !
***
Outre que le compositeur, comme l'auteur dramatique, a besoin de nombreux auxiliaires pour parvenir jusqu'au public alors que l'écrivain et le peintre l'atteignent directement (une toile clouée au mur suffit à ce dernier), au théâtre tous sont solidaires. Pas de succès immédiat sans de bons interprètes, lesquels ne peuvent rien faire d'une mauvaise pièce.
Avec Véronique, Messager trouva d'emblée cette distribution. Tous les airs furent bissés le jour de la répétition générale, et principalement les couplets : « C'est Estelle et Véronique », le « duetto de l'âne », le « duo de l'escarpolette », la « lettre de Florestan ».
Dans cette charmante partition le compositeur s'est diverti le plus aimablement du monde, particulièrement en ce qui concerne l'orchestration. Chaque mot, chaque trait d'esprit, chaque sentiment y sont soulignés avec verve, ironie ou émotion ; les touches légères des instruments à vent et des cuivres y dialoguent délicieusement avec le quatuor à cordes dans un équilibre que Mozart lui-même n'eût pas renié. Le tout, images ou croquis, délicatement dosé, ciselé, rempli de trouvailles heureuses et colorées, sans jamais couvrir les voix (*).
(*) L'apparition du Jazz apportera plus tard d'autres sonorités et des rythmes nouveaux sans rien effacer de ce parfait équilibre.
Puissent les jeunes compositeurs épris de cet art gracieux s'efforcer d'étudier une telle instrumentation et sa légèreté d'écriture !
Bien souvent Messager me faisait observer les finesses que comporte ce métier et quand nous parlions ensemble de tel ou tel musicien peu svelte, qui prétendait, lui aussi, vouloir se risquer dans l'opérette, il me disait malicieusement : « Le vois-tu orchestrant ça ! »
***
Sur ce sujet il ne craignait pas d'ajouter quelques commentaires que nous pouvons résumer ainsi :
« L'instrumentation de la musique légère exige une dextérité et un tact que ne connaissent pas toujours les compositeurs du genre... Certains d'entre eux ne craignent pas de faire orchestrer par d'autres leur musique sans prendre garde que leurs auxiliaires manquent souvent de ce « je ne sais quoi » qui fait qu'une instrumentation bien venue met en relief, soit par le choix des sonorités, soit par l'élégance de l'écriture, les finesses et les intentions des musiques qu'elle prétend traduire. Tel morceau ne prendra sa véritable signification que s'il est bien instrumenté et perdra autrement toute saveur ou toute légèreté ! »
Dirai-je aussi combien Messager s'étonnait d'une méthode très en vogue qui consiste, dans l'opérette, à écrire la musique d'abord pour y « plaquer » des paroles ensuite ? — Alors que chez lui, c'est, au contraire, le texte qui engendrait spontanément la ligne mélodique.
Logiquement, ne devrait-il pas en être toujours ainsi ?
MÉLISANDE
Le premier janvier 1899, Albert Carré est appelé à succéder comme directeur de l'Opéra-Comique à Carvalho qui venait de mourir. Le choix était heureux : mêlé par son talent d'auteur dramatique au monde de la musique, ayant fait représenter divers ouvrages en collaboration avec des musiciens, apparenté lui-même à des librettistes fameux dont il portait le nom, directeur avisé qui venait de faire ses preuves au Vaudeville, possédant le goût de la mise en scène, Albert Carré se trouvait le mieux désigné pour occuper un tel poste dans un théâtre où s'ouvraient tant de perspectives nouvelles et multiples qu'il allait savoir saisir. L'école symphonique française, d'une part, et de nouveaux musiciens dramatiques de l'autre, ouvraient au théâtre lyrique des horizons qui ne pouvaient passer inaperçus à un esprit aussi avisé que celui d'Albert Carré.
Le nouveau directeur n'en sentit pas moins aussitôt la nécessité de s'adjoindre un musicien éclairé et indépendant et nul n'était plus apte à l'aider dans sa tâche qu'André Messager, assez à l'écart des officiels et possédant des antennes dans les milieux musicaux les plus divers. Certains s'étonnèrent de ce choix car la musique légère consacrait difficilement à cette époque la notoriété d'un compositeur ! Mais Carré savait combien diverse était la personnalité de son collaborateur de la Basoche ; il devinait en lui le chef d'orchestre et n'hésita pas à lui confier la direction de la musique à l'Opéra-Comique. C'était un coup de maître et les événements le prouvèrent aussitôt.
Dès lors, Messager oublia ses propres succès et, renonçant à travailler pour lui-même, n'eut plus qu'un but : se consacrer à la musique des autres et unir tous ses efforts à ceux d'Albert Carré pour mettre en valeur les œuvres de ses confrères. Non seulement il leur apportera l'aide de son goût et de ses précieuses connaissances musicales, mais encore il payera de sa personne et tiendra à monter lui-même au pupitre pour en diriger les exécutions. Qu'il nous suffise de citer Fervaal de Vincent d'Indy, la Fille de Roland d'Henri Rabaud, Louise de Gustave Charpentier (*), Grisélidis de Massenet, Pelléas et Mélisande de Claude Debussy.
(*) Gustave Charpentier ! qui du haut de sa mansarde a su colorer la plus saisissante des fresques populaires : sa Louise, âme de notre Paris...
Charpentier ! dont les « Impressions d'Italie » sont baignées du chaud soleil méditerranéen, pittoresques ou ardentes, l'auteur de tant de pages magnifiques, marquées de sa puissante personnalité !
Il restera l'une des hautes figures de son temps avec Gounod, Bizet et Massenet (qui fut son maître), tous musiciens dramatiques inspirés, clairs et directs.
Les instants que ses fervents vivent auprès de lui ? Pour ma part ils sont inoubliables, dans leur cordiale intimité. Depuis qu'il a pu retrouver son vieux logis montmartrois, il s'y enferme, n'entr'ouvrant sa porte que si l'on montre patte blanche, accessible seulement à quelques familiers auprès desquels il devise et observe. Il scrute les époques qu'il a vécues, les apprécie, les compare et, lucide, juge des hommes comme des événements, qu'il s'agisse de musique ou du reste... L'âge ne l'a pas atteint, sa finesse d'esprit demeure entière, son regard vif et perçant vous interroge... Ce regard ! celui que j'ai vu luire chez Massenet, chez Maurice Ravel, celui qui, d'après ses portraits, illuminait Berlioz, celui d'où jaillit l'étincelle...
***
Ce fut en 1893 que Messager rencontra Debussy chez son ami l'éditeur Hartmann. Aussitôt, avec son esprit curieux de toutes nouveautés musicales, il fut conquis par ce qu'apportait l'art si personnel du jeune compositeur.
Déjà il avait contribué à révéler au grand public, dans un concert qu'il dirigea au Vaudeville, le Prélude à l'après-midi d'un faune, qui n'avait été donné qu'une seule fois à la Société Nationale, sous la direction de Gustave Doret. Il vit donc naître et grandir la partition de Pelléas et Mélisande, dont il va devenir le véritable révélateur.
On ne saura jamais assez quel labeur Messager dépensa à mettre ce chef-d’œuvre sur pied, passant des nuits près de Debussy à corriger les parties d'orchestre, avec quel enthousiasme et quelle confiance il parvint, ainsi qu'Albert Carré, à l'imposer au public. Dans de tels moments il s'oublia lui-même, se donnant tout entier à son généreux altruisme musical. Debussy ne s'y trompait pas, puisqu'il dédia sa partition : « A la mémoire de Georges Hartmann et en témoignage de profonde affection à André Messager. »
***
La première de Pelléas eut lieu le 30 avril 1902, avec Mary Garden (Mélisande), pour laquelle Messager éprouvait une admiration particulièrement attentionnée, tant son charme et son talent étaient grands ! La distribution réunissait autour de Mary Garden des artistes incomparables, en tête desquels notre cher Jean Périer (Pelléas) qui révéla en cette occasion ses dons admirables de comédien lyrique ; c'est lui que Messager avait fait engager à l'Opéra-Comique pour la création de Pelléas en se souvenant fort à propos de son exquis Florestan de Véronique. Dufranne dans Golaud et Vieuille dans Arkel complétaient un ensemble excellent, judicieusement choisi par Messager et Carré.
***
La création de Pelléas et Mélisande reste pour notre maître et ami l'un de ses meilleurs titres de gloire. Son souvenir demeurera à jamais attaché à cette œuvre qui symbolise toute une époque et si l'on devait oublier un jour la musique charmante de Messager, le chef-d’œuvre de Debussy qu'il sut découvrir et qui fut compris grâce à lui, rappellerait son nom et ses œuvres aux générations futures. Elles reliront alors les gracieuses pages du compositeur de la Basoche et d'Isoline en y retrouvant l'une des formes de la bonne tradition française, dans un art certes bien différent de celui de Pelléas, mais clair, mélodique et limpide qui, lui aussi, s'exprime avec les meilleures ressources d'une technique appropriée à son style.
***
A propos de Debussy, dirai-je quelques souvenirs personnels auxquels fut mêlé l'auteur de Pelléas ?
Mes relations avec lui furent excellentes, quoiqu'assez rares ; il n'était pas de ma génération et j'eus rarement l'occasion de le voir, si ce n'est autour de Messager.
Mais mon admiration pour son art fut immédiate et ne fit que s'accroître.
Le parfum de son extraordinaire personnalité était enivrant au point que, l'ayant respiré, tout autre arome risquait de paraître fade. Beaucoup de jeunes musiciens s'en grisaient et Debussy devint pour eux l'objet d'une ferveur passionnée, d'un véritable culte sur l'autel duquel ils étaient tentés de s'immoler.
***
Pourtant l'un d'eux, Maurice Ravel, n'entendait pas s'offrir en holocauste. Quoique de nature très différente, il paraissait, de prime abord, devoir subir, lui aussi, cette fascination — même analogie dans l'instrumentation, le chatoiement harmonique, la quintessence d'expression. Moins poète peut-être, mais avec plus de variété dans l'invention, de prestigieuse virtuosité et d'égale sensibilité harmonique, Ravel se voyait injustement reprocher — en dehors des debussystes et des fauréens — son esprit paradoxal et une affirmation de soi qui n'était pas sans agacer ses adversaires. Il passait à leurs yeux pour présomptueux et comme ayant entrepris de réaliser des projets qui leur semblaient chimériques. Ils l'accusaient d'ambitieuses visées, se moquant de ses buts audacieux de novateur. Mais Ravel, confiant dans son étoile ne se découragea pas et soutenu par l'admiration grandissante de son entourage prit son envolée en toute indépendance (*).
(*) Rappellerai-je ici toutes les attaques dirigées contre Ravel dans une certaine presse et l'affront qu'on lui fit en l'éliminant du Concours de Rome ?
***
Plus tard, en 1912, quand viendra Ma mère l'Oye au Théâtre des Arts, Ravel m'enverra, à l'adresse de Messager, quelques lignes qui montrent sa conscience d'artiste et le prix qu'il attachait à l'approbation musicale de celui-ci :
6 février 1912.
« Cher ami,
J'ai retenu une loge pour demain mercredi (n° 17, je crois. En tous cas elle est au nom de Messager).
Tâchez de le décider à venir. Je serai si heureux d'avoir enfin — zut ! mon stylo n'a plus d'encre — d'avoir enfin l'estime de ce parfait musicien. Mais je ne veux à aucun prix m'attirer cette estime autrement que par la sincérité de mon travail. — Dites-lui simplement ce qu'on dit dans ce cas là : que je serai ravi... etc., mais que c'est sincère.
Bien cordialement à vous.
Maurice Ravel. »
Messager vint et sut apprécier l'adorable partition.
***
J'avais suivi les dernières répétitions de Pelléas et, le jour de la générale, je vis Debussy dans le bureau de Messager, pendant un entr'acte. Fièvre, émotion, enthousiasme, toute la gamme des sensations les agitait l'un comme l'autre. Je la partageais avec eux et j'avoue, dès les premiers tableaux, avoir ressenti l'impression immédiate que donne un véritable chef-d’œuvre. Aussi est-ce avec la plus profonde sincérité que j'exprimai au compositeur mon admiration devant les horizons nouveaux qui se dégageaient de sa musique. En me remerciant, il me répondit textuellement : « J'ai voulu prouver que le système de Wagner était faux ! » J'avoue que ces paroles me frappèrent sans me convaincre et si je compris ce jour-là que Debussy venait d'échapper à l'empreinte wagnérienne qui asservissait alors nombre de musiciens, je vis clairement que le « système de Wagner » et le sien — expressions de leur génie respectif — n'étaient faux ni l'un ni l'autre et ne se nuisaient en rien dans l'admiration que j'éprouvais pour chacun d'eux !
Debussy, très paradoxal, me dit une autre fois que Wagner « n'avait commencé à y voir clair qu'avec Parsifal » et un autre jour — alors que nous dînions chez Madame Messager — qu'il ignorait tout de la musique de Fauré.
Il est vrai que Fauré que je rencontrai le lendemain de Pelléas me confia à son tour sa stupeur devant « un tel succès de curiosité » auquel, selon lui, tout contribuait grandement, jusqu'à l'accent étranger de Miss Mary Garden, interprète du rôle de Mélisande...
Et qu'aurait pensé à son tour Wagner de Debussy ? — Secret d'outre-tombe !
L'AMITIÉ DE DEBUSSY
L'affection qui unissait Messager et Debussy au moment de Pelléas et Mélisande se révèle dans les lettres que ce dernier écrivit à son ami après la première de Pelléas. On sait que Messager, après avoir fait toutes les études de l'ouvrage, ne conduisit qu'une seule fois, ayant dû quitter le pupitre le lendemain même, obligé de partir pour Londres où il dirigeait depuis 1901 l'Opéra de Covent Garden dont la saison avait lieu annuellement de mai à juillet. Dès ce moment, c'est par lettre que Debussy le met au courant de la marche des représentations. Voici quelques fragments de cette correspondance (*).
(*) L'enfance de Pelléas, Jean Messager, Ed. Dorbin aîné.
9 mai 1902 — « Très cher ami, depuis que vous êtes parti je suis à peu près aussi morne qu'un chemin où il ne passe plus personne et j'ai chroniquement l'envie de vous voir.
... Vendredi salle superbe, y compris M. Jean de Reszké. Public respectueux... Après le quatrième acte trois rappels viennent récompenser tous ces braves gens de leurs efforts.
Pour conclure : une bonne soirée où il n'a manqué que vous... cela d'une façon totale ! Je m'explique : vous aviez su éveiller la vie sonore de Pelléas avec une délicatesse tendre qu'il ne faut plus chercher à retrouver, cal il est bien certain que le rythme intérieur de toute musique dépend de celui qui l'évoque, comme tel mot dépend de la bouche qui le prononce... Ainsi telle impression de Pelléas se doublait de ce que votre émotion personnelle en avait pressenti, et lui donnait par cela même de merveilleuses « mises en place ». C'est sûrement quelque chose d'introuvable vous le savez aussi bien que moi. Je sais que je ne fais qu'aviver mes regrets ; mais, tant pis ! Il faut que vous le sachiez une fois pour toutes aussi bien que ma fidèle amitié.
Claude Debussy. »
De tels éloges, entièrement mérités et décernés par un grand artiste à un autre — très grand lui aussi — attestent bien toute la ferveur d'une amitié reconnaissante.
Le 21 mai 1902, Debussy écrit :
« Je ne vous oublie pas... J'ai pour cela des raisons dont le détail dépasserait la valeur d'un tome du Dictionnaire Larousse. Simplement j'ai été encombré de choses ennuyeuses et protocolaires. Dieu sait combien votre pauvre ami est peu fait pour ces jeux. Fiche le camp pour Londres, passer une de ces jolies soirées de jadis avec Messager, voilà qui arrangerait tout si « Dieu avait pitié du cœur des hommes (*). » Enfin !...
C'était hier la septième représentation de Pelléas... On a refusé du monde. (Expliquez ça comme vous pourrez.) Pour compenser, l'exécution a été faiblarde.
... Une très belle soirée tout de même, paraît-il, et un grand succès. Personne ne s'aperçoit plus que Messager n'est pas là... (C'est à pleurer) et pourtant, ça n'est déjà plus ça. (Je vous assure que je mets toutes mes forces à combattre le moindre laisser-aller.) »
(*) Parole profonde et angoissante du vieil Arkel dans Pelléas.
Dans une autre lettre, à propos de l'édition de la partition :
« Vous me direz votre avis là-dessus. Pelléas et Mélisande ne sachant rien faire sans le conseil de leur grand-père bien-aimé. »
Et plus loin :
« J'ai oublié de vous dire que nous avons fait 7.400, vendredi dernier ! Aussi vous ne pouvez vous figurer combien on a de respect pour moi ! — Avoir fait Pelléas ça n'avait qu'une signification anecdotique, mais faire recette, voilà qui est bien ! — C'est scandaleux ! En somme, tous ces gens-là ont une esthétique dont la formule se traduit par un chiffre. Il n'y a pas de quoi leur en vouloir. »
Sursaut douloureux où Debussy se cabre devant tant de prosaïsme, et qu'auront ressenti la plupart des compositeurs joués sur nos scènes lyriques.
***
Parmi ces compositeurs, suivons l'un d'eux, sans en désigner aucun, à travers quelques-unes de ses tribulations, en nous reportant au processus habituel :
Dès qu'il entre en répétition et plus les études de son ouvrage s'animent et progressent, il éprouve d'abord l'agréable sensation d'avoir en main tous les rouages du théâtre. A l'approche de la première, la machine tourne à plein rendement, la nef frémissante va s'élancer ; c'est lui qui commande. L'émulation a gagné chacun, tous concourent ardemment au départ quels que soient leur poste et leur tâche ; la scène est un socle sur lequel s'est édifié son rêve de créateur. Instant enivrant !
Le lendemain tout change : sans transition, c'est le tour d'une autre œuvre qui va succéder aussitôt à la sienne, et dont l'auteur éprouvera les mêmes joies et les mêmes déceptions.
C'est alors qu'il va connaître l'angoissante question des recettes, ces recettes auxquelles Debussy fait allusion. Il consultera chaque jour l'affiche et pour peu que la location faiblisse il verra avec angoisse ses représentations s'espacer, son œuvre se dissocier par des changements de distribution auxquels il reste étranger ; le directeur se lassera, notre auteur deviendra presque un intrus. De sa loge, autre salon où l'on cause, le concierge du théâtre le regardera passer avec compassion !
Ainsi s'achève presque chaque fois le beau rêve ! A moins qu'un directeur avisé... Pour Pelléas, ce fut Carré, guidé par Messager.
***
Mais dans bien des cas, Carré, si bon directeur qu'il fût, n'apportait pas tant d'empressement à maintenir les ouvrages sur l'affiche (quoique pour ma part je n'eus qu'à me louer de lui à ce sujet, si ce n'est pour le Roi aveugle qu'il donna peu de fois à l'Opéra-Comique, malgré les encouragements qu'il reçut). Avec quelle ironie il ne manquait pas de dire à qui voulait l'entendre : « Lorsque je joue un auteur je fais un ingrat et quatre-vingt-dix-neuf mécontents ! » Peut-être oubliait-il, à son tour, qu'il était là pour le jouer, cet auteur. Mais il ne manquait pas d'invoquer la nécessité des recettes, compensées à cette époque par le jeu des abonnements qui, disait-il, ne lui permettaient guère, dans la plupart des cas, d'aller plus loin, à l'aventure. Sa joie de monter des nouveautés était telle qu'il passait de l'une à l'autre sans trop insister, souvent avec promptitude, remplissant de tourment et d'amertume les pauvres auteurs qu'il abandonnait après les avoir si bien exaucés !
Souvenons-nous néanmoins — non sans regrets — de cette époque. Epoque heureuse ! c'était l'âge d'or auprès de celle que nous traversons... Qui aurait pu penser qu'un jour viendrait où la misère des temps interdirait presque toute création sur nos scènes lyriques et qu'il ne resterait de tant de beaux espoirs que quelques rares ouvrages recherchés inlassablement par les foules, destinés eux-mêmes à s'user peu à peu, imbattables sur le chapitre des recettes et seuls susceptibles de faire vivre toutes les corporations du spectacle, sauf celle de nos malheureux compositeurs ? (*) Souhaitons que les directeurs actuels, certainement bien intentionnés, puissent du moins parvenir à maintenir sur l'affiche — comme Carré le fit pour Pelléas — quelques œuvres lyriques ayant fait leurs preuves et qui soient capables de concourir au renouvellement indispensable du répertoire.
(*) Il faut faire exception pour les spectacles de ballets qui jouissent présentement d'une grande vogue à l'Opéra.
***
Le 26 juin 1902, nous dînions dans l'intimité avec Debussy et sa femme. C'était chez Messager, boulevard Malesherbes, mais celui-ci était à Londres et c'est Mme Messager qui, en son absence, avait eu l'heureuse idée de nous réunir ce soir-là — nous n'étions que cinq convives. Dans la soirée — instants inoubliables — Debussy nous fit entendre plusieurs scènes de Pelléas. C'est ce soir-là qu'il nous révéla son ignorance — peut-être un peu trop systématique ! — de la musique fauréenne et qu'il nous fit sa profession de foi sur Wagner, révélations auxquelles nous avons fait allusion précédemment. Le lendemain, 7 juin, il s'empressait d'informer Messager de cette réunion, en déplorant son absence :
« Pendant que vous chantiez Pelléas (Dieu sait comme j'aurais voulu être là et... quelle fumée !) savez-vous bien que je chantais, avec cette voix moribonde que vous connaissez, le même Pelléas chez Messager, 174, boulevard Malesherbes ? (Télépathie, tu n'es pas un vain mot !) Et l'on a regretté Messager avec des larmes dans la voix ! »
***
Dans une autre lettre il est question du voyage que Debussy entreprit pour aller retrouver son ami pendant quelques jours à Londres :
« Le 8 juillet 1902 — Je n'ai pas une âme de bronze et votre lettre évoque de telles joies qu'il me devient tout à fait impossible de résister à ce qu'elle me propose. Donc, samedi prochain, je prendrai le train de 9 heures du soir et dimanche il y a beaucoup de chances pour que je puisse revoir enfin votre chère et amicale figure.
Ah ! très cher ami, j'ai tant de choses à vous dire que je n'ai pas la patience de les écrire... Quand je pense que je vous verrai dimanche, mon cœur bat comme un fou jusqu'au fond de ma gorge (si Maeterlinck veut bien me permettre de m'exprimer d'après lui.)
Mais assez de vaine littérature et, en attendant, laissez-moi vous embrassez tendrement. »
Puis il écrit :
« Vous allez m'accuser d'être sentimental comme une modiste, mais j'avoue que d'être privé de vous depuis si longtemps me fait désirer vos lettres presque maladivement. »
Et aussi :
« Merci, très cher ami, de m'avoir répondu tout de suite. Quand je suis sans nouvelles de vous, je ressemble, je vous l'ai dit, à un petit chemin où personne ne passe plus (vous voyez ça d'ici). »
***
A l'adresse de sa Mélisande, engagée au même moment par Messager à Covent-Garden pour y chanter Louise en représentations (sans jamais avoir abandonné son rôle à l'Opéra-Comique) de nombreuses gracieusetés qui n'était pas sans chatouiller agréablement Messager :
« Mademoiselle Garden, que j'envie un peu parce qu'elle est près de vous, a dû vous remettre des photographies et une partition ? »
Dans une autre :
Le succès de « notre Garden » ne m'étonne pas ; il faudrait, autrement, avoir des oreilles bouchées à l'émeri pour résister au charme de sa voix. Pour ma part, je ne puis concevoir un timbre plus doucement insinuant. Cela ressemble même à de la tyrannie tant il est impossible de l'oublier. »
Et plus loin :
« Nous vous embrassons tous les deux en vous priant d'en conserver un peu pour Miss Garden, Reine d'Allemonde et autres lieux. »
Aucune louange, parmi toutes celles prodiguées par Debussy n'était plus propre à enchanter Messager que celle-ci !
Le 8 septembre 1902, à propos d'une audition de la Damoiselle élue chez Mme de Saint-Marceaux :
« L'idée de Mme de Saint-Marceaux est assurément charmante, en ce que vous dirigeriez ; seulement le quatuor me paraît faible... pour les divisions qui sont nombreuses ! De plus, il y a deux harpes, tous les bois, y compris une clarinette basse ; d'ailleurs, si vous jugez que cela puisse marcher, je m'abandonne entièrement à ce que vous déciderez. »
Enfin, une attention d'autant plus précieuse de la part de Debussy qu'il vivait concentré sur lui-même :
« Avez-vous été content de Véronique ? Je puis vous avouer maintenant que, seules, des raisons très misérables m'ont empêché de rester jusqu'à votre première (*), non pas que ma présence vous était nécessaire, Dieu merci, mais que mon amitié pour vous en aurait été satisfaite. »
(*) Il s'agissait de la création de Véronique à Londres, à laquelle Debussy regrettait de n'avoir pu assister.
Véronique ! Délicate pensée et bienveillant égard de l'auteur de Pelléas pour son ami. Combien en avons-nous vus auprès desquels il fallait d'abord s'excuser d'exister pour que les relations restassent possibles (*) !
(*) Nous savons par René Peter que Debussy, même bien avant Pelléas, ne manquait jamais de faire l'éloge de la musique de Messager. Ravel m'en disait autant de son côté.
DANS L'INTIMITÉ
Après une série de créations retentissantes, Messager quitta ses fonctions à l'Opéra-Comique en 1903 pour conserver celles de Covent-Garden jusqu'en 1907.
C'est à ce moment qu'il revint à Montivilliers où il n'avait jamais cessé de se plaire, avec sa femme et sa fille Madeleine, mais non plus aux Rochers, mes parents ayant acquis une villa voisine dont les jardins bordaient les nôtres, qui fut baptisée « Villa Madeleine » dans la circonstance. Il vint s'y installer avec les siens pendant de nombreux étés et nous voisinâmes dans une intimité où la musique trouvait encore la meilleure part. Ce fut pour lui l'époque heureuse des Dragons de l'Impératrice et de Fortunio qu'il composa auprès de nous pendant ses séjours en Normandie.
De cette demeure assez sommaire et rustique, Mme Dotie Messager avait su faire, comme à Maidenhead, un nouveau « home », aussi séduisant. Dès qu'arrivait septembre, sous les ardeurs d'un joyeux feu de bois, nous nous réunissions autour du piano. Messager, comme par le passé, nous jouait sa musique et le plus souvent selon son habitude, celle des autres. Il se complaisait alors dans Liszt et César Franck.
Ce fut le moment où, enfermé de mon côté dans la villa voisine, j'écrivais fiévreusement la musique du Roi aveugle, ma première œuvre théâtrale, et un peu plus tard celle de Monna Vanna.
***
Le Roi aveugle, composé sur une légende scandinave d'après une nouvelle d'Hugues Le Roux, avait été reçu à l'Opéra-Comique en 1904. Il y fut représenté en mai 1906 et, ainsi qu'il est d'usage pour les débuts favorables d'un compositeur, la presse salua sans réticence les qualités qu'elle voulut bien apercevoir dans cet essai d'un jeune musicien. C'est généralement par la suite qu'elle nous demande bien davantage et souvent tout autre chose que ce que nous avons voulu lui présenter !
Messager s'intéressa grandement au Roi aveugle car c'est lui qui, avec Fauré, en avait parlé le premier à Albert Carré. Il tint à assister à l'audition que j'en donnai à celui-ci et se réjouit avec moi de la réception de l'ouvrage. Au lendemain de la première, il m'écrivit de Londres des mots affectueux et particulièrement cette phrase :
« Ton succès m'a été droit au cœur et je réclamerai toujours une toute petite part dans ton éducation musicale. »
Combien j'y accédai volontiers !
***
Pour Monna Vanna ce fut plus compliqué, car il s'était effrayé tout d'abord de me voir entreprendre une œuvre d'une telle importance. Il craignait, disait-il, que je n'eusse pas « la maturité suffisante » (c'était sa propre expression) pour y réussir. Ironie des choses ! il évita même de s'y intéresser pendant que je commençais à l'écrire, affectant de n'en point parler et croyant sincèrement que je n'en viendrais jamais à bout. Ma peine était extrême, mais je ne me décourageai pas. Ce fut Dotie Messager qui rompit la glace... m'ayant demandé de lui montrer ma partition, elle pria son mari de l'entendre à son tour. Messager y consentit, écouta, distraitement d'abord, puis en devenant de plus en plus attentif. Je ne pensais pas ce jour-là qu'il songerait bientôt à Monna Vanna pour l'Opéra !
***
Les soirées de Montivilliers se renouvelèrent souvent et j'y entendis ses nouvelles partitions. Ayant maintenant quelques loisirs réels, il s'était remis à la composition et avait demandé un livret à ses excellents collaborateurs des P’tites Michu et de Véronique : ce fut une opérette en trois actes, les Dragons de l'Impératrice qu'il se mit à écrire d'un trait dans sa villa et qui fut jouée le 13 février 1905 au théâtre des Variétés.
Tandis qu'il composait, j'étais pris tout entier par les accents pathétiques et douloureux de Guido Colonna et de Prinzivalle dans Monna Vanna et c'était un curieux contraste pour moi, autant qu'une agréable récréation, d'entendre s'échapper de la maison voisine des grappes d'harmonies joyeuses et rythmées qui, de loin, me charmaient les oreilles dans les instants où je me plaisais à les percevoir en me délassant de mes propres élans lyriques .
J'ai conservé des Dragons de l'Impératrice un joli souvenir. C'était un opéra-comique rempli, comme ses aînés, de séduisants croquis ; une fine verve y coulait sans cesse et je crois que le directeur qui le reprendrait ne manquerait pas d'en être récompensé. L'époque du Second Empire où se déroulait l'action contribuait à l'agrément du spectacle tant par son luxe frivole que par l'insouciante gaîté qui s'en dégageait. Les librettistes, Duval et Vanloo vinrent à Montivilliers quand la partition fut achevée et je n'ai pas oublié quelle fut leur joie et la nôtre en l'entendant.
Certains morceaux des Dragons de l'Impératrice sont du meilleur Messager. Je citerai les couplets du « Petit frisson » chantés au deuxième acte par Germaine Gallois. L'interprétation, particulièrement bien choisie, comprenait aussi la charmante Mariette Sully (créatrice de Véronique) et l'inimitable Prince, devenu plus tard le populaire « Rigadin » de l'écran.
***
Charles Prince fut mon ami d'enfance ; je lui dois mes premières joies d'auteur. Tout au début de sa carrière — et de la mienne — il me confia le soin d'écrire pour lui la musique d'une pantomime. Il était tout particulièrement doué pour ce genre ; sa mimique si amusante, le goût qu'il avait pour la musique, qu'il tenait de sa famille — laquelle vivait dans l'intimité de Chabrier — et son invention scénique l'y prédisposaient. Il s'adjoignit deux camarades comédiens : Mlle Féral et son camarade Garbagni. Puis l'on s'entendit avec nos librettistes Adrien Vély et Armand Lévy pour mettre sur pied cette œuvrette. On lui donna comme titre : la Leçon interrompue. Nous eûmes la chance de trouver un directeur et même un théâtre : le directeur c'était Bodinier et le théâtre « la Bodinière » — car l'un n'allait pas sans l'autre ! — Tous ceux de ma génération se souviennent de cette petite salle de la rue Saint-Lazare, située dans le fond d'une galerie où l'on exposait des tableaux : c'était « le Théâtre d'application » où se succédaient les conférences, les auditions de tous genres et quelques menus spectacles où se révélèrent des artistes tels que Tarride, Jean Périer, Marguerite Deval, Prince (cité plus haut). Je connus là mes premières émotions d'auteur et aussi de pianiste puisque j'accompagnai moi-même les rythmes et les gestes de mes interprètes. C'était le temps où la pantomime était encore en vogue, spécialement au « Cercle funambulesque » pour lequel j'en écrivis l'année suivante une autre, plus importante, interprétée par les artistes d'un cercle d'amateurs : « la Rampe » où de fort jolies femmes voulurent bien prêter bénévolement leur concours. Délicieuse époque où nous goûtions véritablement la joie de vivre ! Je n'ai pas oublié nos compagnons de plaisir : André Desfossés, Anina, Citroën, Alphandéry, Mapou, Léonce de Joncières, Franck, Houry, Diplaris et Alfred Janssens (deux fidèles de Montivilliers), leurs belles amies, Renée de Presles, Marcilly et bien d'autres, jeunes et charmantes ! Les répétitions duraient très longtemps et chacune était suivie d'un joyeux souper au « Petit Pousset » qui se prolongeait assez tard dans la nuit et me faisait arriver un peu endormi le matin aux classes d'harmonie de Raoul Pugno. Mais celui-ci était si bienveillant, si paternel et son enseignement si profondément musical, qu'on se trouvait tout ragaillardi à son contact !
Cette parenthèse sur Charles Prince et les bons jours de nos vingt ans m'éloigne un peu des Dragons de l'Impératrice et du théâtre des Variétés où mon ami d'enfance fit une carrière splendide sous la direction Samuel. Cette scène connut ensuite de grands succès avec le répertoire d'Offenbach, celui de Flers et Caillavet (dont les opérettes de Claude Terrasse) et plus tard avec Ciboulette de Reynaldo Hahn.
FORTUNIO
La grâce du talent de Messager devait se compléter harmonieusement avec la délicatesse et l'émotion lyrique d'un Alfred de Musset. Combien, ayant relu Musset, se sont sentis attirés par son théâtre et n'ont pas craint d'en tirer des œuvres lyriques ! Je me souviens qu'Henry Bataille me vantait éloquemment le théâtre de Musset et m'affirmait que toutes les pièces qui le composent devraient être mises en musique. Robert de Flers, lui aussi, était de cet avis et c'est lui qui proposa à Messager de tirer du Chandelier une comédie musicale : ce fut Fortunio. Quoique Offenbach ait déjà composé la Chanson de Fortunio, Messager ne s'arrêta pas à ce détail et nos auteurs — en collaboration avec Caillavet — se mirent au travail.
C'est encore à Montivilliers, dans la villa Madeleine, que fut composée la plus grande partie de Fortunio, et le 5 juin 1907, Albert Carré représentait l'ouvrage à l'Opéra-Comique. Les principaux rôles furent créés par Mme Marguerite Carré, délicieuse Jacqueline, M. Francell qui venait, quelques mois auparavant, de sortir du Conservatoire et fut un Fortunio jamais égalé, Dufranne, Fugère et Jean Périer.
Aux dernières répétitions, je pus apprécier le talent que déployaient ces interprètes dans un ouvrage où la comédie la plus fine se joint aux chants les plus gracieux. Il y a là un équilibre que Messager a rarement dépassé. L'instrumentation de l'ouvrage est d'une finesse de touche et d'écriture sans pareille. Aussi Fortunio remporta-t-il un vif succès et les célèbres vers de Musset : « Si vous croyez que je vais dire qui j'ose aimer », mis en musique par Offenbach dans la Chanson de Fortunio, offrirent à Messager l'occasion d'une page non moins touchante composée sur les mêmes paroles. Nous citerons aussi « la vieille maison grise », nuancée dans une adorable émotion (*).
(*) C'est après Fortunio que selon les conseils d'Henry Bataille l'idée me vint de chercher à mon tour dans le théâtre de Musset une autre pièce susceptible d'être mise en musique. Mon choix s'arrêta sur Carmosine. Refusée par Carré à l'Opéra-Comique, mon ouvrage trouva asile en 1912 à la Gaîté-Lyrique, grâce à l'accueil de MM. Isola frères.
Messager suivit les répétitions, fort surpris de l'attitude hostile de Carré envers Carmosine, alors que celui-ci avait déjà essayé de brouiller les cartes en réclamant intempestivement Monna Vanna pour l'Opéra-Comique... Je fus pris entre l'arbre et l'écorce, victime des rivalités de toutes sortes qui séparaient ces deux directeurs, amis hier et ennemis le lendemain !
Voici ce qu'écrivait Gabriel Fauré au lendemain de la générale de Fortunio dans le « Figaro » :
« Je n'étonnerai personne de ceux qui, comme moi, connaissent, suivent et aiment M. Messager depuis longtemps, en disant que Fortunio est d'une saveur exquise, qu'il est la poésie, la fraîcheur et la jeunesse mêmes. On y rencontre des pages de gai mouvement, comme le premier acte, d'autres où la poésie découle simplement, comme la péroraison du troisième acte, d'autres enfin où le pittoresque de couplets mordants et spirituels surprend l'attention, la domine et entraîne la joie à sa suite.
L'invention mélodique, alerte, fertile, abondante, n'abdique jamais sa distinction native ; l'invention rythmique n'est pas moins piquante, et l'harmonie, sans recherche vaine pourtant, fourmille de détails heureusement inventés ; quant à l'orchestre, léger mais sonore, brillant et spirituel, il court, va et vient avec une ingéniosité, une grâce tout à fait séduisantes.
Ai-je besoin d'ajouter que Fortunio, avec des qualités si rarement réunies, a admirablement réussi ; c'est un succès, un très grand succès et nul ne s'en réjouit plus que moi.
Quand M. Messager est apparu au pupitre (car c'est lui qui a conduit l'orchestre) le public tout entier l'a acclamé et l'orchestre lui-même, retrouvant avec joie son ancien chef, lui a fait une ovation. »
Comme on le voit, l'amitié qui unissait Messager et Fauré depuis leur enfance ne se démentait jamais. Elle restera une rare et touchante exception entre grands compositeurs ! Il est vrai que leurs talents et leurs activités, très dissemblables, s'exerçaient dans des sphères fort différentes et ne pouvaient guère se porter ombrage. Ils ne craignaient pas de s'admirer ni de se louer réciproquement pour le plus grand bien de leur affection qui était spontanée, réelle et sans nuages.
Sans qu'il y pensât aucunement lui-même, la renommée de Messager y trouva son compte et il en fut presque immunisé. Mieux encore, on le loua, on l'encouragea, on l'aima ; et parmi les coups de veine dont il se félicitait, celui-ci fut peut-être le plus inattendu !
***
La classe de Fauré au Conservatoire fut pour nous, ses élèves, une source d'enseignement et d'émulation féconde : la forme, la trouvaille harmonique ou d'écriture, et par-dessus tout la qualité des idées le satisfaisaient. Il était simple et attentif et notre humiliation ou notre récompense provenaient de son attitude devant nos travaux : son approbation réservée récompensait notre effort, son silence nous glaçait. Ce n'était jamais l'enthousiasme ni l'ironie espiègle de Massenet ; Fauré examinait longuement, sans rien dire, la page qu'on lui présentait (le plus souvent musique pure ou vocale), puis il apercevait nettement la qualité ou le défaut essentiels et nous les indiquait sobrement d'un mot. Mais ce mot nous dévoilait à lui seul tous les horizons... J'ai su, par moi-même, qu'il pensait à nous après, en dehors de la classe, et le rencontrant le lendemain, il me disait : « Vous savez, dans votre andante, il faudrait plus de mouvement dans la seconde idée. » Ou bien encore : « Vous avez raison d'écrire de la musique de chambre, car elle est celle qui ne vieillit pas. Mon premier quatuor, a été édité grâce à ma Berceuse — l'éditeur a pu ainsi en couvrir les frais ! »
Cependant il était absolu sur bien des points, et un jour où Maurice Ravel lui soumettait une suite d'accords en appogiatures non résolues, il l'arrêta en lui disant : « Je ne puis admettre ceci, car je crois avoir été aussi loin qu'on peut dans cette voie ! » Et Dieu sait combien il appréciait Maurice Ravel !
***
Messager, lui, n'avait pas à dire : halte ! Ayant suivi pas à pas l'évolution, il se contentait d'en goûter toutes les formes, sans penser que parmi les chefs-d’œuvre, se placeraient bientôt, elles aussi, ses pages sensibles et gracieuses.
A L'OPÉRA
MONSIEUR LE DIRECTEUR
Quelques mois après Fortunio Messager était promu officier de la Légion d'Honneur. Cette distinction lui était accordée au moment même où la direction de l'Opéra allait lui être confiée en association avec M. Broussan, et en remplacement de Gailhard, le 26 janvier 1907.
Un véritable courant d'opinion l'avait conduit à l'Opéra : les cercles musicaux, les clubs parisiens, la haute société et le monde politique étaient unanimes à approuver sa nomination et tout le désignait comme grand favori.
Ce fut, je crois, Briand qui signa sa nomination en qualité de Ministre des Beaux-Arts. Le chagrin de Gailhard était grand : il ne se consolait pas d'abandonner une maison à laquelle il avait consacré près de vingt-cinq années de sa vie et l'on doit reconnaître que sous sa direction, l'Opéra avait connu une période de grande prospérité (notamment pendant l'exposition de 1900). Il était le premier qui avait fait entrer Wagner au répertoire ainsi que certains ouvrages de Massenet et de Saint-Saëns. Mais Gailhard n'avait pas toujours consenti à se plier aux volontés ministérielles et l'on raconte qu'il n'encouragea pas suffisamment une grande interprète, Mme Rose Caron, à laquelle s'intéressait particulièrement Clémenceau. Par une fatalité curieuse, celui-ci était au pouvoir quand se posa la question du renouvellement du privilège de l'Opéra. Gailhard fut évincé. Dix ans plus tard Gheusi connut le même sort, pour d'autres raisons, à l'Opéra-Comique, et le décret était signé de la même main. Comme on le voit le Tigre n'hésitait pas moins à culbuter les directeurs des subventionnés que ses adversaires politiques !
A propos de la chute de Gailhard je dois ajouter que la cause n'en fut pas seulement dans l'opposition de Clémenceau, mais aussi dans la nécessité où l'on se trouvait alors de s'affranchir d'une certaine omnipotence officielle et réactionnaire qui, sous sa direction, tendait à tenir à l'écart les indépendants. Je n'entends nullement discriminer le mérite des élus du temps, mais il faut bien constater que tout ce qui n'était pas « eux » se trouvait alors frappé d'exclusive. Depuis, tout a changé et nous assistons dans tous les arts au mouvement inverse.
***
Messager entra en fonctions à l'Opéra le Ier janvier 1908. Il était entouré de dévoués collaborateurs parmi lesquels M. Marius Gabion, publiciste et ami personnel de Briand et M. Pierre Soulaine, excellent musicographe. Son régisseur général était Paul Stuart et ses chefs d'orchestre : Henri Rabaud, Paul Vidal, Bachelet, Büsser. Le peintre Pierre Lagarde fut chargé des décors et M. Pinchon des costumes.

la Direction de l'Opéra en 1908 (de g. à dr. : André Messager, Marius Gabion, Pierre Lagarde, Broussan)
On commença, selon l'usage adopté à chaque
changement de direction, par faire quelques réparations et nettoyages urgents
dans le théâtre ! On abaissa le plancher de l'orchestre afin de gagner des
places et d'atténuer les sonorités instrumentales, mais on ne put se résoudre à
supprimer les loges sur la scène (ce que M. Rouché fit plus tard). Les artistes
durent continuer à chanter ou à danser dans le cadre des décors sur un plan
beaucoup trop éloigné du spectateur.
La nouvelle direction ouvrit ses spectacles par un hommage à Gounod auquel
l'Opéra devait ses meilleures recettes ; les décors et les costumes de Faust
furent entièrement remis à neuf — la musique de Gounod, toujours jeune, pouvant
se passer de maquillage et du « coup de fer » régénérateur ! — Messager dirigea
la représentation. On applaudit, Mmes Jane Hatto, Martyl, MM. Muratore et
Delmas.
Les débuts de la direction Messager-Broussan furent donc excellents, mais, dès les premiers contacts, les nouveaux directeurs, qui n'étaient pas des mécènes, se trouvèrent aux prises avec des embarras d'argent qui ne cessèrent de s'aggraver. La raison de ces difficultés n'a pas changé : elle réside dans l'augmentation progressive des frais d'exploitation et dans l'insuffisance de la subvention. Gailhard n'avait pu vivre qu'en appliquant le plus rigoureux système d'économies, souvent au détriment du prestige de l'Opéra. En y renonçant on courait tous les risques et durant leur privilège les deux directeurs côtoyèrent souvent bien des abîmes ! Cela ne les empêcha pas de monter des œuvres nouvelles dont certaines réussirent pleinement.
***
Ils entreprirent d'abord de remettre à la scène un opéra de Rameau : Hippolyte et Aricie. A ce sujet, nous croyons bon de rappeler les lignes que M. Louis Laloy lui a consacrées dans Cinquante ans de musique française (*).
(*) Publié par la Librairie de France, sous la direction de M. L. Rohozinski.
« C'était une fort bonne idée que de remettre à la scène un opéra de Rameau. Aucune musique, mieux que la sienne, n'était indiquée pour l'état où se trouvait la nôtre et la cure de clarté qui lui était nécessaire. Un de nos musiciens, qui était aussi le plus grand de tous, l'avait compris depuis longtemps. Le 22 juin 1904, Claude Debussy assistait à une représentation d'une pastorale de Rameau, la Guirlande, qui avait lieu dans la cour de la Schola cantorum de la rue Saint-Jacques, et on l'avait vu se lever de l'escalier de bois où il était assis pour crier : « Vive Rameau ! A bas Gluck ! » Depuis lors, il avait affirmé à plus d'une reprise son admiration pour Rameau dans ses conversations, ses lettres particulières, ses articles, pour finir par la mettre en musique, sous la forme d'un Hommage à Rameau qui est une de ses plus nobles et plus touchantes inspirations.
Les jeunes musiciens qui passaient alors pour continuer Debussy et dont quelques-uns croyaient le dépasser n'aimaient pas Rameau. Ils le trouvaient trop simple, et montraient ainsi combien ils étaient éloignés du goût français dont Rameau était le plus bel exemple au dix-huitième siècle, comme Debussy au début du vingtième. Occupés constamment à raffiner sur l'harmonie, ils étaient devenus incapables de comprendre un style qui comme celui de Rameau s'appliquait à ne garder que l'indispensable. Comme ils trouvaient toujours sans difficulté l'explication de l'harmonie de Rameau, ils disaient que c'était une harmonie de professeur. Ils ne savaient pas, ils ne savaient plus que les émotions les plus vives et les impressions les plus subtiles gagnent encore en vivacité et en subtilité quand on parvient à les exprimer en un langage intelligible ; ils ne semblaient avoir d'autre ambition que de se poser des énigmes les uns aux autres, et des devinettes à leurs auditeurs. Comment auraient-ils pu goûter un artiste qui ne procède que par retranchement de matière, pareil à un de ces sculpteurs en pierre dure qui ont pour outil le ciseau ou la bouterolle ? Ils ne faisaient, au contraire, qu'ajouter encore un dièse, encore un bémol, à une agglomération de notes, aussi hérissée de retouches et chargée de coups de pouce qu'une maquette de cire. Mais Debussy, lui aussi, taillait ses œuvres dans le jade ou le cristal de roche. Ils n'entendaient donc pas mieux sa musique que celle de Rameau. C'est par la méthode allemande d'accumulation qu'ils travaillaient la leur. Ils étaient wagnériens bien plus qu'ils ne le pensaient et on put bientôt s'en convaincre quand éclata leur admiration pour la Salomé de Richard Strauss, le plus authentique héritier de Wagner.
Il est intéressant de suivre cette évocation d'une époque et la définition de tendances déjà bien éloignées de nous ! On y décèle l'ardeur des luttes d'écoles où s'affrontaient alors la Schola Cantorum et ses adversaires.
C'est ainsi que retentirent les premières salves de l'assaut dirigé contre l'idole du jour, Wagner, et contre ses fervents, les scholistes.
***
Hippolyte et Aricie n'ayant eu que six représentations, on ne manqua pas d'attribuer cet échec à la Schola dont les avis auraient prévalu à l'Opéra pour abréger exagérément — disait-on — les parties chorégraphiques de l'ouvrage « alors qu'on ne se sent à l'aise que dans l'instant où les chanteurs se taisent et les bergers, les prêtresses, les chasseurs font leur entrée... » — et pour bien marquer que, selon lui, dans un opéra c'est la partie symphonique qui seule importe, M. Laloy ajoutait : « Et cette émotion que les personnages indiquaient par de froids discours comme elle trouve, avec ces danses et ces cortèges que la musique fait surgir, son expression figurée dans les plus précieuses nuances de la tendresse, du plaisir, du deuil et de la terreur ! (*) » Enfin, désignant Messager sans toutefois l'incriminer directement : « M. André Messager avait laissé faire. Ce n'est pas lui qui dirigeait l'orchestre. C'est grand dommage, car personne n'était mieux qualifié pour introduire Rameau à l'Opéra, comme Debussy à l'Opéra-Comique. Aucune confusion n'était à craindre de son esprit clair, de son goût sûr, et admirant chaque ouvrage pour les beautés qu'il y sentait non par raisonnement de théorie, il eût fortement, aussi exactement mis en valeur la netteté de Rameau et sa concision rigoureuse que la puissance progressive de Wagner. Pour des motifs d'ordre intérieur, que je n'ai pas à élucider ici, c'est à Wagner, non à Rameau, que ses soins furent réservés. »
(*) C'était l'amorce de l'opéra-ballet que Louis Laloy réalisera plus tard dans Padmavati, avec notre regretté Albert Roussel.
***
Comment s'en montrer surpris ? Messager n'était-il pas un wagnérien de la première heure ? S'il avait donné tant de gages aux tendances les plus diverses, n'était-il pas fondé à maintenir dans un opéra tel qu'Hippolyte et Aricie la prédominance du chant sur la danse ? Ce qui paraissait, ma foi, fort logique de sa part !
Quant à son culte pour Wagner, rien n'eût pu l'en éloigner. Dès le début, il avait fait son pèlerinage à Bayreuth avec Gabriel Fauré, conduits par Mme de Saint-Marceaux, leur bonne fée, jusqu'au sanctuaire wagnérien. Il en était revenu émerveillé mais non asservi, bien décidé, lui aussi, à préserver sa personnalité sous l'éblouissant orage.
Mais que de fois l'avais-je entendu se délecter au piano avec les partitions de Wagner ! Respectueux de tous les chefs-d'œuvre il entendait bien, à l'Opéra comme ailleurs, continuer leur tradition qu'il connaissait mieux que quiconque. Lorsqu'il accepta de devenir directeur de l'Opéra, son éclectisme lui vint en aide et parmi ses nombreux projets on conçoit qu'il ait entrevu aussitôt ce qu'il allait pouvoir entreprendre en montant et conduisant lui-même le répertoire wagnérien en même temps qu'il donnerait l'opéra de Rameau sans se soucier des querelles d'écoles.
Louis Laloy ne me dira-t-il pas plus tard, avec quelque mélancolie : « Voyez-vous, dans nos milieux musicaux, la politique domine tout ; je veux dire la politique d'art qui fausse tous les jugements, lance aveuglément des exclusives en tous sens, et finalement stérilise les efforts des meilleurs ! »
***
Mettant ses projets à exécution, Messager représentera à l'Opéra et dirigera successivement le Crépuscule des Dieux, l'Or du Rhin, Parsifal (ce dernier, réservé jusqu'alors à Bayreuth. tombait à ce moment dans le domaine public),
Puis il se consacrera aux études de la Salomé de Richard Strauss qu'il conduira lui-même avec des interprétations remarquables (principalement celle qui réunissait Mary Garden, Muratore et Dufranne).
Viendra ensuite Boris Godounov, interprété par Chaliapine. C'est le 19 juin 1909 que cet ouvrage fut donné à l'Opéra avec le chef d'orchestre Blumenfeld sous l'impulsion de Serge de Diaghilev, animateur des fameux Ballets Russes (*).
(*) Laloy raconte encore qu'au sortir de cette représentation Charles Bordes l'interpella dans la foule pour lui dire avec la plus vive émotion : « C'est le grand-père de Pelléas, n'est-ce pas ? »
***
Au même moment, ceux-ci vinrent, sur notre scène nationale, bouleverser et régénérer l'art chorégraphique tandis qu'ils révélaient au grand public les noms de nouveaux compositeurs russes, aux chaudes musiques, parées de la plus étincelante technique orchestrale.
Puis ce furent des cycles de la Tétralogie en plusieurs soirées consécutives — comme cela se faisait à Bayreuth — dirigés par de célèbres chefs d'orchestre étrangers et souvent par Messager lui-même.
***
Je veux rappeler ici un incident auquel j'assistai et qui montrera combien Messager savait, lorsque c'était nécessaire, faire acte d'autorité et de décision dans ses fonctions directoriales :
Un « kappelmeister » réputé était venu conduire un ouvrage wagnérien dans l'une de ces soirées. Au premier entr'acte, il se plaint que la machinerie est défectueuse et que le fonctionnement imparfait des décors empêche de minuter de manière efficace les interludes qui relient les tableaux ou accompagnent les changements à vue. Il se fâche, invective sur scène le personnel du théâtre en déclarant que dans son pays « cela ne se passe pas ainsi ! » et qu'il fallait être en France pour voir un pareil désordre ! Devant les explications qu'on lui donne, il s'exaspère, perd le contrôle de lui-même, et tandis que la sonnerie rappelle l'orchestre dans la salle, il refuse de remonter au pupitre. Grand émoi de toutes parts, on va chercher Messager pour l'avertir de ce qui se passe. Celui-ci va droit au kappelmeister : « Vous refusez de conduire ? Eh bien, j'y vais, moi, et à votre place ! » Et il se dirige rapidement vers l'escalier intérieur qui conduit de la scène à l'orchestre. Inutile d'ajouter qu'il est immédiatement rattrapé par l'autre qui avait trop oublié que le directeur de l'Opéra était, lui aussi, un chef d'orchestre apte à parer utilement aux défaillances et abstentions de cette sorte !
A L'OPÉRA
GIOVANNA !
J'en arrive, et je m'en excuse, à parler d'un ouvrage que l'Opéra donna en janvier 1909, après un certain nombre de tribulations où je fus mêlé plus que quiconque, en étant l'auteur. Il s'agit de Monna Vanna. — Giovanna ! ainsi l'appelle Prinzivalle, qui l'aime...
J'ai dit auparavant que lorsque je composais cette partition à Montivilliers, Messager, qui était alors notre voisin, avait commencé par essayer de m'en détourner. Il était sincère, car il redoutait pour moi une tâche de telle importance, et ce n'est qu'après avoir entendu la seconde moitié du premier acte — par laquelle j'avais commencé à écrire mon œuvre — qu'il s'était ravisé et intéressé à Monna Vanna. Je terminai l'ouvrage à Saint-Germain où il venait souvent nous voir.
Lorsqu'il fut nommé directeur de l'Opéra, je le vis arriver là un beau matin, pour me prier de lui jouer ma partition. Après la lecture, il me déclara qu'il monterait cette pièce comme première nouveauté française de sa direction. Je demeurai interloqué devant une détermination aussi imprévue que flatteuse pour moi, mais il m'assura que le Roi aveugle avait reçu à l'Opéra-Comique un accueil si favorable que nul ne saurait s'étonner de voir Monna Vanna entrer à l'Opéra. Grande était ma joie ! Malheureusement elle fut singulièrement troublée par les difficultés que j'eus à surmonter vis-à-vis de Maeterlinck, mon collaborateur, pour une question d'interprétation. Il y eut interdiction, référé, procès et polémique ; le tribunal autant que l'opinion me donnèrent raison. Les avocats qui plaidèrent ma cause et celle de l'Opéra étaient Me Millerand et Me Aubépin. Ces ennuis m'impressionnèrent vivement et j'eus surtout le chagrin d'être séparé d'un écrivain renommé que j'admirais grandement, avec lequel je n'avais cessé jusqu'alors d'entretenir des relations les plus confiantes et les plus affectueuses. On se souvient que des incidents analogues avaient eu lieu lors de la création de Pelléas à l'Opéra-Comique. Les raisons et un des personnages étaient les mêmes.
Les études avaient commencé en octobre 1908. L'interprétation comprenait Lucienne Bréval, Muratore, Vanni-Marcoux et Delmas. Le chef d'orchestre : Paul Vidal.
On travailla avec fièvre et les interprètes qu'on m'avait donnés rivalisaient d'ardeur dans les foyers d'étude. Paul Vidal était dévoué et bienveillant, comme en toutes circonstances.
***
Ce qui se passa à l'une des premières lectures d'orchestre m'a laissé un souvenir que j'aime à me remémorer quand j'évoque les affectueux élans de Messager. — On a trop souvent dit qu'il était sec et insensible !
Alors que l'orchestre et les chanteurs lisaient « à l'italienne » le premier acte et que j'écoutais dans la salle avec une attention anxieuse, Messager était venu s'asseoir près de moi et écoutait également sans rien dire. Il ne connaissait pas ma partition d'orchestre. Comme je lui demandai ce qu'il pensait de la lecture il me répondit avec émotion et élan : « Comment, si c'est bien ? » Et il acheva sa réponse en me serrant avec effusion dans ses bras. Geste spontané qui pour moi compensait d'un coup les brusqueries et les inégalités de son caractère.
***
La première eut lieu le 13 janvier 1909. J'eus dans la presse de nombreux partisans et certains adversaires. Le public fut pour moi et le manifesta nettement.
C'est en cette occasion que j'appris à connaître les venimeux excès de plume dus aux querelles d'école autant qu'aux rivalités personnelles. Dans la suite, ces attaques devaient s'intensifier pour moi à chaque ouvrage nouveau jusqu'au point de se retourner contre mes détracteurs en faisant naître en ma faveur des mouvements de protestation dont l'ardeur et la spontanéité allaient directement à l'encontre du tort qu'on me voulait !
Je dois convenir qu'en ce qui concerne Monna Vanna la bataille s'engagea à peine et que la critique me demeura favorable dans l'ensemble. Ce sont seulement les ennemis de la nouvelle Direction qui se montrèrent sévères à mon égard, en cherchant plus à nuire aux Directeurs qu'à moi-même. Quelques-uns s'y employèrent sans résultat.
Des défenseurs se dressèrent parmi lesquels je citerai : Pierre Lalo, Jean Chantavoine, Vincent d'Indy, — plus tard Louis Laloy — ainsi que d'autres qui voulurent bien discerner mes intentions et en apprécier la réalisation.
Ces approbations encouragèrent Messager à maintenir l'ouvrage au répertoire. Il le fit adroitement en lui associant de grands interprètes parmi lesquels l'inoubliable Mary Garden, qui interpréta magnifiquement Monna Vanna à l'Opéra et en Amérique du Nord. La plupart des grandes villes américaines l'applaudirent dans ce rôle, entourée de Muratore et Vanni-Marcoux. De réputés chefs d'orchestre étrangers, tels que Campanini, entreprirent des tournées avec l'ouvrage et d'autres le firent connaître jusqu'en Amérique du Sud avec de célèbres chanteurs italiens.
En même temps, Bruxelles donnait Monna Vanna au Théâtre de la Monnaie dans un gala auquel assistaient le roi Léopold et la cour de Belgique ; Messager vint de Paris à cette occasion.
Au Covent Garden de Londres les contrats entre la direction et mon éditeur Henri Heugel étaient signés lorsque la Censure anglaise menacée d'apercevoir l'héroïne « nue sous le manteau » interdit la pièce. O pudeurs anglicanes ! Les Américains, eux, avaient eu les idées plus larges.
***
L'accueil favorable que reçut cette œuvre était dû à diverses causes. Ses adversaires, cela va de soi, ne virent là que favoritisme et l'attribuèrent à l'amitié qui m'unissait à Messager. S'ils avaient été sincères ou seulement perspicaces, ils auraient pu observer que je n'avais osé braver leur omnipotence qu'en essayant simplement de reprendre la tradition française, claire et mélodique.
Plus tard, avec d'autres ouvrages, j'eus à subir leur choc, plus violent encore. Je dus, pour ma défense, exposer mes idées sur le théâtre lyrique. Ce n'était évidemment pas un programme révolutionnaire et c'est bien là ce qu'on me reprochait (*) !
(*) Je me plais à reconnaître que M. Rouché, quand il prit l'Opéra, continua pour Monna Vanna ce que Messager aurait fait lui-même s'il était resté directeur, prouvant ainsi son indépendance et son souci de satisfaire aux diverses tendances de notre musique dramatique.
***
Résumerai-je ici quelques-unes des théories que je m'efforçai d'appliquer ?
« Lier la musique au drame en laissant celui-ci sur son plan théâtral, sans le submerger par un développement symphonique continu. Le public qui vient au théâtre veut pouvoir s'intéresser à une action, en suivre les péripéties ; il souhaite un juste équilibre scénique et musical. Chaque fois que l'occasion en est offerte par le développement de l'action, s'efforcer d'exprimer le lyrisme de chaque situation par des morceaux francs. S'attacher à une écriture vocale qui laisse aux chanteurs le maximum de possibilité d'expression. »
Toutes ces conditions se trouvent réunies dans l'œuvre de Messager lui-même. Gounod, Delibes, Saint-Saëns, Lalo, Bizet, Massenet, Charpentier et tous ceux qui ont fait la gloire de l'opéra et de l'opéra-comique français au XIXe siècle n'écrivaient pas autrement.
Ces principes sont éternels et la trame symphonique, si belle soit-elle, devient fastidieuse au théâtre chanté si elle veut tout primer car il est paradoxal de vouloir réduire la voix à une partie d'instrument secondaire !
Je dois convenir que les luttes que j'entreprenais n'étaient pas toujours du goût de Messager et que souvent il m'exhortait au silence et au calme, redoutant pour moi les suites de polémiques dangereuses.
Je ne l'écoutai pas et l'appris à mes dépens.
A L'OPÉRA
ÉPILOGUE
Parmi les ouvrages représentés à l'Opéra entre 1908 et 1914 nous citerons Bacchus et Roma de Massenet : le premier sur un poème de Catulle Mendès qui faisait suite à Ariane (des mêmes auteurs) ; et le second d'après le drame de Parodi : Rome vaincue, adapté par Henri Cain. Il faut bien le dire, Messager n'aimait guère Massenet ; l'homme comme le musicien n'avaient grâce à ses yeux. Mais cela ne l'empêcha pas de monter deux ouvrages de lui à l'Opéra et de prouver une fois de plus son éclectisme directorial — que de Directions ont sombré depuis pour n'en avoir pas fait autant !
J'avoue, pour ma part, avoir été souvent peiné par cette antipathie qui allait à l'encontre des sentiments d'affectueuse admiration que j'ai toujours éprouvés pour l'auteur de Manon. Ce qu'on reproche à ce compositeur me heurte et m'afflige. J'ai lu sur Massenet de nombreux articles injustes. Il prétendait, lui, n'en lire aucun : je le souhaite de tout cœur, pour sa sensibilité et son émotivité qui étaient grandes et en eussent souffert profondément !
En réalité, ce qu'on n'a jamais pardonné à Massenet, c'est son immense action sur le public, ce don si rare « de passer la rampe », don qui réclame de hautes qualités d'intelligence et de proportion, unies intimement à la pleine connaissance du cœur humain.
On ne s'étonnera pas que Messager, qui fréquentait les milieux musicaux de l'époque — où l'on prétendait détenir « le bon goût » — ait été gagné sur ce point par leurs exclusives et leur intransigeance.
En outre on peut demeurer surpris de le voir tenir grief à Massenet de qualités que lui-même possédait au plus haut point : la facture, la facilité mélodique avec le souci de l'effet vocal « qui appelle l'applaudissement... » (rugissez, ô redoutables juges !) et tant d'heureuses trouvailles d'écriture ou d'orchestration qui les unissaient malgré eux sur le plan de notre estime. Est-ce à dire que leurs musiques se ressemblaient ? Nullement. Mais ils parlaient — ou chantaient — la même langue et leurs manières s'apparentaient en bien des cas. La « vieille maison grise » de Fortunio, ou « la lettre » de Véronique sont du même crû de chez nous que « le Rêve » de Manon ou les « Larmes » de Werther.
Mais que nous importe, après tout, que les auteurs de ces pages émouvantes soient méconnus ou niés durant leur vie alors que leurs muses chantent sans cesse dans nos mémoires et dans nos cœurs (*) !
(*) Oserai-je reproduire ici quelques lignes égrillardes que nous reçûmes de Messager au lendemain d'une première de Massenet : « Quel four hier à l'Opéra ! C'est à avaler sa langue... Il est vrai de dire que nous avons eu une compensation dans la vue (trop courte) du néné droit de Sanderson qui s'est échappé de sa cage au deuxième tableau. Mais ça n'est pas suffisant ! »
***
Fervaal, de Vincent d'Indy, fut adopté par l'Opéra à la même époque.
On sait que Messager fut l'ami de d'Indy et que Fervaal créé à la Monnaie de Bruxelles avait été monté auparavant à l'Opéra-Comique par Albert Carré, à l'instigation de Messager qui, étant directeur de la musique, avait tenu à conduire l'orchestre.
Il en fut de même à l'Opéra où la belle œuvre de Vincent d'Indy trouva un cadre mieux approprié à ses vastes dimensions sonores.
Plus tard on verra le Roi d'Ys, Pénélope, Ariane et Barbe-Bleue abandonner à leur tour la Salle Favart pour le Palais Garnier alors que l'Heure espagnole de Ravel et Scemo de Bachelet feront le trajet inverse — l'œuvre de Ravel ayant même effectué un « aller et retour » ! — Mais Fervaal en restera à son premier voyage, sans être repris, et d'Indy sera boudé, sinon méconnu ; on lui reprochera son sectarisme — moindre que celui de ses adversaires ! — alors qu'il n'avait fait que défendre vaillamment ses doctrines d'art.
j'eus l'occasion d'en juger par une lettre qu'il m'adressa (à propos de conférences pour lesquelles j'avais sollicité son concours) où se révèle son indépendance de caractère :
« Besançon, 21 avril 1909.
Cher Monsieur,
Votre offre aimable me séduirait beaucoup en ce qui regarde au moins les Conférences sur la musique des maîtres anciens, car je serais tout à fait incapable de parler sur ma propre musique ! — mais, parler n'est pas mon métier et j'ai toujours la plus grande difficulté à établir en notes et à réaliser en paroles quelque chose qui se tienne un peu.
De plus, j'ai si peu, mais si peu, de temps disponible que je ne sais où je pourrais trouver, non seulement celui de préparer, mais même celui de faire la conférence en question.
Je crois donc que, comme je ne veux pas promettre une chose que je ne puis pas tenir, le mieux serait de ne pas me compter parmi les conférenciers et si la possibilité m'est donnée, un jour, de vous aider dans cette œuvre, je serais heureux de le faire.
Je profite de cette correspondance pour vous dire que j'ai beaucoup aimé certaines scènes de Monna Vanna qui m'ont prouvé votre sentiment du vrai drame musical, et puis, l'œuvre a, à mes yeux, une immense qualité de technique, en ce sens qu'on ne perd pas une parole, ce qui devrait être toujours la préoccupation du compositeur dramatique et ce qui est hélas, bien peu observé par ceux qui sont habituellement exécutés dans nos grands théâtres.
Je tiens à vous dire mes impressions — excellentes — sur votre œuvre, et croyez bien que ce n'est pas par « amabilité » car je ne sais pas dire ce que je ne pense pas et je me suis fait déjà pas mal d'ennemis pour cette triste disposition.
Veuillez agréer, Cher Monsieur, tous mes plus sympathiques souvenirs.
Vincent d'Indy. »
***
On donna aussi sous la direction Messager-Broussan : la Forêt, de Savard et le Miracle de Georges Hüe, dont le livre signé P. B. Gheusi offrait au compositeur des situations dramatiques et musicales qu'il sut traduire par de hautes envolées lyriques.
Puis vint Déjanire, de Saint-Saëns, sur un livret de Gallet (déjà représentée à Béziers par les soins de M. Castelbon de Beauxhostes le 28 août 1898), et Scemo, d'Alfred Bachelet, poème de Charles Méré, situé en Corse et imprégné d'une passion sauvage et noble, propre à exalter un musicien au tempérament ardent.
Citons encore le Sortilège, d'André Gailhard et Maurice Magre, le Cobzar, de Mme Gabrielle Ferrari, poème de Paul Milliet, les Joyaux de la Madone, de Wolf-Ferrari sur une adaptation française de René Lara, Sibéria de Giordano et la Damnation de Faust que Raoul Gunsbourg, le premier, avait eu l'heureuse idée de porter à la scène en utilisant à Monte-Carlo les décors lumineux de M. Frey. L'Opéra les adopta à son tour pour représenter le chef-d’œuvre de Berlioz (*).
(*) J'eus l'occasion de les employer moi-même avec la Damnation de Blanchefleur (poème de Maurice Léna, l'auteur du Jongleur de Notre-Dame) représentée à Monte-Carlo en 1921 avec Marguerite Carré et Vanni-Marcoux, sous la direction de Raoul Gunsbourg qui, lui aussi, joua souvent Monna Vanna et créa plusieurs de mes pièces dont la Femme nue en 1929, écrite d'après la pièce d'Henri Bataille et donnée ensuite à l'Opéra-comique en 1932.
Plusieurs ballets furent créés durant la même période : la Fête chez Thérèse de Reynaldo Hahn sur un scénario de Catule Mendès, Javotte de Saint-Saëns, España adaptée sur les rythmes fameux de Chabrier qui portent ce titre, la Roussalka de Lucien Lambert scénario de Hugues Le Roux et Dubor, les Bacchantes d'Alfred Bruneau, Philotis de Philippe Gaubert et Hansli le Bossu de Noël et Jean Gallon.
On voit par cette riche nomenclature que l'Opéra ne chômait guère pendant la direction Messager-Broussan !
***
Le 29 novembre 1913, coup de tonnerre — en coulisse ! — On apprend que M. Jacques Rouché est désigné pour prendre la direction de l'Opéra à l'expiration du privilège en cours, c'est-à-dire le Ier janvier 1915 ! — soit un an plus tard. — Mais si le ministre propose « Dieu dispose » et d'ici là que d'événements imprévisibles pouvaient survenir en cette énigmatique année 1914 qui restait à franchir ! (*) Le croirait-on ? Pour Messager c'était la délivrance ! Vingt fois, excédé par les tracas de sa charge, il avait voulu démissionner et vingt fois son associé et son ministre s'y étaient opposés. Cette fois M. Barthou avait pris ses décisions — le vœu de Messager se réalisait. Peut-être pouvait-il, tout au plus, regretter de ne plus conduire les œuvres qu'il avait montées ! Mais il était débarrassé de ses soucis directoriaux : fini le déficit, les réclamations, les grèves, les perfides attaques, les intrigues, les compétitions de cantatrices. Il allait de nouveau pouvoir être aimé pour lui-même et non plus pour les rôles convoités par celles-ci !
(*) En effet, quand éclatèrent les événements de juillet 1914, M. Rouché accepta d'entrer en fonctions à la demande du ministre dès le premier septembre, MM. Messager et Broussan étant démissionnaires.
Il se prépare dignement à terminer son septennat en occupant de son mieux sa dernière année de direction. N'est-il pas de la classe ? Vive la classe ! Et puis il se rappelle qu'il a d'autres cordes à son arc : Euterpe, sa bonne muse, abandonnée depuis longtemps par lui — car il n'a rien composé depuis des années — l'appelle de nouveau. Déjà, sous son égide, l'idée lui est venue d'une légende lyrique : Béatrice, qu'il a commencé à écrire avec Flers et Caillavet après l'avoir découverte dans les contes de Nodier. Il s'y met sans relâche et la pièce est donnée en mars 1914 à Monte-Carlo où elle remporte un retentissant succès musical !
Jadis, avec Madame Chrysanthème et le Chevalier d'Harmental, il s'était essayé dans des ouvrages dont le texte parlé était exclu ; cette fois la réussite semble complète : une presse enthousiaste proclame que Messager, grâce à sa science et sa culture musicale a pleinement atteint son but. Le troisième acte de Béatrice est porté aux nues et on y admire une belle intensité dramatique exprimée avec des moyens sobres et touchants.
***
En relisant quelques lettres personnelles de notre ami, j'y retrouve des allusions à cette partition qu'il chérissait entre toutes :
« Je travaille au second acte de Béatrice dont j'ai fini par avoir le texte et qui est tout à fait bien, à présent. Je suis très content de moi et si je mène cet ouvrage à bout comme il marche à présent, je crois que j'aurais fait quelque chose de bien. »
Et dans une autre :
« Béatrice avance, je suis au milieu du second acte qui est admirable comme livret, et je suis bien content de ce que j'ai fait. Seulement cela vient bien lentement surtout maintenant que je suis à Paris où je n'ai jamais pu travailler avec plaisir. C'est drôle, il me faut l'installation « en camp volant. » Je suis trop dérangé et distrait ici ! »
O joie ! en quittant l'Opéra, il va retrouver liberté et indépendance tandis que sa vie de compositeur lui permettra, comme autrefois, de faire à son gré l'école buissonnière !
Mais soudain, un autre coup de tonnerre, plus sinistre, hélas ! que le premier, a retenti (*).
(*) L'essor de Béatrice fut arrêté par la guerre et aussi par des rivalités d'interprètes... En 1917, l'œuvre de Messager sera donnée à l'Opéra-Comique par P.-B. Gheusi, sous les berthas et les avions ennemis. En cette même année, Messager suivra Béatrice jusqu'à Buenos-Aires et elle reparaîtra passagèrement salle Favart dix ans plus tard (direction Masson-Ricou). Il en est des œuvres de théâtre comme des individus : leur destinée est capricieuse et leur sort incertain !...
1914
Nous entrons maintenant dans l'époque de la première Guerre Mondiale. La vie est subitement interrompue. Les choses de l'Art cessent pour nous d'occuper la première place et la musique va subir un temps d'arrêt dans son évolution. Il ne reste plus qu'un sentiment ardent inspiré par l'émoi du pays : la Marseillaise, le Chant du Départ, Sambre-et-Meuse exaltent les cœurs, l'héroïsme du front vivifie les courages, la mort de Péguy et celle d'Albéric Magnard retentissent en nous comme des glas.
Combien lointaines nous apparaissent à ce moment nos querelles d'écoles et nos polémiques du temps de paix !
Certains modérés — peut-être des réactionnaires — au fond d'eux, semblaient s'imaginer que cette trêve de l'Art allait tout modifier et interrompre le crescendo de tendances qu'ils redoutaient fort. Soulevés par l'élan des événements, ils voulaient oublier nos désaccords, les jugeant puérils, byzantins et hors de saison, espérant presque que ce répit inattendu allait leur permettre de regagner un peu du terrain perdu par eux.
Les autres, les durs, obligés d'accepter la suspension d'armes — alors que le monde était en feu ! — se renfermaient en eux-mêmes, contraints au silence, mais retranchés dans une attente dont ils profitaient pour préparer leurs futures offensives d'esthétique, bien résolus à foncer de l'avant sitôt qu'ils le pourraient.
Et ma foi, ces intrépides ne se trompaient guère ! Leur confiance en eux-mêmes et leur cohésion allaient leur donner les grands premiers rôles dans l'époque de réorganisation qui suivra la première guerre. Ils triompheront. C'est en vain que les autres se boucheront les oreilles en criant à la fausse note !
Nos durs, soutenus par l'élément actif de la presse musicale, se souciant peu d'une opinion publique désorientée — qui cherchera d'instinct à se réfugier dans les œuvres du passé — nos durs prendront la tête du mouvement, imposeront leurs doctrines, en attendant d'être submergés à leur tour par une autre vague de fond. On trouve toujours plus révolutionnaire que soi et quoiqu'on fasse on ne manque pas de devenir « le pompier » de quelqu'un. C'est chacun son tour ! Au théâtre, même offensive : on cherche à déplaire, on provoque, on flagelle !
Mais peu à peu les belles œuvres émergent, la tempête s'apaise, le flot se retire, la vie reprend... Et cela durera jusqu'à la seconde guerre après laquelle nous assisterons à d'autres éclosions et d'autres métamorphoses.
Respectons et louons ces joutes de l'esprit, ces périodes de flux et de reflux qui, dans des temps troublés, sont la vie elle-même ; grâce à elles l'Art, en se transformant, renaît chaque fois dans son évolution.
***
Suivons Messager pendant la tourmente. Nous le voyons se dépenser utilement en toutes circonstances et son activité ne se dément pas.
Les Beaux-Arts, sous la direction de M. Dalimier, créent en 1915, les Matinées nationales de la Sorbonne. Alfred Cortot et Romain Coolus se mettent à la tête du mouvement, Messager y prend la baguette et l'orchestre du Conservatoire interprète les œuvres qu'on y fait entendre.
C'est là, à l'une des matinées du dimanche que je fis entendre l'Hymne aux Morts pour la patrie, que j'avais écrit au lendemain de la bataille de la Marne sur les magnifiques vers de Charles Péguy. Je proposai au Comité des Matinées nationales d'en donner la première audition et je fus envoyé vers Messager pour lui remettre les pages qu'il devait conduire. Comme on le voit, c'est par une nouvelle coïncidence qu'il se trouvait mêlé, une fois de plus, à l'une des manifestations de ma vie musicale.
Je revois cette magnifique salle de la Sorbonne, remplie par un public recueilli autant qu'enthousiaste. Deux de mes morceaux figuraient au programme : l'Hymne aux Morts et la complainte de Minuccio de Carmosine. C'est l'excellent baryton Maguenat — le même qui avait créé Carmosine à la Gaîté-Lyrique en 1912 — qui les interprétait. Messager était au pupitre et la première audition de l'Hymne aux Morts fut saluée par une approbation dont le souvenir ne pourra s'effacer de ma mémoire. Messager tint à m'y associer personnellement en me désignant au public. J'en fus à la fois heureux et confus, car ces applaudissements auraient dû d'abord s'adresser au poète, au grand Français Charles Péguy, qui venait de tomber glorieusement à la Marne après avoir prévu et décrit là sa propre fin héroïque sur le champ de bataille !
En souvenir de Péguy qui inspira ce morceau et de Messager qui le fit connaître ce jour-là, qu'on me permette, en pieux hommage, de redire ici les nobles strophes écrites bien avant 1914 par le grand poète, dans une heure de divination prophétique :
« Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle
« Mais pourvu que ce fut dans une juste guerre
« Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre
« Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle !
« Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles
« Couchés dessus le sol à la face de Dieu
« Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu
« Parmi tout l'appareil des grandes funérailles.
« Heureux ceux qui sont morts pour les cités charnelles
« Car elles sont le corps de la cité de Dieu
« Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu
« Et les pauvres honneurs des maisons paternelles.
« Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés
« Dans la première argile et la première terre
« Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre !
« Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés ! »
Quelques semaines après cette audition, donnée à la fin de l'hiver 1914-1915, je partis pour Verdun. Réformé depuis plusieurs années, j'avais demandé à être envoyé aux Armées et je fus versé en avril 1915 avec Robert de Flers à l'Hôpital d'évacuation de Verdun. L'Hymne aux Morts m'y suivit comme je le suivis moi-même durant la guerre, jusqu'au jour où Clemenceau donna ordre en 1918 de le faire chanter le même jour et à la même heure par les enfants des écoles communales de France.
EN TOURNÉE
De juin à novembre 1916, Messager entreprend une tournée en Argentine, avec Xavier Leroux, au cours de laquelle il dirige de nombreux concerts ainsi que les représentations de Béatrice qui sont données au théâtre Colon, de Buenos-Aires, avec Mme Ninon Vallin et le ténor Laffitte.
J'étais aux armées à cette époque et nous correspondions de temps à autre, Messager et moi, en devisant sur les vicissitudes des temps.
Avant son départ, au début de 1916, il vint à Châlons-sur-Marne où j'étais et fut reçu par les officiers de l'état-major du général Gouraud. Le chef d'orchestre Catherine le pilota dans cette ville du front où se trouvaient réunis, sous l'habit militaire, des personnalités fort diverses.
C'était l'époque où, la guerre traînant en longueur, on commençait à envisager sérieusement au front des distractions propres à chasser le « cafard ». Naturellement, la musique — sous ses formes les plus simples — jointe à la comédie et en général à tout ce qui pouvait composer un programme propre à divertir soit les blessés des hôpitaux, soit les troupes en cantonnement, soit même les états-majors, devait tenir là une place prépondérante.
De l'intérieur, on voyait souvent arriver, tantôt des artistes isolés, hommes ou femmes, qui participaient aux concerts ou séances improvisées sur place, tantôt d'importantes troupes de comédiens, de chanteurs ou danseurs des deux sexes, organisées à Paris par les soins des Beaux-Arts et de M. Dalimier, secondé activement par Emile Fabre, Alfred Cortot, Romain Coolus, Guiraud. Ce fut le temps du « Théâtre aux Armées » où de nombreuses vedettes parisiennes de tous genres mirent leur talent au service de cette bienfaisante cause.
Quoique fort bien organisées, ces tournées, relativement rares, n'atteignaient qu'un nombre restreint de spectateurs. Certes, leur attrait était grand et leurs programmes de choix, mais elles pénétraient peu jusqu'à la troupe et les représentations constituaient surtout des spectacles de qualité dont certains privilégiés avaient la priorité. D'où froissements, déceptions pour ceux, trop nombreux, qui n'en pouvaient profiter ! Ajoutez à cela l'antagonisme constant qui régnait entre les pouvoirs militaires et civils et vous comprendrez pourquoi et comment s'organisa, à côté du « Théâtre aux Armées », à l'exclusion cette fois de tous les éléments venant de l'intérieur, le « Théâtre du Front ».
Déjà à Verdun, en 1915, jusqu'à la bataille de 1916, j'avais été à même de constater combien notre art pouvait apporter d'adoucissement au sort journalier, souvent si monotone, de tous ceux, gradés ou non, que la guerre avait réunis dans cette avancée du front — où l'on se sentait fort isolé et qui semblait connaître le sort d'une ville assiégée. — La place de Verdun contenait alors la plupart des hôpitaux de la région et le corps médical était friand de distractions pour ses blessés. Aussi les concerts ou séances récréatives s'y multiplièrent-ils pendant cette période relativement calme, jusqu'au jour où commencèrent les bombardements à longue portée qui atteignirent spécialement les hôpitaux et firent des ravages affreux parmi les malheureux blessés. On dut évacuer les hôpitaux et Verdun se vida de ses blessés en attendant les heures tragiques de l'immense bataille de février 1916.
***
Revenu à Châlons j'y rencontrai le peintre Georges Scott qui fournissait aux journaux illustrés ses visions de guerre devenues populaires. Il me dit qu'il avait fait construire sur ses plans un théâtre mobile de grande envergure destiné à parcourir les cantonnements pour y abriter des spectacles récréatifs. Il comptait pouvoir s'entendre avec l'organisation du « Théâtre aux Armées » à Paris afin que cette scène ambulante, ornée de ses fresques, servit de cadre aux représentations de ce groupement. Mais, pour les raisons que j'ai indiquées plus haut, cette entente rie put se faire, le « Théâtre aux Armées » entendant conserver son autonomie. C'est alors que Scott envisagea la création de petites scènes mobiles plus légères et plus aptes aux déplacements sur le front.
Cette idée fut adoptée par le haut commandement, soucieux, après les événements de 1917, de maintenir le moral de l'armée, et une vaste organisation, purement militaire, fut créée au Grand Quartier Général : ce fut le « Théâtre du Front ». Le résultat fut couronné de succès et apporta à nos poilus, dans les périodes de calme, un excellent délassement moral.
***
Dans ma correspondance avec Messager, je lui avais expliqué en détail tout ce que nous comptions entreprendre dans ce sens. Scott et moi, avec l'agrément du Grand Quartier Général et cela l'avait vivement intéressé. De son côté, il préparait son voyage en Argentine et au Brésil.
Je fus donc séparé de lui pendant plusieurs mois et lorsqu'il revint en France, j'appris avec surprise et indignation qu'on l'avait attiré là-bas, en pays neutre, dans une sorte de guet-apens où l'on abusa de sa générosité de grand artiste pour l'amener à diriger ces mêmes pages wagnériennes dont il avait été l'un des premiers apôtres bien avant la guerre, pour lesquelles il avait tant combattu autrefois lors de l'éclosion du wagnérisme et plus récemment encore en introduisant ces chefs-d’œuvre au répertoire de l'Opéra alors qu'il en était directeur.
Nul n'ignore que, durant la guerre, Wagner était considéré chez nous comme représentant musicalement le nationalisme allemand. Certains de nos compositeurs — dont Saint-Saëns — avaient fait alors campagne plus encore contre le polémiste que contre le musicien. On avait exhumé le fameux pamphlet écrit par Wagner en 1870, intitulé « Une capitulation » et ses partitions avaient été bannies de l'affiche de nos théâtres. Mais en revanche, la plupart des artistes et des intellectuels ne considéraient pas sans peine cet ostracisme et le déploraient. Ils alléguaient que l’œuvre wagnérienne appartenait plus à l'humanité toute entière qu'à l'Allemagne seule et que malgré les haines légitimes suscitées par la guerre, il était impossible de rayer le nom de Wagner, inscrit pour l'immortalité au « Panthéon Universel ».
C'était évidemment ce que pensait Messager, wagnérien de la première heure. Aussi fut-il très surpris, dès son retour à Paris, de voir que ses intentions de pur artiste avaient été travesties dans certains milieux. Lui, le musicien français par excellence, ne fut pas sans en souffrir... Il apparaît maintenant que certains esprits malveillants avaient tenté, durant son absence, de grossir démesurément un incident qui, somme toute, faisait plus honneur à sa bonne foi musicale qu'il ne le diminuait réellement ! La preuve en est qu'il fut chargé, dès le mois de septembre 1918, d'entreprendre une grande tournée de propagande aux Etats-Unis, à la tête de l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire.
Le hasard, qui en tant de circonstances déjà m'avait fait le retrouver sur mon chemin, intervint encore puisqu'appelé moi-même en Amérique du Nord après l'armistice pour la création de Gismonda à « l'Auditorium Théâtre » de Chicago, je le rencontrai là, dans ce même théâtre où l'on répétait mon ouvrage. J'assistai au Concert de musique française qu'il dirigea de tête, sans nulle partition au pupitre, et j'eus la joie d'être témoin de son succès de chef d'orchestre français... La cabale avait fait long feu !
LE RETOUR
Continuant sa tournée aux Etats-Unis avec l'orchestre du Conservatoire, Messager quitta Chicago avant ma première à l'Auditorium Théâtre de cette ville. Ce fut un grand regret pour moi, car je ne le retrouvai pas à New York où ma pièce fut également donnée au Lexington-Théâtre, avec les mêmes artistes qu'à Chicago. J'y vis aussi représenter Monna Vanna avec la même troupe dirigée par Campanini, directeur et chef d'orchestre italien, ami de la France et de la musique française auquel je devais ma venue en Amérique.
J'ai conservé un souvenir profond de ces heureux instants. C'était en janvier 1919, au lendemain de l'armistice, dans l'immense joie de voir la guerre finie et de se retrouver tout à coup, à l'étranger, dans cette ambiance fiévreuse des théâtres que nous n'avions plus connue depuis 1914 et que bien souvent, pendant les longues et dures années de la guerre, j'avais désespéré de revivre jamais ! Nous avions quitté Chicago par le train spécial qui emportait à New York nos artistes, nos décors et notre orchestre. J'y retrouvai nombre de Français parmi lesquels : Paul Claudel, Gabrielle Gills, Henri Casadesus, Alfred Cortot, Darius Milhaud, Théodore Reinach qui assistèrent aux représentations du Lexington-Théâtre. Tous à cette époque furent, comme moi-même, magnifiquement fêtés par les Américains. Nous revînmes en France sur le même paquebot qui m'avait amené et le retour fut agrémenté de musique, dans les salons de la « Lorraine ».
***
Dès notre arrivée à Paris (février 1919) je constatai combien la vie allait y être âpre et disputée ! Quel contraste entre notre pays meurtri par la guerre et cette opulente Amérique qui savourait les joies de la Victoire sans avoir connu nos ruines, nos immenses pertes et sans être épuisée comme nous par quatre années de batailles ininterrompues !
Je dus m'occuper de suite des études de Gismonda à l'Opéra-Comique, les directeurs voulant donner la pièce dès le printemps de 1919. J'ai dit plus haut que le trop court séjour de Messager à Chicago m'avait laissé du regret car il s'était intéressé depuis longtemps à ma partition et j'aurais aimé qu'il fût là, près de moi, pour en voir la réalisation scénique. Je me souvenais qu'il aurait volontiers monté l'ouvrage à l'Opéra la dernière année de son privilège, si la guerre n'était survenue et si j'avais accepté une Gismonda de son choix.
***
C'est en 1919 que Messager fut appelé par MM. Carré et Isola comme Directeur de la Musique à l'Opéra-Comique (*). Je fus prié par Albert Carré de transmettre officieusement cette offre à son collaborateur de la Basoche, à son co-directeur de jadis.
(*) Les Isola étaient frères inséparables, dans le succès comme dans l'adversité et partout où ils passèrent ils accomplirent de louables efforts directoriaux. Lorsqu'il deviendra président de la Société des Auteurs, Messager fera campagne pour que leur privilège à l'Opéra-Comique ne soit pas renouvelé. Il fut écouté par le ministre. Eut-il tort ou raison à l'époque ? Je l'ignore... Il n'en reste pas moins qu'en 1947 nous pouvons mesurer les conséquences des changements successifs qui s'ensuivirent. Après l'active direction Masson-Ricou, l'Opéra-Comique s'achemina peu à peu vers sa fusion administrative avec l'Opéra en y perdant son autonomie, et le gentil Trianon-Lyrique — alors si habilement dirigé par Louis Masson — devint un cinéma. Résultat : deux scènes indépendantes de moins pour nos compositeurs.

André Messager, rue Jouffroy, vers 1920
Messager resta deux années à l'Opéra-Comique au cours desquelles il monta et conduisit la Rôtisserie de la Reine Pédauque de Charles Levadé ainsi que Cosi fan tutte de Mozart.
A cette époque, il partageait son temps entre ses occupations à l'Opéra-Comique, la critique musicale du Gaulois qui lui faisait suivre assidûment les répétitions générales et les concerts, la direction de l'Orchestre du Conservatoire (qu'il garda peu de temps encore) et enfin la composition musicale.
***
Après tant d'années employées à d'autres fins, il semble vouloir revenir, dès 1918, vers ce style dans lequel il avait excellé autrefois, style qui lui était propre, où s'affirme le mieux sa personnalité, celui de l'opérette ou plutôt de la musique légère. Aussi le voyons-nous, au début de cette année 1918, bien avant qu'ait paru le film célèbre de Rudolph Valentino, composer Monsieur Beaucaire, sorte d'opéra-comique tragi-comique, sur un livret anglais d'allure aimable et romanesque. Cette pièce, représentée d'abord au Prince's Théâtre de Londres, obtint une grande réussite en Angleterre comme en Amérique. Elle fut adaptée en français par André Rivoire et Pierre Veber et représentée plus tard en 1925 sous la direction Volterra au Théâtre Marigny. Monsieur Beaucaire, comme la Basoche, marque un point de départ pour nos jeunes compositeurs et leur montre la voie qu'ils pourraient suivre en renouvelant, pour la plus grande joie des musiciens et du public, notre répertoire lyrique.
Affranchis de toute influence étrangère, ils trouveraient là l'occasion de déployer leurs qualités de grâce, d'émotion, de mesure et d'esprit. Beaucoup, pourvus des dons limpides de notre race latine, se confinent dans le mode grave qui ne convient pas toujours à leur nature. Les Italiens, eux, l'ont trop bien compris et le succès international de leurs ouvrages en fait foi. Pourquoi ne pas continuer, nous aussi, notre tradition ? Le Français a peut-être ses défauts, mais certes pas celui d'être morose !
L'OPÉRETTE RENAIT PAR LA CHANSON
Et voici l'instant d'apprécier les services rendus à cet effet par un compositeur auquel l'auteur de Véronique s'est plu à rendre hommage : je veux parler d'Henri Christiné.
Parmi les derniers crépuscules de l'avant-guerre, la musique légère s'était tue en France. « L'opérette est morte et bien morte ! » avait décrété Catulle Mendès avant de mourir lui-même, et les Viennois s'étaient emparés du genre, né chez nous. Pendant la guerre, il n'en fut plus question, bien entendu. Mais après, allait-elle disparaître de nos théâtres pour laisser la place à des imitateurs étrangers ?
C'est alors que le génie de la race fit le miracle ! « La Chanson », celle de Paris, du boulevard et de la rue, celle des grisettes et des tourlourous, s'évada soudain du café-concert pour venir se nicher comme un oiseau fugitif dans les frises de nos théâtres.
Christiné était passé maître dans les joyeux refrains dont les motifs populaires avaient consacré sa célébrité. Messager qui adorait l'humour ne craignait pas de s'en divertir ; fervent du music-hall qui lui rappelait ses débuts, il s'y récréait fort. Pour lui, des chanteurs comme Polin, Mayol, Fragson, Maurice Chevalier, Dranem étaient de grands artistes : il admirait leur diction, leur mimique, leur invention, leur étonnante musicalité. Mais il savait aussi apprécier l'auteur, celui qui doit trouver « le motif », chantonné à tous les vents !
Quand parut Phi-Phi aux Bouffes-Parisiens — le 12 novembre 1918 — Messager comprit ce qu'on devait à Christiné, à celui qui, enrubannant ses textes de refrains ciselés et irrésistibles, avait su les amalgamer, les fondre adroitement dans l'heureuse pièce de Willemetz, si bien que pendant trois années consécutives le succès de Phi-Phi ne se ralentit pas.
Par la Chanson et par Christiné l'opérette française reprenait son vol !
***
Il s'ensuivit une réelle amitié entre les deux compositeurs et ils combattirent côte à côte, aidés par Maurice Yvain, contre l'intrusion chez nous de l'opérette étrangère.
Je veux reproduire ici une lettre écrite plus tard à ce sujet où l'auteur de Véronique se laisse aller à sa verve épistolaire et relate avec esprit et ironie les faits du jour. Cette lettre de Messager à Christiné est difficile à publier intégralement. Il y est question d'auteurs, de pièces, de directeurs dont la plupart sont encore vivants et d'actualité. On m'excusera donc si je me contente par discrétion de les désigner par des initiales dont je n'ose même pas garantir l'authenticité... D'ailleurs ce ne sont pas les faits relatés qui sont intéressants dans cette lettre, mais plutôt l'amusante « rosserie » qui s'en dégage et qui montre Messager sous un jour auquel, pour ma part, j'étais accoutumé et qui n'était pas sans paraître redoutable aux gens qu'il n'aimait pas !
« 10 avril 1927.
Mon cher ami,
Enfin on nous l'a sortie cette N. N. (*) et c'est une fameuse tape. Vous n'avez pas idée de la stupidité de la pièce et de la vulgarité de la musique. C'est un bruit à ne pas s'entendre, une orchestration de singe en délire et on sort de là assourdi, abruti et écœuré. Mais cette fois, Q... a touché des deux épaules et le public n'a pas marché. Ajoutez à tout ce que je vous dis que la pièce est aussi mal jouée que possible. En tête, R... plus mauvais que tout ce que vous pouvez imaginez (il était génial dans les J... f... n... en comparaison !) S... V... n'ayant déjà plus de médium hurle dans l'aigu en faisant une bouche de plus en plus en cul de poule !... K... lui-même, plus que médiocre. Seule, D... G... a sauvé la situation en jouant supérieurement, au 3e acte, une scène de soulographie. La presse a été, sauf les « intéressés », terrible. Dans son journal A... termine ainsi son article : « A la sortie, nous avons trouvé la pluie, c'était moins embêtant ! »
L'impression générale était de dégoût, on a un peu sifflé à la générale et à la première. Q... déclare par la bouche de P... P... qu'il ne montera plus d'opérettes et qu'il voue tous les théâtres à la littérature. En tout cas, je doute qu'il fasse de nouvelles incursions dans les pièces anglo-saxonnes. En revanche, R... M... gros succès. Pièce nulle, musique douceâtre et mal orchestrée (rien du jazz) mais mise en scène somptueuse et tout le côté danse vraiment de premier ordre. Je crois à un succès de durée, pas celui de N... N... mais devant durer plusieurs mois. Les I... ont fait les choses admirablement, ils méritent d'être récompensés de leur cran.
Voilà, mon cher ami : j'ai pensé que tout cela vous intéresserait et vous mettrait un peu de courage au ventre. Vous voyez qu'il ne suffit pas d'enlever une rangée de fauteuils et de faire jouer du trombone par le chef pour avoir un succès.
Allez, il y a toujours une bonne place pour la musique saine et pour une pièce où on ne dira pas m... Travaillez paisiblement sans vous laisser troubler par cette cacophonie et ces nègres en rut. Le public vous fêtera à la première occasion parce que vous êtes Français et propre et c'est pour cela que je vous aime.
Mes bons souvenirs à votre femme et pour vous mes bien affectueuses amitiés.
A. Messager. »
(*) Il ne s'agit pas ici de No No Nanette, opérette aux mêmes initiales, mais d'une autre opérette étrangère.
Ceux qui veulent savoir ce que Messager pensait des opérettes étrangères de son temps, seront, je crois, suffisamment édifiés par cet écrit !
***
Christiné, de son côté, en souvenir de ces encouragements et du bon combat qu'ils menèrent ensemble fit, quand l'auteur de Véronique eut disparu, une causerie au micro intitulée : « Qu'est-ce que la Chanson ? » où il se recommandait de cette flatteuse estime :
« Lorsque le compositeur charmant et délicat André Messager faisait de la critique, je lui demandai un jour après la répétition générale d'une de mes opérettes : « Comment se fait-il que j'aie eu de vous, de Reynaldo Hahn, musiciens avertis et éminents, des articles très élogieux alors que d'autres m'ont critiqué sans la moindre indulgence ? » Messager me répondit : « C'est que nous, nous sommes des compositeurs et nous savons combien il est difficile d'écrire de la musique qui paraît facile ! »
Fort de cette approbation, Christiné s'enhardira au micro, se répandant en diatribes sur le mouvement musical de son temps :
« Aujourd'hui, il y a dans tous les arts une espèce de surenchère qui aboutit à ce que j'appellerai « le cubisme » à défaut d'un terme plus approprié. De même qu'il y a des industriels peu scrupuleux qui fabriquent du vin dans lequel il n'y a pas de raisin, de même il y a des gens qui veulent composer de la musique sans la moindre mélodie. Une école nouvelle, soutenue par une presse tyrannique, veut imposer son goût.
... Est-ce à dire que les compositeurs français manquent de talent ? — Non pas — mais dès qu'ils ont le malheur d'écrire huit mesures que l'oreille peut retenir, ils sont si malmenés qu'ils n'osent plus se laisser aller à leur inspiration. On décrète que Massenet et Delibes sont tout au plus bons à intéresser les midinettes ; quant à Puccini, c'est de l'ignominie musicale. Qui a raison ? Est-ce le public de tous les pays du monde qui a fait à ces trois compositeurs une renommée universelle ou bien ceux qui sont animés d'un sectarisme étroit ? »
Et se prenant à entonner le Credo de la Mélodie — sur un diapason tel que Messager, sans doute, eut pu difficilement l'entendre jusqu'au bout — Christiné termine ainsi son apostrophe : « Je crois qu'on peut comparer une mélodie réussie à une jolie femme dont l'accompagnement harmonique serait le vêtement : eh bien, je suis certain que le public préférera toujours une jolie femme, c'est-à-dire une mélodie, même pauvrement vêtue ou pas vêtue du tout, à une robe somptueuse sous laquelle il n'y a rien. »
Nous pourrions, en 1947, répondre à notre regretté camarade, s'il était encore parmi nous : « La Mélodie !... n'est-elle donc que dans la voix ? Ce que vous appelez sommairement « l'accompagnement » ne peut-il en contenir lui aussi ? — La mélodie ? elle est partout, mais encore faut-il l'entendre ! Il n'y a pas que des idées mélodiques, il y a aussi des idées, tout court. Il y a le langage harmonique, l'écriture, la couleur, le rythme et tout ce que contient la musique en elle-même. Les œuvres de Fauré, Debussy, Ravel, Dukas, Chabrier, comme celles de Messager sont, elles aussi, remplies de mélodie. Elle y coule à flots comme le sang dans les artères, et c'en est la meilleure substance. Ne savez-vous pas qu'il fut reproché à Berlioz, à Wagner, même à Gounod, de n'en point contenir ? Notre musique française, sous ses formes les plus nouvelles en est imprégnée et par ses richesses s'impose maintenant à l'admiration du monde entier. Les recherches les plus audacieuses prennent chaque jour leur signification et sous un vêtement nouveau tendent toujours vers elle : la Mélodie.
« Ecoutez Ravel, écoutez « le lever du jour » de Daphnis et Chloé, où tout chante éperdument dans l'orchestre ! Ecoutez l’Après-midi d'un faune.
Depuis vos fines chansons, cher Christiné, jusqu'aux sommets altiers qui semblaient alors inaccessibles, la culture musicale s'est magnifiquement développée. Dominant nos malheurs et séchant nos larmes, là où la guerre a passé, la musique, sous toutes ses formes, a su consoler.
Aujourd'hui, par elle, grâce à vous tous, on comprend, on aime, on espère encore… »
L'ÉTÉ DE LA SAINT-MARTIN
Nous retrouvons Messager en 1921 — le 14 mai de cette année — présentant au Théâtre Mogador une opérette nouvelle : la Petite fonctionnaire, écrite d'après la comédie d'Alfred Capus, avec Edmée Favart et Henri Defreyn en tête de la distribution.
Je revois encore son visage heureux et ému en ce jour de reprise de contact avec le public parisien. Ses amis partageaient sa joie et s'empressaient autour de lui dans le foyer des artistes ; tous le félicitaient de la belle réussite qui semblait s'annoncer. Malheureusement, malgré tant d'heureux présages, le succès ne se maintint pas, les recettes baissèrent et la Petite fonctionnaire, en dépit de son excellente distribution, ne put continuer à tenir l'affiche.
Ce demi-insuccès — pour ne pas dire cet échec — laissait notre compositeur dans une grande perplexité : la chance allait-elle l'abandonner au moment même où n'étant plus ni directeur ni chef d'orchestre il croyait pouvoir compter sur sa plume encore féconde et se consacrer exclusivement à sa musique, abandonnée par lui pendant tant d'années ? Certes, la critique lui avait été favorable et, à juste titre, s'était complue dans la louange :
« Quel charme, quelle distinction, écrivait-on, quelle bonne humeur se dégage de cette partition ! Le tour en est délicat, le comique y est fin, la tendresse de bon ton, sans banalité ; l'instrumentation, toujours savoureuse, est un régal exquis. »
Mais rien n'y fit, la partie était malheureusement perdue.
Pauvre « petite fonctionnaire ! » si enjouée, si peu tyrannique encore ! Que d'aimables souvenirs nous laissent, à travers Messager, vos insouciants refrains de l'an de grâce 1921 !
Notre petite fonctionnaire de 1947 ne saurait hélas ! chanter sur le même mode.
***
Un malheur n'arrive jamais seul et l'heureuse destinée de Messager semble vouloir s'assombrir à ce moment de sa vie. Sa santé s'altère. On doit l'opérer et des complications surgissent qui mettent sa vie en danger. Certain jour, l'alarme grandit et les nouvelles deviennent de plus en plus mauvaises. Dans les rues de Londres, les porteurs de journaux annoncent déjà sa mort. J'étais à Berck à cette époque — juillet 1921 — et mon émotion était extrême. Je passais des heures d'angoisse et de chagrin devant le malheur qui pouvait survenir d'un instant à l'autre. C'est alors que je pus mesurer vraiment toute l'affection que j'éprouvais pour lui : le sachant très mal je lui adressai des lignes dans lesquelles je dissimulai mon émoi, pour lui laisser comprendre seulement tout l'élan de mon cœur. Mes lettres parvinrent-elles jamais jusqu'à son lit de souffrance ? Je l'ignore... mais j'y avais mis le meilleur de moi-même dans un instant que je croyais fatal. Heureusement le cauchemar se dissipa peu à peu, il était sauvé et avait échappé par miracle à la grave opération qu'il avait subie.
C'est dans ce même moment d'inquiétude que je commençai d'écrire ma partition de la Femme nue qui devait attendre onze années avant d'être jouée ! Et cependant, pouvais-je songer aux rigueurs et aux attaques à venir, alors que ce 14 juillet de l'année 1921 m'apportait la joie de voir sur les affiches de l'Opéra et de l'Opéra-Comique deux de mes ouvrages joués simultanément le même jour ? Mais tout l'agrément que j'aurais pu en ressentir avait disparu devant les angoisses causées par la santé précaire de mon maître et ami.
***
Le destin lui fut encore une fois favorable et il se rétablit. Il retrouva même dans sa musique une nouvelle jeunesse qui illumina toute la dernière période de sa vie en le rendant tout à fait célèbre et en lui apportant les honneurs et les titres auxquels, ma foi, il n'avait jamais songé jusqu'alors — car Messager était un modeste. Il devint, depuis ce moment jusqu'à sa mort « l'éminence grise » du monde musical. Fauré, qui l'avait précédé dans cette voie lui avait laissé la place en s'éteignant avant lui, en 1925.
Cet honneur curieux et redoutable, cette sorte de puissance occulte qui donne le ton et le diapason, fait ou défait les réputations, influence la presse, crée la mode, lance l'anathème ou porte aux nues tel ou tel, suivant le caprice ou l'humeur du matin, Messager en fut investi soudain. C'est une sorte de pouvoir absolu que le Paris artistique octroie périodiquement à l'un de ses meilleurs favoris qui, tout à coup, se trouve tout puissant, touché par la grâce, et Tabou !
Affirmer que l'élu n'en abusera pas parfois serait téméraire... et quand je me remémore toute la vie de Messager, ce n'est peut-être pas dans cette dernière période, qui fut pour lui presque un règne, qu'elle m'apparaît sous son aspect le meilleur. La politique d'art devient alors règle essentielle et dans un tel sommet on est souvent tenté d'être injuste, exclusif et redoutable.
***
L'apothéose finale, le couronnement, commencèrent pour lui avec le succès de l'Amour masqué. Ayant rencontré Tristan Bernard à la Société des Auteurs, j'eus avec lui une conversation au cours de laquelle il me parla très affectueusement de Messager : « Après sa maladie et l'insuccès de la Petite Fonctionnaire, me dit-il, nous pouvions craindre que son étoile ne pâlit, mais l'Amour masqué le remet sur pied et le voilà parti de nouveau vers de belles destinées ! »

André Messager faisant travailler l'Amour masqué à Yvonne Printemps (1922)
L'histoire de l'Amour masqué est assez curieuse et Jean Messager l'a racontée ainsi : « Un soir, dans sa loge, Sacha Guitry reçut la visite d'un compositeur anglais fort en vogue, M. Ivan Caryll. Celui-ci lui demanda un livret. Sacha Guitry se mit en devoir d'écrire la pièce demandée, mais son premier acte n'était pas encore achevé qu'Ivan Caryll mourait presque subitement. C'est alors qu'il songea à demander à Messager d'écrire la partition de l'Amour masqué. »

André Messager travaillant avec Sacha Guitry (1922)
Des liens d'amitié unissaient les deux auteurs. Sacha Guitry, comme plus tard Albert Willemetz, apporta au musicien l'appoint précieux de son grand talent. Messager qui était lui-même, par sa musique, le meilleur représentant d'un art où se révèle toute la finesse de l'esprit parisien, eut vite fait de s'y retremper. Avec l'Amour masqué, il réalisa la comédie musicale vers laquelle il avait toujours aspiré. Propos charmants, où la grâce et l'émotion rivalisent dans le texte autant que dans la musique, intimement liés dans des canevas qui semblent improvisés, mais n'en demeurent pas moins la fleur d'une époque heureuse et regrettée !
***
Le succès fut complet. Représentée le 13 février 1923 au Théâtre Edouard VII, remarquablement interprétée par Sacha Guitry et délicieusement chantée par Yvonne Printemps, l'exquise comédie musicale réussit pleinement. Ce fut un véritable enchantement (le premier acte, en particulier) et l'on bissa d'enthousiasme les couplets « J'ai deux amants », le « Tango chanté », « Mon rêve ».
A ce propos, Gabriel Fauré adressait à Messager les lignes suivantes qui prouvent une fois de plus la haute estime que l'auteur de la Bonne Chanson témoignait à son ami de toujours :
« Mon cher André, je sais que tu tiens un gros et grand succès avec l'Amour masqué, et j'en suis profondément heureux, comme le sont tous nos amis. Les salles de spectacles me sont encore interdites hélas ! Je ne puis donc pas aller t'applaudir ni me divertir d'une pièce qu'on me dit très amusante et admirablement interprétée. Mais on m'a prêté ta partition. C'est toujours ton esprit — cet esprit qui ne vieillit pas — et ton charme et ta musique si personnelle, et qui reste de l'exquise musique, même dans la bouffonnerie la plus vive. Ce dont je suis privé, c'est de l'amusement de l'orchestre et je m’imagine ce que tu as dû en tirer. Je suis content, mon bon André, et je t'embrasse de tout cœur.
Ton vieux Gabriel Fauré. »
***
Nous n'avons cessé de relater les marques d'affection que, durant sa vie, Fauré témoigna à Messager.
Celui-ci, à son tour, ne manqua pas de lui exprimer son admiration et sa reconnaissance, notamment lors d'une manifestation solennelle donnée à la Sorbonne le 20 juin 1922, en l'honneur de Gabriel Fauré.
A cette occasion, Messager fit paraître dans le Figaro un article dans lequel il retraçait avec éloquence et émotion la noble carrière de l'auteur des Berceaux et du Requiem.
UNE PRÉSIDENCE
Trois mois après l'Amour masqué, Messager qui depuis de nombreuses années faisait partie de la Commission de la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques en fut élu Président, fait unique dans les Annales de cette Société, puisque c'était la première fois depuis sa fondation — qui date de Beaumarchais — qu'un musicien était mis à sa tête.
Le rôle de Président de notre Société, en même temps qu'il honore grandement son titulaire ; le charge journellement d'une besogne incessante et très lourde. Chaque matin, le Président doit examiner les nombreuses questions qui lui sont soumises avant de les résoudre avec la Commission qu'il préside. Il lui faut savoir prendre des décisions conformes à l'esprit des statuts et s'efforcer de ménager les intérêts de chacun, sans enfreindre ceux de la collectivité. L'organisation administrative, les relations avec les directeurs de théâtre, les rapports fréquents avec de nombreux groupements intellectuels ou sociaux, et par-dessus tout la défense du droit d'auteur, tout cela c'est l'apanage du Président et de sa Commission.
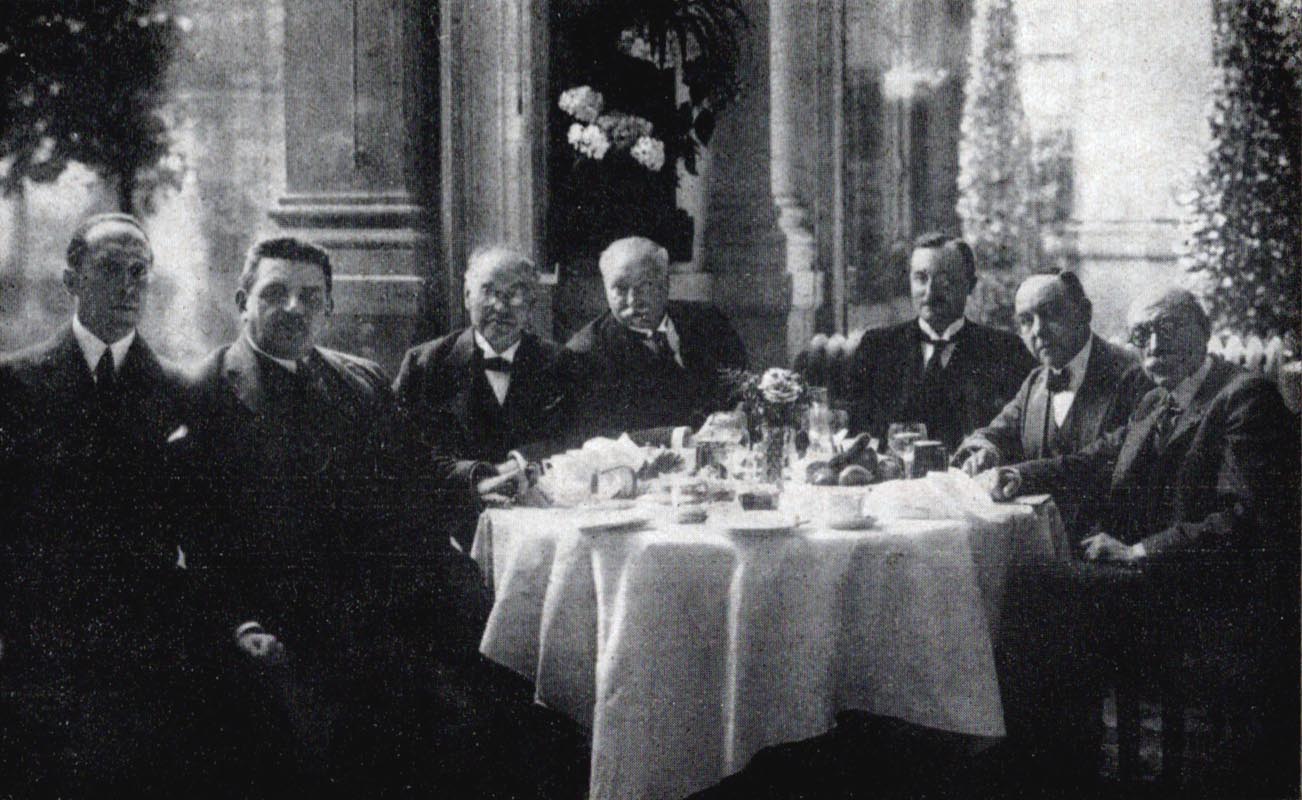
André Messager lors d'un congrès des sociétés d'auteurs, avec Edouard Herriot et Emile Bollaert
On comprend pourquoi Messager, absorbé par ses fonctions, restera encore près de dix-huit mois sans écrire de musique ! Michel Carré, dans un des rapports présentés à l'Assemblée générale, s'exprime ainsi à ce sujet :
Nouveau venu à la Commission, j'ai pu, dès la première année, me rendre compte de l'activité incessante dont doit faire preuve le Président de la Société, à quel point il est entraîné à négliger ses propres intérêts pour s'occuper des nôtres, contraint d'oublier qu'il est poète ou dramaturge devenu par la multiplicité des questions à résoudre, un homme d'affaires et pas autre chose que cela ! »
Vous pensez combien, s'il était compositeur, il lui restait peu de loisirs pour s'adonner à l'exercice lent et laborieux de notre profession ! Messager en profita, du moins, pour entretenir les relations les plus affectueuses et les plus suivies avec la plupart de ses confrères de la Commission.
Vous dirai-je les noms de ces camarades, de ces amis véritables, qui entourèrent de leur sollicitude la présidence d'André Messager ? Sans les citer tous, je désignerai Robert de Flers, Romain Coolus, Brieux, Henri Kistmaekers, Charles Méré, Henri Rabaud, René Peter, Pierre Weber, Hirchmann, Henri Duvernois, Hugues Delorme, Gleize, Michel Carré, René Lenormand, Adrien Vély, et, plus tard, Fernand Rouvray.
***
Parmi ceux-ci, René Peter, esprit observateur et subtil, historiographe apprécié de Debussy, s'était pris de grande amitié pour Messager et cette inclination qui nous était commune avait contribué à nous rapprocher.
Quand Messager s'éteindra en 1929, et après que René Peter eut épousé en secondes noces la belle-fille du compositeur, nos bons rapports s'accentueront pour s'étendre jusqu'à un groupe d'amis que Peter réunira chez lui chaque samedi.
Le soir, la réception terminée, quelques intimes, dont Fernand Gregh, Georges de Lauris, Jules Cayron, Charles Oulmont (*) restaient avec nous à deviser sur tous les sujets, tandis que Mme Lily Peter, par sa bonne grâce et l'agrément de son esprit, contribuait à resserrer les liens de cette aimable compagnie.
(*) J'avais connu Charles Oulmont enfant, alors que sa mère, Mme Léon Oulmont, m'accueillait chez elle, place Malesherbes et interprétait avec talent, dans ses réceptions musicales, quelques-unes de mes mélodies.
Quand vint la guerre de 1939, nous espérâmes trouver dans ces diversions un apaisement aux tourments qui nous accablaient — sans y parvenir hélas ! — car chaque samedi apportait avec lui un horizon mouvant qui variait selon les événements à travers des alternatives d'angoisse et d'espoir...
Dans ces instants — comme aujourd'hui, en 1947 — le souvenir de Messager a continué de planer sur nos pensées et Lily Peter n'a cessé d'entourer sa mémoire d'une filiale mansuétude.
***
Si l'on veut se rendre compte du labeur d'André Messager et des travaux auxquels il associa son expérience et son nom durant ses deux années de présidence, il suffit de parcourir les rapports annuels de la Commission pour la période 1924-1926.
Lucien Gleize termine celui qu'il rédigea, par l'éloge du Président Messager :
« Est-ce le bâton du chef d'orchestre, est-ce le sceptre directorial qui lui apprit à diriger, toujours est-il que la Commission a retrouvé un vrai chef. Ce n'est pas seulement en silhouette qu'il évoque l'allure d'un officier de cavalerie. Il sait vouloir et commander. Il voit net, il parle clair et bref. Ce qui nous encourage à tâcher d'en faire autant. Comme il est depuis longtemps au courant des affaires de la Société, ses décisions sont pertinentes et rapides. Et surtout il n'essaie pas toujours et quand même de ménager toutes les chèvres et tous les choux. Quand quelque chose ou quelqu'un lui semble blâmable, il le dit et vivement. Ah ! Messieurs, que cela est bien ! Je veux arrêter son éloge sur ce dernier trait, je ne trouverai pas meilleur. »
Le rapport est mis aux voix, adopté à l'unanimité, et l'un des membres de l'Assemblée, M. Jules Chancel — si j'ai bonne mémoire — se lève et fait la déclaration suivante qui honore la présidence de Messager :
« Je tiens à déclarer et je suis persuadé que ce n'est pas seulement mon avis personnel — que jamais le travail de la Commission ne nous apparût aussi utile et aussi fructueux que cette année. »
En 1925, Messager est renommé Président. Il consacre encore toute cette seconde année à se dévouer à sa tâche ardue, abandonnant pour l'intérêt de ses confrères sa plume de compositeur. L'activité reste son apanage, la souplesse de son esprit lui permet d'aborder et de résoudre tous les problèmes qui se posent (*).
(*) Sachons gré aussi à quelques compositeurs qui, à l'exemple de Messager, ont sacrifié leur activité à la cause commune : Henri Rabaud, Büsser, Hirchmann et Goublier sont de ceux-là. Rabaud et Büsser ont su accomplir en même temps leur haute tâche d'éducateurs au Conservatoire (dont Rabaud fut l'un de nos meilleurs directeurs). Les œuvres de ce dernier honorent la musique française : la Fille de Roland, Mârouf (au répertoire de l'Opéra), Martine, écrite en 1947 d'après la pièce de Jean-Jacques Bernard, sont des chefs-d’œuvre du théâtre lyrique comme l'est, dans le domaine symphonique, la Procession nocturne.
Henri Büsser, musicien réputé des Noces corinthiennes et de Colomba s'intéresse à tout : à l'occasion avisé directeur, professeur de composition au Conservatoire, il conduit triomphalement tous ses élèves jusqu'au prix de Rome, tandis que Claude Delvincourt et Jacques Ibert le suivent dans la course. A l'arrivée, parmi les arbitres, Georges Hüe et Florent Schmitt indiquent les gagnants qu'ils apprécieront, l'un selon le chaud lyrisme de Titania et du Miracle, l'autre suivant les richesses du Psaume et de la Tragédie de Salomé...
***
L'impulsivité qu'on trouve dans la nature de la plupart des compositeurs et qui, dans l'exercice de leur profession, devient une qualité, se retourne parfois contre eux dans les heurts de la vie quotidienne. Messager possédait cette impulsivité au plus haut point et bien souvent, on était amené à la confondre chez lui avec une certaine versatilité dont quelques-uns ont pu lui faire grief. Elle l'amenait parfois à des mouvements d'humeur qui le plaçaient soudain dans des attitudes difficiles à modifier. Directeur de l'Opéra, on le vit plusieurs fois offrir brusquement sa démission, alors que le Ministre s'ingéniait à la lui faire reprendre et qu'il la reprenait finalement en laissant l'impression d'un coup d'épée dans l'eau. Quand on répétait ses pièces, il n'était pas toujours d'humeur commode et de fréquentes brouilles avec les directeurs, avec ses collaborateurs ou ses interprètes, venaient parfois porter le trouble sur le plateau.
Aux assemblées de la Société des Auteurs, il y eut quelques incidents où son émotivité — pour ne pas dire son irritabilité — l'entraîna parfois plus loin qu'il n'eût fallu. Je me souviens d'une discussion assez vive dans laquelle Henry Bernstein était intervenu avec son ardeur habituelle ; il s'agissait, je crois, de délimiter les rapports entre l'Union des Artistes et la Société des Auteurs, de telle manière que cette importante association ne compromit pas, par ses règlements intérieurs, les intérêts des auteurs joués à l'étranger. Messager, qui présidait la séance, se laissa aller à un mouvement d'impatience tel qu'on le vit tout à coup quitter le fauteuil présidentiel, tandis qu'Henry Bernstein, dans un élan spontané, le retenait et le serrait affectueusement dans ses bras en le suppliant de rester à son poste de commandement. Messager reprit vite son sang-froid et les applaudissements unanimes de l'assemblée lui prouvèrent une fois de plus l'estime et l'affection de tous, en lui apportant l'excuse immédiate d'un mouvement impulsif réprimé aussitôt... On avait compris qu'un grand musicien a parfois le droit « d'avoir ses nerfs ! »
MADAME DE SAINT-MARCEAUX
Le moment est venu d'évoquer ici le souvenir. d'une femme de haute intelligence et de goût raffiné qui exerça sur la destinée des plus grands artistes de son temps une influence aussi heureuse que bienfaisante : je veux parler de Mme René de Saint-Marceaux. Il n'est guère possible d'écrire la vie de Messager sans jeter un long regard sur le rôle de cette amie fidèle qui sut, pour lui comme pour tant d'autres, encourager leurs efforts, partager leurs luttes et les suivre avec sollicitude pas à pas, à travers leurs joies et leurs peines.
Apparentée aux meilleures familles de la société parisienne, elle avait épousé en premières noces le peintre Eugène Baugnies. Son goût très vif pour la musique l'avait auparavant fait remarquer par Camille Saint-Saëns qui, dit-on, la demanda en mariage. Mais ce musicien, encore inconnu, n'avait pu obtenir le consentement de la famille de la jeune fille. Peut-être n'eut-elle pas à le regretter dans la suite, étant donnée la nature capricieuse et quel que fût le génie musical du prétendant évincé !
Sitôt mariée avec Eugène Baugnies, elle commença à grouper autour d'elle, entre 1875 et 1880, une pléiade de jeunes artistes dont elle sut d'instinct apercevoir la valeur. André Messager, l'un des premiers, fut de ceux-là.
Avec lui, parmi les musiciens : Gabriel Fauré, Emmanuel Chabrier, Massenet, Gounod, Paladilhe. Parmi les peintres — tous amis et camarades de son premier mari — Alphonse de Neuville, Edouard Detaille, Jacquet, Meissonnier, Helleu, Arcos, Duez, Carolus Duran, Paul Mathey, Boldini, Jeanniot. Parmi les sculpteurs : Frémiet (beau-père de Fauré) et Saint-Marceaux qui, après la mort d'Eugène Baugnies, allait devenir son second mari. Parmi les littérateurs : Ernest Renan et Melchior de Voguë.
Vers 1880, elle fit construire son hôtel du boulevard Malesherbes par l'architecte Jules Février (père de l'auteur de ces lignes) et dans cette maison, tous les vendredis, se réunira pendant plus d'un demi-siècle une élite intellectuelle qui se transmettra de génération en génération les rites de l'art contemporain.
Son mariage avec Saint-Marceaux fut le symbole d'une union heureuse et fertile par l'esprit, qui contribua largement — tant ces deux êtres étaient faits pour se comprendre et s'élever dans les choses de l'art — à élargir le cercle de leurs relations mondaines et artistiques. L'entrée de Saint-Marceaux à l'Institut y contribua grandement.
Voici en quels termes Miguel Zamacoïs a relaté dans le Figaro du 8 mars 1931 les nobles buts poursuivis par cette femme qui honora hautement l'esprit et la culture de son temps :
« Quelle animatrice prodigieuse fut Mme de Saint-Marceaux ! D'intelligence vive, douée du goût et du jugement les plus sûrs, passionnée dans toutes ses entreprises, elle a fait de son salon l'un des centres les plus brillants du mouvement intellectuel et artistique contemporain ; l'élite des écrivains, des peintres, des sculpteurs, des musiciens, s'est pressée aux charmantes réunions du vendredi soir. Musicienne incomparable, Mme de Saint-Marceaux avait fait aussi et surtout, de sa maison, une sorte d'académie de musique ; éclectique, curieuse de l'évolution progressive, se tenant, comme l'on dit aujourd'hui, à la page, elle accueillit, encouragea, lança nombre de jeunes compositeurs ou virtuoses débutants avec la même bienveillance empressée qu'elle avait témoignée à tant d'anciens glorieux. C'est tout ce qui a eu un nom à cette époque dans les arts et les lettres qu'il faudrait citer puisque l'accueil dans les salons du boulevard Malesherbes équivalait à un brevet de talent et de notoriété. »
En effet, le précieux aréopage s'élargit de jour en jour et l'on vit apparaître boulevard Malesherbes, chaque vendredi, de nouvelles figures qui, sympathisant entre elles, discutaient des goûts du jour et formaient un influent cénacle qui lançait la mode, louant les uns et blâmant les autres, avec une autorité digne des plus renommés salons du dix-huitième siècle.
Messager fut vraiment l'enfant gâté de la maison. Accueilli là tout jeune, dès le début de sa carrière, il excellait à se mettre au piano pour faire connaître aux invités du vendredi tout ce qui paraissait en musique et c'était bien une stupeur de voir l'auteur de Véronique exprimer magnifiquement dans des déchiffrages prestigieux les plus belles pages de Wagner, de Debussy, de Richard Strauss, qui semblaient à l'antipode de son art !
***
Tous les vendredis, Messager et Fauré venaient dîner chez leurs amis Saint-Marceaux. Avec eux, parmi les intimes de la maison : Mme Alexandre Dumas, la Princesse de Polignac, Edouard Imbs, Henry Aubépin, Pierre de Bréville, Ernest Chausson, Pierre Lalo, Vincent d'Indy, Paul Dukas, Paul Mathey et sa fille si finement musicienne, Paul Poujaud, William Ablett, Zamacoïs, André Beaunier, Albert Aublet, Jean-Louis et Georges Vaudoyer et d'autres encore.
Les trois fils de Mme de Saint-Marceaux : Georges, Jacques et Jean Baugnies, auxquels j'étais apparenté, entouraient leur mère et la secondaient dans cet art de recevoir où nulle à Paris n'excellait mieux qu'elle.
Les personnalités de marque étaient accueillies avec cette aisance et cette simplicité distinguée qui étaient le meilleur charme de la maison. Nulle gêne, nulle préférence : Maurice Ravel et Reynaldo Hahn s'y trouvaient invités tout comme Massenet et Vincent d'Indy et on apercevait ainsi combien l'éclectisme régnait dans ce milieu de choix.
Les conversations se poursuivaient sitôt dîné et s'élargissaient dès l'arrivée de nouvelles figures qui venaient s'y mêler durant la soirée. Les uns continuaient à deviser par petits groupes, tandis que les autres s'empressaient autour du piano pour lire les dernières nouveautés. Mais ne croyez pas qu'on lisait là tout ce qui paraissait ! Un choix sévère et quelque peu hautain se faisait d'instinct parmi ces professionnels et ces initiés, tandis que le bon goût et le meilleur ton étaient toujours de règle. Une sélection certes, mais nulle préciosité ; un vif et curieux désir de connaître, dans l'admiration ou la critique souvent impitoyable.
D'autres fois, des cantatrices et des virtuoses en renom faisaient entendre la dernière page des maîtres du jour. C'est là que Fauré apporta, dans cette intimité qu'il aimait, ses mélodies dédiées tantôt à Mme Marguerite Baugnies (avant qu'elle fût Mme de Saint-Marceaux), tantôt à Emmanuel Jadin, familier de la maison, et à d'autres amis de ce milieu. C'est là que nous entendîmes les premiers la Bonne Chanson, le Parfum impérissable, la Chanson d'Eve et tous ces lieds profonds et délicats, fleurs de la mélodie française moderne, avec ceux de Duparc et de Chausson.
Debussy, à l'époque de la Damoiselle élue, fréquenta le salon de Mme de Saint-Marceaux. Il y fut même question pour lui d'un mariage qui ne pouvait avoir de suite.
***
Willy et Colette Willy ne manquèrent pas un vendredi durant des années (*). Willy exerçait alors une sorte de terrorisme sur le monde musical par ses « Lettres de l'ouvreuse » et ses articles de critique. C'était un esprit cultivé, blagueur et acerbe. Il s'en prenait au Conservatoire de Théodore Dubois en s'employant à défendre ardemment la Schola de d'Indy. En qualité d'invité des vendredis, Willy savait montrer qu'il était de bonne éducation et plaisait, tant par son esprit vif et spirituel que par son goût des choses de la musique.
(*) Dans Journal à Rebours (Colette, p. 125).
Salon de Mme de Saint-Marceaux :
« Nul ne trouvait mauvais que Saint-Marceaux s'absorbât dans une lecture... que Gabriel Fauré préférât à la musique le plaisir de dessiner en trois traits de plume le portrait de Kœchlin long et barbu ou celui d'Henry Février, père de Jacques… »
Parmi ces personnalités si variées, Messager, passionné de musique et dilettante, avait vite fait de séduire chacun. Sa modestie naturelle le servait à souhait, autant que l'agrément de sa nature ; il ne prétendait point vouloir se mettre au premier plan comme compositeur et les autres musiciens, au fond d'eux, lui savaient gré de cet effacement opportun, d'autant qu'il mettait ses dons et son intelligence au service de leurs œuvres ! Certes, dans l'intimité, il savait s'épancher et c'est aux amis de tout repos qu'il montrait ses partitions : Mme de Saint-Marceaux était de ceux-là, avec nous-mêmes qui l'aimions et l'apprécions. Mais, durant de longues années, il s'abstint prudemment boulevard Malesherbes de toute ostentation personnelle et s'il y fréquentait sans discontinuer la musique de ceux qui semblaient plus grands que lui — et qu'il admirait vraiment — il demeura effacé pour la sienne, qu'on parut d'abord négliger, sinon méconnaître... Ironie des choses ! Ne pensez-vous pas que bien des pages altières et hautaines dureront moins longtemps que le prologue d'Isoline ou même que le duo de l'âne de Véronique ?
On n'entendait pas seulement les compositions des maîtres modernes consacrés, mais encore les essais des débutants en bonne posture : Ravel, Florent Schmitt, Roger Ducasse, Marcel Labbey, Castéra, de Falla, Samazeuilh, Honegger, Poulenc, y firent presque leurs débuts. C'est là qu'on savoura pour la première fois des pages désormais célèbres, telles que les Jeux d'eau et la Pavane pour une infante défunte.
Reynaldo Hahn, aussi indépendant que profondément musicien, y apporta ses premières mélodies, qu'il chantait délicieusement, tandis que Cortot, Enesco, Risler, Jacques Thibaut y affirmaient leurs talents. Inutile de dire que l'auditoire n'était pas le même chaque vendredi et qu'il variait selon les musiques et les musiciens qu'on lui présentait. C'est une règle que doivent observer ceux qui entreprennent de faire connaître des talents nouveaux et Mme de Saint-Marceaux l'appliquait avec un tact parfait. Elle savait mieux que personne que ceux qui goûtaient seulement Massenet ou Gounod pouvaient difficilement apprécier d'Indy ou Dukas — et réciproquement — à moins que le snobisme...
***
Il y eut trois périodes distinctes : la première, très courte, embryon des autres, de 1875 à 1880 — la seconde, l'apogée, de 1880 à 1914 — la troisième, celle d'après-guerre, qui durera jusqu'à la mort de notre bienfaisante amie en 1930. Messager qui la précéda d'un an dans la tombe, fit partie des trois périodes, ainsi que Fauré qui mourut en 1924.
Dans la dernière phase, de nouveaux musiciens — nos jeunes d'hier ! — accoururent à leur tour et nous eûmes la joie d'entendre, amenés par eux, de grandes interprètes, telles que Jeanne Raunay, Croiza, Marguerite Long, ainsi que Charles Panzéra, Jouatte, Borowsky. Mon fils y fit lui-même ses premières armes et ce fut pour lui un précieux encouragement dans l'art du piano (*). J'y fis connaître mon Trio interprété par Ricardo Vinès, Enesco et Casals, ma Sonate pour piano et violon, ainsi que des fragments du Roi aveugle et de Monna Vanna dont j'avais écrit le second acte en l'automne 1905 à Cuy-Saint-Fiacre, charmant hameau de la Haute-Normandie, où les Saint-Marceaux possédaient un élégant cottage, parmi les boqueteaux et les pâturages qui entourent Gournay-en-Bray.
(*) Messager ne cessa jamais de s'intéresser à Jacques Février. Il l'écoutait avec attention à Montivilliers et tandis que, tout enfant, celui-ci jouait devant lui du piano et déchiffrait sans relâche, Messager me disait souvent : « Il est doué, il faut le pousser. » Maurice Ravel, lui aussi, avec lequel nous vécûmes si longtemps en grande intimité ne cessa jamais de témoigner à Jacques Février les plus affectueux sentiments, l'entourant comme un enfant qu'il avait vu naître et lui confiant, à Paris et en Amérique, l'exécution du Concerto pour la main gauche.

Madame de Saint-Marceaux (assise) à Cuy-Saint-Fiacre
Messager passa à Cuy de nombreux étés, surtout à la fin de sa vie. Il y retrouvait cet agrément de la campagne mêlé au confort anglais et cela lui rappelait ses villégiatures à Montivilliers et à Maidenhead. Mme de Saint-Marceaux l'accueillait avec joie ; elle vivait là d'une existence à la fois active et reposante dont le travail et la promenade étaient les meilleurs éléments. Vie ordonnée où chacun vaquait à ses occupations : Saint-Marceaux à la sculpture, Messager et elle-même à la musique, Jacques Baugnies à la peinture. Tous les arts étaient représentés.
Hélas ! le cottage de Cuy est toujours là (*), mais ses hôtes ont disparu. Notre amie repose dans ce petit cimetière de campagne, près de son fils Jacques que la mort lui enleva en pleine maturité de talent.
(*) Quoique pillé et dévasté maintenant.
Tous ces visages amis marquent une place importante dans la vie de Messager comme dans la mienne et ce m'est un devoir d'affection de fixer ici leurs traits et leur souvenir.
L'AURÉOLE
Reportons-nous en 1924. Messager qui préside la Société des Auteurs se consacre presque entièrement à sa tâche durant dix-huit mois. Mais il ne cesse de suivre avec la plus grande attention le mouvement musical. Toujours dévoue à la cause des jeunes musiciens, il prend plaisir à diriger aux Ballets russes les œuvres de la jeune école d'après-guerre, telles que les Biches de Francis Poulenc, les Fâcheux de Georges Auric, le Train bleu de Darius Milhaud.
Cependant le théâtre continue à l'intéresser et à l'attirer. Il consacre ses soirées aux répétitions générales auxquelles il se plaît à assister, car l'ambiance lui en est sympathique. Ayant succédé à Fauré au Figaro il écrit des articles de critique avec assiduité et indépendance (*).
(*) La critique d'art tient une part assez restreinte dans la carrière de Messager, son activité s'étant exercée de préférence sur d'autres matières. Il fut plus un créateur qu'un exégète. Si la plume du chroniqueur est moins féconde chez lui que celle du musicien, elle n'en demeure pas moins toujours très avertie.
En glanant çà et là dans ses articles du Gaulois et du Figaro on relève, outre ses opinions sur les œuvres qu'il examine, des souvenirs personnels concernant des maîtres de la musique et un aperçu de ses doctrines d'esthétique. On le retrouve là tel qu'il était en toutes circonstances : sobre, précis, incisif, sans exagération ni emphase.
Mais, derechef le voici en vedette : pour inaugurer le nouveau Théâtre Marigny, Léon Volterra donne la version française de Monsieur Beaucaire le 20 novembre 1925 avec André Baugé et Marcelle Denya. Nous avons dit que Monsieur Beaucaire avait été créé à Londres, en 1918, au Prince's Théâtre ; à Paris, la pièce connaît le même succès. Opérette romantique, modèle du genre, empreinte de gaîté et de sentimentalité, elle devint le point de départ d'un nouveau répertoire lyrique.
***
Vient ensuite, le 19 janvier 1926, au théâtre de la Michodière Passionnément sur un charmant livret de Maurice Hennequin et Albert Willemetz où le personnage de l'américain Stevenson est créé d'une façon inoubliable par l'acteur Koval. Cette partition est de la manière de l'Amour masqué : fine comédie musicale, dont chaque morceau est un bijou d'esprit et d'agrément (*).
(*) Là encore, Messager paraît tendre vers un art plus dépouillé et une plus grande simplicité de moyens. Il semble qu'il ait voulu prendre le vent... N'était-il pas toujours habillé à la dernière mode ?... En somme, la manière de Christiné et d'Yvain adaptée à la personnalité de l'auteur de Véronique.
L'orchestration, comme celle de l'Amour masqué, est faite pour un nombre restreint d'instruments, on y retrouve toute la finesse de Messager, tout son coloris. Il a si bien conscience de sa perfection d'instrumentateur que lorsqu'il s'agit, sur l'instigation de Francis Salabert, son éditeur, d'une version orchestrale réduite de la partition à l'usage des petits théâtres, il n'hésite pas à la faire lui-même. Il vient s'installer dans un hôtel d'Etretat pendant un mois d'été et se complait dans ce travail qui le divertit.
***
Un heureux événement : le 8 mai de la même année il est élu membre de l'Académie des Beaux-Arts en remplacement de Paladilhe. Il s'était déjà présenté plusieurs fois et il eût sans doute rencontré dans Vincent d'Indy et Paul Dukas des concurrents redoutables si ceux-ci avaient à ce moment posé leur candidature. Messager est désigné par la section musicale de l'Académie des Beaux-Arts qui reconnaît en lui le digne continuateur de l'opéra-comique français, de la lignée des Hérold, Boieldieu, Auber et Léo Delibes. Ce glorieux hommage rendu à son talent le touche profondément. Il s'en montre très ému et ses amis partagent avec lui sa joie et sa fierté.
Que de chemin parcouru des Folies-Bergère à la Coupole !
***
Il part se reposer à Royan où il a passé l'été de 1926. C'est là qu'il écrit la musique de Deburau destinée à accompagner la pièce de Sacha Guitry pour la reprise qu'en font les frères Isola le 9 octobre suivant, en inaugurant leur direction du théâtre Sarah-Bernhardt.
C'est pendant ce séjour à Royan, qu'il ressent la première atteinte de la maladie qui devait lui être fatale. Sa santé commence à s'altérer et le moment est proche où il va être contraint de se remettre de nouveau entre les mains des médecins et des chirurgiens. Il triomphera plusieurs fois des épreuves physiques qu'il va subir. A un moment, une embolie — heureusement partielle — est sur le point de le terrasser. Sa vitalité et son énergie le préservent encore, comme par miracle !
Je me souviens d'une visite que je lui fis à la maison de santé de la rue de la Chaise quelques jours après qu'il eût échappé à ce mortel danger.
Je le trouvai pâle et amaigri sur son lit de souffrance, mais la volonté de vivre le dominait à tel point que je reconnus soudain en l'observant sa physionomie d'autrefois, celle de Montivilliers, celle de sa jeunesse, de cette jeunesse que son esprit n'avait jamais cessé de conserver à travers les plus périlleuses épreuves !
Mais le mal qui le minait et qu'il combattit jusqu'au bout avec courage ne le terrassa pas d'emblée et lui laissa quelques répits qui lui permirent de terminer sa vie en beauté, car il resta jusqu'à la fin en pleine possession de ses moyens et de ses élans.
A son retour de Royan il m'adressa — à Gailladé, où je passais mes vacances avec Marc Delmas — les lignes suivantes, qui attestent sa résignation et sa fermeté d'âme devant le mal dont il souffrait :
« 103, rue Jouffroy.
6 septembre 1926.
Tu es bien gentil, mon cher Henry, de m'avoir donné de tes nouvelles. J'ai passé un été bien médiocre et suis rentré ici me faire radiographier à la suite d'une horrible crise de coliques néphrétiques et faire constater la présence dans mon rein gauche d'un énorme calcul, cause de tout le mal. Rien à faire du reste qu'à attendre le retour de nouvelles crises. J'ai écrit pour me distraire de la musique de scène pour la reprise de Deburau de Sacha Guitry au théâtre Sarah-Bernhardt, amusant à faire, mais délicat. Ça passera dans les premiers jours d'octobre. Et toi, qu'as-tu fait ? Tu ne me dis rien de tes travaux.
Mille affectueuses amitiés. »
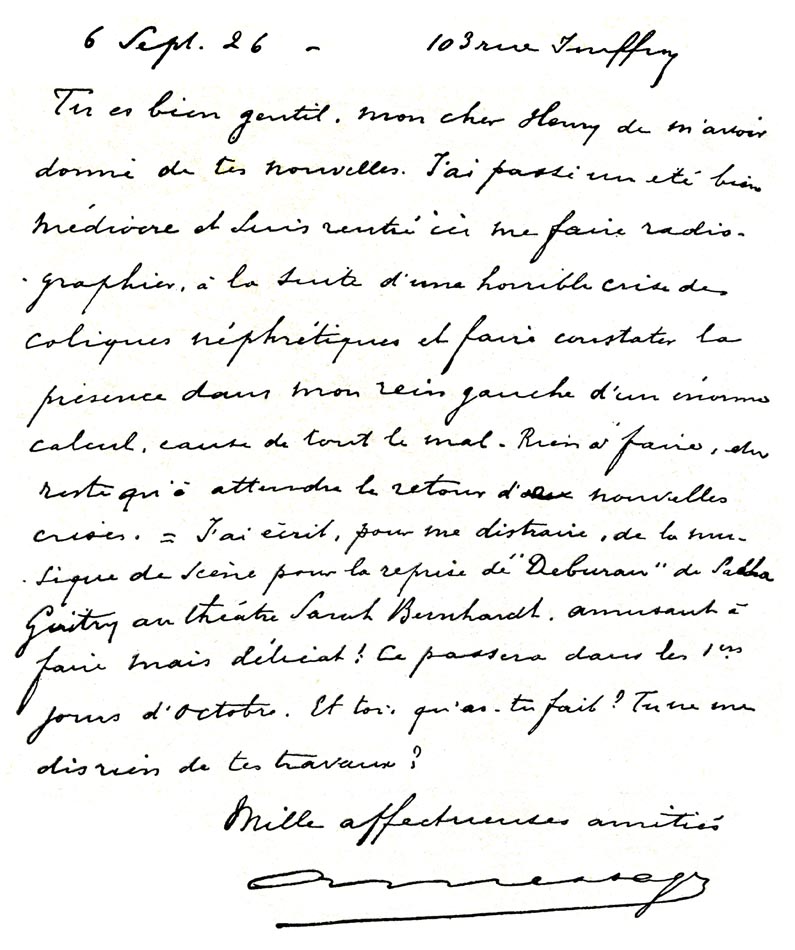
une lettre de Messager à Henry Février
Stoïque et résigné il ne s'attardait jamais sur lui-même ! Lorsqu'il vient à parler de ses maux, il semble vouloir les écarter d'un geste brusque : « parlons d'autre chose ! » dit-il, et le nuage sombre s'évanouit soudain. Son esprit lucide s'élance de nouveau vers la vie, à laquelle il tient tant, et qu'une stupide fatalité menace de lui ravir au moment même où tout s'ouvre devant lui ! Car pour lui, toutes les joies arrivent en même temps, mais peut-être bien tard. Les titres officiels qu'il n'avait ni espérés ni recherchés montent vers lui comme des lauriers presque posthumes. Plus l'heure de sa fin approche, plus la fortune lui sourit, à tel point qu'elle entend le combler à l'instant où tout va lui échapper !
Le 7 septembre 1927, déjà membre de l'Institut et président de la Société des Auteurs, il est promu commandeur de la Légion d'Honneur. (Remarquons que contrairement à celui de certains autres personnages, son avancement ne fut pas des plus rapides car il resta seize ans chevalier et vingt ans officier.)
C'est dans un répit que lui laisse son état chancelant qu'il se remet au travail pour écrire Coup de roulis, sa dernière œuvre.
***
Messager adorait la lecture et en parcourant les romans de Maurice Larrouy il avait distingué d'abord l'un d'eux intitulé Leurs petites Majestés. Mais son choix se porte de préférence sur Coup de roulis. Il prie Albert Willemetz, son excellent collaborateur de Passionnément, d'écrire un scénario d'opérette sur ce sujet (*).
(*) Actif, fertile et spontané, finement doué, Albert Willemetz possède le don de plaire et de charmer. On découvre chez lui, autant dans son œuvre souriante que dans la vie de chaque jour, un esprit sensible et enjoué, l'élégance des sentiments, le trait satirique. Si deux auteurs étaient faits pour se comprendre c'est bien Messager et lui. Seuls, Passionnément et Coups de roulis les a réunis. Que d'autres gracieux chefs-d’œuvre nous eussent-ils donnée s'ils s'étaient, connus plus tôt !
Willemetz se met aussitôt au travail et dès que la pièce est terminée Messager commence à composer sa partition. Enthousiasmé par le livret il l'achève très rapidement en moins de six mois.
La pièce est difficile à placer. Certes, il est sollicité mais ne consent à aucune concession. Il préfère même attendre un an s'il le faut et dans un interview publié dans Comedia il déclare « qu'il accepte tous les retards plutôt que de passer par les mares stagnantes des directeurs ». Il se console en jouant sa partition à ses amis et j'eus la joie d'en avoir la primeur un jour qu'il vint déjeuner avec nous.
LE CHANT DU CYGNE
Jean Messager, en parlant de la dernière œuvre de son père : Coup de roulis, après avoir défini dans quelles circonstances le compositeur avait porté son choix sur le roman de Larrouy, précise la genèse de cette collaboration et son fécond résultat :
« Il restait à chercher le théâtre où cette nouvelle œuvre pourrait être représentée. Etant donnée la mise en scène assez importante, il fallait un cadre suffisamment vaste. Aussi les auteurs pensèrent-ils au Théâtre Marigny où trois ans auparavant André Messager avait fait représenter Monsieur Beaucaire. Le directeur, Léon Volterra, ayant reçu Coups de roulis, les répétitions commencèrent au mois de juin 1928 et furent interrompues au moment des vacances. C'est pendant cette interruption que Messager fut atteint à Aix-les-Bains d'une nouvelle crise rénale plus violente encore que celle qu'il avait subie à Royan deux ans auparavant. Comme il s'était rétabli à peu près grâce à sa robuste constitution, les répétitions reprirent au début de septembre sous sa direction et le 28 du même mois, il montait lui-même au pupitre pour conduire la répétition générale. Ce fut un très gros succès dont le point culminant fut le final du premier acte. C'est que, malgré ses soixante-quatorze ans, Messager avait conservé une fraîcheur et une jeunesse d'inspiration rares chez un homme de cet âge. La distribution particulièrement brillante comprenait Mlles Marcelle Denya et Maguy Varna ; MM. Raimu, Robert Burnier, Pierre Magnier et Gustave Nelson.
Un fait montrera à quel degré Messager poussait la conscience artistique :
Parmi les nombreux morceaux de sa nouvelle partition, deux surtout avaient ses préférences : l'un chanté au deuxième acte, s'intitulait « la Quarantaine », l'autre, au troisième, les couplets du « Devoir ». Or, il n'hésita pas à les couper la veille de la générale, le premier parce que l'artiste chargé du rôle, éminent comédien, n'était pas un chanteur, le second parce qu'il faisait longueur. Aussi préféra-t-il ce sacrifice plutôt que de compromettre le succès de la pièce. Celle-ci fut donnée une première fois jusqu'au 21 avril 1929 et reprise ensuite du 31 janvier 1930 au 11 mai de la même année. Cette fois-là, « la Quarantaine » fut rétablie, l'interprète étant alors un chanteur. Mais Messager étant mort pendant la première série des représentations ne put jamais l'entendre ni jouir du grand succès de Coup de roulis qui, arrivant après plus de trente œuvres précédentes, fut son véritable « chant du cygne ». »
***
Au lendemain de la première de Coup de roulis, la maladie l'attaque de nouveau. J'ai conservé un pieux souvenir des derniers mois de sa vie. J'avais été nommé membre de la Commission de la Société des Auteurs en mai 1928. Messager en faisait partie mais son mandat comme le mien devait expirer en mars 1929, car notre Société, après cent ans d'existence, devait se renouveler sur des bases nouvelles en modifiant ses statuts. J'eus donc la satisfaction, durant ces quelques mois, de siéger auprès de lui et de l'entourer avec mes collègues d'une affection d'autant plus vive que nous sentions tous que sa fin était proche. Surmontant son mal, il s'efforçait de suivre assidûment toutes nos séances de commission et mieux encore il ne manquait presque jamais de venir parmi nous au déjeuner qui, chaque vendredi, clôturait nos réunions. Il s'y montrait, comme auparavant, un convive agréable et enjoué. Sa bonne humeur semblait le soutenir : il continuait de s'intéresser à tout, et sa conversation aussi animée que variée se mêlait sans effort à celles de notre président Brieux et de nos amis.
***
J'eus avec lui, dans ces occasions d'intimité, de nombreux entretiens où nous envisagions amicalement tous deux l'avenir de notre musique française et de ses représentants. Je m'efforçais, le sentant résigné, mais courageux, de lui laisser apercevoir la place glorieuse que lui réserverait la postérité... Il s'en montrait ému et reconnaissant car il restait simple et éloigné de toute vanité. J'eus la joie, dans ces moments ultimes, de ne plus ménager sa modestie, de la froisser presque, en lui disant enfin à cœur ouvert toute l'admiration que je ressentais pour son œuvre et que tous partageaient ou partageraient bientôt. S'en doutait-il au fond de lui ? Je l'ignore encore. Comprenait-il qu'avec la comédie musicale il avait consacré un genre où l'esprit français trouve son essor dans la plénitude de ses moyens et de sa grâce ?
Mais le mal empirait et ses forces déclinaient. Jusqu'au bout, il lutta et n'hésita pas, quoiqu'ayant un pied dans la tombe, à vouloir se représenter encore aux élections de la Société Dramatique. Sa dernière sortie fut pour celle-ci et il tint à venir, rue Ballu, malgré ses souffrances physiques, pour nous exprimer à tous son ardent désir de rester encore parmi nous dans la future Commission. Il ne voulait pas mourir !
Cependant son heure approchait et nous le savions perdu. Quelques jours avant sa fin je proposai à la Commission de le nommer Président d'honneur. Coolus et Peter coururent lui porter la bonne nouvelle en lui disant la part spontanée que j'avais prise dans cette heureuse détermination. Il leur répondit que mon geste « ne le surprenait pas » et cette parole fut la meilleure récompense que je reçus de lui dans ces derniers moments de sa vie.
Quelques jours plus tard, le 24 février 1929, il s'éteignait, entouré des siens.
***
Sa perte fut vivement ressentie de tous : ses amis et ses admirateurs ne pouvaient s'y accoutumer. L'importance de son rôle dans la musique française apparut plus grande encore par le vide que causait sa brusque disparition.
Gabriel Fauré, son ami le meilleur, son camarade de 1'Ecole Niedermeyer, avait su, dès 1908, définir clairement l'art d'André Messager :
« Il n'y a pas beaucoup d'exemples dans l'histoire de la musique d'un artiste d'une culture aussi complète, d'une science aussi approfondie, qui consente à appliquer ces qualités à des formes réputées on ne sait pourquoi secondaires. De combien de chefs-d’œuvre ce préjugé ne nous a-t-il pas privés ? Et c'est encore là que son éclectisme nous apparaît une enviable direction d'art. Avoir osé n'être que tendre, exquis, spirituel, n'exprimer que la galanterie des passions, avoir osé sourire alors que chacun s'applique à bien pleurer, c'est là une audace bien curieuse pour ce temps. Et c'est surtout l'affirmation d'une conscience d'artiste. »
A ces lignes nous ajouterons ces quelques mots de son fils, Jean Messager :
« Pendant toute sa vie, André Messager fut surtout et avant tout un grand serviteur de la musique, sous toutes ses formes. »
***
Ainsi qu'il l'avait demandé, c'est sur la colline de Chaillot, dans le cimetière de Passy, qu'il fut inhumé auprès de Fauré et de Claude Debussy.
Chaque année, à l'anniversaire de sa mort, ses parents et amis se réunissent autour de sa tombe et évoquent le souvenir de cet épicurien qui, par ses dons heureux et l'agrément de son esprit, sut traverser la vie en goûtant sa saveur sans jamais s'attarder dans les jours sombres et décevants... Heureux exemple d'optimisme, si bienfaisant pour ceux qui l'ont entouré et aimé !
Paris, Juin 1947.
FIN
ORAISONS
I
C'est par un pâle soleil dont les rayons timides ne parvenaient pas à réchauffer nos cœurs endoloris, qu'il quitta pour toujours ce coquet logis de la rue Jouffroy, abri de ses dernières années, si actives et si heureusement remplies (*).
(*) Les obsèques de Messager eurent lieu le Ier mars 1929.
Après la cérémonie religieuse, en l'église de la rue Ampère, où se fit entendre l'orchestre du Conservatoire qu'il avait si souvent conduit, une foule recueillie écouta avec émotion les paroles d'adieu prononcées sous le porche par Charles Méré, président de la Société des Auteurs (*).
(*) Extraits du discours de Charles Méré publié dans l'Annuaire de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques.
« La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques est en deuil. Nous perdons un grand musicien. Nous perdons, par surcroît, un guide, un conseiller, un chef. Il fut un de nos meilleurs présidents. Et, si, à cette minute suprême, la voix du représentant de la Société s'élève, seule, pour lui dire adieu, vous pensez bien que c'est André Messager, lui-même, qui l'a voulu. Il a voulu que seuls fussent dits les mots qui viennent du cœur. Ses enfants, ses proches se taisent et le pleurent. Excusez-moi donc de n'apporter ici qu'un hommage incomplet à son œuvre exquise et rayonnante. Excusez-moi de ne pas prononcer le discours éloquent qui est d'usage. Nous aussi nous le pleurons, avec la douleur, avec la fierté de penser que nous étions un peu de sa famille. »
L'orateur nous rappelle ensuite toute la qualité et l'abondance de l'œuvre du compositeur :
« Cher André Messager, nous transmettrons à nos jeunes confrères la belle leçon que vous nous avez donnée. Et puis, vous ne nous quittez pas tout entier ! Votre œuvre nous reste ! Ah ! celle-là non plus n'a pas vieilli ! et ne vieillira pas ! Elle est la jeunesse, la vie même !
… Il est certains ouvrages dont la prétention dépasse visiblement la valeur et où l'ambition de l'auteur éclate, dans chacune de ses intentions. C'est le contraire chez Messager.
Rien de plus simple, semble-t-il, rien de plus aisé que son effort. Vingt œuvres dans lesquelles il affirme une étonnante diversité d'inspiration et une technique impeccable, sans autre but apparent que l'agrément du spectateur !
... Non ! ce n'est pas un simple amuseur, c'est mieux qu'un virtuose, le compositeur qui a écrit Béatrice et Fortunio, le musicien qui nous laisse Monsieur Beaucaire, l'Amour masqué et Passionnément. Il y a dans son œuvre une aristocratie d'inspiration, une « classe » qui force les critiques les plus difficiles à l'admiration et au respect.
A tant de mérites éclatants, André Messager en joignait un autre, et ce dernier, il faut bien l'avouer, extraordinaire. Ce compositeur aimait la musique — je veux dire la musique de ses confrères vivants — à condition qu'il la trouvât défendable ou belle (*).
Il a eu, comme animateur, comme initiateur, une influence considérable dans l'histoire musicale de ces trente dernières années. »
(*) Cet amour de la musique l'emportait chez lui sur tout le reste et je me souviens qu'allant volontiers passer des soirées d'intimité chez de bons amis qu'il ne connaissait pas et qui habitaient rue Jouffroy dans l'appartement situé au-dessous du sien, nos conversations étaient interrompues bien souvent par des flots de musique qui descendaient de l'étage supérieur. Avec curiosité d'abord, recueillement ensuite, nous prêtions l'oreille attentivement... C'était Messager qui, seul chez lui, se jouait pour lui-même tantôt du Beethoven, tantôt du Schubert ou du Schumann. Il aimait à se retremper dans les classiques et là, comme autrefois à Montivilliers, je l'écoutais presque en cachette, sans qu'il le sût, et j'appréciais cette ferveur de son art où il puisait à la source...
Avant de se mettre au travail et de composer, il préludait toujours par une lecture au piano d'un auteur de son choix, dans laquelle il semblait trouver l'élan nécessaire. Son esprit souple, attentif à toutes les formes de l'activité intellectuelle, reprenait avec la musique un contact immédiat qui faisait jaillir de lui l'inspiration.
Et Charles Méré énumère toutes les œuvres que Messager monta à l'Opéra-Comique d'abord, à l'Opéra ensuite, en découvrant des talents nouveaux. Puis il ajoute :
« Qu'il était resté jeune ce musicien classique, ce membre de l'Institut ! Rien ne l'aurait fait dévier de la voie qu'il avait obstinément suivie. Il était rebelle à toute influence. Mais il était aussi décidé à ne jamais combattre de parti-pris une tentative originale, si révolutionnaire soit-elle. Les essais les plus audacieux retenaient son attention, sa bienveillance. Dans ce jazz venu d'Amérique et triomphant chez nous, à la grande indignation de la plupart des musiciens, ses confrères — dans ce jazz nostalgique et barbare — André Messager avec son intelligence toujours en éveil, découvrait des ressources inconnues, des possibilités nouvelles pour la musique de demain.
Hélas ! c'est fini ! Nous ne vous verrons plus, nous ne vous entendrons plus, de votre voix coupante, prodiguer l'éloge ou la critique, et d'un mot, d'une anecdote qui fusaient de vos lèvres, ainsi qu'un rire bref, égayer nos heures de travail. Je vous ai revu dimanche sur votre lit de mort qui fut votre lit de souffrance, si serein, si apaisé, dans ce même habit noir que vous portiez, il y a quelques mois à peine, lorsque vous conduisiez, aux acclamations de tout Paris, et de quelle façon délicate et magistrale, votre dernière partition (*) !
Après une vie si comblée, si magnifique, nous vous sentons, maintenant, si haut ! Peut-être, si vous le pouviez, nous défendriez-vous de pleurer ! »
(*) Allusion à la première de Coups de roulis, où l'on vit pour la dernière fois Messager monter au pupitre.
II
La Notice sur la vie et les œuvres d'André Messager, lue par M. Charles Widor, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, dans la séance annuelle du 30 novembre 1929, s'exprime sur un ton tout différent. C'est à la fois le musicien et l'érudit qui parlent. M. Widor se souvient que Messager fut d'abord organiste, que le Plain-Chant fut au début son apanage et partant de là, il nous enseigne comment Fauré et lui, élèves de Niedermeyer, sont issus du Chant liturgique.
On semble bien éloigné en lisant ces curieux prémices, des pimpants refrains de Véronique et des P’tites Michu, Nous allons voir par quelles adroites déductions M. Widor y arrive tout naturellement...
« Nous ne savons rien de la musique populaire dans l'antiquité ; rien de la chanson du pâtre, des refrains de la rue, des sonneries, des appels de trompettes, du lyrisme de l'Agora.
La Grèce conquise, Rome est envahie par les Grecs. La langue d'Homère s'impose au pays de Virgile. Au théâtre, Eschyle, Sophocle, Euripide, Aristophane tiennent l'affiche, et bientôt des troupes se forment pour courir la province et porter au delà des monts la bonne parole, l'esprit de l'Hellade.
Cette bonne parole, hélas ! ne nous est point parvenue tout entière. Nous avons hérité de textes littéraires mais non de leur complément, la notation musicale qui permettait au poète, au « musicien-poète » de vivifier le mot, d'intensifier l'accent, car il ne suffisait pas de déclamer, il fallait chanter ce texte dans des théâtres ouverts aux quatre vents, pour le faire syllabiquement parvenir à des milliers d'auditeurs.
L'Antiquité nous a laissé, avec ses richesses littéraires et des chefs-d'œuvre d'art, quelques ouvrages sur la musique, d'un vif intérêt, mais sans preuves à l'appui. Que conclure en effet de ces pauvres reliques : un lambeau de papyrus, une inscription funéraire et cet Hymne de Delphes, dont un plaisant a dit « qu'on avait dû le lire à l'envers ».
Lorsqu'il s'agit, à Rome, de constituer le répertoire du Chant liturgique, de faire le tri des cantilènes anciennes et d'en recueillir les plus significatives, comment s'opéra le tri, on ne sait, et ce qu'on sait moins encore, c'est l'aventureuse odyssée du Recueil, alors qu'à défaut de pièces d'identité, de références quelconques, pendant plus de deux siècles, c'est oralement, de vieux à jeune clerc, qu'il s'est transmis.
Sous Louis XIV, Dumont, l'auteur des Plains-Chants, Nivers (organiste de Saint-Sulpice), et bien d'autres après eux, se mirent à étudier, à épurer ce mélos du souvenir. »
En 1853, ce fut un auteur d'opéras applaudis... et nous voici conduit tout naturellement au point stratégique, au carrefour où nous apercevons soudain les horizons vers lesquels M. Widor entend nous conduire « d'opéras applaudis, de musique religieuse remarquée et de mélodies dont l'une au moins, sur des vers de Lamartine, le Lac a charmé les deux mondes, ce fut Niedermeyer qui entreprit une campagne à la fois d'assainissement de notre art, à l'Eglise, et de reconstitution de l'antique tonalité des modes grecs. Il fonda un journal et ouvrit une école : son journal apprenait aux organistes que l’œuvre de Bach pouvait avantageusement les reposer de leurs improvisations, et aux maîtres de chapelle que Palestrina valait bien un cantique. Quant à l'école, grâce à l'intervention du prince de la Moskova, son élève et ami, elle obtint de Napoléon III la subvention officielle nécessaire. Vif succès dès le début pour un enseignement curieusement encyclopédique, un programme d'études tout à la fois anciennes et modernes. « Le Plain-Chant, disait le rapport du Ministre, base de la musique religieuse, sera dans cette Ecole l'objet d'un soin particulier ». Certes, il eût été bien étonné d'apprendre, cet excellent Ministre, que du religieux enseignement de l'Ecole Niedermeyer sortiraient drames lyriques, opéras-comiques et opérettes, que Gabriel Fauré y trouverait un vénérable collaborateur : Eschyle et André Messager un joyeux patron : Aristophane. »
On voit comment ces savants rapprochements amenés avec une logique parfaite parviennent à placer Messager dans une lignée à laquelle il n'avait sans doute jamais songé ! Adroit préambule qui nous conduit d'emblée au cœur du sujet. Et M. Widor, de fil en aiguille, en arrive à la présentation d'un personnage nouveau que l'Institut n'a pas encore eu l'occasion de glorifier : « dame Opérette ».
« Elle, toujours gaie, l'Opérette, gentiment familière, bien tournée et d'un minois charmant. D'où vient-elle, d'Athènes ou de Montmartre, de Florence ou du Boul'Mich'... ? Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas froid aux yeux, ne craint pas l'aventure, sachant bien que tout est bien, qui finit par des chansons. Elle connaît ses auteurs : Homère, Aristophane, Plaute, Rabelais. D'Homère, elle est férue ; des autres un peu moins : elle leur reproche une tenue négligée et leur manque d'éducation. Ses modernes l'enchantent : Meilhac, Halévy, Jules Lemaître, Maurice Donnay..., tous de si bonne compagnie et de si bon conseil ! C'est par eux qu'elle a connu Offenbach et qu'elle a fait fortune : Orphée aux Enfers, la Belle Hélène, la Grande-duchesse, la Vie parisienne — débauche de verve inventive, de truculente folie, — et après Offenbach : Lecocq, Audran, Varney, Terrasse, Planquette...
Et voici que change le décor : Messager entre en scène, fin, réfléchi, curieusement doué, de bonne heure initié aux mystère de son art, de la tonalité antique, de ce Plain-Chant, « base non seulement de la musique religieuse », mais de toutes les musiques — son œuvre même le prouve ! »
M. Widor énumère ensuite les ouvrages du compositeur et définit ses opérettes :
« Œuvres d'esprit et de charme ne devant rien à personne, écrites spontanément d'une main sûre, disposant au mieux des moyens du métier. Art très particulier, qui procède à la fois de l'Ode et de la Chanson, dans lequel le musicien tout en poétisant la phrase, doit au plus juste traduire le mot car, dans l'opérette c'est le mot qu'on écoute : la musique vient après.
« ... La musique dans l'opérette s'interdit toute liberté ; comme un maillot sur la peau, elle adhère à son texte. Ni développements ni commentaires dans Véronique ou dans l'Amour masqué, dans Mirette ou Monsieur Beaucaire, mais une suite de couplets, entrecoupés çà et là par un mouvement de valse, le genre le veut ainsi (*). C'est dans ce cercle étroit que doit graviter l'opérette. Quel talent, quel esprit inventif ne faut-il pas au musicien pour créer des plans, jouer à la fois de la lumière et de la couleur, préparer des surprises ? Or, ce qui surprend chez Messager c'est l'économie des moyens, la variété de l'idée et la distinction de la forme. »
(*) L'observation de M. Widor semble inexacte, car dans toutes les opérettes de Messager, y compris les dernières, on trouve de nombreux morceaux développés, ne serait-ce que les « finals », construits de main de maître.
Tout en fixant les principaux traits de la vie artistique de Messager M. Widor étudie les diverses évolutions du théâtre musical. Il s'applique à situer l'œuvre du compositeur dans son cadre particulier autant que dans les formes auxquelles elle se rattache. Après avoir défini ce que fut d'abord le drame lyrique avant Mozart, il affirme l'influence de celui-ci :
« C'est le génie de Mozart qui brisa le vieux moule. Le Commandeur est descendu de son piédestal ; le sol tremble sous les pas de l'homme de pierre, c'est le destin qui marche. Plus de récitatif, d'aria, de duo : la musique fait corps avec le drame, lui prêtant son intensité expressive, le « fatum » de son rythme, en progression sonore jusqu'au dénouement. »
Puis l'auteur de la Notice nous montre comment le rire avec Offenbach prit sa revanche sur le drame :
« … Jusqu'alors l'opéra avait appartenu aux dieux de la Grèce. Les héros de Lulli, de Rameau, de Gluck, revêtaient le péplum et chaussaient le cothurne ; eux aussi, les Romains de Spontini et tout le théâtre du premier Empire. Deux siècles de péplums et de cothurnes, n'était-ce pas assez pour lasser le parterre et provoquer l'ironie, l'irrévérencieuse ironie d'Offenbach ? »
Il constate que « plus réservé, et à supposer qu'il ait pu jamais en être tenté, Messager s'est abstenu de toute parodie (*). Ce lointain petit-neveu d'Aristophane respecte les ancêtres ; les contemporains lui suffisent, et ce n'est pas de la lyre d'Orphée mais du violon de chez nous qu'il accompagne leurs propos. Il continue d'ailleurs la vieille tradition des trouvères et des troubadours, leurs scènes à deux ou trois personnages, leurs dialogues coupés par des chansons, ces « opérettes » des XVe et XVIe siècles, auxquelles il prête la séduction de son talent et son culte de la Musique, car la Musique est, pour lui, une religion. » Et M. Widor en vient à définir l'influence, personnelle que Messager exerça sur son époque en tant que Directeur et Chef d'orchestre :
(*) Sauf toutefois Amants éternels. Suite parodique à Roméo et Juliette donnée en 1893 et mentionnée précédemment.
« Loin de s'en tenir à des pratiques familières avec des Muses descendant du Parnasse en costume de midinettes, Messager veut, tout en haut, honorer les dieux eux-mêmes. C'est ce qu'il fait en allant à l'Opéra, au Conservatoire, se consacrer aux chefs-d'œuvre de Wagner et de Beethoven.
Chef d'orchestre remarquable, en sa façon de conduire on sentait combien son âge mûr restait fidèle à l'idéal de sa jeunesse, à sa piété pour les maîtres et pour les formes les plus hautes de l'Art. Doué d'autant d'érudition que de sensibilité, il avait sur les œuvres du passé comme sur les modernes, avec des aperçus très personnels, des jugements qui ne laissaient point de tendre, parfois, au paradoxe, mais il restait toujours sincère, et s'il lui arrivait d'aller jusqu'à une sorte de violence, c'était toujours pour une cause juste. Il en était une qui lui tenait au cœur, car elle intéressait à la fois son érudition et sa conscience, celle du chant de l'Eglise latine, héritière de la mélopée antique, de ces Modes grecs « base de toute musique ». En comparant les textes récemment imposés avec l'admirable Canto Firmo de nos pères, l'ancien organiste s'indignait. Et quelle âme tant soit peu musicale ne s'indignerait comme la sienne ? Il s'indignait non moins des mutilations, que du scandale des harmonies sous lesquelles on étouffe ces malheureux textes, de leurs accompagnements modern style, en absolu contre-sens avec la grandeur de la pensée, la clarté, la ponctuation même de la phrase. »
Et M. Widor conclut ainsi :
« ... L'idée du repos ne lui était point encore venue, lorsque la mort vint le surprendre. Surprise pour nous tous, avec quelle verve toute juvénile, en effet, il nous exposait, ici même, ses projets à l'étude, ses rêves d'œuvres nouvelles.
La mort n'enlève point tout entiers ceux qui, comme notre confrère, ont consacré leur vie au service du Beau. Ils laissent derrière eux le meilleur de leur pensée. Jusque dans les parties de leur œuvre les plus légères, jusque dans leurs esquisses, jusque dans les improvisations où ne se joue guère que leur fantaisie, on reconnaît encore ces reflets de la Beauté : l'Elégance, le Charme et la Grâce. Mais ici, au souvenir de l'œuvre s'attachera le souvenir d'un exemple : la profonde unité d'une carrière, en dépit d'un singulier dédoublement sous les apparences. Les fortes études de sa jeunesse, ce fond classique sur lequel repose l'édifice musical, André Messager n'a jamais cessé de le défendre dans ses Directions, dans ses écrits, dans ses paroles. Il était combatif comme nous avons tous le devoir de l'être contre le vandalisme qui s'attaque aux monuments du Passé, contre l'irrespect scandaleux des ignorants, en un mot : contre toute offense à ces lois éternelles qui n'ont jamais arrêté les manifestations les plus audacieuses des plus libres génies, à ces lois dont la garde nous a été confiée et dont nous sommes responsables devant nos successeurs. »
***
Ainsi s'achève cette intéressante Notice (*) dans laquelle se reflète une haute culture qui sait remonter jusqu'aux sources de la Pensée musicale à travers les dédales du temps et situe l'œuvre d'André Messager, cet « arrière petit-neveu d'Aristophane ».
Mais lui, si simple, en eût-il tant demandé ?
(*) Publiée dans le Bulletin de l'Académie des Beaux-Arts, Typographie de Firmin Didot et Cie.
Table des matières
13 – Hyménée et brouillard sur Londres
19 – A l’Opéra. – Monsieur le Directeur
25 – L’opérette renaît par la chanson
Achevé d’imprimer sur les presses des Imprimeries réunies de Chambéry en mai 1948.