
LES MUSICIENS CÉLÈBRES
MASSENET
par
CHARLES BOUVET
Archiviste-Bibliothécaire de l'Opéra.
Biographie critique
Henri Laurens, Editeur
janvier 1929
I
LA VIE, L'HOMME, LE PROFESSEUR
Un grand-père originaire de Gravelotte (Moselle), professeur d'histoire à la Faculté de Strasbourg, une grand'mère, Françoise-Hélène Mathieu de Faviers, de bonne noblesse, fille de Jean-François Mathieu de Faviers, membre de la Chambre des Quinze, à Strasbourg. Un père, Alexis Massenet, ancien élève de l'École polytechnique, d'abord officier du Génie dans les armées de Napoléon Ier, ensuite industriel de grande envergure, et une mère, d'excellente noblesse aussi, Mlle Adélaïde Royer de Marancourt, tels sont les ancêtres de Massenet. C'est dans ce milieu d'intellectuels, de militaires et de femmes distinguées que naquit celui qui devait, un jour, briller au firmament de l'art.
D'un premier mariage, Alexis Massenet eut huit enfants. Devenu veuf, il épousa Mlle Adélaïde Royer de Marancourt, qui lui donna quatre enfants : une fille et trois fils, dont Jules Massenet fut le dernier.
Massenet naquit le 12 mis 1842, au lieu dit de la Terrasse, dans la commune de Montaud, proche Saint-Étienne (Loire). Son acte de naissance lui confère les prénoms de Jules-Émile-Frédéric.
Le père de Massenet, qui avait fait la campagne d'Espagne avec son oncle maternel, le baron Mathieu de Faviers, ordonnateur en chef de l'armée d'Espagne, assista, en 1814, à la bataille de Toulouse où il fut promu commandant. Cette promotion n'ayant pas été ratifiée par le Gouvernement de la Restauration, Alexis Massenet donna sa démission. Le Maréchal Soult, duc de Dalmatie, lui conseilla d'entrer dans l'industrie ; son titre d'ingénieur des mines le désignait pour l'exercice d'une carrière de ce genre et lui en facilitait l'accès. Soult ne se contenta pas de lui donner un conseil, il lui offrit une commandite avec laquelle Alexis Massenet fonda, à Toulouse, une fabrique de faux et faucilles, « façon d'Allemagne et de Styrie », qui prit aussitôt une grande importance. Puis, successivement, il créa deux autres fabriques, l'une à Saint-Juéry, au saut du Tarn, près Albi, l'autre à Touille, au delà de Saint-Gaudens. Voulant alors faire usage de la vapeur pour actionner ses machines, il céda, en 1838, le droit aux usines de Toulouse et transporta dans la région de Saint-Etienne, bassin houiller qui lui donnait toute facilité pour l'accomplissement de ses projets industriels, non seulement son matériel mais encore un personnel ouvrier qu'il avait lui-même recruté en Tyrol, pays d'où la France était obligée, jusqu'alors, de faire venir ses faux et faucilles. C'est ainsi qu'il fonda, en 1838, à la Terrasse, une importante usine.
Cependant, les événements politiques de la France, en remuant profondément les différentes couches de la nation, causaient un trouble général et, notamment en ce qui concernait l'industrie de la métallurgie. La situation était devenue grave ; il fallut faire face aux exigences que comportait l'arrêt des machines. Alexis Massenet, n'ayant pu augmenter sa part de commandite, dut accepter que la raison sociale se transformât et devînt : Jachson, Génin et Massenet, alors que, précédemment, le nom de Massenet figurait en premier. Toutefois, dans cette combinaison, A. Massenet garda des intérêts dans l'affaire, ce qui lui permit de continuer à vivre sur un train relativement réduit mais encore fort honorable.
Entre temps, Mme Massenet voulant pour ses enfants des écoles supérieures à celles de Saint-Étienne, se rendit à Paris en 1847. Son mari vint l'y rejoindre en 1849.
Mme A. Massenet était une femme éminente. Élevée par les soins de la duchesse d'Angoulême, celle de laquelle Napoléon Ier disait qu'elle était le seul homme de la famille, Mlle de Marancourt, outre une culture littéraire très développée, était bon peintre et excellente musicienne. A Paris, elle se mit à donner des leçons de piano afin d'augmenter ses ressources. On ne saurait douter qu'elle n'ait eu l'art du professorat, car, parmi ses élèves, il en est un qui fit le plus grand honneur à son enseignement : c'est son fils Jules.
Massenet a raconté comment il prit sa première leçon de piano le 24 février 1848. Ce fut le matin de ce jour mémorable, puisque cette date coïncide avec la chute de la monarchie de juillet, que, à la lueur des chandelles, sa mère lui mit les doigts sur le piano : il avait alors six ans.
« Pour m'initier davantage à la connaissance de cet instrument, ma mère avait tendu, le long du clavier, une bande de papier sur laquelle elle avait inscrit les notes qui correspondaient à chacune des touches blanches et noires, avec leur position sur les cinq lignes. C'était fort ingénieux, il n'y avait pas moyen de se tromper. Mes progrès furent assez sensibles pour que, trois ans plus tard, en octobre 1851, mes parents crussent devoir me faire inscrire au Conservatoire pour y subir l'examen d'admission aux classes de piano. »
La mère de Massenet avait si bien su développer les dons qui étaient en lui que, présenté le 9 octobre 1851 à l'examen d'admission, véritable concours, car il y a plus d'appelés que d'élus, ce petit garçon, il n'avait pas encore dix ans, était reçu d'emblée dans une classe de piano supérieure, celle d'Adolphe Laurent, où il obtenait, en 1853, un troisième accessit. La même année, le jury lui décernait un troisième accessit de solfège (classe Savard).
C'est à ce moment que le jeune artiste fut contraint d'interrompre des études commencées sous d'aussi heureux auspices. Depuis deux ans, la santé de M. Alexis Massenet inspirait de l'inquiétude à son entourage. Les médecins ordonnèrent le traitement pratiqué à Aix. Le départ pour Chambéry, où M. et Mme Massenet savaient retrouver d'anciennes relations, fut aussitôt résolu. Il fut également décidé que le petit Jules accompagnerait ses parents en Savoie. Dans cet éloignement de Paris, tout contribuait à chagriner le jeune étudiant. Cependant, il ne perdit pas son temps là où le destin le plaçait.
« Je restai à Chambéry pendant deux longues années. Mon existence, toutefois, ne fut pas trop monotone. Je l'employais à continuer mes études classiques, les faisant alterner avec un travail assidu de gammes et d'arpèges, de sixtes et de tierces, tout comme si j'étais destiné à devenir un fougueux pianiste. Je portais les cheveux ridiculement longs, ce qui était de mode chez tout virtuose, et ce point de ressemblance convenait à mes rêves ambitieux. Il me semblait que la chevelure inculte était le complément du talent. »
Durant sa villégiature forcée, le jeune lauréat du Conservatoire ne se contenta pas de développer sa technique instrumentale et de poursuivre ses études classiques ; il se sentit attiré par les diverses beautés naturelles de la région où il séjournait. Fasciné par la dent du Nivolet, qui domine Chambéry, il gravit cette pittoresque pointe. Il alla aux Charmettes, demeure illustrée par J.-J. Rousseau. C'est ainsi que, par d'incessantes et grandes randonnées à travers la délicieuse Savoie, il cultivait et développait ses facultés émotives. En cet enfant, la magie des couleurs et des formes opérait son miracle, déposant un grain qui devait lever par la suite.
Malgré les aliments que Massenet fournissait si merveilleusement à sa jeune imagination, le souvenir du Conservatoire, de ses maîtres, de ses camarades, s'imposait fortement à lui. Il brûlait du désir de se replonger dans cette vie qu'il adorait : c'était une sorte de hantise. Un jour, n'y tenant plus, il quittait subrepticement le toit paternel et, « sans un sou dans la poche, sans un vêtement de rechange », il partait pour Paris, ce Paris lointain objet de tous ses vœux, où, d'ailleurs, il comptait bien trouver un bon accueil chez sa sœur, Mme Cavaillé-Massenet.
Arrivé à Lyon, le pauvre petit pèlerin, dénué de toutes ressources, alla trouver un ami de sa famille, M. Richard, directeur des postes. Celui-ci prévint par dépêche M. et Mme Massenet que leur fils était chez lui, et qu'il le faisait ramener à Chambéry. Après son retour, une sorte de maladie de langueur l'envahit à tel point que ses parents prirent le parti de l'envoyer à Paris, chez sa sœur Julie, qui avait épousé le peintre Paul Cavaillé.

Massenet enfant, peinture à l'huile de Paul Cavaillé (Musée de l'Opéra)
Aussitôt à Paris, Massenet retrouva son entrain, sa gaminerie. Mme Cavaillé-Massenet habitait au coin de la rue Rochechouart et de la rue Condorcet ; or, Massenet, ce diable de Massenet, donnait rendez-vous à quelques-uns de ses camarades, comme lui sans doute élèves du Conservatoire, et, tous ensemble, ils descendaient la rue Rochechouart en poussant des cris perçants propres à mettre en émoi tout le quartier ; on payait ainsi son tribut à la récréation ; une fois au travail, Massenet redevenait sérieux.
Quelle joie de réintégrer la classe de piano, de retrouver son cher professeur Adolphe Laurent ! Fort bien doué pour le piano, Massenet s'adonna avec passion à l'étude de cet instrument. En deux ans, il avait rattrapé le temps perdu en Savoie. Le jury lui décernait un premier accessit en 1856, et le premier prix en 1859. C'est avec le Concerto de François Hiller, dédié à Moschelès, qu'il obtint cette distinction.
S'il ne poursuivit pas la carrière de virtuose, nous voyons Massenet exercer cette profession au cours de l'année 1858. Le 16 septembre 1858, il prend part au concert donné à Tournai par Alphonse Hermann, lauréat du Conservatoire : « M. Massenet, le jeune pianiste, timide devant le public mais plein de puissance et de commandement en face de son clavier, M. Massenet a une touche admirable, et les sons qu'il tire de l'instrument arrivent aux spectateurs pleins de pureté et de vigueur. Parfois on dirait des perles tombant dans une coupe de cristal ». (le Ménestrel, samedi 24 août 1912.)
Si « le jeune pianiste » avait le talent d'un virtuose, il en avait aussi le physique. Jules Vallès, qui collabora avec le frère aîné de Massenet à une pièce burlesque intitulée l'Écureuil du déshonneur, a tracé de Massenet adolescent le portrait suivant :
« Il avait alors, ce pianoteur, quatorze ou quinze ans peut-être, de longs cheveux blonds, des yeux profonds et, tout gamin qu'il fût, il nous intimidait et nous inspirait presque le respect, tant il était assidu et piocheur, exact comme une pendule, venant placer son derrière sur sa méthode et attaquant à heure fixe son instrument, écartant d'un geste de pythonisse ce qui gênait sa furie d'harmonie. »
Ces lignes confirment ce que nous savions sur le soin, la ponctualité et l'opiniâtreté que Massenet apportait au travail. Elles indiquent aussi l'ascendant exercé par lui, presque sans qu'il le voulût, sur tous ceux qui l'approchaient.
Au portrait ci-dessus il convient d'ajouter le suivant, qui figure dans le Gaulois (23 octobre 1898). Victorin Joncières y raconte comment il fit la connaissance de Massenet, alors timbalier d'une Société symphonique d'amateurs dont les bruyantes assises se tenaient au Café Charles, rue des Poissonniers, à Montmartre, et ses débuts, dans la même société, en qualité de grosse-caisse.
« Je n'avais de ma vie touché une mailloche de grosse caisse, mais j'étais d’une assez jolie force sur le tambour. C'est même l'instrument pour lequel j'ai montré, dès l'enfance, les plus remarquables dispositions... J'allai prendre place à côté du jeune adolescent qui m'avait été désigné. Massenet était alors presque un gamin ; imberbe, avec un petit nez retroussé, le front haut sous les longs cheveux rejetés en arrière, le visage pale éclairé de deux petits yeux à la fois pleins de malice et de bienveillance. Il me fit place avec empressement auprès de lui, et je saisis la mailloche et les cymbales pour l'exécution de Lestocq, qui était sur le pupitre... Perdu au milieu des mesures à compter, je frappais au hasard de formidables coups de grosse caisse dont le fracas achevait d'exaspérer le malheureux chef d'orchestre Marié (le père de Galli, l'inoubliable créatrice de Mignon et de Carmen) qui, de temps en temps, épongeait son visage avec un large foulard à carreaux, placé sur le rebord de son pupitre. Vous avez de la vigueur, me dit-il à la fin du morceau, mais vous ne comptez pas vos pauses... Un peu déconfit de mon début comme grosse caisse, je devais prendre une éclatante revanche comme tambour. J'exécutai le roulement de l'introduction de la Gazza ladra avec une incomparable maestria. Mon voisin, le petit Massenet, jetant sur moi un regard d'admiration, me dit avec une conviction qui me fit tressaillir d'orgueil : « Mâtin ! tu as un joli talent de tambour, toi ! » Je fus extrêmement flatté de ce compliment en même temps que charmé de ce tutoiement bon enfant où je devinais un nouvel ami. La glace était rompue ; du coup, je devenais l'un des virtuoses de l'orchestre. »
En confrontant les récits de Vallès et de Joncières, avec le portrait peint par Paul Cavaillé en 1853, alors que Massenet avait onze ans, il est aisé de se rendre compte que, entre l'enfance et l'adolescence, les traits du visage ne s'étaient pas sensiblement modifiés. Au reste, Massenet devait garder longtemps encore cet air juvénile.
Chez Massenet, l'esprit le plus fantaisiste et le sens exact des réalités s'alliaient en un parfait équilibre ; aussi comprit-il de bonne heure la nécessité de besogner pour gagner l'argent qui lui était nécessaire ; il faisait ainsi figure de fils de famille sans aucune fortune, bien que, en réalité, il en fût autrement. Lui-même semble s'être attaché à répandre cette légende de pauvreté. Il est cependant certain que, si les parents indemnisaient Mme Cavaillé de l'hospitalité qu'elle donnait à son frère, ils ne devaient pas verser de mensualité à leur fils cadet pour ses dépenses personnelles : M. et Mme Massenet avaient aussi à subvenir aux frais d'éducation des deux fils aînés qui faisaient alors leurs études au lycée Saint-Louis.
D'ailleurs, Massenet ne profita pas très longtemps de l'hospitalité de sa sœur ; il s'installa 5, rue de Ménilmontant, et dut alors faire face à tous ses besoins.
Tout d'abord, le jeune musicien donna quelques leçons de solfège et de piano dans une pauvre petite institution de quartier ; puis il inaugura ce qui devait, plus tard, s'appeler « la Brasserie ». On lui avait offert de tenir le piano dans un des grands cafés de Belleville, et comme cela était payé... trente francs par mois, il accepta. Ensuite, il entra à l'orchestre du Théâtre Lyrique en qualité de timbalier. C'était tout de même plus relevé que le Café Charles et la société d'amateurs du père Marié ! C'est là qu'il assista à la première représentation du Faust de Gounod, et entendit « l'admirable Mme Miolan-Carvalho ». Enfin, aux bals de l'Opéra, « le brave père Strauss » lui avait confié les parties de tambour, timbales, tam-tam, triangles et autres retentissants instruments. « C'était une grosse fatigue pour moi que de veiller tous les samedis de minuit à six heures du matin ; mais tout cela réuni fit que j'arrivais à gagner, par mois, quatre-vingts francs ! J'étais riche comme un financier... et heureux comme un savetier. »
On le voit, Massenet dut lutter longtemps avant qu'on pût dire que la vie lui ait particulièrement souri.
A des succès de pianiste, si grands fussent-ils, ne pouvait évidemment se borner l'ambition d'une nature telle que la sienne. En lui était une volonté qui le poussait à faire toujours plus et mieux. Écoutons sa parole : « J'avais donc obtenu un premier prix de piano. J'en étais, sans doute, aussi heureux que fier, mais vivre du souvenir de cette distinction ne pouvait guère suffire. »
La composition l'attirait et il était d'une époque où l'on concevait clairement que pour produire, dans quelque art que ce fût, il fallait acquérir une technique profonde de l'art que l'on voulait pratiquer. Il entra donc à la classe de Bazin, l'austère pédagogue duquel Auber disait : « Il enseigne le matin, à sa classe, comment on doit composer, et le soir, au théâtre, comment l'on ne doit pas composer. » Au bout de très peu de temps, Bazin congédia cet élève qui ne pouvait empêcher son originalité d'apparaître, même dans un devoir d'harmonie. Le malheureux expulsé fut admis dans la classe de Reber : il ne perdit pas au change. Henri Reber, homme distingué, nature délicate, comprit tout de suite de quelle essence rare était fait son nouvel élève, lequel marchait à pas de géant. Reçu le 17 janvier 1860, Massenet obtenait, à la fin de son année scolaire, un premier accessit d'harmonie, récompense considérée à ce point inférieure aux mérites du lauréat que Reber lui conseillait d'entrer, sans plus attendre, dans une classe de composition. Ainsi, Massenet, renvoyé d'une première classe d'harmonie pour avoir été jugé insuffisant, quittait la seconde parce qu'il était trop capable !
Massenet, se rangeant à l'avis de son maître Reber, entrait, en 1861, dans la classe de composition d'Ambroise Thomas où il devint vite le benjamin ; comment un homme de la valeur de l'auteur de Mignon et de Hamlet aurait-il pu méconnaître un élève tel que Massenet ? Élève charmant entre tous, assidu, attentif aux conseils du Maître, absorbant ses conseils avec avidité et en profitant si bien qu'il apportait à chaque classe les morceaux les plus divers, montrant ainsi une fécondité surprenante, fécondité que ses camarades ne manquèrent pas de railler, ce à quoi Ambroise Thomas répondait paisiblement : « Laissez faire, qu'il sème d'abord ses herbes folles, vous verrez que, lorsqu'il sera apaisé, il écrira quelque chose de définitif. C'est un génie. » Et ces « herbes folles » poussèrent si dru que, au bout de sa première année de classe, Massenet remportait, en 1862, le second prix de fugue ainsi qu'une Mention honorable au concours pour le prix de Rome. L'année suivante, 1863, il obtenait le premier prix de fugue et était proclamé premier Grand prix de Rome.
La cantate de Massenet, écrite sur un poème de Gustave Chouquet : David Rizzio, était d'une originalité inaccoutumée dans ce genre de composition, qui, après tout, n'est qu'un devoir d'élève. C'est à cette originalité que Massenet dut d'avoir Berlioz pour principal partisan ; si bien que, après le jugement définitif, Ambroise Thomas put dire très justement à son élève : « Embrassez Berlioz, vous lui devez beaucoup de votre prix. »
En appuyant en cette circonstance sur la décision de l'Institut, Berlioz fut à la fois bon juge et bon prophète. Massenet, libéré de toute entrave, va pouvoir prendre son essor, donner la mesure de son talent.
Outre que l'accession au Prix de Rome était le couronnement d'études poursuivies avec méthode et ardeur, c'était aussi, pour Massenet, la réalisation de son premier grand rêve : être lauréat de l'Institut, aller à Rome. Aussi, quelle ivresse lorsque ce rêve devint réalité ! Sa joie déborde de toutes parts, dans ses paroles, ses écrits, ses souvenirs. Recueillons précieusement les impressions données par lui sur le temps qu'il vécut dans la Ville éternelle :
« Oh ! ces deux années délicieuses passées dans Rome, à la chère Villa Médicis, ces années sans pareilles dont le souvenir vibre encore dans ma mémoire et m'aide aujourd'hui même à refouler les influences néfastes du découragement ! — Ce fut à Rome que je commençai à vivre ; ce fut là, au cours des joyeuses excursions faites en compagnie de mes camarades musiciens, peintres ou sculpteurs, et durant nos causeries sous les chênes de la Villa Borghèse ou sous les pins de la Villa Pamphili, que je ressentis les premiers élans d'admiration pour la nature et pour l'art. Quelles heures charmantes nous employions à errer dans les musées de Naples et de Florence ! Quelles délicates et mélancoliques émotions nous faisait éprouver la visite des églises mystérieusement obscures de Sienne et d'Assise ! Comme l'on oubliait vite Paris et ses théâtres, et sa foule bruyante, et sa vie enfiévrée !...
Je ne dirai jamais assez combien m'est cher et combien fidèle me reste le souvenir des années que je passai à Rome. J'aimerais à convaincre d'autres débutants de l'utilité qu'il y a pour les jeunes musiciens de quitter Paris et de vivre, — ne fût-ce qu'une seule année — à la Villa Médicis au milieu d'une élite de camarades. Oui, je suis tout à fait partisan de cet exil, comme l'appellent les mécontents. Je pense qu'un tel séjour peut créer des poètes et des artistes, et qu'il doit éveiller des sentiments et des impressions qui, faute de cela, seraient en danger de rester éternellement inconnus de ceux même chez lesquels ils étaient endormis. »
Pour Massenet, l'Italie a été une terre bénie. Elle lui ouvrit des horizons inconnus, elle fit qu'il se découvrit, qu'il prit conscience de sa personnalité. Il a vingt et un ans, il est plein d'ardeur, de fougue, d'enthousiasme. Il voudrait étreindre l'univers entier. Aussi avec quelle passion absorbe-t-il ce qu'il voit. L'air, le soleil, le parfum des fleurs, les sites diversement pittoresques, la foule gesticulante des rues de Naples, les Musées, tout l'enivre et constitue, pour sa jeune âme, une raison d'envol vers les sphères élevées de l'art. C'est pour lui une source d'inspirations à laquelle il puisera bien souvent au cours de sa carrière.
Il va à Naples avec Falguière et Chaplain. En traversant les bois de Subiaco, une grosse cornemuse, la Zampogna d'un berger, lui fournit une mélodie qu'il noie aussitôt : ces quelques mesures deviendront les premières de Marie-Magdeleine. A Venise, il est frappé par les sonneries, si étranges et si belles, que font entendre les trompettes autrichiennes lorsque, le soir, on ferme le port : il les note et, vingt-cinq ans plus tard, il s'en servira au quatrième acte du Cid. C'est à Venise, où il restera deux mois, que furent tracées les esquisses de la Première Suite d'orchestre.
Quand, après une année de séjour à l'École de Rome, les sages règlements de la Villa Médicis lui prescrivirent d'aller vivre sous d'autres cieux, il se rendit en Allemagne, en Autriche, et en Hongrie. La musique des Bohémiens et des Tchèques l'attira. Il ne manqua pas de noter maints airs populaires dont il se servit par la suite en les parant de cette instrumentation colorée dans laquelle il excella. C'est à Pesth, où il habita pendant un certain temps, qu'il écrivit ses Scènes Hongroises.
La coutume voulait que les Grands Prix partissent ensemble pour la Villa Médicis. Cependant, au lieu de s'embarquer avec ses camarades de promotion : Layrand et Monchablon, peintres ; Bourgeois, sculpteur ; Brune, architecte ; et Chaplain, graveur ; Massenet quitta seul Paris. Il désirait se rendre à Nice où son père, mort le 1er janvier 1863, était enterré. Il désirait aussi aller embrasser sa mère qui était, à Bordighera, l'hôte d'amis occupant une villa située en pleine forêt de palmiers et dominant la mer. Il passa, en effet, avec elle le premier jour de l'an 1864, jour plein d'effusion et d'attendrissement : « Il me fallut, toutefois, me séparer d'elle, car mes joyeux camarades m'attendaient en voiture sur la route de la Corniche italienne, et mes larmes se séchèrent dans les rires. O jeunesse !... »
Il visite rapidement Gênes et son Campo-Santo ; Milan où, devant la cathédrale, toute de marbre blanc, cette belle pensée de Bossuet lui revient à la mémoire : « A cette époque de foi, la terre se couvrit de roses blanches. » Il déplore l'effacement de la Cène de Léonard de Vinci ; puis il quitte Milan et se rend à Vérone pour y accomplir le pèlerinage obligatoire au tombeau de la Juliette aimée de Roméo. Il va ensuite à Vicence, à Padoue où, en contemplant les peintures exécutées par le Giotto dans l'église Santa Madonna dell' Arena, il a l'intuition que Marie-Magdeleine occupera un jour sa vie. Enfin, il arrive à Venise.
« Venise !... On m'aurait dit que je vivais réellement que je n'y aurais pas cru, tant l'irréel de ces heures passées dans cette ville unique m'enveloppait de stupéfaction. »
Massenet n'est pas encore à Rome, et déjà son esprit s'exalte à la vue des chefs-d’œuvre de l'art italien. Le Prix de Rome, qui lui permet de voir ces merveilles, a donc du bon, même pour un musicien.
Massenet et ses camarades ont une première impression de Pise et de Florence ; puis, franchissant leur dernière étape, ils arrivent au terme de leur voyage : Rome ; mais, au lieu d'y arriver par la voie Flaminienne, sur laquelle les anciens se faisaient une fête de venir à leur rencontre, ils prirent le bateau à vapeur de Livourne jusqu'à Civitavecchia et, de là, à la Ville Éternelle par le chemin de fer.
Le Directeur alors en fonction, M. Schnetz, « papa exquis pour tous ses enfants de l'Académie de France à Rome », conduisit Massenet à la chambre qui lui était destinée. De cette chambre, le nouvel occupant avait un horizon magnifique. La vue s'étendait sur toute la ville de Rome dominée par la silhouette du dôme de Saint-Pierre. C'est dans ce logis, ravissante cage pour le délicieux oiseau chanteur, que. Massenet allait faire éclore les envois auxquels il était astreint par les règlements de l'Institut : Grande ouverture de concert, Requiem à quatre et huit voix avec accompagnement d'orgue, violoncelle et contrebasse. A ces envois obligatoires, Massenet ajoute les compositions suivantes, une suite de morceaux symphoniques : Pompéïa ; des Scènes de bal, pour piano ; Deux Fantaisies, pour orchestre, les esquisses assez poussées d'une Esmeralda, opéra d'après Victor Hugo, etc., production intense de laquelle il ne va plus se départir.
Le dimanche soir avaient lieu, dans le salon directorial, des réceptions qui réunissaient, outre les pensionnaires de l'Académie, tout ce que la Société romaine comportait d'important et d'illustre. Il n'était pas un invité qui ne fût fier de gravir le Monte Pincio dominé par la Villa Médicis.
Quoique trois directeurs eussent été successivement appelés à présider aux destinées de l'École pendant le séjour de Massenet à Rome, d'abord « le bon M. Schnetz », puis Robert Fleury, et enfin Hébert, les réceptions n'en souffrirent pas ; il n'y eut aucune solution de continuité. Ces réceptions étaient célèbres. Liszt y brillait d'un éclat immense, s'imposant à tous par la puissance de son talent et de sa haute personnalité. L'originalité de Massenet, la forme de son esprit et les agréments de sa personne plurent au maître aussi grand compositeur que formidable pianiste.
Ici se place un épisode exquis de la vie de Massenet, ce que nous appellerons le Roman de son mariage. — Massenet s'est chargé d'en narrer le début dans ses Souvenirs.
« Une des phases les plus grandes et les plus palpitantes de ma vie se préparait. Nous étions à la veille de Noël (1864). Une promenade fut organisée pour suivre, dans les églises, les Messes de Minuit. Les cérémonies qui se célébrèrent de nuit à Sainte-Marie-Majeure et à Saint-Jean de Latran furent celles qui me frappèrent le plus. Le lendemain, jour à marquer d'une croix, je croisai, dans l'escalier aux trois cents marches qui mène à l'église de l'Ara-Cœli, deux dames dont l'allure était celle d'étrangères élégantes. Mon regard fut délicieusement charmé par la physionomie de la plus jeune.
Quelques jours après cette rencontre, m'étant rendu chez Liszt qui se préparait à l'ordination, je reconnus, parmi les personnes qui se trouvaient en visite chez l'illustre maître, les deux dames aperçues à l'Ara-Cœli.
Je sus, presque aussitôt après, que la plus jeune était venue à Rome, avec sa famille, en voyage de touristes et qu'elle avait été recommandée à Liszt pour qu'il lui indiqua un musicien capable de diriger ses études musicales qu'elle ne voulait pas interrompre loin de Paris.
Liszt me désigna aussitôt à elle.
J'étais pensionnaire de l'Académie de France pour y travailler, ne désirant par conséquent pas donner mon temps aux leçons. Cependant, le charme de cette jeune fille fut vainqueur de ma résistance.
Ce fut cette exquise jeune fille qui, deux ans plus tard, devait devenir mon épouse aimée. »
La violente impression que Mlle de Sainte-Marie, c'était le nom de la jeune fille, fit sur l'esprit et le cœur de Massenet, développa en lui un des côtés primordiaux de sa nature : la tendresse ; cette tendresse infinie qui va déborder dans son œuvre entier.
Marie-Magdeleine, des esquisses de la Vierge et l'Eve datent précisément de cette époque. Le doux émoi dont son âme était remplie lui fit créer, de toutes pièces, un type nouveau, celui de l'amoureuse mystique, en attendant qu'en une langue musicale ravissante, il traduisît la tendresse de la femme simplement femme.
Au printemps de 1865, Massenet fit, en compagnie de Falguière et de Chaplain, un voyage dans le sud de l'Italie. La vie de Naples l'enchante. Il trouve des mots exquis pour exprimer les émotions qu'il éprouve à Sorrente et à Amalfi. Quant à Capri, il aime réellement cette île délicieuse : « Habiter Capri, y vivre, y travailler, est bien l'existence dans tout son idéal, dans tout ce qu'il est possible de rêver ! J'en ai rapporté quantité de pages pour les ouvrages que j'avais projeté d'écrire par la suite. »
Décidément, un musicien peut tirer grand profit des avantages que procure le Prix de Rome.
A l'automne 1865, Massenet et ses camarades revinrent à Rome qu'il allait falloir quitter définitivement, hélas !
Il ne peut s'arracher de ces lieux, de la chère Villa Médicis tant aimée, que jamais il ne l'oubliera. Comme les croyants, il veut se recueillir à la fin du jour. De sa fenêtre, il attend que le soleil se couche derrière le dôme de Saint-Pierre afin de le saluer une dernière fois.
A la Villa Médicis, Massenet s'était fait apprécier et aimer. Son départ, 17 décembre 1865, causa un véritable chagrin.
La route du retour ne fut pas perdue pour Massenet. Chez un être tel que lui, rien ne se perd; toutes choses s'impriment en son esprit comme sur une plaque photographique. A Florence et à Pise, qu'il revoit seul cette fois, il collige ses impressions. Dans la capitale de la Toscane, le soir venu, un paysan auquel il a demandé l'heure, lui fait la réponse suivante, dont il apprécie le tour poétique :
Sono la sette, l’aria ne treme ancora !...
(Il est sept heures, l’air en tremble encore !...)
Il voulut franchir la distance qui sépare Pise de Gênes par l'ancienne voie romaine tracée en corniche sur la mer, et cela par un clair de lune magnifique. C'est ainsi que, blotti sous la bâche d'une rustique diligence, il parcourt ce chemin comme porté dans la nacelle d'un ballon : « Il me sembla, pendant ce trajet, que je n'avais jamais accumulé en moi-même un tel ensemble d'idées et de projets, toujours obsédé par cette pensée que, dans quelques heures, je serais de retour à Paris et que ma vie allait y commencer. »
Le pittoresque voyage que Massenet venait d'accomplir de Pise à Gênes avait fait pénétrer tant de beauté dans ses yeux que, pour en mieux garder le souvenir, il les ferma... et s'endormit jusqu'à Montereau, où le froid le réveilla.
Les pressentiments de Massenet devaient se réaliser. Effectivement, l'année 1866 va être le commencement d'une autre vie. La première étape de son existence est franchie, une autre se présente devant lui.
Les soucis financiers lui étaient à présent évités, puisque, à cette époque, les Grands Prix, à leur retour de Boule, jouissaient d'une pension annuelle de trois mille francs ; Massenet y avait droit encore pendant trois ans.
Massenet s'est défendu d'être un symphoniste au sens strict du mot, et, ma foi, pour expliquer cette opinion sur lui-même, il se sert d'une argumentation assez concluante. En fait, lorsqu'il écrivit des morceaux pour orchestre, il resta un homme de théâtre. A de rares exceptions près, ses œuvres symphoniques ne peuvent pas être considérées comme de la musique pure ; construites sur un argument, elles sont surtout de la musique à programme. C'est cependant sous l'aspect d'un symphoniste qu'il apparaîtra au public parisien.
Cet homme, ce jeune homme, un doux, un tendre, apporte à tout ce qu'il fait une volonté, une ténacité incroyables. Dès son retour à Paris, il s'emploie si bien à faire entendre ses œuvres que, deux mois après, le 24 février 1866, le Casino de la rue Cadet, dirigé par le cornettiste Arban, donne sa Suite d'orchestre : Pompéïa. L'œuvre fut bien accueillie. On y remarqua une habileté surprenante chez un débutant, et même « la touche vigoureuse de Berlioz et son horreur des lieux communs ». Au mois de juillet suivant étaient exécutés, au concert des Champs-Élysées, Deux fantaisies pour orchestre : le Retour d'une caravane et Noce flamande, avec chœur. Puis ce fut, au concert Pasdeloup, le 24 mars 1867, l'audition de la Première Suite d'orchestre.
Quelques jours après cette audition marquante, le Théâtre de l'Opéra-Comique représentait la Grand' Tante, livret de Jules Adenis et Ch. Granvallet, musique de J. Massenet. Cette fois, Massenet débutait dans le genre vers lequel sa nature l'entraînait irrésistiblement : le Théâtre.
La Grand'Tante était un de ces actes imposés au Directeur de l'Opéra-Comique par le cahier des charges, lever de rideau réservé aux pensionnaires de l'Institut. Massenet y avait donc droit ; cependant il n'en fut pas moins heureux : « Que j'étais fier de recevoir mes premiers bulletins de répétition, et de m'asseoir à cette même place, sur cette scène illustre, qu'avaient connue Boieldieu, Hérold, M. Auber, Ambroise Thomas, Victor Massé, Gounod, Meyerbeer !... »
Sans entrer dans l'analyse de ce petit ouvrage, dont Massenet a dit qu'il regrettait de n'avoir pu y mettre tout ce qu'il aurait voulu donner de lui, constatons que, cependant, la critique louangea la musique qui ne parut à personne être celle d'un débutant.
C'est un peu avant cette époque que Massenet, ayant fait la connaissance d'Armand Silvestre, s'enflamma pour les vers de ce poète et mit en musique Poème d'avril. L'œuvre charmante était née, il restait à la publier. Chez l'éditeur Choudens, où l'auteur s'était présenté avec une lettre d'introduction de Reyer, il fut éconduit sans même avoir pu montrer son manuscrit. Il reçut le même accueil chez Brandus et chez Flaxland. Massenet, non seulement ne fut pas trop attristé de cet échec, mais encore trouva cela tout naturel : « Qu'étais-je ? dit-il, un parfait inconnu. »
Il se produisit alors un fait merveilleux.
Lorsque le compositeur, éconduit mais non découragé, regagnait allègrement le logis qu'il occupait à cette époque au cinquième étage d'une maison de la rue Taitbout, il fut interpellé par un grand jeune homme blond, à la figure intelligente et gracieuse, qui lui dit : « Depuis hier, j'ai ouvert un magasin de musique, ici même, boulevard de la Madeleine ; je sais qui vous êtes, et vous offre d'éditer ce que vous voudrez. » Massenet n'eut qu'à sortir de sa poche le manuscrit méconnu et le donner à son interlocuteur, Georges Hartmann. Quelques mois après le Poème d'avril apparaissait dans toute sa fraîcheur et remportait un succès qui fit beaucoup pour la réputation naissante du futur auteur de Manon. De tous côtés on chanta les vers ailés :
Que l'heure est donc brève
Qu'on passe en aimant.
En 1866, le choléra sévit à Paris, Massenet en fut atteint. Tous s'écartèrent de lui ; seul, son maître Ambroise Thomas, bravant la contagion, vint le visiter, là-haut, dans sa chambrette. La réconfortante présence du médecin de l'empereur, qui accompagnait Ambroise Thomas, et surtout la courageuse et paternelle démarche de son vénéré maître, causèrent à Massenet une telle joie, il en ressentit une si vive émotion, qu'il s'évanouit... mais il était sauvé. Cette attaque, au reste assez bénigne, fut de courte durée. Le pauvre malade put terminer Dix pièces de genre, pour piano, que l'éditeur Girod lui paya deux cents francs, vingt francs la page : c'était le premier argent que lui rapportait une de ses œuvres. La cinquième de ces pièces, transcrite pour un violoncelle solo, a été incorporée dans les Erinnyes ; elle est devenue le mélodrame qui sert de fond à l'Invocation d'Elektra, belle et ample phrase célèbre dès la première audition. Massenet l'avait composée quand il était élève au Conservatoire.
Maintenant Massenet a atteint l'objet de son rêve, il a épousé la délicieuse Mlle de Sainte-Marie. Le mariage a eu lieu, le 8 octobre 1866, dans la vieille petite église du village d'Avon.
Pour Massenet, les années 1867, 1868 et 1869 représentent un labeur incessant. D'ailleurs, à part la période 1870-1871, quelles sont donc les années qui ne furent pas consacrées par lui à un labeur opiniâtre ? Il avait organisé sa vie en vue de son travail. Levé de grand matin, à quatre heures, il composait et faisait sa correspondance jusqu'à midi. L'après-midi était employé à ses leçons et aux visites nécessitées par sa profession. Quant aux soirées, n'allant presque jamais au théâtre, elles étaient de courte durée.
A Fontainebleau, où il passait les étés avec sa femme et les parents de Mme Massenet, il se « ruait » sur le travail dans la paix familiale et le calme de la nature ; ce qui, du reste, ne l'empêchait pas de venir assez fréquemment à Paris.
L'empereur Napoléon III avait institué trois concours musicaux ayant pour objet, l'un une Cantate, l'autre un Opéra-Comique, le troisième un Opéra en trois actes. Massenet prit part à ces trois concours : aucun des prix ne lui fut attribué. Le Prométhée de Saint-Saëns fut couronné, Charles Lenepveu obtint le prix pour le Florentin, et Diaz pour la Coupe du Roi de Thulé.
Après ces résultats, Massenet s'écria philosophiquement : « J'étais battu, mais non abattu. »
Il arrive quelquefois que d'un édifice ruiné on tire les matériaux propres à l'édification d'autres monuments. C'est ainsi que Massenet procéda envers les mille pages d'orchestre de sa partition de la Coupe du Roi de Thulé dont bon nombre furent utilisées dans les Erinnyes, Eve, Marie-Magdeleine, la Vierge et le Roi de Lahore. Le troisième acte du Roi de Lahore, notamment, est construit avec le deuxième acte de la Coupe du Roi de Thulé.
Pendant l'été et l'hiver de 1869, et au printemps de 1870, Massenet travailla à Méduse, poème en trois actes de Michel Carré. L'ouvrage étant terminé depuis quelques jours, le librettiste et le compositeur se donnèrent rendez-vous, le 12 juillet 1870, dans la cour de l'Opéra, alors situé rue Lepelletier, afin de voir le directeur. Emile Perrin était absent.
Le lendemain les journaux annonçaient la déclaration de guerre entre la France et l'Allemagne : envolée l'espérance d'être joué à l'Opéra.
Massenet avait alors vingt-huit ans. Il fit son devoir. Il envoya sa femme et sa fille dans le sud-ouest ; quant à lui, incorporé dans la garde chargée de veiller sur Paris, il passa, sous les obus, tout le temps que dura l'investissement. Cependant, si impérieuse était la force qui le poussait à composer, qu'il fit alors une symphonie régulière. Cette œuvre, écrite pendant les jours sombres de la guerre, fut loin de satisfaire son auteur. Massenet, après l'avoir fait essayer par l'orchestre de Pasdeloup, la déclara « mauvaise parce qu'elle devait l'être, attendu qu'il n'avait pas le tempérament d'un symphoniste ». Il s'opposa à ce qu'on l'exécutât. Sans doute fut-il sévère pour lui-même, bien que son langage musical s'adapte, il est vrai, parfaitement au caractère de l'Opéra et moins bien peut-être au style de la symphonie.
Il souffrit moins des privations du siège que des malheurs de sa patrie. Pourtant, le désastre passé, Massenet reprend courage au travail en revoyant sa « chère petite chambre de la campagne », à Fontainebleau. La vie qu'il mène au milieu des siens lui semble plus exquise que jamais, elle ramène en lui la bonne humeur. Son esprit se rassérène : il retrouve le calme. Il écrit les Scènes pittoresques, délicieuse suite d'orchestre dans laquelle Massenet a fait passer le souffle frais de son nouvel état d'âme. Comment un ostracisme incompréhensible écarte-t-il cette œuvre des programmes symphoniques ?
En 1872, l'espoir d'être joué à l'Opéra sembla renaître lorsque, présenté par Émile Bergerat à Théophile Gautier, celui-ci proposa à Massenet deux sujets de ballets : le Roi des Aulnes et le Preneur de Rats. Le souvenir de Schubert fit reculer Massenet ; le directeur de l'Opéra se cabra devant le titre du second argument.
Si les portes de l'Opéra restèrent fermées, celles de l'Opéra-Comique, du moins, se rouvrirent devant Massenet. Depuis quelque temps, il était attelé à un livret tiré, par Chantepie, du fameux drame de Dumanoir et d'Ennery : Don César de Bazan. Du Locle prévint Massenet que l'ouvrage passerait en novembre. Pendant six semaines, Massenet travailla fiévreusement et, le 30 novembre 1872, Don César de Bazan était représenté pour la première fois. Monté à la hâte, dans de vieux décors, cet ouvrage ne réussit pas : il n'eut que treize représentations.
Sur les instances de Georges Hartmann, Duquesnel, alors directeur de l'Odéon, confia à Massenet l'illustration musicale des Erinnyes, tragédie antique de Leconte de Lisle. Un effectif de quarante musiciens avait été mis à la disposition du compositeur ; c'était beaucoup pour l'Odéon, peu pour un orchestre symphonique. Massenet eut l'heureuse idée de répartir ainsi le groupe de musiciens à lui concédé : trente-six instruments au quatuor, trois trombones, image vivante des trois Erinnyes : Tisiphone, Alecto et Mégère, plus une paire de timbales. Massenet avait fait choix de son ancien condisciple, Edouard Colonne, pour diriger ce petit orchestre.
L'œuvre, représentée pour la première fois à l'Odéon, le 6 janvier 1873, produisit une vive impression. « La musique élevée de M. Massenet » aussi bien que « la chaude et vigoureuse poésie de M. Leconte de Lisle » furent abondamment louées par la critique. Six semaines après, Pasdeloup faisait entendre aux concerts populaires la musique de scène des Erinnyes. Ensuite, Massenet développa sa première partition ; il y ajouta une ouverture, des airs de ballet, une marche et des chœurs. C'est sous cette forme que l'ouvrage fut donné à la Gaieté Lyrique, en 1876, à l'Odéon en 1889, et à la Comédie-Française en 1910.
Dans les Erinnyes, Massenet commenta avec un sens littéraire délicat les vers de Leconte de Lisle. Tous les morceaux de cette partition sont à retenir. Dès l'ouverture, le côté tragique du drame est magnifiquement révélé par la Marche funèbre. L'entr'acte, le chœur des Choéphores sont empreints d'une tristesse religieuse qui convient parfaitement au sujet. De même, la mélodie de violoncelle accompagnant l'évocation d'Elektra, est, d'une ligne pure qui fait songer aux profils d'un bas-relief antique. Les chœurs narrant le meurtre d'Egisthe sont comme drapés dans un peplum d'une couleur sombre profondément émouvante. L'épisode de la Troyenne regrettant sa patrie perdue, est d'une mélancolie exquise. Quant au Divertissement, Massenet, qui par la suite devait en composer de si remarquables, n'en a jamais écrit de plus parfait.

Un portrait-charge de Massenet, par L. Borgex (Musée de l'Opéra)
Le nom de Massenet, déjà connu, allait être mis en lumière par l'apparition d'un chef-d'œuvre : Marie-Magdeleine.
A deux reprises, nous avons indiqué l'importance du rôle de Georges Hartmann dans la vie de Massenet, nous allons voir la part qu'il prit à l'audition de Marie-Magdeleine. Homme aimable, intelligent et infiniment adroit, Hartmann possédait une sorte de divination qui lui permettait de pressentir le talent là où il était. C'est ainsi qu'il attira à lui tout ce que la jeune école d'alors avait de remarquable : Bizet, Saint-Saëns, Massenet, Lalo, Delibes, César Franck, Guiraud, etc. Cette élite formait un cénacle dont les assises se tenaient dans le petit magasin, nous allions dire le petit temple du boulevard de la Madeleine. Là, chacun apportait ses idées personnelles, mais tous communiaient en cette même foi ardente dans l'art qu'ils devaient illustrer.
Un jour vint où, non content de publier les œuvres de ces compositeurs, Hartmann voulut que la foule entendît leurs œuvres et que, de la sorte, le nom des auteurs se répandît. En collaboration avec Duquesnel, il créa le Concert National. Edouard Colonne fut chargé du recrutement et de la direction de l'orchestre. Huit séances avaient été prévues. La première eut lieu à l'Odéon le 9 mars 1873 ; la dernière, celle du vendredi saint 11 avril, fut consacrée à l'audition de Marie-Magdeleine.
Pour tous, l'ouvrage fut une révélation : la soirée tout entière fut une longue ovation. La presse loua unanimement les qualités hors de pair dont l'auteur avait fait preuve dans ce drame sacré. Reyer déclara que Marie-Magdeleine serait aussi favorable à répandre la jeune renommée de Massenet que l'Enfance du Christ l'avait été pour la gloire de Berlioz.
Parti le lendemain vers l'Italie, c'est seulement à Naples que Massenet reçut le premier écho de son succès, cela sous la forme touchante d'une lettre de son maître Ambroise Thomas : « Voilà une œuvre sérieuse, noble et touchante à la fois ; elle est bien de notre temps, mais vous avez prouvé qu'on peut marcher dans la voie du progrès tout en restant clair, sobre et mesuré... Dans un sujet mystique, où l'on est exposé à tomber dans l'abus des tons sombres et dans l'âpreté du style, vous vous êtes montré coloriste en gardant le charme et la lumière. »
De son côté Bizet, dont les jours étaient comptés, lui écrivit : « Jamais notre école moderne n'avait encore rien produit de semblable ; tu me donnes la fièvre, brigand ! Tu es un fin musicien, va !... Diable ! tu deviens singulièrement inquiétant ! Sur ce, cher, crois bien que personne n'est plus sincère dans son admiration et dans son affection que ton Bizet. »
En Italie Massenet revoit, en compagnie de sa femme, les sites qui jadis l'enchantèrent ; ces sites aimés lui apportent à nouveau « un indicible ravissement ». A peine Massenet était-il de retour à Paris, au n° 46 de la rue du Général-Foy, maison qu'il habita pendant plus de trente ans, qu'il se « jeta » sur un poème de Jules Adenis : les Templiers. Se rendant parfaitement compte que ce livret, par ses situations historiques, le plaçait sur une voie parcourue par Meyerbeer, Massenet alla demander l'avis de son éditeur. L'opinion d'Hartmann corrobora si bien la sienne, qu'il déchira les deux cents pages de partition qu'il venait de soumettre à son jugement. Un peu désemparé par cette immolation, nécessaire cependant, Massenet s'avisa d'aller trouver son collaborateur de Marie-Magdeleine, Louis Gallet, alors économe à l'hôpital Beaujon. Il sortit de cet entretien avec le plan du Roi de Lahore : « Du bûcher du dernier grand-maître des Templiers, Jacques de Molay, que j'avais abandonné, je me retrouvais dans le paradis d'Indra. C'était le septième ciel pour moi ! »
Le plan du Roi de Lahore, qui tant enchantait Massenet, devait s'élargir et devenir une pièce à grand spectacle. Sur ce splendide canevas, Massenet allait pouvoir broder à son aise, répandre tous les tons de sa palette sonore, donner libre cours à son imagination protéiforme, camper avec un relief saisissant des personnages divers, faire apparaître l'âme de chacun de ces personnages, en un mot... faire du théâtre.
Au cours des hivers 1873 et 1874, trois œuvres exécutées au Concert Pasdeloup : les Scènes dramatiques, les Scènes Pittoresques et l'Ouverture de Phèdre, mirent en évidence l'habileté de Massenet en tant que manieur de l'orchestre, et le montrèrent également sous l'aspect d'un peintre de la nature et des sentiments humains. A ce point de vue, l'Ouverture de Phèdre est significative. En plaçant en manière d'épigraphe les deux vers célèbres de Racine :
Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachée :
C'est Vénus toute entière à sa proye attachée.
Massenet a bien indiqué l'allure passionnée qu'il voulut donner à son œuvre. Dans cette pièce orchestrale de forme classique, passe le souffle de la folle ardeur qu'Hippolyte inspire à la femme de Thésée. Par son coloris, son emportement et sa fougue, l'Ouverture de Phèdre fait songer à un Delacroix.
Se dégageant du moule de l'oratorio classique, Massenet, avec Marie-Magdeleine, avait créé un genre : le Drame sacré, forme d'art dans lequel les personnages bibliques prirent un côté humain. Il est certain que Marie-Magdeleine, tout en restant une sainte femme, n'en est pas moins une femme tendre. Son amour pour Jésus est transposé, par la musique, dans une région intermédiaire où il garde néanmoins toute sa piété. C'est ce mysticisme sensuel qui avive l'œuvre charmante, donne aux mélodies ce tour enveloppant et voluptueux si bien fait pour apporter des frissons inconnus à un auditoire séduit.
Renouvelant, pour l'Ancien Testament, la métamorphose qu'il avait si heureusement appliquée au Nouveau, Massenet fit surgir une Eve, non pas désireuse de connaître la science, mais aspirant passionnément à l'amour. La Mère de l'humanité, devenait une femme moderne, miroir dans lequel toutes les femmes se reconnurent. De là est né l'enthousiasme féminin suscité par ce Mystère lorsqu'il fut donné, pour la première fois, le 18 mars 1875, au Cirque des Champs-Elysées, à l'un des concerts de l'Harmonie sacrée fondée par Charles Lamoureux.
Si Eve perdit par sa faute le paradis terrestre, Massenet, lui, entrevit en songe le paradis d'Indra. Depuis plusieurs mois déjà, il travaillait au livret de Louis Gallet. Or un jour d'orage, anéanti par la chaleur, il s'assoupit ; dans son sommeil, il entendit le troisième acte du Roi de Lahore : le paradis d'Indra. Aussitôt réveillé, il en commença le brouillon instrumental.
L'art venait de faire une perte irréparable : Bizet était mort prématurément le 3 juin 1875. Massenet en éprouva une immense douleur, douleur exprimée dans un Lamento que l'Association artistique, dirigée par Ed. Colonne, exécuta, le 31 octobre de la même année, à son premier concert consacré au jeune maître disparu.
Au commencement de l'été 1876, la partition du Roi de Lahore était terminée. L'ouvrage comportait onze cents pages d'orchestre, sa composition avait duré plus de trois ans. Qu'allait-il devenir, ce grand ouvrage ? serait-il jamais joué ? Telles étaient les questions que se posait Massenet. Au reste, Massenet n'était pas homme à se lamenter outre mesure pour des soucis de cet ordre. Il suivait avec confiance son étoile, d'ailleurs faisant tout pour aider le destin. Cette philosophie, celle des prédestinés, lui fut maintes fois favorable, notamment au sujet du Roi de Lahore.
Alors qu'il flânait, fait exceptionnel dans la vie de Massenet, il fut arrêté, au coin de la rue de la Paix, par le directeur de l'Opéra. Les succès de Marie-Magdeleine et d'Eve avaient-ils bien disposé Halanzier à son égard ? toujours est-il qu'après avoir questionné Massenet et avoir appris la naissance du Roi de Lahore, Halanzier demanda que ce fils de l'Inde lui fût présenté aussitôt. Effectivement, le lendemain à 9 heures, commençait la lecture de l'ouvrage, lecture qui se continua sans arrêt jusqu'à la fin du cinquième acte ; Massenet en était aphone et avait les mains brisées de fatigue. Comme il remettait le manuscrit dans sa vieille serviette de cuir, et que Gallet et lui se disposaient à partir, Halanzier lui dit : « Eh bien ! alors, tu ne me laisses rien pour la copie ? — Mais alors, vous comptez donc jouer l'ouvrage ? répondit Massenet... — L'avenir te le dira ! »
Au mois d'octobre de la même année, Massenet recevait de l'Opéra le bulletin suivant : Le Roi, 2 heures. — Foyer. Dans son laconisme, ce bulletin était éloquent : non seulement la pièce avait été reçue, mais elle entrait en répétitions.
La première eut lieu le 27 avril 1877. Les costumes, les décors étaient fort beaux, et l'interprétation de premier ordre. L'ouvrage obtint un immense succès. En écrivant à Massenet, le matin du 27 : « Je vous plains ce matin, je vous envierai ce soir ! » Gustave Flaubert avait été bon prophète.
Le lendemain de la première, Massenet reçut de Charles Garnier les lignes suivantes : « Je ne sais si c'est la salle qui fait de bonne musique, mais sapristi ! ce que je sais bien, c'est que je n'ai rien perdu de ton œuvre et que je la trouve admirable ! Ça, c'est la vérité. Ton Carlo ».
Après trente représentations consécutives à l'Opéra de Paris, en 1877, l'ouvrage fut monté à Turin ; puis Rome, Vienne, Bologne, Venise accueillirent chaleureusement le Roi de Lahore. De l'Italie, l'ouvrage passa en Autriche-Hongrie, en Angleterre, en Espagne.
Massenet a gagné la grande bataille ; maintenant, il est célèbre.
A partir de ce moment, les honneurs lui vinrent tout naturellement, en raison même de ses succès. Déjà, le 26 juillet 1876, après l'exécution d'Eve, il avait été fait Chevalier de la Légion d'honneur. Peu de temps après son retour d'Italie, il était nommé, par décret en date du 7 octobre 1878, professeur de Contre-point et Fugue et de Composition musicale, au Conservatoire, en remplacement de François Bazin décédé quelques mois auparavant. Le 30 novembre de cette même année 1878, l'Académie des Beaux-Arts l'élisait au fauteuil de Bazin. Puis, successivement, il fut promu Officier de la Légion d'honneur en janvier 1888, Commandeur le 31 décembre 1895 et Grand-Officier en décembre 1899.
Il est, dans la vie, des revanches agréables à constater. Massenet, aussi bien au Conservatoire qu'à l'Institut, s'asseyant dans la chaise curule du magister qui, jadis, l'avait si inconsidérément banni, quel heureux retour des choses d'ici-bas !
Remplie de luttes, mais couronnée par le triomphe, telle est la vie de Massenet : un bel accord.
La classe de Massenet ! — Pendant dix-huit ans, ce fut non seulement une école d'art, mais aussi un ravissement pour les élèves et pour le professeur.
Lorsqu'en 1878, Massenet, après ses créations de Marie-Magdeleine, d'Eve et du Roi de Lahore, prit possession de la chaire de composition musicale au Conservatoire, il était considéré comme un novateur, un chef d'école... En effet, il allait le devenir. Sa nomination mit en effervescence la jeunesse musicale d'alors. Tous aspirèrent à l'honneur de faire partie de cette classe. Massenet succédant à Bazin, quel contraste ! L'enseignement chaleureux du nouveau maître enflamma l'imagination de ses élèves. Il apportait la parole nouvelle à laquelle aspirait précisément toute cette ardente jeunesse, et cette parole, il la dispensait de la façon la plus captivante, la plus exquise. Tout, dans sa manière d'enseigner, contribuait à rendre efficaces et précieuses ses leçons.
Son enseignement portait sur deux points : le côté théorique et le côté pratique. Dans le premier cas, après avoir analysé et comparé les œuvres des maîtres, qu'ils fussent anciens ou modernes, il en tirait des déductions lumineuses tant au point de vue de la forme qu'à celui du fond. Quant au côté pratique, c'est-à-dire en ce qui concerne l'examen et la correction des devoirs de ses élèves, il était merveilleux. Reynaldo Hahn a très joliment indiqué ce que pouvait être une de ses leçons pratiques :
« Il craignait toujours de froisser, de peiner l'élève, et alors c'était des : « Oui... je crois, n'est-ce pas ?... oui, oui, je voudrais déjà entendre votre motif, ne me le faites pas trop attendre, faites-le moi pressentir, les paroles me le font pressentir. Vous me comprenez bien, n'est-ce pas ?... Ah ! voilà, tenez ! » Il se penchait pour atteindre le clavier, s'appuyait sur vous, très familier, très camarade, le monocle à l'œil, ébauchait la modification toujours opportune, ingénieuse, rapidement trouvée et toujours dans le sens de votre propre idée, de votre propre sentiment. Car ainsi que je l'écrivais naguère, « ce qu'il conseillait ne semblait pas émaner de lui, il le tirait, pour ainsi dire, de l'élève lui-même, de son tempérament, de ses intentions, et refaisait le travail tel que relit refait cet élève s'il eût possédé le talent nécessaire ». « Vous n'avez pas absolument rendu ce que vous vouliez... Oh ! je le sais bien, ce que vous vouliez ! c'est difficile... oui... Eh ! bien, cherchons ensemble... je crois que j'ai trouvé... Parbleu ! comment ne l'avez-vous pas vu ? Vous l'aviez indiqué d'instinct !... » Et sa main blanche faisait frétiller le petit crayon d'argent sur le manuscrit. »
On voit à quel point Massenet s'attachait à ce que ses élèves gardassent leur personnalité, et combien il respectait l'esthétique de chacun d'eux : il dirigeait leur nature, il n'imposait pas ses doctrines.
Gaston Carraud a parlé en ces termes de l'enseignement de son maître : « Les leçons de Massenet avaient un pouvoir merveilleux d'éveiller et de soutenir l'activité d'un jeune esprit... La clarté, la mesure, la rigoureuse propreté, mais le mouvement juste de la forme ; la sincérité et la simplicité du sentiment : là étaient ses premiers conseils ».
Un autre élève de Massenet, M. Julien Tiersot, a dit (le Ménestrel, 24 août 1912) la grande leçon qu'il prit lorsque, pour la première fois, il assista à la classe de composition. Ce jour-là, le Maître étudiait la forme du récitatif. Il avait choisi, dans les Troyens de Berlioz, la première partie du monologue d'Enée : « Inutiles regrets, je dois quitter Carthage ». Massenet, jouant et chantant, s'arrêtait fréquemment pour commenter le passage qui venait d'être entendu, et ses commentaires étaient autant de modèles d'analyse dans le genre de ceci : « La voix déclame en des accents abondants et avec une expression aussi juste que profonde, tandis que l'orchestre, par une série de pulsations sans cesse recommencées, semble entraîner le héros vers le destin qui l'appelle ».
A ses leçons, il établissait encore des rapports entre la musique, la littérature, les arts plastiques, et tirait de ces rapports des conclusions d'une ampleur magnifique : Massenet ne formait pas seulement des musiciens, il faisait de ses élèves des artistes-musiciens.
Un enseignement aussi brillant devait produire de beaux et bons résultats. Effectivement, presque chaque année, pendant dix-huit ans, un prix de fugue et un Grand Prix de Rome sortirent de la Classe de Massenet.
Voici l'édifiant tableau de ceux des élèves de Massenet qui obtinrent une récompense au concours de Rome.
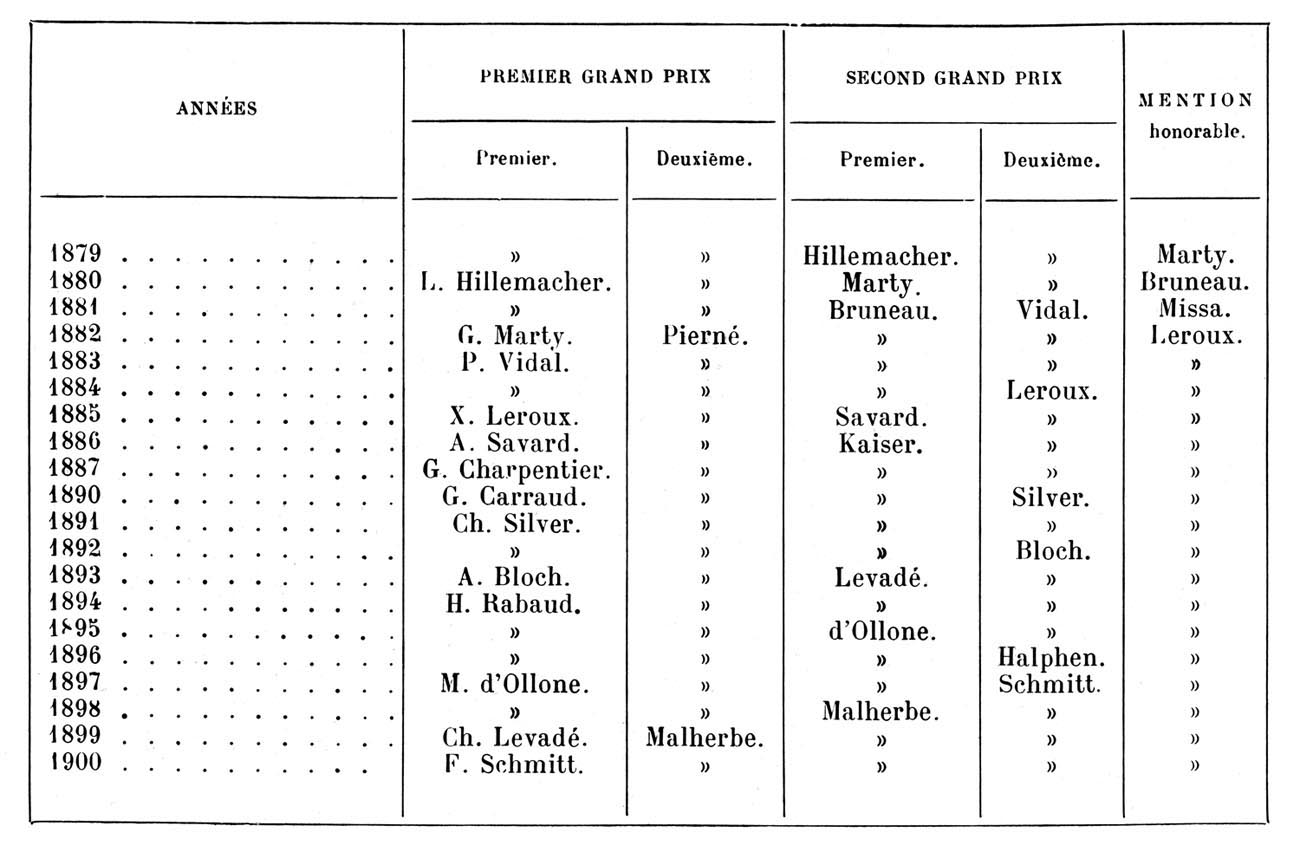
D'autres élèves de Massenet, sans obtenir le Prix de Rome, n'en devinrent pas moins d'excellents compositeurs, le charmant Reynaldo Hahn, par exemple, ainsi que Henry Février, Guy Ropartz, etc.
Les succès de ses élèves lui tenaient à cœur ; il en était joyeux et lier autant qu'eux-mêmes, reportant, du reste, tout l'honneur de ces succès à son maître Ambroise Thomas, auquel il devait sa science, disait-il modestement.
Massenet sut donner de la vie à la pédagogie, parer la scolastique des charmes de l'art.
Nous avons montré ce que fut le professeur, nous essaierons à présent d'indiquer ce qu'a été l'homme.
Déjà on a pu se rendre compte de la volonté de ce doux. A partir du Roi de Lahore, cette volonté va s'affirmer encore : le travail de Massenet s'intensifiera, sa vie sera remplie par un labeur formidable. Les œuvres, les chefs-d’œuvre vont éclore les uns après les autres avec une fréquence d'autant plus surprenante que celui qui les produisit paraissait, en public du moins, libre et dégagé de toute préoccupation. Cependant, c'est cet homme, cette force en perpétuel mouvement, cet être choyé par la destinée, qui, tout à coup, pris de lassitude à propos d'une simple contrariété, s'écriera : « Ah ! qui peut se dire heureux avant la mort ? »…
Jamais on ne vit homme plus aimable, plus séduisant que Massenet. Ses paroles, ses lettres ! quelle affabilité ! — Il semblait vraiment ne s'intéresser qu'à ce qui faisait l'objet des demandes dont il était harcelé. Un secrétaire eût été assez occupé avec sa correspondance ; lui, suffisait à tout. Que ce fût un littérateur voulant lui soumettre un livret ; un journaliste désireux de faire un article sur lui ; un chanteur ou une chanteuse aspirant à se faire entendre ; tous avaient une réponse. Cependant, si l'on observe minutieusement sa correspondance, on s'aperçoit qu'elle offre une véritable gradation de sa sympathie. Voici comment.
Massenet n'aimait pas son prénom : Jules ; pourtant, il l'employa, mais d'une manière significative, pourrait-on dire. Lorsqu'il écrivait à un étranger, il signait M. Massenet. M. Massenet, c'était l'auteur, l'homme public. Si le correspondant gagnait sa sympathie, l'M devenait un J. J. Massenet, c'était Massenet accueillant un peu son correspondant. Enfin, si ce correspondant réussissait à pénétrer dans l'intimité affectueuse du maître, alors apparaissait un Massenet tout court : l'ami. Combien de gens n'ont pas su discerner ces nuances !
Massenet, sans doute pour détendre son cerveau occupé par de si nombreux sujets importants, se laissait volontiers aller à dire des plaisanteries, des bons mots, même à faire des calembours. Les envieux, il en eut beaucoup, lui firent grief de cette monnaie de billon qu'il dépensait avec prodigalité sans se douter qu'on en prenait prétexte pour le montrer comme un esprit superficiel. Lui, Massenet, un esprit superficiel, alors qu'en réalité il était un méditatif.
Nature tendre, vibrante et inquiète, Massenet, pareil aux peureux qui chantent dans la nuit afin de se donner du courage, ne parlait-il beaucoup que pour dominer sa timidité instinctive ?
Évidemment, un des côtés de la nature de Massenet était foncièrement « gamin » ; jamais il ne se départit de cet aspect de caractère. Arrivé au pinacle, il était ravi quand il avait gentiment mystifié un importun ou un détracteur. Malicieusement, il contribua à répandre la croyance qu'il n'y avait pas de piano chez lui. En effet on n'en voyait pas dans la pièce où il recevait, dans son cabinet de travail. Seul, au milieu de cette pièce, trônait un massif bureau. Mais voilà, ce bureau recélait un piano. S'il voulait se rendre compte de ce qu'il venait d'écrire, Massenet n'avait qu'à pousser un peu en arrière le plateau de son bureau pour qu'un excellent instrument se trouvât sous ses doigts. Ainsi, évité le déplacement de la table de travail au piano ; évitée la perte de temps ; évités, surtout, les gêneurs ! Le Musée de l'Opéra conserve précieusement le bureau-piano de Massenet qui démontre péremptoirement combien était erronée la croyance qu'on eut dans la « pianophobie » de Massenet, d'ailleurs remarquable pianiste.
Sans avoir aucune prétention à la littérature, Massenet jugeait les écrits des autres avec discernement. Presque jamais il n'accepta un livret sans l'avoir analysé en véritable lettré ; et, après l'avoir adopté, il en était à ce point pénétré que, non seulement il le savait par cœur, ce qui en somme est assez simple, mais que les situations du drame, quelles qu'elles fussent, lui apparaissaient avec leurs qualités et aussi avec leurs défauts. Les observations qu'il faisait, les remarques qu'il adressait, les modifications qu'il demandait aux auteurs étaient si justes, si objectives à l'égard du but à atteindre : le théâtre, qu'on peut affirmer qu'il collabora aux livrets de ses collaborateurs.
Déjà, en 1862, lorsqu'il concourut la première fois pour le Prix de Rome, Massenet montra, très drôlement, ses qualités de critique littéraire. Le titre de la cantate sur laquelle devait s'exercer le talent des jeunes logistes était Louise de Mézières. Or, pendant longtemps on a pu lire, sur un des murs de la petite chambre mansardée située dans les combles de l'Institut, parmi les inscriptions tracées de la main de Massenet : « Oh ! là ! là ! quel poème ! Pourquoi Louise de Mézières, c'est tout au plus Héloïse la mercière ! » (le Figaro, 24 mars 1899.) Héloïse la mercière inspira faiblement Massenet ; cette année-là, il n'obtint qu'une mention honorable.
Une des raisons pour lesquelles Massenet apprenait ses poèmes par cœur, c'est que, de cette manière, il pouvait y travailler hors de chez lui, dans la rue, dans le monde, à dîner, au théâtre ; car il avait la faculté de pouvoir s'isoler au milieu du bruit et du mouvement. Dans l'interview donnée au Scribner's Magazine et dans l'article de la Lecture du 10 juin 1896, qui n'est qu'une traduction de cette interview, Massenet a rappelé ce fait : « Je suis né au bruit des pesants marteaux d'airain, comme disait jadis le poète. Mes premiers pas dans la voie musicale n'eurent pas un accompagnement plus mélodieux ». Ainsi, c'est sans doute au martellement de l'acier sur la forge, robuste rythme berceur de sa prime enfance, que Massenet dut le précieux don de s'absorber à son gré. Néanmoins, tout comme un autre, il rechercha le calme nécessaire à l'élaboration de ses ouvrages.
Abstraction faite de ses Souvenirs, dont l'inexactitude est malheureusement flagrante en maints cas, et qui, malgré leur intérêt, ne sont à tout prendre qu'un hommage rendu aux siens, à ses maîtres, aux directeurs de théâtres qui montèrent ses pièces et aux artistes qui les interprétèrent, les écrits de Massenet sont peu nombreux. Une sorte d'autobiographie parue dans le Scribner’s Magazine, sous le titre : Comment je suis devenu compositeur, reproduite dans la Revue illustrée, le 15 janvier 1893, et dans la Lecture du 10 juin 1896. Souvenirs d'une première (le Figaro, 29 août 1893). Lettre-Préface au Dictionnaire des Connaissances musicales, 1898. Réponse à Confidences d'hommes arrivés, élude sur les enfants médiocres et les enfants prodiges (la Revue, 15 mars 1901). Musique d'aujourd'hui et de demain (Comœdia, 4 novembre 1909). C'est tout. Dans ces articles, le style est simple, clair, alerte ; la narration pleine de vivacité, d'enjouement : Massenet aurait pu exceller aussi dans ce genre anecdotique.
Nous extrairons de ses Souvenirs le chapitre intitulé :Pensées posthumes. Ce chapitre, le dernier paru dans l'Echo de Paris (lu 11 juillet 1912, exactement un mois avant sa mort, montre un Massenet curieux, à la fois sceptique et idéaliste, un psychologue étrangement clairvoyant, regardant de loin et de haut les hommes et les choses ; qu'on en juge :
« J'avais quitté cette planète, laissant mes pauvres terriens à. leurs occupations aussi multiples qu'inutiles ; enfin, je vivais dans la splendeur scintillante des étoiles qui me paraissaient alors grandes chacune comme des millions de soleils ! Autrefois, je n'avais jamais pu obtenir cet éclairage-là pour mes décors, dans ce grand théâtre de l'Opéra où les fonds restent trop souvent obscurs. Désormais, je n'avais plus à répondre aux lettres ; j'avais dit adieu aux premières représentations, aux discussions littéraires et autres qui en découlaient.
Ici, plus de journaux, plus de dîners, plus de nuits agitées !
Ah ! si je pouvais donner à mes amis le conseil de me rejoindre là où je suis, je n'hésiterais pas à les appeler près de moi ! Mais le voudraient-ils ?
Avant de m'en aller dans le séjour éloigné que j'habite, j'avais écrit mes dernières volontés (un mari malheureux avait profité de cette occasion testamentaire pour écrire avec joie ces mots : Mes premières volontés).
J'avais surtout indiqué que je tenais à être inhumé à Égreville, près de la demeure familiale dans laquelle j'avais si longtemps vécu. Oh ! le bon cimetière ! En plein champ, dans un silence qui convient à ceux qui l'habitent.
J'avais demandé que l'on évitât de pendre à ma porte ces tentures noires, ornements usés par la clientèle. J'avais désiré qu'une voiture de circonstance me fit quitter Paris. Ce voyage, avec mon consentement, dès huit heures du matin.
Un journal du soir (peut-être deux) avait cru devoir informer ses lecteurs de mon décès. Quelques amis — j'en avais encore la veille — vinrent savoir, chez mon concierge, si le fait était exact, et lui de répondre : « Hélas Monsieur nous a quittés sans laisser son adresse. » Et sa réponse était vraie, puisqu'il ne savait pas où cette voiture obligeante m'emmenait.
A l'heure du déjeuner, quelques connaissances m'honorèrent, entre elles, de leurs condoléances, et même, dans la journée, par-ci, par-là, dans les théâtres, on parla de l'aventure.
— Maintenant qu'il est mort, on le jouera moins, n'est-ce pas ?
— Savez-vous qu'il a laissé encore un ouvrage ? Il ne finira donc pas de nous gêner !
— Ah ! ma foi, moi, je l'aimais bien ! J'ai toujours eu tant de succès dans ses ouvrages !
Et c'était une jolie voix de femme qui disait cela.
Chez mon éditeur, on pleurait, car on m'y aimait tant !
Chez moi, rue de Vaugirard, ma femme, ma fille, mes petits et arrière-petits-enfants étaient réunis, et, dans des sanglots, trouvaient presque une consolation.
La famille devait arriver à Égreville le soir même, veille de l'enterrement.
Et mon âme (l'âme survit au corps) écoutait tous ces bruits de la ville quittée. A mesure que la voiture m'en éloignait, les paroles, les bruits s'affaiblissaient, et je savais, ayant fait construire depuis longtemps mon caveau, que la lourde pierre une fois scellée, serait quelques heures plus tard la porte de l'oubli ! »
De tout ceci, il résulte que Massenet eut une sorte de prescience, de double vue de la fin prochaine qui l'attendait. N'y a-t-il pas là quelque chose d'infiniment impressionnant, de tragique même ? Et quelle ironie dans ces lignes tracées d'une main déjà presque mourante.
Quant aux discours auxquels l'astreignirent ses fonctions à l'Institut, que ce soit à l'inauguration du monument élevé, à Givet, en l'honneur de Méhul ; aux obsèques d'Ambroise Thomas ; au centenaire de Berlioz, ou à l'occasion de l'oraison funèbre du sculpteur Frémiet, beau-père de Gabriel Fauré, tous sont bien construits, même éloquents ; mais la timidité dont il ne put jamais se défendre l'empêcha de les prononcer avec toute l'ampleur qu'ils méritaient. Il en est un où Massenet se laissa aller à cette fine ironie qui était un des aspects de son caractère.
Appelé à faire l'éloge de son prédécesseur au fauteuil qu'il occupait à l'Académie des Beaux-Arts, il s'en tira d'une manière fort spirituelle. Obligé de consacrer son discours à la mémoire de Bazin, ce professeur peu perspicace qui le congédia de sa classe au Conservatoire, Massenet retraça la vie et la carrière de l'auteur du Voyage en Chine, mais en manière de conclusion, il employa cette plaisante formule : « Bazin était un professeur de premier ordre. Peut-être est-ce même ce qui a fait son originalité artistique, sa véritable personnalité ».
Quoique malicieux, Massenet était très bon : ces deux sentiments ne s'excluent pas obligatoirement ; mais comme sa bonté se manifestait de la façon la plus discrète, et que, d'après la loi commune, ceux qui en bénéficiaient ne la proclamaient pas, il s'ensuivit que cette bonté resta inconnue de presque tous. La méchanceté l'eût fait craindre, on ne lui sut aucun gré de sa bonté.
Il semblait impossible que le labeur journalier de Massenet s'intensifiât ; cependant, au cours des derniers mois de sa vie, une sorte de fièvre de travail le saisit ; il composait avec frénésie et dans un état d'âme voisin de celui du visionnaire. C'est ainsi qu'il put dire à une chanteuse qui le vint visiter à cette époque : « Vous me voyez bien occupé de mon art, mais je vis déjà bien plus dans le Ciel que sur la Terre. »
Depuis deux ans, sa santé s'était affaiblie. Au printemps de 1910, Massenet eut un sentiment de lassitude. Lui, le travailleur aussi infatigable qu'acharné, il aspira au dolce farniente : il ne voulut pas s'y laisser aller; cependant, son médecin consulté le déclara malade, « très gravement malade ». Cette crise ne fut que de quelques jours, il ne subsista qu'un amaigrissement rapide et excessif qui le marqua aussitôt. Enfin, le 6 août 1912, il quittait sa chère demeure d'Égreville, en Seine-et-Marne, et réintégrait son domicile parisien du 48 de la rue de Vaugirard. C'est là que, huit jours après, Massenet rendit le dernier soupir, le mardi 13 août 1912, à quatre heures du matin. Il était âgé d'un peu plus de soixante-dix ans.
Suivant son désir, ses obsèques eurent lieu à Égreville. Il n'y eut ni fleurs, ni couronnes, ni discours, pas d'honneurs militaires et... pas de musique. Celui dont les mélodies firent battre tant de cœurs n'eut pas le secours des ailes de la musique pour le soulever de cette terre et l'emporter vers les sphères de l'au-delà.
Des honneurs publics lui furent rendus post mortem. La municipalité de Saint-Etienne fit apposer une plaque et un médaillon sur sa maison natale. Le 23 février 1914 eut lieu, dans les jardins de Monte-Carlo, l'inauguration d'un buste de Massenet. De son côté, le Conseil Municipal de Paris a rendu un double hommage au célèbre compositeur en faisant placer une plaque commémorative sur la façade de la maison où il mourut, et en donnant son nom à l'une des rues du XVIe arrondissement. Enfin, le 21 octobre 1926, a été inauguré, dans le jardin du Luxembourg, un monument érigé, par souscription, à la mémoire de Massenet. Ajoutons que, bientôt, l'auteur d'Hérodiade aura son buste à Bruxelles.
II
L'ŒUVRE
Chez Massenet les divers sentiments humains se cristallisent en-musique, cela parce que, presque à son insu, tout se répercute en lui d'une façon musicale. La vie est un spectacle qui s'offre constamment à sa vue et à ses méditations, son être en est violemment ému. Pour traduire cette émotion, personne ne possédait une technique plus profonde, plus étendue, plus complète que la sienne ; dès lors, il aurait pu, comme tant d'autres, se confiner dans l'agencement d'agrégations d'accords et de timbres plus ou moins curieux, chose assez facile à un musicien tant soit peu habile. Intuitivement, il comprenait que ces petits procédés étaient vite surannés : il avait mieux à faire. En son cœur, au souffle de l'inspiration, chantait la mélodie éternelle... trésor autrement précieux et rare. Dans le premier cas, l'esprit crée ; dans le second, c'est l'âme qui jaillit. Massenet, d'ailleurs, réunit le talent et l'inspiration, c'est à cela qu'il doit d'être considéré comme un grand artiste-musicien.
Massenet fut un animateur dans le sens le plus complet, le plus large de ce mot. Des profondeurs de son âme monte le souffle qui lui permit de faire surgir, à l'aide de sa palette sonore, les personnages les plus divers. Il les fit vivre sur le théâtre avec toutes leurs passions. Il les peignit avec une telle vérité et un si grand relief que chacun se reconnut en ces images, et c'est grâce à cette puissance d'évocation qu'il atteignit le public, qu'il attira à lui la faveur du grand public. Il est certain que pour traduire les élans du cœur humain, l'amour, Massenet a trouvé des accents inconnus avant lui. Sous sa plume, la mélodie, sa mélodie, s'assouplit à son gré et suivant les nuances subtiles qu'il veut peindre ; mais au lieu de la présenter à l'état pur, comme les Italiens le font en général, Massenet établit sa mélodie sur un véhicule harmonique et orchestral où chaque dessin instrumental, où chaque combinaison d'accords ou de timbres, sont à ce point à leur place qu'on s'aperçoit à peine de l'habileté avec laquelle tout cela est fait. De sorte que l'on peut qualifier d'originales et de vraiment curieuses des dissonances et des sonorités placées précisément là où elles doivent être pour caractériser davantage encore une mélodie et lui donner une force nouvelle.
Massenet a véritablement créé un langage musical : son style est reconnaissable entre tous. Ce style, il ne l'a pas cherché, il découle, d'une part, de ses fortes études musicales et, d'autre part, de son tempérament. Quant à ses inventions harmoniques et orchestrales, elles sont innombrables. Considéré du point de vue harmonique, Massenet fut un novateur, un précurseur, aussi bien qu'envisagé du point de vue mélodique.
Extrêmement varié, l'Œuvre de Massenet comporte de la musique religieuse proprement dite : Ave Maria, Pie Jesu, O Salutaris, Panis angelicus, etc.; de la musique instrumentale : piano à deux et à quatre mains, violoncelle ; plusieurs recueils de mélodies pour chant ; un grand nombre de mélodies séparées pour chant ; de la musique de scène, Ballets, Cantates, Oratorios ou Drames sacrés; mais surtout des Opéras et Opéras-Comiques.
Si, considérant cette production artistique, on la compare à celle de Mozart, par exemple, on est amené à penser que les œuvres de Massenet ne sont pas en aussi grand nombre qu'elles eussent pu l'être. Cela tient à ce que Massenet réfléchissait longtemps, très longtemps à ses ouvrages avant de les écrire. Il a fait cette confidence sur la genèse de ses œuvres : « Je ne livre jamais un ouvrage qu'après l'avoir conservé, par devers moi, pendant des mois, des années même ». Riche d'idées, il les triait, les notait et ne les employait qu'à bon escient, lorsqu'il était sûr qu'elles convenaient parfaitement au sujet en cours d'exécution. Quand il écrivait, l'ouvrage était complètement composé dans son esprit ; dès lors, sa graphie n'était plus qu'une simple transcription de sa pensée.
Donc, contrairement à l'opinion généralement répandue, Massenet travaillait énormément ses œuvres. Cela est tellement vrai que, de 1872 à 1912, il n'a composé qu'une trentaine d'ouvrages formant un total de cent quinze actes, soit une moyenne de trois actes par an. Ce n'est pas beaucoup pour un travailleur acharné comme le fut Massenet : le catalogue des œuvres de Mozart, qui ne vécut que trente-cinq ans, est autrement considérable.
On a fait à Massenet le reproche d'écrire vite et très facilement. D'abord la facilité est une des marques du génie. Mozart n'a-t-il pas écrit en une nuit l'Ouverture de la Flûte enchantée : qui donc, cependant, oserait là taxer de « bâclée » ? On l'a pourtant fait à l'égard de certains ouvrages de Massenet qui, certes, ne méritaient pas une pareille apostrophe.
Sans être bâclés, les ouvrages dramatiques de Massenet sont d'inégale valeur ; mais, quel est donc le compositeur qui se soit constamment maintenu au niveau le plus élevé de sa production artistique ? Ne rencontre-t-on pas, dans l’œuvre de Mozart, de Beethoven, de Wagner des morceaux à peu près négligeables ? On ne saurait donc faire un crime à Massenet de ces inégalités ; il serait trop injuste de ne pas appliquer à ce seul compositeur la loi formelle qu'on doit juger un artiste d'après ses œuvres les meilleures.
Pour apprécier équitablement l'œuvre de Massenet, le mieux est de considérer cette production dans son ensemble ; on se trouve alors devant un immense ouvrage composé de nombreux chapitres qui tous contribuent, par leur diversité même, à l'unité et à la magnificence du tout.
Massenet a légué les partitions manuscrites de ses drames lyriques et opéras-comiques à la Bibliothèque de l'Opéra. L'ensemble de ces partitions forme un fonds important : soixante-seize gros volumes reliés, les plats en papier ; les dos en parchemin blanc avec étiquettes de différentes couleurs, bleu, rouge, vert ou marron. Ces partitions sont écrites sur un papier à musique fabriqué spécialement pour Massenet ce qui, tout naturellement, le fit baptiser : papier Massenet. De dimensions très grandes, il est d'excellente qualité, permettant les surcharges, les adjonctions et, surtout, le grattage des ratures.
Si, en considérant les partitions de la Bibliothèque de l'Opéra, en voyant le peu de ratures qu'elles comportent, on en déduisait que Massenet les a écrites ainsi, du premier jet, on commettrait une erreur ; une foule de brouillons les ont précédées : ce sont des nets.
Tracées d'une belle écriture, droite, claire, ferme, élégante, très personnelle, ces partitions sont infiniment intéressantes, et cela à bien des titres. On y trouve, par exemple, de fréquentes notes marginales qui font pénétrer le lecteur dans la vie journalière de l’auteur, l'initient à certaines de ses préoccupations, de ses joies. On trouve là des dates, des relations de faits que Massenet a consignées, marquant ainsi son désir de les enregistrer pour en garder le souvenir. Sur la première page du dernier tableau du troisième acte de Werther, nous relevons ceci : « Dimanche 26 juin 1887, sept heures du matin, temps gris.... Charpentier, premier grand prix de Rome, hier samedi. Sujet : Didon ». Gustave Charpentier fut, on le sait, un des élèves sur lequel Massenet fondait les plus belles espérances. Plusieurs de ces notes, entourées d'un cercle ou d'un ovale, indiquent le jour et l'heure où a été commencée telle œuvre ou tel acte de cette œuvre ou d'une œuvre quelconque. D'autres nous donnent le jour précis où Massenet mit le point sur l'i du mot Fin. Il y a là encore des dates de funérailles, d'inaugurations de monuments, etc., etc. On peut constater aussi que l'état de l'atmosphère jouait un grand rôle sur la mentalité du scripteur. Faisait-il un ciel sombre, la nervosité de Massenet en était désagréablement impressionnée ; au contraire, le soleil brillait-il dans un ciel radieux, alors Massenet en recevait le contrecoup : son esprit dégagé était comme illuminé par les rayons solaires. Cet homme du Nord-est aimait le climat et la lumière du Midi.
On a dit que chez les grands rien n'était petit ; pourtant, les grands hommes ont bien leurs petits défauts. Massenet fut superstitieux ; oh, cela se réduisit à peu de chose : il redouta le nombre 13. Les manuscrits de la Bibliothèque de l'Opéra ne comportent pas la page 13, laquelle est remplacée par la page 12 bis. De plus, il s'est arrangé afin qu'aucun de ses ouvrages ne fût représenté, pour la première fois, un 13... Pressentait-il donc que la mort viendrait le saisir un 13 comme cela se fit, le 13 août 1912.
Ne se contentant pas des termes génériques : Opéra, Opéra-comique, Drame lyrique, Ballet, usités d'ordinaire et dont il se sert dans ses premières œuvres, Massenet, afin de préciser le caractère particulier de chacun de ses ouvrages, les désigne par des qualificatifs d'une extrême variété. A partir d'Esclarmonde, il crée et adopte des titres spéciaux. Nous relevons : Opéra romanesque, Légende mimée et dansée, Episode lyrique, Pièce lyrique, Conte de fées, Conte lyrique, Miracle, Divertissement-ballet, Comédie chantée, Drame musical, Comédie héroïque, Opéra tragique, Haulte farce musicale, Opéra légendaire.
Il est à remarquer que si les musiciens célèbres eurent trop souvent à souffrir de l'accueil injuste réservé à leurs ouvrages par une critique et un public peu compréhensifs, ils ont eu, du moins, la satisfaction de trouver les interprètes dignes de traduire leur pensée. Cette juste revanche serait-elle la simple résultante du principe énonçant que la fonction crée l'organe ? Les compositeurs ont-ils fait jaillir les interprètes ? Toujours est-il que si l'on se reporte à Wagner, Meyerbeer, Halévy, Gounod, Saint-Saëns, Berlioz, Bizet, Lalo, Debussy, il est rare qu'il n'y eût pas unité entre les animateurs et les animés. Massenet, lui aussi, a rencontré les interprètes qui convenaient le mieux à chacun de ses ouvrages. Les citer tous nous entraînerait à une nomenclature dépassant les limites de nos possibilités.
Nous étudierons les ouvrages de théâtre de Massenet, donnés du vivant de l'auteur et après sa mort, en adoptant l'ordre chronologique des premières représentations.
Don César de Bazan avait permis à Massenet de montrer des qualités d'homme de théâtre, qui allaient s'affirmer complètement dans le Roi de Lahore.
Le livret du Roi de Lahore contenait ce qui pouvait le mieux convenir au tempérament artistique de Massenet : sentiments puissants, d'une extrême variété, présentés avec une remarquable entente scénique ; exotisme favorable aux chatoyantes couleurs orchestrales. Même le lieu de l'action, l'Inde Brahmanique, appelait des décors et des costumes propres à constituer un cadre pittoresque aux différentes scènes ; tout cela était bien fait pour échauffer l'imagination du jeune compositeur.
La musique que Massenet écrivit suit le poème avec art ; tout à tour tendre, passionnée, mystique ou guerrière, elle dépeint à merveille les divers sentiments inclus dans le drame.
Le troisième acte forme un contraste excellent avec ce qui précède et ce qui suit. L'âme d'Alim s'est élevée jusqu'au céleste séjour, au merveilleux Paradis d'Indra. Le dieu lui-même accueille l'âme du malheureux roi tandis que, baignées dans les splendeurs d'une lumière astrale, les Apsaras exécutent leurs danses rituelles. Cet épisode est délicat, vaporeux, fluide ; et, si l'on veut bien se souvenir que Massenet le conçut en un jour d'orage, alors qu'il s'était endormi, accablé par la chaleur, on dira, avec Wagner, que l'œuvre d'art est un rêve réalisé.
La mort de Sita, fatalement suivie de celle d'Alim, constitue un dénouement magnifique à ce magnifique poème de tendresse et d'amour.
Nous avons dit comment cet ouvrage entra à l'Opéra et l'accueil enthousiaste qui lui fut fait à Paris et à l'étranger. Cet accueil n'était que légitime. Dans cette première grande œuvre, Massenet avait donné libre cours à son talent, tant au point de vue de l'expression dramatique qu'à celui de la science musicale.
Le Roi de Lahore est un vase oriental qui contient, déjà, presque tout l'arôme spécial du génie de Massenet.
« A moi Regnault ! à moi Flaubert ! à moi vous tous qui vous êtes épris de ce type étrange de puberté lascive et d'inconsciente cruauté qui a nom Salomé, fleur du mal éclose dans l'ombre du temple, énigmatique et fascinatrice ! Venez et expliquez-moi, vous les génies, expliquez-moi comment Salomé s'est changé en Marie-Magdeleine ! » (Saint-Saëns. le Voltaire, décembre 1881.)
Jean a subi, dans le livret d'Hérodiade, la même transformation que Salomé. Ce n'est plus le rude anachorète Iochanaan, le prédicateur insensible à tout autre sentiment que celui de sa foi dans l'eau du baptême, image vivante de purification, de rénovation ; c'est un homme qui se défend, assez mal, de l'amour de Salomé, lui le sévère juge d'Hérode Antipas et d'Hérodiade.
Une fois sur la voie de l'erreur historique, le dénouement du drame devait être faussé ; il l'est en effet. La tête de Jean n'est plus réclamée par Salomé ; au contraire, c'est cette décapitation qui entraîne la mort de Salomé. Au moment où elle va venger le bien-aimé en poignardant Hérodiade, elle apprend que la reine de Judée est sa mère ; elle retourne le poignard contre elle.
Sur cette donnée si contraire à l'histoire, mais cependant favorable à la musique, Massenet a écrit une partition devenue célèbre après avoir eu bien des mésaventures.
Vaucorbeil, alors directeur de l'Opéra, à qui l'ouvrage fut présenté tout d'abord, n'en voulut pas sous prétexte que le livret était « incendiaire », expression vague qui, en somme, voulait simplement dire : refus. Sur ces entrefaites les directeurs du Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, MM. Stoumon et Calabrési, proposèrent à Massenet de monter Hérodiade. Ceci se passait en février 1881. L'activité apportée aux études, aux répétitions, à la confection des costumes et des décors, permit de donner la première représentation peu après le début de la saison, le 19 décembre 1881.
A cette occasion, il vint à Bruxelles des critiques d'Italie, d'Allemagne et de Russie ; mais, le gros de cet exode vers la capitale des Flandres, furent les quatre cents personnalités qui quittèrent Paris. On dut doubler et même tripler le train de Bruxelles. Les Bruxellois ne furent pas très satisfaits de cet envahissement : ils trouvèrent qu'on avait invité trop de Parisiens dans un théâtre où, grâce aux abonnements, il reste peu de places disponibles les soirs de première. « Si vous aviez tant envie de voir cet opéra, dirent-ils aux Parisiens, il fallait le jouer chez vous... » Malgré ces légers mécontentements, la soirée n'en fut pas moins triomphale. On acclama Massenet. Les journaux parisiens, ceux de Bruxelles et de l'étranger, publièrent des articles dithyrambiques sur la musique du maître français.
Après un tel succès, il semblait que l'ouvrage dût s'imposer à Paris : il n'en fut rien ; seule la province s'en empara, Nantes d'abord, puis Lyon, en 1883, où l'ouvrage eut cinquante représentations consécutives. Enfin, Hérodiade fit bien son entrée à Paris mais en ne franchissant que de petites portes. Traduit par Zanardini, Hérodiade fut représenté, le 1er février 1884, au Théâtre Italien, dirigé par Victor Maurel. L'interprétation vocale était de premier ordre ; toutefois, la situation embarrassée du théâtre fit que l'ouvrage dut être arrêté, dans la carrière glorieuse qu'il parcourait, à la dixième représentation. Le soir de la dernière, le 13 mars 1881, on pouvait voir, imprimés en grosses lettres sur l'affiche, à côté du nom de Victor Maurel, Hérode, ceux de Mlle de Reszké, Salomé, et de ses deux frères Jean et Edouard : Jean, Phanuel. A son tour, le Théâtre de la Gaîté donna Hérodiade le 2 octobre 1903. Quant à l'Opéra, c'est seulement en 1921 que cet ouvrage y fut monté. La première représentation, à ce théâtre, eut lieu le 21 décembre.
Si l'on se reporte à la facilité avec laquelle le Roi de Lahore pénétra à l'Opéra en 1877, on est surpris de constater ce qu'il fallut de temps à notre Académie de musique pour accueillir Hérodiade.
Œuvre construite dans la « forme opéra », telle à peu près que l'avaient conçue les compositeurs de la première moitié du XIXe siècle, Hérodiade comporte des airs ; mais ces airs sont peut-être plus intéressants encore que la partie purement d'action dramatique. Au 1er acte, l'air de Salomé : « Il est doux, il est bon » est remarquable par le souffle qui l'inspire et par les trouvailles harmoniques et orchestrales soulignant le chant : sur cet air plane le charme de Marie-Magdeleine. Au 2e acte, l'air d'Hérode : « Vision fugitive » exprime, d'une façon à la fois intense et profonde, la passion qui entraîne irrésistiblement le Tétrarque vers Salomé. Enfin, le 1er tableau du 3e acte, ajouté lors des représentations données à Paris, contient un air de Phanuel : « Astres étincelants », d'une magnifique ampleur, soulignée par un orchestre d'une richesse incomparable : seuls, les fonds de portraits d'un Rembrandt peuvent être comparés à cette puissance de couleur dans le clair-obscur.
Que dire de la somptuosité des ensembles, de leur majesté et de la grâce des danses, plus variées, plus :charmantes et plus pittoresques les unes que les autres ? Il nous faut cependant signaler, au 2e tableau du 3e acte, la Scène du Temple. La marche religieuse et le chant hébraïque : « Schemali Israël » ainsi que les danses sacrées, coupées par le chant de la Sulamite, sont autant de pages qui retiennent l'attention, intéressent et charment.
A son apparition, Manon souleva de nombreuses controverses. Les opinions les plus diverses, les plus contradictoires furent émises à propos de cette partition. On discuta sur le fond et sur la forme de l'ouvrage, et cela suffirait à en démontrer la valeur si cette démonstration n'était faite depuis longtemps.
Parce que Massenet s'était servi de quelques « motifs-types » pour caractériser les personnages principaux de la pièce et pour rappeler aux auditeurs la nature des pensées et des sentiments de ces personnages, on le qualifia de « Wagnérien », épithète péjorative s'il en fut à l'époque.
La vérité est que Massenet, renonçant fort judicieusement à la forme classique de l'opéra-comique, avait innové : il venait de créer un mode d'élocution. Le genre opéra-comique comportait, jusqu'alors, du parlé interrompant la musique de façon quelquefois assez désagréable. Massenet évita très habilement cet inconvénient en soutenant le dialogue par un orchestre discret, voilé, délicieux, jouant en demi-teinte une foule de petites phrases exquises. Ce n'était plus ainsi l'ennuyeux dialogue, ce n'était pas non plus le récitatif, c'était quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il fallait trouver : plus de scission dans la musique ; dans le charme sonore aucune solution de continuité.
On peut préférer à Manon une autre partition du même auteur ; il n'en est pas moins vrai que celle-ci, diverse en ses parties mais homogène quant à son ensemble, est une des plus parfaites qui soient sorties du cerveau, du cœur et de la plume de Massenet.
Le livret de Manon est redevable à Massenet de cieux scènes importantes qui forment un heureux contraste : l'acte du Séminaire et celui de l'hôtel de Transylvanie. C'est Massenet qui combina le premier avec Meilhac ; c'est lui qui réclama le second à ses collaborateurs.
Dans leur arrangement de l'épisode extrait des Mémoires d'un homme de qualité : les Aventures du chevalier Desgrieux et de Manon Lescaut, les auteurs du livret ont accommodé, pour le théâtre, le poème de l'abbé Prévost. Ils ont supprimé Tiberge, mentor peu nécessaire à l'action théâtrale. Certains détails psychologiques eussent été déplacés au théâtre ; ils ont été écartés. Enfin l'horreur du dénouement a été atténuée en faisant mourir Manon, non pas à la Louisiane, mais sur la route du Havre.
Malgré ces modifications, l'adaptation de H. Meilhac et Ph. Gille n'a pas moins gardé l'essentiel de la donnée du poème ; elle en a aussi conservé avec goût le caractère propre.
Massenet, depuis longtemps, était hanté par le désir de mettre Manon en musique. Manon, créature charmante, être frivole, objet de plaisir et de luxe, fait pour les légères amours, transfigurée par le grand amour de Desgrieux, devait en effet séduire Massenet. Pour traduire les élans passionnés d'es deux amants, il a trouvé des accents variés. Sa mélodie, tour à tour rêveuse, enveloppante, lascive, a un charme, une souplesse indicibles... et quel orchestre !... Par l'activité qui l'anime, il semble, vraiment, que l'on voit courir le sang dans les artères des personnages du drame, personnages auxquels l'orchestre confère, de la sorte, une vie intense.
Des figures de second plan comme Lescaut, Brétigny, Guillot de Morfontaine, Poussette, Javotte, Rosette, acquièrent, sous la plume de Massenet, un relief extraordinaire.
Les danses se chargent de rappeler le côté « époque ». Toute la joliesse des robes à paniers, des habits à la française, des souliers à boucles ; des perruques poudrées, des flots de rubans, des jabots de dentelle du temps de Louis XV, est évoquée en de petits ballets d'un archaïsme plein de grâce.
Manon est un des ouvrages que Massenet mit le moins de temps à composer. Commencé au cours de l'été 1881, il était terminé au printemps de 1883 : deux ans à peine avaient suffi à l'écrire. Dira-t-on, cependant, que c'est de la musique « bâclée » ?
On admet généralement que les compositeurs n'ont nul besoin de beaux vers pour leur suggérer une illustration musicale, et que la musique n'ajoute rien à de beaux vers..., au contraire.
Lorsque Massenet fut chargé d'écrire de la musique de scène pour les Erinnyes, Leconte de Lisle, inquiet, s'écria : « Croyez-vous que cette musique sera bien utile à mon drame, et qu'elle ne va pas empêcher d'entendre les vers ? » Cependant la musique de Massenet, bien loin de nuire au drame, lui apporta un surcroît d'intérêt et de succès.
Il est une poésie de Leconte de Lisle qui, sans aucun doute se suffisait à elle-même, c'est l'exquis parfum impérissable. Pourtant, soulevé par l'émotion et l'admiration que lui firent éprouver ces vers enchantés, Gabriel Fauré a trouvé des accents adorables pour ajouter de la musique sonore au rythme des hémistiches ; et il a si bien réussi que les deux éléments qui, soi-disant, n'étaient pas faits pour s'unir, paraissent être ici inséparables.
Massenet, grand admirateur des tragédies de Corneille, en particulier du Cid, comprenait mieux que qui que ce fût, la différence qui sépare le vers tragique du vers lyrique. Il savait parfaitement que, dans le premier cas, le vers contenant une pensée complète, le rôle de la musique est de se limiter à un simple commentaire orchestral : quelques morceaux encadrant le drame ou servant de fond à un nombre restreint de scènes. C'est ce que Massenet s'était contenté de faire dans la première version des Erinnyes ; sa partition ne comportait alors que : un prélude, un entr'acte et deux mélodrames. Dans le second cas, les vers doivent être construits de telle manière qu'ils constituent une sorte de canevas permettant au compositeur de broder, sur cette trame, les caractères des personnages de la pièce.
Une lettre, extraite de la collection d'autographes appartenant à la Bibliothèque de l'Opéra, permet de se rendre compte comment Massenet réalisa son projet de mettre en musique un drame cornélien. Cette lettre, datée du 14 octobre 1911, répond à une question, posée à Massenet, un an à peine avant sa mort, sur la genèse de son opéra le Cid ; en voici le texte :
« Cher ami,
J'avais le désir, depuis bien des années, en 1882, d'écrire un ouvrage d'après le chef-d’œuvre de notre Grand Corneille ; j'en parlai à mes amis Louis Gallet et Edouard Blau qui avaient été mes collaborateurs alors que j'obtins le second prix au concours de l'Opéra Impérial : la Coupe du Roi de Thulé. Diaz, fils du célèbre peintre, fut couronné Premier Prix et joué à l'Opéra.
Louis Gallet et Édouard Blau m'apprirent qu'ils avaient un poème, en 5 actes, complètement terminé, d'après le Cid ; je leur demandai de bien vouloir ajouter un tableau, que la lecture du Romancero espagnol m'avait suggéré ; il devint la scène de la consolante apparition au Cid perdu et éperdu !
Tout en travaillant, je me rappelai que j'avais, dans une pièce que d'Ennery m'avait confiée, un 5e acte d'une très belle émotion ; D'Ennery consentit à ce que j'en fasse le 2e tableau du 2e acte.
Voici, à peu près, mes souvenirs.
Pardonnez ma hâte et mon écriture, il est 4 heures du matin... et je m'éveille !...
MASSENET. »
Le livret du Cid est un amalgame de la tragédie de Corneille et de la Jeunesse du Cid, de Guilhem de Castro. Malgré tout ce qu'on peut facilement reprocher à une accommodation de ce genre, cet « arrangement » est assez habile. Il contient le plus grand nombre des vers classiques qui résonnent à nos oreilles depuis notre enfance, et presque toutes les situations de la tragédie ont été respectées. Les parties empruntées à Guilhem de Castro, le serment et la vision, sont bien loin de nuire à l'effet théâtral.
La tragédie de Corneille ne comporte naturellement pas de ballet ; on en a ajouté un, devenu très vite célèbre. Massenet a raconté comment il a noté, en Espagne, le motif qui devint le début de ce ballet. — Dans la salle basse d'une posada on dansa toute la nuit à l'occasion d'un mariage. Plusieurs guitares et deux flûtes répétaient à satiété un air de danse..., c'est cet air que Massenet nota et plaça dans le Cid.
En somme, on a fait du Cid une pièce à grand spectacle. Représenté pour la première fois à l'Opéra, le 30 novembre 1885, le Cid, interprété par Mmes Fidès Devriès, Bosman, MM. Jean et Édouard de Reszké, Melchissédec, Plançon, obtint un vif succès.
Le côté héroïque du poème a peut-être un peu moins bien inspiré Massenet que la partie amoureuse ? Là, Massenet était dans son élément : il a été incomparable. La Cantilène : Pleurez, pleurez mes yeux, et la musique placée sous les vers :
« Mon âme aurait trouvé dans le bien de te voir
L'unique allègement qu'elle eut pu recevoir. »
sont de ces choses qui comptent parmi les meilleures inspirations de Massenet.
Somme toute, cette partition, digne pendant du Roi de Lahore, est une œuvre de théâtre remarquable, variée, brillante, émouvante.
L'arrêt rendu, au royaume des purs esprits hindous, par le dieu Indra contre Alim : Qu'il soit lui ! Qu'il ne soit plus lui ! domine la partition d'Esclarmonde. L'étrange mystère s'est accompli. Massenet a trouvé le moyen de n'être plus lui tout en restant lui-même.
Un roman de chevalerie : Parthenopœus de Blois, a fourni aux librettistes le sujet d'Esclarmonde.
Tous les attraits de la légende dorée se trouvent inclus dans le poème mis entre les mains de Massenet : combats aventureux, amour, volupté, féerie, magie..., le réel dans l'irréel. De plus, ce poème nécessitait les décors et les costumes de l'époque byzantine, peut-être les plus somptueux qui soient. Tout était ainsi réuni pour former un spectacle d'une extrême variété et d'une grande séduction, mais aussi pour placer Massenet devant une énorme difficulté. Le langage musical qu'il avait employé jusqu'alors ne convenait plus ici : il fallait en trouver un autre.
Massenet connaissait à fond l'œuvre de Wagner, maintes fois il l'avait analysé au cours de ses leçons au Conservatoire. Obligé de prendre un parti, en l'occurrence il s'engagea résolument sur la voie ouverte par le maître de Bayreuth. Il lui prit le « leitmotiv » dont il avait d'ailleurs fait usage déjà dans Manon ; mais, passant au crible de sa raison l'art allemand de Wagner, il n'en garda que ce qui convenait à sa nature et à l'essence d'un poème légendaire français. Loin de copier son modèle, il ne fit que s'en inspirer et resta absolument français : David n'abdiqua pas devant Goliath.
Ce qui ajouta à l'idée de wagnérisme qu'on s'était fait tout d'abord à propos d'Esclarmonde, c'est que le livret offre évidemment quelques points de contact avec les poèmes de Wagner. Le glaive invincible de Roland fait songer à l'épée de Siegmund, comme le sommeil enchanté d'Esclarmonde et sa déchéance rappellent Brunehilde dans la Walkyrie. De même que le charme de l'amour est rompu aussitôt que Lohengrin a été amené à dire son nom, le pouvoir magique d'Esclarmonde s'évanouit, dès que sa personnalité est dévoilée. Néanmoins, l'art prestigieux de Massenet a su rendre tout tellement différent, qu'on ne saurait coin-parer ceci à cela.
Jamais peut-être l'art de Massenet ne s'est élevé plus haut que dans Esclarmonde. Sa technique semble s'être encore accrue. Il a trouvé des sonorités d'orchestre d'une puissance inouïe pour décrire, par exemple, l'écroulement des murailles de Blois. Vraiment le déchaînement de l'orchestre et sa force, donnent l'impression d'un cyclone, d'un typhon ; et, à d'autres moments, que de délicatesses, que de calme, que de sérénité !
Voici une analyse qui indique assez bien les aspects variés de la musique d'Esclarmonde :
« Tour à tour noble et sévère dans le magnifique récitatif de Phorcas, au prologue ; pleine de tendresse dans le duo des deux sœurs, au premier acte ; heurtée, sauvage, enfiévrée, dans l'admirable chasse qui suit ce duo ; impérieuse et farouche, dans l'évocation des Esprits de l'air ; délicieusement sensuelle, dans l'île enchantée et dans la symphonie qui accompagne les premiers baisers d'Esclarmonde ; pieuse et vaillante dans le chant de l'Épée de Saint-Georges ; dramatique, large et puissante, lorsque Roland, pressé par l'évêque, trahit le serment qui le lie ; émue et poignante dans la douleur d'Esclarmonde pleurant sur sa puissance envolée, moins encore que sur son bonheur détruit, et exhalant sa peine en un si tendre reproche :
Regarde-les, ces yeux plus purs que les étoiles ! »
Esclarmonde émancipa l'art français, lui fit faire un pas en avant.
Que Richepin le voulût ou non, des profondeurs de son poème, le Mage, monte le symbole. Les personnages sont plus que des êtres participant à une action théâtrale, ce sont des idées matérialisées.
Entre les deux voies qui s'offrent à lui, Zarastra, mage blanc, mage de vérité et de justice, ne peut hésiter un instant entre l'esprit du bien, de la lumière, personnifié par Anahita, et l'esprit du mal, de l'obscurantisme, représenté par Veredha. Après une série de dramatiques aventures, Zarastra, s'étant retiré sur la montagne sacrée afin d'épurer son âme par la méditation, et ayant triomphé de toutes les difficultés suscitées par le mal, s'unit enfin à Anahita : le bien s'unit à la vérité, à la justice.
Le Mage, poème atlante comme celui de la Flûte enchantée, poème bien plus en profondeur qu'en surface, n'a pas bien inspiré Massenet. Ce n'est pas qu'on ne retrouve dans cet ouvrage les qualités de l'auteur d'Esclarmonde, mais ces qualités, les mêmes ici et là, s'appliquent mal dans le second cas. Il aurait fallu que Massenet accordât sa lyre au ton du poème, cette fois il ne le fit pas.
Le public, qui après tout est souvent meilleur juge que l'on ne pense, accueillit assez froidement cet ouvrage d'un de ses musiciens préférés. Le Mage n'eut que trente-deux représentations et ne fut jamais donné en province ni à l'étranger, fait bien rare pour une œuvre de Massenet.
L'élaboration du livret de Werther fut difficile. Comme pour Manon, il s'agissait en effet d'adapter au théâtre un roman dans lequel les détails psychologiques constituent un des côtés fondamentaux de l'œuvre. La difficulté était accrue du fait que les Souffrances du jeune Werther étaient conçues par un cerveau allemand et écrites en langue allemande. Les adaptateurs surent vaincre toutes ces difficultés ; leur livret contient l'essentiel pour former une donnée poignante dans sa simplicité bourgeoise.
Le premier projet du livret fut ébauché, en 1882, au cours d'un voyage que firent ensemble Massenet, Hartmann et P. Milliet. Il ne fallut pas moins de quatre ans pour que ce livret fût terminé : l'Invocation à la nature fut refaite un nombre incalculable de fois. Quant à la musique, Massenet en écrivit les premières mesures au printemps de 1885, il travailla fiévreusement pendant toute l'année 1886 à cet ouvrage dont le développement scénique lui plaisait infiniment ; c'est seulement à la fin de l'hiver 1886 qu'il y mit la dernière main.
Avec son admirable talent d'assimilation, Massenet comprit que la passion de Werther perdrait de sa force en étant traduite avec l'exaltation frénétique d'un romantique. Descendant alors le ton de son langage et le maintenant dans une note contenue, il donna ainsi, par la sobriété des moyens, plus d'intensité à la puissance émotive de ce poème d'amour.
Massenet confie un rôle primordial à l'orchestre ; il l'a dit lui-même : « Dans la partition de Werther, l'orchestre représente symboliquement l'un des principaux personnages ». Effectivement, en cet orchestre sont presque inclus toute la pensée et tout l'intérêt du drame sans pour cela que, chose merveilleuse, la mélodie, émue, vibrante, ne chante sur le théâtre comme à l'orchestre.
Grâce à l'emploi du leitmotiv, qui subit au reste de continuelles transformations, l'unité musicale, aussi bien que le caractère profond du poème, est constamment maintenue.
Dès le premier acte, après la scène charmante entre le Bailli et ses enfants répétant le chant de Noël, le sentiment de la nature apparaît et s'allie fort joliment aux aveux de Werther dans un morceau intitulé : le clair de lune. D'ailleurs, ces deux scènes ne sont pas les seules beautés que renferme le premier acte. Le prélude construit sur le thème du désespoir de Werther et sur celui de son aspiration au calme, crée une atmosphère de douleur et de mort caractéristique du héros de la pièce. Toute la fin de ce premier acte, dominée par le thème de l'amour, est d'un charme que Massenet a égalé mais n'a jamais dépassé, lui le charmeur. La scène où Charlotte relit les lettres de Werther, au troisième acte, et la Cantilène : les larmes qu'on ne pleure pas, sont de ces inspirations nées du cœur et qui vont au cœur. Le dénouement est une trouvaille. La scène se passe encore pendant une nuit de Noël, mais quel contraste entre cette nuit-ci et celle de l'année précédente ! La joie a fait place à la douleur, au drame. Werther, en proie au plus violent désespoir, est rentré chez lui, dans son cabinet de travail. Il a envoyé un domestique porter une lettre demandant au mari de Charlotte de lui prêter ses pistolets, prêt assez traîtreusement consenti par Albert. Charlotte, comprenant le danger, accourt : le corps inanimé de celui qui l'aima d'un amour si noble et si grand que la mort en est l'issue, est le spectacle qui s'offre à ses yeux. Au moment où la fin s'approche, fin adoucie par la présence de la bien-aimée, éclate le chant de Noël entendu au début de la pièce. Cette bouffée de jeunesse et de joie, arrivant en un pareil moment est d'un effet saisissant ; elle ranime encore un instant le désespéré, Werther trouve alors la force de s'écrier d'une voix expirante : Ah ! les enfants ! mais, bientôt les voiles de la mort l'enveloppent complètement. Il semble que le rideau s'abaisse sur cette philosophique pensée, que si la mort est auguste, la vie est la raison d'être du Monde.
Werther aurait dû être composé avant Manon, diverses circonstances en décidèrent autrement. Non seulement Manon passa avant Werther, mais encore cette dernière œuvre ne fut représentée qu'après le Cid, Esclarmonde et le Mage.
Paris n'eut pas la primeur de cet ouvrage. L'Opéra-Comique ne le donna que le 16 janvier 1893 ; la première représentation avait eu lieu, à l'Opéra Impérial de Vienne, le 16 février 1892.
Très apprécié dans la capitale de l'Autriche, Werther fut loué par la presse et par les vrais connaisseurs lors de la première à Paris ; cependant, il fallut attendre la reprise de 1903 pour que cette partition fût adoptée par la masse du public.

le bureau-piano de Massenet (Musée de l'Opéra)
Au lendemain de la première représentation à l'Opéra-Comique, Charles Garnier écrivit à Massenet l'affectueuse et amusante lettre que voici : « Amico mio, Deux yeux pour te voir, Deux oreilles pour t'entendre, Deux lèvres pour t'embrasser, Deux mains pour t'applaudir et Deux mots pour te faire tous mes compliments et te dire que ton Werther est joliment tapé, — savez-vous ? Je suis fier de toi et de ton côté ne rougis pas d'un pauvre architecte tout content de toi. Carlo. »
Massenet a déclaré avoir mis dans Werther « toute son âme et sa conscience d'artiste »... La musique de Werther proclame la vérité de ces paroles.
Le créateur de Werther, le ténor Van Dyck, avait imaginé une Légende mimée et dansée : le Carillon. L'argument de cette légende, présenté à Massenet, lui plut à ce point qu'il en composa la musique en un mois. L'œuvrette, proposée au directeur de l'Opéra de Vienne, fut acceptée avec empressement et montée aussitôt. C'est ainsi que, quatre jours après la première de Werther, l'Opéra Impérial donna le Carillon pour la première fois.
Dans l'argument de ce ballet plusieurs choses se réunissaient pour séduire Massenet. D'abord le caractère moyenâgeux de la légende, caractère qui donne à tous les personnages un tour fort plaisant ; ensuite les différentes scènes formant entre elles des contrastes rapides favorables à la musique de ballet; enfin l'époque : la scène se passe à Courtrai au XVe siècle, d'où matière à des décors et à des costumes pittoresques.
Massenet n'eut qu'à se laisser aller à la verve qui l'avait si bien inspiré en écrivant les ballets intercalés dans ses précédents ouvrages pour trouver, en son ingéniosité mélodique et rythmique, les éléments musicaux d'un charmant spectacle de danse.
Les pages de ce ballet particulièrement bien venues sont : l'Entrée des Corporations ; le pas de Bertha raillant son amoureux Karl ; le duo d'amour, dialogue entre le violon et le violoncelle ; l'apparition des anges protecteurs de Karl contre les méfaits de Pit et de Jef, amoureux éconduits et finalement métamorphosés en Jacquemars par la puissance surnaturelle de saint Martin ; enfin, la danse pleine d'entrain, de mouvement et de couleur qui termine cet agréable ballet.
Deux ouvrages d'un caractère diamétralement opposé : Thaïs et la Navarraise, virent « le feu de la rampe », pour la première fois, en 1894 ; une charmante bluette : le Portrait de Manon, prit place entre ces deux œuvres importantes.
L'histoire de Thaïs et du cénobite Paphnuce est trop connue pour qu'il soit nécessaire de la narrer à nouveau. Constatons cependant que, en donnant à son Paphnuce un côté diabolique qu'il n'a pas dans la Vie des Saints-Pères du désert, Anatole France a créé un personnage qui pouvait parfaitement être transporté au théâtre. Il forme effectivement un contraste saisissant à opposer à Thaïs. Alors que la danseuse-courtisane, conquise par la foi, s'élève vers les hautes sphères de la félicité divine, Paphnuce (Athanaël), par un mouvement contraire, descend des régions sublimes où il était parvenu. Il a sauvé sa belle catéchumène, mais lui, moine satanique, devient blasphémateur, proclamant que rien n'existe hormis la vie et l'amour ; après quoi il s'abîme dans le désespoir lorsque Thaïs meurt.
Il y a là une opposition que Massenet a traduite avec force. Ce dénouement est assurément une des scènes les meilleures de la partition. Au reste, c'est l'opposition constante des deux personnages principaux, Thaïs et Athanaël, qui insuffle la vie à tout l'ouvrage. Opposition de milieu aussi, dès le début de la pièce, entre la vie austère, contemplative des anachorètes au désert et l'existence de plaisir dans Alexandrie, la terrible cité. Somme toute, poème favorable à la musique.
Massenet a exprimé de main de maître l'évolution spirituelle de Thaïs. D'abord câline, voluptueuse, la musique qui la concerne prend ensuite un caractère intérieur, mystique, tout à fait approprié au personnage transformé par la foi. Il en est de même pour Athanaël, dont les accents passionnés de la fin contrastent tellement avec la sérénité de ceux des premières scènes.
L'hymne à Éros, la Méditation pour violon, dont le charme est encore accru lorsque le chœur, placé derrière le rideau en accompagne la longue mélodie, le Ballet et la Danse de Thaïs, la jolie scène de l'Oasis, sont autant de pages délicieuses qui peuvent être considérées comme de l'excellent Massenet.
Quoi qu'on puisse reprocher à cet ouvrage, écrit pour l'Opéra-Comique, de manquer un peu de l'ampleur nécessaire à l'Opéra, il n'en est pas moins vrai que son pouvoir d'action s'exerce puissamment sur le public.
A propos de Thaïs, Massenet a révélé son affection pour les bêtes, notamment pour les chats. Il eut un énorme angora gris, au poil long et soyeux, qui ne le quittait ni jour ni nuit. Pendant l'élaboration de Thaïs, ce chat venait se coucher sur la table du maître, presque sur ses feuilles, avec un sans-gêne qui ravissait Massenet.
A la même époque se trouvait, également sur le bureau de Massenet, une statuette polychrome, œuvre de Jérôme. Massenet l'avait désirée car il aimait avoir sous les yeux une image, un symbole de l'ouvrage qui l'occupait ; or, cette statuette représentait Thaïs. Voici dans quels termes Jérôme offrit l'objet convoité à son confrère de l'Institut : « 1er août 1892... Je vous avais apporté à l'Institut la petite poupée Thaïs, et comme je partais pour la campagne au sortir de la séance où vous n'êtes pas venu, je l'ai laissée à Bonvalet, le priant de la traiter avec soin... Jérôme. »
Tiré d'une nouvelle de J. Claretie : la Cigarette, le livret de la Navarraise est, comme son prototype, violent et passionné. Un épisode de l'insurrection carliste, dominé par l'amour, en fait tous les frais.
Anita aime le sergent Araquil, mais ne peut l'épouser faute de la dot exigée par le père. Cette dot, deux mille douros, elle se la procure en allant tuer le chef carliste Zaccaraga. Parvenue à ce point, l'action dramatique se corse encore du fait que, Araquil, soupçonneux, a suivi Anita aux avant-postes carlistes ; là, il est blessé à mort et, lorsqu'on le ramène agonisant, Anita a beau lui dire qu'elle est riche à présent et qu'ils seront heureux, il meurt en la maudissant. Alors, devant le cadavre du bien-aimé, Anita devient folle de douleur et rit, rit terriblement.
Massenet a écrit la seule musique pouvant convenir à ce poème angoissant. Le dialogue est traité avec l'art coutumier de l'auteur et, quand s'apaisent les coups de feu, les sonneries militaires, il y a là quelques morceaux profondément tendres et émus, notamment le duo entre Anita et Araquil, le Nocturne, pièce symphonique exquise, qui sépare et unit à la fois les deux actes, enfin les déchirantes lamentations de la pauvre Anita sur le corps inanimé de celui qu'elle aima éperdument.
Cette partition est unique dans l'œuvre de Massenet. Si on la rapproche de Thaïs, on se rendra compte à quel point le style de Massenet savait s'assouplir, se modifier, s'adapter aux différents sujets qu'il traita. En écrivant la Navarraise, Massenet a montré qu'il pouvait être « Vériste » aussi bien et même mieux que tout autre.
Cet ouvrage représenté pour la première fois le 20 juin 1894 au Théâtre de Covent Garden, de Londres, obtint en Angleterre un grand succès. A Paris on le discuta ; il se forma un camp des deux côtés de la barricade. Finalement la Navarraise s'imposa.
Le chevalier des Grieux a maintenant quarante ans. L'impression douloureuse que son aventure avec Manon a laissée en son souvenir l'a vieilli avant l'âge. Il s'est retiré en province, dans un château où il revit sans cesse les tristes phases du roman de sa jeunesse en contemplant un Portrait de Manon, seule image matérielle qu'il ait conservée de la bien-aimée. Son neveu, le jeune vicomte de Mortcerf, dont il surveille l'éducation, lui avoue l'amour qu'il ressent pour la gentille Aurore et lui exprime son désir d'épouser celle qu'il aime ; mais Aurore, fille de Lescaut, recueillie et élevée par Tiberge, est roturière ; dès lors des Grieux ne saurait consentir à une mésalliance malgré l'intervention de Tiberge en faveur des deux amoureux, lesquels, désespérés, étudient la manière dont il va falloir mourir. En attendant, Jean cherche à prendre un baiser sur la joue en fleur d'Aurore, qui se défend, assez faiblement d'ailleurs. Dans cette petite lutte, Jean fait tomber le coffret où se trouve enfermé le Portrait de Manon et voici que s'en échappe la charmante miniature. A la vue de ce portrait, l'idée de vêtir Aurore d'une robe semblable à celle que portait jadis Manon lorsqu'elle descendit du coche, s'empare de l'esprit de Tiberge. C'est sous ce costume que, peu de temps après, Aurore apparaît aux veux du chevalier. La ressemblance entre la nièce et la tante est si frappante que ce n'est pas Aurore qu'il a devant lui, c'est Manon elle-même surgissant des voiles du passé. Des Grieux, profondément troublé, s'écrie alors que : « La raison n'est qu'un sacrilège, l'amour seul est la vérité » et consent à l'union de Jean et d'Aurore.
La partition que Massenet a écrite sur cet agréable livret contient maintes réminiscences de Manon. Ces motifs caractéristiques sont ici parfaitement à leur place ; de plus, ils sont amenés avec un goût, un art, une science consommés. A ce point de vue, le monologue de des Grieux se remémorant avec mélancolie les divers épisodes de sa vie passée, est admirable : l'auditeur peut entrer dans le for intérieur du personnage, suivre sa pensée vraiment révélée par la musique.
Citons encore la leçon d'histoire romaine sur Scipion l'Africain, fort spirituellement traitée, ainsi que la fable de Tiberge : « Dans le puits où jadis logeait la vérité » d'un tour enjoué très agréable. Naturellement la scène entre Jean et Aurore a bien inspiré Massenet ; ce duo déborde de jeunesse et d'amour ; il est en outre coupé par une pastorale : « Au jardin Colin..., d'un archaïsme savoureux. V. Joncières a pu dire très justement à propos du Portrait de Manon : « La partionnette de M. Massenet est un vrai bijou, finement ciselé, d'une grâce exquise ».
« J'étais parti pour les montagnes, le cœur léger... J'écrivis Sapho avec une ardeur que je m'étais rarement connue jusqu'alors.
Nous habitions une villa, où je me sentais si loin de tout, de ce bruit, de ce tumulte, de ce mouvement incessant de la ville, de son atmosphère enfiévrée ! Nous faisions des promenades, de grandes excursions en voiture, à travers ce beau pays, tant vanté pour la variété de ses sites, mais alors encore trop ignoré « l'Auvergne ». Nous allions silencieux. Le seul accompagnement de nos pensées était le murmure des eaux qui couraient le long des routes et dont la fraîcheur venait jusqu'à nous ; parfois, c'était le bruit jaillissant de quelque source qui interrompait le calme de cette luxuriante nature. Les aigles, aussi, descendant de leurs rocs escarpés, « séjour du tonnerre », suivant le mot de Lamartine, venaient nous surprendre, en un vol audacieux, faisant retentir les airs de leurs cris aigus et perçants. Tout en cheminant, mon esprit travaillait, et au retour, les pages s'accumulaient. J'étais passionné pour cet ouvrage. »
Et Massenet ajoute que, dans le travail, quatre de ses ouvrages lui ont donné des joies exquises : Marie-Magdeleine, Werther, Sapho et Thérèse.
Ce vif sentiment de la nature, cette joie de se trouver au sein des montagnes comme au bord de la mer ou au milieu d'une campagne agreste, Massenet va traduire un peu de tout cela dans Sapho. Dès le premier acte, lorsqu'au milieu d'un bal de rapins et de modèles, Jean Gaussin dépaysé se remémore le pays d'Arles, l'atmosphère brillante, éclatante de la Provence est tout à coup révélée par la musique, l'auditeur en est baigné. Plus tard, au quatrième acte, la scène se passant à Avignon, on retrouve ce savoureux arôme provençal que Massenet a rendu avec force. Et, lorsque les aspects charmants de Ville-d'Avray servent île cadre aux troisième et cinquième actes, avec quelle poésie Massenet fait-il surgir devant nos yeux les étangs et les bouleaux chers à Corot ! il semble vraiment que le musicien se soit emparé des pinceaux et des couleurs de ce peintre exquis.
Le livret que H. Cain et A. Bernède ont tiré du roman d'A. Daudet sont trop connus, l'un et l'autre, pour qu'il soit nécessaire d'en analyser l'argument ; disons seulement que leur côté si profondément humain était bien fait pour inspirer Massenet. A la vérité, la passion de Fanny et de Jean, qui durant quatre actes s'exhale en un duo d'amour, a permis à Massenet d'écrire des pages débordantes de tendresse, pathétiques plus encore par la vie intérieure qu'elles renferment que par l'extériorisation des diverses circonstances de la pièce.
Tout en gardant son étonnante maîtrise de coloriste de l'orchestre, Massenet, dans Sapho, a réservé au chant un rôle prépondérant ; mais au quatrième acte, ce chant acquiert une puissance d'expression qui sera encore dépassée au cinquième pour décrire le désespoir de Fanny Legrand. Il y a là de ces fonds d'âme déchirants. Et quelle mélancolie dans cette fin, lorsque la jeune femme, profitant du sommeil de son Jean, s'éloigne de lui par amour.
Sur cet ouvrage plane une amère tristesse ; aussi est-ce avec raison qu'Alphonse Daudet a pu dire de cette Sapho musicale : « Massenet a dû mettre là-dedans toutes les blessures, toutes les angoisses de sa jeunesse, il a dû enterrer je ne sais quoi. »
Les contes de fées de Perrault, s'ils sont écrits pour les petits enfants, ce qui est indubitable, ne conviennent pas moins excellemment aux grands enfants que nous sommes tous, quel que soit notre âge. Dès lors, on conçoit fort bien que soit venue à l'idée d'un lettré délicat la pensée de tirer d'un des contes de cet attrayant auteur, la matière d'un livret propre à être mis en musique.
Dans son adaptation de Cendrillon, Henri Cain a laissé indemnes les personnages principaux : Cendrillon, le Prince Charmant, la bonne-fée et les méchantes belles-sœurs ; mais il a donné un rôle important au malheureux Pandolfe, époux de cette pie-grièche Mme de la Haltière, et a développé le côté plastiquement féérique du conte de Perrault. C'est ainsi qu'a poussé et s'est épanoui l'arbre symbolique, le tutélaire chêne des fées autour duquel évoluent sylphes et lutins, tandis que s'animent les fleurs.
Massenet a trouvé là un livret qui convenait on ne peut mieux aux multiples aspects de son talent.
De nombreux poètes, tant en France qu'en Italie, en Allemagne et en Angleterre, se sont inspirés de l'attendrissant fabliau de Grisélidis, écrit à la fin du XIIe siècle et attribué, non sans raison, à la gente trouveresse Barbe de Verrue.
Déjà, à la fin du XIVe siècle, les tourments endurés par la pauvre Grisélidis avaient fourni le sujet de l'Estoire de Grisélidis, la marquise de Saluces, sa merveilleuse constance, le miroir des dames mariées, représentée par les clercs de la Basoche en 1395. Ensuite Pétrarque, et Boccace dans son Décaméron, achevèrent de populariser cette perle poétique puisée à l'abondante source littéraire du haut moyen âge.
Le conte du Décaméron, duquel s'inspirèrent A. Silvestre et Eug. Morand lorsqu'ils écrivirent leur pièce du Théâtre-Français, suit assez exactement la donnée du fabliau de Barbe de Verrue, fabliau qui oppose et unit à la fois, avec tant de pathétique, à l'exquise douceur de Grisélidis, l'odieuse rudesse de son époux. Jugeant particulièrement choquante cette manière d'être de Gaultier à l'égard de sa femme, A. Silvestre et Eug. Morand en atténuèrent le côté un peu blessant. Au lieu de laisser au marquis de Saluces le soin de tourmenter Grisélidis, ils confièrent ce rôle au diable, diable dont l'allure s'avère plus comique encore du fait qu'il se chamaille fréquemment avec son acariâtre épouse Fiamina. L'adjonction de ces deux personnages sataniques à la trame initiale du poème offrait l'avantage de fournir au musicien un élément à la fois démoniaque et bouffe d'un puissant effet théâtral, tout en gardant le contraste de l'éternelle antinomie de l'esprit du bien s'opposant à l'esprit du mal. Il est évident que le spectacle des malignes épreuves infligées à Grisélidis par le diable constitue un saisissant contraste à la vertu intangible de la marquise de Saluces.
L'argument du livret est d'ailleurs fort simple. Gaultier, marquis de Saluces, en partant pour la croisade, doit forcément abandonner sa femme, jeune et belle, et son fils Loys. Gaultier est si sûr de la fidélité de Grisélidis qu'il défie le diable et parie avec lui qu'il n'aura pas raison de la vertu de Grisélidis. Effectivement, malgré les embûches du malin, malgré les charmes et les assiduités du séduisant Alain, la marquise ne faillit pas à son devoir d'épouse. Le diable, furieux, se venge de cet échec en ravissant le petit Loys et, au moment où Grisélidis, éplorée de la disparition de son fils, se laisserait prendre au piège d'aller le réclamer à bord du navire d'un pirate, qui n'est autre que le diable, le marquis de Saluces revient de Terre Sainte. Il n'ajoute aucune créance aux calomnies répandues sur sa femme; mais, lorsqu'il demande à voir son fils, le diable déclare que Loys lui appartient. Gaultier et Grisélidis s'agenouillent devant l'autel de sainte Agnès, leur patronne. Ils implorent ardemment et pieusement la sainte. L'autel alors s'illumine. Le triptyque s'entrouvre et Lovs apparaît endormi aux pieds de la sainte tandis qu'un chœur d'anges chante le Magnificat. Ainsi se termine ce conte lyrique, sorte de mystère, en trois actes et un prologue.
Massenet aima beaucoup cette pièce dans laquelle tout lui plaisait, a-t-il dit ; cependant l'élaboration de Grisélidis fut longue. Massenet y travailla durant le cours de neuf années, par intervalles, il est vrai, entre ses voyages dans le Midi et au cap d'Antibes.
C'est vers la quarante et unième année de sa vie que Massenet commença les esquisses d'un ouvrage dont l'achèvement ne devait avoir lieu que lorsqu'il eut cinquante ans ; pourtant on y rencontre le charme, la verve juvénile, l'émotion des premières productions du maître. Si ce n'était la virtuosité qui décèle la maturité de cette œuvre, tout y est jeune : les effusions de tendresse de Grisélidis, ses rêveries ou ses ardentes prières, ainsi que les élans passionnés d'Alain.
Rarement Massenet a été mieux inspiré qu'en écrivant Grisélidis. Le rôle de l'héroïne est plein de douceur, de charme et de candeur ; celui d'Alain tendre à souhait; quant au rôle du noble et puissant seigneur de Saluces, Massenet lui a donné toute l'ampleur désirable.
Le diable d'Armand Silvestre et d'Eug. Morand n'a rien de bien effrayant. Par la façon dont Massenet a traité ce personnage et celui de Fiamina on peut constater un habile retour vers les traditions instaurées par Dalayrac, Monsigny, Boieldieu, ces maîtres qui, avant Gounod (le Médecin malgré lui) et Ambroise Thomas (le Caïd) illustrèrent le genre opéra-comique si éminemment français.
A propos du petit Loys, Massenet s'est exprimé ainsi : « Nous avions pour ce grand personnage une petite fille de trois ans qui était le théâtre même. Comme au second acte, l'enfant, sur les genoux de Grisélidis, devait donner l'illusion de s'endormir, la petite artiste trouva seule le geste utile et compréhensible de loin pour le public : elle laissa tomber un de ses bras, comme accablée de fatigue. Oh la délicieuse petite cabotine. »
Allant du plaisant au sévère, du comique au tragique en passant de l'irréel au réel, la musique de Grisélidis assigne à cet ouvrage une place de premier plan dans l’œuvre de Massenet.
Le Jongleur de Notre-Dame. — Ici encore la littérature du haut moyen âge a fourni à Massenet le sujet d'un de ses ouvrages les plus remarquables. Dépourvu, non seulement de l'élément satanique qu'on rencontre dans Grisélidis, mais encore ne comportant pas de rôle de femme, le poème du Jongleur monte droit dans le ciel azuré, tel un lys.
Lorsqu'apparut le Jongleur de Notre-Dame, on s'étonna de voir surgir le nom d'un librettiste inconnu. Comment Massenet, compositeur justement célèbre, assailli d'offres de collaborations, pouvant choisir qui il voulait parmi les librettistes les plus réputés, avait-il précisément accueilli cet auteur ignoré du public théâtral ? Différentes versions furent alors données pour expliquer la genèse d'une telle collaboration, versions ingénieuses mais toutes aussi fausses les unes que les autres. Par la suite, Massenet lui-même, par l'imprécision de ses souvenirs, contribua à déformer les faits. Voici l'histoire vraie de ce petit événement dû à une circonstance fortuite... la modestie et le talent du poète ayant fait le reste.
En juin 1899, l'auteur vint discrètement, déposer son livret chez le concierge du maître, qui habitait alors rue du Général Foy. Quand Massenet, se rendant à l'Institut, quitta son logis peu de temps après la visite du jeune écrivain, son concierge lui remit le manuscrit en question. Massenet le prit, le feuilleta pour ainsi dire machinalement, et comme, apriori, l'idée ne lui déplut pas, il l'emporta avec lui afin de le lire plus attentivement dans le wagon où il prit place le soir mémo pour se rendre à Nice... Arrivé à Avignon il avait trouvé et noté la phrase musicale à adapter sur les mots : Vierge, mère d'Amour ! On peut donc dire que, dès la première lecture, Massenet fut conquis par son livret et entra dans le vif du sujet.
Il peut paraître étonnant qu'un livret dépourvu de rôle féminin ait pu séduire Massenet, le peintre évocateur des tendres élans de Manon, de Thaïs, de Sapho et de tant d'autres héroïnes ; pourtant, le poème de Maurice Léna renferme une si grande somme de beauté que son charme devait agir sur Massenet et, fatalement, s'emparer de son esprit, esprit tellement apte et prompt à saisir toutes les nuances de la beauté.
Maurice Léna, fin lettré, artiste délicat, a tiré son livret d'un fabliau du XIIe siècle intitulé : del Tumbeor Nostre-Dame, dont il a suivi le texte d'assez près, en particulier au 3e acte. L'auteur anonyme du fabliau a situé son récit au couvent de Clairvaux ; Maurice Léna, transposant le lieu de l'action, l'a placé à l'abbaye bénédictine de Cluny au XIVe siècle ; il y avait avantage, en effet, à ce que les habitants du monastère s'occupassent aux travaux de l'esprit, ainsi que cela se pratique dans les abbayes bénédictines. Toutefois, le costume noir des bénédictins a été remplacé par la robe cistercienne de Clairvaux. Ce léger anachronisme était nécessaire, la couleur blanche du froc cistercien étant infiniment plus jolie sur la scène.
Sur la place ménagée devant l'abbaye, les jeunes filles dansent une bergerette. Tout à coup, au son d'une vièle à archet, survient un baladin, un jongleur. Il tente de gagner quelques deniers en exécutant ses tours, mais tous sont connus des villageois ; le pauvre bateleur ne récolte que moqueries. La Chanson du vin, sorte d'alleluia profane dont le refrain, moins que pieux, unit Bacchus à Jésus et Vénus à la Vierge, intéresserait beaucoup plus son auditoire, qui la réclame. Tiraillé par la faim, Jean, c'est le nom du jongleur, se résout à chanter le couplet irrévérencieux. A ce moment, s'ouvre la porte du monastère. Le prieur s'est avancé, et ses paroles courroucées reprochent au baladin son acte sacrilège. Jean, dont le nom était synonyme de pureté et d'innocence à l'époque du haut moyen âge, exprime son repentir. Le prieur lui dit alors qu'une seule chance de salut s'offre à lui, celle de se consacrer à la Vierge qu'il vient d'outrager. Jean hésite un instant à se rendre aux exhortations du prieur : ce gueux tient à la liberté. Enfin, il pénètre dans l'abbaye emportant avec lui son attirail de jongleur. Dans le monastère auquel il appartient maintenant, chacun glorifie la Vierge à sa manière ; seul, Jean n'est bon à rien. Il se désole de son incapacité ; il faut que Boniface, moine-cuisinier, narre la légende de la sauge pour que Jean comprenne que la moindre offrande est favorablement accueillie par la mère du Christ. Dès lors son parti est pris. A l'heure où la chapelle est déserte il y pénètre; puis, ôtant son froc, apparait vêtu du costume de jongleur qu'il porta jadis, et, devant la statue de la Vierge à laquelle il a dit innocemment l'hommage qu'il voulait lui rendre, il exécute les tours de son répertoire : il chante, danse et tournoie, tournoie vertigineusement. Attirés par ce bruit insolite le prieur et les moines ont pénétré lentement dans la chapelle et crient au sacrilège. Mais voici que l'autel s'illumine. La Vierge s'incline et bénit le jongleur tandis que se fait entendre un chœur d'anges : du plus profond de son âme Jean a donné tout ce qu'il avait en lui, il sera sanctifié. Épuisé, il tombe sur les marches de l'autel et meurt extasié. Le miracle est accompli et, après que les moines prosternés ont adressé leur supplication : Priez pour nous, le prieur conclut en proclamant la parole de l'Évangile : Heureux les simples, car ils verront Dieu, parole que Massenet a utilisée comme épigraphe à son « Miracle ».
Se souvenant des époques où la foi était le seul foyer de l'art, Massenet a conçu le Jongleur à la manière des primitifs de la peinture. Toutefois, en s'inspirant de ces modèles, il ne tomba pas dans l'erreur de faire maladroit sous prétexte de faire naïf. Avec un rare bonheur il s'assimila leur sensibilité, leur émotion un peu naïve mais profondément mystique, et y ajouta une maîtrise que les adorables peintres des XIIIe et XIVe siècles ne pouvaient avoir. En effet, ce n'est que plus tard, à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, que les peintres acquirent les sciences du dessin, de l'anatomie et de la perspective portées au superlatif.
Véritable triptyque musical, dont chaque panneau, chaque acte est surmonté d'un fronton constitué par un prélude instrumental, le Jongleur de Notre-Dame occupe une place prépondérante dans l'Œuvre de Massenet et, ainsi, honore l'école française tout entière.
Formé de motifs-types, de leitmotiv si l'on veut, le prélude de chaque acte prépare psychologiquement l'auditeur à ce qu'il va voir et entendre, il aide sa compréhension et crée l'atmosphère de laquelle il va être enveloppé. En outre il y a, dans la nature de ces idées-mères, une gradation qui montre et explique parfaitement l'évolution du personnage principal : le Jongleur.
Le premier prélude a pour base un thème fugué qui dépeint la physionomie professionnelle du jongleur. Le deuxième est composé de deux éléments principaux : un Motet à Marie et le motif de la paix du cloître. La pastorale mystique éclaire et magnifie le troisième prélude, le troisième fronton.
Pour analyser la musique des trois actes du Jongleur, tant au point de vue technique qu'au point de vue esthétique, il faudrait écrire un volume. Nous nous contenterons de constater l'unité qui règne dans cet ouvrage, le parfum de mysticisme qui s'en dégage, et la sublimité à laquelle il parvient par des moyens simples en apparence. Le sentiment, sentiment intense, profond, domine cette œuvre. Pour l'écrire, Massenet a affiné son âme; il s'est élancé vers l'idéal à la fois le plus séduisant et le plus élevé.
Dans un excellent dessein, nous voulons le croire, une remarquable artiste, Mary Garden, l'inoubliable créatrice de la Mélisande de Claude Debussy, a voulu jouer et chanter le rôle de Jean... ce travestissement est une profanation. L'adorable conte, l'exquis fabliau enluminé par l'art de Massenet doit garder sa pureté initiale : il ne comporte aucune voix de femme.
Représenté pour la première fois au Théâtre de Monte-Carlo, le 18 février 1902, le Jongleur de Notre-Dame a été donné à l'Opéra-Comique, le 10 mai 1904. Depuis, il a fait son tour du monde.
La Cigale et la Fourmi, de La Fontaine, a inspiré à M. Henri Cain un scénario dans lequel l'ordre des facteurs s'est trouvé renversé : les animaux sont devenus des êtres humains. La Cigale et la Fourmi se sont transformées en femmes, très femmes, avec leurs sentiments, leurs qualités et leurs défauts ; de plus, trois personnages nouveaux : le Petit Ami, la Pauvrette et le Garçon de Banque, ont été ajoutés aux deux héroïnes.
Voici comment Massenet s'exprime au sujet de cette pochade, divertissement-ballet destiné à une fête de charité : « Henri Cain m'avait amusé en me faisant écrire la musique d'un joli et pittoresque ballet en un acte : Cigale. L'Opéra-Comique le donna le 4 février 1904. De ceux qui assistèrent aux répétitions de Cigale, je fus, certes, celui qui s'y divertit le plus. Il y avait à la fin une scène fort attendrissante et d'une poésie exquise : celle d'une apparition d'ange, avec une voix d'ange qui chantait au loin ».
Oui, Massenet s'est amusé en écrivant cette pochade, on le sent dans chaque épisode du rôle de Mme Fourmi, rentière, et dans chacun de ceux du rôle du Garçon de Banque ; mais il s'est aussi ému des malheurs de Cigale donnant tout ce qu'elle possède et qui ne reçoit, en retour, que noire ingratitude, jusqu'au moment où, lasse, elle meurt de chagrin et de froid sur la neige et au clair de la lune pendant une nuit de Noël. Aussi, tout en restant dans une tonalité enjouée, légère, spirituelle, la musique de ce divertissement ne manque-t-elle pas de cette sensibilité qui, pour être un peu à fleur de sentiment, n'en est pas moins très vraie.
Pochade, cette œuvrette, mais pochade brossée par un maître d'une habileté incomparable ; telle est l'impression qui se dégage de la partition de Cigale.
Chérubin, le charmant personnage du mariage de Figaro, n'est plus un enfant, il a maintenant dix-sept ans. C'est un jeune officier adoré des femmes. Comme Don Juan, il brise des cœurs, mais aussi, comme Don Juan, il est crâne : il ne craint pas de croiser le fer avec tous ceux dont la jalousie a été éveillée par ses allures galantes. La pupille du Comte, Nina, est naturellement amoureuse de Chérubin ; mais lui se soucie infiniment moins des tendres émois de Nina qu'il n'est préoccupé de la sémillante Ensoleillad, danseuse auréolée par sa beauté et ses succès.
Le Philosophe, précepteur de Chérubin, a beau sortir d'excellents arguments pour démontrer à son élève les dangers d'une passion qui ne peut que lui être funeste, rien n'y fait : il résiste à ces bonnes raisons ; aussi, lorsque l'Ensoleillad, ne prenant pas au sérieux l'amour de ce jeune conquérant, continue sa route, Chérubin est-il plongé dans un noir désespoir devant ses illusions envolées. Mais, comme le fond n'est pas mauvais, quand Chérubin apprend que Nina va entrer au couvent, c'est elle qu'il aimera et dont il fera son épouse. Tel est l'alerte poème sur lequel Massenet a écrit une musique alerte.
Massenet a cinquante-neuf ans lorsqu'il commence Chérubin et, cependant, pareil à son héros, il sait avoir une rime de dix-sept ans en l'écrivant ; cette partition déborde de jeunesse.
Si, dans le livret, à côté de Chérubin se voit le Philosophe, de même, dans la partition, le maître, esprit clair, hautement cultivé, pondéré, tempère et affine les idées de l'élève, dont la fougue, l'impétuosité, pourraient paraître excessives sans cette maîtrise consommée.
L'âme de chaque personnage est révélée à l'auditeur par une série de motifs-types ; mais, ces motifs-types, Massenet, au cours des trois actes de cette Comédie chantée, les développe ou les condense avec une souplesse et une habileté incroyables. Dans l'ouverture ces motifs sont présentés à l'état pur, pourrait-on dire, et s'enchaînent avec une logique aussi rigoureuse que parfaite.
Si Massenet, en composant Chérubin, n'a pas manqué de s'imprégner de Beaumarchais, il s'est également souvenu du divin Mozart maintes pages de sa partition reflètent l'influence de l'auteur des Noces de Figaro ; mais cette influence n'est que salutaire, car Massenet a si bien absorbé et assimilé la source d'inspiration à laquelle il a puisé, qu'il en a fait du Massenet. Sa personnalité domine constamment l'œuvre. Sans parler du rappel de la sérénade de Don Juan, placée à la fin de la pièce comme un hommage rendu à Mozart, on pourrait citer bien des coins charmants venant appuyer notre thèse au reste tout à l'honneur de Massenet... et de Mozart.
Malgré un rare ensemble de qualités, Chérubin n'a rencontré, ni auprès du public, ni surtout auprès des directeurs de théâtre, le succès qu'il méritait.
« Depuis très longtemps germait en moi le désir de pleurer les larmes d'Ariane ; je vibrais donc de toutes les forces de mon cœur et de ma pensée avant de connaître le premier mot de la première scène. »
Cette phrase, extraite des Souvenirs de Massenet, indique assez avec quelle joie il accueillit le livret auquel il aspirait depuis toujours. Son poème le transporta à tel point qu'il a pu s'écrier : « Ariane ! Ariane ! l'ouvrage qui m'a fait vivre dans ses sphères si élevées. » L'Opéra le donna le 31 octobre 1906.
Certains vers du livret de Catulle Mendès sont d'une indigence incroyable ; cependant, dans son ensemble, ce livret offrait au compositeur des situations dramatiques propres à être traduites musicalement.
Massenet apporta à l'élaboration d'Ariane toutes les ressources de son art. La musique est non seulement appropriée au sujet, mais encore Massenet a su faire parler à chaque personnage du drame le langage qui devait lui conférer son caractère particulier, et le mettre ainsi en complète valeur. La mélodie se modifie, s'assouplit, se transforme de façon à exprimer tour à tour les emportements de Thésée, le désespoir d'Ariane, les accents passionnés de Phèdre ou la sérénité de Pirithoüs. Quant à Perséphone, c'est sans doute le personnage le mieux campé de toute la pièce. Et quel orchestre ! comme il suit, avec une maîtrise inouïe, les méandres d'une action compliquée.
Nombreuses sont les scènes d'Ariane qui mériteraient d'être citées : la fin du troisième acte, tout le quatrième et le dernier, si navrant du fait que Thésée abandonne la pauvre Ariane en quittant, avec Phèdre, le rivage de Naxos. La mort d'Ariane, attirée dans les flots de la mer par le chant des Sirènes, est le digne couronnement de cette œuvre imprégnée d'émotion.
Massenet avait l'intention de demander la suppression de l'acte des Enfers, le quatrième ; lorsque, cédant à la curiosité de sa petite-fille, il lui raconta Ariane. Arrivé au moment où Ariane, après avoir invoqué Cypris, est conduite aux enfers par les trois grâces, comme Massenet arrêtait son récit, sa petite-fille lui dit alors : « Et maintenant, bon papa, nous allons être aux Enfers ? » Cette question lui fit comprendre l'évidence de la scène, et, subitement, il se décida à la conserver. C'est ainsi que l'ouvrage ne fut pas amputé du délicieux épisode des roses qui, rappelant Perséphone au souvenir de la terre, où jadis elle vécut, fait qu'elle accorde à Ariane la vie de Phèdre.
Massenet, qui avait déjà traité tant de sujets d'ordres différents, ne s'était attaché à la période révolutionnaire que par l'ouverture de Brumaire, écrite en 1899, pour un drame d'Ed. Noël. Le drame ne fut pas représenté mais l'ouverture subsista. Cette ouverture, dont la forme classique fait par instant songer à Beethoven, comme on sait grand admirateur de Bonaparte, est une œuvre remarquable. Il y souffle un vent de patriotisme qui l'avive ; derrière le grand Soldat de la République marche tout le peuple français. On y sent aussi, dans certains passages sombres et inquiets, comme un souvenir oppressé des angoissantes journées de la Terreur. Or, c'est précisément un épisode de la Terreur qui va fournir à Massenet le sujet d'un de ses plus beaux ouvrages : Thérèse.
Depuis longtemps, et sous diverses influences, Massenet désirait mettre en musique quelque chose qui eut trait à la Révolution. Jules Claretie, féru de cette période de l'histoire de France, lui permit de réaliser son projet en imaginant un livret dans lequel une femme, tempérament d'amoureuse, s'étant éloignée du devoir conjugal, y revient finalement avec toute la fougue de sa nature tendre et passionnée.
Outre les deux personnages principaux : Thérèse et son mari, le Girondin Thorel, il en est un autre, le marquis Armand de Clerval, dont le rôle est tellement piteux qu'on sait doublement gré à Thérèse de se reprendre d'amour pour un époux qui a décidément plus d'allure.
Le premier acte de ce drame musical est empreint d'une mélancolie qui plane sur le parc abandonné et sur la demeure délabrée habitée par Thorel et Thérèse, demeure où, grâce à la bonté aveugle de Thorel, Armand de Clerval, royaliste émigré, va recevoir une hospitalité qui coûtera la vie à son hôte. Le second acte s'oppose fortement au précédent en ce sens que ce qui en fait les frais, ce sont les journées de juin 1793, c'est l'émeute, c'est la mort.
En ces deux actes se meut une action en somme assez simple, quoique tragique, et dans laquelle les personnages vivent intensément par la force de leurs sentiments. En penseur, en philosophe, Massenet est descendu au fond de leur psychologie, il en a scruté les recoins les plus intimes, et cette psychologie il l'a musicalement exprimée avec des ressources aussi variées que l'étaient les états d'âme de ses héros. Chaque motif mélodique est absolument adéquat au sentiment que le compositeur veut traduire, et son orchestre n'a peut-être jamais été aussi nuancé, fluide et puissant que dans Thérèse.
Au début de la pièce la saison automnale est évoquée d'exquise façon. Il y a de ces délicatesses qui apportent à nos sens comme un arôme de terre humide et aussi le parfum des feuilles nouvellement tombées sur le sol. Les entretiens amoureux ont, suivant les cas, une signification toute particulière; et, chose merveilleuse, la foule grouillante, hurlante, effroyable, a trouvé en Massenet l'interprète le plus vigoureux qui se puisse rencontrer. — Thérèse s'est mise à la fenêtre et a délibérément clamé le cri de Vive le roi qui doit l'unir, dans la mort, à l'époux dont elle a trompé la confiance et l'affection. Alors, les révolutionnaires se ruent, enfoncent la porte et s'emparent de leur victime pour la mener à l'échafaud. — Massenet a su faire de cette scène finale une chose terrible.
La partition de Thérèse occupe une place de premier plan dans l'Œuvre de Massenet. A un ami qui lui disait : « Si vous avez écrit le Jongleur de Notre-Dame avec la foi, vous avez écrit Thérèse avec le cœur », Massenet répondit : « Oui, Thérèse est mon cœur, et le Jongleur est ma foi ».
En dehors de la musique de danse intercalée dans ses opéras ou opéras-comiques, des trois ballets que Massenet a fait représenter, l'un, le Carillon, est comique ; l'autre, Cigale, est tendre, poétique et triste ; enfin, le dernier, Espada, est dramatique.
Sur un argument vériste, dû à M. René Maugars (Henri de Rothschild), où de violentes émotions sont groupées en un court espace de temps, Massenet a écrit une musique puissante, vigoureuse, passionnée, qui rehausse encore le vif éclat d'un scénario intéressant. L'esthétique d'Espada peut être rapprochée de celle qui inspira à Massenet la Navarraise. Il serait oiseux de faire ressortir une partie de ce ballet au détriment d'une autre : il vaut surtout par une harmonieuse entente entre les péripéties du drame et la façon dont ces péripéties sont musicalement exprimées. Espada donne l'impression de dépasser les limites assignées, d'ordinaire, au ballet.
Bacchus, opéra en quatre actes, est la résultante de l'erreur d'un poète et de la bonté de Massenet.
Massenet n'accepta le livret de Catulle Mendès que pour ne pas désobliger son éditeur, Henri Heugel, qui s'était entendu avec le librettiste pour donner une suite à Ariane. En partie puisé dans le grandiose poème indou Râmayana, le livret de Bacchus se perd dans des abstractions inintelligibles pour le public. Comme dans le Mage, c'est bien le triomphe de l'esprit de lumière sur l'obscurantisme, mais l'exposé de cette doctrine ne constitue pas une action théâtrale susceptible d'intéresser les spectateurs. Cette action a pu intéresser Massenet, elle ne l'a pas bien inspiré. Au cours de la composition de cet ouvrage, combien d'hésitations, de doutes l'ont assailli. Son travail fut acharné. Il luttait, rejetait, reprenait sans cesse. « Enfin, je terminai Bacchus après y avoir consacré tant de jours, tant de mois ! »
Massenet eut beau placer dans Bacchus de belles pages destinées à Ariane, rien n'y fit : cette fois, le souffle coutumier manqua au maître. Doit-on l'en incriminer, ou ne faut-il pas, plutôt, reconnaître que le poème manque totalement de situations dramatiques capables de fournir un élément d'inspiration au compositeur ? Ce n'est pas qu'on ne puisse rencontrer quelques morceaux intéressants dans Bacchus : l'air d'Amahelli est passionné et prophétique à souhait ; le rôle de Bacchus contient plusieurs parties qui ne sont pas dépourvues d'ampleur, mais il manque à tout l'ouvrage une des qualités primordiales de Massenet : la vie.
Deux idées mythiques intéressantes sont ici exprimées ; l'une, par Antéros, lorsqu'il dit que, pour le salut de l'humanité, les dieux sont quelquefois amenés à prendre une forme humaine ; l'autre, par la Parque Clotho, expliquant que Bacchus a dû s'incarner dans le corps de Thésée pour conquérir l'amour d'Ariane.
Tout cela est bien subtil pour la moyenne des spectateurs. Malgré les soucis que lui causa l'élaboration de Bacchus, Massenet déclare avoir eu de bons moments, par exemple le jour où il s'avisa d'écrire un important morceau d'orchestre pour accompagner le combat victorieux des singes des forêts de l'Inde contre l'armée héroïque de Bacchus ; et Massenet ajoute : « Que de fois, en écrivant ce morceau, j'allai étudier les mœurs de ces mammifères, au Jardin des Plantes ! Je les aimais, ces amis, eux dont a si mal parlé Schopenhauer en disant que si l'Asie a les singes, l'Europe a les Français ! Peu aimable pour nous l'Allemand Schopenhauer ! » Bacchus n'eut que trois représentations.
Si, par la pensée, on unit l'esprit de Don Quichotte, toujours épris d'idéal, rêvant de conquêtes chimériques et d'amours impossibles, à l'implacable bon sens de Sancho Pança, on aura une sorte de Massenet. Dès lors il était tout naturel que Massenet s'enflammât pour un sujet dans lequel deux des personnages principaux présentaient de telles affinités avec sa propre nature qu'il pouvait se reconnaître en eux; tant il est vrai, comme l'a dit Fromentin, qu'un peintre, en faisant le portrait des autres, reproduit bien souvent sa propre image.
Nous n'ergoterons pas sur le Don Quichotte de Jacques Le Lorrain. Nous ne chercherons pas à démontrer si ce poète malheureux qui, semblable à Hans Sachs, faisait tour à tour des vers ou des souliers, n'a pas eu le plus grand tort de déformer l'œuvre géniale de Cervantès. Ce qui est intéressant est de savoir si Henri Cain a tiré un livret musical du Chevalier à la longue figure de Le Lorrain. Massenet a répondu par l'affirmative et nous croyons qu'en cela il eut raison.
Sans vouloir soupeser la valeur spécifique du Don Quichotte, du Sancho Pança et de la Dulcinée de Le Lorrain, et par conséquent d'Henri Cain, disons que ces personnages très différents de ceux créés par Cervantès, conviennent néanmoins à un commentaire musical, non pas seulement en raison des situations théâtrales auxquelles ils participent, mais aussi par leur caractère personnel. Or, dans cet ouvrage, comme dans tous ses ouvrages, Massenet s'est identifié avec les personnages dont il avait à traduire les sentiments ; de la sorte, il a précisément écrit la musique qui convenait à chacun d'eux ; il s'ensuit que, lorsque les personnages sont, scéniquement médiocres, la musique ne s'élève pas plus haut que leur niveau moyen : tel est le cas de la partition de Don Quichotte. Est-ce à dire qu'on ne puisse relever des choses intéressantes dans Don Quichotte ? non : chaque acte en contient. Il y a de l'esprit, de la grâce et de la tendresse dans cette Comédie héroïque; par moments même, notamment en ce qui concerne la Prière de Don Quichotte, au troisième acte, et sa mort, à la fin de l'ouvrage, la musique acquiert un sens élevé du plus beau caractère. En outre, l'examen de la partition révèle l'habileté d'une orchestration pittoresque, savoureuse, pleine de trouvailles.
Don Quichotte a remporté de vifs succès, il en remportera sans doute encore : c'est un ouvrage « très public », comme on dit en jargon de théâtre ; mais, vraiment, on ne peut pas placer cette partition à côté des grandes œuvres du maître.
En 1902, dix ans avant les premières représentations de Roma à l'Opéra de Monte-Carlo et à l'Opéra de Paris, Massenet écrivait une des scènes les plus importantes de cet ouvrage et décidait en outre du titre qu'il porterait. Ainsi, dix ans d'élaboration pour cette partition ; de celle-là, du moins, on ne dira pas qu'elle fut bâclée.
La Rome vaincue d'Alexandre Parodi hantait Massenet depuis le retentissant succès que cette tragédie obtint à la Comédie-Française en 1876. Aussitôt après une lecture qu'il fit du poème, en 1902, l'idée de mettre en musique Rome vaincue s'imposa si fortement à l'esprit de Massenet que, non seulement il écrivit la scène de Posthumia, au 4e acte, mais qu'il alla jusqu'à choisir, in petto, le titre de l'ouvrage projeté : Roma. C'est en 1907, cinq ans après ce premier emballement, que la collaboration d'Henri Cain fut décidée ; cependant, depuis longtemps la musique de cette œuvre chantait en Massenet.

Massenet et le Prince Albert Ier dans les jardins de Monaco (Bibliothèque de l'Opéra)
Il est impossible de s'occuper de Roma sans songer à la Vestale de Spontini. Les deux ouvrages mettent en scène une vestale transgressant la loi jurée et attirant ainsi sur Rome là défaite de ses armées. Toutefois, dans le chef-d'œuvre de Spontini, Julia épouse prosaïquement l'objet de son amour, tandis que dans Roma Fausta, ne pouvant se poignarder elle-même puisqu'elle a les mains liées, est poignardée par Posthumia, la patricienne, l'aïeule aveugle. Il y a là une différence qu'on pourrait dire d'époque. Au XVIIIe siècle on aimait assez que les livrets d'opéras finissent bien ; au XIXe sans doute sous l'influence du Romantisme, les dénouements devinrent, en général, tragiques. Au reste la fin de Roma paraît être infiniment plus conforme à la vérité historique que le dénouement de la Vestale.
Certes, les personnages constitutifs de la Rome vaincue de Parodi sont on ne peut plus intéressants ; cependant, il est une entité qui domine toute la tragédie, c'est Rome ; et voilà précisément pourquoi le titre choisi par Massenet est si parfaitement normal. C'est pour sauver Rome que Fausta se constitue prisonnière et avoue sa faute sachant le châtiment qu'elle encourt. C'est aussi pour Rome que Fabius Maximus n'hésite pas à condamner à la mort sa fille adoptive coupable d'avoir souillé le temple de Vesta, souillure d'où découlent les malheurs de Rome.
Comme la tragédie de Parodi, le livret d'Henri Cain est trop connu pour que nous ayons à en narrer les épisodes magnifiques; disons seulement que Massenet a écrit sur cette donnée cornélienne, une partition qui, tout en étant conçue dans la forme et le style classiques, présente, néanmoins, les qualités d'émotion, de sensibilité, de charme inhérentes au talent de l'auteur, et une puissance, une distinction s'accordant à merveille avec la noblesse des sentiments de chacun des personnages de la pièce.
Chaque acte de Roma a sa forme, sa couleur, son essence propres ; cependant, dans son ensemble, l'œuvre entière garde une unité qu'on rencontre rarement chez quelque compositeur que ce soit.
Une ouverture crée l'ambiance dans laquelle va se mouvoir l'action, action dramatique faite d'oppositions violentes formant entre elles de saisissants contrastes.
Au moment où le rideau se lève pour la première fois, le peuple, accouru au Forum, exprime sa consternation en un chœur d'une couleur sombre appropriée à la situation. L'entrée de Lentulus, ses récits de la mort de Paul-Émile et de la défaite des légions romaines ont grande allure ; l'air de Posthumia : « Quel est ce lieu ? » ajoute encore à l'oppression de cette scène. L'acte du Temple de Vesta est d'une majesté splendide. La scène d'amour, scène qui englobe presque tout le troisième acte, est sans doute une des plus belles que Massenet ait jamais écrites. En voyant les désastres que sa faute attire sur Rome, Fausta en comprend l'immensité ; pourtant elle ne peut résister au charme de la tendresse dont son cœur est plein. D'autre part, en son âme de romaine naît le sentiment de sa responsabilité et de son devoir : elle s'avouera coupable et expiera son crime pour sauver la patrie. Tout -cela est exprimé par la musique avec une force et un sens profonds. Et voici une scène capitale, l'Acte du Sénat ; d'ailleurs, dans Roma, toutes les scènes sont capitales. Devant le Sénat assemblé, Fausta est venue s'accuser de sa faute. Avec quels accents véhéments fait-elle l'aveu de son crime !... et, tout à coup, le ton change, la voix de Fausta s'est alanguie au souvenir de l'amour : « En écoutant sa voix, j'ai tout oublié », quelle douceur la musique n'a-t-elle pas pour souligner ces paroles, ce sentiment ! Fausta est condamnée à être enterrée vive. Alors, c'est la scène admirable dans laquelle Posthumia, pour épargner à sa fille les affres d'une lente agonie, poignarde elle-même la vestale coupable, puis elle s'écrie : mon enfant !
Qu'on écoute cette partition, et l'on verra si Massenet manque de grandeur et de force, comme on le lui a reproché. La vérité est que Roma constitue un sujet d'étonnement lorsqu'on analyse l'Œuvre de Massenet : comment l'auteur de Manon et de Werther a-t-il pu élever son style à une telle hauteur, lui donner l'ampleur qu'on rencontre dans Roma ? Ce qui est certain, c'est que Roma, véritable hymne à la patrie, à l'amour, est une œuvre de beauté antique, de pure beauté.
De l’œuvre monumentale de Maître François Rabelais Gargantua et Pantagruel, bien peu de choses subsistent dans le livret de Panurge : ce Panurge n'a aucun rapport avec celui du Curé de Meudon. La vérité est qu'il était à peu près impossible d'adapter Rabelais à la scène ; son œuvre, s'il contient une humanité, profonde, néanmoins n'est pas du théâtre. Des personnages ont dû être inventés pour former l'action théâtrale d'une opérette, qu'ils avivent au reste assez convenablement ; mais que nous voilà loin de Rabelais !
Lorsque Balzac composa ses Contes drolatiques, il comprit que, pour leur donner toute la saveur désirable, il était indispensable qu'ils fussent écrits en vieux français. De même, Massenet se rendit parfaitement compte que, en ce qui concerne Panurge, la langue de Rabelais devait être conservée ; il ne put l'obtenir. On lui objecta que le public n'arriverait jamais à comprendre le langage du XVIe siècle ; fallacieux prétexte qui alla à l'encontre du véritable but à atteindre : garder au livret le côté savoureusement archaïque que comporte le modèle. De sorte que, contrecarré dans ses idées et, de plus, gêné par un livret que transformait étrangement l'original, Massenet, dans ces conditions, ne pouvait écrire qu'une partition hybride, sans cohésion, sans unité : ce qu'il fit. — Et alors, comment lui, Massenet, a-t-il accepté un livret dont il reconnaissait évidemment les qualités, mais dont les défauts apparaissaient à son esprit critique avec toute leur force ? — A la lecture attentive de ses Souvenirs il semble bien que ce soit encore sa bonté qui l'ait entraîné à l'acceptation d'un livret qu'il savait ne pas devoir lui être favorable. Massenet dit expressément : « Tandis que j'en étais aux dernières corrections d'épreuves de Panurge, dont le poème m'avait été confié par mon ami Heugel... »
Il y aurait beaucoup à dire sur la bonté de Massenet.
« Amadis ! Quel joli poème j'avais là ! Quel aspect vraiment nouveau ! Quelle poétique et touchante allure avait ce Chevalier du lys, resté le type des amants constants et respectueux ! Quel enchantement dans ces situations ! Quelle attachante résurrection, enfin, que celle de ces nobles héros de la chevalerie du moyen âge, si vaillants et si braves ! »
Le poème qui enchantait à ce point Massenet est, comme Esclarmonde, Grisélidis et le Jongleur de Notre-Dame, issu de notre vieux fonds littéraire médiéval. Claretie l'a extrait du célèbre roman, Amadis de Gaule, écrit en prose au XVe siècle, mi-partie en français, mi-partie en espagnol, par divers auteurs. Ce roman méritait l'estime dans laquelle le tint Cervantès, puisque, s'il est vrai qu'Amadis soit le modèle des amants constants et respectueux, il est aussi un exemple typique de ces chevaliers errants ridiculisés par le Don Quichotte de Cervantès.
Plusieurs compositeurs, avant Massenet, mirent en musique Amadis de Gaule. Ce sujet inspira notamment à Jean-Chrétien Bach, fils cadet de Jean-Sébastien Bach, une tragédie-opéra en 3 actes, représentée à l'Académie de Musique le 14 décembre 1779, opéra qui n'eut que sept représentations.
L'élaboration et la destinée d'Amadis sont assez curieuses. Comme toujours, dès que Massenet fut en possession du livret, il se mit fiévreusement à la composition des esquisses de cet ouvrage, si bien que, commencées à la fin de l'année 1889, les sept cents pages formant le brouillon d'orchestre d'Amadis étaient terminées en mai 1891. A cette époque la maison Hartmann venait de disparaître. Massenet plaça dans un coffre-fort la partition de Werther et celle d'Amadis ; Werther n'y resta pas longtemps, pour Amadis il en fut autrement. Ce n'est que dix-neuf ans après, au printemps de 1910, que Massenet vint réveiller Amadis du sommeil léthargique dans lequel il était plongé. Il s'agissait à présent de revoir ces esquisses, de recopier, et de mettre le tout au net. Le maître, très fatigué déjà, se mit cependant à la besogne avec allégresse. Quel temps y consacra-t-il ? nous ne le savons pas. Toujours est-il que l'ouvrage, complètement achevé, ne devait être représenté que dix ans après sa mort. La première représentation d'Amadis eut lieu, à Monte-Carlo, le 1er avril 1922, et, en France, le 19 décembre 1922, au Grand-Théâtre de Bordeaux.
Deux princes jumeaux, Amadis et Galaor, placés sous la protection des fées, ont grandi sans connaître leur commune origine. Les voici rivaux, puisqu'ils vont combattre l'un contre l'autre dans un tournoi dont le prix sera Floriane, la fille du roi Rambert. Galaor est vainqueur. Amadis, désespéré, se retire dans la lande où il vit, en ermite. Là, le souvenir de Floriane le poursuit et l'obsède. Il décide de retourner au palais du vieux roi ; il y arrive le jour où va être célébré le mariage de Floriane et de Galaor. Amadis demande à nouveau le combat ; mais, à ce moment, il s'aperçoit que son épée est brisée. Les fées viennent alors à son secours, transformant en glaive la branche de lys qu'il tient à la main. Le combat a lieu ; cette fois Galaor est mortellement blessé. Grâce à la pierre magique qu'ils portent tous deux, Galaor et Amadis se reconnaissent. Amadis déplore la mort de son frère ; celui-ci pardonne et lui cède généreusement Floriane : Amadis épousera celle qu'il aime et dont il est aimé. Sa mission s'accomplira : il chassera les pirates qui désolent l'Armorique.
Poème d'amitié et d'amour, de vaillance et de noblesse, où le réel et l'irréel sont étroitement unis pour conférer un tour légendaire à la vie, il y avait là matière à une musique épique, tendre et colorée.
Massenet n'eut qu'à se laisser aller à l'intérêt que suscitait en lui la nature des personnages de son poème pour écrire une partition remplie de charme, d'émotion et de bravoure.
Composé alors que Massenet avait atteint les quarante-septième et quarante-huitième années de son âge, Amadis est l'œuvre d'un maître parvenu à sa pleine maturité : tout y est parfait. La musique jaillit des divers sentiments de chaque personnage avec le mode d'expression qui lui convient précisément le mieux, et cela sans jamais aller au delà ni rester en deçà des limites du goût le plus sûr. Et que dire de cet orchestre souple, vibrant, coloré, original, qui, tour à tour, sert de fond ou occupe le premier plan ; être vivant, animé, palpitant, qui s'incorpore à la vie des êtres agissant sur le théâtre, souligne leurs pensées, marque les pulsations de leurs cœurs, et intervient d'une manière ample, somptueuse, lorsqu'il s'agit de dépeindre un cortège, un tournoi, une fête quelconque, ou bien encore quand il convient d'exprimer les mouvements tumultueux d'une foule grouillante. Et sur tout cela, Massenet a répandu un charme spécial : celui du moyen âge.
En illustrant Amadis de Gaule, Massenet a fait œuvre d'enlumineur ; mais ici l'art exquis de nos anciens artisans a pris un aspect nouveau. Filtré au travers de la Renaissance, il s'est pour ainsi dire stylisé ; une fleur nouvelle, toute moderne et rare, a poussé sur la souche originelle.
Si l'on montait Amadis avec de bons chanteurs, comprenant leur rôle d'interprète, vêtus des pittoresques costumes de l'époque, il est certain que ce spectacle, placé dans les magnifiques décors qu'appelle le moyen âge, obtiendrait le succès que mérite un ouvrage de cette haute valeur.
Bien que Cléopâtre eût été représentée avant Amadis, nous avons cru devoir nous occuper de cet ouvrage en fin d'étude parce qu'il est, pour Massenet, son chant du cygne. Effectivement, si la partition manuscrite de la Bibliothèque de l'Opéra ne porte pas les dates précises auxquelles cette œuvre fut commencée et terminée, nous savons du moins que Massenet en entreprit la composition vers le printemps de 1910, et que l'ouvrage était achevé au début de juin 1912, c'est-à-dire deux mois et demi à peine avant la mort de l'auteur.
Cléopâtre procède d'une esthétique analogue à celle de Roma ; on pourrait même dire qu'il existe des liens évidents de parenté entre Ariane, Roma, et Cléopâtre.
Les dramaturges ont toujours pris de grandes libertés à l'égard de l'histoire ; le librettiste de Cléopâtre n'a pas échappé à cette loi, il ne s'est pas fait faute de modifier certains détails historiques, notamment en ce qui concerne la mort de Cléopâtre et le voyage de la fille d'Auguste, qui ne vint pas jusqu'en Égypte : son voyage s'arrêta à Athènes, nous dit-on. De plus, le livret comporte un personnage de pure invention, l'esclave affranchi Spakos, auquel est réservé un rôle assez méprisable. Toutes les actions de cet individu sont révoltantes, aussi bien la nature de ses relations avec la reine que son mensonge relatif à la mort de Cléopâtre, lequel mensonge amène le suicide du triumvir Marc-Antoine. Ces entorses données à la précision des faits ne pouvaient avoir que peu d'influence sur les destinées de l'ouvrage, la musique sauvant tout. L'insuccès, ou plutôt le demi-succès de cet opéra tient à des causes diverses et infiniment plus profondes. D'abord, un procès retentissant qui amena le directeur du Théâtre de Monte-Carlo, où Cléopâtre fut représentée pour la première fois, le 23 février 1914, à donner le rôle de Cléopâtre à un soprano alors que Massenet l'avait écrit pour un contralto, d'où déséquilibre total dans l'architecture vocale et harmonique des scènes ; ensuite, d'indignes coupures pratiquées avec une sauvagerie et une maladresse insignes. Il semblait que plus tard on dut rendre à Cléopâtre sa vraie physionomie, il n'en fut rien. Lorsqu'en 1919 l'ouvrage reparut au Théâtre-Lyrique du Vaudeville, il fut victime des mêmes errements. A ces déplorables conditions de représentation, il faut encore ajouter le parti-pris évident d'une critique acharnée à détruire Cléopâtre, sorte de testament artistique du maître disparu. Ainsi honnie et défigurée, Cléopâtre ne pouvait rencontrer auprès du public l'accueil que méritait cette grande œuvre de laquelle un de ses rares défenseurs osa loyalement dire : « Il y a une jurisprudence massénétique et elle sera appliquée, impitoyablement, jusqu'à la fin des temps. C'est donc en vain que nous adjurerons les professionnels de regarder d'un peu plus près cette œuvre singulière ; c'est en vain que nous leur ferons remarquer qu'à l'étranger, en Amérique et en Russie, par exemple, où l'ingénuité critique est plus grande, Cléopâtre a pris immédiatement, dans l'œuvre de Massenet, une place considérable : nous n'arriverons pas à faire réviser une sentence aussi solennellement promulguée... » (C. Vuillermoz. — le Théâtre, novembre 1919.)
Pauvre Massenet, lui dont les opéras bénéficièrent, de son vivant, d'une excellente interprétation, il fallut que pour sa dernière œuvre, exécutée après sa mort, il en fût tout autrement.
Quels que soient les outrages qu'ait eu à subir Cléopâtre, cet ouvrage n'en est pas moins le digne couronnement de l'œuvre d'un artiste dont le nom restera gravé sur le fronton du Temple de la Musique.
CONCLUSION
Qu'on ne s'y trompe pas, l'importance de Massenet dans l'histoire de la musique contemporaine est considérable. A une époque où, seule, la personnalité de Verdi se détachait sur le crépuscule de la musique italienne, et où la musique allemande, dominée par Wagner, menaçait de tout envahir, il s'est créé en France une véritable École dont les principaux représentants furent Berlioz, Bizet, Gounod, Saint-Saëns, Lalo et Delibes. Le mérite de cette École est d'avoir construit un édifice autochtone, absolument français par la forme et par le fond. Dans cette école, Massenet, prit une place des plus importantes.
La sensibilité de Massenet n'a rien de commun avec le gemüthlich allemand ; ni, non plus, avec la préciosité italienne; préciosité d'ailleurs à ce point épuisée que la plupart des compositeurs italiens de la fin du XIXe siècle absorbèrent complètement le style du maître français qui nous occupe : Massenet.
Ce n'est pas seulement à l'étranger qu'on a imité Massenet ; en France, ceux mêmes qui le dénigraient ont subi l'influence de ce grand artiste. Ils se sont inspirés de sa manière, de sa technique, de son esthétique : ils ont fait du Massenet. Quand à lui, il n'a copié personne.
On a dit et répété que Massenet était le musicien des femmes, qualification qui pourrait être prise dans un sens péjoratif ; il conviendrait de s'entendre sur cette qualification. Si, en s'exprimant de cette manière, on a voulu dire que sa musique était uniquement appréciée des femmes, on aurait commis une grosse erreur : l'action de l'art de Massenet s'exerce aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Non, la vérité est que Massenet a fait surgir une foule d'héroïnes : Manon, Thaïs, Charlotte, Esclarmonde, Thérèse, Sapho, etc., mais que toutes ces héroïnes, diverses en apparence, ne forment qu'une seule et même femme, la femme du rêve qu'il a poursuivi, en un mot : la femme. C'est ainsi qu'il mérite l'épithète dont on l'a qualifié. Mais, à côté de la femme engendrée par sa fantaisie, par sa pensée profonde, n'a-t-il pas aussi créé des types d'hommes ? En nous montrant Des Grieux, Werther, le Jongleur, Gaussin, Thorel, avec toute la force de leurs sentiments, de leurs passions, ne leur a-t-il pas donné une vie intense, un relief saisissant ? — Massenet a été et restera un grand dramaturge.
A ceux qui, méconnaissant le génie de Massenet, dénigrent sa musique, on peut répondre, comme le fit Puvis de Chavannes au petit jeune homme qui déclarait ne point aimer Ingres : « Ça ne fait rien. »
Saint-Saëns l'a bien dit : « Massenet est un des joyaux les plus étincelants de notre écrin musical. »
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
BELLAIGUE (Camille). L'année musicale (1838-1889). Paris, 1890 (1890-1891). Paris, 1892. — L'année musicale et dramatique (1893). Paris, 1894.
BRANCOUR (René). Massenet. Paris, 1922.
BRUNEAU (Alfred). Musique d'hier et de demain. Paris, 1900. — La musique française, Paris, 1901. — Musiques de Russie et Musiciens de France, Paris, 1903.
CURZON (H. de). L'Evolution lyrique au théâtre dans les différents pays. Paris, 1908.
FINCK. Massenet et ses opéras. Londres, 1911.
FOURNIER (Dr C.). Etude sur le style de Massenet. Amiens, 1905.
IMBERT (Hugues). Profils d'artistes contemporains. Paris, 1897.
JULIEN (Adolphe). Musiciens d'aujourd'hui, 1resérie, 1892 ; 2e série, 1894. — Musiciens d'hier et d'aujourd'hui. Paris, 1910.
LENA (Maurice). Conférence sur Massenet. Paris, 1921.
MALHERBE (Charles). Notice sur Esclarmonde. Paris, 1890.
MASSENET (Jules). Mes souvenirs. Paris, 1912.
MAUCLAIR (Camille). Histoire de la musique européenne (1854-1914). Paris, 1914.
MENDES (Catulle). L'Art au théâtre, t. III. Paris, 1900.
POUGIN (Arthur). Massenet. Paris, 1914.
RIGNE (R. de). Le Disciple de Massenet. Paris, 1921-1923.
SAINT-SAËNS (Camille). L'École buissonnière. Paris, 1913.
SCHNEIDER (Louis). Massenet. Paris, 1926.
SOLENIÈRE (E. de). Massenet. Etude critique et documentaire. Paris, 1897.
SOLVAY (Lucien). L'Évolution théâtrale, t. II. — La Musique. Bruxelles-Paris, 1922.
SOUBIES (Albert). Massenet historien. Paris, 1913.
UDINE (J. d'). Paraphrases musicales sur les grands concerts du dimanche (1900-1903). Paris, 1904.
WEBER (J.). Les illusions musicales et la vérité sur l'expression. Paris, 1900.