
René DUMESNIL
(Rouen, 19 juin 1879 - Paris, 25 décembre 1967)
HISTOIRE ILLUSTRÉE DU THÉÂTRE LYRIQUE
Editions d’Histoire et d’Art (Collection « Ars et Historia »)
Librairie Plon, 8 rue Garancière, Paris
1953

dessin de Jean Carzou pour les Indes galantes (Opéra, 1952)
TABLE DES MATIÈRES
LES ORIGINES
Le Moyen Age. Les Tropes. – Le Drame liturgique ; le Quem quæritis. – L'introduction de la langue vulgaire dans le drame. – Le Drame semi-liturgique. – Le théâtre profane. – Les Miracles. – Adam de la Halle. – Les « jeux ». – Survivances médiévales dans l'art classique naissant.
CHAPITRE II
LE BALLET DE COUR. L'ART LYRIQUE DE LA RENAISSANCE
L'art lyrique s'éloigne des formes populaires. – Le goût de la danse et le goût des spectacles. – Le Ballet de cour en France et en Italie ; « entremets » et intermezzi. – Les Masks anglais. – Beaujoyeux et Lambert de Beaulieu : le Ballet de la Reine. – Guédron. – Évolution du ballet. Vers la Tragédie lyrique.
CHAPITRE III
L'HUMANISME FLORENTIN. LA NAISSANCE DE L'OPÉRA ET DE L'ORATORIO
La camerata de Giovanni Bardi. – Buts et théories. – Le stilo rappresentativo. – Rinuccini et Peri : Dafne. – Euridice. – Caccini. – Emilio de' Cavalieri et l'Oratorio. – Le dramma in musica. – Claudio Monteverdi. – Le stilo concitato. – L'Opéra à Venise. – Cavalli. – L'Opéra à Rome ; les théâtres des Borghèse et des Barberini. – Progrès de l'opéra et de l'oratorio : Rossi. Cesti. – Rayonnement de l'opéra en Italie. – L'Opéra à Florence ; l'aria da capo.
CHAPITRE IV
L'OPÉRA FRANÇAIS AU XVIIe SIÈCLE. LULLY ET SES CONTEMPORAINS
Le rôle de Mazarin. – Les précurseurs français : Guesdron, Boësset, Michel de La Guerre. – Perrin et Cambert. – Création de l'Académie royale de musique. – Sourdéac et Champeron. – Embarras financiers. – Lully. – Son caractère. – Son style. – Colasse et Desmarest. – Marc-Anthoine Charpentier. – La Couronne de fleurs. – Ses tragédies musicales. – Son style.
LE RAYONNEMENT DE L'OPÉRA EN EUROPE AUX XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES. L'ÉCOLE ITALIENNE. - L'ÉCOLE ANGLAISE
L'ÉCOLE ITALIENNE : Provenzale. – Influence romaine : Carissimi. – Influence napolitaine : Alessandro Scarlatti. – G.-B. Pergolesi et l'opera buffa. – Jommelli ; Galuppi ; Piccini. – Paesiello ; Cimarosa. - Rayonnement de l'école italienne au XVIIIe siècle. – Castrats et Bel canto.
L'ÉCOLE ANGLAISE : Lanyer, Davenant, Lowes, Locke. – Henry Purcell. – Händel à Londres. – Les deux Arne. – Le destin du théâtre lyrique en Angleterre.
LE THÉATRE LYRIQUE EN FRANCE SOUS LOUIS XV. - LA FOIRE. - LA GUERRE DES BOUFFONS ET LA NAISSANCE DE L'OPÉRA-COMIQUE
Campra. – Destouches. – La Lande. – L'Opéra et les Nuits de Sceaux. – Mouret. – La guerre des Bouffons. Rameau. – Lullistes et « ramoneurs ». – Le style de Rameau.
Les théâtres de la Foire. – Saint-Edme, la dame de Beaune, Dominique. – Saynettes, vaudevilles et opéras comiques. – Vadé, Dauvergne, Monnet, Pergolèse. – Jean-Jacques Rousseau et le Devin du Village. – La « Guerre des Coins ».
CHAPITRE VII
LE THÉATRE LYRIQUE ALLEMAND AUX XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES
Heinrich Schütz, Heinrich Albert. – L'école de Hambourg. – Erlebach, Mattheson, Telemann. – J.-S. Bach. – J.-C. Bach. – Händel.
LE RAYONNEMENT DE L'ART LYRIQUE ALLEMAND AU XVIIIe SIÈCLE : GLUCK, HAYDN, MOZART ET L'OPÉRA VIENNOIS
Gluck. – Ses débuts. – Sa venue à Paris. – Gluckistes et Piccinistes. – La « réforme » de Gluck. – Joseph Haydn. – Mozart : les débuts. – L'influence française ; Idemeneo. – L'Enlèvement au sérail. – Le Nozze. – Don Juan. – Cosi fan tutte. – La Flûte enchantée. – L'art de Mozart. – L'Opéra viennois : Salieri. – Sarti, Martin y Soler.
CHAPITRE IX
L'ART LYRIQUE PENDANT LA RÉVOLUTION ET L'EMPIRE. - L'AUBE DU ROMANTISME
L'Opéra-Comique à la fin du XVIIIe siècle. – Duni, Philidor Danican, Monsigny. – Dalayrac, Martini (Schwarzendorf), Grétry. – Nicolo Isouard. – Paer, Gossec, Le Sueur. – Cherubini, Boieldieu. – Spontini. Carafa.
CHAPITRE X
LE ROMANTISME. L'OPÉRA INTERNATIONAL
Le courant romantique à la fin du XVIIIe siècle. – Caractères généraux de l'art lyrique romantique. – Beethoven et Fidelio. – Weber : Undine ; le Freischütz. – Euryanthe. – Obéron. – Spohr. – Marschner, Kreutzer, Flotow, Nicolai, Schubert. – Schumann. – Mendelssohn. – Meyerbeer.
Rossini. – Le style de Rossini. – Donizetti. – Bellini. – Le Barbier de Séville ; Guillaume Tell.
Auber. – Halévy. – Hérold. – Adam. – Ambroise Thomas. – Hector Berlioz. – Benvenuto Cellini. – Les Troyens. – Béatrice et Bénédict. – Félicien David. – Niedermeyer, Maillart, Bazin.
CHAPITRE XI
RICHARD WAGNER
L'homme. Les débuts. – Rienzi. – Le Vaisseau fantôme. – Tannhäuser : le système wagnérien : mélodie continue et thèmes conducteurs. – Lohengrin. – L'Anneau du Nibelung. – Tristan et Isolde. – Les Maîtres chanteurs. – Parsifal.
CHAPITRE XII
LES ÉCOLES NATIONALES AU XIXe SIÈCLE ET AU DÉBUT DU XXe
L'art lyrique et la renaissance de la Musique pure.
L'ÉCOLE FRANÇAISE : Victor Massé. – Charles Gounod ; les premières œuvres. – Le Médecin malgré lui. – Faust. – Mireille. – Roméo et Juliette. – Les dernières œuvres. – Le style de Gounod. – Georges Bizet. – Les premières œuvres. – L'Arlésienne, Carmen. – Ernest Reyer. – Saint-Saëns ; Samson et Dalila. – Étienne Marcel, Henry VIII. – Les dernières œuvres. – Édouard Lalo. – Namouna, le Roi d'Ys. – Emmanuel Chabrier : l'Étoile. – Une éducation manquée, le Roi malgré lui. – Delibes. – Guiraud, Paladilhe. – J. Massenet, ses débuts. – Hérodiade, Manon. – Werther, Thaïs. – Les derniers ouvrages. – Benjamin Godard.
L'ÉCOLE ITALIENNE : Giuseppe Verdi. – Les débuts. – Les « trois manières » de Verdi. – La Forza del Destino, Don Carlos. – Les idées de Verdi sur l'art. – Aïda, Otello, Falstaff. – L'unité de sa vie et l'unité de son style. – Mercadante. – Luigi et Frederico Ricci. – Ponchielli. – Arrigo Boito. – Le Vérisme : Mascagni : Cavalleria rusticana. – Leoncavallo : I Pagliacci. – Giacomo Puccini : la Vie de Bohème, la Tosca, Madame Butterfly. – Alfano. – Zandonai. – Respighi. – Les indépendants : Pizetti. – Malipiero. – Casella, Rieti, Dallapiccola.
L'ÉCOLE ALLEMANDE, APRÈS WAGNER : Hugo Wolf, Mahler, Reger. – Humperdinck. – Siegfried Wagner. – Max von Schillings. – Weingartner. – Richard Strauss : Feuersnot. – Salomé, Elektra, le Chevalier à la rose. – Ariadne auf Naxos, la Femme sans ombre, Hélène d'Égypte, Arabella. – Les dernières œuvres : Jour de Paix, Danaé. – Le style et l'art de Richard Strauss. – Paul Hindemith.
L'ÉCOLE RUSSE : Glinka. – Dargomijski. – Le « groupe des Cinq » : Balakirev. – César Cui. – Alexandre Borodine. – Le Prince Igor. – Moussorgski : Boris Godounov. – Les autres œuvres. – Rimski-Korsakov : la Pskovitaine, Snegourotchka. – Sadko. – Mozart et Salieri, le Tsar Saltan, Katcheï ; le Coq d'Or. – Tchaïkovski. – Eugène Onéguine, la Dame de Pique. – Rachmaninov.
L'ÉCOLE TCHÈQUE : Smetana, Dvorak, Janacek, Novak. – L'ÉCOLE POLONAISE : Szymanovski, Paderevski, Tansman, Opienski.
L'ÉCOLE SCANDINAVE : Edvard Grieg.
LA MUSIQUE BELGE : Jean Blockx. – Joseph et Leon Jongen ; Victor Vreuls, Albert Dupuis, Louis Delune.
LA SUISSE : Jaques-Dalcroze ; Gustave Doret ; Ernest Bloch ; Jean Dupérier.
L'ÉCOLE ESPAGNOLE : Felipe Pedrell, Albeniz, Granados. – Manuel de Falla. La Vie brève. – Le Tricorne, l'Amour sorcier. – Le Retable de maître Pierre.
L'OPÉRETTE : Hervé et Offenbach. – Lecocq. – Audran, Planquette, Varney. – André Messager. – Reynaldo Hahn. – Claude Terrasse. – Maurice Yvain. – Louis Beydts. – L'Opérette viennoise : les Strauss. – Franz Lehar. – L'opérette américaine.
CHAPITRE XIII
FRANCKISME, RÉALISME, NÉO-CLASSICISME ET IMPRESSIONNISME
César Franck. – Vincent d'Indy : le Chant de la Cloche. – Fervaal. – L'Étranger, la Légende de saint Christophe. – Le style de Vincent d'Indy. – Guy Ropartz : le Pays. – Albéric Magnard : Bérénice, Guercœur. – Witkowski, P. de Bréville. – Chausson, Déodat de Séverac. – Joseph Canteloube. – Paul Le Flem, Antoine Mariotte, Albert Roussel, Marcel Labey, Arthur Coquart. – Sylvio Lazzari : la Lépreuse, le Sauteriot. – Gabriel Pierné : Sophie Arnould, Fragonard. – Georges Hüe. – Les frères Hillemacher, Ch.-M. Widor, Camille Erlanger. – Alfred Bachelet. Scemo, Quand la Cloche sonnera, Un Jardin sur l'Oronte. – Henri Rabaud : Mârouf, l'Appel de la Mer, Rolande et le mauvais garçon. – Max d'Ollone : l'Arlequin, la Samaritaine. – Henri Février : Monna Vanna, la Femme nue. – Henri Büsser : Colomba, les Noces corinthiennes, le Carrosse du Saint-Sacrement. – Raoul Laparra : la Habanera. – Gabriel Dupont : Antar. – Charles Levadé, Gabriel Grovlez, Omer Letorey, Philippe Gaubert, Paul Ladmirault. – Marcel Samuel-Rousseau. – Mazellier, Michel-Maurice Lévy.
Alfred Bruneau et le réalisme. Collaboration avec Émile Zola, du Rêve à la Faute de l'abbé Mouret. – Gustave Charpentier : Louise ; Julien. – Francis Casadesus ; Francis Bousquet.
Gabriel Fauré : Prométhée. Pénélope. – Debussy ; ses idées sur l'art lyrique. – Pelléas et Mélisande. – Le Martyre de saint Sébastien. – Les ballets. – Paul Dukas : Ariane et Barbe-bleue. – La Péri. – Maurice Emmanuel : Salamine – Maurice Ravel : l'Heure espagnole. – Daphnis et Chloé, l'Enfant et les Sortilèges. – Louis Aubert : la Forêt bleue. – Roger Ducasse : Orphée ; Cantegril. – Georges Enesco : Œdipe. – Albert Roussel : le Festin de l'Araignée ; Padmâvatî, les Ballets : 211.
CHAPITRE XIV
ÉTAT PRÉSENT ET PERSPECTIVES D'AVENIR DU THÉATRE LYRIQUE
Les courants et les idées : la mode du « dépouillement ». – Le vieillissement du répertoire lyrique et la mode des ballets. – Vers un rajeunissement des formes : l'opéra-ballet ; le « mélodrame » ; le mystère et le mimodrame. – L'opera buffa moderne. – Influence de l'Europe centrale. – Renaissance de l'école anglaise.
Conclusion : avenir de l'art lyrique.
LES ORIGINES
C’est une erreur assez commune que de vouloir faire remonter à l'antiquité gréco-romaine l'origine de notre art lyrique : le théâtre latin, imité du théâtre grec, est mort sans descendance avec la propagation du christianisme. Mais comme le polythéisme avait donné naissance à des formes dramatiques qui entraient dans les manifestations rituelles — les dionysies, par exemple — de même c'est de la liturgie chrétienne qu'est né, dans l'ignorance à peu près totale de ses prédécesseurs gréco-latins, le théâtre moderne, qui eut d'abord, lui aussi, la forme d'un drame liturgique chanté.
Par la publication en 599 du Sacramentaire, saint Grégoire le Grand avait réformé la liturgie. Quelques années plus tôt, il avait fondé à Rome, une école de chantres dont les élèves envoyés dans toute la chrétienté unifièrent les chants de l'Église en imposant en tous lieux le « grégorien » désormais fixé ne varietur. Cependant il n'est pas de contrainte spirituelle qui puisse s'opposer à l'évolution d'un art. A côté d'une tradition immuable, au moins en apparence, des tendances propres à chaque groupe ethnique, reflétant ses usages ancestraux et ses aspirations, se révélèrent plus vigoureuses sans doute d'avoir été longtemps comprimées. C'est au IXe siècle que naissent les tropes d'où vont sortir à la fois la rénovation de la musique et les premiers balbutiements du théâtre chrétien.
Les tropes ne furent primitivement qu'un moyen mnémonique inventé par un moine de Jumièges, près de Rouen. Pour retenir plus aisément les longues vocalises placées sous les alleluia, il imagina de mettre des paroles sous les notes chantées. Un prêtre de l'abbaye, fuyant les Normands qui dévastaient la Neustrie, parvint jusqu'à Saint-Gall. Il était porteur d'un antiphonaire ainsi noté. Un bénédictin de Saint-Gall, nommé Nokter, qui cherchait lui aussi un moyen de soulager sa mémoire, s'enthousiasma pour ce procédé et composa de nombreux tropes en perfectionnant l'invention des moines neustriens. Petit à petit les tropes se détachèrent de la mélodie dont ils n'étaient qu'une dépendance. La barrière opposée par saint Grégoire à la diversité des chants liturgiques n'était point rompue : elle était tournée.
L'abbaye de Saint-Gall, près du lac de Constance, rayonnait sur toute l'Europe bénédictine ; Jacques Chailley montre les conséquences immédiates de la mode introduite par Nokter le Bègue : un style nouveau, syllabique, symétrique, grâce auquel la versification rythmique et rimée du latin d'Église se généralise, se répand aussitôt et jusqu'en dehors même de l'Église ; il est à l'origine de la chanson populaire, de la poésie lyrique française et du théâtre chrétien (*).
(*) Jacques CHAILLEY, Histoire musicale du Moyen Age (Paris, Presses universitaires de France, 1950, pp. 65 et sq.).
C'est à la fin du Xe siècle qu'on trouve la première mention d'un drame liturgique chanté, dans la Regularis concordia — la règle unifiée — que saint Ethelwold rédige pour ses moines d'Angleterre : il leur propose en exemple ce que font les moines de Saint-Bavon et de l'abbaye de Fleury (Saint-Benoît-sur-Loire) : « Pour célébrer en cette fête la mise au tombeau de notre Sauveur et fortifier la foi du vulgaire ignorant et des néophytes, en imitant le louable usage de certains religieux, nous avons décidé de le suivre. Dans une partie de l'autel où il y aura un creux, que soit disposée une imitation du Sépulcre et qu'un voile soit tendu tout autour. Que s'avancent deux diacres portant la Croix, qu'ils l'enveloppent dans un linceul, puis l'emportent en chantant des antiennes, jusqu'à ce qu'ils parviennent au lieu du Sépulcre et y déposent la Croix, comme si c'était le corps de Notre-Seigneur qu'ils ensevelissaient. Que dans ce même endroit, soit gardée la Sainte Croix jusqu'à la nuit de la Résurrection.
Au jour saint de Pâques avant Matines, les sacristains enlèveront la Croix pour la placer dans un lieu approprié. Tandis que se récite la troisième leçon, quatre moines s'habillent, dont l'un, revêtu d'une aube, entre, comme occupé d'autre chose, et gagne secrètement le Sépulcre, où, tenant en main une palme, il s'assied silencieux. Au troisième répons, surviennent les trois autres, enveloppés de dalmatiques, portant l'encensoir, s'approchant pas à pas du Sépulcre, à la façon de ceux-là cherchant quelque chose, car tout ceci se fait pour représenter l'Ange assis au tombeau et les Femmes venant oindre le corps de Jésus. Lorsque donc celui qui est assis aura vu approcher ceux qui semblent perdus et cherchent, qu'il entonne à voix sourde et douce le Quem quœritis (Qui cherchez-vous ?) ; celui-ci chanté jusqu'à la fin, les trois répons à l'unisson : Jesum Nazareum, et il leur réplique : « Il n'est pas ici, il est ressuscité d'entre les morts. Allez et annoncez qu'il est ressuscité. » Obéissant alors à cet ordre, que les trois moines se retournent alors vers le chœur et disent : « Alleluia, le Seigneur est ressuscité. »
Ceci dit, celui qui est assis leur récite cette fois comme pour les rappeler l'antienne : « Venez et voyez le lieu » et, ce disant, il se dresse, lève le voile, leur montre le lieu, privé de la Croix et où ne restent que les linges dans lesquels celle-ci avait été enveloppée. Ayant vu cela, ils déposent dans le même Sépulcre les encensoirs qu'ils ont apportés, prennent le linceul, l'étendent vers le clergé comme pour montrer que le Seigneur est ressuscité puisqu'il n'y est pas enveloppé et ils chantent l'antienne : « Le Seigneur est ressuscité du Sépulcre », plaçant ensuite le linceul sur l'autel. L'antienne terminée, l'abbé se réjouissant du triomphe de Notre Roi qui, ayant vaincu la mort, ressuscite, entonne l'hymne Te Deum laudamus et dès qu'il a commencé, toutes les cloches sonnent à la fois (*). »
(*) Le texte original a été publié dans E. K. CHAMBERS, The mediœval Stage, Oxford, Clarendon Press, 1903, t. II, pp. 308-309. La citation reproduite ici est prise dans Gustave COHEN, la Vie littéraire en France au Moyen Age, Paris, Tallandier, 1949, pp. 20-22. (Cf. aussi : G. COHEN, le Théâtre en France au Moyen Age, Paris, Rieder, 1928, t. I, p. 10.)
Gustave Cohen qui traduit ce texte et le cite ajoute que rien ne manque ici des conditions qui font le théâtre ; une salle : la nef ou le chœur ; des acteurs : les moines ; le costume : vêtements ou ornements sacrés qui masquent les hommes en femmes ; la mimique qui souligne et traduit les paroles encore latines ; la musique des tropes ou proses ou additions à la liturgie du temps pascal ; le décor : installation du Sépulcre auprès de l'autel ; symbolisme de la croix nue sans qu'encore un Dieu crucifié y saigne. « Alors, ajoute Gustave Cohen, comment ne pas appeler spectateurs ceux qui, passionnés en cette fin de Passion, suivent anxieux la marche processionnelle des trois Maries allant au Sépulcre ? Le voilà le public de ce premier drame qu'il vit et sent. »
Il le vit, il le sent si bien, que les imagiers en reproduisent naïvement les épisodes avec un réalisme qui ne laisse point de doute sur la forte impression qu'ils en ont reçue. Sur des bas-reliefs du XIe siècle, à Beaucaire, les trois Maries qui se rendent chez le marchand d'aromates (Et quum transisset sabbatum, Maria Magdalene, et Maria Jacobi et Salome emerunt aromata, ut venientes ungerent Jesum, Marc, XVI, I, ainsi que le dit l'évangile du dimanche de Pâques), sont figurées par des moines barbus. C'est la reproduction fidèle de la scène que le bénédictin anglais Ethelwold avait vue à l'abbaye romane de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire (*).
(*) Le théâtre devait renaître nécessairement sous des formes diverses : à Byzance, on centonise les tragiques grecs, c'est-à-dire qu'on leur emprunte des vers pour composer le drame du Christos paschon (Cf. Venezia COTTAS, le Théâtre à Byzance, Paris, Geuthner, 1931). Mais c'est en France que naît le drame musical.
Parallèlement va s'accomplir une évolution de la musique. Le trope est bien vite devenu aussi traditionnel que la plus officielle des antiennes grégoriennes. Ce que l'on fait à l'occasion de la fête de la Résurrection, on imagine bien vite de le faire pour la Nativité ; le Quem quœritis in sepulchro ? va devenir par un simple changement de deux mots : Quem quœritis in prœsepe ? Au tombeau se substitue la crèche ; la question ne s'adresse plus aux trois Maries, mais aux bergers, mais aux Rois Mages. Les deux anges qui gardaient le Sépulcre sont remplacés par Joseph et Marie qui gardent Jésus. Les rôles ont changé ; le décor funèbre a fait place à un décor joyeux. La mise en scène se complique : l'âne et le bœuf apparaissent, et, naturellement, les Rois sont escortés de serviteurs qui portent les présents symboliques : l'or, la myrrhe, l'encens. Les bergers amènent qui une brebis, qui une chèvre ; et c'est tout un peuple d'artisans qui se joint à eux, le peuple de petites gens que sculptent encore aujourd'hui les santonniers d'Aubagne — car nos santons, nos « petits saints » de Provence sont les images fidèles des acteurs et des spectateurs du drame de la Nativité tel qu'on le jouait, tel qu'on le chantait au XIIe siècle, tel qu'on le chante et qu'on le joue encore près d'Arles, aux Baux, où la coutume s'est conservée depuis plus de huit siècles. Puer natus est nobis hodie... Un enfant nous est né aujourd'hui, et cet Enfant sera notre Sauveur. Le Fils de Dieu s'est fait pareil à nos propres enfants pour se rapprocher de nous, et nous nous approchons de Lui en ce jour de Noël. Nos chants joyeux célèbrent sa venue sur la terre. A l'Alleluia et au Gloria se joignent d'autres chants ; le drame se développe ; les textes saints en fournissent la trame. On montre Hérode et sa fureur à l'annonce de la venue du Roi des Rois ; on montre les anges descendus du ciel pour veiller sur l'Enfant et le bercer tandis que Marie repose.

la fête de Noël aux Baux [photo Keystone]
La coutume survit, même dans les pays où s'étend la Réforme plus tard : l'Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach en atteste la persistance dans l'Allemagne luthérienne. A Leipzig, en effet, au XVIIIe siècle encore, deux personnages costumés représentaient Joseph et Marie, et se tenaient près de la crèche tandis que le chœur des élèves de la Thomasschule figurait les anges et chantait le Gloria et des chorals. Cela s'appelait le Kindelwiegen, le « bercement de l'Enfant », et la pastorale (Sinfonia) de l'Oratorio de Noël était un prélude au choral, où, au thème des Anges, répond le thème des Bergers.
On en vient à varier les sujets : l'histoire sainte en fournit toujours l'essentiel, et l'on trouve dans le Propre du temps — commémoration de la vie de Jésus — et dans le Propre des saints, dans les divisions de l'année liturgique, prétexte à les renouveler. Ces drames latins se perpétuent jusqu'à la fin du moyen âge, et demeurent toujours une paraphrase plus ou moins habile des Écritures. Mais leur structure est comparable à celle de l'opéra telle qu'elle s'établira plus tard : des airs s'intercalent entre les récitatifs et les chœurs. Bientôt deux événements marquent une orientation nouvelle du théâtre : la langue vulgaire s'introduit timidement dans les textes ; d'autre part le « parlé » se substitue de plus en plus au chant.
C'est que, sans cesser de s'inspirer des Écritures, le drame ne s'incorpore plus strictement, comme à l'origine, aux offices religieux. Ce sera un drame semi-liturgique. Conséquemment, il cessera d'être donné dans l'église même, et sera représenté sous le porche ou devant le portail. Il nécessite d'ailleurs une mise en scène, des décors, des costumes qui vont se compliquant. Ainsi, vers 1140, à Beauvais, les écoliers jouent un Daniel dont la structure est semblable à celle de l'opéra moderne. Le prologue présente les auteurs, les jeunes clercs :
In Belvaco est inventus
Et invenit hoc juventus.
Les entrées des personnages sont annoncées, commentées par le chœur qui chante des conduits (composition libre à plusieurs voix note contre note, chantant ensemble le même texte, syllabe par syllabe) ; ces chœurs alternent avec des airs ; des figurants évoluent selon des rythmes déterminés, à la manière du ballet ; enfin la mise en scène, le décor, les lions dans la fosse, la main mystérieuse qui trace les mots fatidiques Mane, Thecel, Phares, tout préfigure l'opéra tel qu'il apparaîtra au début du XVIIe siècle.
Ailleurs, principalement dans le Nord, ce sont les Miracles. La légende de saint Nicolas sert de thème aux inventions dramatiques. On s'éloigne des Écritures, et l'imagination des auteurs se donne libre cours. Le théâtre se rapproche d'une forme plus lâchée qui rappelle l'improvisation.
Déjà la langue vulgaire s'était glissée, timidement pourrait-on dire, dans le Jeu de Daniel, où les mots « Daniel vien al Roi », revenaient sous forme de refrain. Dans le Sponsus (L'Époux, drame des Vierges sages et des Vierges folles), dont l'auteur anonyme est certainement du Haut-Angoumois — pays de langue d'oïl — la moitié des quatre-vingt-quinze vers formant le texte du manuscrit est en langue vulgaire. Rien ne permet de distinguer les raisons qui déterminent l'emploi des deux idiomes : ainsi les Vierges, sages ou folles, et le Christ font alterner le limousin et le latin, tandis que l'ange Gabriel et les marchands s'expriment uniquement en limousin. Le drame est étroitement inspiré de l'Évangile (Matthieu, XXV, 1-13), et le dialogue reproduit le texte de la parabole. Les Vierges folles, les Fatuœ qui ont laissé se répandre l'huile de leurs lampes, ne peuvent fléchir ni les marchands, ni les Sages, ni l'Époux (qui donne son titre à la pièce). Elles font entendre à chaque échec une plainte, une mélopée désespérée :
Las ! chétives, las ! malheurées, trop y avons dormi !
qui répète les mots de ceux qui les repoussent « Las ! malheurées, trop y avez dormi. » Elles sont précipitées en enfer « peut-être, déjà, comme le dit Gustave Cohen, représenté par une gueule ouverte et menaçante. L'enfer entre en scène. Le théâtre français va naître (*) ».
(*) G. COHEN, la Vie littéraire en France au Moyen Age, p. 62. — Alfred JEANROY, la Littérature de langue française des origines à Ronsard. (In : Histoire des Lettres, Société de l'Histoire nationale, Plon-Nourrit, 1921, p. 339.)
L'emploi de la langue vulgaire devient bientôt général. S'écartant de la liturgie, il fallait en effet que le drame fût compris des spectateurs. Tant que le texte chanté était demeuré liturgique, chacun était censé en connaître ou tout au moins en deviner la signification. Mais la musique ne disparaît pas du théâtre médiéval avec le latin. Même dans le Jeu d'Adam, dont on a souvent fait le premier ouvrage de notre théâtre moderne — entendant par là le théâtre uniquement parlé — le texte reste « farci de musique » selon l'expression de Jacques Chailley, et si l'on a prétendu le contraire, c'est que le manuscrit ne donne des leçons et des répons que leur seul incipit. Le Jeu d'Adam, par le mélange des deux langues, se rapproche donc des épîtres farcies ; mais dans tous ces ouvrages le latin subsiste surtout dans les didascalies ou indications des jeux de scène.
Quels instruments se faisaient entendre ? A partir du XIIe siècle, la facture des orgues progresse ; l'hydraule a presque entièrement disparu ; les grandes orgues pneumatiques s'installent dans les églises. A côté des instruments fixes, les orgues portatives, « positives » comme on les nomme parce qu'il est aisé de les poser à terre ou sur une table, restent en usage. Un curieux passage du roman provençal Flamenca, du XIIIe siècle, énumère les instruments alors en usage. Il s'agit ici, il est vrai, d'une fête donnée dans un château, à Bourbon-l'Archambault, dont le seigneur vient d'épouser la fille du roi de Namur — la Flamande, la Flamanca, qui donne son titre au roman — mais peu importe, et voici les instrumentistes : « L'un joue de la viole ou de la flûte, l'autre du fifre ; l'un de la gigue (ancienne forme de la viole), l'autre de la rote (instrument à cordes pincées, voisin de la cithare)... l'un joue de la musette (cornemuse), l'autre du pipeau ; l'un de la mandore (mandoline primitive), l'autre accorde le paltérion avec le monocorde (*). » A ces instruments, il faut joindre la trompette, le cornet, la saquebute, ancêtre du trombone ; et pour la percussion, les tambours, tambourins, castagnettes.
(*) Trad. Paul Meyer. Cité par G. COHEN, loc. cit., p. 156.
Si la musique subsiste encore dans les drames semi-liturgiques, le texte parlé devient petit à petit l'essentiel, à tel point que le manuscrit n'indique même plus ce qui est chanté par les chœurs ou les solistes, joué par les instruments. On devine, au lyrisme du Miracle de Théophile de Rutebeuf, la part importante faite à la musique, et de même au XIVe siècle dans les Miracles de Notre-Dame ; mais, pour nécessaire qu'elle demeure dans le spectacle, elle n'y tient plus qu'un rôle secondaire — celui d'un décor sonore. Parfois cependant les airs, les motets sont fort beaux ; les silete, qui invitent le public à faire silence pour écouter le drame, sont écrits à deux voix, et dans la Passion de Semur, ce sont deux anges qui, fléchissant le genou, chantent :
Silete, silete, silentium habeatis
Et per Dei Filium pacem faciatis.
(Taisez-vous, taisez-vous, faites silence, et pour l'amour du Fils de Dieu, tenez-vous en paix.) D'autres fois la musique remplit les pauses, comme dans nos mélodrames modernes. Enfin dans la Passion d'Arnoul Greban, il ne semble pas douteux que certains passages tussent destinés à être chantés, et probablement même à plusieurs voix ; ainsi la fameuse Chanson des Damnés dont le texte est, au demeurant, fort explicite :
Sathan tu feras la tenure
Et j'asserrai la contre-sus.
Belzebuth dira le dessus
Avec Berich à haute-double
Et Cerberus fera un trouble (triple)
Continué Dieu sait comment (*)
(*) Jacques CHAILLEY, loc. cit., p. 297-298.
Tout y est de ce qui fait le motet : et Lucifer répartit à chacun son rôle dans la polyphonie. On voit bien là que Greban, organiste de Notre-Dame, dirigeait la maîtrise. Les chants liturgiques figurent eux aussi dans le mystère qui s'achève par le Te Deum.
Il arriva que le drame semi-liturgique devint parfois une vraie comédie lyrique : ainsi le Juif volé, dans le Miracle de saint Nicolas. Un juif confie son trésor à la garde du saint, pendant un voyage. A son retour, le trésor a disparu ; il injurie le saint, jusqu'au moment où se produit le miracle, car le saint fait rendre gorge aux larrons. Les deux monologues sont dignes de Plaute, et J. Combarieu juge la musique d'une justesse parfaite dans la notation du sentiment. Ainsi l'exclamation du juif lorsqu'il découvre le vol (Vah ! perii !) est exprimée par une longue suite de brèves descendantes qui peint à merveille l'effondrement du personnage.
Si la plupart des « jeux » et des « miracles » se donnent sur le parvis de l'église, certains usages persistent qui font se dérouler dans le sanctuaire même des scènes théâtrales : un texte découvert par Deschamps de Pas dans la Bibliothèque municipale de Lille, et publié dans les Annales archéologiques de Didron (t. XVII) nous tait connaître une singulière fondation instituée au XVIe siècle par testament d'un chanoine de Tournai et archidiacre de Bruges, Pierre Cotrel : dix jours avant Noël, dans le chœur de la cathédrale de Tournai, une colombe descendait du ciel, tandis que deux jeunes gens mimaient la scène de l'Annonciation.
J. Combarieu pense que cette fondation perpétuait une coutume beaucoup plus ancienne et qui, vraisemblablement, remonterait au XIIe siècle.
Au début du XIIIe, l'archevêque de Sens, Pierre de Corbeil, « épure » la Fête de l'Ane. Cette fête singulière qui subsista jusqu'au XVIe est attestée par deux manuscrits qui en précisent les rites. L'un, de Beauvais, est au British Museum ; l'autre, de Sens, qui compte 33 folios de vélin et qui date des premières années du XIIIe siècle, est édité. On y trouve des tropes et des morceaux extra-liturgiques, et certains d'entre eux devancent si bien leur époque qu'on pourrait les croire composés au XVIIIe siècle si l'écriture et la notation n'en certifiaient l'origine (*).
(*) Édition critique publiée par l'abbé Villetard (Paris, Alph. Picard, 1908). (Cf. COMBARIEU, Histoire de la Musique, Paris, Armand Colin, 1924, 4e édit., t. II pp. 305-306.)
Pour bien comprendre ce mélange du sacré et du profane qui nous semble aujourd'hui si étrange et même choquant, il faut se souvenir de ce qu'est l'église au moyen âge : maison de Dieu et lieu d'oraison, certes ; mais aussi la maison de tous, l'endroit où l'on s'assemble, comme jadis au théâtre et au forum ; le respect que l'on doit au temple du Seigneur s'accommode d'une familiarité très simple, et les mœurs du temps ont une liberté dont témoigne la gaillardise des chansons qui, bientôt, vont, avec le développement de la polyphonie, s'introduire jusque dans l'office divin et donner leur titre aux messes (Messe de l'Homme armé, Messe Le Bien que j’ay, etc.).
Cette tendance à traiter de façon de plus en plus familière les drames sacrés fait éclore le théâtre profane dès le XIIIe siècle. Mais seul, le choix des sujets marque cette évolution : sa charpente reste identique à celle des drames semi-liturgiques. Cependant un genre nouveau apparaît alors : la pastourelle, comédie musicale pièce à couplets où l'on insère des chansons dont le « timbre », sinon les paroles, est connu de tous. La pastourelle dont le Jeu de Robin et Marion, d'Adam de la Halle (ou de la Hale, surnommé le Bossu d'Arras) est le plus célèbre exemple, n'est en réalité qu'une chanson animée, mimée, jouée, dont les couplets sont devenus un dialogue, et dont les refrains varient. La pastourelle était en effet, à l'origine, une chanson, une sorte d'églogue narrant les amours d'un berger et d'une bergère ; parfois un chevalier remplace le berger. Certaines fois la bergère est sage, fidèle à ses amours ; d'autres fois elle est volage, et souvent son amoureux est le troubadour, le trouvère lui-même. Thème aux mille variantes, mais sujet toujours semblable.

le Jeu de Robin et Marion [manuscrit du XIIIe siècle]
Adam de la Halle, né à Arras vers 1240, mort à Naples en 1287, fut un de ces trouvères si nombreux en Artois, qu'en la fin du XIIIe siècle on en comptait 182 rien qu'à Arras. La grande vogue des « puys », des concours de poésie et de musique organisés par la confrérie de la « carité des Ardents », les y attirait (*). Adam de la Halle y débuta en 1262 par un coup de maître : le Jeu de la Feuillée, qui lui valut le succès et attira sur lui l'attention de Robert II, comte d'Artois. Il accompagna celui-ci lorsque son oncle Charles d'Anjou, roi des Deux-Siciles et frère de saint Louis, l'appela à Naples après le massacre des Vêpres siciliennes ; c'est là que le Bossu (qui d'ailleurs n'était nullement contrefait : « on m'appelle Bossu, mais je ne le suis mie », a-t-il écrit), aux fêtes de la Noël, en 1283, fit représenter une pièce bien différente du Jeu de la Feuillée, le Jeu de Robin et Marion. La Feuillée était presque uniquement littéraire ; la musique n'y trouvait place qu'aux instants où les personnages chantaient quelque refrain. Dans Robin au contraire on ne trouve pas moins de trente-deux mélodies, empruntées d'ailleurs à des chansons dont les timbres alors connus de tous, ne paraissent pas toujours en plein accord avec les situations, les sentiments exprimés par le texte. Sans doute, faire du Jeu de Robin et Marion notre premier opéra-comique, l'ancêtre d'un genre que l'Italie allait reprendre au XVIIIe siècle, est-il excessif. Mais dans l'histoire de l'art lyrique, ce jeu n'en occupe pas moins une place fort importante, puisqu'il est analogue à ce que sera, au XVIIIe siècle, « la comédie en vaudeville » dont les couplets sont chantés sur des airs populaires. En outre le Jeu de Robin atteste nettement l'évolution du théâtre vers le réalisme : ce n'est plus quelque épisode de l'histoire sainte, quelque légende greffée sur un texte religieux, que traite Adam de la Halle ; ce ne sont même pas les amours quintessenciées du seigneur et de la dame qui l'inspirent, mais il fait dans son Jeu de Robin « la satire de l'amour courtois », et fort vertement.
(*) « Cette confrérie dont l'importance sociale était considérable commémorait le souvenir du miracle de la Sainte Chandelle qui au début du XIIe siècle, avait guéri la ville du terrible « mal des Ardents » grâce à l'intervention de la Vierge apparue à deux jongleurs, Itier et Norman ». (J. CHAILLEY, loc. cit., p. 203.)
Le « mal des Ardents » qui fit de terribles ravages au moyen âge est l'ergotisme gangréneux, dû à l'absorption prolongée de farines contenant du seigle ergoté.
On peut dire, pour conclure avec Jacques Chailley, qu'il serait puéril « de se représenter le Jeu de Robin comme surgi d'une prescience de génie cinq cents ans avant la Foire Saint-Laurent, en vue de fournir un modèle à ses lointains imitateurs ». Mais Adam, en transposant en « jeu » la chanson pastourelle à laquelle il conserve ses deux éléments essentiels : le couplet (qu'il transforme en dialogue parlé), et le refrain (qui est une citation musicale) suit le plan qui sera cinq siècles plus tard celui de Jean-Jacques Rousseau dans le Devin du Village, où l'air de Colette : J'ai perdu mon serviteur, — J'ai perdu tout mon bonheur, répond exactement à la chanson de Marion : Robin m'aime, Robin m'a ; Robin m'a demandée, et il m'aura ; où le divertissement champêtre par lequel Adam termine sa pastourelle est tout semblable aux couplets de Jean-Jacques : Allons danser sous les ormeaux, — Animez-vous, jeunes fillettes.
La part faite à la musique ne va plus cesser de se restreindre dans les ouvrages dramatiques ; lorsque les situations l'exigent, ou lorsque sa fantaisie le commande, l'auteur se contente de laisser au choix des interprètes l'air qu'ils doivent exécuter, la chanson qu'ils chanteront. Le théâtre évolue vers les formes qui seront celles de la tragédie et de la comédie classiques. Beaucoup de pièces sont totalement dépourvues de musique. Cependant, au XVIe siècle encore, on trouve une survivance du théâtre médiéval dans l'Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze, tragédie en vers français, représentée à Lausanne vers 1552. La pièce est un prêche : elle exhorte les spectateurs à sacrifier tout ce qui les attache au monde, à rompre les liens avec la famille, et à se donner entièrement au vrai Dieu. Les allusions à la papauté y sont claires. Le calviniste farouche que fut Théodore de Bèze exprime ses sentiments sans détour ; il n'empêche cependant qu'il compose des chœurs de bergers et leur confie le soin de commenter l'action par leurs chants. Ceci n'est pas pour surprendre du poète qui compléta la traduction des Psaumes commencée par Clément Marot. On sait d'autre part le souci de l'Église réformée de constituer sa liturgie en faisant large place au choral. On ne possède pas la musique des chœurs d'Abraham sacrifiant. Tout porte à croire qu'elle était analogue à celle que Goudimel, Claude Le Jeune, Loys Bourgeois et Philibert Jambe de Fer composèrent pour le Psautier huguenot.
Même survivance aussi dans le théâtre catholique de Marguerite d'Angoulême, reine de Navarre, qui laissa quatre comédies pieuses, quatre pièces profanes et deux comédies mystiques. Pierre Jourda a montré ce que Marguerite emprunte aux mystères médiévaux, aux Enfances de Jésus (*) : elle leur doit de touchants épisodes (dans la Nativité, les Trois Rois, les Innocents et le Désert), et suit exactement la tradition, tout en imprimant au drame une sobriété déjà classique. En intitulant ses pièces « comédies », elle marque son dessein d'y réduire le merveilleux au strict nécessaire. Mais ces comédies sont quand même moins dramatiques que lyriques ; on y trouve des monologues, des cantiques, des hymnes, et Pierre Jourda a sans doute raison de croire que le Gloire soit au Dieu des Dieux des anges, dans la Nativité « appelle le chant et résonnerait au plus haut des nefs gothiques », de même que le finale du Désert « accompagnerait fort bien telle page de Bach ou de Händel ». Il est regrettable que rien ne subsiste de la musique sur laquelle ils durent être chantés. Nous ne savons pas non plus si les chœurs des tragédies de Jodelle furent chantés. Il faut cependant remarquer que les musiciens tiennent une place importante dans l'humanisme, et que le lyrisme des amis de Ronsard ne se conçoit pas sans liaison étroite avec la musique. Les rapports de Jodelle avec un poète et musicien allemand Paul Schede, dit Melissus, bibliothécaire savant de la Palatine d'Heidelberg, étaient amicaux, puisque ce Schede, venu deux fois à Paris, y vécut près de Ronsard et de Jodelle et traduisit les vers français de celui-ci. Lié pareillement avec Goudimel et Lassus, Jodelle n'écrivit certes point des chœurs sans songer à les mettre en musique (**).
(*) Pierre JOURDA, Une Princesse de la Renaissance : Marguerite d'Angoulême, reine de Navarre. Paris, Desclée et de Brouwer, 1932, Collection Temps et Visages, pp. 136 et sq.
(**) Cf. Pierre DE NOLHAC, Ronsard et l'Humanisme, Paris, Champion, pp. 223 et sq. (Bibliothèque de l'École des Hautes-Études).
Cette période brillante de l'histoire des arts voit néanmoins se consommer la rupture de l'union, si complète au moyen âge, de la poésie et de la musique dans le drame. Des temps nouveaux vont produire d'autres genres, mais un besoin de synthèse se manifestera bientôt encore : un demi-siècle plus tard, à Rome et à Florence vont naître l'oratorio et l'opéra.
LE BALLET DE COUR
L'ART LYRIQUE DE LA RENAISSANCE
Le drame religieux, pendant cinq siècles, avait réalisé une forme de théâtre purement lyrique (puisqu'il était entièrement chanté) ; et la mise en scène, les décors, les costumes, la part faite aux chœurs et à la musique instrumentale le rapprochaient singulièrement de notre opéra ; il disparut vers le milieu du XVIe siècle après qu'il se fut répandu à travers l'Europe, donnant lieu à des manifestations ne différant que fort peu d'un pays à l'autre, selon les coutumes locales. Mais partout aussi le caractère profane des ouvrages alla s'accentuant, et si bien que le drame finit par perdre son sens religieux, et que les licences prises par les auteurs et les interprètes amenèrent les autorités ecclésiastiques à interdire les représentations. Jusque-là, le théâtre lyrique demeurait un art essentiellement populaire : son origine l'y contraignait. Né dans l'église, il était comme une forme concrète, matérialisée, de la liturgie qui unit, dans la prière et sans distinction de castes, l'ensemble des fidèles. La communauté chrétienne y participait tout entière, comme jadis, en Grèce, la cité. Mais il n'y a déjà plus rien de religieux dans les pastourelles, et c'est l'amour, c'est un élément profane qui se substitue complètement désormais à l'inspiration des premiers drames, des miracles et des mystères. Les progrès de la polyphonie, les complications contrapuntiques du style vocal ont aussi pour effet, dans le même temps, de donner à l'art des sons des formes qui l'éloignent du peuple et en font une affaire de lettrés, de spécialistes initiés. Ce sera l'une des causes — et la principale — qui amèneront vers 1600, la « révolution » des humanistes italiens, et qui donneront naissance aux deux formes nouvelles du drame lyrique, l'oratorio et l'opéra. Mais ceci encore éloignera le drame chanté de ses sources populaires, en fera davantage un art aristocratique, tout comme le ballet de cour dont l'évolution aboutit dans le même temps en France à une nouvelle forme lyrique.
C'est un fait curieux, et fort important, que cette sorte de convergence d'éléments et de faits, d'ordres très différents, vers une forme nouvelle du théâtre. On reviendra plus loin sur les sacre rappresentazioni romaines et sur les premiers opéras florentins. Il convient cependant de noter que les représentations sacrées de l'Oratoire se rattachent étroitement au drame liturgique et au mystère en raison même de leur caractère religieux, tandis que les premiers opéras aussi bien que les ballets de cour n'ont plus rien de commun avec lui, mais se rapprochent de la pastorale.
Le goût de la danse était si répandu que l'église elle-même avait connu des danses sacrées ; elles se sont perpétuées en Espagne, avec le rite mozarabe. Au moyen âge le peuple carole sur les airs des « chansons à danser », et il y prend plaisir aussi bien que les chevaliers et les nobles dames, en toute occasion, autour des feux de la Saint-Jean comme au château. Mais s'il ne peut exister de ballet sans danse, ce n'est pourtant point la danse qui, à elle seule, fait le ballet : il y faut un ordre, une succession, il faut que le ballet soit composé comme une comédie ou comme un drame, autour d'une idée directrice. La danse populaire est faite pour le plaisir individuel des danseurs qui s'agitent ; le ballet se donne devant un public qui l'admire : il est spectacle autant que récréation pour ceux qui l'animent et pour ceux qui le contemplent. Les uns et les autres lui demandent un plaisir esthétique né des figures dessinées au cours des évolutions des danseurs, réglées elles-mêmes par le développement d'une action. Tel est du moins le ballet de cour, et si nous connaissons aujourd'hui des ballets que l'on peut dire de danse pure, et seulement faits d'une suite de pas variés, où alternent danses lentes et danses vives, ensembles et soli, le ballet de cour, au contraire, ne se conçoit point sans un sujet, sans des sujets, même, car c'est chose fort compliquée qu'un ballet à la cour de Bourgogne, à la cour de France, à la cour de Milan. L'une des plus anciennes descriptions que nous en ayons est celle qu'a laissée Olivier de La Marche qui assista aux fêtes du mariage de Charles le Téméraire et de Marguerite d'York, à Bruges, en juillet 1468. Le spectacle dura plusieurs jours, et commença par une représentation du combat d'Hercule et de Thésée, puis vinrent les douze travaux du héros. Enfin « le dernier jour, on vit entrer dans la salle une baleine de soixante pieds de long, escortée de deux grands géants. Son corps était si gros qu'un homme à cheval aurait pu y tenir caché. Elle remuait la queue et les nageoires ; ses yeux étaient deux grands miroirs ; elle ouvrit la gueule : on en vit sortir des sirènes qui chantèrent merveilleusement, et douze chevaliers marins qui dansèrent et se combattirent les uns les autres, jusqu'à ce que les géants les firent rentrer dans leur baleine (*) ». On le voit : le ballet constitue un spectacle complet, et déjà semblable à l'opéra. Les machines, les décors, les costumes, la mise en scène y sont. La mimique et la danse se joignent aux chants, à la musique. Ces longues représentations sont offertes aux convives d'un festin, comme intermèdes, d'où le nom d'entremets qu'on leur donne en France, d'intermezzi en Italie. En 1489, Jean-Galéas Sforza, duc de Milan, épouse la fille du duc de Calabre Isabelle, et c'est en Lombardie même déploiement de faste que dans les Flandres, mêmes intermezzi dans une vaste salle surmontée d'une galerie où se tiennent les musiciens, tandis qu'autour de la table, évoluent Jason et les Argonautes, portant la Toison d'or, suivis de Mercure venant offrir aux époux le veau gras dérobé au troupeau d'Apollon. Des balladins dansent, Diane paraît avec ses nymphes : elles portent un cerf, qui, ainsi que tout à l'heure le veau gras, est présenté à l'épousée. Au son des flûtes et des lyres, c'est le tour d'Orphée de venir : il pleure Eurydice, et les oiseaux accourent, attirés par ses chants. Il les vient offrir à la duchesse Isabelle. Des divinités accourent : Iris, qui apporte des paons, Hébé des fruits, des Tritons, Atalante, Thésée, les Grâces qui représentent la Foi conjugale, puis encore des Satyres formant cortège à Bacchus. Ballet monstre, fait de plus de quinze épisodes, et faisant paraître plus de cent danseurs ou chanteurs.
(*) Olivier de La Marche, édition Beaune et d'Aurbemont, t. III, p. 197. (Cité par J. COMBARIEU, Histoire de la Musique, t. I, p. 629, Paris, Armand Colin.)
Des fêtes de même importance sont données à la cour des Valois, où les « entremets » accompagnent les repas de cérémonies. Signe des temps : c'est partout la mythologie qui en fournit le sujet. La Renaissance, l'humanisme, marquent le retour à l'antiquité, et le délaissement de l'inspiration biblique. Le spectacle déborde le palais et se répand dans la rue : à Florence, Laurent de Médicis est au premier rang du cortège qui parcourt la ville et figure l'Age d'or. Des chars le suivent, où divers épisodes de l'histoire romaine sont représentés. Lui-même a composé les poèmes des chœurs chantés à quatre et huit parties, car nous sommes alors au temps où les élèves d'Okeghem, d'Obrecht, de Dufay faisant école en Italie, y portent à son apogée l'art polyphonique.
Ce goût des spectacles de plein air, des « ballets lyriques », comme les nomme J. Combarieu, se manifeste également en France : « Pour recevoir Louis XI à Paris, on avait placé à la fontaine du Ponceau trois belles filles faisant personnages de sirènes, chantant des bergerettes, de petits motets, tandis que plusieurs musiciens, jouant de bas instruments, rendaient de grandes mélodies. » C'est une ébauche de ballet, puisque « les acteurs se dépouillent du caractère qu'ils ont dans la vie réelle pour faire un personnage et suivre un thème mythologique ».
Un opuscule imprimé à Rouen contient outre le détail du spectacle offert pour leur entrée dans cette ville à Catherine de Médicis et Henri II, le morceau de musique noté pour quatre voix de femmes, et chanté par les personnages du cortège allégorique. Même chose à Lyon en 1564, à l'occasion de la visite de Charles IX. Mais en dépit de ces tentatives, le ballet ne pourra devenir un art populaire.
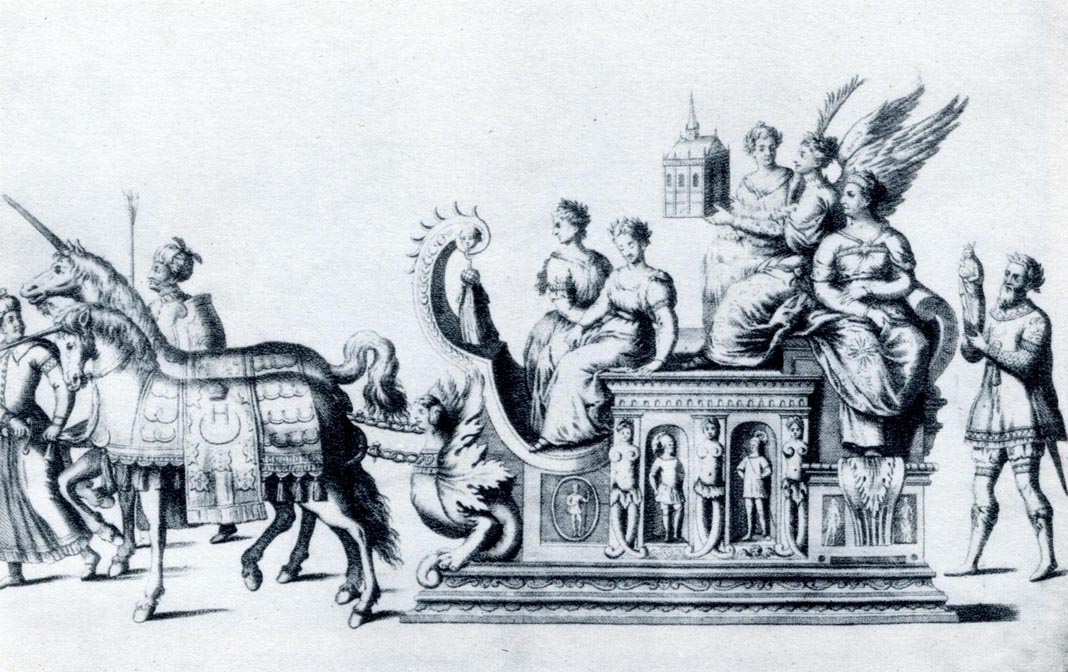
entrée de Henri II à Rouen en 1550 ; le char de la Religion [gravure du XVIe siècle]
En Angleterre, les masks ont pareil succès. Le mot désigne le ballet avec chant et grande mise en scène, et, dès 1501, au mariage du prince Arthur, fils aîné d'Henry VIII avec Catherine d'Aragon, des spectacles de danse, mêlée de scènes mimées et parlées, mais où la musique occupe la place principale, sont donnés. Les souverains sont eux-mêmes de bons musiciens, et jouent volontiers de la viole, du virginal. Les voix et les instruments accompagnent les danseurs et les mimes. Les masks resteront en vogue à la cour de Jacques Ier et de Charles Ier. Leur sujet est généralement allégorique et mythologique, et les poèmes ont pour auteurs les écrivains les plus célèbres. On y reviendra plus loin.
Il est classique — mais les exemples qu'on vient de citer montrent que ce n'est point tout à fait exact — de voir dans Circé ou le Ballet comique de la Reine, l'ancêtre de l'opéra français. Baldassarino Belgiojoso, Piémontais d'origine, dont le nom francisé est Beaujoyeux, en écrivit le libretto et en régla les danses. La musique eut pour auteurs Lambert de Beaulieu et Jacques Salmon, chantres de la Chapelle royale. L'exécution de cet énorme ouvrage dura de dix heures du soir à trois heures du matin, se déroulant dans un luxe inouï de décors, de machines représentant des monstres, au milieu de figurants portant de riches costumes. Donné en 1581 pour les noces du duc de Joyeuse, amiral de France, avec Marguerite de Lorraine, sœur de la reine, il est le premier ouvrage du genre respectant — en dépit de sa diversité — l'unité d'action. Jusque-là, les entrées se succédaient sans lien entre elles ; ici, le sujet les commande. Mais Circé présente un défaut qui va peser lourdement sur le ballet de cour : les grands personnages, les princes, la reine Louise elle-même, y tiennent les rôles essentiels. D'où la nécessité pour le librettiste de faire converger vers ces illustres acteurs et danseurs tout l'intérêt du ballet ; et pour le musicien, le souci de ne leur confier que des airs qu'ils soient capables de chanter, lorsqu'ils ont ou croient avoir un peu de voix. Il faut, de toutes manières, que ce soit eux qui brillent du plus vif éclat.


le Ballet comique de la Reine (1582) ; sirènes et tritons [gravures du livret]
Le retentissement du Ballet de la Reine fut immense : il prolongea pendant cent ans la vogue du genre. On comprend la vive impression que les assistants en gardèrent lorsqu'on lit sa description dans le livret publié par Robert Ballard en 1582. La préface nous instruit des intentions de Beaujoyeux :
Quant au Balet, encores que ce soit une invention moderne, ou pour le moins, repetée si loing de l'antiquité, que lon la puisse nommer telle, n'estant à la vérité que des meslanges geometriques de plusieurs personnes dansans ensemble dans une diverse harmonie de plusieurs instruments, je vous confesse que simplement représenté par l'impression, cela eust eu beaucoup de nouveauté et peu de beauté, de réciter une simple comédie, cela n'eust pas esté bien excellent. Sur ce je me suis advisé qu'il ne serait point indecent de mesler l'un et l'autre ensemblément, et diversifier la musique de poésie et entrelacer la poésie de musique, et le plus souvent les confondre toutes deux ensemble ainsi que l'antiquité ne récitait point ses vers sans musique et Orphée ne sonnait jamais sans vers. J'ai toutefois donné le premier titre et honneur à la danse, et le second à la substance, que j’ay inscrite Comique, plus pour la belle tranquille, et heureuse conclusion où elle se termine, que pour la qualité des personnages, qui sont presque tous dieux et déesses, ou autres personnes héroïques. Ainsi j’ay animé et fait parler le Balet, et chanter et resonner la Comédie : et y adioustant plusieurs rares et riches representations et ornements, je puis dire avoir contenté en un corps bien proportionné, l’œil, l'oreille et l'entendement (*).
(*) Bibliothèque Nationale, L n 27 10436.
On ne saurait trop insister sur l'importance de cette préface : elle définit exactement le programme que vont s'efforcer de remplir compositeurs et librettistes créateurs de l'opéra : contenter l'œil et l'oreille — l'entendement aussi, lorsqu'il se pourra, mais ce ne sera pas toujours.
Autre point remarquable : en 1581, on ignore tout en France, et pour cause, des discussions qui font l'objet ordinaire des réunions de la camerata florentine, et qui aboutiront à la création de l'opéra, avec la Dafne de Peri, en 1587. Mais le but poursuivi par les humanistes français et italiens est le même : c'est — ils le croient fermement — un retour à l'antique, et c'est ce qui fait dire à Beaujoyeux, pour s'appuyer sur un exemple célèbre, qu'Orphée ne « sonnait » jamais sans vers. Avec le Ballet de la Reine, nous rencontrons un premier essai de cette synthèse lyrique et dramatique que l'antiquité avait réalisée, que le moyen âge avait également réussie, et que l'opéra du XVIIe siècle allait de nouveau tenter.
Mais les choses se compliquaient : la musique n'était plus la monodie des premiers âges ; les langues dérivées du latin ne gardaient plus la quantité des syllabes, l'alternance de brèves et de longues réglant la métrique, et, du même coup, imposant le rythme au musicien. L'essai des vers mesurés à l'antique, de Baïf et de ses confrères de l'Académie de poésie, était voué à l'insuccès, car il allait contre le génie de notre langue. Le vers français, issu des tropes, des séquences et des proses liturgiques, est essentiellement syllabique et rimé.
Les instruments employés pour le Ballet de la Reine étaient l'orgue, le luth, le hautbois, la lyre (lira da braccio, violon à sept cordes, lira di gamba, à 12 cordes, archiviola di lira, à 24 cordes, équivalent à la contrebasse), la saquebute (trombone ou grosse trompette), le cornet (petit cor) et le tambour (*). La musique, dit Combarieu, n'est pas sans valeur, bien qu'elle ne soit pas franchement dramatique. Elle sait trouver une certaine grandeur solennelle : le style est sévère (consonances pures). L'influence du plain-chant y est à peine sensible, et le sentiment de la tonalité y apparaît déjà, mais l'écriture n'est pas assez complète pour qu'on puisse émettre un jugement sûr.
(*) J. COMBARIEU, Histoire de la Musique, t. I, p. 644.
Nous sommes d'ailleurs à une époque de transition : le style polyphonique prévaut toujours : il s'effacera bientôt, avec la vogue des ouvrages italiens introduits en France par Mazarin. Le ballet n'est encore, au point de vue musical, qu'une adaptation à des fins nouvelles, de pièces dont la forme s'apparente étroitement aux airs de cour pour la musique vocale ; pour les entrées de ballet, ce sont les danses qui la règlent.
Le compositeur dont l'influence demeure persistante jusque dans les premières années du XVIIe siècle est Pierre Guédron, qui succéda à Claude Le Jeune dans la charge de maître des enfants et compositeur de la musique de la Chambre en 1601. Ses ouvrages, malgré leur solennité, semblent souvent un « arrangement » dont les parties apparaissent comme surajoutées à la mélodie principale, et non sans l'alourdir. Mais ses airs ont de la grâce, de la clarté, de la distinction, et l'on remarque la parfaite convenance de la musique aux paroles. Il a le souci de l'originalité rythmique, et se préoccupe moins de la prosodie du texte chanté que d'un dessin mélodique suggérant des images sonores en quelque sorte complémentaires de ce texte. Les répétitions sont rares : il a le sens dramatique et n'emploie qu'à bon escient les vocalises. Dans ses ballets : Alcine (1610), les Argonautes (1614), le Triomphe de Minerve (1615), Délivrance de Renaud (1617), Roland (1618), Tancrède (1619), on peut constater l'influence florentine de Caccini et de Rinuccini qui séjournèrent à la cour de France de 1601 à 1605. Il est, en définitive, un des créateurs du style lyrique français.

deux scènes de la Délivrance de Renaud, ballet de Guédron (1617) [gravures du livret]
Les mêmes qualités se retrouvent chez son gendre Antoine Boësset, sieur de Villedieu, qui lui succéda dans sa charge en 1613. En comparant la facture de ces deux musiciens, on est tout d'abord frappé de leur ressemblance. Mais un examen plus attentif fait constater, surtout dans les « récits » (qui ne sont aucunement des récitatifs, au sens que l'on donnera plus tard à ce terme), le caractère essentiellement lyrique de la mélodie. Sa prosodie est aussi très différente ; elle épouse plus intimement le texte, évite de l'allonger, sauf à l'instant où une vocalise peut exprimer un élan de l'âme. Les airs de Boësset furent opposés aux airs italiens et passèrent pour représenter la meilleure musique vocale française. Enfin c'est lui qui, le premier, applique le système de la basse continue.
On retrouvera plus loin son fils Jean-Baptiste Boësset, dont l'importance est moindre, mais dont l'activité fut grande au temps de Lully. Tous les compositeurs de cette période écrivent pour le ballet : l'usage est d'ailleurs de collaborer, et ce sont le plus souvent les instrumentistes qui sont en même temps les auteurs des partitions qu'ils jouent. Le genre évolue, en même temps que les formes se fixent : le ballet s'adapte aux circonstances qui le font naître. Il y a des ballets mélodramatiques, comme l'Alcine de Guédron ; il y a des ballets « à entrées », comme les ballets des Nègres, des Bohémiens, des Paysans et des Grenouilles, où l'élément bouffon prédomine, le Ballet des Fées de la Forest Saint-Germain, dansé en 1625, le Ballet de la Douairière de Billebault, l'année suivante. Le ballet est maintenant un véritable opéra. Au chœur, qui primitivement servait d'ouverture, se substitue une « symphonie », « ouverture à la française » qui débute par un mouvement lent, de caractère pathétique, suivi d'un mouvement vif, le plus souvent de style fugué, puis d'un finale, qui est presque toujours une reprise du premier mouvement. Viennent ensuite les « entrées » ; on en compte parfois jusqu'à trente, toutes variées de mouvement et de style, sur des airs de danse ou sur des « symphonies » accompagnant les pantomimes non dansées. Ce n'est qu'à partir du Ballet de la Reine que ces entrées ont un lien entre elles. Le finale était dit « grand ballet » ; il forme à lui seul un ensemble de danses auxquelles prennent part le roi et les grands personnages. Presque toujours, ils y paraissent masqués, du moins à l'origine. L'usage du masque se perpétue en Italie comme en Angleterre.

Ballet des Fées de la forêt Saint-Germain (1625) ; entrée
des vaillants combattants [dessin aquarellé du XVIIe siècle]

Ballet de la Douairière de Billebault (1626) ; entrée de la Douairière et de ses dames [dessin aquarellé du XVIIe siècle]
Les guerres de religion n'interrompirent qu'un instant la vogue des ballets : chaque trêve en ramenait l'occasion. Il en fut de même en Angleterre, mais les luttes des Cavaliers et des Têtes Rondes imposèrent une discrétion que commandaient les circonstances.
Partout, les costumes étaient somptueux ; les sujets mythologiques justifiaient leur diversité, et il fallait que dieux et déesses parussent au milieu des nuées, des arcs-en-ciel, grâce à d'ingénieuses machines. Le ballet était exécuté sur un plancher entouré de balcons ; au fond de la salle, une large entrée permettait le passage des machines. Les figures exécutées par les danseurs en groupe étaient géométriques, et les gravures du temps nous montrent des évolutions assez semblables à celles que l'on voit dans les carrousels militaires. De place en place, intervenaient des pas faisant valoir la virtuosité d'un soliste. Au début de chaque entrée, parfois aussi au milieu de l'action, des « récits » exposaient ce qu'il fallait connaître pour comprendre le sens des allégories représentées par la danse.
Ainsi, en évoluant, le ballet de cour aboutit à la tragédie lyrique, au moment où les musiciens italiens viennent hâter une transformation du genre qui, par d'autres voies, était en train de s'accomplir en France. Le P. Mersenne, ami de Descartes, note dès 1636 dans son Harmonie universelle, ce qui sépare encore à ce moment le style italien du style français : « Les Italiens, écrit-il, observent plusieurs choses dans leurs récits dont les nôtres sont privés parce qu'ils représentent tant qu'ils peuvent les passions et les affections de l'âme, de l'esprit, avec une violence si étrange, que l'on jurerait quasi qu'ils sont touchés des mêmes affections qu'ils représentent en chantant ; au lieu que nos Français se contentent de flatter l'oreille et qu'ils usent d'une douceur perpétuelle dans leurs chants, ce qui en empêche l'énergie. » En d'autres termes, les musiciens français, instruits par l'exemple de leurs confrères italiens, vont s'appliquer à donner plus de vérité, et partant, plus de variété, au discours musical ; la mélodie va devenir plus expressive, en devenant plus simple, plus humaine. Ils n'auront plus seulement pour dessein de faire paraître sur la scène des bergers d'églogue, d'aimables divinités mythologiques, venues sur le théâtre pour flatter les souverains.
Certes, les flatteries ne cesseront point de paraître, aussi directes, à la cour de Louis XIV comme à la cour d'Henri III. Et Lully passera maître en l'art de faire briller du plus vif éclat le Roi-Soleil. Mais quelques héros de tragédie en dehors des ballets, se trouveront vraiment aux prises avec l'adversité, et la musique trouvera les accents qu'il faut pour exprimer le trouble de leurs âmes. Il arrivera aussi souvent que, les deux formes se combinant lorsque le sujet s'y prête, l'on verra sur la scène « l'opéra-ballet ». Il durera jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
L'HUMANISME FLORENTIN
LA NAISSANCE DE L'OPÉRA ET DE L'ORATORIO
Ordinairement l'évolution des genres et des styles s'opère lentement ; et s'il est vrai que des artistes de génie la hâtent plus ou moins par ce qu'ils apportent de vraiment original et de nouveau, il faut toutefois quelque temps pour que ces idées neuves se répandent, germent et produisent des fruits où se retrouveront les caractères de cette semence spirituelle. A Florence, dans les dernières années du XVIe siècle, rien de pareil : c'est la volonté concertée de quelques hommes, poètes, savants, musiciens, qui opère une révolution. Ils sont comme des conjurés qui se préparent à renverser un tyran. Ils en décident la mort ; ils veulent faire régner à sa place un successeur qu'ils ont choisi, parce que celui-ci ramènera l'âge d'or en ramenant la poésie et la musique aux sources pures de l'art antique. Ils sont nourris d'illusions — nous le savons certes aujourd'hui — mais leur dessein est noble. Ils aperçoivent, avant leurs contemporains, que les vieilles formes sont usées, que le respect des traditions n'aboutit qu'à ressasser de vaines formules, et que la lettre de prétendues lois régissant l'art a déjà tué l'esprit. Peut-être ne voient-ils pas cependant que ces formes caduques sont à la veille de se transformer d'elles-mêmes ; que déjà les échelles diatoniques se réduisent insensiblement aux modes majeur-mineur et que la gamme d'ut a conquis la musique. Ils sont des hommes de la Renaissance, des humanistes que grise la découverte récente des trésors oubliés. Ils se sont émerveillés de ces richesses si longtemps obscurcies. Ils rêvent à ce que devait être le théâtre au temps où les chœurs d'Eschyle, Sophocle, Euripide « chantaient » les strophes et les antistrophes en évoluant sur la scène. Ils rêvent — comme fera Wagner deux siècles et demi plus tard — d'un art complet, d'une synthèse opérée dans le drame ; et leur rêve est pareil à celui de Beaujoyeux qui voulait dans le Ballet de la Reine « contenter en un corps bien proportionné l’œil, l'oreille et l'entendement ».
Mais l'oreille de l'homme du XVIIe siècle est plus exigeante que celle des contemporains de Périclès : la polyphonie est née, elle a progressé. Bien trop, songent-ils, puisqu'elle s'est alourdie, puisque ses complications en ont fait une sorte de monstre qui dévore sa propre substance, et qu'il est impossible à l'oreille de saisir à la fois tant de notes superposées et tant de mots si bien emmêlés qu'on n'en perçoit plus le sens. Leur effort veut être un retour à la simplicité sans laquelle il n'est pas de vraie grandeur. La lyre et la flûte agreste suffisaient aux Anciens. Sans se priver des ressources des instruments nouveaux, n'est-il point aisé d'alléger ce grimoire de notes enchevêtrées, et de laisser le vers sonner dans la plénitude et la nudité de sa forme ?
Ils sont une douzaine, et se réunissent chez l'un d'eux, Giovanni Bardi, dei conti di Vernio. Ils se nomment Vincenzo Galilei — dont le fils Galileo Galilei, sera l'illustre mathématicien et astronome — Ottavio Rinuccini, poète, Girolamo Mei, théoricien de la musique, Jacopo Peri, chanteur et compositeur, Pietro Strozzi, compositeur, Emilio dei Cavalieri, organiste, intendant de la musique à la cour de Ferdinand Ier, Giulio Caccini, professeur et remarquable joueur de tous instruments.
L'abus du contrepoint les choquait tous. On imagine leurs propos : c'est à peu près ce que Hans Sachs dit à Beckmesser dans les Maîtres chanteurs. La Dafne de Peri, représentée en 1594 au palais Corsi, est née de ces discussions passionnées sur la nécessité de rendre à la musique une liberté perdue sous les complications scolastiques. Le poème d'Ottavio Rinuccini était très simple. La musique a disparu, hélas ; on sait seulement qu'elle était écrite dans ce stilo rappresentativo, ou stilo recitativo qui liait intimement la mélodie aux paroles, et calquait la déclamation lyrique sur la phrase parlée. Le même musicien écrivit le premier opéra qui nous soit parvenu — une Euridice, sur un poème de Rinuccini. Il fut joué à Florence au palais Pitti en 1600, pour les fêtes du mariage de Marie de Médicis et d'Henri IV, roi de France, célébré le 16 décembre, et le succès en fut immense. Cette Euridice fut heureusement imprimée ; un prologue est chanté par la Tragédie ; les personnages sont, outre Orphée et Eurydice, les bergers Tirsi, Aminto, Arcetro et les Nymphes. Les chœurs y tiennent grand'place, alternant avec quelques soli et deux trios. Le livret est pompeux ; la musique sommaire ; quelques intermèdes symphoniques divisent l'action qui se termine par un ballo dansé et chanté à cinq et à trois voix. Sous la mélodie, une basse chiffrée use à satiété, dit Combarieu, de la cadence où le quatrième degré fait l'appoggiature du troisième, et l'ensemble est d'une grande monotonie. Mais le chant d'Orphée aux Enfers Funeste piagge est émouvant : il fit couler les larmes des assistants.
Caccini composa lui aussi une Euridice sur le même sujet et son ouvrage souffre du même défaut : la monotonie. Mais au contraire de Peri, Caccini aime les ornements vocaux. Il donna, quelques jours après son Euridice, Il Rapimiento di Cefalo sur un poème de Chiabrera, et dont la musique est de même style.
Ce que les débuts de l'opéra florentin ont laissé de meilleur est dû à Peri, bien plus qu'à Caccini beaucoup moins original. Mais Caccini a écrit une préface à son Euridice, publiée en 1600, et l'année suivante dans un avis ai lettori, il précisait en tête de le Nuove Musiche, la doctrine des réformateurs : « A l'époque où florissait l'éminente compagnie du très illustre Signor Giovanni Bardi dei conti di Vernio, je puis dire, l'ayant fréquentée, que j'ai plus appris de leurs doctes discours que je ne l'ai fait en plus de trente ans pour l'étude du contrepoint ; car ces gentilshommes très éclairés m'ont toujours engagé (et convaincu par des raisons lumineuses) à dédaigner cette sorte de musique qui, ne laissant pas bien entendre les paroles, gâte l'idée et les vers en allongeant ou en raccourcissant tour à tour les syllabes pour se conformer au contrepoint, écartèlement de la poésie... » En 1608, dans la préface de Dafne, Marco da Gagliano vantera les mérites du genre nouveau : « Vrai spectacle de princes, et plus que tout autre agréable, car il réunit en lui tous les plus nobles plaisirs : l'invention et la distribution du sujet, les idées, le style, la douceur des rimes, l'art de musique, les concerts de voix et d'instruments, la délicatesse du chant, la légèreté des danses et des mouvements, et l'on peut dire aussi que la peinture y joue un rôle important, par la perspective et par les costumes ; si bien qu'avec l'intelligence, sont charmés tout ensemble tous les plus nobles sentiments par les arts les plus agréables qui aient été inventés par le génie humain. » Commentant ces déclarations, Combarieu remarque que cette « conquête » de la camerata florentine ne va point sans pertes. Les gains sont peu de chose, et ils se réduisent à l'emploi — non point à l'invention — du récitatif, et à la mise en honneur du bel canto (ce qui n'est pas surprenant car tous étaient des chanteurs) ; ils ont amené une détente après les œuvres trop surchargées des contrapuntistes. Mais ces « conquêtes » marquent un recul, parce qu'elles ont à peu près aboli les progrès lentement accomplis depuis l'organum du moyen âge (*).
(*) Cf. COMBARIEU, Histoire de la Musique, t. II, pp. 10 et sq.
Romain d'origine, humaniste fort savant, musicien et organiste animateur des fêtes de l'Oratoire del Santo Crucifisso in San Marcello, Emilio de' Cavalieri fut mandé par le duc de Toscane Ferdinand pour son mariage avec Christine de Lorraine en 1588, et aussitôt nommé intendant général des Beaux-Arts. A Florence, il fut naturellement amené à faire partie de la camerata et la fréquenta assidûment. Il écrivit dès 1588 une Ascension de Notre Sauveur, dont le manuscrit a été récemment découvert par le R. P. Martin, puis, de retour à Rome où l'appelait son amitié pour Philippe de Néri, qui allait mourir en 1595 Cavalieri fit exécuter en février 1600, dans l'Oratoire Santa Maria in Vallicella, la Rappresentazione di Anima e di Corpo, que, jusqu'à ces dernières années l'on considérait comme le premier oratorio. Le genre nouveau — le drame sacré, d'abord en effet représenté, et de style homophone (stilo espressivo) tout comme celui des ouvrages mythologiques de Peri et de Caccini — prit le nom du lieu même où il avait été créé. La Rappresentezione di Anima e di Corpo n'est point seulement intéressante du point de vue historique, et parce qu'elle marque le début d'un genre bientôt florissant ; l'ouvrage est d'une beauté qu'il doit à ses chœurs, à ses récitatifs d'une simplicité pleine de grandeur et d'une justesse d'accent admirable. Le corps et l'âme en sont les personnages et ils dialoguent, l'âme s'efforçant de montrer au compagnon auquel elle demeure attachée, qu'il faut se dégager des plaisirs matériels et s'élever à des joies plus sereines. Le texte et la musique, étroitement unis, donnent à l'œuvre de Cavalieri un caractère profond d'humanité émouvante. On regarde en outre Cavalieri — et Peri l'affirme dans la préface de son Euridice — comme l'inventeur de la basse chiffrée.
Ainsi se précise au même moment, à Rome comme à Florence — mais c'est la capitale toscane qui est bien à l'origine du mouvement, puisque Cavalieri fit partie de la camerata florentine — une orientation nouvelle de la musique lyrique. Le commencement du XVIIe siècle est en même temps le commencement d'une période nouvelle où va régner l'opéra. Entre ce siècle et le précédent, la rupture est complète, et sans analogue dans l'histoire des arts : en quelques années les ouvrages, les chefs-d’œuvre des maîtres les plus grands, tombent dans l'oubli, et il faudra deux siècles pour qu'on en redécouvre et la valeur et la beauté.
Ce qui surprend dans cette aventure, c'est que rien de semblable ne survient dans les autres domaines de l'esprit : ici, la création d'un genre nouveau s'accompagne d'une régression fort nette de la technique. Lorsque les hommes du XVIIe siècle déclarent laid l'art ogival et font du mot « gothique » dont ils l'accablent le synonyme de barbare et d'affreux, du moins ils se gardent de renoncer aux procédés de construction perfectionnés par leurs pères. Mais les créateurs du dramma in musica font, sous le prétexte d'un retour à l'antiquité, le sacrifice léger du trésor musical patiemment amassé par leurs aïeux.
Durant une longue période l'opéra va demeurer — comme le ballet — délassement de princes et spectacle de cour, sauf à Venise, où on le verra bientôt, à cause des mœurs de la ville, devenir spectacle populaire tout en gardant son caractère aristocratique. D'autre part, un musicien de génie, Claudio Monteverdi, aussi bien par l'élévation de sa pensée que par la haute qualité de sa technique, va bientôt aussi enrichir l'opéra de chefs-d’œuvre d'une resplendissante beauté dont le rayonnement ne s'est point terni au bout de trois siècles. Et il aura quelques successeurs dignes de lui.
San Orfeo, représenté à Mantoue, dans la salle de l'Académie des Invaghiti, le 24 février 1607 (*), doit sans doute aux circonstances de sa composition une part du pathétique qu'il dégage : passionnément épris de sa jeune femme Claudia Cattaneo, fille d'un musicien d'orchestre, et qu'il avait épousée douze ans plus tôt, il la voit dépérir sans que les médecins la puissent soulager. Elle allait bientôt mourir à Crémone, le 10 août de cette même année. C'est le reflet de ses propres angoisses que l'on retrouve dans l'Orfeo comme on trouvera dans l'Arianna, écrite la même année, un écho de sa douleur. Le livret d'Orfeo est dû à Striggio. Il suit de près la légende, mais l'accommode au goût du jour : le librettiste introduit au premier acte des danses pastorales ; au finale une intervention d'Apollon, deus ex machina, qui emmène avec lui Orphée dans l'Olympe. Le deuxième acte où, au milieu de la joie bucolique, une nymphe apparaît aux bergers et leur enjoint de cesser leurs chants car Eurydice vient de mourir, est un des sommets de l'art lyrique, et les plaintes d'Orphée, son exclamation : Ohimè ! son déchirement : ed io respiro ! ed io rimango ! n'ont jamais été dépassés par aucun musicien dramatique.
(*) Littéralement : les épris : invaghirsi, s'éprendre, être séduit.
Si Monteverdi réussit ce miracle, c'est qu'il a été formé à l'école de Marco-Antonio Ingegneri, maître de chapelle de la cathédrale de Crémone, auteur des célèbres répons de la Semaine Sainte que leur beauté fit si longtemps attribuer à Palestrina. C'est que sa science du contrepoint, sa connaissance profonde de la musique modale le servent utilement, même lorsqu'il emploie le stilo espressivo. D'instinct, il retrouve ce qui peut renforcer un accent pathétique par un « retour » au style ancien. Il demeure exempt de parti pris (*) et on a pu rapprocher maints passages d'Orfeo des trouvailles les plus originales de Moussorgski dans Boris Godounov et de Debussy dans Pelléas et Mélisande. L'auteur d'Orfeo est aussi l'auteur des Madrigali spirituali à quatre voix, publiés à Brescia en 1583, et sait se souvenir qu'il y a introduit des dissonances non préparées, des accords de septième et de neuvième de dominante. Ses libertés harmoniques et ses emprunts à la musique modale vont de pair, et témoignent de la liberté de son esprit, de son affranchissement de toute contrainte scolastique aussi bien que de tout attachement aux idées du jour.
(*) Cf. Maurice LE ROUX, Claudio Monteverdi, Paris, édit. du Coudrier, 1951, pp. 64 et sq.
Arianna est écrite sur un livret de Rinuccini. La première représentation en fut donnée le 28 mai 1608. Nous n'en possédons que la scène VI, le célèbre lamento qui bouleversa les auditeurs et valut à Monteverdi un véritable triomphe. Il suffit à nous faire juger l'ouvrage. Monteverdi l'utilisa pour Il Pianto della Madonna, sous des paroles latines. De cette même année de deuil, datent aussi deux autres ouvrages du compositeur : une comédie musicale, l'Idropica, sur un livret de Guarini, et un ballet, Il Ballo dell'Ingrate. On ne possède rien de l'Idropica, mais le Ballo dell'Ingrate nous est parvenu intégralement ; l'ouvrage est mêlé de récitatifs et d'airs qui sont les chefs-d’œuvre du style florentin.
Maître de chapelle de la cathédrale de Venise, après qu'il eut quitté la cour de Mantoue, Monteverdi compose des madrigaux dans la forme polyphonique, des motets et des messes, sans cesser d'écrire des ouvrages dramatiques : Peleo e Teti (1616), Amori di Diana e d'Endimione (1618), Andromeda (1620), la Finta pazza Licori (1627), Proserpina rapita (1630), la Vittoria d'Amore (1641), Adone (1639), — qui eut un succès énorme à Venise au théâtre San Giovanni e Paolo. Beaucoup sont hélas perdus. Mais il nous reste Il Nerone ossia l'Incoronazione di Poppea, sur un livret de Busenello, représenté au même théâtre en 1642, et confirmant le succès d'Il Ritorno d'Ulisse in patria, remporté l'année précédente au théâtre San Cassiano de Venise. Des éditions modernes ont rendu à ces chefs-d'œuvre la place qu'un très long oubli leur avait fait perdre. Ils se distinguent, au point de vue de la forme, par une variété extrême : changements de scènes fréquents, diversité de la musique où le récitatif est coupé d'ariosi, de duos, de trios, d'ensembles, qui s'enchaînent avec lui sans rompre l'action. L'esthétique de ces drames est toute moderne, et Monteverdi devançant son époque a fait œuvre qui appartient à tous les temps, parce qu'elle passe de très loin les productions de ses contemporains et que l'on y trouve, comme s'il eût deviné ce qui n'allait être réalisé que longtemps après lui, tout ce que ses successeurs allaient redécouvrir. Ainsi la grandeur simple et le pathétique des adieux de Sénèque à la vie, dans l'Incoronazione, fait présager Rameau et Gluck ; le délicieux duo de la Damoiselle et du Page, dans le même drame, annonce la scène de Suzanne et de Chérubin dans le Nozze. De nombreux passages du Ritorno d'Ulisse sont écrits en style polyphonique, et l'on a dit déjà les fréquents emplois des gammes modales qui donnent à de nombreux passages la couleur de certaines pages de Moussorgski, de Fauré ou de Debussy. En outre, c'est, dans l'Orfeo déjà, l'apparition de thèmes caractérisant une situation, un personnage. Et c'est, partout, un merveilleux équilibre de tant de moyens si différents.
Auprès des ouvrages dramatiques de Monteverdi, développés en forme de tragédies lyriques, il faut ranger des récits épiques, des cantates, des morceaux divers dont le caractère expressif se rapproche de l'art théâtral, et si bien même que certains d'entre eux peuvent aisément paraître sur la scène. Ainsi le Combattimento di Tancredi e di Clorinda, tiré du chant XII de la Jérusalem délivrée, et que l'on trouve dans le VIIIe livre des Madrigaux publié chez Alexandre Vincenti à Venise en 1638 sous le titre de Madrigali guerrieri ed amorosi con alcuni opuscoli in genere rappresentativo qui en indique fort bien la nature. Dans le Combattimento un testo, un texte, est dit par un récitant et forme le récitatif contant les circonstances qui amènent la rencontre de Tancrède et du guerrier mahométan, lequel n'est autre que Clorinde, méconnaissable sous le heaume qui cache ses traits. Ce récitatif est d'une extrême simplicité mélodique ; il est rompu ici et là par les voix des deux adversaires qui s'affrontent. La fin de cette cantate est d'une grandeur et d'une émotion admirables, résultant de l'art avec lequel Monteverdi retarde la résolution de l'appoggiature amorcée quinze mesures avant la cadence conclusive (*). L'orchestre offre aussi des particularités géniales : Monteverdi lui confie un rôle que l'on pourrait dire actif, indépendant et expressif au même titre que celui des voix, un rôle qui est déjà celui que les maîtres de l'art lyrique au XIXe siècle lui accorderont. Monteverdi, conscient de la valeur, de l'avenir de cette innovation, le dit sans fausse modestie : « Il m'a paru bon de faire savoir que c'est de moi que sont venues les recherches premières et les premiers essais dans ce genre, si nécessaire à l'art musical et faute duquel on peut dire honnêtement que cet art était demeuré imparfait jusqu'à présent puisqu'il n'y avait que les deux genres à savoir le doux et le modéré. » Ce stilo concitato, ce style « animé », lui appartient : hardi novateur, il a pressenti, et réalisé le plus souvent, presque tout ce qui allait constituer la musique moderne (**).
(*) Cf. Maurice LE ROUX, Claudio Monteverdi, Paris, édit. du Coudrier, 1951, pp. 64 et sq.
(**) Sur Monteverdi, on consultera les ouvrages d'Henry Prunières, Librairie de France 1926, et de Maurice Le Roux.
On vient de voir que plusieurs ouvrages de Monteverdi furent créés à Venise. La raison n'en est point seulement dans le fait que le compositeur fut appelé à Saint-Marc, mais aussi dans l'amour que les Vénitiens montrèrent pour l'opéra aussitôt qu'il leur fut révélé. Bien que le genre fût né à Florence, ce fut Venise en effet qui, la première, ouvrit un théâtre public d'opéra. En 1637, une troupe de chanteurs s'installa au San Cassiano, récemment reconstruit par la famille Tron, et le public y fut admis pour la somme de quatre lire. L'entreprise était hasardeuse : les rappresentazioni, fort coûteuses, passaient pour ne pouvoir être organisées qu'aux dépens des princes, qui, presque tous, possédaient des salles de musique assez vastes. Il en était ainsi à Florence et à Rome, chez les Borghèse, chez les Barberini. Ceux-ci avaient fait construire une salle pouvant contenir quatre mille personnes, et le Bernin lui-même s'était occupé de la machinerie. A chaque carnaval, le cardinal Antonio Barberini, neveu du pape Urbain VIII, suspendait ses audiences et refusait même de recevoir les ambassadeurs pour se consacrer tout entier à la préparation des spectacles, surveiller la confection des machines et des décors. On se disputait les invitations à ces fêtes auxquelles les meilleurs chanteurs, les castrats les plus réputés prêtaient leur concours. Mais cela restait un plaisir réservé à quelques privilégiés — nombreux à vrai dire, puisque le théâtre était fort grand — nullement public, cependant. Et c'est ce plaisir aristocratique que le peuple de Venise peut, à partir de 1637, connaître en payant quelques lire. Le bruit fait dans toute la péninsule autour des merveilles que l'on a vues à Florence et à Rome sur les théâtres privés, pique la curiosité des Vénitiens. La musique n'est certes point ce qui les attire davantage, elle va cependant trouver bientôt bénéfice de cet engouement. Les organisateurs des représentations du San Cassiano surent en profiter. Leur mécénat fut facilité par la place que la musique occupait dans la vie vénitienne : la chapelle de Saint-Marc était une des plus réputées de l'Italie. L'école vénitienne avait produit quelques-uns des compositeurs les plus fameux au cours des deux siècles précédents, organistes et madrigalistes, auteurs de pièces religieuses et de motets profanes. Le terrain se trouvait donc fort bien préparé pour le succès de l'opéra.
Henry Prunières en a donné dans son Monteverdi, dans ses ouvrages sur Cavalli et l'opéra vénitien, sur l'Opéra en France avant Lulli, un tableau exact et coloré :
Une simplification de la mise en scène fut nécessaire ; il en fut de même de l'exécution musicale. Il ne pouvait être question de payer chaque soir sur la recette les soixante ou quatre-vingts musiciens et les nombreux choristes dont disposait le pape. Il fallut se contenter d'une douzaine d'instruments à archet et de deux clavecins, l'un di ripieno pour soutenir l'orchestre, l'autre touché par le maestro, pour accompagner les récitatifs. Deux trompettes s'ajoutaient ordinairement à ce modeste ensemble pour jouer dans les ouvertures, les scènes guerrières ou triomphales.
Le public dont dépend le succès est fort différent de celui qui, jusque-là, s'est intéressé aux représentations d'opéras : il n'y aura plus d'invités dans la salle, et on ne peut compter sur les applaudissements de politesse. Les gens de toute condition qui garnissent les loges et le parterre ont payé à l'entrée le droit de voir et de juger librement. Il n'y a aucune distinction de place dans la salle : les meilleures appartiennent aux premiers arrivants, aussi ce sont de véritables batailles pour s'emparer de celles qui sont le plus rapprochées de la scène. Les sièges sont peu confortables ; la salle n'est pas éclairée : dès le lever du rideau, on éteint les deux lustres qui ont permis aux spectateurs de se placer. Ceux qui veulent lire le livret doivent l'acheter en entrant avec la petite bougie qui servira à le déchiffrer. Ils pourront aussi se procurer des pommes et des poires cuites qui leur serviront à calmer leur faim ou, en certains cas, à assouvir leur fureur sur les acteurs...
Les artisans et les gondoliers auxquels l'usage veut qu'on abandonne parfois les loges demeurées vides, ne sont pas les moins assidus à l'Opéra : ils prononcent sur les chanteurs des jugements sans appel. Ils savent les reconnaître sous leurs travestissements bizarres, et c'est pour eux un jeu que d'y parvenir : lorsque paraît costumé en nourrice un certain prêtre renommé pour la manière dont il tient les rôles bouffes, tout le parterre charmé s'exclame : « Ecco Pre Pierro che fa la vecchia ! » On s'assure le concours des meilleurs virtuoses, mais, pour les petits rôles, on a recours aux amateurs de bonne volonté : il y a beaucoup de prêtres, de moines, parmi eux. Nul ne s'en étonne. A Rome aussi, d'ailleurs, les couvents fournissaient la plupart des choristes.
Le théâtre ouvre pendant trois « saisons » par an : du lendemain de Noël au 30 mars ; du second jour de Pâques au 30 juin, et du 1er septembre au 30 novembre. Le public vénitien ne le boude point. Il adore les intrigues compliquées, les scènes violentes, et, parfois, c'est dans la salle elle-même que se donne la tragédie. Certain soir, dans une loge, un Morenigo abat un Foscarini d'un coup de pistolet. Les soldats et les bravi préposés au service d'ordre n'y suffisent pas toujours, et, souvent, il leur faut du renfort.
Les mœurs vénitiennes de ce temps nous surprennent : on aurait peine à croire à toutes les noirceurs et à tous les crimes rapportés dans les chroniques si des documents certains n'en affirmaient l'authenticité. Les livrets d'opéras vénitiens vont en refléter l'image. Ils sont dédiés aux grands seigneurs qui ne s'étonnent même point d'y retrouver des allusions à leurs forfaits : leur dédain les met au-dessus de l'opinion, et leur fortune les place au-dessus des lois, tels ces frères Grimani-Calergi dont l'oncle fit construire le théâtre SS. Giovanni e Paolo. Férus de l'opéra, ils s'occupent eux-mêmes des représentations, veillent au luxe du spectacle et de la mise en scène, jamais trop fastueuse. J'emprunte encore à Henry Prunières ce détail : « Ces mécènes sont par ailleurs des êtres redoutables, accusés avec vraisemblance d'être « comptables à Dieu de la vie de deux cents personnes qu'ils ont dépêchées par le fer ou par le poison ». A plusieurs reprises, ils sont bannis de Venise, mais ils bravent les ordonnances et y demeurent, entourés d'une véritable armée de sicaires jusqu'au jour où ils font déborder la coupe en enlevant en gondole, la nuit, à la sortie d'une répétition d'opéra au théâtre SS. Giovanni e Paolo, leur ennemi le comte Querini Stampalia qu'ils font assassiner cruellement sous leurs yeux dans leur palais. Ils ne tarderont pas d'ailleurs à être graciés, et rentreront triomphalement à Venise. Ils s'empresseront d'abattre le monument expiatoire élevé sur l'emplacement de la maison du crime et rebâtiront l'aile gauche du palais Vendramin, leur somptueux repaire. » Il faut noter que c'est dans ce palais que Wagner viendra mourir le 13 février 1883.
Si l'on rapporte ces traits, ce n'est point seulement à cause de leur couleur pittoresque : ils marquent l'opéra vénitien à son origine, et lorsque Lorenzo Da Ponte, Vénitien, librettiste de Mozart, écrira le poème de Don Giovanni, on retrouvera dans ses personnages l'exact reflet des mœurs de sa patrie depuis un ou deux siècles. Il fait ainsi de la légende espagnole un véritable opéra vénitien.
Il n'entre point dans le plan de ce volume d'énumérer tous les musiciens qui ont enrichi le genre lyrique : ils sont innombrables ; on a seulement marqué l'évolution du genre en précisant par l'étude des œuvres essentielles ses caractères aux différentes époques, et dans les divers pays où il s'est répandu.
A Venise, les deux Romains qui avaient été les premiers directeurs des théâtres San Cassiano et SS. Giovanni e Paolo, Francesco Manelli et Benedetto Ferrari — tous deux musiciens qui ne manquent pas d'écrire, naturellement, pour la scène —, voient bientôt s'élever des salles concurrentes. Le San Samuele reprend l'Arianna de Monteverdi pour son inauguration en 1639. Manelli ouvre une quatrième salle, le Teatro Novissimo, en 1642, et y fait chanter son Alcate. Puis Ferrari part pour Modène et Manelli, dont la superbe voix de basse a fait le succès de maints ouvrages, entre à la chapelle San Marco. C'est alors que commence le règne de Francesco Cavalli.
Protégé du podestat de Crema qui s'était chargé de son éducation, Francesco Cavalli était entré à la chapelle San Marco en qualité de chantre. Bientôt, il y devenait organiste. La dignité de sa vie, la qualité de ses ouvrages lui valaient une haute estime. En 1639, à l'âge de trente-sept ans, il donnait au San Cassiano le Nozze di Teti e di Peleo, opera scenica. Henry Prunières signale que c'est le premier ouvrage portant ce titre d'opera scenica qui devait faire fortune. Le livret est d'Orazio Persiani, et la partition révèle l'influence romaine par la prédominance du style récitatif ; mais certains passages (la chiammata alla caccia — l'appel à la chasse — par exemple) laissent voir l'influence de Monteverdi. Toutefois ce n'est que deux ans plus tard, avec Didone, créée au même théâtre, qu'affirmant une manière plus personnelle, Cavalli trouve en récompense un succès si vif qu'il lui faut immédiatement donner d'autres ouvrages et qu'en 1642, il est joué en même temps sur trois théâtres : au San Cassiano avec Virtù degli Strali d'Amore (Puissance des flèches de l'Amour), au San Mosè avec Amore innamorato (l'Amour amoureux), et au SS, Giovanni e Paolo avec Narciso ed Eco.
En trente ans, de 1639 à 1669, date à laquelle Cavalli se consacra à la musique religieuse, il écrit quarante-deux opéras. Sa renommée dépasse très vite les frontières de son pays : en 1642, la cour de Vienne lui commande Egisto qui non seulement fut donné en 1643 au San Cassiano de Venise, mais bientôt après dans toutes les villes importantes d'Italie, et à Paris même en 1646. Nous retrouverons Cavalli lorsqu'il s'agira de l'opéra en France ; son Serse, créé au SS. Giovanni e Paolo en 1654, sera chanté à la cour de France en 1660. Parmi ses ouvrages les plus célèbres, il faut citer Deidamia (1644), Doriclea accueilli triomphalement en 1645, Titone la même année, Romolo e Remo, joués concurremment ; la Prosperità infelice di Giulio Cesare, dittatore (1646), Giasone (1649, qui jouit d'une immense popularité, grâce à la scène où Médée évoque les esprits infernaux), Euripo, 1649, Bradamante, 1650, Alessandra vincitor di se stesso (que Prunières attribue à Cesti, un livret imprimé à Lucques portant le nom de ce musicien), Scipione Africano, Eritrea, la Veremonda, Ciro, Statira, Erismena, la Presa d'Argo e Gli Amori di Linceo con Ipermestra, chanté solennellement le 18 juin 1658 à Florence à l'occasion de la naissance d'un fils du roi d'Espagne Philippe IV, et pour lequel le cardinal Giovanni Carlo avait commandé d'extraordinaires machines permettant de faire les changements de scène avec une incroyable rapidité. Cavalli remporta avec son Ipermestra un des triomphes les plus éclatants de sa carrière. Vers la fin de celle-ci il fit encore représenter Pompeo magno en 1666 et Coriolano en 1669.
Rien que cette nomenclature permet de voir que le théâtre lyrique s'oriente nettement vers les sujets mythologiques, de préférence, et, en second lieu vers les sujets historiques. Mais les librettistes ne se croient nullement tenus de respecter l'histoire ni même la légende. Monteverdi se souciait fort de la tenue littéraire de ses livrets ; ses successeurs n'en ont cure, et se préoccupent surtout de flatter le goût des spectateurs pour les belles histoires sentimentales : dans Muzio Scevola que Cavalli fit représenter au San Salvatore en 1664, Nicolà Minato, auteur du poème, explique l'héroïsme du jeune patricien brûlant lui-même sa main sur le brasier de l'autel, par le désespoir d'amours malheureuses !
Le style de Cavalli marque le même genre de complaisance : certes, le musicien a grand soin de la justesse des accents ; il sait donner aux récitatifs et aux airs une intensité d'expression vraiment admirable ; il a de la vigueur, et il sait aussi montrer du charme. Il possède fort bien son métier, et son génie se révèle dans l'invention mélodique, parfois, et beaucoup plus rarement dans ses accompagnements instrumentaux. Mais il n'est, comme le dit fort bien son biographe, ni un chercheur ni un novateur. Il parle la langue de son temps, et n'hésite pas à emprunter à Monteverdi les modèles dont il a besoin. Il les calque sans trop de scrupule. Ce qui plaît en lui, ce qui fait de lui un grand musicien, c'est sa vigueur et sa franchise plutôt que sa richesse. Et puis, il est savant, il est habile, mais il se contente à moins de frais que Monteverdi ; il affectionne la canzone à refrain qui est déjà l'aria da capo ; parfois même les paroles du refrain changent et entraînent une modification de la mélodie. D'autres fois les couplets sont séparés du refrain par des récitatifs. Il excelle dans le lamento, et celui de Climène dans Egisto est une des pages les plus émouvantes de la musique dramatique. « La basse martèle un thème formé par un fragment de gamme chromatique descendante et la mélodie plane au-dessus avec une liberté de mouvement inouïe. » (H. Prunières.)
Il faut encore noter l'importance croissante prise par les accompagnements d'orchestre dans l'opéra vénitien ; mais bientôt se manifeste une tendance à la simplification et qui parfois même laisse une impression de pauvreté, surtout dans les derniers ouvrages de Cavalli : après une ritournelle, au début des arie, l'orchestre se contente de plaquer des accords, ou n'intervient que pour faire écho à la voix et remplir les silences.
L'orchestre se compose du clavecin, de théorbes qui font la basse, des violons et des violes qui le plus souvent accompagnent les voix, des trompettes, des cornets, des trombones et des bassons. Les timbales interviennent dans les airs guerriers, très fréquents dans les opéras de Cavalli.
Henry Prunières signale l'adresse de l'écriture des quatuors vocaux dans ses opéras. Qu'il s'agisse d'obtenir un effet bouffon (comme dans le finale d'Egisto, où l'Amour, descendu aux Enfers, est aux prises avec ses victimes : Phèdre, Sémélé, Didon, qui veulent le fouetter), ou un effet de grandeur et de simplicité, comme dans l'Ercole amante (avec le quatuor Dall'Occaso a gl'Eoi — du couchant jusqu'au levant), c'est la même habileté, et dans Pompeo magno, lorsque après les sonneries de trompettes, le cortège de Pompée paraît, les acclamations de la foule alternant avec les soli produisent un extraordinaire effet.
On a pu dire que Cavalli, coloriste comme les peintres vénitiens de son temps, sut créer un décor sonore orchestral et vocal propre à encadrer l'action dramatique et à en rehausser l'éclat.
Dans le même temps, à Rome, l'opéra conçu selon les théories des réformateurs florentins rencontre la faveur des dignitaires de la cour papale. Stefano Landi, castrat au service du cardinal Borghèse, et qui sera bientôt nommé à la chapelle Sixtine, fait représenter en 1619 une Morte d'Orfeo, et l'année suivante donne chez le cardinal Borghèse son Aretusa. L'aristocratie romaine s'engoue bien vite des ouvrages florentins ; quant à ceux que produisent les compositeurs romains, ils témoignent, à partir de 1626, avec la Catena d'Adone, de Domenico Mazzocchi (lui aussi au service des Borghèse) d'une évolution très nette du style lyrique : le récitatif florentin n'a plus sa monotone pureté ; il est coupé d'airs, de ritournelles confiées à l'orchestre, de chœurs, de danses. Mais Mazzocchi qui s'est formé à l'école des madrigalistes, garde le goût du contrepoint, et le manifeste dans l'écriture de ses chœurs ; il a le sens de la modulation, du chromatisme, et l'air Folle l'aura mi scherne, d'Adone, imite, grâce aux altérations qu'on y trouve à chaque mesure, la plainte du vent dans le feuillage de la forêt. C'est de cet opéra que les historiens font partir la seconde époque du drame lyrique, l'époque romaine. Mais ce n'est point seulement la musique qui change de caractère, c'est, en même temps, la structure des livrets où plus large place est faite à l'élément fantastique et féerique. L'opéra va devenir de plus en plus un spectacle, un prétexte à exhibitions, dans une mise en scène compliquée à plaisir.
Les Barberini font construire le premier grand théâtre qui va servir de modèle à tant d'autres, et qui est inauguré le 23 février 1632 avec le San Alessio de Stefano Landi, sur un poème de Mgr Rospigliosi. Le succès est énorme, et l'ouvrage fut repris trois ans de suite pendant les fêtes du carnaval. Landi est lui aussi rompu aux subtilités des madrigalistes. Ses chœurs, ses symphonies sont très développés, et il se meut à l'aise dans les situations diverses d'un drame sacré, rompant avec la monotonie solennelle des sujets mythologiques. En outre on a pu voir dans la coupe de la sinfonia qui précède le deuxième acte (allegro-adagio-allegro) le premier modèle de l'ouverture à l'italienne.
Une autre nouveauté va se manifester bientôt. En 1639, avec la Galatea de Loreto Vittori, célèbre sopraniste qui, avant d'entrer à la chapelle pontificale, avait vécu à Florence, la grâce et la légèreté, la gaieté s'introduisent dans l'opéra (San Alessio, déjà, comptait quelques scènes bouffes). C'est Mgr Rospigliosi — le futur pape Clément IX — qui écrivit le libretto de la première comédie musicale, mise en musique par Vergilio Mazzocchi (fils de Domenico) et Marco Marazzoli : Chi soffre speri. On leur doit l'invention du récitatif quasi parlando qui sera si fréquemment employé dans l'opera-buffa, et qui traduit avec tant de naturel la volubilité du dialogue italien dans les ouvrages de Mozart et Rossini. Ce recitativo secco n'est accompagné que par des tenues, plus tard par des arpèges du clavecin. Chi soffre speri est une œuvre de verve où, dans une scène qui se passe à la foire, promeneurs et marchands dialoguent avec animation. En collaboration avec Antonio-Maria Abbatini, Marazzoli écrivit Dal Male il Bene, représenté également à Rome en 1654, et qui est un véritable opéra-comique, où les finales sont développés comme ils le seront plus tard dans les œuvres légères de Mozart et de Rossini.
Un des plus grands succès de l'opéra des Barberini fut, en 1637, Erminia sul Giordano de Michel-Angelo Rossi, dit « del Violino » et, en effet, violoniste et organiste célèbre. Henry Prunières en a publié des fragments ; la pièce, dit-il, est une succession de très courts tableaux qui ravissent les yeux, occupent l'esprit et laissent à peine le temps au spectateur d'écouter la musique. « Le compositeur laisse passer sans commentaire les fantasmagories du livret. Armide peut invoquer les furies, et les déchaîner sur le camp des chrétiens, une pluie de grêle s'abattre sur la scène, l'enfer s'ouvrir et laisser voir ses démons et ses spectres, l'orchestre se tait. »
C'est en 1641 que Luigi Rossi entre au service du cardinal Antonio Barberini. Chanteur célèbre, compositeur de cantates profanes des plus appréciées, il débute au théâtre en 1642 et applique au drame lyrique le style de la cantate, avec le succès le plus vif, dans Il Palazzo incantato d'Atlante. Très peu de temps après, il donne un oratorio, Giuseppe, figlio di Giacobbe. C'est à Paris, où il suit les Barberini exilés à l'avènement du pape Innocent X, et qui trouvent refuge près de Mazarin, que Luigi Rossi compose son Orfeo représenté à la cour le 2 mars 1647 par toute une troupe italienne et joué jusqu'en mai sans que le succès se ralentisse. On dira plus loin l'influence exercée par ces représentations sur l'art lyrique français. Rossi revint à Rome, puis fut rappelé à Paris par Anne d’Autriche en 1648. Il y demeura pendant la Fronde, suivit ensuite le cardinal Antonio Barberini à Aix-en-Provence, puis à Rome.
Ce qui donne du prix à ses ouvrages, c'est qu'il est un des maîtres harmonistes dont la science n'est guère inférieure à celle de Monteverdi. Mais il est aussi un mélodiste de génie ; ses airs savent exprimer la résonance intime, le sens profond des situations et des paroles. Malheureusement la valeur musicale des opéras de Rossi n'empêche point les livrets d'être faibles, invraisemblables jusqu'à l'extravagance : dans Orfeo, l'abbé Buti ne craint point de montrer Eurydice préférant mourir plutôt que de laisser Aristée arracher de sa jambe le serpent qui la tue. Et cet excès de pudeur n'empêche point l'abbé de faire escorter Aristée le pitoyable d'un joyeux satyre et la douce Eurydice d'une gaillarde nourrice (*) !
(*) Henry PRUNIÈRES, Histoire de la Musique, t. II, p. 52 (Paris, Rieder, 1936).
Bientôt l'opéra et l'oratorio jusque-là confondus, ou du moins les drames profanes et les drames sacrés également représentés au théâtre des Barberini, vont être séparés par le pape Urbain VIII. Ce furent très probablement les moines qui décidèrent le Saint-Père à trancher si nettement les genres : ils gardèrent pour eux les rapprezentazioni spirituali, et le théâtre du pape conserva les ouvrages moins austères, mythologiques et historiques, et les comédies musicales.
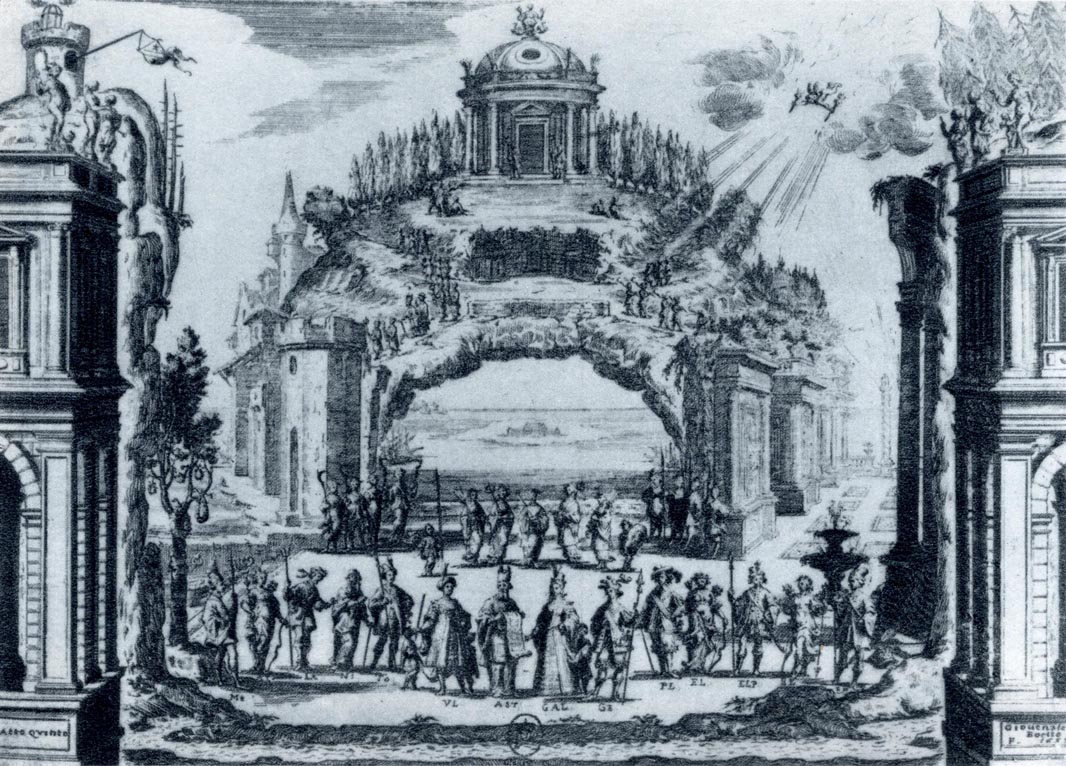
scène d'opéra italien (1655) [gravure de Boetto]
A Venise, pendant ce temps, l'art lyrique ne cessait point d'attirer un public devenu passionné de théâtre. L'année même où Cavalli faisait applaudir son Giasone (1649), Marc'Antonio Cesti débutait avec l'Orontea pendant le carnaval et remportait pour son coup d'essai un véritable triomphe. Il venait de Florence et de Rome ; religieux franciscain, il était, après avoir travaillé avec Abbatini, devenu maître de chapelle de son couvent de Volterra. A Rome il connut sans doute Luigi Rossi. Il fut bientôt, selon le mot de son ami Salvator Rosa, « la gloire et splendeur des scènes profanes » ; mais en même temps, il cessa d'être le Padre Cesti pour devenir Il Signor cavaliere Cesti. Non sans quelque scandale, il se débarrassa de son froc. Il écrit en 1651 l'Alessandro vincitor di se stesso (selon Prunières, mais que les musicographes s'accordent ordinairement à attribuer à Cavalli, aîné et rival de Cesti), et, la même année, Cesare amante. Son succès grandit ; l'archiduc Ferdinand le fait venir à Innsbruck où, en 1655, il donne Argia en présence de la reine Christine de Suède ; l'ouvrage sera repris à Venise en 1669, et y triomphera d'autant plus que, dans l'intervalle, la renommée de Cesti aura grandi encore avec Dori, donnée à Florence en 1661 pour les noces de Côme de Médicis et de Marguerite-Louise d'Orléans, puis reprise à Venise deux ans plus tard. C'est encore à Innsbruck, en 1662, la Magnanimità d'Alessandro, c'est, à Rome, où, bien qu'il soit défroqué, le pape l'a appelé à la chapelle Sixtine, Alessandro vincitor di se stesso ; c'est à Venise, Tito en 1666 ; c'est, à Vienne où il trouve, heureusement, une place de Vice-Kapellmeister à la cour impériale, car sa vie scandaleuse lui a valu d'être bâtonné à Venise, Nettuno e Flora festiggianti, en 1666. Et c'est, l'année suivante, pour les noces de l'empereur Léopold Ier et de Marguerite d'Espagne, Il Pomo d'Oro ; c'est enfin la même année, et à Vienne aussi, le Disgrazie d'Aurore et la Schiava fortunata. Puis, il revient à Venise, repart pour Florence où il meurt empoisonné le 14 octobre 1669 : fin dramatique d'une existence étrangement agitée.

scène d'Il Pomo d'Oro, opéra de Cesti (1667) [gravure de Kussel]
Ce que Cesti apporta tient à la finesse de son esprit en même temps qu'à sa grande culture musicale. Il a le sens inné de la mélodie à laquelle il donne naturellement une suavité et une pureté que renforcent ses trouvailles harmoniques. Henry Prunières remarque qu'il est venu au point culminant de la carrière de Cavalli, comme Racine lorsqu'il menaça la gloire de Corneille. Il a, beaucoup plus que son rival, contribué à faire évoluer l'aria vers la mélodie pure, équilibrée. Mais ses voyages, mais ses tribulations, l'ont en quelque sorte déraciné, et ses œuvres portent sans doute la marque du désordre de sa vie : elles lui doivent des qualités, du pittoresque, mais aussi un mélange d'influences diverses, que son art sait fondre en un tout quand même personnel.
Giovanni Legrenzi, maître de chapelle de Saint-Marc, puis directeur du Conservatoire dei Mendicanti, exerça par son enseignement une influence considérable : il fut le maître de Lotti et de Gasparrini. On lui doit une vingtaine d'opéras (Achille in Sciro, 1664 ; Zenobia, Creso, Eteocle e Polinice, etc.), mais dont beaucoup sont perdus. Ce qui en reste a permis de connaître qu'il perfectionna l'aria da capo dont il fit un emploi systématique.
Il serait tout à fait vain de classer par écoles — florentine, vénitienne, romaine et bientôt aussi napolitaine — les œuvres lyriques italiennes du XVIIe siècle : l'opéra tend à devenir, et il est déjà un genre universel : les meilleurs musiciens passent d'une ville à une autre, d'Italie en France et en Autriche. Certes, les tempéraments individuels lui impriment leur marque, et les mœurs, l'esprit des diverses races s'y reflètent dans la musique tout comme dans les œuvres littéraires ; mais les formes sont déjà fixées ; et jusqu'au XIXe siècle elles ne subiront plus que des changements de détail.
Stradella est Napolitain ; il naît en 1645, et il meurt assassiné à Gênes vers 1684 après des aventures amoureuses qui en ont fait le héros de deux opéras, l'un de Flotow, l'autre de Niedermeyer ; il s'était épris d'une chanteuse, son élève, maîtresse d'un noble Vénitien — car Alessandro Stradella s'était lui aussi fixé un temps à Venise pour faire jouer ses opéras. Une première fois il parvint à fuir avec son amie, et vint avec elle à Rome où le jaloux le poursuivit et tenta de l'assassiner. Il s'échappa encore, fut rejoint à Turin, où son rival le blessa. Deux ans plus tard, à Gênes, il tombait sous les coups du Vénitien. Ses oratorios (San Giovanni Battista, Ester, Santa Pelagia, San Giovanni Crisostomo), ses opéras (Biante, Corispero, Floridora, Orazio Cocle, Trespolo tutore) ont été joués au hasard de sa vie errante. Ils ne nous sont parvenus qu'en manuscrits ; c'est surtout dans ses cantates qu'il excelle, et ses dons mélodiques y font merveille. Dans la Forza dell’amore paterno, représenté à Gênes en 1678, Alberto Gentili a signalé que l'ouverture est construite en deux parties, dont le premier thème est emprunté à l'air d'Antiochus qui commence la pièce. Cet usage, inauguré par Cesti dans Pomo d'Oro, et selon lequel l'ouverture expose un ou plusieurs thèmes de l'ouvrage, se généralisera avec Alessandro Scarlatti.
Le véritable fondateur de l'école napolitaine est Francesco Provenzale (1610-1704) dont les ouvrages furent tous créés à Naples. Il y débuta en 1653 avec Ciro, donna en 1658 un Teseo et produisit une dizaine d'opéras dont deux nous sont parvenus, Stellidaura vendicata et Lo Schiavo di sua moglie. Il y a déjà chez cet habile musicien un compositeur bouffe qui devance les maîtres des XVIIIe et XIXe siècles.
C'est que déjà le public n'a plus guère souci que d'entendre de belles voix dans de beaux airs, fabriqués pour faire valoir le talent des interprètes :
Ce qui compte, écrit Henry Prunières, c'est le talent du virtuose et la façon dont il fait valoir les airs. Tout artiste tient ainsi en réserve un certain nombre d'arie di baule (*), à toutes fins. Nul ne s'étonne de cette façon d'agir, car on ne s'intéresse plus à ce qui se passe en scène. Comment d'ailleurs s'y reconnaître ? Ce ne sont que castrats habillés en femmes, que cantatrices en travesti. Un moine, le R. P. Dom Filippo Melani, vint à Paris en 1660 chanter dans le Xercès de Cavalli le rôle de la reine Amestris, amoureuse du roi de Perse et déguisée en homme ! Le public renonce à discerner si tel castrat figure un homme ou une femme, il ne se formalise pas de voir César ou Pompée figuré par un eunuque ! A Naples, on laisse parfois les cantatrices tenir les emplois d'homme, car on ne goûte guère que les voix du registre élevé. Cependant dans les partitions du temps, on ne remarque pas encore de notes aiguës. Les chanteurs les plaçaient à leur convenance en brodant les reprises des arie da capo. L'art de cette époque est tout imprégné de sensualité et la voix prime tout. Les musiciens excellent à faire ressortir les effets vocaux par le contre-chant d'un instrument soliste, violon, cornet, flûte, hautbois, trompette. Le reste de l'orchestre, composé d'un petit nombre d'instruments à cordes se borne à accompagner le plus discrètement possible.
(*) Baule = malle : airs que le chanteur tire de son bagage pour les placer n'importe où ils peuvent plaire. (Cf. Henry PRUNIÈRES, Histoire de la Musique, t. II, p. 67.)
L'opéra va être ainsi durant tout le XVIIIe siècle, du moins partout où l'opéra français ne maintiendra pas ses positions.
Car si la réforme florentine avait été, selon le mot de Romain Rolland, une réaction de simplicité et de clarté, pareille aux réactions de la Renaissance dans les autres domaines de l'art, réaction nécessaire puisque la complication et l'obscurité croissantes menaçaient de mort la polyphonie, sans doute le mouvement des humanistes avait-il dépassé le but qu'ils souhaitaient atteindre en croyant remonter aux sources du drame antique. Aux fioritures excessives des madrigalistes, à la bizarrerie de leurs inventions purement formelles et étrangères à l'art, se substituent bientôt d'autres singularités que le bon goût ne règle pas davantage, et dont on vient de donner quelques exemples. Cependant, à travers ces excès, dont le pire tient aux exigences des chanteurs, l'harmonie progresse et l'orchestre se développe. L'art lyrique est tout près d'atteindre ce point d'équilibre que lui donneront les chefs-d’œuvre de Rameau et de Mozart.
L'OPÉRA FRANÇAIS AU XVIIe SIÈCLE
LULLY ET SES CONTEMPORAINS
La politique eut une influence décisive sur l'évolution de l'art lyrique français : le cardinal Mazarin, succédant à Richelieu, demeura premier ministre de 1643 à 1661 ; pendant la dernière année du règne de Louis XIII, durant la minorité et les dix premières années du règne personnel de Louis XIV, rien ne se fit qu'il ne le voulût. Élevé à Rome, il avait chanté à l'Oratoire de saint Philippe de Néri les rappresentazioni et pris part aux fêtes de la canonisation de saint Ignace de Loyola en 1622 ; il gardait pour la musique un goût très vif. Lorsque les Barberini durent quitter l'Italie à la mort du pape Urbain VII en 1644, Mazarin les accueillit en France, où ceux-ci devinrent de véritables ambassadeurs de la musique italienne. Le cardinal Antonio Barberini se chargea de faire venir les meilleurs compositeurs et interprètes qui avaient paru sur le théâtre à Rome : Marco Marazzoli et la cantatrice Leonora Baroni, de 1643 à 1645, Atto Melani, en 1644, Luigi Rossi en 1646-1647, puis en 1648-1649, Carlo Caproli en 1654, parurent ainsi devant la cour. En 1645, on y représenta la Finta pazza de Sacrati ; l'année suivante, l'Egisto de Cavalli ; en 1647, Luigi Rossi, accompagné des plus grands chanteurs de la péninsule, fit représenter son Orfeo. Vint la Fronde : le premier ministre eut d'autres soucis plus pressants ; mais lorsque la bourrasque fut passée, il poursuivit son dessein, et, en 1654, il fit représenter les Nozze di Peleo e di Teti, de Carlo Caproli avec des ballets. Le succès en fut vif. Quand fut conclu le traité des Pyrénées, renforcé par le mariage du jeune Louis XIV avec l'Infante d'Espagne Marie-Thérèse, en 1659, Mazarin fit venir de Venise Francesco Cavalli pour monter, au Louvre, le 22 novembre 1660, son Serse, puis, dans la salle des Tuileries, le 7 février 1662, son Ercole Amante remanié pour la circonstance. Cavalli fut victime d'une cabale — à laquelle Lully, comme on le verra plus loin, ne fut point étranger. Mazarin d'ailleurs, était mort peu auparavant, et le public, indisposé par la langue italienne qu'il ne comprenait pas, ne cacha guère son impatience, s'intéressant à la mise en scène, aux magnifiques décors, à la splendeur des costumes, bien plus qu'à la musique. Mais celle-ci ne pouvait manquer d'être remarquée des musiciens, et Jean-Baptiste Lully allait tirer bientôt un merveilleux parti des enseignements recueillis pendant les spectacles auxquels il prenait part.
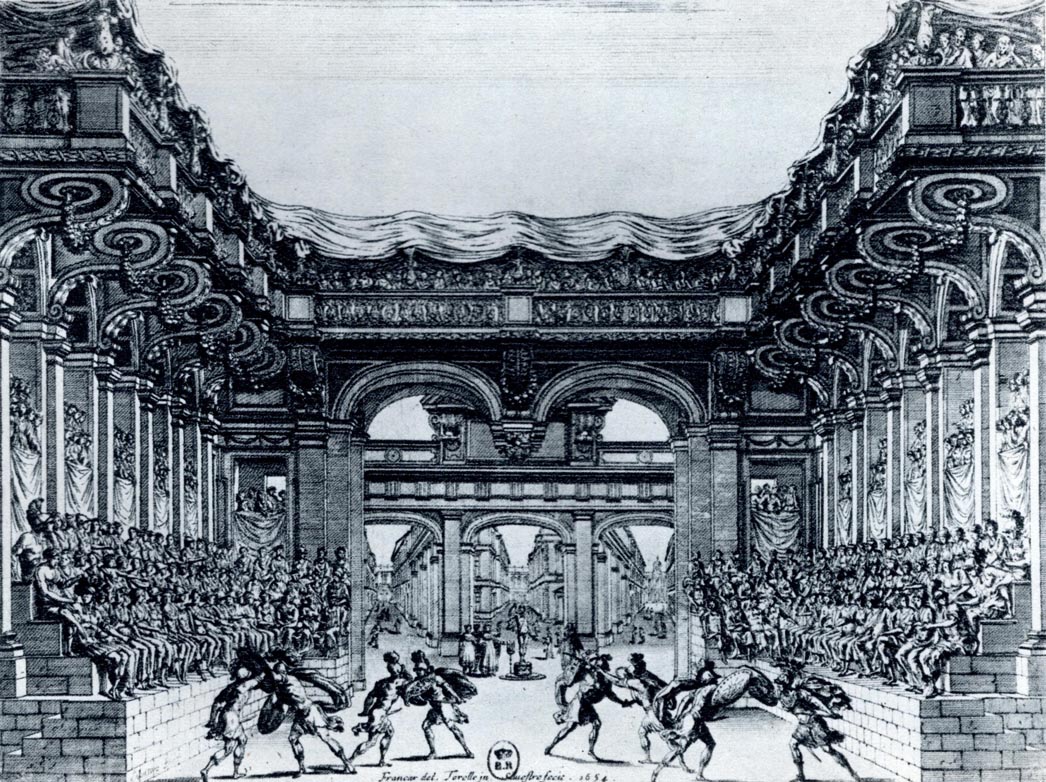
décor de Torelli pour les Noces de Thétis, opéra de Caproli (1654) [gravure de Silvestre]
Tandis qu'ils se déroulaient et que Mazarin révélait aux Français les beautés de la musique italienne et les splendeurs de l'opéra, ceux-ci ne demeuraient point improductifs. Ils écrivaient des musiques de scène pour des comédies utilisant les machines — à l'instar des Italiens — ils composaient des pastorales, et, naturellement aussi, des ballets. Ainsi l'Andromède de Corneille fut jouée au Petit-Bourbon en 1650, avec des intermèdes musicaux de Charles d'Assoucy. Celui-ci composa la même année une comédie musicale les Amours d'Apollon et de Daphné, dont on ne sait si elle fut jouée, mais qui est un des premiers essais d'opéra français mêlé de chant et de parlé, précédant de quatre ans l'ouvrage de Michel de La Guerre : le Triomphe de l'Amour.

scène d'Andromède, tragédie de Corneille, musique de C. d'Assoucy (1651) (les mêmes décors avaient servi pour l'Orfeo de Rossi en 1647) [gravure de F. Chauveau]
Comme Guesdron et Antoine Boësset (qui appartiennent d'ailleurs à la génération précédente), Michel de La Guerre s'efforce, dans sa pastorale le Triomphe de l'Amour sur les bergers et les bergères, composée sur un livret de Charles Beys, et chantée en concert devant le roi le 22 janvier 1655, donnée de nouveau à la cour et cette fois sur un théâtre, le 26 mars 1657, de demeurer fidèle à la tradition française. Son petit opéra est une « comédie de chansons », malheureusement perdue, mais dont on sait du moins qu'elle obtint un vif succès devant le public.
Malgré cela, le poète Pierre Perrin, auteur du livret de la Muette ingratte, mis en musique par Robert Cambert, n'hésite pas à s'attribuer le mérite d'avoir « inventé » le genre, imité, avoue-t-il, des « comédies en musique comme on en fait en Italie ». Il n'est pas douteux que Cambert ait assisté aux représentations des ouvrages de Caproli et de Rossi. Mais, peut-être parce qu'il se défie de lui-même, il ne se hasarde point à écrire des récitatifs, et d'accord avec son librettiste, il remplace ceux-ci par des airs alternés. Le sous-titre de la Muette ingratte en fait d'ailleurs l'aveu, qui définit l'ouvrage une « élégie à trois voix en forme de dialogue ». Avec le même librettiste Cambert écrit la Pastorale d'Issy, qui doit son titre à ce qu'elle fut représentée par des amateurs en avril et mai 1659 au château d'Issy, maison de campagne du riche orfèvre parisien de La Haye. Son succès fut tel que la Pastorale parut à Vincennes, en présence de la cour. Dans son avant-propos, Perrin déclare : « Le dessein de l'Autheur de cette pièce est d'essayer si la comédie en musique peut réussir sur le théâtre françois, estant réduite aux lois de la bonne musique et au goût de la nation et ornée de toutes les beautés dont est capable cette espèce de représentation. » Mazarin l'entendit, et, aussitôt, encouragea Cambert et son librettiste à composer un opéra en cinq actes et un prologue, Ariane ou le Mariage de Bacchus qui serait représenté aux fêtes du mariage de Louis XIV. Mais le projet fut abandonné, et, comme on sait, Cavalli fut mandé. La raison en fut sans doute, estime Combarieu, qu'il était impossible à cette époque de trouver à Paris des acteurs capables de jouer et de chanter un opéra, et que la Pastorale avait dû être confiée à des amateurs faute de chanteurs professionnels. Quoi qu'il en soit, on ignore si Cambert avait écrit quelques fragments de sa partition. Rien ne nous en est parvenu. On n'a rien non plus de la Mort d'Adonis d'Antoine Boësset le fils, écrite sur un livret de Perrin ; mais on sait, par les airs de cour du même compositeur, publiés dans le recueil de Ballard, que son style est tout voisin de celui de son rival heureux, Lully.

affiche de théâtre en 1658 [Archives de l'Opéra]
Le roi voulut entendre quelques fragments de la Mort d'Adonis et les fit chanter par sa chapelle à son petit coucher. Au dire de Perrin, il y prit plaisir, et les défendit contre la cabale « qui taschoit de l'abismer par des motifs particuliers d'intérest et de passion ». Le fait est que l'auteur ne se découragea point, et poursuivit obstinément son dessein de créer la comédie en musique. Il finit par obtenir la protection de Colbert et lui présente un Recueil de Paroles de musique, qu'il vient de publier en 1667, pour les concerts de la reine. A ces chansons, sérénades, airs à boire, il a joint des ballets, et aussi des comédies : le Ballet des Faux Roys, le Mariage du Roy Guillemot ; dans la préface, il demande la création à Paris d'une Académie de poésie et de musique, fait valoir « la gloire qu'il y aurait pour le Roy à ne pas souffrir qu'une nation partout ailleurs victorieuse soit vaincue par les étrangers en la connaissance de ces deux beaux arts, la Poésie et la Musique » ; il insiste sur ce que la compagnie devrait être composée de poètes et de musiciens « ou, s'il se pouvait, de poètes-musiciens qui s'appliquassent à ce travail, ce qui ne serait d'un petit avantage au public, ni peu glorieux à la nation (*) ». Il fait si bien que Colbert accueille favorablement la supplique et obtient de Louis XIV, le 28 juin 1669, le privilège octroyant à Perrin « la permission d'établir en sa bonne ville de Paris et autres du royaume, une Académie composée de tel nombre et qualité de personnes qu'il avisera pour y représenter et faire chanter en public des opéras et représentations en musique et en vers français pareilles et semblables à celles d'Italie, et pour dédommager l'exposant des grands frais qu'il conviendra faire pour les dites représentations, tant pour les théâtres, machines, décorations, habits et autres choses nécessaires, lui permettant de prendre du public telle somme qu'il avisera ». Le privilège était accordé pour douze ans et étendu à tout le royaume, à peine, pour ceux qui ouvriraient des théâtres concurrents, de payer dix mille livres d'amende et de voir confisquer théâtres, machines et habits. Il spécifiait en outre que tous gentilshommes, damoiselles et autres personnes pouvaient chanter audit Opéra sans que pour cela ils dérogent au titre de noblesse, ni à leurs privilèges, charges, droits et immunités. Cette clause montre en quelle haute estime était tenue l'entreprise.
(*) Cf. COMBARIEU, Histoire de la Musique, t. II, pp. 79 et sq.
Perrin prit Cambert pour associé, et fit aussitôt construire une salle à l'emplacement du Jeu de Paume, rues de Seine et des Fossés de Nesle. Mais il eut l'imprudence de s'adjoindre deux autres associés, Champeron et un gentilhomme, Sourdéac, deux aventuriers. Ils s'engagèrent par-devant notaire, en décembre 1669, à fournir les fonds nécessaires. Ils n'en possédaient pas le premier sou. Cependant, pressé de débuter, Cambert, chef d'orchestre du théâtre, faisait répéter une Ariane, composée sur un livret de Perrin, tandis que Monier, un des artistes déjà engagés, parcourait le midi de la France pour y recruter des chanteurs et composer la troupe. Sourdéac rompit l'engagement qui le liait à ses associés, mais ne continua pas moins à leur promettre des fonds. On abandonna Ariane, et l'on mit en répétitions Pomone qui put être jouée le 12 juin 1670 à Sèvres dans la maison de campagne de Sourdéac. Mais cette répétition générale — que, peut-être par prudence, on avait donnée dans le privé en attendant les fonds qui n'arrivaient toujours pas — fut comme le signal de réclamations bientôt changées en procès par des créanciers impayés, des artistes congédiés. Pomone put cependant être jouée dans la salle de l'Académie le 3 mars 1671. C'était un opéra pastoral en cinq actes et un prologue. Le succès fut assez grand, mais point suffisant pour permettre à l'entreprise de résister aux assauts des créanciers. On avait pourtant réduit les frais ; Sourdéac et Champeron, assis à la porte, tête nue et en manches de chemise, recevaient eux-mêmes le prix des entrées, pesant les louis au trébuchet, et les enfouissant dans leurs poches. Sans doute trop bien, puisque le pauvre Perrin ne pouvant plus obtenir de « lettres de répit », fut emprisonné pour dettes à la Conciergerie en juin 1671. Il vendit tous ses droits, parts et portions, dans le privilège au musicien Jean Granouillet de Sablières, par acte « passé entre deux guichets de la prison ». Malgré cela — rapporte Combarieu — il commit la faute grave de vouloir désintéresser un créancier avec « ce qui lui appartenait par le privilège de l'Opéra ». Et mal lui en prit.
Cambert se vit préférer Guichard par Sablières, et demeura victime des filouteries de Sourdéac et Champeron. Ceux-ci avaient commandé à Gilbert le poème du second ouvrage que l'Académie représenta en février 1672, et Cambert, bien que déjà fort mal avec eux, l'avait mis en musique. Les Peines et Plaisirs de l'Amour, en cinq actes et un prologue, furent représentés en février 1672. Cambert plaida contre Sourdéac, après que, par autorité royale, l'Académie fut fermée le 1er avril, en attendant que Lully en obtînt le privilège. Il se réfugia bientôt en Angleterre, fut bien accueilli par Charles II, fonda une Académie sur le modèle de celle de Paris et y fit jouer son Ariane remaniée en 1674, puis les Peines et Plaisirs de l'Amour et Pomone. La malchance le poursuivit. Il mourut à Londres, assassiné par son domestique au printemps de 1677.
En ces circonstances, commença le règne de Lully
qui allait durer jusqu'à sa mort, en 1687, soit quinze ans ; mais en fait, on a
pu dire non sans raison que Lully continua de régner sur l'Opéra longtemps même
après qu'il n'y fut plus.
On ne reviendra pas ici sur ses débuts, sur les détails biographiques qui ont
été donnés dans l'Histoire de la Musique. Il suffit de rappeler que Lully
arrivait à son heure, et que cette heure, il avait su la hâter, flattant
habilement les goûts du jeune Louis XIV pour la danse et les spectacles, gagnant
les faveurs de ceux qui pouvaient le servir, usant de tous les moyens pour faire
valoir ses talents dont nul d'ailleurs ne pouvait contester qu'ils fussent
grands. Excellent violoniste, musicien accompli, il avait « pendu au croc » son
instrument lorsqu'il prit la direction de l'Académie. Il ne l'en tira que fort
rarement, se donnant tout entier à sa tâche (*).
(*) Romain ROLLAND, dans ses Notes sur Lully (Musiciens d'autrefois, Hachette, p. 119), rapporte que le maréchal de Grammont fut le seul qui trouvât le moyen de l'en faire jouer de temps en temps.
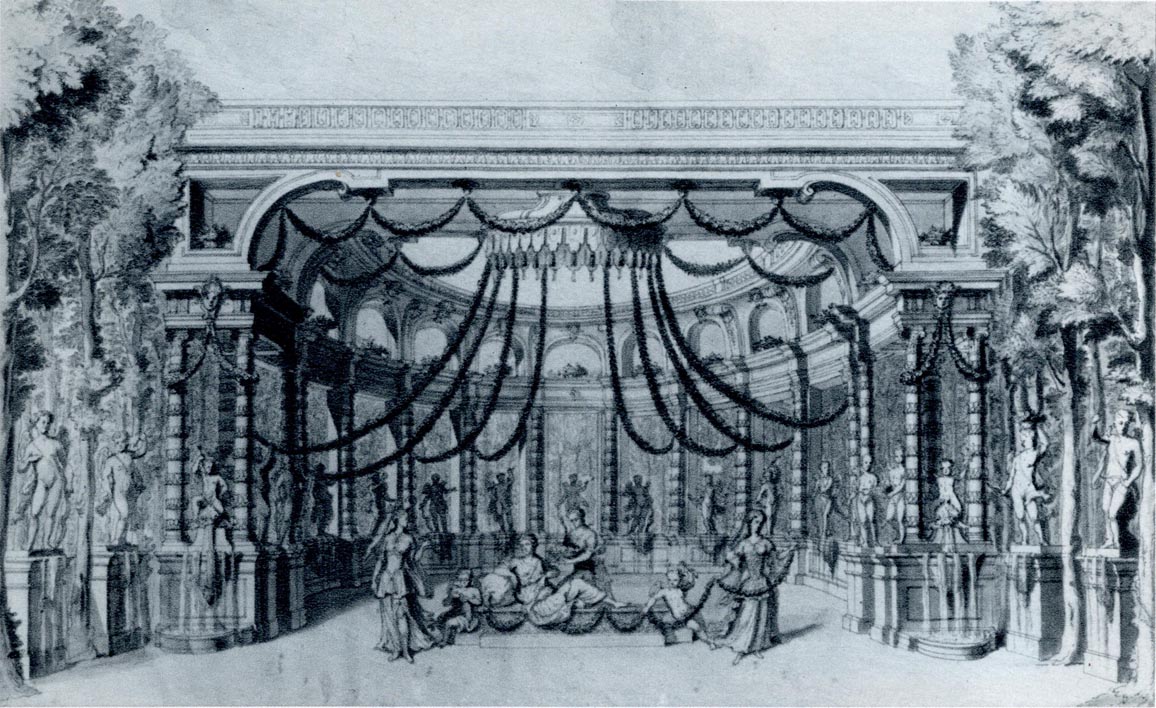
décor de Psyché, tragédie-ballet de Molière, Corneille et Quinault, musique de Lulli (1671) [gravure du XVIIe siècle]
Il y était fort bien préparé : il avait composé la musique de nombreux divertissements, dansé avec le roi dans une quarantaine de ballets. Improvisateur jamais à court d'idées, il était depuis 1661 surintendant de la musique de la Chambre royale. Le 30 mars 1672, M. de La Reynie, lieutenant de police du royaume, recevait l'ordre de faire cesser les représentations de Perrin — dont Lully avait racheté le privilège en février — et le même jour celui-ci lui succédait. Le nouveau privilège célèbre ses mérites :
Le roi, ayant été informé que les peines et les soins que le sieur Perrin avait pris pour l'Académie de musique n'ont pu seconder pleinement son intention et élever la musique au point qu'il s'en était promis, a cru que pour y mieux réussir, il était à propos d'en donner la conduite à une personne dont l'expérience et la capacité lui fussent connues et qui eût assez de suffisance pour former des élèves, tant pour bien chanter et jouer sur le théâtre que dresser des bandes de violons, flûtes et autres instruments, à ces causes, bien informé de l'intelligence et grande connaissance que s'est acquise son cher et bien-aimé Jean-Baptiste Lully, au fait de la musique dont il lui a été donné et donne journellement de très agréables preuves, depuis plusieurs années qu'il est à son service...
Tels sont les termes de l'ordonnance royale qui donne Lully pour successeur à Perrin.
Lully était d'ailleurs si sûr de l'événement qu'il avait fait commencer la construction d'un nouveau théâtre par Charles Vigarani, décorateur de la cour, et qu'il se l'était associé. La salle allait s'élever dans un autre jeu de paume, rue de Vaugirard, près du palais d'Orléans (aujourd'hui palais du Luxembourg). Tout était prêt, et l'on ouvrit le 15 novembre 1672, avec les Fêtes de Bacchus et de l'Amour (pastiche formé de scènes de ses ballets et comédies-ballets : la Princesse d'Elide, Ballet des Muses, George Dandin, les Amants magnifiques, le Bourgeois gentilhomme, etc.) et qui fut repris aux fêtes de Versailles en 1674. Son premier opéra — qui, cette fois, n'était plus une sorte de pot-pourri — Cadmus et Hermione fut donné le 27 avril 1673. Le livret était de Quinault dont Lully avait fait la connaissance grâce à Molière, ce qui fut pour lui une très heureuse fortune.
Car si accréditée que soit l'opinion qu'on peut faire une bonne musique sur un mauvais livret, il n'en demeure pas moins vrai que c'est dans le sujet proposé par son librettiste, dans l'agencement des scènes, dans le développement des passions et dans le dialogue qui les exprime que le musicien trouve l'inspiration. La platitude des livrets de Pellegrin pèsera lourdement sur l'avenir des opéras de Rameau, comme plus tard, au XIXe siècle, Chabrier sera victime de l'insuffisance de ses livrets. Philippe Quinault a mérité le bel éloge qu'en fit Herder : « Il a des passages aussi forts que ceux de Corneille et Racine dans les formes qu'ils ont cultivées ; par ses récitatifs aussi bien que par ses chœurs, il a éveillé le sens de la musique chez les Français ; on trouve dans ses pièces la même clarté d'exposition, la même ordonnance, la même logique des scènes, la même tenue que chez les grands tragiques. »
Il est sûr que Lully sut être habile et défendre ses intérêts sans beaucoup de scrupules. Mais il est non moins certain qu'en lui faisant confiance Louis XIV sauva l'Opéra qu'il venait d'instituer. Lully fut un excellent administrateur ; l'Académie de musique lui doit le prestige qui lui permit de traverser toutes les tourmentes, de survivre à tous les régimes et de durer encore aujourd'hui.
Mais ce ne fut point seulement en montrant ses capacités administratives que Lully rendit service à la musique. Soigneux du travail des répétitions, capable de diriger mieux qu'aucun autre, il sut encore donner le goût de l'opéra à un peuple qui jusqu'alors préférait la chanson. Assurément il fut, comme tous les hommes dont la volonté reste tendue vers un seul objet, d'un caractère peu maniable, volontiers même tyrannique. Il ne toléra guère les rivaux, surtout ceux dont le talent lui portait ombrage. Sa vie privée, jusqu'à son mariage, et même après, donna lieu à bien des critiques. Ses ennemis n'ont pas manqué de la juger sans indulgence. Mais ce qui nous importe, en définitive, c'est l'influence qu'il a exercée sur l'art lyrique français, et nul ne peut contester qu'elle ait été décisive.
On n'énumérera point les quelque trente ouvrages qu'il a laissés et qui furent représentés tantôt à la cour, tantôt à l'Opéra, dans ses salles successives. Car aussitôt après Cadmus et Hermione, le théâtre se transporta au Palais-Royal qui lui fut attribué à la mort de Molière (17 février 1673) ; il allait y demeurer un siècle.
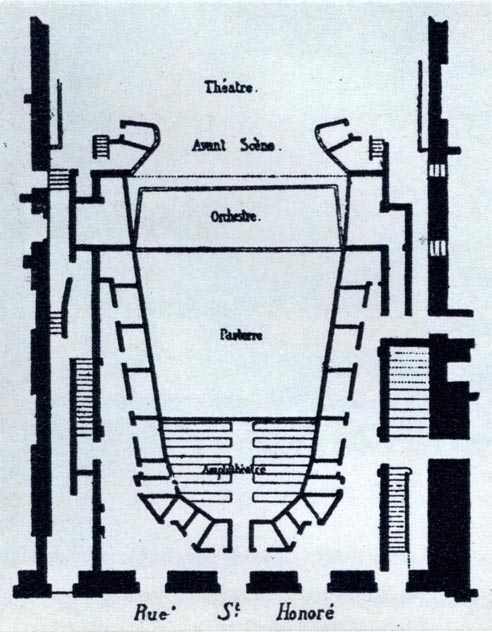
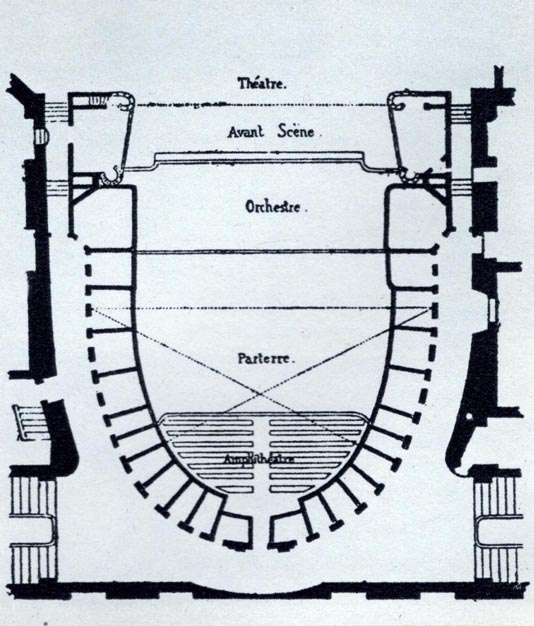
première salle du Palais-Royal à Paris [à gauche] dans laquelle s'installa Lully et qui fut détruite par l'incendie en 1763. - deuxième salle du Palais-Royal [à droite] qui brûla à son tour en 1781
C'est là que furent créés Alceste, le 11 janvier 1674 ; Thésée, le 11 janvier 1675 ; Atys, le 10 janvier 1676 ; Isis, le 5 janvier 1677; ces quatre opéras en cinq actes et un prologue sur des livrets de Quinault. Tous furent repris au cours des saisons suivantes. Psyché, tragédie en musique, en cinq actes et un prologue, créée le 19 avril 1679, était de Thomas Corneille et Fontenelle pour le livret, ainsi que Bellérophon, cinq actes et un prologue, créé le 31 janvier 1679. A Quinault, Lully dut encore : Proserpine, créée le 15 novembre 1680 ; Persée (18 avril 1682) ; Phaéton, créé d'abord à Versailles, le 6 janvier 1683, repris à l'Opéra le 27 avril de la même année ; Amadis, 18 janvier 1684 ; Roland, le 18 janvier 1685 ; Armide, le 15 février 1686 ; tous ces ouvrages également en cinq actes et un prologue. La pastorale héroïque Acis et Galathée, en trois actes et un prologue, sur des paroles de Campistron, créée à Anet le 6 septembre 1686, entra au répertoire de l'Opéra quelques jours plus tard. Enfin Achille et Polyxène, en cinq actes et un prologue, sur un livret de Campistron, fut terminé par Pascal Colasse, le premier acte seul ayant pu être achevé par Lully dont la mort survint le 22 mars 1687 ; l'ouvrage fut créé le 7 novembre et cette même année l'Opéra reprit l'Ariane de Cambert.

scène de Thésée, opéra de Lulli (1675) [dessin d'après F. Chauveau]

scène de Roland, opéra de Lulli (1685) [dessin d'après Bérain]
Comme cette liste le montre, aucun autre ouvrage ne fut reçu à l'Opéra sous le « règne » de Lully qu'il n'en fût lui-même l'auteur.
A cette production considérable, il faut naturellement ajouter les ballets de cour, les comédies-ballets et les pastorales qui le firent collaborer principalement avec Molière, avec Benserade, et Quinault. Quant aux musiciens auxquels il eut recours, il est aussi difficile d'en établir la liste que de déterminer exactement ce que leur doivent les partitions. On ne possède aucun autographe musical de Lully. On ne saurait en déduire que la musique des ouvrages qu'il signa n'est pas de lui. Sa méthode de travail est connue : il s'asseyait au clavecin, déclamait les scènes qu'il devait mettre en musique, essayait les airs en les chantonnant et en jouant, tout en se bourrant le nez de tabac. Il dictait à ses secrétaires Lallouette ou Colasse, auxquels il abandonnait d'ailleurs la confection des parties intermédiaires — au dire de Lecerf de la Viéville. On a pu comparer sa manière de procéder à celle de certains peintres dont l' « atelier » collabora grandement à la production du maître, mais sous sa direction, sous sa surveillance. Rien ne nous dira sans doute jamais quelle fut la part exacte de Colasse, par exemple, dans ce travail. Tout ce que nous savons de façon sûre (mais qui aggrave nos doutes) c'est que Colasse n'était point indigne de la confiance que Lully lui donnait, car les œuvres qu'il a signées de son nom témoignent de son mérite. Ce fut à lui que Lully confia la direction de l'orchestre de l'Opéra et, à ce poste encore, il mérita sa confiance. Gervais et Marais furent aussi de bons musiciens, mais sans grande originalité. D'autre part l'égoïsme et le despotisme de Lully étouffèrent ceux qui auraient pu devenir ses rivaux.
Du point de vue technique, on doit à Lully non point la création (comme on l'a trop dit) de l'ouverture française, mais son perfectionnement. Elle se compose définitivement avec lui d'un mouvement lent, ordinairement sur une mesure binaire, auquel succède un mouvement vif, presque toujours à trois temps, et qui est le plus souvent fugué. Son orchestre s'enrichit et comprend : premier et deuxième dessus de violon ; quinton (alto) ; premier et second dessus de flûte ; premier et second dessus de hautbois, basson, trompettes (quelquefois), trompes de chasse et timbales. La basse continue est réalisée au clavecin et par des théorbes.
Son style vocal est plus simple que celui des compositeurs italiens de son temps. On a dit qu'il avait étudié la déclamation de la Champmeslé, interprète ordinaire des tragédies de Racine, et calqué sa prosodie sur la diction de la comédienne. Cela n'est pas certain, mais c'est possible, sinon même probable. Qu'il l'ait fait ou non, c'est le récitatif qui constitue l'élément essentiel, fondamental de son style. Lecerf de la Viéville le déclare « presque parfait » et remarque qu'il « tient le juste milieu entre le parler ordinaire et la musique ». Ses contemporains le jugent presque tous naturel et simple, et le P. André, dans son Essai sur le Beau, le loue de suivre pas à pas la nature. Mais un siècle plus tard, Jean-Jacques Rousseau ne lui ménagera pas les plus sévères reproches. Il le blâme de son « extravagante criaillerie qui passe à chaque instant de bas en haut et de haut en bas, dans la langue française dont l'accent est si uni, si simple, si peu chantant ». Nous ne savons pas comment prononçaient, comment disaient les tragédiens au grand siècle : verba volant ; mais il y a tout lieu de croire fort emphatique leur diction. Le récitatif de Lully reproduit presque constamment ce « ronron » de la tragédie, cette monotone suite d'anapestes, de dactyles, ou de péons :
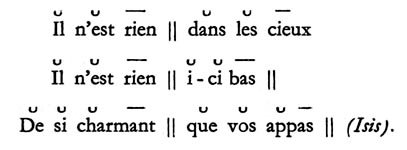
On pourrait multiplier les exemples, cela est vrai. Mais on pourrait citer aussi bien des pages où Lully introduit tout à coup dans le récitatif des accents profondément humains, traduit la mélancolie, la passion, et Romain Rolland, dans ses Musiciens d'autrefois, dit très justement qu'alors « sa musique reflète l'émotion d'une façon transparente ». Mais ces instants où l'accent dramatique l'emporte sur le « ronron » du vers tragique sont assez rares. Ordinairement, c'est la première phrase de l'air qui révèle ces trouvailles fort belles ; la suite ramène presque toujours la symétrie.
Sa froideur sait cependant s'animer. Il montre de l'esprit dans les passages comiques ; et il sait tout aussi bien trouver des accents mystérieux, comme dans le nocturne du Triomphe de l'Amour, comme dans le sommeil d'Atys, un chef-d’œuvre de simplicité et de justesse :
Doucement, flûtes et violons, soutenus par de tranquilles harmonies, dessinent de petits mouvements onduleux de noires liées de deux en deux, après quoi les flûtes à la tierce déploient de souples festons. Dans toutes les parties, la sonorité s'écoule d'un mouvement continu, sans effort, et c'est une sorte d'anéantissement très doux, et qu'on retrouve dans le sommeil des Gorgones, de Persée, dans le sommeil de Protée, de Phaéton, et dans les « sourdines » d'Armide. La symphonie erre à l'abandon, mince, ténue, comme en rêve (*).
(*) Lionel de la LAURENCIE, Lully, Alcan, les Maîtres de la Musique, 1911, p. 209-210.
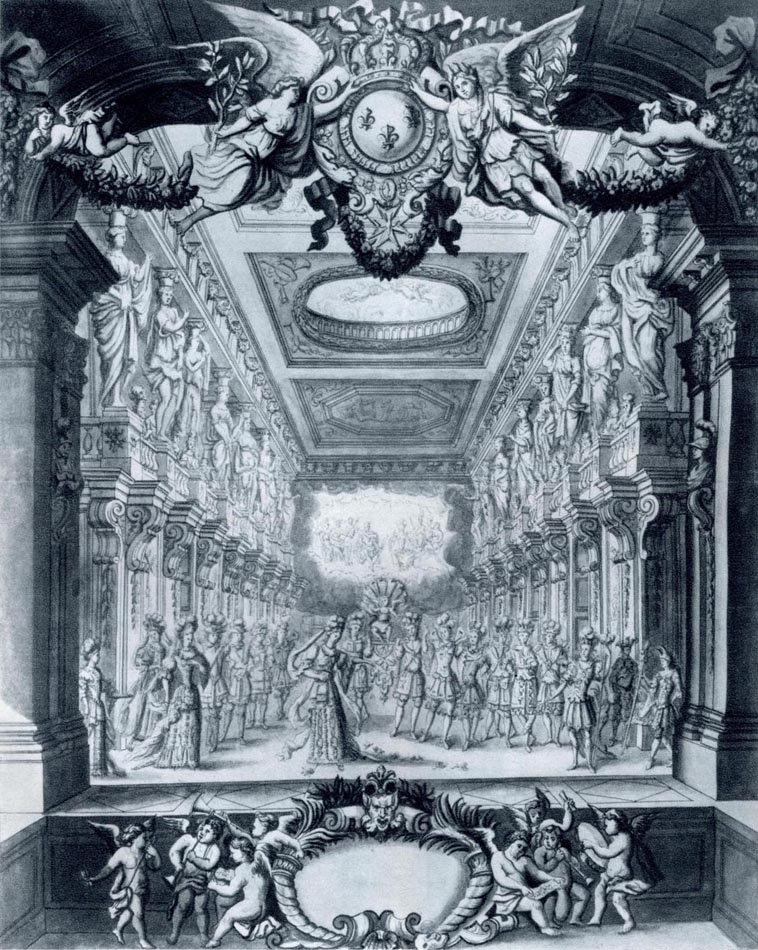
scène du Triomphe de l'Amour de Lulli (1681) [dessin attribué à F. Chauveau]
Il ne réussit pas moins les marches guerrières, les combats, et le premier acte de Thésée en offre un exemple fameux. Sa réputation dans ce genre est grande, et c'est à lui que le prince d'Orange s'adresse lorsqu'il désire une marche pour ses troupes. Danseur lui-même, « balladin » comme on disait alors, il s'est naturellement soucié d'animer la musique des ballets, d'introduire des danses nouvelles ou peu connues jusqu'alors : le menuet, la bourrée. Il composa des « airs de vitesse » qui n'échappèrent pas à la critique et que l'on qualifia de « balladinages ». Il n'en eut cure et finit par les imposer, comme aussi les airs « caractérisés », c'est-à-dire représentatifs de certains personnages par leur rythme expressif.
Ce qui est surtout remarquable chez Lully, Italien francisé, c'est que son art, son style, sont essentiellement français, et c'est la raison sans doute pour laquelle ils exercèrent une influence aussi profonde, aussi durable. Toute la musique du XVIIIe siècle, et point seulement au théâtre, lui doit quelque chose. Quant à son succès prodigieux, Lionel de la Laurencie remarque que Lully, habile courtisan qui sait évoluer avec les circonstances, en s'élevant au rang d'historiographe du Roi-Soleil, rencontre déjà dans le sujet qu'il traite un gage d'immortalité. « Sa musique chante deux choses qui tiennent à cœur au souverain : la majesté et le plaisir, et par là, elle s'emboîte on ne peut mieux dans l'art du siècle. » Elle est bien en effet du temps où Charles Le Brun retraçait par allusions les exploits de Louis XIV en peignant les victoires d'Alexandre. La marche de Thésée, sonnant en janvier 1675, c'est la conquête de la Franche-Comté et c'est le succès de Turenne en Alsace qu'elle salue, c'est la gloire du roi qu'elle chante.
Il y a entre sa musique et celle du siècle précédent la même différence qu'entre l'art de Ronsard et celui des poètes du Grand Siècle, soumis à la discipline cartésienne : Aimez donc la raison... La musique de Lully est une construction raisonnable. Avec elle, dit Lionel de la Laurencie, avec ses chœurs massifs, ses trompettes stridentes, impérieuses, ses symphonies solennelles, le décor visuel trouve son équivalent. L'Opéra devient l'image musicale du siècle et reflète moins la personnalité artistique de son auteur que le milieu dans lequel celui-ci a vécu (*). L'art n'est plus autant individuel qu'au siècle précédent.
(*) Lionel de la LAURENCIE, loc. cit., p. 227.
Et ceci est encore une raison de son succès : les airs de Lully se répandent dans le peuple aussi vite que dans le monde de la cour ; une gravure du temps représente Lully arrêtant son carrosse sur le Pont-Neuf pour donner aux chanteurs populaires le mouvement exact d'une de ses mélodies. Ce n'est point seulement à la cour que « tout ce qui s'éloigne trop de Lully, de Racine et de Le Brun est condamné » : La Bruyère le remarque. La France entière n'a d'oreilles que pour Jean-Baptiste.
Bien que Pascal Colasse se soit tenu tout près de lui, bien qu'il ait remplacé Lallouette dans ses fonctions de secrétaire lorsque celui-ci perdit la confiance du maître, sa réputation, qui fut grande, ne lui a guère survécu. Il ne put d'ailleurs devenir lui-même qu'une fois mort celui pour qui il avait beaucoup travaillé : de cette longue sujétion, sans doute, garda-t-il comme une marque profonde, un pli trop bien pris pour se redresser. Mais c'est beaucoup déjà que d'avoir laissé Thétis et Pélée (1689), Astrée (1692), sur un livret de La Fontaine, Jason (1696), l'opéra-ballet des Saisons et trois ou quatre autres ouvrages dont, en les lisant ou en les écoutant, on ne saurait dire, pour quelques-uns des meilleurs passages, s'ils ne sont pas de Lully lui-même. Car à défaut d'originalité, Pascal Colasse possédait à coup sûr son métier.
Henri Desmarest qui fut l'ami de Campra, mais n'en eut pas le grand talent, a montré néanmoins de l'habileté dans ses Fêtes galantes (1698) ; et il n'y a pas grand'chose à dire non plus de La Coste ni de Charles-Hubert Gervais, dont les opéras eurent quelque succès, mais furent vite oubliés.

représentation d'un opéra à la cour de Louis XIV [gravure d'Aveline]
Tout autre est Marc-Anthoine Charpentier, car celui-ci aurait été sans doute le maître de l'opéra français si Lully lui en avait laissé le moyen. Né en 1634, il était allé en Italie et avait été l'élève, à Rome, de Carissimi. Revenu en France, il rapporta le goût de la musique italienne, et si bien même que l'on a pu dire en l'opposant à Lully que le Florentin s'était montré plus français que son rival parisien. A la vérité, ce que Marc-Anthoine Charpentier devait à Carissimi, c'était une excellente formation, un métier solide, comme il allait le montrer dans ses grandes compositions religieuses. Et cela surtout lui a nui : on lui reprocha d'être trop savant, trop compliqué. Savant, certes, il le fut, mais compliqué, point : sa musique, oubliée durant plus de deux siècles, a retrouvé de nos jours un public qui l'apprécie bien plus qu'elle ne goûte les ouvrages de Lully.
Au théâtre, il avait réussi avec la musique du Malade imaginaire (1673), après que Molière se fut brouillé avec Lully ; et il resta le musicien attitré de la Comédie pour laquelle il écrivit la musique de l'Inconnu et de Circé, de Thomas Corneille (1675). Pour Molière encore, il composa les partitions de la Comtesse d'Escarbagnas et du Mariage forcé ; pour Poisson, celle des Fous divertissants ; pour Thomas Corneille et Visé, celle des Amours de Vénus et d'Adonis ; pour Baron, celle du Rendez-vous des Tuileries. Il y montrait mieux que du savoir-faire.
C'est dans la Couronne de Fleurs que Charpentier donna toute sa mesure. Cette pastorale en musique, sur des paroles de Molière, allait devenir, remaniée, l'églogue ajoutée au Malade imaginaire, et distincte de la première version. Elle fut jouée chez Mlle de Guise en son hôtel du Marais. La scène est dans un bocage, et la guerre a dépeuplé la campagne. Flore y veut ramener bergers et bergères, car un héros vient de rendre au monde la tranquillité. L'allusion est transparente : c'est Louis XIV dont les victoires vont permettre à la France de jouir de la paix, et Flore invite bergers et bergères à chanter la gloire de leur bienfaiteur : aux vainqueurs de ce tournoi poétique.
Sa main destine les honneurs
De cette couronne de fleurs.
Ils chantent donc ; mais Pan les interrompt, et c'est pour une nouvelle flatterie à l'adresse du Grand Roi :
Chanter sur vos chalumeaux
Ce qu'Apollon sur sa lyre
Avec ses chants les plus beaux
N'entreprendrait pas de dire !
On partage donc les prix entre les concurrents, et dans un ensemble on fait des vœux pour la gloire et le bonheur du roi.
Henri Quittard, qui publia une étude sur cette partition remarquable, n'y relève aucun italianisme notable, mais trouve dans les thèmes de Marc-Anthoine Charpentier une grâce aisée, fluide, qu'on ne rencontre guère chez nous au XVIIe siècle.
Le premier récit de Flore, par exemple, Renaissez, paraissez, tendres fleurs, celui de Rosélie : Puisque Flore en ces bois nous convie, le petit ensemble à trois qui vient ensuite sentent déjà leur XVIIIe siècle. Rameau n'écrivit nulle part rien de plus frais ni de plus aimable, d'un caractère plus tendrement champêtre ainsi qu'on l'entendait alors... Enfin les ensembles, après chaque solo, le grand ensemble final surtout, sont toujours d'un excellent style. Il y a loin de cette écriture, sinon très rigoureusement figurée, du moins partout animée d'un esprit polyphonique véritable, à l'architecture un peu compacte des chœurs de Lully. Au reste cette indépendance et cette fantaisie dans le maniement des voix se retrouvent chez presque tous les Français de ce temps.
Sans doute. Mais c'est le temps où Lully leur ferme les portes de l'Opéra. Et Jules Combarieu remarque à propos d'Orphée descendant aux Enfers, divertissement donné de même à l'un des concerts de Mlle de Guise, que Charpentier savait aussi « manier les cordes graves de la lyre et qu'il aurait pu fonder l'opéra français ». Il aurait su certainement unir le style polyphonique au style récitatif, conserver de l'héritage du passé ce qui devait légitimement survivre, et qui fut oublié durant deux siècles. Mais ces regrets sont superflus : Lully l'emporta sur Charpentier.
En 1680, Marc-Anthoine Charpentier avait été nommé maître de chapelle de l'église Saint-Louis des Jésuites et de leur collège où l'usage s'était perpétué de donner des représentations sacrées analogues à celles qu'avait instituées saint Philippe de Néri à Rome. C'est là que Charpentier fit connaître ses oratorios le Reniement de saint Pierre, l'Enfant prodigue, le Sacrifice d'Abraham, le Massacre des Innocents, la Naissance de Jésus-Christ, la Peste de Milan, à l'exception du Jugement de Salomon, donné en 1702 à la Sainte-Chapelle pour la rentrée du Parlement. Mais outre ces oratorios, le maître de chapelle écrivit pour le collège de Clermont (aujourd'hui lycée Louis-le-Grand) deux tragédies chrétiennes, représentées par les élèves, et dont le texte était en latin. La regrettée Claude Crussard, qui a tant fait pour la mémoire de Charpentier, donne sur ces représentations les détails que voici :
Ces tragédies se composent de trois ou cinq actes, que les PP. La Rue, Le Jay et Porée portent à leur perfection. Très souvent s'y mêlent des intermèdes en français. Le ballet, la mise en scène, les décors, les costumes y sont particulièrement soignés. A côté des élèves acteurs, aux plus grands noms tels que MM. de la Trémouille, de Mortemart, de Condé, etc., paraissent des danseurs de l'Opéra. Le P. Porée est un metteur en scène remarquable, dont aujourd'hui encore, grâce au livre de Boysse (*) nous savourons les minutieux conseils. Rien de plus amusant que de voir un de ces Pères, à la fois auteur et metteur en scène d'une de ces grandes tragédies, présidant à son exécution : réglant un pas, rectifiant une attitude, disposant des ensembles, animant une diction monotone, atténuant un effet exagéré, mettant sa culture au service d'une manifestation d'art jugée utile pour le développement de la grâce, du maintien et du bon goût chez des élèves destinés à représenter l'élite de la société (**).
(*) BOYSSE, le Théâtre des Jésuites, Paris, 1880.
(**) Cl. CRUSSARD, Un Musicien français oublié : M.-A. Charpentier, Paris, Floury, 1945.
La cour et la ville sont friandes de ces spectacles : en 1651, « la Reine et Messieurs ses deux fils » y vont avec leur suite. Louis XIV s'y montre lui-même. Le 10 février 1687, on donna la tragédie Celsus, représentée par les élèves de seconde, avec Celse martyr « tragédie en musique pour servir d'intermède à la pièce latine ». Le texte en était du P. Bretonneau, la musique de Charpentier. Le 25 février de l'année suivante, ce furent Saül, avec David et Jonathas, tragédies en musique des mêmes auteurs, et le Mercure rapporte :
On a encore plus fait cette année, et outre la tragédie de Saül qui a été représentée en vers latins, il y en avait une en vers français intitulée David et Jonathas, et comme ces vers ont été mis en musique, c'est avec raison qu'on a donné le nom d'opéra à cet ouvrage. On ne peut recevoir de plus grands applaudissements qu'il en a eu, soit dans les répétitions, soit dans la représentation. Aussi la musique est-elle de M. Charpentier.
L'œuvre est admirable en effet, et fort différente de ce que l'on entendait d'ordinaire alors à l'Opéra : dédaignant la mode et les conventions, Charpentier prête à ses héros un langage musical profondément humain. Claude Crussard, analysant son style, met en relief ses qualités, dues d'abord au plan qui dispose les symphonies, danses, récits, airs et chœurs en suivant rigoureusement les exigences de l'action ; à la musique elle-même dans laquelle « l'esprit du passé, le goût du moment et les tendances de l'avenir se rejoignent pour mieux traduire les passions des personnages. Chaque scène, chaque acte est complet en lui-même, tout en dépendant du tout ». Les symphonies situent l'atmosphère des actes qu'elles préfacent ; les récits commentent l'action ; les airs expriment les sentiments individuels tandis qu'avec les chœurs nous sommes mêlés à une foule qui, avec des mouvements de joie, de crainte ou d'effroi, assiste ou participe au drame. C'est le principe des grands oratorios de Händel.
C'est là sans doute qu'est le meilleur de Marc-Anthoine Charpentier, là et dans ses Leçons de Ténèbres, absolu chef-d’œuvre, et dans son Te Deum à six parties, et plus peut-être aussi que dans sa Médée, tragédie lyrique en cinq actes et un prologue, sur des paroles de Thomas Corneille, représentée pour la première fois en décembre 1693. Dans une curieuse note, Brossard (l'auteur du Dictionnaire de musique publié en 1703, et auquel Rousseau fit de nombreux emprunts) juge ainsi Médée : « C'est l'ouvrage sans contredit le plus sçavant et le plus recherché de tous ceux qui ont été imprimez, du moins depuis la mort de M. de Lulli, et quoy que par les caballes des envieux et des ignorants, il n'ait pas esté si bien reçeu du public qu'il le méritoit, du moins aussi bien que d'autres, c'est celluy de tous les Opéras, sans exception, dans lequel on peut apprendre plus de choses essentielles à la bonne composition (*). »
(*) Catalogue du Cabinet de Brossard, p. 183 (Bibl. Nat. Rés.).
Il est probable que ce fut moins la science de Charpentier que la médiocrité du livret qui empêcha le succès de Médée : les mérites de la partition demeurent quand même évidents, moins sans doute que dans les pièces que l'on vient de citer, mais de même ordre. Et c'est d'abord la clarté, l'aisance d'un style extrêmement travaillé mais qui garde toujours une apparence de naturel. Qu'il écrive pour le théâtre ou pour l'église, il emploie avec la même sûreté la construction polyphone, le chœur en harmonie verticale, le récitatif sec ou le récitatif expressif, l'air à une ou plusieurs voix. Sa musique a une vie intense, une extraordinaire résonance humaine, et l'on retrouve chez lui, plus que chez aucun autre compositeur du XVIIe siècle, les qualités qui furent celles de Monteverdi. Il sait la vertu du silence, et indique volontiers sur ses partitions : « Il faut icy un très grand silence. » Sa phrase mélodique est d'une souplesse rythmique qu'on ne trouve chez aucun autre musicien de son temps, et ses audaces harmoniques montrent chez lui une persistance voulue du style contrapuntique. N'écrit-il pas : « Plusieurs quartes ou quintes de suite sont permises entre les parties supérieures, pourvu qu'elles soient de différentes espèces et qu'elles cheminent par degrés conjoints. » Dans un exemple cité par Claude Crussard, on trouve l'accord mi bémol, ré, sol naturels, sous lequel Charpentier a noté : « Cet accord est très plaintif. » Il est juste de dire que les dissonances dont il se sert avec une tranquille assurance sont toujours amenées avec une sûreté qui les justifie.
Si les formes tendent dès la fin du XVIIe siècle à une construction rigide, Charpentier est certes l'un de ceux qui se plient le moins volontiers à ces exigences. Il passe au contraire avec une virtuosité de plume remarquable des complications de huit parties réelles distribuées en deux chœurs à la simplicité d'un récit de tour populaire, et il semble toujours obéir à une nécessité commandée par l'action, par les sentiments qu'elle exprime.
Alors que nous sommes renseignés abondamment sur les moindres détails de la vie de Lully, nous ignorons presque tout de la biographie de Marc-Anthoine Charpentier. Peu importe en somme : l'essentiel est que son œuvre nous soit parvenue. Bien des parties demeurent encore manuscrites. Mais petit à petit, grâce à la patience et à l'érudition de musicographes auxquels Claude Crussard a donné l'exemple, cette œuvre immense nous est révélée. Et à mesure, grandit le nom d'un maître qui doit prendre place auprès des plus illustres musiciens que le monde ait produits.
LE RAYONNEMENT DE L'OPÉRA ITALIEN EN EUROPE AUX XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES
Si l'on a pu parler à tort, comme on l'a vu, d'écoles florentine, vénitienne, romaine et napolitaine à propos de l'art lyrique italien dans les trois premiers quarts du XVIIe siècle, il n'en est pas moins certain que les centres de production de cet art se sont déplacés à cette époque. Né à Florence, l'opéra s'est manifesté à Rome chez les Borghèse et les Barberini, à Venise presque aussitôt, où il est vite devenu populaire, puis à Naples où il n'a pas manqué de prendre une couleur plus vive sinon plus vigoureuse.
Tandis que Provenzale développe chez les Napolitains le goût de la tragédie lyrique, et montre en même temps qu'il est possible de faire naître le rire aussi bien que les larmes par le moyen du théâtre chanté, Giacomo Carissimi (1605-1674) exerce sur le développement de l'oratorio une influence considérable. Il y fait plus large place à la virtuosité vocale, mais recherche aussi une traduction musicale plus fidèle du texte aussi bien dans la mélodie que dans les accompagnements instrumentaux. Par son enseignement, si recherché, au collège germanique de Rome, il forme des élèves comme Marc-Anthoine Charpentier, Alessandro Scarlatti, Johann-Kaspar von Kerll, Kaspar Förster qui, essaimant à travers l'Europe, y répandent les principes qu'ils en ont reçus. Et l'on a déjà signalé, à propos de M.-A. Charpentier, l'importance de ce mouvement et son rôle dans la diffusion du style italien qui tend, à partir de cette époque, à une sorte d'universalité. Les oratorios latins ou histoires sacrées de Carissimi : Abraham et Isaac, Balthasar, Diluvium universale, Ezechia, Felicitas beatorum, Historia divitis, Jephte, Job, Jonas, Judicium Salomonis, Lamentatio damnatorum, Lucifer, Martyres, Vis frugi et paterfamilias, ont servi de modèles à quantité de productions ultérieures. La Lande et Bach lui doivent des procédés qu'ils sauront adapter à leur propre tempérament, mais qui n'en ont pas moins leur source dans l'art de Carissimi. Et bien qu'on ne connaisse point d'opéras qu'il ait signés, on l'a toujours considéré comme un maître dans l'art de la scène. Il est vrai qu'entre l'oratorio et l'opéra, la différence est légère et ne tient qu'au sujet traité.
Sicilien d'origine, Alessandro Scarlatti (1659-1725) avait été l'élève de Provenzale avant de devenir le disciple de Carissimi. Ce fut à Rome qu'il donna son premier opéra, l'Errore innocente, en 1679, et le second, l'Onestà nell'amore, l'année suivante, fut joué dans le palais de la reine Christine de Suède qui, depuis son abdication, résidait en Italie. Il lui plut, et Scarlatti devint son maître de chapelle. Il quitta Rome pour Naples où il fut nommé maître de chapelle de Santa Maria di Loreto, puis maître de chapelle de la cour et directeur du Conservatoire de Sant'Onofrio. Francesco Foggia étant mort, Scarlatti fut mandé à Rome pour lui succéder à Sainte-Marie-Majeure. Le cardinal Ottoboni se l'attacha en qualité de directeur de sa musique, et le fit nommer chevalier de l'Éperon d'or. De nouveau, un an plus tard, il quitta Rome et revint à Naples où il enseigna au Conservatoire dei Poveri, comblé d'honneurs. D'une intarissable fécondité, il a écrit, au milieu de ces déplacements, plus de cent quinze opéras, une vingtaine de messes, deux cents psaumes et motets, une prodigieuse quantité de cantates, d'airs, de pièces vocales et instrumentales. Beaucoup de ses ouvrages sont perdus, mais comment en être surpris ?
Il a apporté à la composition de l'orchestre d'heureuses modifications assurant l'équilibre sonore des cordes et de l'harmonie, et c'est lui qui a donné à l'aria toute l'importance qu'il a prise dans le style italien. Ses élèves, Leo, Pergolesi, Durante, Hasse, devinrent célèbres à leur tour. Ce qu'ils doivent à leur maître, la parenté de leur art avec le sien, légitime le terme d'école napolitaine :
L'art fondé par Scarlatti — écrit Combarieu — est en effet très éloigné de la gravité de Florence et de ces illusions d'humanistes qui voulaient ramener à la vie la Tragédie antique ; il est, aussi, très en progrès sur le théâtre vénitien. Sa caractéristique la plus générale est un esprit national, une sorte de retour à la libre expansion du génie populaire qui, au théâtre, tend à faire pénétrer l'élément comique jusque dans l'opera seria, et garde ininterrompue la tradition qui, de l'antique atellane latine, va jusqu'aux types consacrés d'Arlecchino, de Pantalone, de Colombine. Par l'intermezzo, où l'on fait voir une sorte de parodie de la tragédie lyrique, il fera peu à peu le départ entre le genre sévère et le genre plaisant d'abord confondus pour aboutir à l'opera buffa, qui, entre les mains d'un Pergolèse et d'un Rossini aura de si brillantes destinées (*).
(*) COMBARIEU, loc. cit. t. II, p. 34.
Car l'usage s'établit d'introduire entre les actes de l'opera seria, ces intermezzi, faits de pièces légères et gaies, de véritables farces. Le mot avait d'abord, comme on l'a vu, servi à désigner les divertissements musicaux intercalés dans les représentations parlées. Par analogie, on le conserva pour les intermèdes insérés pendant les entractes des opere serie. D'abord sans lien aucun entre eux, ils formèrent, avec Nicolà Logroscino (1700-1763), de véritables pièces, comme Il vecchio marito, Tanto bene che male, avec un ensemble pour le finale de chaque acte. Mais ces pièces, le plus souvent en dialecte napolitain — ce qui contribuait certes à leur succès populaire — continuaient d'être intercalées, acte par acte entre les actes de la « grande pièce », de l'opera seria.
La Serva padrona, qui est un chef-d’œuvre de l'opera buffa, n'est point autre chose qu'un intermezzo de cette sorte. Elle a pour auteur Giovanni-Battista Pergolesi (1710-1736) qui fut l'élève de Durante au Conservatorio dei Poveri. Sa mort prématurée, à vingt-six ans, priva la musique de chefs-d’œuvre que promettaient des ouvrages comme ses Sonates à trois, son Stabat (sa dernière production) et ses pièces bouffes. La Serva padrona (la Servante maîtresse) fut créée à Naples en 1733 et elle devait tenir dix-neuf ans plus tard un rôle historique dans la querelle des Bouffons qui prit naissance à son propos. Peu d'œuvres ont eu semblable fortune, puisqu'elle n'a point quitté le répertoire tant italien que français depuis plus de deux siècles. La Serva padrona était donc primitivement un intermède inséré dans Il Prigioniero superbo, et de même Amor fa l'uomo cieco (l'Amour rend aveugle) dans la Sallustia (1731), dont le succès fut éclipsé par celui de la Serva padrona.
Il y a dans ce petit ouvrage tout ce qui peut contribuer à un succès durable en effet : un livret (de G.-A. Federico) amusant, assez gros, mais habile car il fait supporter une donnée fort simplette, dont tout fait présager l'issue dès les premières répliques où l'on devine bien que le vieux Uberto (Pandolphe dans la version française) se laissera mener jusqu'où le voudra l'aguichante et rusée Zerbina, par lui naguère recueillie et chaque jour plus exigeante, plus capricieuse, plus insolente. Cela pourrait s'appeler aussi bien « à combien l'amour revient aux vieillards ». Thème éternel, que deux personnages chantants et un muet, le valet Vespone (Scapin, dans la version française) suffisent à développer pendant les deux actes. Vespone se déguisera en matamore pour intimider Uberto et se donnera pour le fiancé de la soubrette, si bien que pour la soustraire à ce butor, il résoudra de l'épouser ; sur quoi, Zerbina démasquera le valet. Et tout finira par une promesse de bonheur : « Per te ho nel core il martellin' d'amore, che mi percuote ognor ! » (Pour toi j'ai dans le cœur le marteau de l'amour qui me frappe sans cesse.) La qualité de la musique tient à ce qu'elle s'adapte exactement au texte : elle a, de plus que lui, un esprit endiablé. Le défaut, qui semblait alors fort naturel, est que les paroles sont répétées indéfiniment, ce qui ne manque pas d'amener la lassitude. Jean Chantavoine a dit fort bien que ces personnages de la comédie italienne que fait chanter la Servante maîtresse appartiennent à l'époque des marionnettes et des pantins ; or la drôlerie des marionnettes consiste dans l'imitation des gestes humains et dans la raideur même de cette imitation ; en retour, sur le théâtre, la drôlerie des personnages vivants réside dans l'imitation de ces marionnettes. La musique de la Servante maîtresse avec son mélange de vivacité et de maigreur, de gentillesse facile et de formalisme étroit, traduit à souhait cette action réciproque et réalise à merveille cet équilibre (*).
(*) J. CHANTAVOINE, Cent opéras célèbres (Paris, Plon, 1948. p. 33).
Un autre élève de Durante, Nicolà Jommelli (1714-1774), débuta par de petits ouvrages qui n'eurent aucun succès, puis donna en 1736 l'Errore amorosa, mieux appréciée, et en 1737, Odoardo qui affermirent sa réputation. Il quitta Naples pour Rome, y donna Ricimero et Astianasso (1740), puis se rendit à Bologne où il prit du P. Martini des leçons de contrepoint, gagna Venise, y fit représenter Merope (26 décembre 1741) dont la réussite lui valut la direction du Conservatorio dell'Incurabili, revint à Rome et accepta en 1753 la place de maître de chapelle de la cour de Stuttgart. Quinze ans de séjour dans le Wurtemberg lui valurent une connaissance profonde de la musique allemande, et l'influence des ouvrages symphoniques de Stamitz élargit sa manière. En 1745 il donna à Vienne Didone abbandonata sur un poème de Métastase, son ami. Mais revenu en Italie, il y fut considéré comme un étranger. Ses opéras Fetonte (qui avait été représenté à Stuttgart), Armida (1770), Demofoonte (1770), Ifigenia in Tauride (1771), ne rencontrèrent qu'indifférence. Pensionné par Joào VI, roi de Portugal, il ne voulut point s'exiler à la cour de Lisbonne, et mourut dans le chagrin, après avoir achevé un Miserere devenu célèbre.
Le Vénitien Baldassare Galuppi (1706-1785) avait été l'élève de Lotti, et commença par produire de nombreux opéras sérieux avant de se consacrer au style bouffe qui devait assurer sa gloire. Sa fécondité — on lui doit au total cent douze opéras, vingt oratorios, trois cantates dramatiques et une vingtaine de pièces de musique de chambre — ses voyages, ont beaucoup contribué à répandre à travers l'Europe la musique italienne. On le joua, en effet, non seulement dans toute l'Italie, mais à Londres, à Mannheim, à Stuttgart, à Strasbourg, à Prague, à Madrid et à Saint-Pétersbourg où il séjourna en 1745 et fut chargé par le tsar de diriger l'orchestre du théâtre. De retour à Venise, il se lia avec Goldoni, et ce fut à partir de ce moment qu'il donna la mesure de son génie spirituel et léger : Il Filosofo di campagna est d'une verve étourdissante, et la musique, qui abonde en traits délicats, montre en même temps une science harmonique et une qualité de l'instrumentation qui lui devraient mériter de n'être point oubliée.
Cette fécondité extraordinaire fut encore dépassée par celle de Nicolà Piccini (1728-1800) qui fut, à Naples, l'élève de Leo et de Durante. Il ne fut cependant que relativement précoce, puisqu'il ne donna son premier ouvrage qu'en 1754, avec le Donne dispettose ; il allait être suivi de près de cent cinquante opéras dont nous connaissons seulement cent trente, au moins par leurs titres. En 1760, à Rome, son opéra-comique Cecchina nubile (la Buona Figliuola) lui valut un triomphe si éclatant que l'ouvrage fit exactement le tour de l'Europe ; la réputation que lui dut Piccini fut la raison des sollicitations dont il fut l'objet lorsque les Français voulurent opposer à Gluck un rival italien. Nous retrouverons donc Piccini à Paris lorsqu'il sera question de la querelle des gluckistes et des piccinistes. Cependant la versatilité du public romain ne lui permit point de se maintenir dans la position où son succès l'avait placé. On lui préféra Anfossi qui n'avait point son talent. Piccini se jura de ne plus revenir à Rome et partit pour la France (1776). Mais la Révolution le fit revenir à Naples ; il y écrivit quelques pièces italiennes ; le mariage de sa fille avec un révolutionnaire français le fit tomber en disgrâce. Il réussit à s'échapper, reprit le chemin de Paris où sa famille parvint à le rejoindre. Dédommagé de la perte de ses biens et nommé inspecteur du Conservatoire, il acheva son existence à Passy où il mourut le 7 mai 1800.
C'est encore un exemple de fécondité que donna Giovanni Paesiello (1741-1816), auteur de plus de cent opéras dont les meilleurs sont du genre bouffe. Lui aussi avait été élève de Durante à Naples, et ce fut au théâtre d'études du Conservatoire de Sant'Onofrio qu'il débuta en 1763 avec un intermezzo qui lui valut aussitôt des commandes. Après le Virtuose ridicole, l'Idolo Cinese (1767) fut le début d'une série de brillants succès qui en firent le rival de Piccini. Il Duello, en 1774, Il Socrate immaginario en 1775, et surtout Il Barbiere di Siviglia (1782) et la Molinaria (1788) étendirent sa réputation à travers le monde, si bien même que l'on reprocha à Rossini d'avoir osé écrire un Barbiere après le chef-d'œuvre de Paesiello. Quelques raisons que nous ayons de préférer l'opéra de Rossini, il est certain que Paesiello fut un maître en l'art d'écrire des mélodies pleines de verve et de fraîcheur, et, plus encore d'imprimer à une comédie musicale tout entière une unité de mouvement et de style qui en rehausse l'éclat. Comme Jommelli, il fut mandé en Russie et demeura à Pétersbourg de 1776 à 1784, puis revint à Naples où, en 1799, le gouvernement républicain le maintint à son poste de maître de chapelle. En 1802, Napoléon demanda au roi de Naples, restauré, de lui céder Paesiello dont il admirait fort le talent ; mais celui-ci, bientôt en butte à la jalousie de ses confrères parisiens, revint à Naples près de Murat. Il ne survécut que peu de temps au retour de Ferdinand qui fut pour lui la cause d'une nouvelle disgrâce.
Son rival Domenico Cimarosa, de huit ans plus jeune (il était né en 1749 à Aversa, près de Naples, et il mourut à Venise en 1801), avait été l'élève de Piccini et conquit, dès la création de son premier ouvrage au théâtre de Fiorentini, le Stravaganze del conte, le public napolitain. En 1779, le succès à Rome de l'Italiana in Londra lui fit partager sa vie entre les deux capitales. Mais bientôt sa renommée dépassa l'Italie : en 1789, il est à Pétersbourg, après avoir été fêté à Vienne, où il écrivit l'ouvrage auquel il doit le meilleur de sa gloire : Il Matrimonio segreto, chef-d’œuvre de l'opera buffa, dont le triomphe fut immédiat. On conte que l'empereur Léopold après la première représentation, à laquelle il avait assisté, fit inviter les chanteurs et les musiciens à un souper, et voulut réentendre la pièce le soir même. Stendhal prétendait l'avoir applaudie plus de cent fois ; dans le monde entier le Mariage secret fut accueilli avec la même faveur : à Naples, on le joua soixante-dix-sept soirs consécutifs sans en épuiser le succès. En 1794, Astuze femminile soulevèrent un enthousiasme presque aussi grand. Cimarosa, compromis par ses opinions républicaines et la part qu'il avait prise à la révolution de 1799, fut condamné à mort. Gracié, il s'embarqua pour Venise, mais il mourut en y arrivant, empoisonné, dit-on alors ; l'opinion publique accusa le gouvernement. Une déclaration officielle du médecin privé de Pie VII, qui résidait à Venise, constata la mort naturelle du malheureux compositeur.
Sans doute la partition d'Il Matrimonio segreto a-t-elle quelque peu vieilli ; mais la finesse et l'esprit de cette musique ont gardé leur séduction et font passer sur les longueurs du livret trop étiré de Giovanni Bertati : Geronimo, négociant riche et sourd, a pour commis Paolino, qui a épousé secrètement Carolina, seconde fille de son patron. Les jeunes époux tremblent — ce qui nous vaut un charmant duo : Cara, non dubitar... Ah ! pietate troveremo Se il ciel non barbaro é. Le comte Robinson va venir demander la main de l'aînée, Elisetta et le bonhomme rayonne ; il chante : Di giubbilo, saltate ! Elisetta partage sa joie : elle sera comtesse, et déjà exige de Carlotta des hommages que celle-ci refuse. Intervention de la tante Fidalma — et ravissant trio. Le comte arrive. Naturellement c'est Carlotta qui lui plaît davantage : quatuor non moins spirituel, non moins réussi que tout à l'heure le trio : Sento in petto un freddo gelo..., puis duo de basses entre Geronimo et le comte. Celui-ci s'adresse à Paolino pour obtenir la main de la cadette. Paolino lui remontre l'impossibilité de ce changement ; Carlotta elle-même se dérobe ; le comte s'obstine. Pour sortir d'embarras, Paolino veut faire hâter le mariage : sextuor.
Au deuxième acte, Geronimo s'entête, s'irrite. Pour l'adoucir, le comte propose d'abandonner la moitié de la dot si on lui donne Carlotta au lieu d'Elisetta. Paolino cherche à faire alliance avec la tante Fidalma et veut lui avouer son mariage secret. La vieille fille prend les réticences du commis pour l'embarras d'un amoureux timide, et pour le mettre à l'aise, se déclare prête à l'épouser. Carlotta survenant, se croit trahie. Tout s'explique : un enlèvement pourra dénouer l'imbroglio, et c'est l'air célèbre : Pria che spunti in ciel l'aurora...
Pour convaincre Elisetta, le comte se peint sous les traits les plus noirs. Elisetta n'est point dupe. Nouvelles complications : Fidalma veut éloigner Carlotta et suggère de la mettre au couvent. Nouvel ensemble, et cette fois, un quintette. Enfin, au dernier tableau, le comte, sortant de sa chambre, la nuit venue, pour aller trouver Carlotta et lui faire l'aveu de son amour, est surpris par Elisetta. Paolino et Carlotta, à leur tour, sortent un flambeau à la main, et c'est une suite de quiproquos qui se dénoueront par des aveux suivis d'une réconciliation : Oh ! che gioja ! Oh ! che piacere !
Certes Giovanni Bertati qui avait succédé à Da Ponte comme poète lauréat de la cour de Vienne, n'a point le génie de Beaumarchais, et Cimarosa est plus loin encore du génie de Mozart. On songe par instants aux Nozze et au Barbier cependant, car il y a dans le Mariage secret de la gaieté, de la finesse, un art consommé de la construction et de l'équilibre, un travail extrêmement délicat du musicien. Mais le défaut de l'ouvrage est dans l'uniformité de cette perfection formelle : point de profondeur, et n'était la tessiture dans laquelle ils sont notés, ces airs iraient aussi volontiers à tel personnage au lieu de tel autre.
Il faut encore citer parmi les musiciens de cette période qui illustrèrent l'école italienne, Léonardo Vinci qui fut l'émule de Pergolèse, Tommaso Traetta, dont Il Fornace connut la popularité, et dont l'Ippolito, donné au mariage du prince des Asturies, lui valut une pension du roi d'Espagne ; Domenico Terradellas, élève de Durante, qui mourut prématurément ; Antonio Sacchini qui séjourna à Londres et à Paris et contribua grandement à la diffusion du répertoire italien ; Niccolò Porpora, qui passa lui aussi par Londres et Vienne, puis Dresde, où il demeura assez longtemps comme maître de chapelle en même temps que Hasse. Tous ces déplacements de compositeurs, principalement d'opere buffe, expliquent pour une bonne part non seulement la vogue du genre si vite répandu dans le monde, mais aussi le goût du bel canto qui se développe en même temps dans toutes les capitales où l'air « de bravoure » soulève l'enthousiasme des foules. Désormais on va au théâtre moins pour entendre un bel ouvrage que pour applaudir des interprètes réputés; et les compositeurs écrivent de plus en plus dans le dessein de provoquer des succès profitables.
L'emploi des castrats contribuait au développement de cet art vraiment trop artificiel. Cependant la France demeura hostile à ces pratiques, et on n'y employa jamais régulièrement de castrats.
S'il est vrai que Nicolas Lasnier (ou Lanyer, 1588-1666), au retour d'un voyage en Italie, où il s'était rendu pour rapporter à Charles Ier des tableaux des maîtres, ait tenté d'acclimater en Angleterre le stilo rappresentativo dont il s'était épris durant son séjour dans la péninsule, on ne saurait voir en ses Lovers made men, sur le poème de Ben Jonson, autre chose qu'un mask, ni dans ses cantates pastorales autre chose que des airs de cour. De même Henry Lawes (1595-1662) qui met en musique le Comus de Milton (1634) emploie le style monodique avec trop de froideur bien qu'avec élégance. En 1656, Henry Lawes, Coleman, George Hudson et Henry Cook (communément appelé Captain Cooke, parce qu'il avait gagné ce grade dans l'armée royale) signent en commun le First Day's Entertainment, un curieux ouvrage où la musique et la déclamation se mêlent, et où l'on entendit Aristophane et Diogène, un Parisien et un Londonien discuter sur le théâtre, de l'opportunité des représentations. Il s'agissait — comme le rapporte Henri Dupré — de « sonder les dispositions des chefs de la Commonwealth ». Elles furent conciliantes ; Davenant, auteur du livret de l'Entertainment, s'enhardit et écrivit le poème du Siege of Rhodes, dont la partition est malheureusement perdue. Malheureusement certes, car ce fut là le premier opéra anglais (*).
(*) Cf. Henri DUPRÉ, loc. cit., p. 17.
En 1670, Matthew Locke compose une musique de scène pour Macbeth de Davenant ; un peu plus tard, des airs et des chœurs pour la Psyche de Shadwell et pour The Tempest, de Shakespeare. Mais bien que publiées sous le titre de The English Opera or the vocal music, etc., ces partitions ne sont rien d'autre que des musiques de scène, et il faut arriver à Purcell pour trouver vraiment le créateur de l'opéra anglais.
Né probablement en 1658, Henry Purcell avait donc seize ans lorsque Cambert, accueilli à Londres par Charles II, fit représenter son Ariane en 1674. Entré à la chapelle royale, il y fut l'élève de son père, maître de chœur de l'abbaye de Westminster, puis de Cooke, d'Humphrey et de Blow. En 1680, il est titulaire des orgues de l'abbaye, et nommé un peu plus tard compositeur de la cour. Ses pièces religieuses, ses Welcome Songs, ses Hymnes lui valent une réputation grandissante. Il écrivit une cinquantaine d'ouvrages destinés au théâtre, mais qui sont simples musiques de scène, interludes symphoniques, airs et chœurs pour des comédies ou des drames souvent « arrangés » d'après Shakespeare, Dryden, Congreve ou Tom d'Urfey, soit encore des masks. Sans doute ne l'eût-on pas complètement oublié, mais son nom n'eût pas brillé d'un éclat plus vif que ceux de ses maîtres Cooke ou Blow — et c'eût été d'ailleurs injuste, car il les surpasse en toutes ses œuvres — s'il n'avait, à trente ans, composé Dido and Æneas, son unique opéra. Il faut remarquer cependant que certaines de ses productions sont très voisines de la tragédie lyrique : la frontière qui sépare les genres est incertaine. Mais si le plus souvent la musique destinée à la scène n'est qu'une suite de catches (canons à deux parties ou plus), et qui fait courir les voix les unes après les autres, comme pour se rattraper (to catch), elle est ailleurs beaucoup plus développée, comme dans King Arthur, sur le livret de Dryden, et qui fut regardé comme le chef-d’œuvre de Purcell (1691).
Le livret de Dido and Æneas était dû à Nahum Tate (1652-1715), qui fut nommé poète lauréat à la mort de Shadwell. Tate était un homme singulier, dont l'intempérance fit scandale. Écrivain médiocre, mais fort orgueilleux, il eut l'audace de remanier et de compléter des pièces de Shakespeare, modifiant à son goût, qui n'était pas pur, le dénouement aussi bien que les épisodes. Pour Dido, ce fut un de ses propres ouvrages qu'il adapta, avec l'aide de Virgile s'entend, et Brutus of Albe, donné à Dorset Garden dix ans auparavant devint ainsi Dido and Æneas. Le scénario n'était pas mauvais, et Tate parvint à faire autre chose que ce que nous appellerions aujourd'hui une pièce pour patronage. Car c'était de cela qu'il s'agissait, et c'est pourtant un des plus grands chefs-d’œuvre du théâtre lyrique. On lit en tête de la partition, en effet : « Opéra joué au pensionnat de M. Joseph Priest, à Chelsea, par des jeunes filles de bonne famille, paroles de M. N. Tate, musique de M. Henry Purcell. » Pas de date ; aucun autre renseignement. Beau sujet de discussion pour les érudits : les uns proposèrent 1675 ; d'autres, 1677 ; d'autres encore 1680. On pense aujourd'hui, avec Barclay Squire, que ce fut en 1689 que Dido and Æneas fut créé. Mais ce dont on est le plus certain, c'est que cette Didon ne fut plus représentée jusqu'en 1895. On en interprétait, il est vrai, quelques pages de temps en temps au concert. Pour le bicentenaire de la mort de Purcell, les étudiants du Royal College of Music la jouèrent sous la direction de sir Charles Standford ; puis l'opéra fut donné plusieurs fois, et même en France où la Schola le joua, puis en 1927, on put l'entendre à la Petite Scène de Xavier de Courville. Mais ce furent toujours des amateurs qui l'interprétèrent. Cependant il atteint, comme le dit Edward J. Dent, professeur de musicologie à Oxford, « une ampleur tragique et une beauté qui ne sont pas surpassées par les œuvres les plus célèbres de Gluck. » On peut même dire qu'il y a dans Dido and Æneas quelque chose de plus humain, de plus merveilleusement profond. Aujourd'hui, un enregistrement intégral de l'ouvrage de Purcell permet à tous de connaître ce chef-d’œuvre si longtemps oublié.
La Carthage de Tate n'a rien d'historique. L'action suit à peu près le récit du prince troyen dans Virgile, mais Tate ne s'est pas refusé le plaisir de l'enjoliver au goût du jour, en l'agrémentant des sorcières traditionnelles dans le drame anglais, et qui interviennent à plusieurs reprises. Accompagnée de sa suivante Belinda, Didon paraît dès le début du premier acte. Elle est triste, agitée de pressentiments. Elle cache pudiquement l'objet de ses soucis : Belinda les devine. C'est « l'invité » troyen qui les cause. Pourquoi ne point consommer une union qui serait profitable au royaume ? Didon avoue enfin qu'elle aime Énée. Elle tremble pour lui qui est exposé à tant de périls. Il survient. Il sait ce que les dieux exigent, et pourtant, il faiblit. Et le chœur l'encourage : « Amour, poursuis ta conquête ! » Le triomphe de l'amour est exprimé par une danse, tandis qu'Énée s'éloigne aux côtés de Didon.
Nous sommes transportés dans l'antre d'une sorcière. Celle-ci appelle ses sœurs et leur annonce qu'Énée, lié par le Destin, doit poursuivre son voyage, en quête de l'Italie où Troie revivra. Les sorcières veulent la perte de Didon ; tandis qu'on entend les échos de la chasse royale, elles clament leur haine et décident d'envoyer un elfe qui prendra l'apparence de Mercure et donnera à Énée l'ordre d'embarquer cette nuit même. L'une d'elles va provoquer un orage qui dispersera la chasse. Un chœur et une danse des sorcières achèvent le premier acte.
A l'acte II, tandis que Didon et Énée se reposent dans un bosquet dédié à Diane, l'orage éclate : il faut fuir devant l'ouragan. Et c'est alors que l'elfe apparaît à Énée et lui signifie la volonté des dieux. Énée, maudissant son sort, se dirige vers les vaisseaux pour donner l'ordre d'appareiller dans la nuit.
Le troisième acte est fait du désespoir de Didon. Mais auparavant, les sorcières se réjouissent du malheur de la reine. Elle paraît ; Énée l'ayant rejointe, c'est elle qui le repousse : il faut obéir au destin. Admirable scène où Purcell exprime le douloureux conflit de l'amour et du devoir, où Didon, déjà, ne songe plus qu'à la mort : « Elle l'attend ; elle doit venir dès qu'il sera parti... »
Elle meurt en effet. Et c'est l'air magnifique : « Quand je reposerai en terre... » ; c'est l'adieu suprême à Carthage, à la fidèle Belinda, c'est le chant funèbre :
Thy band, Belinda, darkness shades me...
When I am laid in earth, may my wrongs create
No trouble in thy breast :
Remember me, but, ah ! forget my fate !
Elle ne se tue pas : les susceptibilités des jeunes personnes « de bonne famille » pensionnaires à Chelsea empêchaient de suivre Virgile jusqu'au suicide ; elle meurt doucement, exhalant à deux reprises le sublime Remember me, dont on a dit que Purcell avait fait, par un pressentiment de sa courte destinée, sa propre épitaphe. Nul musicien n'a, en tous cas, jamais trouvé plus nobles accents, ni plus déchirants. L'air de Didon est accompagné par les cordes, sur une basse obstinée, une gamme chromatique descendante, procédé que Bach utilisera dans le Crucifixus de la Messe en si mineur et Mozart dans la mort du Commandeur au premier acte de Don Giovanni. Mais ces airs de la reine désespérée ne sont pas les seules beautés de Dido and Æneas. Le chœur final, lui aussi repris deux fois, est une merveille, et puis encore l'ouverture, grave et dramatique, qui s'achève par un allegro fugué au moment où vont paraître les personnages ; l'air de Didon au premier acte : Ah ! Belinda, I am pressed with torment..., le récit fait par une servante, au second acte, de la mort d'Actéon ; les adieux d'Énée au troisième acte, et le chœur qui suit. Dido and Æneas est un des plus hauts sommets de l'art lyrique de tous les temps. Ce n'est point le seul chef-d’œuvre de Purcell : il y a dans The Fair Queen (la Reine des Fées, d'après Shakespeare) des beautés de même grandeur.
Purcell ne devait survivre que peu d'années — six, si l'on en croit M. Barclay Squire. Il mourut en effet le 21 novembre 1695, à l'âge de trente-sept ans, et il repose dans l'abbaye de Westminster, tout près de l'orgue qu'il joua. Une épitaphe latine dit : « Il vit, certes, et qu'il vive tant que résonneront les orgues voisines, tant que, par des chants harmonieux, la foule honorera Dieu. »
Dido and Æneas allait demeurer longtemps le seul opéra anglais — ou presque. Bien que Charles II aimât la musique, il n'aurait pu financer sur sa cassette les frais d'un théâtre d'opéra, comme Louis XIV ou comme l'empereur d'Autriche, car le Parlement, remarque Edward J. Dent, ne lui aurait pas accordé de gaspiller tant d'argent pour des « frivolités ». Le puritanisme s'en serait offensé. Cependant sous la reine Anne, un théâtre italien s'installa à Londres : Vanbrugh avait construit à Haymarket une salle immense pour Batterton, mais on s'aperçut que l'acoustique ne convenait point au drame et à la comédie tandis que la musique y sonnait bien. Durant deux siècles cette salle servit pour l'opéra italien ; elle fut incendiée deux fois ; on la réédifia : l'aristocratie avait pris l'habitude de s'y rendre, et cependant l'opéra était condamné à une ruine chronique : tous les deux ou trois ans, un syndicat de mélomanes y faisait faillite (*). Un autre le remplaçait. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'Opéra, malgré ces pertes énormes ne cessa jamais d'exister, jamais d'être le spectacle le plus select de Londres. Toujours quelques chanteurs anglais ou demi-anglais y paraissaient ; mais ils chantaient en italien. Sous la reine Anne, on y avait joué des ouvrages de Scarlatti, de Bononcini, traduits en anglais ; mais dès que l'on eut persuadé les chanteurs italiens de venir à Londres, les traductions furent arrêtées. A peine un seul opéra étranger fut-il traduit complètement et chanté en anglais durant le XVIIIe siècle ; et même jusqu'au milieu du XIXe, il n'y eut aucun principe établi selon lequel un opéra devait être traduit en anglais sans modifications, et joué sans mutilations (sauf quelques coupures nécessaires). Et quoique certains compositeurs anglais, comme lord Burghers, écrivissent des opéras en italien, il y eut à peine quelques opéras anglais composés entièrement dans cette langue.
(*) J'emprunte ces détails à l'excellente étude sur l'Avenir de l'opéra anglais, de Edward-J. DENT, en tête de la Création de l'Opéra anglais et « Peter Grimes », publiés sous la direction d'Eric Crozier (Paris, collection Triptyque, Richard-Masse, 1947).
En 1711, Händel fait jouer son Rinaldo improvisé en quinze jours à l'aide de fragments empruntés à ses précédents ouvrages. Il lui fallut rejoindre Hanovre, comme on le verra plus loin. Il revint, et obtint de la reine Anne une pension de deux cents livres. Mais le prince électeur de Hanovre accédant au trône d'Angleterre, lui tint rigueur d'avoir oublié de rentrer en Allemagne. Il fallut d'heureuses circonstances — la composition de Water Music assure-t-on — pour réconcilier le nouveau roi et le musicien. Händel recruta la troupe de la Royal Academy of Music, fondée en 1719 et y donna une quinzaine de ses opéras. Bononcini, dont il avait cependant joué les ouvrages, ouvrit un théâtre rival. Il avait la faveur du duc de Marlborough, et tint au King's Theatre jusqu'en 1732. Ayant fait jouer un madrigal de Lotti sous son nom, la supercherie fut découverte, et il dut quitter Londres pour Paris. La concurrence avait été si désastreuse pour Händel, que l'opéra fit faillite. Le public n'avait d'ailleurs jamais goûté pleinement la tragédie lyrique, et seule l'aristocratie fréquentait Haymarket, ce qui ne suffisait pas à en assurer la vie. Le peuple n'y venait point : il applaudit The Beggar's Opera, de John-Christopher Peepush, satire à la fois de l'opéra italien et de la vie anglaise qui, sous le titre d'Opéra de quat' sous, a retrouvé en ces dernières années un regain de faveur. Peepush en avait composé l'ouverture, Gay les autres parties, faites de chansons sur des airs empruntés au folklore ou aux couplets à la mode. Händel bien que comblé d'honneurs en Angleterre et enterré près de Purcell à Westminster appartient à l'histoire musicale de l'Allemagne où on le retrouvera tout à l'heure.

le Beggar's Opera, de Peepush (1728) ; scène du Jugement (acte III, scène 2) [peinture de W. Hogarth]
La Grande-Bretagne n'a plus produit de musiciens lyriques après ceux qu'on vient de citer, sauf les deux Arne, le père, Thomas-Augustine (1710-1778) et Michael, son fils (1741-1786). Le premier écrivit une trentaine d'opéras (y compris la musique de scène pour des tragédies de Shakespeare). Au nombre de ceux-ci, figure Artaxerces, sur des paroles anglaises (1762). Thomas Arne donna en outre deux oratorios, Abel et Judith. Il fut le premier à introduire des voix de femmes dans les chœurs des oratorios, en 1773. Mais il doit surtout sa célébrité au Rule Britannia dont il fit la musique sur des paroles de James Thomson, l'auteur des Saisons. Michael Arne composa quelques opéras représentés avec succès, mais vers 1770, il se consacra à l'alchimie et se ruina. Il revint ensuite à la musique et écrivit quelques musiques de scène pour les théâtres de Londres.
Edward J. Dent remarque que l'une des causes de l'absence de compositeurs lyriques en Angleterre est dans ce fait que très peu de chanteurs anglais étaient capables de jouer, alors que les acteurs, à leur aise sur la scène, étaient incapables de chanter. Les chanteurs, en effet, se consacraient à l'oratorio et se trouvaient dépaysés sur le théâtre. Sous le règne de Victoria, Covent Garden fut remis à neuf pour l'opéra italien en 1847. Une autre troupe italienne donna des saisons au His Majesty's Theatre concurremment avec celle de Covent Garden. En 1892, Covent Garden, où l'on joua les ouvrages de Wagner, cessa de s'appeler Opera Royal italien et devint Opera Royal. On y chanta fort rarement en anglais, les troupes appelées à interpréter les ouvrages étrangers, allemands, français, italiens, les chantant dans leur langue. Et les compositeurs anglais qui réussissaient à faire jouer quelque opéra de leur façon devaient les faire chanter en français ou en italien (*). Edward J. Dent ajoute : « Les connaisseurs des générations précédentes s'intéressaient seulement aux voix ; ils se rendaient à Covent Garden comme ils se seraient rendus à une exposition chevaline ou florale. Ce qui leur plaisait le plus, c'était faire montre de leur expérience. » L'Angleterre n'a pas eu le privilège de ces prétendus mélomanes pour lesquels l'interprète compte beaucoup plus que le compositeur et son œuvre. Mais il est certain que cette raison, ajoutée à toutes celles qu'on vient de dire, empêcha l'art lyrique anglais de prendre son essor. On se contenta de calquer sur les chefs-d’œuvre éprouvés les quelques opéras qu'un très petit nombre de compositeurs eurent l'audace — et il en fallait — d'écrire ; et ces chefs-d’œuvre étaient naturellement tous étrangers, italiens pour la plupart. Eussent-ils été tentés de montrer quelque originalité, qu'on ne les eût pas compris. Et c'est ainsi qu'il fallut attendre l'initiative du théâtre de Sadler's Wells pour remettre en scène, en 1941, à Hull, sous les bombardements, Dido and Æneas, et Thomas and Sally, de Arne, avant de créer des ballets et de monter Peter Grimes, de Benjamin Britten, manifestation éclatante d'une renaissance de l'opéra anglais.
(*) Edward-J. DENT, loc. cit., p. 14.

Masquerades and Operas [gravure satirique de W. Hogarth]
LE THÉATRE LYRIQUE EN FRANCE SOUS LOUIS XV
LA FOIRE — LA GUERRE DES BOUFFONS — LA NAISSANCE DE L'OPÉRA-COMIQUE
I
La période qui suit la disparition de Lully n'apporte point de changement notable à l'opéra français : les tragédies musicales, les ouvrages de style noble, restent calqués sur ceux qui avaient eu la faveur de la cour et du public au temps des fastes de Versailles. Marc-Anthoine Charpentier mis à part, tous les musiciens se montrent si dociles aux enseignements qu'ils ont tirés de Lully qu'on a peine à discerner aujourd'hui en quoi ils diffèrent les uns des autres.
Les ballets restent en grande faveur ; eux aussi sont construits comme ceux de la période précédente. Mais le goût des bergeries sentimentales va bientôt s'y manifester davantage, quand la liberté des mœurs, succédant sous la Régence à l'austérité des dernières années du Grand Roi, trouvera une compensation quelque peu hypocrite dans une affectation de sensibilité qui n'exclut pas la galanterie frivole. L'affabulation des livrets ne compte pas pour grand-chose : elle n'est que prétexte à « entrées » comme par le passé. On ne lui demande que de fournir tant bien que mal un canevas. Ce qui compte, ce qui relève certains de ces ouvrages, c'est la qualité de la musique dont sait les orner un compositeur comme Campra ou comme Destouches. C'est par là qu'ils se sont conservés et qu'ils ne cessent point de plaire aujourd'hui.
De ces ouvrages, l'Europe galante reste le type achevé. Le succès en fut si vif, que Campra, son auteur, d'abord maître de chapelle de l'église Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence, puis des cathédrales de Toulouse et de Paris, donna sa démission de chanoine pour se consacrer plus complètement à la musique. La première représentation d'un précédent ballet, Bacchus et Silène, donnée au château du Raincy en juin 1679 chez la princesse Palatine, avait été triomphale. On l'applaudit si fort que Campra décida de travailler pour l'Opéra et entreprit immédiatement l'Europe galante. Elle y fut en effet donnée quatre mois plus tard, le 16 octobre. Là ce fut un succès éclatant, et Campra, se hâtant d'en profiter, entama un ouvrage du même genre, le Carnaval de Venise, non moins favorablement accueilli. Il allait produire ainsi quelque vingt-cinq opéras ou ballets, et partager avec son émule André-Cardinal Destouches la constante faveur du public.
Son style, plus fleuri que celui de Lully, accuse cependant plus nettement le rythme des airs de danse. Campra montre le souci de l'interprétation chorégraphique en facilitant la tâche des danseurs. La forlane de l'Europe galante, restée célèbre, est le type achevé de sa manière. Dans la musique vocale, il aime répéter les mêmes phrases, les orner de vocalises. Ce n'est point encore l'abus où tomberont tant d'autres musiciens, mais c'est déjà la marque d'une orientation nouvelle vers un style qui bientôt manquera de simplicité.
Les Éléments d'André-Cardinal Destouches, élève de Campra, portent comme sous-titre « Ballet du Roi, en quatre entrées et un prologue ». Le livret était de Roy, et pour la musique, Destouches avait trouvé en La Lande un collaborateur précieux. L'ouvrage fut représenté aux Tuileries le 22 décembre 1721. Le compte rendu que publia le Mercure de France donne une exacte idée de la richesse du spectacle : « A la troisième scène de la première entrée, le palais de Junon s'ouvre. Elle paraît sur son trône, les Heures à côté d'elle, avec les Aquilons et les Zéphirs. Iris est derrière le trône, sur son arc. Cette décoration est des plus galantes : elle est formée par des colonnes de nuées, autour desquelles voltigent toutes sortes d'oiseaux peints par M. Houdry, de l'Académie royale de peinture... Dans l'épilogue qui termine le ballet, le roi, représentant le Soleil, paraît sur son char, environné des signes du Zodiaque, et suivi des quatre parties du Monde... De chaque côté du proscenium, on a ménagé deux balcons, l'un au-dessus de l'autre pour les chœurs : les femmes en bas, les hommes au-dessus ; l'orchestre pour les instruments, en tout à fait hors-d’œuvre, mais attenant le théâtre... Le Soleil qui paraît dans le fond du théâtre à la fin de la dernière entrée est très ingénieusement composé : le disque en est lumineux et les rayons bien imités par le moyen d'une eau safranée dans des tuyaux de verre. » Que voulait dire le rédacteur du Mercure de France par les mots : l'orchestre est placé en tout à fait hors-d’œuvre ? On imagine mal qu'il ait pu se tenir loin des chœurs qu'il devait soutenir... Cependant la description est à retenir : elle montre le soin apporté par les décorateurs et le metteur en scène aux moindres détails du spectacle. Tout doit plaire aux yeux ; mais il importe aussi que les chœurs, immobiles et gênants par le nombre des chanteurs qui les composent, n'encombrent pas le plateau. Il faut néanmoins que le chef les tienne sous sa baguette. Il est curieux de noter que leur disposition dans des balcons en avant-scène sera celle que, se trouvant devant le même problème, on adoptera en 1949 à l'Opéra, pour la représentation de Lucifer. En même temps, l'importance donnée aux machines, le luxe du décor en trompe-l’œil, tous ces soins matériels exigés par le genre en font la faiblesse et vont bientôt servir d'argument à ceux qui voient la vraie grandeur du théâtre lyrique dans la qualité de la musique et des émotions qu'elle traduit — ou qu'elle fait naître.

costumes de Gillot pour les Eléments, ballet de Destouches (1725)

décor de Slodtz pour la IVe entrée du ballet des Eléments (reprise au théâtre de Versailles en 1763) [dessin, crayon et plume]
Au vrai, cette qualité ne manque cependant pas aux ouvrages de La Lande et de Destouches. Mais c'est bien plus lorsqu'ils sont libérés des servitudes que leur impose la scène, c'est dans les œuvres destinées au concert qu'ils sont à l'aise pour l'exprimer.
A propos de l'Europe galante, fut réglée pour la première fois en France, la question des droits d'auteur, grâce à l'énergie de Campra et de La Motte, auteur du livret. Ils reçurent chacun cent livres pour les dix premières représentations, cinquante livres ensuite jusqu'à la vingtième ; après quoi, l'ouvrage devint la propriété de l'Académie de musique. C'est encore l'Europe galante qui inaugure ces spectacles coupés dont la vogue durera pendant une partie du XVIIIe siècle. Enfin Combarieu signale en outre que l'organisation matérielle du théâtre est encore à ce moment des plus rudimentaires. Ce ne fut qu'après 1715 que les bougies furent substituées aux chandelles pour l'éclairage. Le danger d'incendie n'en fut d'ailleurs qu'à peine diminué : le 6 avril 1763, à huit heures du matin, par l'imprudence d'un balayeur qui avait posé un chandelier tout près d'un câble de manœuvre, celui-ci s'étant enflammé, se libéra du contrepoids, remonta tout brûlant dans les cintres, et communiqua le feu aux toiles et aux autres câbles. L'incendie consuma entièrement la scène et la salle de l'Opéra, qui était alors au Palais-Royal. Le 8 juin 1791, cette salle, entièrement reconstruite, fut de nouveau la proie des flammes.

incendie de la première salle du Palais-Royal à Paris en 1763 [gravure coloriée de l'époque]
Quant aux gens qui prétendaient entrer à l'Opéra sans bourse délier, le nombre n'en cessait de croître, si bien que plusieurs ordonnances et arrêtés furent promulgués sans parvenir à supprimer entièrement ces abus. Ainsi, le 28 novembre 1713, le roi ordonne : « Sa Majesté étant informée... défend aux Officiers de sa Maison, à ses gardes, gendarmes, chevau-légers, mousquetaires, d'entrer à l'Opéra sans payer, et à tous domestiques portant livrée, sans exception aucune sous quelque prétexte que ce soit, d'y entrer, même en payant. (*) » L'Opéra devait rester un plaisir aristocratique, et on y redoutait les rixes.
(*) Cf. COMBARIEU, loc. cit., t. II, pp. 106 et sq.
Mais ce ne fut point seulement à la cour et à l'Académie royale de musique que fleurit l'art lyrique à cette époque. La petite cour de la duchesse du Maine, (petite-fille du grand Condé, et épouse du second fils de Louis XIV et de la marquise de Montespan) fut un des cercles artistiques les plus brillants de toute l'Europe dans le premier tiers du XVIIIe siècle. La duchesse attira dans son domaine de Sceaux quantité de beaux esprits, parmi lesquels des musiciens comme Jean-Joseph Mouret. Les « Nuits de Sceaux » — c'est ainsi qu'on appela ces réunions — faisaient bonne part à la musique, et si Mouret fut surnommé le Musicien des Grâces, à cause du titre d'un ballet qu'il fit représenter en 1733, il faut aussi voir en lui un des compositeurs qui exercèrent une influence décisive sur l'évolution de l'art lyrique par le souci qu'ils eurent de la vérité d'expression. Mouret fut un des créateurs de l'Opéra-Comique, et nous l'y retrouverons bientôt.
Le début du XVIIIe siècle vit s'ouvrir une querelle qui allait durer fort longtemps : elle s'éleva sur le point de savoir quelle musique l'emportait de l'italienne ou de la française. En 1702, l'abbé Raguenet publiait une vive attaque contre Lully, et l'intitulait Parallèle des Italiens et des Français. La riposte vint du garde des sceaux du Parlement de Rouen, La Viéville de Fréneuse, qui deux ans plus tard, fit paraître à Bruxelles une Comparaison de la Musique italienne et de la Musique française, véritable panégyrique de Lully.
Un peu plus tard, à propos de Rameau, la querelle devint bataille. Jean-Philippe Rameau n'aborda le théâtre que fort tard ; mais déjà ses pièces pour le clavecin, son Traité de l'Harmonie réduite à ses principes essentiels, montraient en lui non seulement un compositeur d'une originalité singulière, mais aussi un théoricien dont les vues profondes devaient exercer une influence considérable sur l'art des sons. Il donne d'abord à la Foire (et nous l'y retrouverons lui aussi un peu plus loin) quelques comédies musicales ; puis, assuré du lendemain en devenant maître de musique du fermier-général La Pouplinière, il écrit un opéra, Samson, sur un livret de Voltaire. L'Opéra le refuse, à cause du sujet biblique. Ce n'est qu'en 1733, à l'âge de quarante ans, qu'il compose Hippolyte et Aricie, tragédie lyrique en cinq actes et un prologue, sur un livret de l'abbé Pellegrin. En 1735, ce sont les Indes galantes, ballet héroïque en trois actes et un prologue, sur un livret de Fuzelier. Ainsi vont alterner dans ses productions, tragédies lyriques et opéras-ballets. Le bonheur de Lully avait été de rencontrer Quinault, comme ce fut un peu plus tard la chance de Gluck de trouver Raniero de Calzabigi ; le malheur de Rameau fut de se contenter des livrets de Pellegrin. Leur faiblesse a nui grandement à ses magnifiques tragédies. Mais Rameau se souciait trop peu de ce qui servait de prétexte à la musique : aujourd'hui encore, chaque fois qu'on en fait une reprise, la médiocrité des livrets en empêche le maintien au répertoire. Heureusement ce fut Gentil Bernard qui lui fit le livret de Castor et Pollux (1737). L'ouvrage demeura à l'affiche de l'Opéra pendant quarante-sept ans, et il y reparut plusieurs fois depuis. Heureusement aussi les opéras-ballets permettent une mise en scène dont la variété est un élément de succès : la très belle reprise des Indes galantes en 1952 a montré combien la musique y trouvait un regain de faveur.

personnages de Castor et Pollux, opéra de Rameau (1737) [gravure gouachée de Wirsher ; Musée de l'Opéra]
Quand on lit les critiques du temps sur les opéras de Rameau, leur violence étonne ; elles débordent de passion, et les injures même s'y donnent libre cours au milieu des perfidies. Les « lullistes » déclarèrent la musique de Rameau « barbare, bruyante, intolérable » ; sa mélodie était « sans âme » ; les musiciens de l'orchestre, rebutés, affirmait-on, disaient n'y rien comprendre et se fatiguer de jouer sans arrêt durant tout le temps de la représentation, sans pouvoir même éternuer. L'abbé Desfontaines qualifie Rameau de « distillateur d'accords baroques », et Campra dit au prince de Conti : « Il y a assez de musique dans Hippolyte et Aricie pour faire dix opéras » — ce qui pourrait être un éloge, mais était certes pris dans un sens malveillant. Jean-Jacques Rousseau se fera l'écho de ces reproches qui nous semblent aujourd'hui si peu fondés. Il les ramassera, les développera non sans perfidie.
Nous voyons maintenant en Rameau le père de la musique moderne, et moins par ses écrits théoriques que par l'exemple donné dans ses ouvrages. A distance, le style de Rameau nous semble plus proche de celui de Lully qu'il ne le parut aux contemporains, à cette différence que nous le trouvons immédiatement beaucoup plus original. Lully, en effet, n'invente à peu près rien, mais utilise habilement tout ce qu'il connaît. Rameau est au contraire un véritable créateur qui affirme sa forte personnalité aussi bien par la hardiesse de son écriture harmonique que par ses trouvailles mélodiques. Sa musique de danse est faite avec tant de soin qu'elle offre toutes les qualités de la symphonie. Ses qualités propres le feront reconnaître par Debussy pour le véritable père de l'art contemporain, pour le premier et le plus grand musicien vraiment français, pur de toute influence étrangère, depuis les maîtres polyphonistes de la Renaissance ; mais ce qui fait l'admiration de Debussy est précisément ce que lui reprochent le plus amèrement les « lullystes » au sortir de l'Opéra. L'homme avait un caractère difficile ; ses boutades restées légendaires excitèrent l'acharnement de ses détracteurs. Opposant, affectant même une complète indifférence aux jugements de ceux qu'à bon droit il méprisait, il passa pour égoïste et dur. On dit qu'il était heureux du tapage fait autour de lui. En fait ce tapage fut fort bruyant : le Neveu de Rameau nous en a conservé l'écho. Avec les Bijoux indiscrets, Diderot nous fait comprendre la violence de la passion dont furent animés lullystes et ramistes (ironiquement, on disait alors ramoneurs, parce que la musique de Rameau étant « triste et noire », ceux qui l'aimaient devaient être comparés à des barbouillés de suie).
La première représentation de Dardanus, le 19 novembre 1739, excita tellement la curiosité que toutes les places étaient déjà retenues huit jours avant la soirée, et pour plus de deux semaines. Et l'on allait répétant que la « conjuration des ramoneurs » rassemblait plus de mille partisans, décidés tous à applaudir « avec fureur » pour faire le succès de l'œuvre nouvelle. Ce fut un succès, en effet, mais payé de méchants articles, où la musique est qualifiée de « scientifique », de « bourrue », de « mécanique difficile ». On dit qu'elle « secouerait les nerfs d'un paralytique ». L'abbé Desfontaines s'écrie : « L'inintelligibilité, le galimatias, le néologisme veulent donc passer des discours dans la musique ? » Jean-Jacques Rousseau ramassera ces arguments injurieux pour dauber plus fort le pauvre Rameau, coupable d'avoir devancé son temps de plus d'un demi-siècle.


à gauche : le chanteur Jélyotte (1713-1796) dans Dardanus, opéra de Rameau (1739) - à droite : costume pour Zoroastre, opéra de Rameau (1749) [dessins aquarellés ; Musée de l'Opéra]
En tout, il a été en effet un précurseur. Dans Platée, pendant le carnaval, le 4 février 1749, Rameau se révèle le véritable créateur d'un genre qui ne connaîtra la fortune que plus de cent années après lui : l'opérette. Jamais le livret d'Autereau ne lui semble assez gai, assez frondeur, et plus de trois fois, il le fait remanier. Le sujet en est la jalousie de Junon, et les dieux de l'Olympe y sont représentés de manière grotesque, comme ils le seront dans Orphée aux Enfers ou dans la Belle Hélène. Les flûtes accompagnant le chœur chanté dans les coulisses imitent le coucou ; le hautbois et le second violon, par une succession de quartes, coassent comme les grenouilles.
Il est fort difficile de définir le style de Rameau, et tous ceux qui l'ont tenté n'y sont parvenus qu'en comparant ses ouvrages à ceux de ses contemporains, de ses devanciers et même de ses successeurs ; car son style est comme tout ce qui vient de lui, d'un précurseur.
Fermeté et clarté caractérisent la ligne mélodique de ses récitatifs ; de ses airs. En vérité il n'y a d'ailleurs point de différence chez lui entre le récitatif et l'air pour ce qui est de la construction de la mélodie. Il demande à l'un comme à l'autre d'exprimer par la musique sentiments, états d'âme et passion. Nul ornement inutile, mais quand on en rencontre, c'est qu'ils ajoutent quelque chose qui vient renforcer l'expression.
Louis Laloy en fait très justement la remarque dans son livre pénétrant (*) : chez Rameau, sous la mélodie, toujours l'harmonie affleure : d'où résulte que son style est à la fois très serré et très libre ; on ne changerait, on n'ajouterait ni retrancherait rien à sa phrase musicale, à son accompagnement harmonique, sans la détruire complètement. Elle exprime nettement, sans ambiguïté ce qu'elle veut dire, rien de moins, rien de plus. Elle y suffit. Et cela explique peut-être le mot qu'il dit un jour à une interprète qui se plaignait de la rapidité du tempo de l'air qu'elle avait à chanter : « Qu'importe qu'on n'entende pas les mots, répondit-il, l'essentiel est qu'on entende ma musique. » On a cité cela comme une boutade, comme une marque d'un excessif orgueil. Mais non : ce que Rameau exigeait, c'est que le mouvement fût vrai, que, par sa vivacité, il traduisît exactement la nature des sentiments qui devaient agiter le personnage, quitte à ce que le sens des mots devînt moins aisément compréhensible. On voit combien cette exigence s'écarte du soin pris par Lully de nettement détacher chaque syllabe et de s'en tenir à une déclamation calquée sur celle des acteurs du Théâtre Français au temps de Racine et de la Champmeslé. Il a dit ailleurs : « Une musique sans mouvement perd toute sa grâce, on ne peut même inventer de beaux chants sans ce mouvement. » Sa « prosodie » est donc bien loin de se modeler sur l'emphase des acteurs tragiques. Elle est vivante et souple ; elle lui est dictée par le sens de la phrase, par son contenu émotionnel ; elle ne se préoccupe pas de faire, comme on dit, un sort aux mots.
(*) Louis LALOY, Rameau (collection des Maîtres de la Musique, Paris, Alcan). — Cf. aussi Georges MIGOT, Jean-Philippe Rameau (collection les Grands Musiciens par les Maîtres d'aujourd'hui, Paris, Delagrave).
Pour ce qui est de l'harmonie, il faut citer ce qu'il en dit lui-même, car ses ouvrages sont comme une illustration de ses propositions :
Il est certain que l'harmonie peut émouvoir en nous différentes passions, à proportion des accords qu'on y emploie. Il y a des accords tristes, languissants, tendres, agréables, gais et surprenants ; il y a encore une suite d'accords pour exprimer les mêmes passions. La douceur et la tendresse s'expriment quelquefois assez bien par emprunts et par superpositions (septièmes diminuées, et neuvièmes et onzièmes) plutôt mineures que majeures, faisant régner les majeures qui peuvent s'y rencontrer, dans les parties du milieu plutôt que dans les extrêmes. Les langueurs et les souffrances s'expriment parfaitement bien avec des dissonances par emprunts (septièmes diminuées) et surtout avec le chromatique. Le désespoir et toutes les passions qui portent à la fureur, ou qui ont quelque chose d'étonnant, demandent des dissonances de toute espèce non préparées ; et surtout que les majeures règnent dans le dessus. Il est beau, même dans certaines expressions de cette nature, de passer d'un ton à un autre par une dissonance non préparée.
On comprend en lisant cela que Debussy ait trouvé dans Rameau l'ancêtre auquel il voulut rattacher son propre génie. Et d'autant mieux, que ces phrases du Traité de l'Harmonie, Rameau en fit couramment l'application dans ses propres ouvrages. Il suffirait de citer l'air des Prêtresses d'Hippolyte et Aricie, l'air du sommeil de Dardanus (où se trouvent, alternativement, les deux accords de tonique (sol, si bémol, ré) et de dominante avec neuvième (ré, fa dièse, la, do, mi bémol) et cent autres exemples. Mais jamais chez lui le chromatisme n'amène une confusion des tonalités : il a le sens de la valeur expressive des accords ; il estime que cette valeur de l'harmonie est égale au pouvoir de suggestion de la mélodie, qu'elle la complète. Le merveilleux quatuor vocal dans l'entrée des Fleurs, des Indes galantes, avec son accord de neuvième, en est un exemple. Jamais musicien ne s'est montré plus sûr de ses moyens, plus heureux dans leur emploi.
Rameau parut au théâtre trop tôt ou trop tard, et ce fut grand dommage : vingt-cinq ans plus tôt, il eût, en pleine possession de sa technique, orienté la musique française sur des voies qu'elle ne devait retrouver que bien longtemps après, et il n'eût pas subi les méchantes attaques de tant d'ennemis. Mais il a laissé, comme dit Louis Laloy, « une musique de certitude et de clarté », et la force de son esprit méthodique fut telle « qu'elle le conduisit loin des chemins battus, en plein avenir ».

reprise des Indes galantes à l'Opéra de Paris (1952) ; le Palais d'Hébé (costumes et décor de J. Dupont) [photo Lipnitzki]

reprise des Indes galantes ; les Sauvages (costumes et décor de Chapelain-Midy) [photo Erlanger]
II
Au XVIIIe siècle naît un genre dont l'importance ne va plus cesser de croître pendant une très longue période : l'opéra-comique. A vrai dire il a commencé un peu plus tôt, à la Foire Saint-Germain qui s'ouvrait chaque année le 3 février sur la rive gauche et y occupait deux grandes halles sur les terrains dépendant de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, et dont l'origine remonte au règne de Louis XI. Ce fut là que s'établit le premier café public, près des salles de danse et des théâtres, entourés des boutiques des marchands. Ce terrain tenait à peu près l'emplacement du marché et de la place Saint-Sulpice. La foire fut supprimée en 1789.
La Foire Saint-Laurent commençait le 9 août, la veille de la fête du saint, et sa durée d'abord fort courte, fut fixée à huit jours, puis à quinze, pour être enfin étendue du 28 juin au dernier jour de septembre lorsqu'elle se transporta, en 1661, dans un enclos de cinq arpents, appartenant aux lazaristes, et situé entre Saint-Lazare et les Récollets. On y édifia des loges et des boutiques fermées, bordant des rues plantées d'arbres. Elle eut ses théâtres de marionnettes, ses marchands de jouets, de pâtisseries, d'étoffes, de toutes sortes d'ustensiles, et bien entendu, ses cabarets, ses bals, ses montreurs de curiosités et ses baladins. Elle aussi fut fermée en 1789.
Les forains donnaient des spectacles mêlés de chants. Bien des fois les Comédiens-Français, usant de leur privilège, tentèrent de leur interdire de représenter toute espèce d'ouvrages dialogués. La ruse des forains finissait toujours par triompher des obstacles légaux dressés devant eux. L'Opéra, à son tour, intervint pour leur faire défense de chanter dans leurs représentations. Peine perdue, mais la lutte fut fertile en épisodes héroï-comiques. Le 26 novembre 1716, un arrêt en bonne et due forme sanctionna un contrat passé entre les syndics de l'Opéra, les sieur et dame Saint-Edme, et la dame de Baune, aux termes duquel lesdits sieur et dames obtenaient le privilège de représenter aux foires « des spectacles mêlés de chant, de danse et de symphonies, sous le nom d'Opéra-Comique » sans que cette permission pût être transportée à personne, le tout moyennant la somme de trente-cinq mille livres par année, payée à l'Opéra. La dame de Baune, en 1717, était seule en possession du privilège ; un an plus tard, elle était ruinée.
La troupe de Dominique (directeur de la Comédie-Italienne) lui succédant ouvrit le 22 août 1721 son théâtre de la Foire Saint-Laurent.

acteurs du Théâtre italien à Paris vers 1730 [croquis à la sanguine]
Qu'étaient ces théâtres ? Qu'y représentait-on ? Pour bien comprendre ce qui fit leur succès, il est bon de se souvenir que, simultanément, à Naples, à Londres, à Paris, une réaction contre la solennité compassée de la tragédie lyrique se dessine à ce moment. En France, c'est sur les tréteaux de la foire que s'installent les parodies comparables au Beggar's Opera : on y raille les héros à panache, et le succès de ces petits ouvrages souvent spirituels, parfois grossiers, mais toujours mordants, est d'autant plus vif que l'Opéra est devenu tout à la fois un centre mondain et spirituel qui absorbe la plus grande part de l'activité musicale de l'époque. Les pièces de musique de chambre, les suites symphoniques sont en étroit rapport avec le ballet et semblent aussi bien destinées au théâtre qu'au concert. Le Français est frondeur : les querelles le passionnent. Celles qui naissent au sujet de l'Opéra s'agrémentent de « potins » comme on dirait aujourd'hui, qui mêlent aux questions de principes des commérages dont les célébrités du moment font les frais. Les démêlés de la Foire avec les Comédiens-Français, avec l'Opéra font une fructueuse publicité aux petits spectacles d'opéra-comique où l'on ne se prive pas de faire rire aux dépens de l'adversaire. Le genre parodique est naturellement le plus souvent employé : il permet des allusions personnelles, des imitations où l'on grossit à plaisir les travers des auteurs et des interprètes célèbres. Les paroles de ces saynètes sont adaptées aux airs des opéras en vogue que l'on veut ridiculiser, ou bien encore, lorsqu'il faut redouter les fâcheuses conséquences d'un arrêt de justice, on revient aux « timbres » des chansons en vogue. Ces vaudevilles sont désignés dans les brochures imprimées par les premiers mots du couplet ; plus rarement, on a recours à une musique nouvelle. Mais tout cela, qui n'est guère relevé, fera dire à Voltaire, non sans acrimonie : « L'Opéra-Comique n'est autre que la foire renforcée ; le siècle présent n'est guère composé que des excréments du grand siècle de Louis XIV. »
Mais cela qui est vrai au début du XVIIIe siècle va changer assez vite : on voit des musiciens comme Rameau ne point dédaigner les théâtres de la Foire, des compositeurs comme Mouret se faire les fournisseurs attitrés de ces troupes foraines. Jusqu'aux dernières années du XIXe siècle, l'opéra-comique gardera la marque de ses origines : obligatoirement, à la salle Favart, le « parlé » alternera avec les airs chantés, et le genre français se distinguera de l'italien par cette survivance, qui exclut à peu près de l'opéra-comique français le récitatif.
Cependant tout le XVIIIe siècle retentit des démêlés des théâtres de la Foire avec les théâtres réguliers, Opéra, Comédie-Française, Comédie-Italienne. L'histoire en est confuse, car les épisodes de cette guerre d'usure, où défaites et victoires restent indécises, s'enchevêtrent. La liste est longue des directeurs contraints de fermer leurs théâtres, usant de ruse pour les rouvrir, se livrant à un véritable jeu de cache-cache dont le public s'amuse autant que des pièces représentées sur leurs tréteaux. Gilliers, Allard, Vanderberg, Monnet, dépensent des trésors d'ingéniosité pour ne point succomber. L'esprit de Scapin et d'Arlequin les inspire.
En 1746, la Serva padrona avait été représentée dans son texte original à la Comédie-Italienne. Le 1er août l'ouvrage de Pergolèse reparaissait à l'Opéra, mais, cette fois, dans une version française. Ce fut le prétexte d'une interminable querelle qui porte dans l'histoire le nom de Guerre des Bouffons (*). Les ennemis de Rameau trouvèrent dans la Servante maîtresse de nouveaux arguments. Au style « trop savant » de Rameau, ils opposèrent la transparente simplicité du maître italien. Ils prêchaient un « retour à la nature », une déclamation lyrique calquée sur le débit de la parole. Ils trouvèrent en Jean-Jacques Rousseau un champion véhément.
(*) Elle dut son nom à ce que l'on appelait « bouffons » les acteurs de la troupe italienne jouant l'opera buffa.
Le 30 juillet de cette année 1752, la troupe de Jean Monnet, à la Foire Saint-Laurent, avait représenté les Troqueurs, opéra-comique en un acte, paroles de Vadé et musique de Dauvergne. Le livret reprend un sujet déjà bien souvent exploité : Lubin et Lucas croient bon d'échanger leurs fiancées ; celles-ci, informées de ce dessein, savent s'y prendre de telle façon que les deux paysans renoncent à leur projet. Le succès fut vif ; l'ariette « On ne peut trop tôt se mettre en ménage » fut vite populaire. C'est de cette première représentation des Troqueurs que l'on fait partir ordinairement l'histoire de l'opéra-comique français.
Il ne suffit pas à Rousseau d'écrire sa Lettre sur la Musique françoise, il voulut avec le Devin du village, montrer aux musiciens de ce pays ce qu'il fallait faire. La lettre s'achevait par cette violente conclusion :
Le Monologue d'Armide, de Rameau, a toujours fait, et je ne doute pas qu'il ne fît encore un grand effet au théâtre, parce que les vers en sont admirables et la situation vive et intéressante. Mais sans les bras et le jeu de l'Actrice, je suis persuadé que personne n'en pourrait souffrir le récitatif, et qu'une pareille musique a grand besoin du secours des yeux pour être supportable aux oreilles. Je crois avoir fait voir qu'il n'y a ni mesure ni mélodie dans la Musique Françoise, parce que la langue n'en est pas susceptible ; que le chant françois n'est qu'un aboyement continuel, insupportable à toute oreille non prévenue ; que l'harmonie en est brute, sans expression, et sentant son remplissage d'Écolier ; que les airs François ne sont pas des airs ; que le récitatif François n'est point du récitatif. D'où je conclus que les François n'ont point de Musique et n'en peuvent avoir ; ou que si jamais ils en ont une, ce sera tant pis pour eux.
Et Rousseau ajoutait en note : « Je n'appelle pas avoir une Musique, que d'emprunter celle d'une autre langue pour tâcher de l'appliquer à la sienne, et j'aimerais mieux que nous gardassions notre maussade et ridicule chant, que d'associer encore plus ridiculement la mélodie italienne à la langue françoise. Ce dégoûtant assemblage qui, peut-être, fera désormais l'étude de nos musiciens, est trop monstrueux pour être admis, et le caractère de notre langue ne s'y prêtera jamais. » En quoi, violence des termes mise à part, il avait raison, précisément parce qu'il avait tort de refuser aux musiciens français, à Rameau singulièrement, la possibilité de faire une musique susceptible de s'accorder au génie de la langue française ; et il est curieux de rapprocher de ce texte de Rousseau, la réfutation qu'il trouve dans la Correspondance de Romain Rolland et de Richard Strauss à propos de Pelléas et Mélisande : « Ce que vous appelez la « Nonchalance der Declamation » est souplesse et variété psychologique. Nous n'avons pas une seule façon d'accentuer un mot une fois pour toutes. Il est accentué différemment selon le sens de la phrase, et surtout suivant le caractère de celui qui parle (*). » Et s'il est un moyen de marquer ces nuances, c'est bien à la musique qu'il appartient.
(*) Cahiers Romain Rolland (n° 3), Richard Strauss et Romain Rolland, Correspondance, avant-propos de Gustave Samazeuilh (Paris, Albin Michel, 1951, pp. 45-46).
Rousseau ne fit pas autre chose dans le Devin du village que de s'y efforcer (sans atteindre d'ailleurs son but, car il n'était pas assez bon musicien pour y parvenir, et l'eût-il été que le sujet choisi était trop enfantin pour lui en donner l'occasion). L'ouvrage fut joué le 18 octobre 175 2 devant la Cour à Fontainebleau, puis à l'Académie royale de musique le 1er mars 1753. Il eut un énorme succès, dû surtout à sa naïveté presque puérile. On était « sensible », et devant le roi, devant un public blasé, l'ouvrage trouvait un auditoire prêt à s'émouvoir ; dans ses Confessions, Rousseau a complaisamment rapporté que « Sa Majesté ne cessait plus de chanter avec la voix la plus fausse de son royaume » l'air de Colette :
J'ai perdu mon serviteur,
J'ai perdu tout mon bonheur.
Retour à la simplicité, à la nature ; mais marque d'impuissance à construire le moindre développement symphonique, à trouver dans la musique la traduction expressive d'un sentiment. Et sans doute faut-il voir dans la conscience qu'il eut de ce qui lui manquait, une des raisons de son acharnement contre Rameau : « L'abbé Du Bos, écrit-il dans sa Lettre sur les ouvrages de Rameau, se tourmente beaucoup pour faire honneur aux Païs-Bas du renouvellement de la musique, et cela pourrait s'admettre si l'on donnait le nom de Musique à un continuel remplissage d'accords. Mais si l'harmonie n'est que la basse commune et que la mélodie seule constitue le caractère, non seulement la musique moderne est née en Italie, mais il y a quelque apparence que dans toutes nos langues vivantes, la Musique italienne est la seule qui puisse réellement exister. Du temps d'Orlan et de Goudimel, on faisait de l'harmonie et des sons ; Lully y a joint un peu de cadence ; Corelli, Buononcini, Vinci et Pergolèse sont les premiers qui aient fait de la musique. » Voilà qui est péremptoire autant qu'absurde.
La Querelle des Bouffons s'amplifiait et s'envenimait. On fut « bouffon » avec les encyclopédistes, avec Grimm et d'Holbach. On fut « antibouffon » avec Cazotte, Rameau (naturellement), l'abbé Fréron, le P. Castel. Les adversaires multipliaient les pamphlets, tels que la Lettre à une Dame d'un certain âge sur l'Opéra, de d'Holbach, le Petit Prophète de Bœhmischbrode, de Grimm et Diderot, les lettres de Rousseau déjà citées. Laissons à celui-ci le soin de peindre la violence de la querelle : « Tout Paris, écrit-il, se divisa en deux partis, plus échauffés que s'il se fût agi d'une affaire d'État ou de religion. L'un, plus puissant, plus nombreux, composé des grands, des riches, des femmes, soutenait la musique française ; l'autre, plus vif, plus fier, plus enthousiaste, était composé des vrais connaisseurs, des gens à talent, des hommes de génie. Son petit peloton se rassemblait à l'Opéra sous la loge de la reine. L'autre parti remplissait tout le reste du parterre et de la salle, et son foyer principal était sous la loge du roi. Voilà d'où vient ce nom des partis célèbres dans ce temps-là, le Coin du Roi et le Coin de la Reine. Le Coin du Roi voulut plaisanter ; il fut moqué par le Petit Prophète ; il voulut se mêler de raisonner, il fut écrasé par la Lettre sur la Musique française. » On ne saurait évidemment parler de soi et de ses écrits avec plus de modestie. On ne saurait se montrer plus injuste non plus que Rousseau lorsqu'il reproche à Rameau « ces imitations, ces doubles dessins, ces basses contraintes qui ne sont que des monstres difformes ». Il est étrange de reprocher aux Français de faire une musique française, comme il serait injuste de s'étonner que les Italiens fissent une musique italienne. Verdi a dit là-dessus, cent-quarante ans plus tard, les choses les plus sages dans sa réponse à Hans de Bülow : « Vous êtes les fils de Bach, nous les fils de Palestrina. Il est bon que les artistes du Nord et du Sud aient des tendances diverses. Tous devraient maintenir les caractères propres de leur nation. » Il est fort naturel aussi que les Français soient les fils de Rameau, comme le furent plus ou moins les meilleurs d'entre eux — et comme ils auraient sans doute continué de l'être —, si, bientôt après, la venue de Gluck n'avait soulevé une nouvelle querelle (qui ne fut, en réalité, qu'une reprise de la guerre des Bouffons).
On a peine à comprendre aujourd'hui les raisons qui firent le succès du Devin du village, ou plutôt pourquoi l'on attacha tant d'importance à une œuvrette qui n'en avait aucune. Pour l'entendre, il faut se souvenir de ce qui se passa dans le même temps au théâtre de drame et de comédie. Nivelle de la Chaussée fait jouer le Préjugé à la mode en 1735, et il y mêle quelques scènes comiques aux scènes pathétiques. Mais six ans plus tard, en 1741, dans Mélanide, il n'y a plus place pour le rire. Son succès est énorme : les femmes vont « pleurer » au théâtre avec délices. Voltaire dont l'esprit caustique commence par se moquer du genre bâtard, ne tarde point à suivre la mode et il écrit l'Enfant Prodigue et Nanine ou le Préjugé vaincu (1749).
On dispute ; les arguments qu'invoquent les partisans de la « comédie larmoyante » sont ceux du Coin de la Reine dans la querelle des Bouffons : ils croient défendre la vérité, la simplicité, la nature. Ils attaquent l'emphase de la tragédie à cothurne, comme les autres le style ampoulé de l'opéra. L'influence de La Chaussée va s'exercer profondément et longtemps ; des créateurs originaux comme Diderot et Beaumarchais n'y échapperont pas. Sedaine donnera en 1765, le modèle du genre nouveau avec le Philosophe sans le savoir, et Sedaine, librettiste de Philidor, de Monsigny, de Grétry, exercera une influence certaine sur ses musiciens. Dans l'art lyrique, l'optimisme aimable n'évite que de justesse la pure niaiserie ; le sentimentalisme banal de La Chaussée, c'est celui du Devin du village, et c'est la raison de son succès.
Jamais le parallélisme de l'évolution des arts à une même époque n'a été plus net qu'à ce moment : c'est partout le mélange de réalisme et d'attendrissement : Chardin, Greuze qui se dit prédestiné à peindre la vertu. Si faible qu'ait été la partition du Devin, le lyrisme de Rousseau a donc exercé une très grande influence ; mais ce n'est pas seulement par le Devin que Jean-Jacques fit école. Son Pygmalion a trouvé d'illustres imitateurs. Là, il est original : il invente « un genre de drame dans lequel les paroles et la musique, au lieu de marcher ensemble, se font entendre successivement, et où la phrase parlée est en quelque sorte annoncée par la phrase musicale. En employant cette méthode, on réunirait le double avantage de soulager l'acteur par de fréquents repos, et d'offrir au spectateur français l'espèce de mélodrame le plus convenable à sa langue ». Ce qui guide Rousseau, ici encore (comme si Rameau ne venait pas de démontrer exactement le contraire), c'est cette idée fausse que la langue française ne peut supporter d'être mise en musique. Mais si le parti pris l'aveugle, Rousseau en tire du moins quelques remarques intéressantes. C'est en écoutant à Mannheim deux mélodrames de Benda, Médée et Ariane à Naxos, directement issus de Pygmalion, que Mozart fait dans une lettre à son père cette réflexion : « Voulez-vous mon opinion ? Dans l'opéra, il faudrait traiter la plupart des récitatifs de cette façon. » Et il parle de « l'opéra sans chanteurs ». Combarieu remarque à ce propos que, outre les mélodrames de Benda, Sémiramis et Zaïde de Mozart, la scène de la prison de Fidélio, le Songe d'une Nuit d'été de Mendelssohn, le Manfred de Schumann, le Struensee de Meyerbeer, le Peer Gynt de Grieg, l'Arlésienne de Bizet, appartiennent à la postérité de Pygmalion.
La Guerre des Coins, la querelle des lullystes et des ramoneurs, allaient bientôt renaître : en janvier 1774, Gluck arrivait à Paris pour donner le 19 avril de cette même année son Iphigénie en Aulide. Mais avant de retracer les épisodes de cette bataille, plus acharnée et non moins perfide que les précédentes, il faut examiner comment l'évolution de l'opéra allemand avait décidé Gluck à tenter sa réforme de la tragédie lyrique.

le Grand Théâtre de Bordeaux, construit de 1773 à 1780 par Victor Louis [gravure du temps]
LE THÉATRE LYRIQUE ALLEMAND AUX XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES
L'opéra s'était répandu dans les cours allemandes : ce furent les compositeurs italiens qui l’y firent connaître. Vienne, Munich, Dresde, Hanovre, Berlin les accueillirent, et Hambourg bientôt après. Cependant dès 1627, Heinrich Schütz faisait représenter au château de Hartenfels, près de Torgau, pour les fêtes données à l'occasion du mariage de Sophie de Saxe avec Georges II de Hesse-Darmstadt, une Dafne, qui est le premier opéra écrit par un musicien allemand. Mais le livret est italien, et c'est celui de Rinuccini qui déjà avait servi à Peri. La partition fut brûlée, comme celle d'Orpheus und Euridice, opéra-ballet que Schütz écrivit pour le mariage de Jean-Georges II de Saxe, en 1638, et nous ne pouvons que supposer les qualités de son style lyrique, sans doute analogues à celles dont font preuve ses Passions. Il avait, en Italie, reçu l'enseignement des Vénitiens, les deux Gabrieli ; il y avait entendu des ouvrages de Monteverdi. Bien que fixé à Dresde, il avait obtenu du landgrave des congés pendant lesquels il était retourné en Italie. On n'ose parler d'influences lorsqu'il s'agit d'un artiste aussi puissant, aussi original ; il est cependant certain que Schütz doit aux Vénitiens et sa profonde connaissance de l'art polyphonique et son initiation au nouveau style. Mais il a marqué tous ses ouvrages de son originalité propre, et du même coup orienté l'art allemand dans les voies que Bach allait suivre à son tour.

l'Opéra royal de Berlin au XVIIIe siècle [gravure de Schleuen]
Heinrich Albert (1604-1651), cousin de Schütz et son élève avant d'être le disciple de Stobäus, eut le malheur de rester deux ans prisonnier des Suédois ; il fit représenter pour les fêtes du centenaire de l'Université de Königsberg en 1645 un Prussiarchus qui ne nous est pas parvenu, et, en 1647, un Cleomedes dont on ne possède que quelques fragments. Ils ont suffi aux musicologues pour reconnaître qu'Albert eut un rôle fort important dans l'introduction en Allemagne du style monodique. Adam Krieger (1634-1666) subit son influence ainsi que Wolfgang Franck (1640-1695) qui fut, à Hambourg, l'un des fondateurs de l'opéra, puis voyagea, s'établit à Londres, passa en Espagne, où il mourut probablement empoisonné après une vie semée de drames et d'aventures. Il donna à Hambourg quatorze opéras ; on ne connaît que quelques airs qui en ont été extraits et publiés entre 1680 et 1686.
L'Opéra avait été fondé à Hambourg le 2 janvier 1678. Il donna pour son inauguration l'Adam et Ève de Johann Teile, surnommé par ses contemporains le « père des contrapuntistes » (1646-1724). Élève de Schütz, Teile eut lui-même pour disciple Johann-Adolf Hasse (1699-1783) qui aborda la scène comme ténor avant de devenir un des compositeurs d'opéras les plus féconds. Il débuta à Brunswick en 1721 par un Antiochos — le seul de ses ouvrages qui ait été écrit sur un texte allemand — puis partit l'année suivante pour l'Italie où il travailla à Naples avec Porpora et ensuite avec Alexandre Scarlatti. C'est dans cette ville qu'il fit représenter Tigrane, accompagné d'un « intermède » la Serva scaltra, en 1723, Astarto, en 1726, et, la même année, Il Sesostrate, qui eut un grand succès. Les Italiens lui avaient donné le surnom d'Il Sassone (le Saxon) ; il alla s'établir à Venise en 1727 et y devint maître de chapelle du Conservatoire des Incurables. Marié à une cantatrice italienne, Faustina Bordoni, il revint ensuite à Dresde, où il fit représenter Cleofide (13 septembre 1731) dont elle tenait le premier rôle. Mais tous deux reprirent le chemin de l'Italie ; ils y remportèrent de nouveaux triomphes. Un séjour à Londres lui permit de faire connaître aux Anglais son Artaserse déjà représenté à Venise. Il aurait pu demeurer en Angleterre, mais il se retira devant Händel, et partagea sa vie entre Dresde et l'Italie. On le vit à Paris en 1750, où il fut accueilli triomphalement. Pendant le bombardement de Dresde, en 1760, sa maison fut incendiée et presque tous ses manuscrits brûlés. En 1765, Hasse et sa femme se rendirent à Vienne ; il y écrivit quelques opéras pour le théâtre de la cour, puis il alla finir ses jours à Venise. Il avait produit plus de quatre-vingts opéras, quatorze oratorios et un grand nombre de messes et de motets.
L'Opéra de Hambourg eut le sort de l'Opéra vénitien dans les premiers temps de son existence : le goût d'un public plus friand de spectacles que de musique exigeait qu'on lui montrât de beaux décors, de grandes machines, des défilés et une figuration nombreuse ; parmi les ouvrages médiocres qu'on y fit entendre, Ismène de Reinhardt Keiser (1674-1739) fait exception. Cet opéra avait été donné d'abord en 1693 à la cour de Brunswick sous le titre de Die wiederzefundenen Verliebten avec un succès retentissant. Son Basilius, représenté deux ans plus tôt à la cour, fut de même repris à Hambourg, mais son plus grand triomphe fut Störtebecker und Gaedje Michel, qui portait à la scène les aventures d'un chef de brigands fameux dans la région. Il composa également d'autres ouvrages sur des sujets populaires, parfois même très risqués. Lui-même eut une existence fort agitée et il dut s'enfuir de Hambourg à plusieurs reprises pour échapper à ses créanciers. Excellent musicien, doué d'originalité mélodique, il fut un des premiers à écrire sur des livrets allemands, et à marquer ses ouvrages d'un caractère vraiment national. Son style est élégant ; ses airs ont de la grâce et son instrumentation est savante. Il a exercé une réelle influence sur Hasse et Händel, et il sut former le goût de ses concitoyens, leur donner l'amour de la musique — eux qui jusqu'alors allaient au théâtre uniquement pour se divertir du spectacle. Il créa des concerts, recruta un excellent orchestre.
Parmi les autres compositeurs qui furent joués à Hambourg, on relève les noms de quelques-uns des maîtres qui ont créé la symphonie moderne : Philipp-Heinrich Erlebach (1657-1714), à qui l'on doit Die Plejaden, une sorte de comédie lyrique, créée d'abord à Brunswick en 1693 ; Johann-Sigmund Kusser (1660-1727), qui, pendant huit ans, de 1674 à 1682, fut l'élève préféré de Lully, et qui, incapable de se fixer jamais, dut à cette inquiétude l'obligeant à se déplacer sans cesse, une vaste culture vraiment européenne. On le trouve dans toutes les villes allemandes, à Londres, à Dublin, en Italie. Il séjourne cependant assez longtemps à Hambourg, de 1693 à 1696, pour diriger l'Opéra et mériter de Mattheson le nom de « modèle des chefs d'orchestre ». Son Ariadne (Brunswick, 1682), son Erindo oder die unsträfliche Liebe (Hambourg, 1693), dont nous sont parvenus de nombreux airs, ses ouvertures, montrent en lui un musicien certes influencé par le goût français, mais original, doué d'une réelle puissance dramatique, qui lui valut d'éclatants et durables succès ; le plus grand fut celui qui accueillit Die glückliche Liebe des tapfern Jasons créé à Brunswick dans une première version en 1692, et repris après une refonte à Hambourg en 1697.
Johann Mattheson (1681-1764), homme d'une culture très vaste, musicien qui sut jouer de tous les instruments, chanteur accompli, doué d'une belle voix de ténor, et capable de chanter aussi bien en italien, en français, en anglais qu'en allemand, fut d'abord l'ami de Händel qu'il prit sous son égide lorsque celui-ci vint à Hambourg en 1703, mais il se brouilla très vite avec lui. Il eut une carrière fort mouvementée, fut précepteur des fils de l'ambassadeur d'Angleterre, diplomate lui-même, directeur de la musique et chanoine de la cathédrale de Hambourg, directeur du théâtre de cette ville ; devenu sourd, il dut abandonner ses fonctions. On lui doit huit opéras et vingt-quatre oratorios, sans compter de très nombreux ouvrages instrumentaux et vocaux (Die Plejaden, 1699, Porsenna, Der Tod der grossen Pan, 1702, Cleopatra, 1704, Boris Goudenow, 1710, Henrico, re di Castilla, 1711). Ses ouvrages symphoniques lui ont valu d'être considéré comme le plus grand des contemporains de Bach, et ses écrits théoriques ont exercé une influence considérable sur l'évolution de la musique en contribuant à l'établissement du système harmonique moderne.
Auprès de lui, il faut citer Georg-Philipp Telemann, dont certains ouvrages furent signés de son pseudonyme anagrammatique Melante (1681-1767). Né à Magdebourg et mort à Hambourg, il y fut appelé au poste de directeur de la musique en 1721, après avoir été successivement maître de chapelle à Leipzig, où il donna quelques opéras (ce qui lui fut assez vite interdit, comme étant incompatible avec ses fonctions à l'église Saint-Thomas) ; à Sorau, à Eisenach (où il se lia avec la famille Bach), et à Francfort-sur-le-Main. Il fonda des concerts à Hambourg, qui ont duré jusqu'au XXe siècle, et, compositeur d'une intarissable fécondité, il a écrit de la musique de tous les genres : quarante opéras italiens ou allemands, presque tous pour Hambourg, près de six cents ouvertures françaises et suites d'orchestre, un grand nombre d'oratorios et de cantates dramatiques. Sa célébrité fut, en son temps, plus grande que celle de Bach. Son style est très proche du style de Rameau, qu'il admirait ; mais il a pratiqué aussi le style italien, et son habileté, son goût, ont imprimé à ses ouvrages une réelle personnalité qui les sauve du pastiche. Il a été un novateur hardi dans le domaine de l'harmonie. Ses pièces symphoniques montrent en même temps qu'un sentiment poétique, un don de la couleur et une verve charmante. Il a, par ses petits ouvrages lyriques, été l'un des précurseurs, sinon même le créateur du Singspiel où ses qualités comiques se donnent libre cours. Riemann voit dans les œuvres dramatiques de sa vieillesse, Ino, Tag des Gerichts, une force lyrique et un sentiment de la nature qui font présager à la fois Gluck et Beethoven.

Georg-Philipp Telemann [gravure de Lichtensteger]
Ne serait-ce que par ses Cantates profanes, Jean-Sébastien Bach doit trouver place dans une histoire du théâtre lyrique. Si l'on n'y insiste pas sur ses oratorios, c'est parce que l'étude en a été faite ailleurs ; mais il faut au moins rappeler que nul plus que le cantor de Leipzig n'a su mettre dans ses ouvrages une force, un accent dramatique dont la puissance suffit, par la seule qualité expressive de la musique, à traduire toute la grandeur des scènes tragiques de la Passion. Par sa noblesse, par sa simplicité familière, il sait à la fois se hausser sans effort jusqu'où nul autre n'a atteint, et il sait aussi rapprocher de nous sans les amoindrir les personnages de l'Évangile et Jésus lui-même. La forme des grands oratorios de Bach est toute voisine de celle des drames liturgiques qui sont à l'origine du théâtre médiéval. Mais le génie du compositeur en varie les développements avec un art qui n'a jamais été égalé.
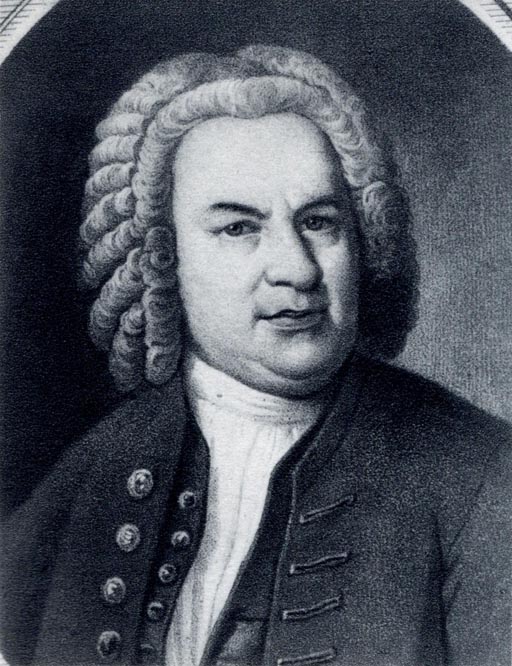
Jean-Sébastien Bach [gravure]
Il est fort difficile de dater les Cantates profanes de Bach ; Albert Schweitzer donne de bons arguments pour le classement des quelque vingt ouvrages de ce genre qui nous restent sur la quarantaine que Bach écrivit probablement. Point de doute pour la Chasse (Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd) : elle fut exécutée le 23 février 1716 pour le trente-cinquième anniversaire du duc Christian de Saxe-Weissenfels, célébré par une chasse à laquelle assista le prince de Cöthen. L'allégorie mythologique que développe le texte de Salomon Frank est banale : Diane, Endymion et leur cortège chantent la gloire du prince. La cantate servit plusieurs fois, et pour divers grands personnages : on se borna à modifier le nom du prince ; et Bach ne se fit pas faute d'utiliser divers morceaux de sa partition pour d'autres ouvrages. La cantate de la Chasse fournit même, à peine changé, l'air célèbre de la Cantate de la Pentecôte : il s'agissait d'exprimer la joie et le thème convenait parfaitement (*).
(*) A. SCHWEITZER, J.-S. Bach, le musicien-poète (Lausanne, Fœtisch, 5e tirage, s. d., p. 151).
De même la cantate Durchlaucht'ster Leopold, composée à Cöthen en 1717 pour la fête du prince, servit pour le second jour de la Pentecôte, au moins le tempo di minuetto, Bach se contentant de substituer Dieu au prince. Cantates de circonstances, encore, pour un mariage à la cour (Weichet nur, betrübte Schatten) ; pour la fête de F. Müller, professeur de philosophie à l'Université de Leipzig, où Bach venait de s'installer trois mois plus tôt (elle fut chantée le 3 août 1725). Le livret est de Picander (qui allait devenir le poète attitré de Bach sans parvenir jamais à se hausser jusqu'à la cheville de son musicien). Ce dramma per musica — comme l'intitule Bach — est encore une allégorie mythologique : Éole va rendre la liberté aux vents enchaînés ; Zéphir et Pomone ne le peuvent fléchir. Mais Pallas intercède : elle annonce que les Muses se rassemblent en l'honneur de leur protégé, M. le professeur August Müller, et le dieu se calme. Il y a dans cette cantate des pages admirables, dans lesquelles Bach s'est laissé aller à la joie d'écrire. L'air de Pomone, si mélancolique, la plainte de Zéphir, la beauté du finale — bien qu'un peu lourd — en font un ouvrage vraiment digne de Bach. Mais, comme dit Albert Schweitzer, eut-il pleine conscience de sa valeur, du caractère si heureusement descriptif de sa musique lorsqu'il accepta, en janvier 1734, de la faire servir sans y changer grand'chose, à la cantate pour le couronnement d'Auguste II, accédant pour son malheur au trône de Pologne?
C'est à Ovide qu'est emprunté par Picander le sujet de Phébus et Pan, et le célèbre défi fournit à Bach le plus heureux prétexte à musique descriptive. Il lui donne aussi l'occasion de se venger personnellement. « C'est pour dire son fait à Scheibe le fils, qui reprochait à sa musique d'être trop artificielle et trop peu à la portée du public, que Bach écrivit Phébus et Pan : Midas, c'est Scheibe ; Phébus, c'est Bach. C'est la vengeance de Hans Sachs contre Beckmesser. » Dans Bach comme dans Wagner, c'est le même mélange de sublime et de lourdeur qui, suivant Nietzsche, constitue l'un des caractères essentiels de l'art allemand (*). Le largo de Phébus, l'air de danse que chante Pan s'opposent complètement, et sont caractéristiques de la manière de Bach. La Cantate sur le café (écrite en 1732) a pour titre Schlendrian mit seiner Tochter Liessgen, et la fille de Schlendrian est si bien passionnée de café qu'elle fait vœu de ne prendre pour mari qu'un homme aimant ce breuvage autant qu'elle. Ainsi pourra-t-elle en boire à son aise et résister aux reproches et aux menaces de sa famille. Le livret fait rire, d'un rire un peu gros, certes ; mais la musique de Bach est celle d'une opérette, et le maître des Passions y devance Offenbach de plus d'un siècle, dans le trio final.
(*) A. Schweitzer cite à ce propos le passage de Par-delà le bien et le mal, où Nietzsche définit l'art allemand à propos des Maîtres-chanteurs : « Une certaine lourdeur, qui est encore soulignée, comme si l'artiste voulait nous dire : elle fait partie de mes intentions, un manteau pesant, quelque chose de volontairement barbare et solennel, un clinquant de dentelles et de préciosités savantes et surannées, quelque chose d'allemand dans le meilleur et le plus mauvais sens du mot, quelque chose de germaniquement multiple, d'informe, d'inépuisable... » (Loc. cit., p. 157).
L'Éloge du contentement (Von der Vergnügsamkeit), que Schweitzer date de la même époque, célèbre le bonheur paisible du foyer ; et Bach s'y peint tout entier, au naturel. A un début banal et « bourgeois », succède un finale d'une réelle poésie mystique, un grand élan vers la paix en Dieu. Le 27 juillet 1733, Bach sollicite le titre de compositeur de la cour de Dresde, et le 5 septembre il fait exécuter à la société de Telemann le dramma per musica Hercules auf dem Scheide-Wege (le Choix d'Hercule), pour l'anniversaire du prince héritier. Spitta juge fort justement que la musique en est supérieure à celle que Händel écrivit sur le même sujet : elle est d'une vigueur qui convient au héros. Bach, selon sa coutume, en a utilisé des fragments pour ses œuvres religieuses, et la berceuse de la Volupté est devenue, en changeant quelques paroles, la berceuse de Jésus ; et si cette métamorphose est légitime, celle qui fait de l'air « Sur mes ailes tu planeras », l'air de l'Oratorio de Noël, « C'est en ton honneur que je veux vivre », ne tient aucun compte du sens expressif de la musique. Il n'y a pas moins de six emprunts de l'un à l'autre ouvrage, et aussi malencontreux : Bach, pressé par le temps, se soucia fort peu de saccager sa propre musique.
Passons sur des cantates de circonstance : trois en 1733, deux autres en 1735, pour en venir à la cantate burlesque : Mer hat en neue Oberkeet (Nous avons un nouveau gouvernement), composée en l'honneur du chambellan Heinrich von Dieskau, et exécutée le 30 août 1742. Elle est fort intéressante, parce qu'elle fait place à la musique populaire, qu'elle utilise pour l'ouverture des airs de danse (l'une des mélodies se retrouve dans les Variations de Goldberg), et que l'on y retrouve l'air de Pan, du Défi. Bach s'est diverti en écrivant cette musique, et cela se sent en l'écoutant : son plaisir est contagieux.
Il faudrait, pour être complet, ajouter deux cantates italiennes, Amore traditore et Non sia che sia dolore (*). Elles n'offrent qu'un médiocre intérêt. Une remarque s'est imposée à l'esprit d'Albert Schweitzer lorsqu'il les analysa : Bach s'est fort peu soucié du texte de Picander ou de ses autres librettistes, du moins littéralement : sa musique est un libre commentaire du mot essentiel, de l'idée principale, de l'image qui se dégage de ce texte. Le reste (et il n'a pas tort, car ces textes sont aussi plats qu'insignifiants) ne compte point pour lui. Et cela devrait mettre à l'aise les traducteurs éventuels des cantates profanes : mieux vaut traduire avec fidélité le sens de la musique de Bach que serrer de près le texte de Picander. La traduction littérale « n'aurait d'autre effet que d'amplifier ses défauts ».
(*) Cf. sur Bach, outre l'ouvrage d'Albert Schweitzer déjà cité ; Norbert DUFOURCQ, Jean-Sébastien Bach, génie allemand ou génie latin ? (La Colombe, 1947) ; Robert PITROU, Jean-Sébastien Bach (Albin Michel, 1941).
Jean-Chrétien Bach, cadet des fils de Jean-Sébastien, (1735-1782), avait quinze ans lorsque son père mourut. Il termina son éducation musicale auprès de son aîné Karl-Philipp-Emanuel, claveciniste de la chambre de Frédéric-le-Grand, puis il partit pour Milan, en qualité de maître de chapelle du comte Agostino Litta. Celui-ci lui accorda toutes facilités pour aller recevoir des leçons de contrepoint du P. Martini à Bologne. Converti au catholicisme, nommé en 1760 organiste du Dôme de Milan, il écrivit de la musique religieuse et des opéras qui eurent un vif succès : son Catone d'Utica, créé à Milan, en 1758, fut repris à Naples en 1760 ; et c'est à Naples que fut créé en 1762 Alessandro in Indie, ainsi que plusieurs intermèdes. Il partit pour Londres, sa réputation ayant encore grandi, et y devint le maître de musique de la reine. Associé avec K.-Fr. Abel, son premier violon solo, il fonda les Bach-Abel-Concerts de Hanover-Square qui devinrent l'équivalent dans la vie musicale anglaise des Concerts Spirituels de Paris. Les seize opéras italiens, les quatre opéras français (Amadis des Gaules, créé à Paris en 1779), malgré leur succès, malgré leur nouveauté, ont moins fait pour sa réputation et sa survie que ses ouvrages symphoniques en tous points remarquables par la nouveauté de leur style, élargissant la manière de Stamitz. Il fut en outre le premier qui joua au concert, en 1768, un pianoforte à marteaux.
La chronologie aurait exigé de placer Händel avant Bach et ses fils, car Händel, né le 23 février 1685, fut de quatre semaines l'aîné de Jean-Sébastien. Pour les mêmes raisons qui ont fait écourter ici ce qui a été dit de Bach, on sera bref sur Händel et l'on ne s'étendra point sur la meilleure part de ses chefs-d’œuvre — sa musique religieuse. On a déjà dit comment, à Hambourg, lié d'abord avec Mattheson, il se brouilla avec celui-ci qui le blessa grièvement dans un duel. Il avait donné à Hambourg quatre opéras : Almira, puis Nero (1705), Daphne et Florinda (1708). Un séjour de quatre années en Italie (de 1706 à 1710), lui permet de s'initier de plus près au style italien et de donner, en 1707, à Florence, Rodrigo. A Venise, où il est l'année suivante, il rencontre le prince Ernest-Auguste de Hanovre — rencontre qui lui sera profitable dans la suite. A Rome, il loge chez le marquis Ruspoli et y fait exécuter deux oratorios. Il s'y lie avec les deux Scarlatti, les accompagne à Naples où il demeure une année avec eux (1708). C'est là qu'il donne sa cantate dramatique Alci, Galetea e Polifemo. Sur le chemin du retour, à Florence, en 1709, il fait représenter Agrippina, dont le succès est renouvelé à Venise au carnaval suivant.

Georg-Friedrich Händel [dessin de Faber]
Il hésite à se fixer : des Hanovriens rencontrés à Venise insistent pour qu'il accepte la place de maître de chapelle à la cour du Prince-Électeur. Il s'y décide, mais sollicite un congé pour se rendre à Londres. On a dit déjà (p. 58) avec quel enthousiasme il y fut accueilli, et comment il y donna son Rinaldo (1711) ; mais les devoirs de sa charge le rappelaient à Hanovre, à l'automne de cette même année. Il n'y demeura qu'un an, pressé de regagner l'Angleterre — ce qui ne fut point sans froisser gravement le prince. A Londres, on lui prodigue les faveurs ; cependant son Pastor fido n'a qu'un médiocre succès et son Teseo moins encore. Mais, en 1713, le Te Deum qu'il écrit pour célébrer la paix d'Utrecht lui procure une éclatante revanche, et, dès ce moment, on le regarde comme un autre Purcell. La reine Anne lui accorde une pension de deux cents livres. Mais elle meurt, et c'est le prince de Hanovre qui lui succède. Naturellement il tient rigueur à son maître de chapelle d'avoir déserté ses fonctions. Il feint de l'ignorer. La légende veut que la sérénade (Water music) ait réconcilié le souverain et son musicien : l'ouvrage est assez réussi pour avoir opéré ce miracle. Händel accompagne George Ier (ex-prince de Hanovre) lorsque celui-ci se rend en Allemagne. Il y compose sur des paroles de Brokes, une Passion, y fait jouer, sous le titre d'Oriana, son opéra donné à Londres sous celui d'Amadigi di Gallia. Et il revient en Angleterre, où il est l'hôte du duc de Chandos pour lequel il écrit, outre les célèbres Chandos Anthems, un oratorio profane où il traite pour la seconde fois (comme précédemment à Naples) le sujet d'Acis and Galatea, et son premier oratorio anglais Esther. C'est ensuite, en 1710, la fondation de la Royal Academy of music, les démêlés avec Bononcini, les rivalités qui amènent la ruine de l'entreprise, et dont il a déjà été parlé (p. 58). Un voyage en Allemagne et en Italie, en 1729, lui permet de revoir sa vieille mère et de retrouver les Scarlatti. De retour à Londres avec une troupe recrutée dans la péninsule, il ouvre une seconde Academy. Il a pour associé le Zurichois Heidegger ; mais Porpora et Hasse créent un théâtre rival, et Heidegger, découragé, se retire. Händel persévère, monte Arianna, version nouvelle d'Il Pastor fado, crée Terpsichore, Ariodande, Alcina, Atalanta, Giustino, Arminio, Berenice, de 1734 à 1737 au Covent Garden, et commence la série de ses grands oratorios. Mais sa santé a décliné, les soucis l'ont rongée, et une première attaque d'apoplexie l'a contraint à abandonner l'opéra. Il suit à Aix-la-Chapelle une cure énergique, se remet à peu près, trouve le courage de monter en 1739-1740 ses opéras nouveaux, Jove in Argo, Imeneo, Deidamia, ses oratorios, Saül, Israël. Il compose avec acharnement, malgré ses souffrances : il écrit son chef-d’œuvre The Messiah en vingt-quatre jours (1742, à Dublin). Bientôt sa vue s'affaiblit et le travail lui devient très difficile. Il n'en continue pas moins à donner des concerts et à tenir l'orgue : huit jours avant sa mort, il est encore devant ses claviers. Il s'éteint le 14 avril 1759, laissant un nom aussi grand que celui de Jean-Sébastien Bach.

Judas Macchabée, oratorio de Händel [gravure italienne du XIXe siècle]
Naturalisé Anglais en 1726, regardé dans son pays d'adoption comme le successeur de Purcell, il doit en effet beaucoup à l'art britannique, et son œuvre si diverse, si originale même, est un confluent des influences qu'il a si bien assimilées : les maîtres de l'opéra italien et français, les traditions allemandes et le goût anglais y ont une part égale. Mais il a réussi à puiser dans ces sources si diverses ce qu'il fallait à sa nature, à son tempérament pour créer ce qui est bien à lui, ce qui reste inimitable : son style. Génie universel, curieux de toutes choses, il plonge dans le passé de solides racines qui le rattachent à la tradition polyphonique. Mais il appartient à l'avenir autant qu'au passé. En lui s'est opérée une fusion de l'esprit germanique et de l'esprit latin : il doit à l'Italie ce qu'il y a de plus léger, de plus chantant dans sa musique, comme il doit sa solidité instrumentale à ses premiers maîtres organistes, puis à Mattheson qui l'introduisit en qualité de second violon à l'orchestre de Hambourg. Il est, pour une part, l'héritier de Buxtehude qui fit sur lui, comme sur Bach, la plus profonde impression, lorsqu'il alla l'entendre à Lubeck en compagnie de Mattheson. Mais c'est surtout dans ses oratorios que son génie s'est révélé. La forme plus austère du drame sacré convenait mieux à Händel que le cadre de l'opéra. Il n'en a pas moins exercé à son tour une influence profonde sur le drame lyrique : la vive impression que Gluck emporta de son séjour à Londres, où il entendit Händel, fut décisive à son tour.

à gauche : le public de Covent Garden à Londres vers 1730 - à droite : exécution d'un oratorio à Londres en 1732 [eaux-fortes de W. Hogarth]
LE RAYONNEMENT DE L'ART LYRIQUE ALLEMAND AU XVIIIe SIÈCLE
GLUCK, HAYDN, MOZART ET L'OPÉRA VIENNOIS
I
Comme l'art lyrique italien avait rayonné à travers l'Europe au XVIIe siècle, l'opéra allemand se répandit cent ans plus tard. L'empereur Joseph II, son frère et successeur Léopold II, bons musiciens, aimaient le théâtre. L'Autriche eut de plus la fortune de produire un Gluck et un Mozart, et Vienne attirait depuis longtemps les compositeurs italiens, outre ceux de l'Allemagne du Nord. Les conditions étaient favorables pour l'expansion des goûts viennois en Europe occidentale : le mariage de l'archiduchesse Marie-Antoinette avec le Dauphin allait avoir sur la musique française des conséquences imprévues.
Fils d'un « maître des forêts » (Oberforster) au service de la duchesse de Toscane, du comte Kinsky, et enfin du prince Lobkowitz (*), Christoph-Willibald Gluck (1714-1787) eut la chance d'entrer dans la musique du prince Melzi, d'une famille lombarde, qui l'emmena en Italie. A Milan, Sammartini lui donna des conseils. En décembre 1741, Gluck débute au théâtre avec un Artazerse, sur le livret de Métastase qui, déjà, servit à Hasse et servira dans la suite à quantité d'autres musiciens. On n'en connaît que deux airs, mais l'ouvrage eut assez de succès pour décider le théâtre Grimani di San Samuele de Venise à commander un ouvrage au jeune compositeur. Demetrio y parut le 4 mai 1742. La même année, de retour à Milan, il y donne Demofoonte ; en trois ans, il écrira dix opéras, et dans Ipermestre créé au théâtre Grimani le 21 novembre 1744, l'ouverture offre un des plus beaux adagios que Gluck ait faits. Les récitatifs y font en outre pressentir ses chefs-d’œuvre. De Venise, il se rend à Turin, y monte un Poro (Alessandro nell'Indie), et, errant de Venise à Naples, à Milan, il passe à Londres où, en 1746, après avoir entendu les oratorios de Händel, il entreprend de perfectionner son style. Mais dès le 4 janvier 1745, il fait jouer à Haymarket la Caduta de' Giganti, pièce de circonstance, dont le sous-titre, la Rebellione punita, fait allusion aux Jacobites. Elle est assez bien accueillie pour lui valoir la commande d'un second ouvrage. Il arrange une Artamene dans laquelle il fait entrer une douzaine d'airs provenant de ses pièces antérieures.
(*) Cf. le Gluck de J.-G. PROD'HOMME ouvrage définitif qui rectifie bien des erreurs et éclaircit maints points obscurs (Paris, Société d'Éditions françaises et internationales, 1948).
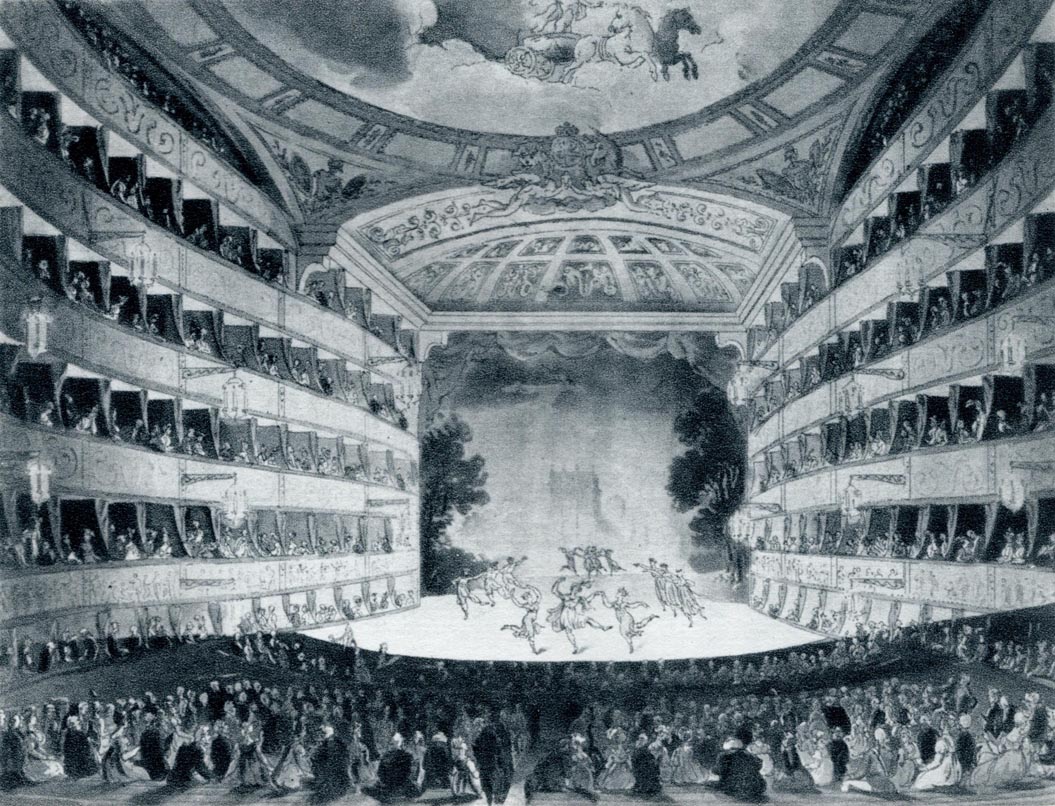
intérieur de l'opéra royal d'Haymarket à Londres [gravure de Rowlandson et Pugin]
L'époque à laquelle il quitta l'Angleterre est incertaine. Mais ce dont on est sûr — J.-G. Prod'homme l'a démontré — c'est que Gluck se rendit à Hambourg et qu'il ne vint point alors à Paris pour y entendre Castor et Pollux (qu'on n'y joua pas à ce moment). Lesté des guinées britanniques, il entre dans la troupe de Pietro Mingotti en qualité de maestro al cimbalo et d' « arrangeur » chargé de composer à l'occasion quelque aria pour une chanteuse ou un virtuoso. Il parcourt ainsi l'Europe, passe à Dresde, Prague, Hambourg, Copenhague. Puis de 1754 à 1764, il est maître de la chapelle de l'Opéra de la cour. Le 15 septembre 1750, il se marie avec une fille de dix-huit ans, Maria-Anna Pergin, d'une famille très aisée. Il peut désormais travailler sans soucis.
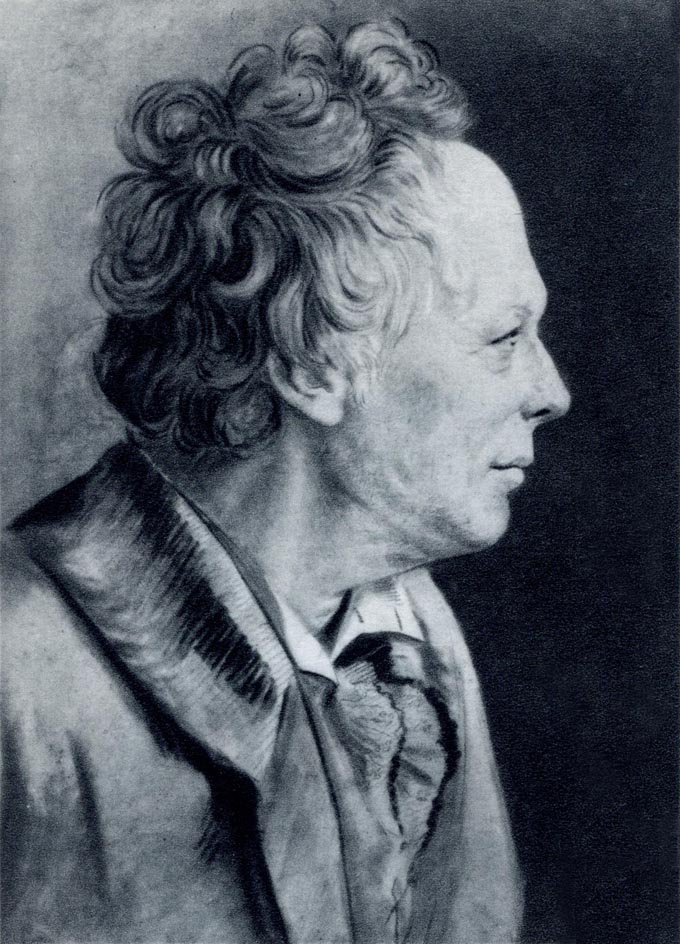
Christoph Gluck [dessin à la pierre noire ; Musée de l'Opéra]
Sa « réforme » a mûri dans son esprit. Le premier fruit de ses méditations sur l'art lyrique est Orfeo ed Euridice, qui parut le 5 octobre 1762 au Burgtheater. Le rôle d'Orfeo était chanté par le castrat Guadagni, Euridice par Marianne Bianchi et l'Amour par Lucie Glebero-Clavereau. La première avait eu lieu en présence de la cour ; la seconde fut donnée le 10. L'ouvrage allait être profondément remanié pour les représentations de Paris en 1774. Cependant Gluck fait retour aux formes italiennes dans quelques-uns des ouvrages qui suivent (Telemaco, Il Trionfo di Clelia) ; il les abandonne dans Alceste (Vienne, 1767), composé, comme Orfeo, sur un livret de Raniero da Calzabigi, providentiellement rencontré pour lui fournir des poèmes de haute tenue qui lui permettront de ne point faire de concessions à la virtuosité vocale. Dans l'épître dédicatoire au grand-duc de Toscane, Gluck prend position ; dans la dédicace de Paride ed Elena au duc de Bragance, la même année, il affirme plus nettement encore son propos :
Lorsque j'entrepris d'écrire la musique de l'Alceste, écrit-il dans l'Épître, je me proposai de la dépouiller entièrement de tous ces abus qui, introduits par la vanité mal entendue des chanteurs ou par une complaisance exagérée des maîtres, défigurent depuis longtemps l'Opéra Italien, et qui, du plus pompeux et du plus beau de tous les spectacles, en font le plus ridicule et le plus ennuyeux. Je pensai à restreindre la musique à son véritable office, qui est de servir la poésie pour l'expression et pour les situations de la Fable, sans interrompre l'action, et sans la refroidir par des ornements superflus. Je crus qu'elle devait être (au poème) ce que sont à un dessin bien agencé la vivacité des couleurs et le contraste bien assorti des lumières et des ombres qui servent à en animer les figures sans en altérer les contours. Je n'ai donc pas voulu arrêter un acteur dans la grande chaleur du dialogue pour attendre une ennuyeuse ritournelle, ni couper un mot sur une voyelle favorable pour faire parade dans un long passage de l'agilité de sa belle voix, ou pour attendre que l'orchestre lui donnât le temps de reprendre haleine pour faire une cadence... J'ai imaginé que la Sinfonie (ouverture) devait prévenir les spectateurs de l'action qui est à représenter, et en former, pour ainsi dire l'argument... J'ai cru encore que mon plus grand effort devait se réduire à rechercher une belle simplicité ; et j'ai évité de faire parade de difficultés aux dépens de la clarté ; je n'ai jugé précieuse la découverte de quelque nouveauté qu'autant qu'elle était naturellement commandée par la situation et par l'expression. Enfin, il n'est point de règle d'ordre que je n'aie cru devoir sacrifier de bonne volonté en faveur de l'effet. Voilà mes principes.
Gluck qui avait enseigné la musique à la future dauphine de France, avait déjà rencontré à Rome Gaud Lebland du Roullet quand il le retrouva à Vienne, où celui-ci fut attaché à l'ambassade de France. Cela faisait un atout de plus dans les mains du musicien qui caressait le projet de venir à Paris. Une collaboration s'esquissa bientôt entre eux. Du Roullet s'était attaqué à l'Iphigénie en Aulide de Racine pour en tirer un livret d'opéra. Gluck se mit à la besogne en 1771. Du Roullet fut « subjugué par son génie », dit J.-G. Prod'homme, et cela est vrai : jusqu'à sa mort il s'appliqua à servir le compositeur. Iphigénie fut terminée au cours de l'été 1772 ; dès le 1er août Du Roullet adresse à Dauvergne, directeur de l'Opéra avec Berton, Trial et Joliveau, une lettre annonçant que le « fameux M. Glouch (sic) si connu dans toute l'Europe, a fait un opéra français qu'il désirerait qu'il fût donné sur le théâtre de Paris ». La lettre fut publiée dans le Mercure de France du 1er octobre. Du Roullet y insiste sur l'étude particulière que le compositeur a faite de la langue française qu'il parle « avec difficulté », mais qu'il « sait à fond », et vante les mérites de Gluck, « homme de génie en même temps qu'homme de goût. » Comme Du Roullet avait quelque peu égratigné Calzabigi dans son panégyrique de Gluck (pour se faire certainement la part plus belle), Gluck jugea prudent d'écrire lui-même au Mercure afin de ne point mécontenter son précédent librettiste. Et, en même temps qu'il fait l'éloge de Calzabigi, il fait non moins prudemment l'éloge de Jean-Jacques. Ainsi Gluck prépare — et avec un peu trop de diplomatie, car l'excès d'habileté peut être plus nuisible que profitable — son voyage à Paris.

costumes de Boquet pour Iphigénie en Aulide, opéra de Gluck (1774)
Dauvergne a reçu le premier acte d'Iphigénie. Il admire, mais déclare qu'il ne jouera Iphigénie que si Gluck s'engage à lui donner six partitions de ce genre, « un tel ouvrage étant fait pour tuer tous les anciens opéras français ». Sentant l'ambiguïté de cette réponse, Gluck fait pressentir la dauphine, son ancienne élève. Elle répond en l'invitant à venir à Paris (*). J.-G. Prod'homme cite un passage des mémoires de Joseph Weber, frère de lait de Marie-Antoinette, et qui plus tard occupa un emploi dans les Finances, grâce à la protection de la reine. Il écrit : « La France ne connaissait qu'une musique demi-barbare ; cet art y était dans l'enfance, lorsque tous les autres y avaient passé l'époque de leur maturité. Marie-Antoinette vit l'opéra français, et résolut aussitôt de rectifier le goût national. C'est à elle, à son amour éclairé des arts que la France doit la révolution qui s'opéra alors dans la musique. » A travers ces phrases, on retrouve sans doute les appréciations de la dauphine. D'autre part, Marmontel dit que Gluck fut « aussi fortement recommandé à la jeune reine par l'empereur Joseph que si le succès de la musique allemande avait eu l'importance d'une affaire d'État ». Picciniste, remarque J.-G. Prod'homme, il se peut que Marmontel exagère. Mais lorsque Gluck débarqua à Paris le 20 novembre 1773, tout était prêt pour qu'éclatât une nouvelle querelle, une reprise de la « guerre des coins ».
(*) Cf. J.-G. PROD'HOMME, loc. cit., p. 193.
Dauvergne se montrait peu empressé ; Gluck profita de ces atermoiements pour observer l'Opéra, étudier la situation, se créer des amis. On commença les répétitions : Gluck se montrait difficile, souvent quinteux. On colportait des ragots de coulisses, le récit de ses algarades avec Sophie Arnould, avec les musiciens de l'orchestre. La dernière répétition eut lieu le 11 avril 1771 ; la première fut retardée jusqu'au 19, à cause d'une indisposition de Larrivée qui tenait le rôle d'Agamemnon. En sortant de la répétition générale, Rousseau avait griffonné un billet pour dire à Gluck que celui-ci venait « de réaliser ce qu'il croyait impossible jusqu'à ce jour ». La première produisit la plus forte recette qu'avait jamais encaissée l'Opéra : 6 212 livres 10 sols, et les cinq premières, du 19 au 29, totalisèrent 29 655 livres. Des revendeurs s'étaient livrés à un véritable agio sur les billets. Pour profiter de ce succès foudroyant, Gluck fait traduire en hâte son Orfeo, son Alceste, et écrit une Armide sur l'ancien livret de Quinault, mis en musique un siècle plus tôt par Lully. On n'entrera pas dans le détail du séjour du musicien viennois à Paris : il suffit de dire que le 3 mars 1777, lorsque l'Opéra donne Armide, sa réputation est si solidement établie, ses partisans sont si chaleureux, que l'on doit, faute de places à la première et aux représentations suivantes, admettre des spectateurs payants à la répétition générale. Mais pour bien marquer qu'on leur fait grande faveur, Gluck vient diriger l'orchestre sans perruque, la tête couverte de son bonnet de nuit. On l'en admire davantage.
La politique s'est déjà mêlée à la querelle. Tout le parti de Marie-Antoinette est naturellement gluckiste ; ceux qui ne l'aiment point se rangent parmi les antigluckistes, auprès de d'Alembert, Marmontel, La Harpe qui sont les plus actifs. Rousseau d'abord gluckiste comme on l'a vu, est resté flottant, puis est revenu à la défense de ses chères et vieilles idées sur la musique italienne.
Pour faire pièce à Marie-Antoinette et mieux combattre Gluck, les adversaires du compositeur autrichien s'avisent de lui susciter un rival. Leur choix se porte sur Piccini. Mme Du Barry, ennemie jurée de la reine, est dans le complot : elle met en mouvement l'ambassadeur du roi de Naples près la cour de France, le marquis de Carraccioli, et Piccini arrive en décembre 1776, ignorant complètement le français. Qu'à cela ne tienne : Marmontel se charge de lui enseigner l'indispensable rudiment. Puis sur le texte du livret de Roland, il marque les accents pour que le compositeur ne les fasse point tomber à faux. Le 27 janvier 1778, l'ouvrage est donné au Théâtre italien, et malgré les efforts des gluckistes pour le faire échouer, il réussit. Point assez cependant pour que Gluck en soit écrasé.

costumes pour Roland, opéra de Piccini (1778) [dessins à la plume]
Alors, les deux rivaux sont mis directement en compétition : chacun d'eux écrira une Iphigénie en Tauride. Et en attendant que la sienne soit prête, Piccini donne sa Cecchina, puis Il Vago disprezzato dont le succès exaspère de plus en plus les gluckistes. Ceux-ci pressent le Viennois dont la pièce est achevée la première et passe à l'Opéra le 18 mai 1779. L'accueil du public est enthousiaste. Chose singulière : on loue Gluck de s'être inspiré si heureusement du récitatif français de Lully et de Rameau !
Ce ne fut que le 23 janvier 1781 que l'Iphigénie en Tauride de Piccini put être représentée. Elle n'eut qu'un petit succès. Mais en 1783, Gluck étant reparti pour l'Autriche quelques mois après le triomphe de son Iphigénie, Piccini obtenait avec sa Didon une belle revanche. Cette fois ce n'était plus sur Gluck qu'il l'emportait, mais sur son compatriote Sacchini dont on avait représenté la Chimène (Il Gran Cid) à l'Opéra avec succès. Mais Didon, de 1783 à 1826, obtint plus de deux cent cinquante représentations !

la cantatrice Saint-Huberty (1756-1812) dans un opéra de Gluck [gravure coloriée du temps]
Si l'on parle de réforme, de révolution gluckistes, c'est d'abord parce que Gluck voulut résolument changer bien des choses, comme on l'a vu par les citations de son Épître dédicatoire. On a comparé ses principes si nettement exprimés à la Déclaration des Droits de l'Homme, et on en a fait la déclaration des droits du musicien dramatique. Déclaration qui souffre cependant quelques accommodements et contradictions : n'est-ce point Gluck lui-même qui écrit à son librettiste d'Iphigénie en Tauride : « Pour les paroles que je vous demande, il me faut un vers de dix syllabes, en ayant soin de mettre une syllabe longue et sonore aux endroits que je vous indique ; enfin que votre dernier vers soit sombre et solennel, si vous voulez être conséquent avec ma musique. » Cette demande ne prouve-t-elle pas que parfois, que souvent même, Gluck exige que la poésie, que l'action, se plient aux volontés du musicien et non point le musicien aux exigences de l'action et aux nécessités du poème ?
Contradiction encore, sa prosodie si souvent destructrice de la mesure du vers dont elle prolonge ou accentue même les muettes ; qui oblige parfois le chanteur à répéter une syllabe sur une note différente de celle qui servit à l'émission (pleu-eurs ; moi-oi ; instants-ants). Contradiction, sa résolution de n'employer plus les airs à reprise, et les reprises que cependant l'on trouve ici et là dans ses œuvres sans qu'elles paraissent toujours bien justifiées.
Marmontel, qui ne l'aimait point, l'a comparé à Shakespeare. Mais c'était pour lui une sorte d'injure, car il trouvait Shakespeare plein d'incohérence, de dureté, barbare, en un mot. Et il compare en même temps l'art italien à celui de Racine, ce qui était à ses yeux le plus bel éloge.
Il y a en effet chez Gluck des duretés parce que sa crainte du chromatisme va jusqu'à la terreur. Elle le lui fait fuir où cependant le chromatisme aurait adouci, assoupli la sécheresse de ses successions d'harmonies consonantes. Enfin, au bout de deux siècles, Gluck nous paraît avoir quelquefois pris le sentimentalisme pour le sentiment, alors que ses rivaux italiens — si légers qu'ils soient, et malgré leur complaisance aux effets vocaux — ont montré moins de lourdeur et gardé plus de mesure.
Combarieu, après avoir formulé ces objections, conclut fort justement : « En somme, au XVIIIe siècle, les succès et les pénibles épreuves paraissent avoir été à peu près également partagés entre Gluck et Piccini. La querelle se termina comme celle des Bouffons et comme beaucoup d'autres batailles après lesquelles on chante le Te Deum dans les deux camps. »
Romain Rolland s'est demandé quel avait été pour la musique française le résultat de ces luttes : « Avant Gluck, écrit-il, le problème était réduit à une opposition entre l'art italien et l'art français. Gluck arrive. Que fait-il triompher ? Est-ce l'art italien ou l'art français ? Est-ce l'art allemand ? Est-ce bien autre chose encore ? C'est un art international !... Oui, l'art de Gluck est un art européen, et c'est en cela qu'il surpasse à mon sens l'art de Rameau qui est exclusivement français... » Il est incontestable que Gluck ait été un Européen ; mais il ne cesse pas, pour autant, d'être essentiellement Allemand. Et Debussy, après avoir montré de manière irréfutable ce que Gluck doit à Rameau, écrira — feignant d'adresser une Lettre ouverte à M. le chevalier W. Gluck : « Malgré le côté « luxe » de votre art, il a eu beaucoup d'influence sur la musique française. On vous retrouve d'abord dans Spontini, Lesueur, Méhul, etc. ; vous contenez l'enfance des formules wagnériennes, et c'est insupportable. Entre nous, vous prosodiez fort mal ; du moins, vous faites de la langue française une langue d'accentuation quand elle est une langue nuancée. (Je sais : vous êtes Allemand.) Rameau, qui aida à former votre génie, contenait des exemples de déclamation fine et vigoureuse qui auraient dû mieux vous servir. Je ne parle pas du musicien qu'était Rameau pour ne pas vous désobliger. Il y a plus : Rameau était lyrique ; cela nous convenait à tous points de vue ; nous devions rester lyriques sans attendre un siècle et demi pour le redevenir. De vous avoir connu, la musique française a tiré le bénéfice assez inattendu de tomber dans les bras de Wagner. Je me plais à imaginer que, sans vous, ça ne serait non seulement pas arrivé, mais que l'art musical français n'aurait pas demandé aussi souvent son chemin à des gens trop intéressés à le lui faire perdre (*). »
(*) Monsieur Croche antidilettante, par Claude DEBUSSY (Paris, N. R. F., 1921).
Jugement sévère, mais assez juste en vérité. S'il est vrai que Gluck ait voulu — et on n'en peut douter — orienter l'art lyrique vers une sorte d' « internationalisme », faudrait-il l'en louer ? Souvenons-nous de la parole de Verdi, citée tout à l'heure : ce qui nous plaît aujourd'hui encore dans Gluck, ce qui nous le fait admirer, n'est-ce point qu'il soit demeuré, tout en s'efforçant de ne l'être plus, un pur Allemand à qui Weber et Wagner doivent une assez large part de leur formation. Un art « international », comme le voulait Gluck, c'est, pour le théâtre lyrique, l'art de Scribe-Meyerbeer, l'art cosmopolite de l'opéra de 1835, après Rossini ; c'est le plus détestable « passe-partout », utilisant tous les clichés, et mortel à toute originalité. Les œuvres durables de l'époque suivante, signées de Bellini, de Rossini, de Weber, de Berlioz, sont heureusement restées italiennes, allemandes ou françaises. Aucune d'elles ne fut internationale.
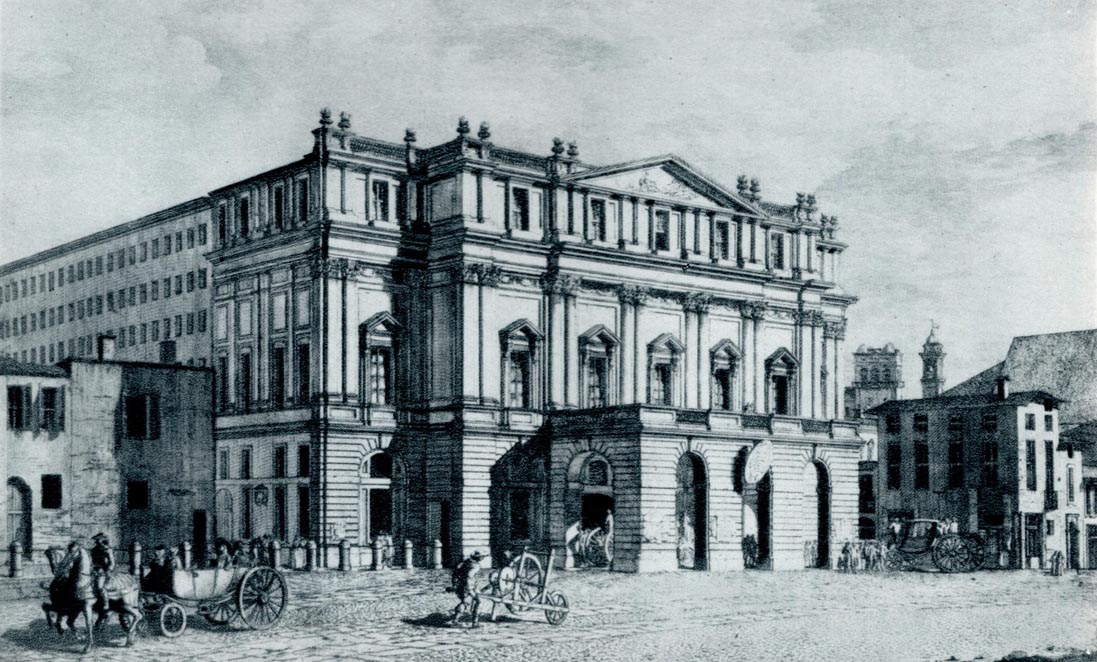
la Scala de Milan vers 1790, construite par G. Piermarini de 1776 à 1778 [gravure du XVIIIe siècle]
II
On ne saurait passer tout à fait sous silence dans une histoire de l'art lyrique, le nom de Joseph Haydn, bien que ce ne soit point au théâtre qu'il acquit une gloire durable. On lui doit cependant vingt-quatre opéras. Il les a écrits pour un cadre restreint, pour les moyens assez sommaires que lui offraient les ressources d'Esterhaz. Et s'il lui est arrivé parfois de souhaiter voir représenter à Paris sa Vera Constanza (qui, seul de ses opéras, fut écrit pour le théâtre de la cour, à Vienne, en 1777, mais n'y fut pas joué), il se rendit toutefois assez nettement compte de l'impossibilité où il se trouvait, malgré son génie, de rivaliser avec Gluck ou Mozart. La lettre par laquelle il répondit à une invitation venue de Prague en 1787, prouve à la fois sa modestie et le juste sentiment qu'il avait de son infériorité sur ce terrain : « Vous désirez de moi un opéra bouffe ; bien volontiers s'il vous est agréable de posséder pour vous seul quelque œuvre vocale de ma composition. Mais quant à l'exécuter sur le théâtre de Prague, en ce cas, je ne puis vous servir, car tous mes opéras sont trop liés à notre personnel d'Esterhaz, et ils ne produiraient jamais au dehors l'effet que j'ai calculé pour cette localité. Il en serait autrement si j'avais le bonheur inestimable de pouvoir composer pour ce théâtre sur un livret entièrement nouveau : mais là encore, je courrais trop de risques, car il serait difficile à n'importe qui de se placer à côté du grand Mozart. C'est pourquoi je voudrais pouvoir imprimer dans l'âme de tous les amateurs de musique, et surtout des grands, les inimitables travaux de Mozart aussi profondément et avec une connaissance musicale et un sentiment aussi vifs que ceux que je ressens moi-même à leur égard ; alors les nations se disputeraient la possession d'un tel trésor. Il faut que Prague retienne un homme aussi précieux et qu'elle le récompense ; car sans cela, l'histoire d'un grand génie est triste et ne donne à la postérité que peu d'encouragements à poursuivre l'œuvre. C'est pourquoi, malheureusement, tant de beaux génies pleins d'espérances succombent. Je suis tout en colère de ce que cet unique Mozart ne soit pas encore attaché à une cour impériale ou royale ! Pardonnez-moi si je sors ainsi de mes gonds : c'est que j'aime trop l'homme ! (*) »
(*) Cette lettre adressée à Roth, de Prague, est citée par Michel Brenet dans son Haydn, pp. 105 et sq. (Alcan, collection les Maîtres de la Musique).
Cette lettre fait aimer aussi, en Haydn, l'homme, comme on aime, comme on admire le symphoniste qu'il fut : il est rare qu'un confrère se montre aussi généreux et aussi clairvoyant. Il est plus rare encore de voir un musicien de génie s'incliner avec autant de vraie et sincère modestie devant un autre musicien de génie — plus jeune que lui de vingt-quatre ans.
Haydn avait soixante-cinq ans passés lorsqu'il écrivit la Création et les Saisons. Bien que ces deux oratorios ne soient pas des ouvrages destinés à la scène, leur inspiration, leur style, si près de l'art populaire en certains passages, ont apporté quelque chose d'entièrement neuf et qui a exercé une influence certaine sur la musique dramatique. La Création fut exécutée en 1798, et les Saisons en 1801 : on y trouve mieux qu'un reflet des goûts de cette époque : Haydn nous fait comprendre ce qu'il y eut de généreux et de meilleur chez ses contemporains, car lui, fut profondément sincère
III
L'influence de Haydn sur le jeune Mozart ne se reflète pas seulement dans la musique instrumentale de celui-ci, mais aussi bien dans ses œuvres scéniques : Mozart était encore un enfant lorsqu'il écrivit d'avril à juillet 1768 (il avait douze ans), la Finta semplice (opéra bouffe en trois actes), commandée par le Burgtheater de Vienne, et qui, en dépit de l'intervention de l'Empereur, ne fut pas représentée avant 1769 où elle parut à Salzbourg. L'influence italienne y est sensible et si le manuscrit conservé à Berlin n'offre point la révélation du génie qui va bientôt apparaître, il témoigne cependant d'une habileté déjà étonnante.

maison natale de Mozart à Salzbourg [gravure allemande]
Beaucoup plus intéressant est le Liederspiel : Bastien und Bastienne composé en 1768 pour le célèbre magnétiseur Mesmer sur un texte de Weiskern adaptant un livret de Favart, contrefaçon du Devin du village. L'ouvrage compte seize numéros, et ce n'est plus cette fois l'influence italienne qui s'y révèle, mais celle de J.-A. Hiller dont les singspiele marquèrent le début du genre essentiellement allemand de la comédie musicale. L'influence française s'y retrouve également dans l'accompagnement des récitatifs, avec ses modulations mineures. Mais, ainsi que le signale Georges de Saint-Foix, les souvenirs français rapportés du voyage à Paris en 1763-1764, s'effacent sensiblement à mesure que progresse l'ouvrage, et la romance et le rondeau se changent, dans les derniers numéros, en véritables lieds, où la grâce de la mélodie a plus d'importance que la justesse de l'expression.
Au cours de son séjour en Italie, Mozart compose, dans le second semestre de 1770, un opera seria en trois actes, Mitridate, re di Ponto, sur un poème de Cigna Santi, d'après Racine. La commande lui avait été faite pour l'Opéra de Milan. A ce moment, l'enseignement du P. Martini l'avait familiarisé avec le genre qu'il devait traiter. La première fut donnée le lendemain de Noël et le succès fut honorable. Chose curieuse, le jeune musicien avait composé plusieurs airs qu'il remplaça par d'autres, plus faciles à chanter, et d'une moindre hardiesse dans les modulations.
Wolfgang, mis en si bonne voie, ne va plus cesser d'écrire pour le théâtre. Pour le mariage du grand-duc Ferdinand et de la grande-duchesse Béatrice, il reçoit la commande d'une serenata, une pastorale de trente-trois numéros, Ascanio in Alba, sur un poème de J. Parini, et la compose à Milan du 1er au 30 septembre 1771. Elle y fut représentée le 17 octobre. Le succès en fut vif et « écrasa » l'opéra du vieux Hasse, Ruggiero ou l'Eroïca Gratitudine. L'œuvre de Mozart vaut surtout par les chœurs qui sont d'une charmante fraîcheur ; le ballet a été malheureusement perdu.
Rentré à Salzbourg, Mozart y reçoit une nouvelle commande pour les fêtes de l'intronisation de l'archevêque Colloredo, le 29 avril 1772. Il Sogno di Scipione, azione teatrale en un acte, sur un poème de Métastase, d'après Cicéron, se rapproche de la cantate et contient douze numéros dont deux chœurs et neuf airs dans le style de l'opera seria. L'ouvrage est assez superficiel et laisse voir qu'il s'agit là d'une tâche imposée — et sur un livret d'une lenteur fastidieuse.
En Italie, Mozart avait reçu la commande d'un dramma per musica en trois actes, Lucio Silla, sur le livret de Giovanni da Camera. Il l'exécuta en novembre-décembre 1772 et la première représentation en fut donnée à Milan le 26 décembre pour l'ouverture de la saison de Carnaval. L'inexpérience d'un acteur fit rire le public et troubla la soirée ; en outre l'insuffisance d'un livret moins que médiocre n'a point aidé Mozart, qui sut mettre cependant dans les airs de Giunia des accents dont la réelle grandeur fait ressortir davantage l'infériorité des autres scènes.
Deux ans s'écoulèrent entre Silla et la Finta Giardiniera, composée à Salzbourg et à Munich d'octobre 1774 à janvier 1775 sur un livret bouffe, en trois actes, déjà mis en musique par Pasquale Anfossi. L'ouvrage, commandé pour le théâtre de la cour de Munich, appartient à cette période « galante », où Mozart se plie au style mondain sous l'influence des Italiens accueillis à Salzbourg par Colloredo, ennemi juré de la musique allemande. Le livret de la Finta Giardiniera est un imbroglio plein d'invraisemblances : Mozart sut lui imprimer un caractère tout différent de celui que lui avait donné Anfossi : sa musique est plus savante ; il y traite la voix comme les instruments de l'orchestre et sans trop de souci de la déclamation. Anfossi ne songeait qu'à s'amuser en amusant les spectateurs ; Mozart, plus profond, veut émouvoir dès qu'il trouve l'occasion d'exprimer un sentiment tendre ou mélancolique ; et cela ne va pas toujours sans fausser le sens de l'ouvrage ; mais cela nous montre aujourd'hui, qu'en 1774, à dix-huit ans, Mozart est déjà lui-même. La Finta Giardiniera fut remaniée deux fois, en 1780 et en 1789.
A l'occasion de la visite à Salzbourg de l'archiduc Maximilien-François, en avril 1775, Mozart reçut la commande d'Il Re Pastore, dramma per musica en deux actes, sur un poème de Métastase. L'ouvrage qui appartient au même genre qu'Ascanio fut joué le 23 avril ; il ne compte guère dans la production du jeune maître.
Les années s'écoulant sans que l'archevêque octroie à Mozart un poste suffisamment rémunérateur, et veuille même lui accorder un congé pour une tournée à l'étranger, il démissionne et part pour Paris avec sa mère ; arrivé le 23 mars 1778, il y a la révélation d'une musique qu'il ne soupçonne pas. Vite, il s'assimile les styles de Gluck, de Grétry, de Schobert, claveciniste de la chambre du prince de Conti, dont les Sonates le séduisent. Deux événements marquent son séjour à Paris : la mort de sa mère, survenue le 3 juillet 1778, et la commande par Noverre d'une partie de la musique d'un ballet pour l'Opéra : les Petits Riens, qui y sont joués le 11 juin avec la Finta Gemella, de Piccini. Ils passent d'autant mieux inaperçus que le nom de Mozart ne figure même pas au programme. Telles étaient les mœurs du temps. L'ouverture et quatorze danses sont cependant de lui. Musique simple, charmante, d'esprit purement français ; et il est possible que les sept autres danses qui entrent dans la partition aient été revues, et même orchestrées par Mozart. Elles eurent du succès ; mais ce fut à Noverre qu'il profita.
Mozart reçut de Munich la commande d'un opera seria pour le carnaval de 1781. Il se mit au travail à son retour à Salzbourg, sur le livret d'Idomeneo, trois actes de l'abbé Varesco, et l'ouvrage fut joué le 29 janvier 1781. L'abbé avait « arrangé » la tragédie de Danchet et Campra, elle-même tirée de Campistron. Sujet pathétique, situations variées : pour les traiter, Mozart s'inspire visiblement du style de Gluck ; mais en même temps on constate avec quelle force il marque cette inspiration de sa propre personnalité ! L'orchestre, comme le dit G. de Saint-Foix, est plus jeune d'au moins un demi-siècle que celui de Gluck. Les « vents », surtout, sont employés avec cette sûreté, cette maîtrise, que nul avant lui n'avait montrées. Et le jeune homme de vingt-cinq ans se révèle dans Idoménée le plus grand musicien de son temps : il traite les chœurs avec un souci de l'expression vraie, avec une science pareille à celle qu'il montre dans son instrumentation. L'adagio O voto tremendo est un chef-d’œuvre, non seulement musical, mais, pourrait-on dire, humain, et que Mozart était seul capable d'écrire. Et quelles hardiesses harmoniques, quelle audace dans l'emploi des neuvièmes déchirantes qui l'accompagnent ! On ne peut être surpris que le public n'ait pas compris ce que cet ouvrage apportait de nouveau.
C'est sans doute du même temps que date un opéra en deux actes, Zaïde, inachevé, et découvert dans ses papiers après sa mort. Les analogies avec l'Enlèvement au Sérail sont nombreuses, et point seulement dues aux ressemblances des livrets. Mozart y réussit un accord entre le genre bouffe et le genre de la comédie larmoyante, et qui apparente son style, dans cet ouvrage, à celui de Monsigny.
Mozart a maintenant rompu toute attache avec Salzbourg et son prince-archevêque. Il se rend à Vienne. Il y trouve mariée Aloysia Weber, qu'il a tendrement aimée dans le secret de son cœur ; mais il s'éprend de la troisième fille, Constance, et l'épousera le 4 août 1782 — trois semaines après la première de l'Enlèvement au Sérail qui a lieu le 16 juillet. L'ouvrage, comme l'ont dit Schürig et Prod'homme est « la cristallisation de l'amour du jeune couple ». Le titre d'abord est comme un aveu : Belmont und Konstanze, ou Die Entführung ans dem Serail. Il est aisé de deviner que Belmont est Mozart — comme Constance est sa fiancée, et la musique traduira passionnément les sentiments du jeune homme.
Mis en possession du manuscrit un an plus tôt, il avait immédiatement commencé son travail. Il alla vite, mais des empêchements vinrent en travers de ses projets, et il fallut même que l'Empereur intervînt pour le faire jouer. Ce fut un triomphe qui dure encore. Sous le badinage de l'aimable turquerie dans le plus pur goût du XVIIIe siècle que le librettiste Christoph Bretzner et l'adaptateur Stéphanie le jeune proposent au musicien, on sent les battements d'un cœur voluptueux et ardent. Bien des pages sont comme des confidences à peine voilées sous un humour léger. Elles traduisent le « romantisme » de Mozart qui écrit là non point un ouvrage de commande, mais qui raconte sa propre histoire, qui se peint tout vif dans sa partition. La musique a le ton d'une lettre d'amour : elle est convaincante et passionnée.
Inutile d'entrer dans le détail d'un livret si connu ; l'intrigue est simplette, son invraisemblance n'embarrasse point : la musique, dès l'ouverture, fait accepter d'avance tout ce que le spectateur verra sur le théâtre. La partie bouffe n'est pas moins réussie que les scènes d'amour ; et les situations qui défient la logique, la grâce et l'esprit de la partition empêchent qu'on en remarque l'incohérence. Les deux airs d'Osmin, au premier acte et au dernier, les airs de Belmont et de Constance, la sérénade de Pedrillo, le quatuor du second acte, le trio du premier, sont parmi les chefs-d’œuvre les plus purs du maître : ils soutiennent la comparaison avec les pages les plus belles des Nozze et de Don Giovanni. Sans doute faut-il mentionner tout spécialement la romance de Pedrillo, accompagnée par des pizzicati, non seulement à cause de la poésie si merveilleuse de cette sérénade, mais parce que l'incertitude tonale de ce morceau l'apparente étroitement à ceux que Fauré écrira un siècle plus tard. Mozart s'aventure ici avec une magnifique sûreté hors de toutes les règles admises. Il retrouve d'instinct ce que la musique modale avait produit de plus suave, il anticipe ce qui fera le charme merveilleux de Fauré.
Der Schauspieldirektor (le Directeur de Théâtre) conte, en un petit acte, commandé pour un gala donné à Schönbrunn par l'empereur, une anecdote de coulisses, la rivalité de deux cantatrices. Le livret de Stéphanie le jeune est assez fade ; la musique de Mozart parvient, non sans peine, à en relever la médiocrité.
En 1783, pendant l'été, il commence un opéra bouffe en deux actes, sur un texte de l'abbé Vacario, l'Oca del Cairo (l'Oie du Caire), et il en écrit le premier acte, malgré l'ineptie du livret, qui bientôt le décourage. Ce qui en reste contient des pages délicieuses dont une au moins, est reprise dans les Nozze. Un heureux hasard met alors sur sa route l'homme qui va lui fournir l'occasion de donner sa pleine mesure, Lorenzo da Ponte, de son nom véritable Emanuele Conigliano. Vénitien d'origine juive, mis au séminaire, devenu abbate sans conviction, Da Ponte fait songer à Casanova — dont il est d'ailleurs l'ami. Il a la même insouciance, sans doute aussi la même absence de scrupules ; il est aussi friand d'aventures, de conquêtes féminines. Le Don Juan qu'il offrira plus tard à Mozart lui ressemblera par plus d'un trait, et il n'aura qu'à puiser dans ses propres souvenirs pour peindre le personnage au naturel. Pour le moment Da Ponte qui a dû fuir Venise est à Vienne ; il y est devenu une sorte d'homme indispensable, grand fournisseur de libretti aux musiciens à la mode. Sans trop de vergogne — mais tel était l'usage, et nul n'y voyait malice — il tire du Mariage de Figaro un livret qu'il remet à Mozart en juillet 1784. Le compositeur est cette fois en possession d'un texte qui va lui permettre de se donner tout entier ; en outre le projet, aussitôt que soumis au directeur du théâtre, est accepté, et Mozart se presse d'écrire. En quatre mois, il a terminé sa partition ; mais des rivaux intriguent et parmi eux, Salieri, l'auteur applaudi des Donne letterate (les Bas-Bleus) se montre le plus actif. Il ne peut cependant triompher de l'astuce du Vénitien et le Nozze di Figaro sont représentées le 1er mai 1786 à l'Opéra de Vienne.
La cabale veillait : elle faillit compromettre l'ouvrage à la première représentation. Elle n'en put empêcher complètement le succès, mais il demeura médiocre. Mozart allait prendre sa revanche à Prague, où une excellente interprétation lui valut un triomphe quelques mois plus tard : Da Ponte fera allusion dans le livret de Don Giovanni à ce succès.
Mettre en musique la comédie de Beaumarchais semblait une impossible gageure, Mozart l'a tenue et il a même fait un miracle. Le chef-d’œuvre est étincelant : plus on le connaît, plus on l'étudie, plus on y trouve des raisons nouvelles de l'aimer, de l'admirer davantage. Son extrême variété, le don que possède le musicien de traduire les moindres nuances des sentiments, des caractères, de faire naître dans l'esprit de l'auditeur par une simple allusion la pensée même qu'il lui plaît de suggérer, en font une partition qui serait sans égale si Don Juan ne la surpassait sans doute encore.
Bondini, directeur du théâtre de Prague, tout heureux du succès des Nozze, s'empressa donc de commander à Mozart un autre opéra. Da Ponte à défaut d'originalité très vive, avait une qualité : il savait discerner dans les œuvres de ses confrères ce qui était excellent, ce qui était mauvais, et s'approprier sans scrupules les premières de ces choses en évitant les secondes avec soin. Innombrables étaient les Don Juan ; le sujet faisait même partie du répertoire de la Commedia dell'arte ; en 1786, le Vénitien Gazzaniga venait de faire représenter un Don Giovanni ; ce fut probablement cet opéra qui donna l'idée à Da Ponte d'en écrire un à son tour. Il s'inspira très largement du livret que Bertati avait tiré de Goldoni pour Gazzaniga ; mais il sut aussi emprunter ailleurs les éléments dont il avait besoin. Il est sûr que Mozart et lui eurent de nombreux entretiens au sujet du scénario ; il est possible que Casanova ait même aidé son ami Da Ponte. Celui-ci, en tous cas, alla vite en besogne, et durant l'été, le musicien se mit à la composition de son Don Giovanni, et le dramma giocoso entra en répétitions au début de l'automne. La première représentation, le lundi 29 octobre 1787, fut accueillie par un public transporté jusqu'au délire.

costumes italiens du XIXe siècle pour Don Juan, opéra de Mozart
Dramma giocoso : ces deux mots définissent exactement le Don Juan de Mozart. On a fait bien des reproches à Da Ponte. Il eut le mérite de fournir à un musicien de génie l'étoffe d'un chef-d’œuvre, et taillée très exactement à sa mesure : la gaieté naturelle de Mozart, son humour, s'y trouvent à l'aise comme ses qualités profondes d'émotion et Don Giovanni reste le plus parfait de ses ouvrages. Depuis l'ouverture, qu'on dit avoir été improvisée à la veille de la création, jusqu'au finale, la partition offre une diversité, une richesse dont on reste confondu. Des scènes comme la mort du Commandeur (Mozart avait perdu son père le 28 mai, quelques semaines avant d'écrire la première scène, et c'est sa propre douleur qu'il y exhale) atteignent par leur concision, par la grandiose simplicité des moyens mis en œuvre, le plus haut degré du pathétique, tandis que les parties bouffonnes, le rôle de Leporello, sont bien certainement ce qui a été fait de plus réussi dans le genre. Mais c'est peut-être encore dans le mélange qu'on pourrait dire réaliste de l'élément comique et du dramatique, que se révèle le génie de Mozart, fait de tact, de mesure, de pudeur et de simplicité naturelles. Rien de forcé jamais ; quelques notes, un trait léger, suffisent à marquer de la nuance la plus juste une situation ou un caractère. Les airs de Zerline comme ceux de Suzanne dans le Nozze, expriment, ou plutôt suggèrent sans appuyer jamais, toute la grâce de la femme amoureuse et qui hésite à l'appel du désir. Jamais musique n'a su exprimer tant de choses, et si parfaitement, transporter l'auditeur en un instant et avec tant d'aisance, de la tendresse voluptueuse à la douleur. Jamais art n'a été aussi spontané.
Le caractère de Don Juan doit même à Mozart une sorte d'élargissement : son héros libertin demeure — comme celui de Molière — un grand seigneur pour qui rien ne compte hormis la satisfaction de son caprice. Mais il est quelque chose de plus, et qui resterait à peine esquissé si Mozart s'en était tenu au texte du livret. Don Giovanni reste chevaleresque jusque dans la ruse et dans le crime. Ce que le librettiste n'avait su dire, la musique l'exprime. Et cette réussite du génie est si grande qu'elle offre à chaque génération un miroir où celle-ci trouve le reflet de sa propre image dans les personnages qu'on lui montre. Chacun d'eux, cependant, est d'une vérité temporelle et locale fort exacte : il est de son propre temps, et il est aussi de tous les temps, parce qu'il est, de par la grâce de la musique de Mozart, profondément humain.
L'heureuse collaboration de Mozart et de Da Ponte se poursuit avec Cosi fan tutte, dont le titre est la paraphrase d'une parole de Basile dans les Nozze lorsque le comte découvre Chérubin tapi sous la robe jetée sur un fauteuil :
Cosi fan tutte le belle,
Non c'è alcuna novità.
J'insisterai davantage sur cet ouvrage parce qu'il est peut-être moins connu du public français et parce qu'il a donné lieu à maintes discussions sur son sens et sa valeur. Vaines querelles, d'ailleurs et qui sont venues de ce besoin de tout embrouiller de ce qui resterait clair si l'on ne prêtait gratuitement aux auteurs des intentions secrètes, si lorsqu'il s'agit de musique, le plus simple n'était pas de la lire, de l'écouter telle qu'elle est et sans idées préconçues. La musique est claire. Le livret n'a point bonne réputation. Il passe pour absurde. Taine a dit dans une page de Thomas Graindorge : « La pièce n'a pas le sens commun ! » Mais il a tout aussitôt ajouté : « Et c'est tant mieux ! Est-ce qu'un rêve doit être vraisemblable ? » Prenons donc le livret pour ce qu'il est : un livret d'opéra bouffe, une seconde mouture, enjolivée, des Troqueurs de Vadé et Dauvergne, représentés à la Foire Saint-Laurent en 1753. Rien ne permet d'affirmer que Da Ponte l'ait connu ; on assure même que ce fut l'empereur qui lui proposa de développer une aventure survenue à Trieste peu avant et dont on avait beaucoup jasé. Quant à Mozart, on n'a point à lui reprocher d'avoir « accepté un livret indigne de lui » : Niemtschek affirme qu'il lui fut expressément imposé et qu'il n'était pas en son pouvoir de le refuser. En 1790, Mozart était d'ailleurs dans la pire détresse, et si quelque chose étonne, c'est qu'il ait pu, au fond de la misère, composer un ouvrage aussi gai que Cosi fan tutte.
Da Ponte a voulu écrire une farce, et c'est bien une farce italienne, toute proche de la Commedia dell'arte qu'il a écrite. Il a parfaitement fait ce qu'il voulait faire. Taine a raison : il est absurde d'attendre d'une farce autre chose qu'une occasion de rire. Don Alfonso, le raisonneur de Cosi fan tutte, le dira expressément en tirant la morale de la comédie :
Fortunato l'uom che prende
Ogni cosa per buon verso...
Quel che suole altrui fare piangere
Sia per lui cagion di riso.
C'était déjà la morale de Figaro : Da Ponte avait sujet de s'en souvenir.
Deux lieutenants, deux amis, Ferrando et Guglielmo sont amoureux des deux sœurs, Fiordiligi et Dorabella, et tous deux fort épris. Don Alfonso parie avec eux que leurs belles sont pareilles à toutes les filles. Les deux compères sont trop coiffés pour douter. Ils gagent donc. Cent sequins sont l'enjeu que chacun croit empocher. Arrivent les deux sœurs ; Alfonso leur annonce que le régiment part pour la guerre : adieux déchirants, promesses de fidélité. Une marche guerrière sonne (et c'est un chef-d’œuvre d'ironie mozartienne) ; une barque emporte les deux officiers. Pas bien loin, juste le temps qu'il faut pour qu'ils se déguisent en Albanais et pour qu'Alfonso mette dans son jeu la soubrette Despina. Ils reviennent méconnaissables : « Che figure, che mustacchi ! Io non so se son Valacchi, o se Turchi son costor ! » s'écrie Despina en riant. On présente les deux Albanais aux jeunes filles, et bien entendu le malicieux Alfonso a voulu qu'il y ait chassé-croisé : c'est à Dorabella que Guglielmo fait la cour, et c'est Fiordiligi qu'entreprend Ferrando. La prudence le veut : on ne déguise pas sa voix sous une paire de moustaches. Les deux filles résistent d'abord. Avec la complicité de Despina, Alfonso, tandis qu'elles se promènent dans le jardin, fait revenir les deux Albanais. Simulant le désespoir de n'avoir pu fléchir les belles, ils feignent d'avaler de l'arsenic. On court chercher un médecin, et c'est Despina, déguisée en docteur, qui accourt. Elle applique la méthode de Mesmer : pour ses passes, Fiordiligi soutient la tête de Ferrando, Dorabella la tête de Guglielmo. On s'attendrit ; on renaît à la vie. Et les deux Albanais reconnaissants vont offrir une fête de nuit à leurs charitables victimes.
C'est le sujet du second acte. Despina qui décidément est le diable, entreprend de persuader à ses maîtresses qu'elles ont tort de demeurer insensibles. On entend une sérénade. Les soupirants arrivent aussitôt. Guglielmo offre à Dorabella un bijou en forme de cœur, et obtient en échange le portrait de Ferrando ; Fiordiligi lui en fait reproche : elle aime toujours Guglielmo et veut aller le rejoindre aux armées sous un déguisement. Ferrando paraît alors et la supplie de le tuer puisqu'il ne doit plus la revoir. C'en est trop : elle est vaincue — et c'est maintenant Guglielmo qui se désespère. Alfonso tire la morale : « Cosi fan tutte ! Tout le monde accuse les femmes ; moi, je les excuse ; jeunes ou vieilles, belles ou laides, elles sont toutes ainsi ! »
On se hâte d'organiser une cérémonie pour signer les contrats. Despina sera le notaire comme elle a été le médecin. Elle lit l'acte en effet ; mais on entend à nouveau la marche militaire et Alfonso simulant l'inquiétude fait disparaître les deux Albanais. Ainsi Guglielmo et Ferrando peuvent quitter sabres et moustaches de janissaires. Ils disparaissent, trouvent Despina qui s'est réfugiée dans une pièce voisine. La fine mouche prétend revenir d'un bal masqué. Ils s'empressent près de leurs fiancées, mais Guglielmo découvre le contrat de mariage, et éclate en reproches véhéments. Alors il leur faut bien déclarer que c'était eux les deux Albanais. Et tout finit par une réconciliation générale. Sur quoi Alfonso tire la morale que l'on sait.
On a pu remarquer les nombreuses analogies de certaines scènes avec celles des Nozze. Oh ! certes, le livret n'a pas la finesse de l'autre ; mais il tendait au musicien un piège redoutable par ces analogies elles-mêmes. La marche militaire du premier et du deuxième acte fait irrésistiblement penser au Non più andrai de Figaro, au Cherubino alla vittoria ! Et les ruses de Despina rappellent celles de Suzanne. Mais Wagner s'est écrié : « Comme j'aime profondément Mozart parce qu'il ne lui fut pas possible d'inventer pour Cosi fan tutte une musique pareille à celle de Figaro ! » L'originalité de Mozart est là tout entière. Sur le texte assez médiocre de Da Ponte, il a renouvelé le miracle de Don Giovanni.
Cosi fan tutte, c'est la musique avant tout, c'est sur une trame qu'on dirait trop mince si l'on n'était tenté de la dire assez grossière, une broderie qui la couvre, qui la transforme si complètement que peu importe la matière qui lui sert de support. Elle disparaît, cette matière, elle n'est plus que le soutien du rêve que Taine disait tout à l'heure : « Est-ce que dans la contrée idéale comme la forêt d'As you like it, les amants ne sont pas affranchis des nécessités qui nous contraignent et des chaînes sous lesquelles nous rampons ? Ceux-ci se déguisent en Turcs, et leurs maîtresses croient tout cela. Moi aussi, je veux croire ces folies un instant, si peu d'instants qu'il vous plaira ; et c'est justement pour cela que mon émotion est charmante. Je ferai comme le musicien : j'oublierai l'intrigue. » La partition de Cosi contient des beautés qui autorisent à la mettre en balance avec celles des Nozze et de Don Giovanni ; elle est tout entière baignée dans une atmosphère sonore d'une limpidité et d'un charme que G. de Saint-Foix qualifie justement de « méditerranéens » et nulle part Mozart n'a cherché avec un tel raffinement « la jouissance purement musicale, la beauté concertante d'un son instrumental qui vient s'adjoindre à la voix, rehausser son accent, commenter sa mélancolie, son ardeur et son trouble. La clarinette y multiplie ses chaudes caresses, ses molles inflexions. » Les airs de Fiordiligi, l'air de Ferrando au second acte, l'air de Guglielmo dans lequel, pour plaire à sa fiancée, il énumère toutes ses qualités, sont parmi les plus beaux du répertoire mozartien ; le musicien a su, de ce livret de farce, faire un poème qui chante l'amour heureux tout nuancé de mélancolie. Mais Cosi fan tutte n'offre pas seulement d'admirables pages isolées ; ce qui relie entre eux ces passages est de la même qualité dans la diversité, et c'est d'un bout à l'autre un jaillissement continu, un flot mélodique harmonisé et orchestré avec un raffinement sans défaillance. Et cette continuité si variée, cette pure atmosphère de rêve font de Cosi fan tutte quelque chose qui est dans la musique l'analogue de ce qu'est dans la poésie dramatique l'enchantement shakespearien.
Cosi fan tutte fut représenté pour la première fois au Burgtheater de Vienne le mardi 26 janvier 1790 et fut donné dix fois dans l'année : en février la mort de Joseph II en interrompit le cours. Néanmoins le succès en avait été assez vif pour qu'une traduction allemande en fût immédiatement faite.
De mars à septembre 1791, Mozart fut occupé de la Flûte enchantée. On sait les circonstances qui l'amenèrent à entreprendre ce grand opéra en deux actes d'un genre nouveau : le 7 mars, Schikaneder lui en avait proposé le sujet : un conte de fées, inspiré de l'esprit maçonnique — Mozart était depuis longtemps affilié à une loge viennoise à laquelle appartenait également Schikaneder. Pas plus que Da Ponte, Schikaneder ne se montrait scrupuleux sur la question des emprunts faits à ses confrères : Die Zauberflöte doit beaucoup à quelques ouvrages antérieurs, et le fond même vient à la fois d'un conte de Wieland et de Sethos, histoire de l'ancienne Égypte, de l'abbé Terrasson. Quoi qu'il en soit, une fois encore la musique de Mozart va triompher de la puérilité du livret, et tout en respectant les inventions parfois incohérentes de Schikaneder, le compositeur va donner à l'ouvrage une noblesse qui l'élèvera jusqu'aux sommets. Ce qui revient en propre à Schikaneder c'est le personnage de Papageno, l'oiseleur, reflet du héros populaire salzbourgeois Kasper, naïf et fanfaron. Mozart a paré d'une grâce ingénue les couplets de son librettiste, avec la même sûreté qu'il mit une sobre grandeur dans le rôle du grand prêtre d'Isis Sarastro, une intense poésie dans ceux de Tamino et de Pamina, une délicate et charmante drôlerie dans le duo de Papageno et de Papagena qui précède le finale, et dans le rôle de Monostatos. Et quelle merveille que cette scène où les deux hommes armés qui veillent aux portes de l'effroi, attendent et accueillent Tamino pour l'épreuve suprême ! Ici, par la simplicité des moyens l'art de Mozart se surpasse.
La première représentation fut donnée le 30 septembre 1790 au théâtre auf der Wieden, une sorte de grange transformée en salle de spectacles dans un faubourg de Vienne. De soir en soir les recettes montèrent, et Schikaneder dut donner die Zauberflöte deux cents fois en trois ans.
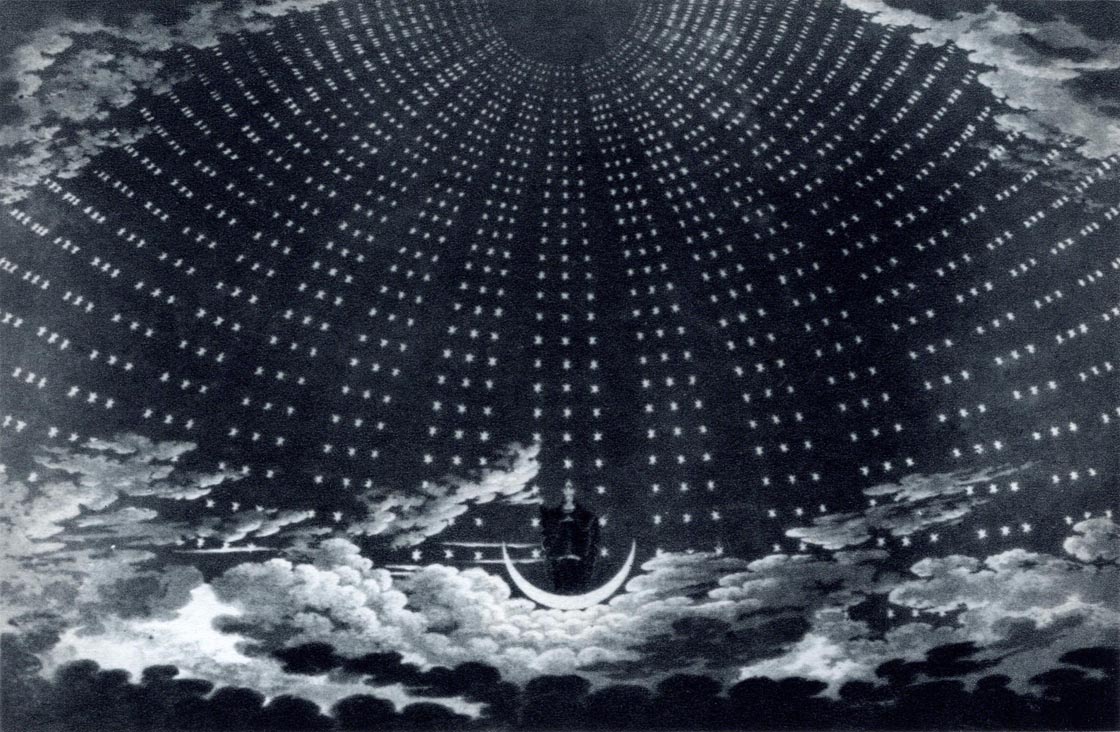
décor de Schinkel pour la Flûte enchantée de Mozart (acte I, scène 6), reprise à Berlin vers 1845
Tandis qu'il avait commencé l'orchestration de la Flûte enchantée, Mozart reçut au début d'août la commande d'un opera seria, la Clemenza di Tito, sur un texte de Métastase réduit en deux actes par Caterino Mazzola. Il s'agissait de composer pour les fêtes du couronnement de l'empereur Léopold II une partition destinée à Prague. La cérémonie était fixée au 6 septembre ; Mozart était épuisé par le travail ; il avait en chantier l'instrumentation de la Flûte enchantée et la composition du Requiem. Rien d'étonnant que la Clémence de Titus sente la hâte, que certains passages laissent même voir une sorte d'indifférence pour un sujet imposé. Et pourtant la partition contient des chœurs qui sont parmi les plus beaux que l'on doive au musicien. Il se peut qu'il ait laissé à son élève Sussmayer (qui acheva le Requiem) le soin d'écrire quelques numéros de l'opéra. Il allait mourir dans la nuit du 5 décembre 1791, à l'âge de trente-cinq ans. Ses compatriotes ne soupçonnaient même pas sa valeur, et il fallut bien des années pour que l'on reconnût en Wolfgang Mozart l'un des plus grands, sinon même le plus grand de tous les musiciens de génie.
On a noté déjà chemin faisant, à propos des Nozze, de Don Giovanni et de Cosi fan tutte, les traits les plus caractéristiques de son style. Il est d'ailleurs fort inexact de parler du style de Mozart puisqu'il sut varier à l'extrême les modes d'expression de sa pensée et changer de manière selon qu'il changeait de sujets. D'autre part, au cours d'une si brève carrière, mais si remplie de travaux, Mozart a sensiblement évolué au gré des circonstances, et selon les influences recherchées plutôt que subies. Il les a toutes si parfaitement assimilées, dominées même, qu'aucune d'elles n'a gêné l'épanouissement de sa propre sensibilité. Il est en cela pareil à un polyglotte capable d'exprimer aussi parfaitement sa pensée en italien qu'en allemand ou en français, d'en marquer les moindres nuances en quelque langue qu'il écrive ou qu'il parle, et Wagner a pu dire que les meilleurs opéras italiens avaient été composés par un Allemand. Pourtant on sent bien en écoutant les Nozze ou Cosi fan tutte (je ne parle même pas de Don Giovanni, où il y a plus de profondeur), que la perfection de cet italianisme recouvre une perfection allemande plus grande encore.
Mais en dépit de cette diversité, la phrase de Mozart se reconnaît entre toutes, si parfaites que soient les autres. Prenons par exemple les airs les plus réussis du Matrimonio segreto : il manque à Cimarosa, malgré le charme pétillant de son orchestre, malgré la perfection d'écriture des parties vocales, malgré l'esprit de sa musique, ces nuances subtiles d'émotion contenue, de tendresse et de mélancolie qui se font sentir à chaque instant sous la mélodie de Mozart ou dans la trame harmonique de ses accompagnements. Il y manque ces fulgurantes audaces, ces raccourcis prodigieux — et toujours si parfaitement naturels chez Mozart — ces trouvailles qui émeuvent, qui déchirent même, sans appuyer jamais. Il lui faut six mesures, et une gamme descendante toute simple pour faire sentir à l'auditoire le frisson de la mort à l'instant qu'expire le Commandeur ; et dans le même ouvrage, la phrase de Zerlina offrant à Masetto le délicieux remède qu'elle lui apporte, n'est-elle pas la plus voluptueuse qu'un musicien ait jamais écrite :
Toccami quà ! sentilo battere...
L'appoggiature et le trille qui la suit deux mesures plus loin, n'est-ce point le frisson de la chair amoureuse, n'est-ce point la vie ? Il y a une sorte d'innocence dans tant de hardiesse ; et l'art pour mieux faire comprendre la nature en retrouve la simplicité.
De même dans le duo Là ci darem la mano : jamais musique n'a si bien exprimé l'amour — ou plutôt l'instinct d'aimer, la puissance qui pousse deux êtres à s'étreindre. Et cependant jamais musique n'a été moins vulgaire, plus immatérielle que celle où Mozart a su mettre tous les désirs, tous les appels irrésistibles de la volupté. Comment des sentiments si complexes, si divers, ont-ils pu tenir dans une trentaine de mesures ? Vorrei e non vorrei — Je voudrais et je ne voudrais point... Sollicitation des sens, conscience du devoir, qui va s'affaiblissant jusqu'à l’Andiamo ! jusqu'au moment où l'instinct d'aimer l'emporte sur la raison...
Et combien d'autres pages merveilleuses dans ces ouvrages lyriques de Mozart ! Génie libre, qui semble avoir tout pressenti, tout deviné de ce qu'il n'a pu connaître, et qui dans une courte existence de trente-cinq ans parvint à accumuler les plus hauts chefs-d'œuvre que l'art des sons ait jamais produits.
IV
Et cependant ses contemporains lui opposèrent Salieri, le lui préférèrent souvent même. Antonio Salieri, le rival heureux de Mozart, était né à Legnano le 19 août 1750. Après avoir étudié à Venise, il y connut F.-L. Gassmann qui, appelé à Vienne en 1775 pour y écrire des ballets, l'emmena avec lui, lui enseigna la composition et prit soin de développer sa culture générale. Grâce à son protecteur, le Donne letterate (les Bas-Bleus), furent présentés à Gluck qui encouragea Salieri, et créés en 1770 devant l'empereur. Avec la Fiera di Venezia, le succès de Salieri grandit deux ans plus tard, et l'ouvrage fut joué à Munich et à Mannheim après Vienne. Alors commença une existence de production fiévreuse : Salieri n'a pas laissé moins de quarante opéras. Cependant le renom grandissant de Gluck aurait pu lui nuire ; il eut l'adresse de se rendre indispensable au maître ; il sut imiter son style, l'aider si bien que Gluck le manda à Paris et fit représenter le 26 avril 1784 les Danaïdes (opéra en cinq actes sur un livret de Du Roulet) comme un ouvrage de lui ; et ce ne fut qu'après la douzième représentation, une fois le succès assuré, que Gluck déclara dans une lettre rendue publique, que l'œuvre appartenait entièrement à son élève Salieri. Les Danaïdes contiennent de belles scènes, et l' « Imprécation » d'Hypermnestre, refusant à Danaüs d'obéir à l'ordre qu'il lui donne, comme à ses sœurs, d'immoler son époux, est d'une réelle grandeur qui explique la méprise des contemporains. C'est encore pour Paris que Salieri écrivit les Horaces (1786), Tarare (1787). Rentré à Vienne en 1788, Salieri fut nommé chef d'orchestre de la cour, puis maître de la chapelle de l'empereur. Il agit malheureusement avec Mozart d'une manière qui a terni sa réputation. On a prétendu qu'il s'était accusé sur son lit de mort d'avoir empoisonné son rival, et Pouchkine a tiré de cette légende un opéra mis en musique par Rimski-Korsakov ; rien ne prouve que Salieri ait commis ce crime. On est sûr cependant que ses intrigues n'ont que trop réussi à assombrir les dernières années de Mozart.

costumes pour la création à Paris de Tarare, opéra de Salieri (1787)
Giuseppe Sarti (1729-1802) fut lui aussi un rival de Mozart. Élève du P. Martini, appelé à Copenhague près du prince héritier, il y donna une vingtaine d'opéras, revint en Italie — à Venise d'abord, puis à Milan où il fut maître de chapelle du Dôme — fit jouer à Venise en 1776 le Gelosie villane et Farnace, à Florence Achille in Sciro en 1779, Fra i due litiganti, il terzo gaude à Milan en 1782, puis deux ans plus tard, Catherine II l'appelait pour le nommer maître de chapelle de sa cour. Il créait en 1791 une Académie de musique à Ekaterinoslav ; Paul Ier la ferma, avec toutes les institutions fondées par sa mère, en accédant au trône en 1797. Quatre ans plus tard, sa santé fort altérée, Sarti revenait en Italie ; il n'y put parvenir : la mort le prit à Berlin. Ses œuvres avaient connu à Vienne un succès prolongé, et c'est ainsi que Mozart, faisant jouer par le petit orchestre de musique de table des airs à la mode pour le souper de Don Giovanni, y place un fragment de Fra i due litiganti. Dans la même scène, il intercale aussi une citation de la Cosa rara après l'air Non più andrai de son propre Figaro. C'est qu'en effet Martin y Soler (que les Italiens surnommaient Lo Spagnuolo, parce qu'il était né à Valence en 1754, et que demeuré dans sa patrie pendant sa jeunesse, il s'y était fait connaître à vingt-deux ans avec I Due avari), avait eu la fortune de voir représenter en 1786 la Cosa rara à Vienne où il s'était fixé. L'ouvrage y fut donné soixante fois consécutives après que Martin y Soler eut déjà conquis une solide réputation en Italie avec une dizaine d'autres opéras. Son Arbore di Diana eut encore plus de succès et fut joué une centaine de fois à Vienne. Rival souvent heureux de Mozart, de Cimarosa et de Paesiello, Martin y Soler se rendit en Russie en 1788 et demeura à la tête de l'Opéra italien de Pétersbourg jusqu'en 1801, où ce théâtre céda la place à l'Opéra français. Il mourut dans cette ville en 1806.
A ces noms il faut joindre celui de Cimarosa. Mais on a dit déjà (p. 52) l'accueil triomphal que les Viennois firent au Matrimonio segreto lorsqu'il fut créé chez eux en 1792.
L'ART LYRIQUE PENDANT LA RÉVOLUTION ET L'EMPIRE
L'AUBE DU ROMANTISME
I
Il est bien difficile de tracer des limites précises entre les périodes de l’histoire. Les troubles les plus profonds, les événements les plus graves, s'ils bouleversent l'existence des hommes qui les traversent, s'ils trouvent dans les ouvrages de l'esprit un écho souvent perceptible, ne modifient cependant point les tempéraments des créateurs qui s'adaptent aux circonstances en conservant quelque chose qui tient à leur nature intime. Et s'il est vrai qu'un historien de la musique, doué d'un humour certain, a pu définir la période révolutionnaire : « Un opéra, paroles de Marie-Joseph Chénier, musique de Méhul et Gossec dans un décor de David », c'est qu'en effet la Révolution s'est accompagnée de beaucoup de chants, d'hymnes patriotiques, de fêtes civiques et de grands cortèges, c'est que la musique y tint beaucoup de place ; mais ni Gossec, ni Lesueur, ni Méhul, ni Grétry, n'ont été révolutionnaires dans leur art. Ils ont vécu ; ils ont été les survivants d'une société qui enfanta un monde nouveau, certes, mais eux ne furent pas des hommes nouveaux et traversèrent l'orage comme ils purent pour se retrouver prêts à donner leur concours aux fastes napoléoniens. Leur formation, leurs idées esthétiques, leurs goûts personnels les rattachent au XVIIIe siècle bien plus que la date de leur mort ne les fait hommes de la Révolution et de l'Empire. Ils ont été les fils spirituels de Rameau et de Gluck, comme les politiques du même temps furent les fils de Rousseau et des Encyclopédistes. Et ils sont, en vérité, demeurés ce qu'ils étaient.

incendie de la Foire Saint-Germain en 1762 [gravure coloriée du temps]
La Révolution survient au moment où l'opéra-comique a conquis une grande place dans la vie musicale, et produit des ouvrages qui la méritent. Il en doit une bonne part à un Napolitain francisé, Egidio-Romualdo Duni (1709-1775), élève de Durante, et qui après avoir obtenu des succès en Italie avec un Nerone qui éclipsa à Rome l'Olimpiade de Pergolesi, renouvela ce coup de fortune à Milan, Gênes, Florence et Parme, où il fut nommé professeur de musique de l'Infante Élisabeth. L'influence française y était grande : on lui demanda de composer des opéras sur des paroles françaises ; il mit en musique un livret de Favart, Ninette à la cour qui obtint en 1755 un éclatant succès. Enhardi, il vint à Paris et y produisit quantité de petits ouvrages jugés ravissants. Les plus connus sont le Peintre amoureux de son modèle (1757), le Retour au village (1762), la Clochette (1766), le Docteur Sangrado, la Fille mal gardée, Nina et Lindor, l'Ile des Fous, le Milicien, les Deux Chasseurs et la Laitière, le Renard et la Perdrix (que Marie-Antoinette voulut interpréter elle-même à Trianon avec le comte d'Artois et M. de Vaudreuil), la Fée Urgèle ou Ce qui plaît aux Dames. Le succès de ces ouvrages où avaient brillé Mmes Laruette et Favart auprès de Clairval, se prolongea durant tout l'Empire ; et, bien qu'Italien, Duni fut considéré comme l'un des fondateurs de l'Opéra-Comique français.

Mme Favart dans les Trois Sultanes, opéra-comique de Favart [dessin aquarellé de Boquet ; Musée de l'Opéra]


à gauche : la Bohémienne, opéra-comique de Favart (1755) - à droite : la Chercheuse d'Esprit, opéra-comique de Favart (1741)
Philidor Danican (1726-1795) fut aussi célèbre comme joueur d'échecs que comme compositeur et partagea sa vie entre les parties disputées avec les meilleurs joueurs de l'Europe, et la musique. Il appartenait à une dynastie de musiciens de la Grande-Écurie et avait pour prénoms François-André ; il débuta par un Lauda Jerusalem donné au Concert Spirituel en 1755, puis s'avisa d'écrire pour le théâtre. Blaise le Savetier (récemment encore repris à l'Opéra-Comique), en 1759, l'Huître et les Plaideurs, la même année, le Quiproquo ou le Volage fixé (1760), la même année le Soldat magicien (un chef-d’œuvre), le Jardinier et son Seigneur (1761), un autre chef-d’œuvre : le Maréchal-ferrant, Sancho Pança dans son île, le Bûcheron (1763), le Sorcier (1764), (une date : ce fut la première fois que les applaudissements contraignirent un auteur à venir saluer le public sur la scène au milieu de ses interprètes) ; dix ou vingt autres ouvrages légers et spirituels, pleins de musique, attestent son génie en même temps que sa fécondité. Mais on lui doit aussi le Carmen Sæculare d'Horace qu'il mit en musique pour Londres en 1779, et qui reste le plus grand oratorio profane français du XVIIIe siècle.
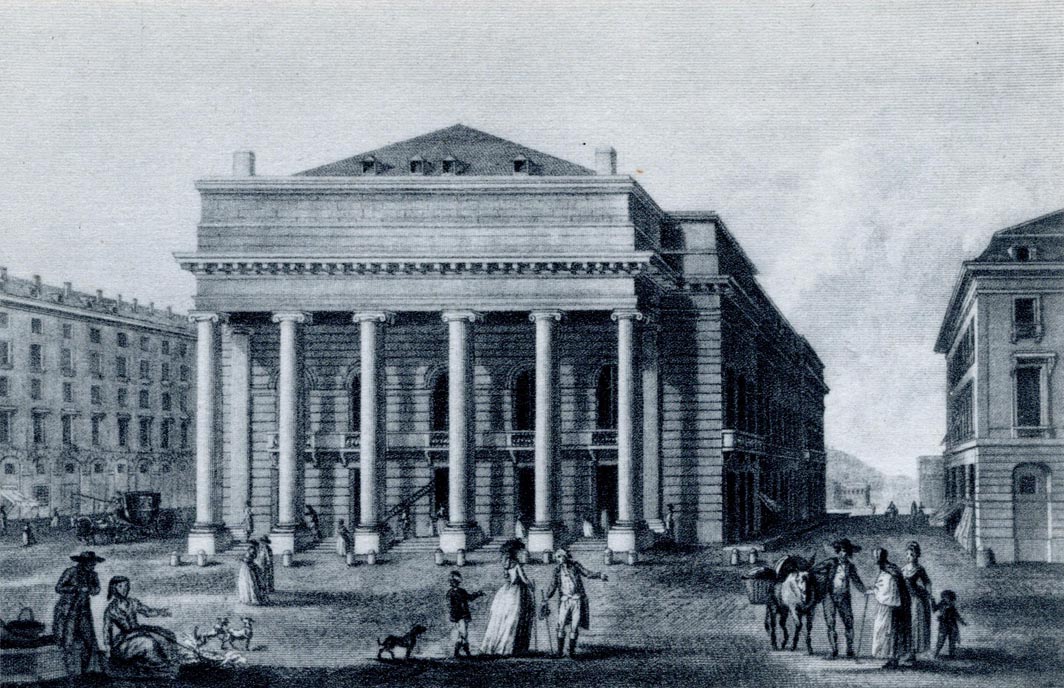
la salle Favart vers 1785 (détruite en 1838) [gravure d'après un dessin de Lallemand]
Pierre-Alexandre Monsigny (1729-1817) débuta comme violoniste, puis, à la mort de son père, dut subvenir à l'entretien de sa famille et fut intendant de la Maison du duc d'Orléans. La Serva padrona le décida à travailler la composition, et bientôt après, il donnait à la Foire Saint-Laurent les Aveux indiscrets (1759). Le succès l'encouragea et Monsigny fut bientôt le fournisseur attitré des Italiens : le Maître en droit (1760) et le Cadi dupé, la même année, On ne s'avise jamais de tout (1761), le Roi et le fermier (1762), Rose et Colas (1764), Aline reine de Golconde (1766), l'Ile sonnante (1768), le Déserteur (1769), le Faucon (1772), la Belle Arsène (1773), le Rendez-vous bien employé (1774), Félix, l'enfant trouvé (1777), lui valurent la fortune. Ce dernier ouvrage fut un triomphe : les livrets de Sedaine trouvaient en lui le musicien le mieux fait pour en traduire la bonhomie et la sentimentalité ; mais il y a quelque chose de mieux dans sa musique : le don mélodique de Monsigny, un tour charmant, une distinction naturelle ont gardé ses ouvrages du vieillissement. Devenu inspecteur général des Canaux, il cessa d'écrire. La Révolution lui fit perdre et sa place et ses économies, et il fût tombé dans la misère si l'Opéra-Comique ne lui avait fait une pension annuelle de 2 400 francs. En 1813, il succéda à Grétry à l'Académie.
Soixante et un opéras-comiques écrits en vingt-huit ans valurent à Nicolas d'Alayrac (ou Dalayrac) (1753-1809) une réputation considérable. Ami des Encyclopédistes, il débute en 1781 par deux opéras-comiques, le Petit Souper et le Chevalier à la mode, donnés sur le théâtre de société du comte de Besenval. Marie-Antoinette assiste au spectacle et prend Dalayrac sous sa protection. La Comédie-Italienne s'ouvre devant lui. Il en deviendra l'un des musiciens attitrés. Ses principaux succès furent l'Éclipse totale (1782) avec laquelle il débuta ; le Corsaire (1783), Nina ou la Folle par amour (1786), Azémia ou les Sauvages (1787), Fanchette (1788), les Deux petits Savoyards (1789), Éloi et Bathilde, la Soirée orageuse, Vert-Vert (1790), Marianne (1795), la Famille américaine (1795), Gulnare ou l'Esclave persane (1797), la Maison isolée, Primerose, l'Erreur d'un bon père, Adolphe et Clara, Laure, Maison à vendre (qui est resté au répertoire) (1800), Luina, etc.
J.-P. Schwarzendorf, qui changea son nom pour celui de Martini (1741-1816) écrivit d'abord des marches militaires, puis débuta au théâtre avec l'Amoureux de quinze ans en 1771. On lui doit le Droit du Seigneur, Annette et Lubin (1800), qui eurent du succès ; mais c'est la romance Plaisir d'amour sur des paroles de Florian, qui sauva son nom de l'oubli.
Né à Liège en 1742, A.-E.-M. Grétry sut traverser les orages qui bouleversèrent l'Europe sans perdre sa bonhomie, et s'il n'est plus guère aujourd'hui qu'un nom de musicien dont l'œuvre est à peu près oubliée, il mit cependant dans ses opéras une fraîcheur superficielle qui peut plaire encore. Il y mit mieux aussi, car, en bien des points, il a devancé son temps, et il ne faut pas oublier que Mozart tira profit de l'avoir entendu. Mais sa musique est souvent creuse, et l'on a pu dire qu'entre la partie de premier violon et la basse, on ferait passer un carrosse. Il a énormément écrit dans tous les genres, comme tant d'autres musiciens de son temps. Ses idées sur l'opéra devancent celles de Wagner ; mais on n'en trouve point dans ses ouvrages la démonstration convaincante.
Une bourse lui permit d'aller en 1759 à Rome. Il y donne en 1765 la Vendemmiatrice (la Vendangeuse) à un théâtre d'amateurs. De son énorme production — plus de cinquante opéras, et des ouvrages de tous les genres, en nombre plus élevé encore — que reste-t-il ? Sa fortune commença avec le Huron, sur un livret que Marmontel tira de l'Ingénu, et qui fut représenté au Théâtre italien le 20 août 1768. Auparavant, Isabelle et Gertrude avaient eu quelque succès ; mais les Mariages samnites firent bâiller d'ennui. La marche du Huron (qui venait pourtant des Mariages) fit la fortune de l'ouvrage et celle du musicien. Tout Paris chanta
Comme il est gai, comme il est leste…
Il a des ailes aux talons,
et elle est encore au répertoire de nombreux orphéons. Lucile (5 janvier 1769, où se trouve le fameux « Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ») semblait une transposition sonore d'un tableau sentimental de Greuze, proposée au musicien par Marmontel. Les Deux Avares (I770), Zémire et Azor (1771), la Rosière de Salency (1773), la Fausse Magie (1775), un ballet héroïque, Céphale et Procris (1775), réussirent, mais un drame burlesque, Matroco (1778) fut un échec racheté par le succès du Jugement de Midas et de l'Amant jaloux (1779). En 1782, c'est Colinette à la Cour ou la Double Épreuve, et l'année suivante la Caravane du Caire, et c'est enfin le 21 octobre 1784 Richard Cœur-de-Lion, son chef-d’œuvre, resté classique, bien que presque oublié après s'être maintenu fort longtemps au répertoire. Le livret de Sedaine offrait providentiellement à Grétry des situations les mieux faites pour donner libre cours à sa facilité en même temps qu'à sa sensibilité. Fait prisonnier au retour de la Croisade, le roi d'Angleterre est enfermé dans le château de Dürenstein. Le ménestrel Blondel de Nesle veut le sauver, et pour se faire reconnaître, il vient chanter sous la fenêtre du cachot, la chanson Une Fièvre brûlante, dont Richard chante en réponse la seconde strophe. D'autres passages de l'opéra sont devenus populaires : l'air de Blondel au premier acte, O Richard, ô mon Roi, l'air de Richard, au second acte, Si l'Univers entier m'oublie, le trio du troisième acte : Le Gouverneur pendant la danse, la ronde de la noce : Et zig, et zig et zog, quand les bœufs vont deux à deux, en ont assuré le succès. Grétry a fait effort pour être vrai, tout en essayant de donner à sa musique un aspect suffisamment archaïque. On ne peut dire qu'il n'a point trop présumé de ses forces ; il eut en tous cas le bonheur de plaire, tout en orientant l'art lyrique vers une direction nouvelle. Et ce ne fut point sans lutte : on sait le quatrain que Voltaire écrivit à propos du Jugement de Midas :
La Cour a dénigré tes chants
Dont Paris a fait des merveilles
Grétry, les oreilles des grands
Sont souvent de grandes oreilles.

tableau magique de Zémire et Azor de Grétry (1771) [gravure de Voyez le jeune]

scène de Richard Cœur de Lion de Grétry (1784) ; acte III, scène 10 [gravure de Bornet]
Isouard, connu sous son prénom : Nicolo, était né à Malte en 1775 et s'était fait une réputation en Italie par un Artaserse créé à Livourne en 1794. Il vint à Paris où l'Opéra-Comique monta son Tonnelier en 1799, suivi bientôt de Michel-Ange (1802) dont le succès fut vif, des Rendez-vous bourgeois, de Cendrillon, du Billet de Loterie (1810). Il fut le rival, parfois heureux, de Boieldieu, mais malgré la réussite de Jeannot et Colin, en 1814, et de Joconde, l'Institut lui préféra l'auteur de Jean de Paris. Il mourut le 23 mars 1818 ayant presque achevé la partition d'Aladin ou la Lampe merveilleuse, que termina Benincori et qui, jouée en 1822, fut un des plus grands succès de l'Opéra (qui, en cette circonstance, inaugura l'éclairage au gaz).
Ferdinando Paer (1771-1839) fut d'abord violoniste à Parme, sa ville natale, et Circe, son premier opéra, fut représenté à Venise en 1791. Il partit pour Vienne, où il fut chef d'orchestre, et où Camilla en 1799 et Sargino en 1803 eurent de grands succès. A Dresde, l'année suivante, il donne Eleonora sur un scénario semblable à celui de Fidelio. Il s'attache à Napoléon, le suit à Varsovie puis à Paris où il est nommé chef d'orchestre impérial. En 1812, il est directeur du Théâtre italien, et doit céder en 1823 la place à Rossini. Nommé en 1832 directeur de la musique de la chambre royale, il est élu à l'Institut. On l'aurait aujourd'hui bien oublié s'il n'avait donné, en 1821, le Maître de chapelle à l'Opéra-Comique ; le spirituel livret de Sophie Gay, l'air du maître de chapelle et le duo que celui-ci chante avec sa servante ont sauvé cet ouvrage qui, réduit à un acte sur les deux qu'il comportait à l'origine, demeura longtemps comme lever de rideau et mériterait d'être repris.
Belge comme Grétry, Gossec (1734-1829) fut présenté à La Pouplinière par Rameau, puis devint maître de chapelle du prince de Conti. Ses pièces de musique de chambre l'ont fait parfois comparer à Stamitz. Pour le théâtre, il écrivit le Tonnelier (1761) que suivit une vingtaine d'opéras, dont quelques-uns sont des pièces de circonstance (la Reprise de Toulon, 1796) ; parmi ses partitions dramatiques, on distingue Toinon et Toinette (1767), Rosine (1786), Sabinus (1774), Alexis et Daphné, la Fête du Village (1778), les Visitandines ; mais ce sont surtout ses chants patriotiques qui lui valurent de survivre. Musicien quasi officiel de la Révolution, il écrivit le Chant du 14 juillet, l'Hymne à l'Être suprême, les Hymnes à la Liberté, à l'Humanité, à l'Égalité, le Serment républicain, etc., où il sut mettre de la flamme. Étienne-Nicolas Méhul (1763-1817) reste l'auteur du Chant du Départ, où il y a quelque chose de plus que dans les hymnes de Gossec, et qui tient autant à la valeur du musicien qu'à sa foi patriotique. Cette valeur se retrouve dans les ouvrages dramatiques de Méhul, aussi bien dans le genre léger (l’Irato, 1801, qui est un chef-d’œuvre de vivacité) que dans l'opera seria, avec Joseph. Cet ouvrage remporta le prix institué par Napoléon en 1807, bien qu'il offrît la particularité de ne comporter aucun rôle de femme, et il fit le tour de l'Europe. De nombreuses reprises l'ont maintenu au répertoire de l'Opéra. Malgré le livret languissant de Duval, sa popularité est justifiée par la vérité dramatique d'une musique simple. Dès 1797, Méhul avait obtenu avec le Jeune Henri un succès singulier. L'ouverture souleva un tel enthousiasme que l'orchestre dut la jouer trois fois. Mais les patriotes de l'an V s'indignèrent lorsqu'ils virent paraître sur la scène un jeune roi qui n'était pas représenté comme un tyran, et les sifflets interrompirent la représentation. Bientôt cependant l'ouvrage devint un des plus célèbres du répertoire.
Compositeur fécond, Le Sueur (1760-1837) doit d'avoir survécu bien plus à ce qu'il fut le maître clairvoyant de Berlioz qu'à sa production dramatique. Il eut à lutter contre la mauvaise fortune et la coalition des médiocres, vit son Télémaque refusé en 1787 par l'Opéra, et se retira pendant quatre ans à la campagne. Il en revint avec deux partitions, la Caverne et Paul et Virginie qui furent jouées à la salle Favart ; mais Ossian ou les Bardes dut céder la place à la Sémiramis de Catel (1773-1830), l'auteur du Traité d'harmonie, et que ses œuvres de circonstance pour les fêtes nationales avaient rendu célèbre.
Né à Florence en 1760, élève de Sarti à Bologne, Cherubini était venu en France après avoir déjà acquis une réputation justifiée par le mérite de ses compositions religieuses et scéniques (Quinto Fabio, 1780 ; Armida, 1782 ; Adriano in Sira ; la Sposa di tre) ; après un séjour à Londres où il donna la Finta Principessa en 1785 et Giulio Sabino l'année suivante, il se fixa à Paris en 1788. Sa Lodoïska à la salle Feydeau en 1791, suivie d'Elisa, de Médée, de l'Hôtellerie portugaise, la Punition, Emma, les Deux Journées, Épicure, Anacréon, tous ouvrages donnés à la foire Saint-Germain sauf Demophon qui fut créé à l'Opéra, ne purent lui concilier les faveurs de Bonaparte dont il avait critiqué vertement le goût musical, et l'Opéra lui demeura fermé. Il se rendit à Vienne en 1805 et y fit représenter Faniska qui lui valut l'admiration de Beethoven et de Haydn. A l'arrivée des Français, il fut engagé comme chef d'orchestre des concerts de Schönbrunn ; il ne sut pas en profiter pour rentrer en grâce auprès de Napoléon. De retour à Paris, découragé, Cherubini abandonna presque complètement la composition et se retira chez le prince de Chimay. On lui commanda une messe pour l'inauguration de l'église : ce fut l'admirable Messe en fa. Cependant il ne renonça point complètement au théâtre, fit jouer Pimmalione en 1809, Crescendo en 1810, et donna les Abencérages à l'Opéra qui tombèrent à plat en 1813, dès la première. Il fut nommé en 1816 professeur de composition et surintendant de la musique du roi, puis, en 1821, lorsque le Conservatoire fut rétabli, il en fut le directeur, fonctions qu'il résigna un an avant sa mort (1842). L'ouverture d'Anacréon est restée au répertoire des concerts symphoniques ; Weber admirait le Porteur d'eau et même le considérait comme un chef-d’œuvre. Il est certain que Cherubini, malgré quelque froideur, est un remarquable musicien. Il eut le tort de demeurer fermé aux idées nouvelles et de regarder Beethoven comme « l'Antéchrist de l'Art » — du moins Berlioz l'assure. Mais aussi il refusa d'admettre Liszt au Conservatoire...
François-Adrien Boieldieu, né à Rouen en 1775, fit d'heureux débuts à dix-huit ans dans la capitale normande avec deux petits ouvrages la Fille coupable, et Rosalie et Mirza. Il vint à Paris, eut la chance de faire chanter quelques mélodies par Garat, ce qui lui permit de trouver un public prêt à l'applaudir au théâtre. En 1795, l'Opéra-Comique montait la Dot de Suzette, et deux ans plus tard la Famille suisse qui y furent bien accueillis. En 1800, le Calife de Bagdad, puis, en 1803, Ma Tante Aurore lui valurent la célébrité. Il avait épousé la danseuse Clotilde Mafleuroy qui le rendit fort malheureux ; il accepta pour s'éloigner la place de compositeur de la cour de Russie, et, pendant sept années, il resta à Pétersbourg. A son retour à Paris, en 1812, l'Opéra-Comique monta Jean de Paris qui fut un triomphe ainsi que le Nouveau Seigneur du village, créé l'année suivante, et le Petit Chaperon rouge en 1818. Le 10 décembre 1825 la Dame blanche obtenait un succès prodigieux qui se renouvela à chaque reprise, et qui, sur le moment, valut au compositeur les chaudes félicitations de Rossini, en attendant que la partition fît le tour de l'Europe et procurât à Boieldieu l'honneur (posthume) de voisiner en effigie avec Mozart au foyer de l'Opéra de Vienne.

costumes pour Pharamond, opéra de Boieldieu (1825)
Le livret de Scribe s'inspirait du Monastère et de Guy Mannering de Walter Scott. George Brown, jeune officier, arrive au manoir des comtes d'Avenel, en Écosse, et il ignore qu'il est le dernier rejeton de cette famille. L'intendant Gaveston a tenté de détourner à son profit les biens dont il est le gardien. Mais la Dame blanche veille : elle apparaît dans la nuit, et, avec son aide, George Brown déjoue les intrigues de Gaveston. On va vendre aux enchères le domaine. Les fermiers se sont concertés pour enchérir. Ils vont renoncer lorsque George intervient, pousse follement, et fait si bien que Gaveston abandonne. Mais George ne possède pas un sou vaillant. N'importe ! La Dame blanche (qui n'est autre qu'Anna, une jeune orpheline jadis recueillie par le comte d'Avenel) lui révèle qu'elle a reçu la garde d'un coffret remis par le comte et qui renferme la fortune immense de la famille. Au moment où le juge vient avertir George qu'il doit l'emprisonner s'il n'acquitte immédiatement sa dette, le beau lieutenant est déjà en possession du trésor — et d'une fiancée. Car tout finit, bien entendu, par le mariage du charmant militaire et de la jolie Dame blanche.
Il y a dans cette partition quelque chose de naïf et de spirituel, de léger et de frais, de gracieux et de tendre, qui lui donne un indéfinissable charme. Elle a beaucoup vieilli, mais elle conserve pourtant une jeunesse délicieuse. Elle est conventionnelle peut-être, mais est-ce la faute de Boieldieu si les orgues de Barbarie et les boîtes à musique ont moulu « Prenez garde ! la Dame blanche vous regarde ! » et « Ah ! quel plaisir d'être soldat ! » Le succès a sa rançon. Et il reste que la Dame blanche marque une date dans l'histoire de l'art lyrique, non seulement parce qu'elle est un des premiers ouvrages de ce que l'on pourrait appeler le cycle écossais, inspiré de Walter Scott, parce qu'elle met en scène un de ces fantômes dont les romantiques vont user et abuser, mais bien par la qualité de la musique dont Boieldieu a paré les inventions de Scribe, et parce que la scène de la vente aux enchères est un chef-d’œuvre de vie et de mouvement.
Après la Dame blanche, Boieldieu se retira et n'écrivit plus que les Deux Nuits, en 1829. L'ouvrage n'eut qu'un succès d'estime : on ne refait pas deux fois la Dame blanche... Mais il serait injuste de ne point reconnaître aux Voitures versées, ramenées de Pétersbourg par Boieldieu, un mérite sinon égal, du moins comparable à celui de la Dame blanche : ne serait-ce que pour l'air : « Apollon toujours préside au choix de mes voyageurs », que pour le duo « O dolce concento ! » et pour les variations sur « Au clair de la Lune », ce petit ouvrage en deux actes mérite de survivre.
II
Paris, à cette époque, s'ouvre largement aux musiciens étrangers, et particulièrement aux Italiens. La Vestale de Spontini (1774-1851) triomphe avec éclat à l'Opéra le 11 décembre 1807, et l'auteur, naturalisé Français, marié à Mlle Érard, va diriger le Théâtre italien où il révélera Don Giovanni et Cosi fan tutte aux Parisiens. Louis XVIII le nommera compositeur de la cour, où il restera jusqu'à ce que Guillaume III, roi de Prusse, le mande à Berlin.

décor de Schinkel pour le IIIe acte de la Vestale de Spontini (reprise à Berlin, vers 1845)
Élève de Piccini, il avait conquis la célébrité en Italie avec I Puntigli delle donne dès 1796, à l'Argentina de Rome, avec la Finta filosofa, à Naples, mais à Paris, en 1804, Julie fut sifflée, et la Petite Maison n'eut pas plus de succès. Il allait trouver sa revanche avec la Vestale à l'Opéra de la rue de la Loi, aujourd'hui rue Richelieu, en présence de l'impératrice Joséphine. Le succès tint bien moins à la solennité de la représentation qu'au caractère nouveau de l'ouvrage. Le livret de Jouy était destiné à Boieldieu qui le refusa. Cherubini n'en voulut pas davantage. Entre temps, grâce à sa cantate sur Austerlitz qui avait conquis la faveur de Napoléon, Spontini était nommé compositeur de l'Impératrice. Le comité de l'Opéra exigea des corrections pour la Vestale, malgré la protection de Joséphine. La magistrale interprétation de Mme Branchu, de Lainez et Dérivis contribua grandement au triomphe du musicien.

Théâtre de l'Opéra de la Porte Saint-Martin (1781-1794) [gravure d'après Lallemand]

Théâtre de l'Opéra de la rue de Richelieu à Paris (1794-1820) [vue d'optique de l'époque]
On a vu dans cet ouvrage le point de départ du romantisme musical français. C'est beaucoup dire, et il semble bien plutôt que le style de Spontini reflète les préoccupations du moment : tout le monde alors a le sentiment que la peinture, l'architecture, les arts plastiques sont en accord avec la grandeur du régime, mais que la musique demeure en arrière et n'a rien produit depuis la Révolution qui marque un changement correspondant à l'évolution des autres arts. Les auditeurs de la Vestale sont secoués par les accents passionnés, par l'enthousiasme dont la partition déborde. Les plus savants, ceux qui sont capables d'analyser cette musique, discernent aisément que la partition observe un plan d'une netteté quasi géométrique. Ils y retrouvent le souci d'ordre, la discipline à laquelle se soumettent les artistes contemporains. Et c'est vrai : Spontini réalise la double aspiration de son époque. Il sait traduire la passion avec véhémence (et en cela il y a déjà en lui du romantisme, comme chez tous les meilleurs de ce moment) ; mais il se tient dans une forme qui demeure rigoureuse, et en cela il se montre classique. Il possède en outre, mieux qu'aucun autre alors, le sens du théâtre. Il ne craint point les contrastes ; il renforce l'orchestre ; il y introduit même la grosse caisse, et ce qui est mieux, il écrit aussi bien pour les voix (il est Italien) que pour les instruments, dont il sait utiliser à merveille les registres et les timbres, sans rien exiger qui force leurs moyens, et parvient assez simplement à des effets qu'un autre moins adroit n'aurait pas obtenus.
Il apparaît comme un précurseur, et Berlioz ne s'y trompe point : l'orchestre de Spontini, en dépit d'une harmonisation trop souvent creuse, « sonne » comme nul n'avait sonné avant le sien, et déjà presque comme sonnera celui de Meyerbeer.
Moins heureux avec Fernand Cortez (aussi sur un livret de Jouy), accueilli cependant avec faveur le 28 novembre 1809, Spontini bénéficiait encore de la même interprétation ; mais l'ouvrage ne se maintint pas, tandis que la Vestale demeura plus de trente ans au répertoire. Fernand Cortez engageait l'Opéra dans la voie des grandes fresques historiques, animées d'une figuration considérable et permettant aux décorateurs de larges compositions. La Restauration fit perdre à Spontini ses charges et ses honneurs : il se remit à écrire pour le théâtre, fit jouer Pélage, les Dieux rivaux, Olympie, puis en 1824 Nurmahal, d'après Lallah-Rook, de Moore. A Berlin, il donna Alcidor, en 1825 et Agnès de Hohenstaufen, en 1829. Devenu irritable, voyant pâlir son étoile, il se retira en Italie et alla mourir dans son village natal de Majolati le 14 janvier 1851.
Il faut au moins faire mention de Carafa de Colobrano, de la maison princière napolitaine des Carafa (1787-1872), qui débuta en Italie avec Il Fantasma et Il Vascello d'occidente (1814) et, venu en France, fit représenter à l'Opéra-Comique en 1821 une Jeanne d'Arc, suivie, à Feydeau, du Solitaire sur un livret de Planard. Le succès de cet opéra-comique fut énorme, comme celui de Masaniello (Opéra-Comique, 27 décembre 1827) ; mais la Muette de Portici d'Auber, sur le même sujet, en empêcha la reprise. Il laissa trente opéras, se prévalut de ce nombre en posant sa candidature à la succession de Le Sueur à l'Académie des Beaux-Arts. La Revue musicale eut communication de cette lettre imprudente et la publia, suivie de cette simple remarque : « C'est bien ce qui nous inquiète ! »
Carafa n'apportait rien de nouveau. La malchance de Masaniello qui dut céder la place à la Muette se répéta pour le Nozze di Lammermoor (Théâtre italien, 1829) : six ans plus tard, Donizetti faisait représenter Lucia. Ce ne sont point là simples coïncidences. Ces rencontres attestent le même besoin chez les contemporains d'élargir les sources d'inspiration, de ne plus se contenter des sujets mythologiques ou légendaires où avaient puisé les musiciens des deux siècles précédents, mais d'emprunter aux poètes et aux romanciers de leur temps les thèmes qu'ils vont traiter.
Époque de transition, où se devine l'aube des temps nouveaux qui vont être le romantisme. Le mouvement est déjà né en Allemagne, alors qu'on le pressent à peine en France. Beethoven a écrit Fidelio déjà en 1805, et Weber qui donne Abu-Hassan en 1811 va faire jouer le Freischütz en 1821.
LE ROMANTISME
L'OPÉRA INTERNATIONAL
Bien des causes déterminent l'évolution de l'art lyrique qui s'accomplit dans la première moitié, et même dans les deux premiers tiers du XIXe siècle. C'est d'abord l'importance du mouvement romantique, ce courant d'idées dont la violence se manifeste à travers l'Europe tout entière et, sous des formes diverses tenant au caractère particulier des peuples, conserve cependant chez tous des traits communs dont le plus net est un besoin d'affranchissement, de rénovation, lui-même issu de l'idéologie du XVIIIe siècle. Bientôt la plus grande facilité des échanges à travers un monde qui semble se rapetisser à mesure que les distances comptent de moins en moins, vient encore accentuer une tendance à ce que l'on a nommé d'un mot barbare l'internationalisation (qui n'est pas l'universalité, mais plutôt le cosmopolitisme) de l'art des sons : le vœu de Gluck n'est que trop entendu ; mais Gluck n'avait pas souhaité ce qui va se produire. Il voulait être compris en tous lieux parce qu'il avait pour ambition d'exprimer des sentiments assez généraux — et généreux — pour qu'ils fussent accessibles à tous. On va désormais rechercher l'audience du plus grand nombre, non sans sacrifier pour l'obtenir ce qui faisait refuser à la musique le suffrage des médiocres ; et l'on en viendra vite à flatter, au contraire, les goûts les moins nobles. De cela les premiers romantiques ne sont aucunement responsables ; mais c'est bien pourtant du romantisme que sont sortis les maux dont l'art lyrique a failli périr environ 1860 ; les maux dont il serait mort si quelques artistes n'avaient, parfois à leur insu, maintenu malgré tout ce qui devait le sauver.
On a très souvent jugé le romantisme avec sévérité, souvent même avec injustice. Aux yeux impartiaux de l'historien, le romantisme se caractérise d'abord par un besoin de retourner à la Nature. En Allemagne la première vague romantique a pris le nom à peu près intraduisible de Sturm und Drang — littéralement tempête et assaut. C'est le titre d'un ouvrage dramatique de Klinger, qui parut en 1777 (et qui n'a laissé que son titre). Mais Klinger, poète superficiel, a cependant écrit dans sa préface des choses fort sages, et notamment ceci : « Rien ne mûrit sans fermentation ». Le romantisme a mûri dans une fermentation d'idées, un bouillonnement de révoltes tel que le monde n'en avait jamais vu de plus grand : « La Nature, s'écrie Werther, forme seule le grand artiste. Un homme qui se forme d'après les règles, ne produira jamais rien d'absurde ou de mauvais, de même que celui qui s'est modelé d'après les lois ne sera jamais un coquin ; mais en revanche toute règle étouffera, quoi qu'on en dise, le vrai sentiment de la nature et son expression fidèle. » Plus de maîtres, plus de règles. Mais le romantisme reconnaît cependant ses maîtres ; il découvre Shakespeare ; Goethe célèbre le dramaturge anglais, le vénère : « Tout est nature chez les héros de Shakespeare : il a créé des hommes, comme Prométhée ! »
Le culte de Shakespeare ramène à l'époque où il vécut en l'opposant à la nôtre (à celle des premiers romantiques). D'où le goût pour la Renaissance, puis pour le Moyen Age ; et si l'on regarde vers l'antiquité, ce ne sera plus avec les mêmes yeux que les classiques. Sous la toge ou la chlamyde, on voudra entendre battre le cœur de l'homme tout pareil en ses désirs et en ses passions au cœur de l'homme contemporain.
Cependant le mot romantisme n'apparut pas tout d'abord pour désigner ce que nous appelons aujourd'hui de ce nom. A l'origine, il n'indiqua guère autre chose que la provenance historique ou la couleur particulière des sujets. En Angleterre le mouvement trouva un terrain tout préparé par le goût national pour le romanesque et par l'individualisme, si fort chez tout Anglais. Mais la Grande-Bretagne n'a point produit de musiciens romantiques, et l'on n'en parlerait pas ici, si Walter Scott, si Byron, n'avaient exercé une influence si profonde, si étendue sur les compositeurs allemands et français du même temps.
L'extension du mouvement romantique ne s'est pas opérée d'un seul coup à travers l'Europe. Il s'est en outre adapté au tempérament national, et nous distinguons sans peine le romantisme allemand de Beethoven et de Weber, du romantisme français de Berlioz. Mais le rapprochement de ces noms nous impose immédiatement cette remarque : c'est en Allemagne, avant qu'il ne se montre en France, que le romantisme apparaît dans la musique (comme d'ailleurs dans la littérature). La musique suit, avec quelque retard, comme au siècle précédent, le mouvement des idées.
Enfin, le romantisme va d'abord se manifester par le contenu des œuvres bien plus nettement que par leur forme. C'est-à-dire qu'il respectera à peu près la coupe traditionnelle des ouvrages, la syntaxe et la grammaire musicales, qu'il sera presque d'apparence classique. Mais sous ce vêtement extérieur, les idées laisseront percevoir leur violence, leur nouveauté ; elles inquièteront les champions du classicisme mainteneurs de la tradition. Nous retrouvons ici ce qui s'est passé dans le domaine littéraire, au temps où Victor Hugo s'écriait : « Guerre au Vocabulaire, et paix à la Syntaxe ! » Que voulait-il dire ? Que si l'on veut se faire comprendre il faut parler un langage compris de tous, et que si l'on veut enrichir ce langage, il est licite de recourir à des locutions oubliées ou dédaignées, à des mots considérés comme vulgaires, à condition qu'ils soient de bonne frappe. Ainsi Beethoven enrichit le langage musical ; mais dans ses premiers ouvrages, il écrit à peu près comme Haydn et comme Mozart.
Les contemporains ont été mauvais juges de ce qu'ils voyaient, de ce qu'ils entendaient, et nous comprenons mal aujourd'hui pourquoi les mêmes hommes qui applaudissaient les drames de Hugo et luttaient contre les « perruques » classiques montrèrent si peu d'empressement à soutenir Berlioz ; pourquoi leurs faveurs allèrent-elles à des musiciens de second ordre et point à des artistes de valeur certaine ; pourquoi les opéras les plus vides, la musique la plus exsangue fut, par eux, considérée comme une expression de l'art nouveau, alors que celle où nous trouvons aujourd'hui la marque la plus profonde de l'esprit romantique ne put les toucher et leur parut incompréhensible.


à gauche : le danseur Pierre Gardel (1758-1840) [gravure de Prud'hon] - à droite : le danseur Auguste Vestris (1760-1842) [dessin d'Isabey ; Musée de l'Opéra]
Un des caractères de l'opéra romantique est bien de vouloir exprimer la nature. Les ouvrages de Weber sont d'un homme qui, comme le dira le Walther von Stolzing de Wagner — a écouté la voix des forêts et ce que lui dit le murmure du vent et de la source. On a fait de tout temps de la musique imitative, et les classiques — un Couperin, un Rameau — y ont excellé. Mais il ne s'agit plus de reproduire le caquetage de la poule ou le bruit des marteaux du forgeron. On veut évoquer, suggérer plutôt que reproduire. Et c'est la symphonie qui va entrer dans l'opéra avec Beethoven et Weber. La couleur locale et la couleur temporelle seront de même soigneusement imprimées à l'ouvrage, et par les mêmes moyens de suggestion. Enfin le musicien romantique ne reculera plus devant la crainte de faire monter sur une scène jusqu'alors réservée aux héros à panache, les personnages les plus humbles. Beethoven opposera la jovialité du geôlier Rocco à l'angoisse de Léonore, à la grandeur du noble Florestan, victime de la haine de Pizzaro. L'art secoue les chaînes par lesquelles le classicisme le retenait dans des formules devenues trop étroites et qui lui faisaient courir le danger de périr en se desséchant. Il donne la primauté au sentiment. Il assigne pour objet à la musique, selon le mot de Beethoven, de venir du cœur pour aller au cœur. Mais cela n'ira pas toujours sans excès : il y aura de bons et de mauvais romantiques. On s'étonne, à distance, que ce soient parfois les pires qui aient séduit davantage leurs contemporains, et l'on voudrait être sûr que la postérité a remis en leur place légitime les hommes et les œuvres. Nos arrière-grands-parents se pâmaient en écoutant des opéras où leurs neveux n'ont plus trouvé qu'ennui — en attendant que les générations suivantes y redécouvrent du charme. Ce qui importe, c'est ce qu'il y a d'original dans chaque œuvre, ce qui n'y fut pas introduit pour satisfaire la mode d'un moment et gagner l'applaudissement de la foule. Certains procès sont périodiquement révisés, et l'on voit les valeurs spirituelles osciller de temps en temps comme les valeurs d'argent qui s'inscrivent à la cote de la Bourse. Assez de temps s'est écoulé pour que nous discernions aujourd'hui, sans parti pris, ce que le romantisme nous a légué qui fut vraiment un enrichissement.

la Camargo dans le pas de la Nuit [gravure anonyme]
I
Il y a certes déjà du romantisme dans Mozart : il a tout compris, ou tout pressenti, et il a tout exprimé de ce que la musique peut traduire, et jusqu'au plus secret de l'âme féminine. Il est sûr aussi que le sentiment de la nature n'est point absent de son œuvre. Mais on n'aurait pas de peine à montrer que Rameau peut être lui aussi regardé comme un précurseur du Beethoven de la Pastorale et du Berlioz de la Fantastique : la tempête du Turc généreux, l'orage de l'entrée des Fleurs, l'éruption volcanique de l'entrée des Incas dans les Indes galantes sont traités musicalement comme le feront les romantiques, avec le même souci de refléter l'homme et ses passions dans la description de la nature.
Beethoven ne nous a laissé qu'un opéra : Fidelio ; mais ce n'est pas le seul de ses ouvrages destiné à la scène. Outre le ballet de Prométhée, il a écrit l'ouverture de Coriolan, la musique pour Egmont, les Ruines d'Athènes et le Roi Etienne. Si le livret de Fidelio, quand on le lit froidement, en essayant d'oublier la partition, peut sembler une parodie du drame romantique tel que le conçurent Dumas père et Hugo, si l'invraisemblance du personnage de Léonore, déguisée en jeune garçon, et que sa voix trahit si peu que Marcelline, bien qu'elle vive sous le même toit, s'en éprend et la veut pour époux ; si tout cela nous choque ou nous apprête à rire, on comprend néanmoins ce qui put séduire Beethoven dans le mélodrame de Bouilly. Gaveaux l'avait déjà mis en musique et il fut représenté à Vienne après avoir été créé à l'Opéra-Comique. Beethoven n'en a retenu que les intentions nobles, sans en apercevoir la gaucherie assez ridicule. Le dévouement de Léonore pour Florestan, son mari prisonnier c'est l'amour tel qu'il le rêve, l'amour qui garde jusque dans la passion un caractère religieux. Le cadre même du drame : une prison, semble un symbole. Beethoven est lui aussi prisonnier, mais d'une incurable surdité qui le sépare des autres hommes tout autant qu'un mur épais et des barreaux.
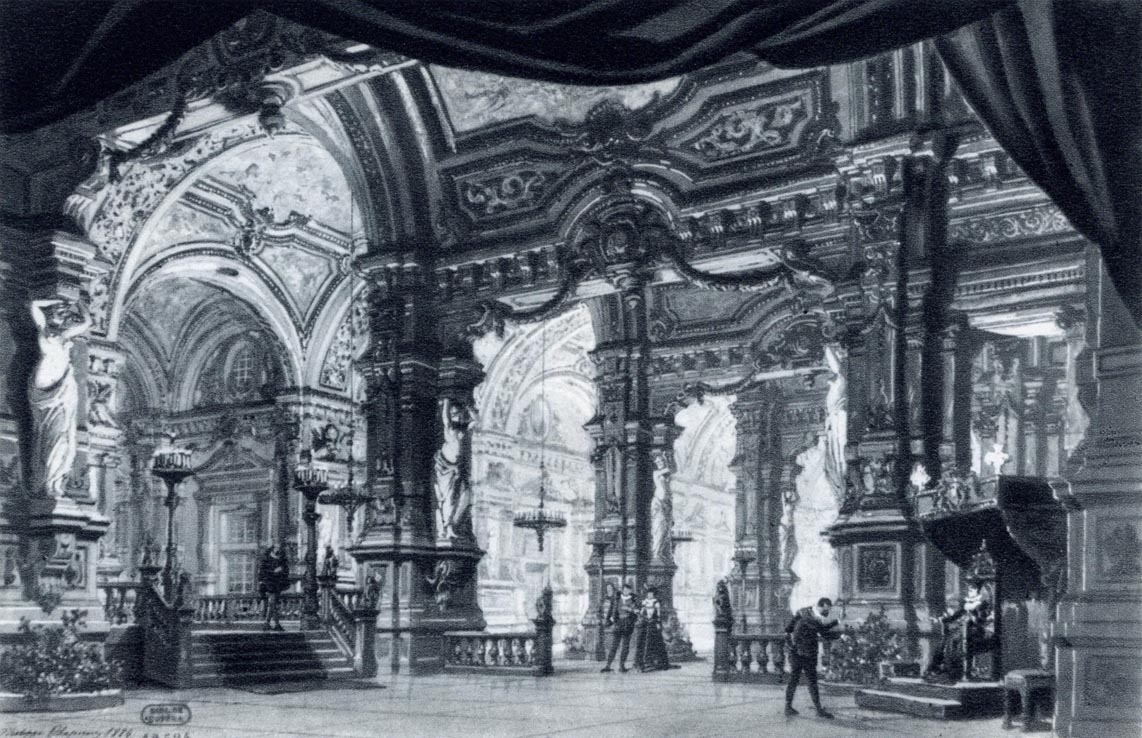
décor de Chaperon pour le IIIe acte d'Egmont de Beethoven (reprise à Paris, 1884)
Fidelio fut représenté pour la première fois le 20 novembre 1805 à Vienne. Les Français étaient entrés le 15 dans la capitale après les combats de Dirstein et de Mariazell. Tout était défavorable au succès de l'ouvrage ; il n'eut que trois représentations et fut repris l'année suivante, au printemps, mais réduit à deux actes au lieu de trois — et c'est à cette occasion que Beethoven écrivit l'ouverture connue sous le nom de Léonore n° 3, que l'on a l'habitude de jouer maintenant entre le tableau de la cour de la prison et la scène du cachot. Remanié encore en 1814, Fidelio fut enfin jugé selon son vrai mérite.
Beethoven s'y montre — on l'a déjà dit — respectueux des formes traditionnelles, et c'est la qualité expressive de la musique qui en fait le romantisme. L'air, le « grand air » est bâti selon les règles classiques : une introduction de mouvement modéré ou allegro, qui est une sorte de récitatif ; un mouvement lent ; enfin une strette rapide, agitato. Ce plan est logique : il correspond aux sentiments que le personnage exprime dans ce monologue, cette sorte d'examen de conscience qu'est l'aria : le personnage résume d'abord en lui-même l'objet du débat ; il médite ensuite sur ce qu'il va décider, puis il s'enflamme pour passer à l'action. Les deux airs fameux de Fidelio, celui de Léonore et celui de Florestan sont construits sur ce plan. Ce n'est point dans la flamme mise par Beethoven en ces airs que se révèle son tempérament romantique. Ici, c'est la passion qu'il traduit ; mais dans le chœur des prisonniers au second tableau, c'est un élément pittoresque, tout chargé d'émotion d'ailleurs, que l'on trouve. Fidelio apparaît tout entier comme un hymne à la liberté autant qu'un hymne à l'amour. Florestan est un martyr de la liberté ; il a été jeté dans un cachot parce qu'il a lutté contre la tyrannie de Pizzaro. Et le dévouement de Léonore — si l'amour conjugal en est le principal ressort — est bien aussi un combat pour la délivrance des opprimés. Au deuxième tableau, lorsqu'elle convainc Rocco d'accorder aux détenus politiques de venir un instant respirer librement au jour et de contempler la radieuse lumière de l'été, elle poursuit en même temps que son but particulier — approcher Florestan et lui rendre courage — un dessein généreusement altruiste. Avant qu'elle ne pénètre près de son époux, celui-ci l'appelle dans son rêve et la salue de ce nom : « Un ange de la Liberté ! » Et lorsque don Fernando vient délivrer les victimes de Pizzaro et que celles-ci s'agenouillent devant leur sauveur : « Relevez-vous ! » leur dit-il. « Je ne suis ici qu'un frère parmi ses frères ! » Ce sont presque les mêmes mots que ceux du finale de la IXe Symphonie, que le vers de Schiller : « Alle Menschen werden Brüder ! » Tous les hommes deviennent frères.
Le rêve d'universelle fraternité que Beethoven n'a jamais cessé de caresser, la lumière d'une aurore longtemps espérée, éclaire son œuvre. Comment n'eût-il pas mis le meilleur de lui-même dans ce chant des prisonniers de Fidelio ? — le meilleur de son âme tourmentée, de son âme romantique ?
Dans l'accueil plus que réservé qui fut fait à Fidelio, on trouve la preuve de l'hostilité rencontrée par le romantisme musical à ses débuts, hostilité bien plus nette que celle qui se manifesta envers la littérature romantique. L'originalité de Beethoven est contestée par le critique de la Gazette générale de Musique qui écrit au lendemain de la première : « Beethoven s'est plu tant de fois à sacrifier le beau au désir de faire du neuf et de l'extraordinaire, qu'on pourrait au moins s'attendre à trouver dans son premier ouvrage dramatique une certaine originalité. Or c'est précisément ce qu'on y rencontre le moins. Sa partition ne se distingue ni par l'invention, ni par le style. Les morceaux de chant ne sont jamais bâtis sur une idée neuve. Ils n'ont la plupart du temps aucun caractère. Les chœurs sont sans aucun effet ; l'un d'eux entre autres, qui exprime la joie des prisonniers venant respirer l'air librement, est complètement manqué... »
En bref, c'est tout ce que nous admirons dans Fidelio qui choque le critique allemand. Tout ce qui donne à l'œuvre le pouvoir de durer, de soulever au bout d'un siècle et demi l'émotion des auditeurs est ce qui le laisse indifférent et lui déplaît. En France, Cherubini ne le comprit pas davantage et il fallut qu'Habeneck amenât progressivement son public de la Société des Concerts — et même les musiciens de son orchestre — à l'accepter. Car il fallait sans doute pour comprendre cette musique, en attendre tout autre chose qu'un plaisir superficiel : une émotion profonde à laquelle étaient assez mal préparés les amateurs de bel canto.
De ce point de vue, Weber se trouve mieux en accord avec les exigences de son époque. Ce qui ne veut pas dire que sa musique manque de profondeur, mais qu'elle se laisse plus aisément aborder parce qu'elle est parée de brillantes couleurs et que l'élément fantastique la rend plus accessible.
Mais avant de parler de Weber, il faut au moins citer Hoffmann, musicien et poète fantastique. Son Undine, opéra romantique, composé sur un livret de La Motte-Fouqué, fut représenté à Berlin le 3 août 1816, cinq ans avant le Freischütz et Weber en reçut une impression profonde. On crut la partition brûlée dans un incendie. Pfitzner en retrouva une copie et Undine fut rejouée à Essen et à Mayence en 1918. On y aperçut une véritable préfiguration, encore maladroite peut-être, mais déjà bien nette, du style romantique de Weber.
Dès ses débuts Weber a été attiré par le fantastique. Né en 1786, à Eutin, il est le fils d'un directeur de théâtre et mène avec lui une vie errante. Il reçoit, au hasard des séjours de la troupe, des leçons de Michel Haydn à Salzbourg, de l'abbé Vogler à Vienne, et compose chemin faisant : à quinze ans, il est déjà l'auteur de trois opéras. Vogler lui fait comprendre la nécessité des études sérieuses. Il se soumet, et son maître le fait nommer chef d'orchestre à Breslau. Il a dix-huit ans, mène une vie joyeuse, mais travaille. Son ami Rhode lui remet un livret d'opéra, Rübezahl, une légende de géant populaire, où il y a des chœurs d'esprits, de génies, de gnomes. Weber en écrit l'ouverture qui, remaniée en 1811, porte le titre de Beherrscher der Geister (le Souverain des Esprits). Cette ouverture contient déjà tout Weber en puissance ; rythmes francs, effets de théâtre — mais de bon aloi — instrumentation remarquablement colorée, et déjà aussi, en épisode médian, ce que Weber appelait plaisamment « le parc d'artillerie » parce qu'il y employait trois trombones, quatre cors et trois timbales. Et c'est déjà presque l'instrumentation de Wagner.
Il voyage encore ; en 1810, il donne Silvana à Francfort — un ouvrage achevé en prison où ses créanciers l'avaient fait enfermer. Silvana a pour titre : opéra romantique. Et c'est, sur un livret de Hiemer, l'histoire d'une fille des bois à qui un ermite a interdit de parler aux étrangers ; elle ne peut s'exprimer que par gestes, mais l'orchestre se charge de compléter la mimique : belle occasion pour le compositeur de montrer ses dons expressifs, ses dons de coloriste. L'année suivante, il les affirme plus encore à Munich dans Habu-Hassan, sur un livret du même Hiemer. C'est une turquerie en un acte, qui fait songer au poème de l'Enlèvement au Sérail, car il s'agit pour Fatime et Hassan, réduits aux expédients, d'approcher le calife, de l'enjôler, d'obtenir remise de leurs dettes, et de faire bannir Omar, le plus cupide de leurs créanciers. Hiemer avait fait une satire des embarras d'argent que Weber et lui-même avaient connus à Stuttgart. L'ouvrage qui mêle le parlé au chant, comme tous ceux de Weber (sauf Euryanthe), comptait à l'origine l'ouverture et huit numéros. Le compositeur en ajouta deux autres. L'ouverture, charmante, rompt avec l'usage des ouvertures italiennes et offre un véritable sommaire de l'œuvre. Celle-ci porte bien le caractère du romantisme, non seulement par le tour de quelques phrases qui déjà font pressentir Wagner, mais par le langage harmonique qui devance de loin son époque.
Mais c'est dans le Freischütz que s'affirme nettement le romantisme allemand. Livret et musique sont purement germaniques ; ce qui n'empêche aucunement l'ouvrage d'être compris, d'être aimé en tous lieux par ceux qui sont sensibles à la grâce de la mélodie et à la qualité de l'instrumentation.
Le sujet, déjà traité par Roser von Reiter, est tiré d'une vieille légende. C'est en deux mots, l'histoire d'un adroit tireur, Max, qui, pour obtenir le prix à un concours, et, du même coup la main de la jeune fille qu'il aime et dont il est aimé, la belle Agathe, promise par son père, le garde-chasse Kuno, au vainqueur d'un concours de tir, se laisse entraîner par son mauvais génie Kaspar à faire un pacte avec le diable, lequel lui donnera sept balles franches ; les six premières atteindront le but visé par Max ; la septième appartient au diable qui la dirige comme il veut. Le titre de l'ouvrage s'explique ainsi par les « balles franches », les balles maudites, dont l'une, celle qui appartient au diable, devait frapper la fiancée de Max. Mais elle abattra Kaspar ; car un saint ermite surviendra à temps pour déjouer la ruse diabolique de Samiel (le démon) et de son suppôt. Et tout finira par le pardon obtenu du prince, à la condition que Max attende pendant un an le bonheur qu'il espérait pour le lendemain même.
Plus encore peut-être que l'élément fantastique, la poésie d'une inspiration populaire fait le prix du Freischütz. Si le livret juxtapose plutôt qu'il ne fond en un tout ces traits divers, la musique passe au contraire des uns aux autres avec une souplesse extraordinaire. Elle est pleine de bonhomie et d'effets de terreur, de grâce primesautière dans le rôle d'Annette, de pittoresque dans les parties descriptives. Elle atteint dans l'acte de la gorge au loup, l'épisode de la chasse infernale et de la fonte des balles une sauvage grandeur. Elle a servi de modèle à cent autres ouvrages. L'apport du Freitschütz est un des plus considérables que la musique ait reçus : toute l'orchestration moderne est sortie de ce chef-d’œuvre.
Le duo d'Annette et d'Agathe est à mettre en parallèle avec celui de la comtesse et de Suzanne dans le Figaro de Mozart. L'air d'Agathe est comparable à l'air de Léonore. Et si Gluck est parvenu dans la scène de l'entrée des Enfers d'Alceste à faire passer un frisson d'angoisse parmi les auditeurs, Weber dans l'acte de la gorge au loup a utilisé avec une sûreté étonnante les moyens les plus propres à créer une atmosphère de terreur : c'est bien plus la musique que les apparitions sinistres, c'est le choix des timbres, c'est le heurt des rythmes, c'est l'invention mélodique qui l'imposent à l'esprit. Il existe entre les deux ouvrages l'écart que l'on trouve entre une scène de violence et de passion dans la tragédie classique et un épisode de même nature dans un drame de Shakespeare.
Weber ne fit qu'esquisser un opéra-comique, les Trois Pintos, qui aurait été le pendant d'Abu-Hassan. On en déplore la perte : c'eût sans doute été une de ses œuvres les plus personnelles. Euryanthe qui vient ensuite, fut, comme l'a dit William Saunders, « la plus parfaite réussite de l'opéra romantique et le plus grand échec de l'opéra en général. » L'absurdité et la complication du livret, dû à Helmina de Chezy, bas-bleu de Dresde, sont la cause de l'échec. Elle s'inspira d'un roman de chevalerie, l'Histoire de Gérard de Nevers et de la belle et vertueuse Euryanthe de Savoie. Histoire fort compliquée : Euryanthe, fiancée d'Adolar, a reçu confidence d'un secret : Emma, sœur d'Adolar, ayant perdu son fiancé Udo, s'est donné la mort en absorbant le poison contenu dans le chaton d'une bague. Son âme ne doit trouver de repos que si les larmes d'une innocente persécutée baignent cette bague maudite, et quand « la fidélité au meurtrier sera la rédemption du meurtre ». Or Euryanthe a une rivale, Églantine, qui aime Adolar. Et Adolar a lui aussi un rival, Lysiart, qui gage de prouver à Adolar qu'Euryanthe ne lui est point fidèle. Voici donc un drame à deux traîtres ; mais on ne devine tout cela que dans le cours de la pièce, d'où la ténébreuse obscurité de l'intrigue. Euryanthe a fait part du secret d'Adolar à Églantine, sa perfide amie, qui lui a même dérobé l'anneau. Apprenant qu'Euryanthe a trahi son serment, Adolar, sous l'empire de la colère, emmène celle-ci dans une forêt et s'apprête à l'immoler lorsqu'un serpent monstrueux menace le jeune homme. Euryanthe lui fait un rempart de son corps. Il tue le monstre et s'enfuit, renonçant à son crime, mais abandonnant Euryanthe. La chasse du roi la retrouve inanimée et le roi porte la nouvelle à Adolar. Il rejoint celui-ci à l'instant où il se bat avec Lysiart. Le roi sépare les adversaires, fait arrêter Lysiart, qui a le temps de tuer Églantine. Des chasseurs ramènent Euryanthe, et Adolar tombe à ses pieds.
Le fantastique de ce sujet séduisit Weber : il y retrouvait ce qui lui avait si bien réussi dans le Freischütz. Il fit ajouter au livret ce qu'il offre de plus invraisemblable : l'histoire d'Emma et d'Udo ; elle lui permettait de faire apparaître (ou tout au moins d'évoquer, car l'apparition n'est heureusement pas toujours réalisée au théâtre) le fantôme d'Emma suppliante. Dans l'ouverture d'Euryanthe, célèbre entre toutes, le passage largo qui est repris au deuxième acte, est d'un caractère profondément dramatique le rendant propre à accompagner la vision du fantôme sortant de la tombe. L'ouverture est une page éclatante, d'une réussite merveilleuse : elle emprunte à la partition deux airs d'Adolar, le premier chevaleresque, vigoureux, le second plein de tendresse ; puis vient le largo évoquant le fantôme d'Emma ; le brillant finale ramène les motifs du début. Euryanthe marque une date peut-être plus importante encore que celle de la création du Freischütz. Son influence sur Wagner est manifeste. Schumann a dit que « Euryanthe fut le sang du cœur de Weber et lui a certainement coûté quelques années de sa vie. Mais c'est par cet ouvrage qu'il atteignit l'immortalité ». Il fut créé à Vienne le 25 octobre 1823.
Weber avait reçu de Londres la commande d'Obéron pour le Covent Garden. Il se rendit en Angleterre, fort malade déjà, malgré une cure à Marienbad qui ne lui donna qu'un répit. Il travailla avec ardeur et Obéron fut joué pour la première fois le 12 avril 1826. Weber allait mourir le 5 juin. Mais il avait pu assister au triomphe de l'œuvre nouvelle. Le scénario est un mélange de féerie et de drame fait d'emprunts au Songe d'une Nuit d'été, au vieux roman français Huon de Bordeaux, et surtout à l'Obéron de Wieland. Brouillé avec Titania, son épouse, Oberon a juré de ne la revoir que si la fidélité de deux amants rachète les parjures des inconstants. Huon de Bordeaux, Huon le Preux, et Rézia fille du sultan de Bagdad seront ces amants fidèles. Mais ils traverseront toutes sortes d'épreuves avant d'être unis. Un cor magique, donné au chevalier par Obéron, l'aidera à en triompher, et Huon devra libérer Rézia que des pirates ont enlevée. Weber aurait souhaité de faire un opéra véritable ; les exigences du théâtre anglais tel qu'il subsistait encore au début du XIXe siècle l'en empêchèrent. Il a pourtant réussi à donner à sa partition une extraordinaire couleur. Elle reste un chef-d’œuvre splendide, que l'extravagance du livret a cependant condamnée à n'être que trop rarement exécutée.

décor de Cambon pour Obéron de Weber (reprise à Paris, 1857)
On entend du moins fort souvent au concert l'ouverture et l'air de Rézia. L'ouverture est une page symphonique merveilleuse qui résume l'ouvrage. Elle débute par les trois notes mystérieuses du cor magique : trois notes ascendantes, qui suffisent à créer une atmosphère de féerie, et qui reviendront à plusieurs reprises dans le drame, constituant un véritable leitmotiv. Les danses et les chœurs qui souvent les accompagnent tiennent une place importante dans Obéron. Souvent c'est aux voix que Weber confie le soin d'exprimer les forces de la nature : la barcarolle des Ondines est d'une intense poésie. Jean Chantavoine a pu très justement dire d'Obéron qu'au point de vue historique, c'était moins une œuvre qu'un legs, c'est-à-dire un trésor dont le possesseur ou l'inventeur a tiré moins d'avantages que ne feront ses héritiers, au nombre desquels seront entre autres Wagner et Bizet (*).
(*) Jean CHANTAVOINE, Petit Guide de l'auditeur de musique : Cent opéras célèbres (Paris, éditions « le Bon Plaisir », Plon, 1948, p. 164).
Le Faust que Ludwig Spohr (1784-1859) fit représenter à Francfort en 1881, obtint un succès éclatant et fut considéré comme le chef-d’œuvre de l'opéra allemand. Jessonda (d'après la Veuve du Malabar, Cassel, 1823), fut un autre triomphe. Violoniste d'un rare talent, Spohr joua en Italie avec Paganini. Auteur fécond de symphonies et de musique de chambre, il a laissé une dizaine d'opéras dont l'un, Zemir und Azor, donné à Francfort en 1819, fut mis au même rang que son Faust. Weber lui a reproché d'écrire pour les voix en virtuose du violon. Sa sensibilité quasi féminine, son romantisme débordant se sont donné libre cours dans Faust, qui fut d'abord un oratorio, et reste aujourd'hui bien oublié. Il en est de même des opéras d'Heinrich Marschner (1795-1861), protégé de Weber qui fit jouer à Dresde en 1820 Heinrich IV und Aubigné. Devenu chef d'orchestre du théâtre de Leipzig, Marschner y donna Der Vampyr en 1828 et Der Templier und die Jüdin l'année suivante. Sa musique est elle aussi fort colorée, mais d'un romantisme tout extérieur. Parmi ses autres ouvrages (il écrivit une quinzaine d'œuvres lyriques), Hans Heiling conserve un intérêt historique parce que la critique allemande l'a rapproché du Vaisseau fantôme. Il est sûr que l'orchestration de Marschner est brillante ; mais il n'y a chez lui ni la qualité ni l'originalité de Weber ; et les drames lyriques de Wagner ont fait oublier sans trop d'injustice ceux de Marschner.
Il n'y a pas grand'chose à retenir non plus de Konradin Kreutzer (1780-1849) et de sa trentaine d'opéras, bien que sa Nuit à Grenade (das Nachtlager von Grenada), représentée à Vienne en 1834, ne manque point d'agrément — ni de Gustav-Albert Lortzing (1803-1851) dont les œuvres reflètent des influences italiennes et françaises. Musicien-né, comédien, écrivain, il eut de la facilité et s'en contenta sans doute trop aisément. Son Zar und Zimmermann (Tsar et charpentier), malgré un échec à Leipzig en 1837, fut un triomphe à Berlin.
C'est par son style léger et gracieux que survit Friedrich von Flotow (1812-1883) qui connut le succès en 1839 avec le Naufrage de la Méduse créé à Paris à la Renaissance. Ses meilleurs ouvrages sont Stradella (Hambourg, 1844) et surtout Martha (Vienne, 1847). La mélodie irlandaise The last rose of summer, sur le poème de Thomas Moore, introduite par Flotow dans cet ouvrage, contribua grandement à sa réussite. L'Ombre (Sein Schatten) créée à l'Opéra-Comique le 7 juillet 1870, porte à la scène un épisode de la guerre des Cévennes sous Louis XIV ; l'ouvrage retrouva le succès de Martha.
Mort jeune, Otto Nicolaï (1820-1849) survit grâce à son opéra Die lustigen Weiber von Windsor, créé à Vienne deux mois avant sa mort ; la franche gaieté de l'ouvrage est encore appréciée, tandis que ses autres productions sont tombées dans l'oubli. Bien que Franz Schubert ait composé quelques ouvrages dramatiques, singspiele, farces, opéras, ballets, cette production scénique n'ajoute pas grand'chose à la gloire du musicien des lieder. Beaucoup de ces partitions ont été perdues ; de certaines autres, il ne nous est parvenu que des fragments. Restent Rosamunde dont le ballet est demeuré au répertoire des concerts ; Fierrabras (1823), Alfonso und Estrella qui dut attendre trente ans que Liszt le représentât à Weimar en 1854 et Die Verschworener (les Conspirateurs) ; elles montrent que s'il avait vécu, Schubert aurait pu apporter au théâtre des qualités qui lui eussent valu d'y réussir.
A Robert Schumann, on ne doit qu'un seul opéra, Genoveva, qui n'obtint à Leipzig, en 1850, qu'un fort maigre succès. L'œuvre est intéressante bien qu'assez peu scénique, et sa parenté étroite avec le sujet de Lohengrin en accuse les faiblesses ; celles-ci viennent en gâter les beautés dignes du musicien de Faust et de Manfred ; Genoveva montre ce que Schumann aurait pu faire au théâtre si la maladie ne l'avait condamné au silence pendant les dernières années de sa vie, avant de l'emporter à quarante-six ans. Il en est de même de Mendelssohn, mort plus jeune encore en 1847. Il n'a laissé qu'un opéra, Die Hochzeit des Gamacho, qui reçut bon accueil à Berlin en 1827. Cet ouvrage ne compte guère dans la production de l'auteur ; mais sa musique de scène pour le Songe d'une Nuit d'été, ses grands oratorios (Paulus, Elias), sont d'un maître incontesté.
Il est difficile de parler équitablement de Meyerbeer (1791-1864), et on le voit bien aux jugements extrêmes qui ont été portés sur son œuvre : il a connu des triomphes éclatants, et ce fut sa gloire naissante qui fit rentrer dans le silence le prudent Rossini. Ses contemporains l'ont regardé comme le dieu de l'art lyrique, et, longtemps après sa mort, il a continué de rayonner sur l'Opéra. Mais, dès sa jeunesse, son ancien condisciple Weber, élève comme lui de l'abbé Vogler, lui reprochait d'avoir trahi la patrie allemande pour se faire Italien ; et Schumann, un peu plus tard, l'accusait avec plus de force encore de s'être fait Français. Au vrai, il ne fut ni Italien, ni Français, ni même Allemand ; admirablement doué, il a donné l'illusion d'une forte personnalité et ne posséda que le don d'être tour à tour ce qu'il lui plaisait de paraître afin de mieux séduire ses contemporains. Il a été cosmopolite et, à ce titre, l'un des meilleurs artisans de l'opéra international, fait pour soulever l'applaudissement à Paris comme à Rome, à Vienne comme à Londres ou à New York. Ses œuvres ne manquent point de force ; mais trop souvent aussi la boursouflure y tient lieu de puissance ; ses dons mélodiques sont réels, mais il ne redoute point la fadeur ; il harmonise en homme pour qui la science musicale n'a point de secrets, mais il laisse des platitudes dans ses accompagnements, et il ne redoute ni les effets faciles et attendus, ni la vulgarité. Comment définir ce Protée dont quelque défaut se révèle à l'instant même qu'on est prêt de l'admirer, ce musicien artificieux et savant qui peut-être a été victime de son habileté, et à qui il a manqué certainement d'être sévère envers lui-même et de ne pas préférer sa propre estime à l'applaudissement des foules ?
De ses premiers ouvrages écrits en Italie où il était allé sur le conseil de Salieri pour se perfectionner, il n'y a pas grand'chose à dire. Ni Il Crociato in Egitto (Venise, 1824), ni ses ouvrages antérieurs complètement oubliés, ne nous apprennent rien. Et si l'on parle du Crociato, c'est parce que le succès en fut assez vif pour décider Sosthène de La Rochefoucauld, surintendant des théâtres, à le jouer à Paris. Il y fait venir Meyerbeer, qui repart pour l'Allemagne et en revient six ans plus tard avec Robert le Diable. On sait comment Véron, directeur de l'Opéra, lui donna des interprètes de choix, comment il fut même assez habile pour obtenir du compositeur, fils de banquier, l'édification d'un orgue sur son théâtre, comment il sut faire naître le succès (qui n'était point immérité, certes), et l'exploiter ; comment, enfin, profitant de ce triomphe, il commanda aussitôt un second ouvrage à Meyerbeer en stipulant un dédit que le compositeur préféra payer plutôt que de trop hâter — et ceci est à son honneur — l'achèvement des Huguenots. Robert le Diable, 22 novembre 1831 ; les Huguenots, 26 février 1836 : deux dates mémorables dans l'histoire de l'Opéra. Une troisième, 16 avril 1849, le Prophète, et enfin mieux encore, un événement sans précédents, un ouvrage posthume (Meyerbeer était mort le 2 mai 1864), attendu, désiré, réclamé aux exécuteurs testamentaires, commenté par d'innombrables articles de presse, par toute une réclame savamment entretenue : l'Africaine, le 28 avril 1865. A ces ouvrages, faut-il encore ajouter la musique de scène pour Struensee (un drame de son frère), Das Feldlager in Schlesien (l'Étoile du Nord) composés à Berlin où Meyerbeer fut directeur de la musique de la cour de 1842 à 1848, et une paysannerie, Dinorah ou le Pardon de Ploërmel, jouée à l'Opéra-Comique le 4 avril 1859.

costumes pour Robert le Diable, opéra de Meyerbeer (1831)
Il semble que la conjonction de Scribe et de Meyerbeer ait été voulue par les dieux pour orienter l'opéra vers son destin. Le savoir-faire du musicien trouvait son égal dans l'habileté du librettiste. Aux inventions de l'écrivain dramatique, à ses coups de théâtre amenés par des « ficelles » que Berlioz jugea « grosses comme des câbles » — et aussi grosses que celles du compositeur, à ce don merveilleux d'interpréter l'histoire, d'y ajouter à chaque occasion ce que la réalité n'offrait point, à ce « métier » de bon artisan, empressé à satisfaire la clientèle, s'ajustaient admirablement qualités et défauts de Meyerbeer, son étonnante plasticité, d'abord.
Désormais, il n'est plus d'autre forme lyrique que l'opéra historique. Car c'est elle qui permet les défilés, les cortèges, les pompes nuptiales ou funèbres, les chasses, les grands ballets donnés sous prétexte de fêtes dans les résidences royales. Il faut des chevaux sur le plateau de l'Opéra qu'un critique du temps appelle « l'Opéra Franconi », Marguerite de Navarre entre à cheval dans sa bonne ville de Paris au troisième acte des Huguenots ; pour le Prophète, comme l'action se déroule en Hollande, on imagine un ballet où danseurs et danseuses évoluent sur des patins à roulettes, au grand dommage d'une musique d'ailleurs charmante, et qui, débarrassée du bruit infernal des patins, accompagne aujourd'hui une des meilleures créations des Sadler's Wells. On donne au public le spectacle d'un incendie à la fin du même ouvrage ; dans Robert des fantômes de nonnes sortent de la tombe pour danser. Tout l'effort créateur consiste bien plus à trouver ce qui est extérieur au drame et lui sert de cadre que ce qui fait pénétrer les sentiments des personnages, ce qui en explique les passions. Et cependant tout n'est point haïssable dans cette musique complaisante : le quatrième acte des Huguenots est un chef-d’œuvre que gâte à peine quelque facilité, et dans le Prophète la cavatine de Fidès sur les notes de l'accord parfait en serait un si elle ne s'achevait malencontreusement en morceau de bravoure. Musique trop souvent clinquante où l'on voudrait un peu de profondeur, musique qui trop souvent rétrécit le drame au lieu de l'élargir, de l'élever ; musique qui a fait dire à Wagner : « qu'il la réduisait au zéro absolu », et à Mendelssohn, parlant de Robert : « ce diable est un pauvre diable ! » Et pourtant... Oui, la séduction en est puissante : l'art — ou l'artifice — de Meyerbeer agit comme un aimant : il attire. Mais l'aimant était destiné à perdre très vite sa force magnétique : il a cessé de retenir le public, comme il avait cessé depuis longtemps d'attirer les musiciens.

décor de Chaperon pour le Ier acte des Huguenots, opéra de Meyerbeer (reprise, 1896)
II
Tout autre est Rossini. Non point qu'il n'ait été aussi habile, aussi prompt à saisir l'occasion et à profiter du succès que son rival allemand. Mais il y a dans la musique de ce gros homme jovial une finesse toute italienne ; mais il y a un enjouement irrésistible, un esprit pétillant dans ses airs, enlevés à la diable, et tant de mouvement qu'on prend pour de la vie, et tant de grâce savante qui paraît naturelle, et tant d'effets de théâtre qui semblent logiques, nécessaires, qu'on lui pardonnerait tout avant même qu'il ait péché. Pèche-t-il, d'ailleurs ? Lui en veut-on d'avoir été lui-même avec tant de malice qu'on la prendrait pour de la candeur si on ne le savait rusé ? Et lui, a su durer.
Certes il y a quelque déchet dans une production aussi abondante, aussi variée, et qui s'étend sur vingt années. Mais, suprême habileté, il sut s'arrêter dès qu'il sentit que le vent allait tourner, et que mieux valait demeurer l'auteur du Barbier et de Guillaume Tell qu'ajouter au catalogue de ses œuvres quelques numéros qui l'auraient alourdi sans augmenter sa gloire. Guillaume Tell n'est plus souvent joué en France et ne reparaît guère que pour les « débuts » des ténors en province. Mais le Barbier vivra tant qu'il y aura des amateurs de théâtre lyrique, et le Comte Ory mériterait bien de ressusciter.

carte-portrait signée par Rossini à l'occasion de la 500e de Guillaume Tell à l'Opéra de Paris le 16 février 1868
Inutile d'énumérer ces ouvrages qui vont de la Cambiale di Matrimonio, jouée au San Mosè de Venise en 1810, quand Rossini avait dix-huit ans, et qui probablement ne méritait pas mieux que de passer inaperçue, jusqu'à Guillaume Tell qui, le 3 août 1829, commençait à l'Opéra une carrière si durable — il suffit de mentionner Tancredi, qui contient le fameux air Di tanti palpiti cher aux cœurs de Balzac et de tous les romantiques, et que Rossini écrivit (du moins le veut la légende) sur une table d'auberge, en cinq minutes ; l'Italiana in Algieri, Elisabetta d'Inghilterra (et seulement parce que cet ouvrage est lié au souvenir d'Isabella Colbran, qu'il épousa et qui le décida — eut-elle raison ? — à écrire des opere serie) ; Il Barbiere di Siviglia, la Cenerentola, la Gazza ladra qui enthousiasma Stendhal comme la Cendrillon italienne enthousiasmait Gautier ; Mose in Egitto (dont la prière Dal tuo stellato soglio fut un article du credo musical de tous les mélomanes romantiques, bien qu'elle nous semble aujourd'hui plus conventionnelle que sincère) ; la Donna del Lago, inspirée de Walter Scott ; Maometto, Semiramis, qui survit par son ouverture ; le Siège de Corinthe, autre version de Maometto ; Il Viaggio a Reims qui se changea en Comte Ory ! La liste n'est pas complète, il s'en faut : elle suffit à montrer la fécondité de Rossini. Où sont ces opéras d'antan ? Tout n'alla pas sans quelques échecs, assurément, dans cette carrière fortunée. Mais un opera buffa succédait à un opera seria, et quand les choses n'allaient point, Rossini reprenait un chœur ici, un air ailleurs et les accommodait à des livrets nouveaux.

costumes pour la création en France du Siège de Corinthe, opéra de Rossini (1826)
On a tout dit sur le Barbier. L'ouvrage mérite pleinement sa réputation. Il a exercé sur les compositeurs français une influence qui vint renforcer celle de Spontini, et qu'allait encore appuyer Guillaume Tell. Désormais la place faite au bel canto s'élargit dans les opéras français. Meyerbeer n'y échappe point plus qu'Auber, Halévy, Hérold. Et s'il est vrai qu'Auber, avec la Muette de Portici, en 1828, avait déjà engagé l'opéra dans une voie parallèle à celle que Victor Hugo ouvrait au drame romantique avec Hernani, c'est Guillaume Tell qui, l'année suivante, l'y poussait définitivement.

affiche de la 1re représentation de Guillaume Tell à l'Opéra de Paris le 3 août 1829
D'où vient cette action décisive ? Guillaume Tell renouvelle, en l'amplifiant, ce que la Vestale de Spontini avait vingt ans plus tôt seulement indiqué. Et les résultats sont cette fois, durables. Il faut remarquer que, comme Spontini, Rossini écrit Guillaume Tell sur un livret français. Mais lui, a acquis une connaissance profonde des goûts, des aspirations, des tendances du public et des musiciens français. Il est un auteur célèbre, dont les ouvrages sont joués à Paris et en province plus souvent que ceux des Français. Mais il est encore jusque-là un musicien étranger. Et Guillaume Tell, sans que le style italien de Rossini perde aucune de ses qualités, reflète plus qu'aucun de ses autres ouvrages la volonté du musicien de se renouveler. Chose difficile, que Rossini réussit sans effort apparent, et tout en demeurant lui-même — mais point sans travail, comme le prouve la genèse laborieuse de l'œuvre. A plus d'un siècle de distance nous y discernons ce qui la rattache aux œuvres plus anciennes ; les contemporains y découvrirent bien mieux ce qui l'en séparait. Ils y aperçurent le souci de traiter musicalement un sujet historique en donnant très nettement à la partition la couleur locale exigée par le drame de Schiller. Le soin attentif de souligner par une musique nettement expressive les sentiments, les passions des personnages, de créer l'atmosphère physique et morale du drame se manifeste dès la célèbre ouverture, qui est une véritable symphonie ; cela apparaît dans les ensembles, plus encore que dans les airs (et ceux-ci sacrifient volontiers au goût du temps, car nous sommes à l'âge d'or du bel canto). Rossini fait effort pour atteindre la vérité expressive, et il y réussit en simplifiant son écriture vocale. En même temps, il donne à l'orchestre une couleur bien plus nette, et crée un décor symphonique mouvant, qui reflète les aspects de la nature, du paysage, qui, dans le premier acte est une véritable symphonie pastorale.

Adolphe Nourrit, créateur du rôle d'Arnold dans Guillaume Tell [gravure en couleur]
Lorsque l'on compare cette partition avec celles qui composaient alors le répertoire, on mesure les progrès qu'elle réalise. Et s'il est vrai que bien des pages sont faibles, que l'idylle d'Arnold et de Mathilde amoindrit l'ouvrage, nous sentons cependant qu'en maints autres endroits, Rossini a mis plus que son savoir-faire : il y a dans la scène finale, dans l'hymne saluant la liberté, une sincérité généreuse qui la rehausse.
Et c'est cela qui, dans Guillaume Tell, correspond aux aspirations de la génération romantique — cela qui n'était encore dans la Muette qu'à l'état embryonnaire, se trouve répandu dans Guillaume Tell. De là vient l'influence exercée par cet ouvrage qui, très longtemps, va demeurer au répertoire, et malgré les mutilations qu'on lui fait subir, va continuer de plaire. Après lui, Meyerbeer change de style ; et bien d'autres avec lui. Malgré sa science harmonique, malgré les hardiesses des modulations à des tons très éloignés que Meyerbeer introduit dans le duo de Valentine et de Marcel (les Huguenots), son influence s'exerce bien plus sur la forme extérieure des ouvrages ; Rossini, tout en finesses, offre un exemple plus facilement assimilable au génie français, et l'unité de style de Guillaume Tell ou du Comte Ory donne un exemple infiniment profitable, que beaucoup dédaigneront, mais qu'un petit nombre de privilégiés se hâtera de suivre.

le chanteur Duprez (1806-1896) dans Guillaume Tell
Plus fécond encore que Rossini, Gaetano Donizetti (1797-1848) dut à la France la consécration de ses succès remportés en Italie durant sa jeunesse : en cinquante ans de vie et en trente années de production, il a écrit plus de cinquante opéras. Il en reste quatre ou cinq qui ne sont pas oubliés : Lucia (1835, à Naples) ; la Favorite, la Fille du Régiment, les Martyrs, créés tous trois à Paris en 1840, et Don Pasquale, également à Paris en 1843. On se souvient encore certes de quelques titres : Anna Bolena (Milan, 1828), l'Elisir d'Amore (Milan, 1832), Linda da Chamouni (Vienne, 1842), Don Sebastien (Paris, 1843) ; mais le déchet est grand ; et l'on fera plus d'une fois la même constatation à propos de musiciens de la même époque. Ce n'est pas seulement le goût qui, en changeant, a fait paraître tant d'ouvrages vieillis et usés : c'est bien plus encore leur faiblesse.
Pourtant Donizetti avait été un enfant prodige, admirablement doué, qui avait tout appris de ce qui peut armer un compositeur d'un métier solide. Sa facilité l'a entraîné à se satisfaire à bon compte. Tous ses ouvrages se ressemblent, et l'on s'étonne aujourd'hui que Scudo, critique musical de la Revue des Deux Mondes ait pu voir dans Lucia non seulement le chef-d’œuvre de Donizetti, mais le chef-d’œuvre de tout le théâtre lyrique. D'où vient cet enthousiasme ?
Du livret d'abord, qui porte à la scène The Bride of Lammermoor de Walter Scott. En 1835, tout le monde a lu le roman écossais publié en 1819, et traduit dans toutes les langues. Le romantisme s'en exhale à chaque page. Le livret, tiré du livre par Cammarano, n'en conserve qu'un canevas sans finesse. Il eût appartenu au musicien de restituer au sujet ce que le librettiste lui avait maladroitement enlevé. Non point : Donizetti ne parvient qu'à souligner la violence du drame, l'invraisemblance des situations fournies par le découpage de Cammarano. Reste une teinte de mélancolie répandue sur les trois actes ; une teinte malheureusement uniforme. Ce qui a sauvé Lucia si longtemps de l'oubli, c'est la part faite aux voix par Donizetti, c'est la perfection (pour le chanteur) de son écriture. Il a le mérite d'avoir pour ainsi dire débarrassé, simplifié la mélodie des ornements surabondants dont Rossini lui-même la chargeait. Mais si l'on regarde, par exemple, le début du fameux sextuor (deuxième acte), si adroit, si remarquable, on voit que la phrase mélodique d'Edgar par laquelle il commence, répète à trois reprises le même dessin descendant de doubles croches, ce qu'imite aussitôt Lucia dont la réplique est calquée sur le même motif de gamme descendante, et c'est beaucoup ! Autre cause de vieillissement : la faiblesse des accompagnements, leur monotonie, l'abus des arpèges. Et pourtant il reste quelque chose de prenant dans Lucia — point l'air de la folie, bien sûr, qui n'est, au moment le plus pathétique, où l'héroïne succombe sous le poids de la trahison et perd la raison, qu'un pur exercice de virtuosité — mais dans quelques passages comme la mort d'Edgar au dernier acte.
Les mêmes défauts et les mêmes qualités, ceux-là en plus grand nombre, se retrouvent dans la Favorite. Certaines inflexions d'un tour mélancolique ont une couleur très personnelle : elles expriment l'âme même de Donizetti, en même temps que l'âme du romantisme. Le succès en fut grand et durable : l'ouvrage est un de ceux qui furent le plus souvent joués en France. Il semble aujourd'hui bien vieilli. La Fille du Régiment, qui ne paraît plus guère sur la scène, s'est pourtant mieux défendue des atteintes du temps. Le sujet, tout voisin de l'opérette, la partition allante et tendre, ont entraîné le succès. Mais c'est sans doute dans Don Pasquale que Donizetti mit le meilleur de son talent. Et c'est là, pourtant, un sujet bouffe : un vieillard amoureux berné par une jeune femme rusée, c'est presque le thème du Barbier de Séville, et il y a naturellement une charmante sérénade. Mais ces ouvrages sentent trop souvent la hâte. Le surmenage allait tuer Donizetti en lui ôtant d'abord la raison. La mélancolie qui baigne tant de ses créations était-elle un signe avant-coureur de son triste destin ?
Celui de Bellini fut plus sombre encore après avoir été plus brillant : Vincenzo Bellini mourut à trente-quatre ans. Sicilien d'origine, élève de Zingarelli à Naples, il débute en 1825 avec Adelson e Salvini sur la scène du Conservatoire. Lablache, la fameuse basse, le prend sous sa protection et crée l'année suivante, au San Carlo, Bianca e Fernando, ce qui vaut au musicien de dix-huit ans une commande de la Scala ; Il Pirata, puis la Straniera y triomphent ; mais Zaïra échoue à Parme. L'échec est compensé par le succès des Montecchi e Capuletti à Venise, et surtout par celui de la Sonnambula à Milan (1831). La même année Norma rencontre un accueil plus chaleureux encore ; en 1833 Beatrice di Tenda ne réussit qu'à moitié, et Bellini vient à Paris définitivement. Aux Italiens, I Puritani di Scozzia, d'après le roman de Walter Scott, remportent un immense succès ; mais Bellini meurt presque aussitôt.
Déjà, après la Sonnambula, des critiques italiens lui avaient reproché la simplicité excessive de ses accompagnements. Cette faiblesse du soutien harmonique des voix, cette pauvreté des parties symphoniques de ses ouvrages sont les causes de leur vieillissement. Il faut toute la chaleur des voix italiennes, entraînées au bel canto, pour rendre comme elle doit l'être une musique dont la pureté de la ligne mélodique constitue tout le charme. Mais ce charme est puissant. Il a séduit Bizet qui tenta de réorchestrer Norma, puis y renonça, au bout du premier acte, parce que — rapporte Camille Bellaigue — « ce qu'il faisait, c'était, à coup sûr, mieux orchestré que Bellini, mais ce n'était plus du tout Norma ! » Il y a en effet dans les ouvrages de Bellini quelque chose d'indéfinissable, de fragile, auquel on ne peut toucher sans tout détruire. De-ci, de-là, quelque trouvaille harmonique : à la fin du duo de Norma, l'accord de mi bémol frappé par tous les violons en plein ton de sol majeur, ou encore, dans le même ouvrage, la progression montante des basses, exactement reproduite dans la mort d'Isolde, aboutissant à la même appoggiature qui « dans les deux œuvres donne le comble de l'émotion (*) ». Mais ces trouvailles sont rares : la Sonnambula et Norma valent par le jaillissement spontané de la mélodie, et cet art-là échappe à toute analyse. Il est immatériel : l'air Casta diva est une simple monodie, aussi nue que le grégorien ; elle repose il est vrai sur un fantôme d'harmonisation, si maigre qu'il ne semble mis là que pour montrer son insuffisance. Mais Bellini sans doute n'a pas voulu autre chose : il a laissé la voix humaine s'épanouir. Il eut le génie de tracer les lignes aériennes les mieux propres à favoriser son essor.
(*) Cf. Bellini, musicien dramatique, par Domenico DE PAOLI. — Bellini harmoniste, par Marc PINCHERLE, « Revue musicale », mai 1935.
III
Au temps où Paris est envahi par les musiciens étrangers, italiens surtout, trois compositeurs français, Auber, Halévy et Hérold maintiennent plus ou moins heureusement la tradition nationale. Encore subissent-ils tous trois l'influence de Rossini et de Meyerbeer.
L'œuvre de Daniel-Esprit Auber, qui vécut quatre-vingt-dix ans, de 1782 à 1871, apparaît comme un pont jeté entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Du premier, elle a la légèreté, l'esprit, les qualités superficielles souvent, qui furent celles des petits maîtres de l'Opéra-Comique dans les dernières années de l'ancien régime et pendant la Révolution et l'Empire ; du second, elle traduit les goûts pour le pittoresque romantique ; mais ici encore, rien de bien profond, et c'est cela qui l'a fait vieillir. Mais ce pur Parisien — né par hasard à Caen — méritait vraiment son prénom d'Esprit ; sans doute a-t-il un peu trop éparpillé cet esprit dans les cent trente-deux actes (sans compter les ballets) qu'il a signés.
Élève de Cherubini dont il fut le successeur à la direction du Conservatoire, c'est bien plus par ses opéras-comiques que par ses grands opéras qu'Auber survit. Il avait déjà atteint la célébrité avec la Bergère châtelaine (1820), avec Emma ou la Promesse imprudente (182), qui fut jouée 181 fois à Paris et 582 fois en province en quelques années, avec Leicester ou le Château de Kenilworth qui, en 1823, marque le début de sa collaboration avec Scribe, avec Léocadie (1824), le Maçon (1825), Fiorella (1826), lorsque le 29 février 1828, le rideau de l'Opéra se leva sur le premier acte de la Muette de Portici, après une ouverture fort brillante, qui parut originale et le semble moins aujourd'hui. L'originalité la plus certaine est d'avoir fait d'une muette, la pauvre Fenella, le personnage central du drame lyrique. Auber avait vu Émilie Bigottini, danseuse de l'Opéra, mimer Nina ou la Folle par amour, le ballet que Milon et Persuis tirèrent en 1813 de l'opéra de Dalayrac ; il eut l'idée de lui confier un rôle dans un ouvrage lyrique : ce fut la Muette. Pour la première fois paraissait sur la scène un épisode de l'histoire moderne et qui semblait plein d'allusions aux faits contemporains. Par la forme, la Muette est le premier opéra romantique : l'abondance de ce qui n'était jusque-là que l'accessoire et va devenir l'essentiel en fit le succès. Le spectacle séduisit tous ceux que la musique aurait pu ne pas convaincre. L'ouverture, avec sa marche entraînante, ponctuée par le tambour sur les temps forts, la barcarolle : Amis, la matinée est belle, le duo, avec sa phrase Amour sacré de la patrie, qui devait soulever les Bruxellois trois ans plus tard, la cavatine du ténor, l'air du quatrième acte : Arbitre d'une vie, la qualité d'une interprétation qui réunissait les meilleures voix de l'époque (Nourrit, Mme Cinti-Damoreau, Alexis Dupont, Dabadie, Prévôt, Pouilley, Massol) enfin la grâce de Mlle Noblet à qui échut le rôle de Fanella, primitivement conçu pour Mlle Bigottini, tout se trouva réuni pour faire applaudir l'ouvrage, qui resta au répertoire jusqu'à la fin du siècle dernier... mais n'a plus été repris. La lecture de la partition montre la faiblesse du génie dramatique d'Auber.

costumes pour la création de la Muette de Portici, opéra d'Auber (1828)
Fra Diavolo (1830) et bien plus encore le Domino noir (1837) demeurent ceux de ses ouvrages où il faut chercher ce qu'il a produit de meilleur. Le Domino noir a été l'un des succès les plus grands, les plus longtemps maintenus, de l'Opéra-Comique. Le livret est une sorte de transposition du conte de Cendrillon, et qui en garde l'invraisemblance à défaut de la poésie (il y a loin de Scribe à Perrault) : il offre au musicien tous les artifices déjà connus en y ajoutant certains autres que l'on retrouvera dans les Mousquetaires au Couvent et dans Mam'zelle Nitouche. Mais il sert de prétexte au musicien pour quelques aimables couplets, pour une séguedille bien troussée : « Ah ! quelle nuit ! Le moindre bruit me trouble et m'interdit ! », le cantique avec chœur : « Heureux qui ne respire », l'air « Une fée, un bon ange » ont fait au Domino noir un sort heureux. Haydée, de même, en 1847, est resté longtemps populaire grâce à la barcarolle « Ah ! que Venise est belle ! », et les Diamants de la Couronne eurent 379 représentations en dépit de l'invraisemblance du livret. Manon Lescaut contient l'air fameux de « l'éclat de rire » que l'on réentend assez souvent au concours du Conservatoire.
On prétend — et lui-même l'affirmait — qu'Auber disait un adieu définitif à ses ouvrages le soir de la répétition générale et qu'il n'alla jamais en revoir un seul. Il a dit aussi : « J'ai aimé la musique jusqu'à trente ans ; je l'ai aimée tant qu'elle a été ma maîtresse ; mais depuis qu'elle est ma femme !... » La boutade s'achevait par un sourire. Il ne faut demander à Auber, sceptique et spirituel, que ce sourire, et lui savoir gré de n'en avoir jamais fait une grimace.
Tout au contraire Fromental-Élie Halévy (élève de Cherubini lui aussi) fut un musicien plein de sérieux et de gravité. Grand prix de Rome à vingt ans (il était né en 1799 et mourut en 1862), il eut des débuts difficiles, malgré ses succès scolaires. Un De profundis sur le texte hébraïque, composé en 1820 pour la cérémonie funèbre du duc de Berri, attira l'attention sur le musicien. Ce ne fut pourtant que sept ans plus tard que l'Artisan, au Théâtre Feydeau, puis Clari, au Théâtre italien, lui valurent les suffrages du public ; mais il connut ensuite quelques échecs, et dut attendre la création de la Juive à l'Opéra le 25 février 1835 pour être mis au premier rang. Le livret de Scribe, les excellents conseils de Nourrit qui écrivit lui-même les paroles de l'air : Rachel, quand du Seigneur, pour les proposer au musicien en remplacement du finale du quatrième acte, les frais énormes engagés par Véron et Duponchel pour monter l'ouvrage luxueusement, la richesse des décors, des costumes, l'attrait d'un « défilé » resté légendaire, concoururent au succès de la Juive ; mais si ces détails extérieurs amenèrent bien des curieux à l'Opéra, la qualité de la musique y fit aller les amateurs. La partition a vieilli, certes, mais bien moins que beaucoup d'autres qui furent ses contemporaines. Elle renferme des pages pleines de passion et d'originalité ; elle montre un souci du style qui contraste avec la négligence de maints ouvrages d'alors. Et l'orchestration est, elle aussi, plus raffinée, plus élégante qu'aucune autre en ce temps. L'Éclair, que l'Opéra-Comique donna en 1835, offre cette particularité de ne point comporter de chœurs, et si le sujet n'est pas d'une vraisemblance bien certaine, la partition est agréable et les couplets de « l'espérance », au troisième acte, devinrent vite populaires. Guido e Ginevra ou la Peste à Florence, à l'Opéra en 1838, donne une idée du goût macabre de l'époque : on y voit tout un attirail singulier, tombeaux de pestiférés, condottieri qui chantent : « Vive la peste ! » et échangent des coups de dague, poison que l'on verse ; un romantisme qui fait songer à Han d'Islande. Ce fut ce soir-là que Rosine Stoltz fit un éclatant début.
Le 22 décembre 1841, sur le même théâtre, la Reine de Chypre fut pour Halévy un triomphe qui dépassa encore le succès de la Juive. Le livret de Saint-Georges lui offrait d'ailleurs des situations variées et dramatiques. Il en sut tirer un habile parti. Moins réussie est la partition de Charles VI (1843) ; mais les évènements en firent un instrument politique contre Guizot, trop anglophile au goût de ses ennemis, et tout Paris chanta : « Guerre aux tyrans, jamais en France, jamais l'Anglais ne régnera ! »
Halévy connut vers la fin de sa vie la tristesse des artistes qui sentent que leurs ouvrages se démodent et que la foule s'en détourne. Dans une notice sur Frohberger, il a écrit ces lignes désenchantées : « Le souvenir des triomphes qui ne sont plus est pour eux si amer, si plein de regrets, qu'ils semblent les poursuivre comme un remords. »
Plus qu'Auber et Halévy, Ferdinand Hérold aurait pu exercer une influence durable sur l'art lyrique français s'il n'était mort prématurément à quarante-deux ans en 1833. Admirablement doué, grand prix de Rome à dix-huit ans après avoir travaillé avec Méhul, il était riche de dons, et néanmoins fort modeste (il n'osa pas aller voir Beethoven pendant qu'il était à Vienne) ; il avait en outre beaucoup de bon sens. Il a écrit : « En quoi consiste la richesse d'une musique ? Est-ce dans la manière de traiter les idées, ou dans les idées elles-mêmes ? » Il en eut, et d'excellentes ; mais il n'eut ni toujours assez de hardiesse, ni surtout point assez de temps pour en tirer les conséquences, et c'est ce qui fait déplorer sa disparition au moment où comme il l'a dit à son lit de mort « il commençait à comprendre la musique ». Avec Zampa et avec le Pré aux Clercs, il s'est cependant révélé un précurseur : entre tous les ouvrages lyriques de cette période, ceux-ci se classent parmi les meilleurs. Le livret de Zampa n'est à vrai dire qu'un démarquage de celui de Don Juan. Mais la statue du Commandeur y devient l'effigie de marbre d'une jeune fille jadis séduite par le pirate Zampa, et morte de chagrin. La partition a des qualités : la ballade dont le refrain est une prière à sainte Alice n'a point la fadeur de tant d'autres pages du même genre ; les chœurs ont de l'allant ; mais trop souvent ces promesses tournent court. Le Pré aux Clercs (Opéra-Comique, 15 décembre 1832) est antérieur aux Huguenots, et Scribe doit beaucoup à Planard — comme Meyerbeer doit aussi à Hérold. Mais s'il y a moins d'effets mélodramatiques et plus de fraîcheur dans le Pré aux Clercs, il y a moins de « métier » ; il y a plus d'originalité et c'est ce qui conserve à la partition un charme qui la sauve des injures du temps. Hérold fut un musicien sincère. On pouvait attendre de lui ce qui manqua précisément à la plupart des opéras de son temps.
Adolphe Adam (1803-1856) a sacrifié au succès et à la facilité tout ce qui aurait pu faire de lui un musicien original ; il a écrit cinquante-trois partitions en vingt-sept ans ; il a trouvé, après des débuts difficiles, de retentissants succès avec le Chalet (1834), le Postillon de Lonjumeau (1836), le Toréador (1840), Si j'étais roi ! (1852). Il survit grâce à son Noël : Minuit, chrétiens ! et à son ballet Giselle, alors qu'il put croire durables les productions dont le succès lui semblait un gage de pérennité. Le Noël d'Adam n'est qu'une assez pauvre chose. Et Giselle doit aux librettistes, Théophile Gautier et Saint-Georges, au chorégraphe Coralli — au souvenir de Carlotta Grisi, qui la créa — d'avoir conservé plus d'un siècle un attrait qui ne lui vient point de la musique d'Adolphe Adam, souvent mieux faite pour en détruire la poésie que pour y ajouter quoi que ce soit. Et pourtant la médiocrité de cette partition bâclée en quelques jours, vulgaire en maints endroits, se relève ici et là par quelques trouvailles dont le musicien n'a point voulu ou n'a pas su tirer parti : le thème de Giselle effeuillant la marguerite avec Albrecht, et qui reparaît dans la scène de la folie, aurait pu servir à Chopin pour un Nocturne. Adam n'a su que le gâter, comme il a noyé sous d'insipides flonflons ce qu'il y avait de meilleur dans le ballet blanc des Willis au second acte.

de gauche à droite : Carlotta Grisi, Marie Taglioni, Lucile Grahn et Fanny Cerrito [lithographie anglaise du XIXe siècle]
Bien que de huit ans plus jeune que Berlioz, Ambroise Thomas (1811-1896) se rattache bien davantage aux musiciens qui l'ont précédé ; et cette sorte de conformisme académique lui fit devancer l'auteur de la Symphonie fantastique dans la course au fauteuil de l'Institut. Lui aussi fut élève de Le Sueur, et grand prix de Rome (1832) ; il eut des débuts difficiles, et ses quatre premiers ouvrages tombèrent. Les suivants n'eurent qu'un succès si médiocre qu'il renonça au théâtre. Il y revint pourtant en 1849, avec le Caïd, opéra bouffe sur un livret de Sauvage, qui, le 3 janvier, obtenait un succès triomphal à l'Opéra-Comique. Succès mérité : l'ouvrage vif, charmant, révélait un savoir-faire peu commun. Mais Ambroise Thomas aspirait à montrer qu'il était capable de force, de grandeur, en collaborant avec Shakespeare, Goethe et Dante ; il écrivit le Songe d'une Nuit d'été, qui n'a de commun que le titre avec la féerie shakespearienne, et où le dramaturge anglais paraît lui-même auprès d'Elizabeth et de Falstaff, tandis que disparaissent Obéron, Titania et Puck, qui seraient évidemment dépaysés dans le parc de Richmond (1850). En 1866, ce fut le tour de Goethe, avec Mignon, l'un des succès les plus grands, les plus durables de l'Opéra-Comique. Le roman de Wilhelm Meister fournit l'héroïne et la plupart des personnages, mais point tels que Michel Carré et J. Barbier les montrent. Philine, qui ne tient guère de place dans Wilhelm Meister, devient un des principaux personnages de Mignon, et c'est la rivalité de la comédienne et de la pauvre et simple enfant qui fait le sujet de la pièce. En vingt-huit ans, du 17 novembre 1866 au 16 mai 1894, Mignon paraissait mille fois sur l'affiche de l'Opéra-Comique, où on la retrouve encore fréquemment aujourd'hui. C'est qu'il y a dans cet opéra toute l'adresse du compositeur jointe à tout ce qui peut plaire au public ; des airs joliment tournés, faciles à retenir, une musique aimable, que les orgues de barbarie ont rendue populaire. Il y a autre chose aussi, et c'est la très juste convenance de la couleur musicale aux personnages, aux situations du drame ; c'est un « métier » singulièrement adroit. C'est de même ce que l'on trouve dans Hamlet (1868) dont le succès ne fut guère moins vif. Mais la sombre atmosphère d'Elseneur n'était pas l'affaire d'Ambroise Thomas : les caractères manquent de profondeur ; les épisodes tragiques se prêtent mal à n'être que prétextes à romances. La partition est superficielle, et celle de Françoise de Rimini (1882) plus encore. Le succès, en dépit d'une mise en scène fort luxueuse, en fut médiocre ; la Tempête, transformée en ballet fantastique, ne dut, en 1884 qu'à la danseuse Rosita Mauri son triomphe éphémère.
Le véritable romantique français est, dans le domaine de la musique, Hector Berlioz. Exactement contemporain de Victor Hugo (il est né en 1803), il a combattu pour la même cause et engagé à l'Opéra un combat tout pareil à la bataille d'Hernani. Mais, moins heureux que le poète, le compositeur a subi la défaite avec Benvenuto Cellini, représenté rue Le Pelletier le 10 septembre 1838, huit ans donc après le drame de Hugo. Quelles en furent les raisons ? La cabale ? Les défauts d'un mauvais livret ? La réputation de « fauve » comme on aurait dit cent ans plus tard, que Berlioz avait acquise avec ses ouvrages symphoniques, et singulièrement la Fantastique ? Il y eut bien de tout cela, mais la vérité semble être dans ce fait que le public de l'Opéra était alors plus encore qu'aujourd'hui un petit monde très fermé à toute idée nouvelle ; il aurait fallu que Berlioz ne disposât point seulement d'une escouade d'amis pour défendre son Benvenuto, mais d'une armée, résolue autant que celle des « Jeune France » qui soutint Victor Hugo. Or cette troupe, il ne l'avait même pas à ses côtés. Les quelques camarades qu'il comptait dans la salle ne pouvaient rien devant un public défavorablement prévenu contre l'ouvrage par un article perfide de Mainzer, publié dans la Revue musicale un mois plus tôt, et que l'on avait répandu. Ils ne pouvaient couvrir de leurs maigres applaudissements les sifflets, les cris d'animaux déchaînés dès le premier acte par quelques mots trop familiers du texte. Un ventriloque, au parterre, rapporte Adolphe Boschot, obtint un succès prodigieux tandis que dans les loges, des dandies poussaient des gloussements. La seconde représentation, le 12, eut lieu devant une salle à moitié vide ; deux jours plus tard, moins de monde encore. La chute de Benvenuto allait faire renoncer Berlioz au théâtre pendant vingt-cinq ans. L'ouvrage ne fut plus jamais joué en France ; mais on le donne en Allemagne.
La scène est à Rome pendant le carnaval, en 1532. Benvenuto Cellini est amoureux de Teresa Balducci, fille du trésorier du pape, et médite de l'enlever en profitant du désordre de la mascarade. Mais Fieramosca, sculpteur du pape, capitan poltron et bravache, surprend l'entretien des amoureux ; il se cache dans une pièce voisine pour les épier. Balducci rentre et le surprend tandis que Benvenuto réussit à se sauver. Au premier tableau du second acte, Cellini attend Teresa sur la place Colonna. Ascanio, son élève préféré, survient, portant, de la part du pape, un sac d'écus, avec l'ordre de fondre immédiatement la statue de Persée. Cellini ne songe qu'à Teresa, qui l'a rejoint. Fieramosca la suit, accompagné d'un spadassin, déguisé en moine. Benvenuto tue le sicaire. Le canon du fort Saint-Ange tonne heureusement et l'obscurité permet à Ascanio d'emmener Teresa, tandis que Cellini s'enfuit et que les sbires arrêtent Fieramosca. On se retrouve au deuxième tableau dans l'atelier du maître, où Teresa et Ascanio attendent son retour. Il arrive, encore déguisé, et bientôt suivi de Balducci et de Fieramosca, puis d'un cardinal que le pape envoie pour surveiller la fonte du Persée. Tumulte : Fieramosca veut que Cellini soit pendu pour avoir tué le spadassin ; Balducci veut sa fille ; le cardinal veut la statue. Cellini menace de briser le moule s'il n'obtient son pardon et la main de Teresa. Le cardinal promet. Le métal bout, mais la fonte manque. Cellini saisit, désespéré, ses statuettes d'argent, ses vases précieux, jette le tout dans la fournaise. La fonte s'achève et le Persée apparaît, incandescent. Balducci transporté, met la main de sa fille dans la main de Cellini.
Il y a dans Benvenuto Cellini de fort belles pages, et l'on ne pardonne pas au public son injustice. L'ouverture est un des succès de nos concerts symphoniques ; le tableau du carnaval est d'une vivacité de rythme et de couleurs extraordinaire ; Liszt ne s'y trompa pas : il garda pour Benvenuto Cellini une admiration qui lui fit monter cet ouvrage à Weimar en 1852. Il y eut un succès triomphal, mais qui ne parvint point à consoler Berlioz.
Bien que la Damnation de Faust soit au répertoire de l'Opéra, la « légende dramatique » (tel est son titre) de Berlioz n'était point destinée à la scène. On sait qu'en 1828, il avait écrit les Huit Scènes de Faust ; il les reprit en 1844, y intercala, entre autres développements et adjonctions, la Marche de Racoczy, écrite pendant son voyage en Europe centrale et exécutée pour la première fois à Pesth au milieu de l'indescriptible enthousiasme du public hongrois, et acheva sa partition le 19 octobre 1846. Tout a été dit sur cette œuvre célèbre, sur les circonstances de la première audition le 6 décembre 1846 devant une assistance clairsemée, et tout peut être résumé dans ce mot d'Adolphe Boschot : le chef-d’œuvre de Berlioz venait de le ruiner. Ce ne fut que bien longtemps après sa mort qu'Édouard Colonne, par son obstination fervente, sut lui faire rendre justice.
L'idée de tirer des premiers livres de l'Énéide un grand ouvrage hantait Berlioz depuis longtemps. Il ne se décida à l'entreprendre que sur les vives instances de Liszt et de la princesse Sayn-Wittgenstein. Il relut Virgile — qu'il savait par cœur ; il relut Shakespeare pour y trouver un modèle de charpente dramatique, et il écrivit lui-même son poème. La partition le retint longtemps ; elle fut achevée le 7 avril 1858. Mais alors commencèrent de nouveaux embarras : l'Opéra refusait obstinément l'ouvrage, jugé trop long — ce qui n'était hélas que trop vrai ; les portes des théâtres se fermaient devant l'auteur de Benvenuto Cellini ; enfin en février 1865, Carvalho, directeur du Théâtre-Lyrique, promet de monter les Troyens, mais à condition que Berlioz en détache la première partie, la Prise de Troie ; et ces deux premiers actes attendront jusqu'en 1890 pour être créés à Carlsruhe, — vingt et un ans après la mort de Berlioz — jusqu'en 1899, pour paraître en France sur la scène de l'Opéra. Mais ce qui reste de la partition après cette amputation semble encore trop long à Carvalho ; il faut consentir d'autres coupures et la première a lieu le 4 novembre 1863.
Le succès de curiosité fut assez grand les premiers soirs. Mais le public se détourna vite d'un ouvrage regardé par les uns — et fort injustement — comme « difficile », par les autres, qui étaient les plus nombreux, comme obscur et ennuyeux. Les Troyens nous livrent cependant Berlioz tout entier, avec ses grandeurs et ses faiblesses. Celles-ci ont masqué celles-là.
Il y a en réalité deux sujets dans les Troyens : le premier est inspiré du deuxième livre de l'Énéide, et il a Cassandre pour héroïne ; le second est beaucoup plus long, et c'est Didon qui en est le personnage principal. Le lien entre la Prise de Troie et les Troyens à Carthage n'est réalisé que par la présence d'Énée. La Prise de Troie contient des pages magnifiques : le récitatif et l'air de Cassandre, déplorant l'aveugle obstination des Troyens à courir à leur perte, l'entrée d'Andromaque conduisant, sous ses voiles de deuil, le jeune Astyanax au milieu du peuple en fête pour porter des fleurs à l'autel, la symphonie qui accompagne cette scène muette, l'apparition mystérieuse d'Hector, où chaque phrase prononcée par l'ombre du guerrier baisse d'un demi-ton, la mort de Cassandre dans le temple de Vesta. Mais il y a bien des longueurs, bien des singularités, bien des italianismes déjà démodés en 1863.
Les Troyens à Carthage paraissent encore plus inégaux ; les beautés qu'on y trouve sont de premier ordre, et parmi les meilleures de Berlioz. L'air de Didon : « Chers Tyriens, tant de nobles travaux... », au premier acte, est solennel comme il convient, mais quelque peu froid, conventionnel ; au contraire, l'expression du désespoir de la reine, au dernier acte, atteint le sublime, et jamais l'art de Berlioz n'est allé plus haut. C'est au deuxième acte (le quatrième, de l'ouvrage considéré dans son ensemble) que se trouve le septuor qui est suivi d'un nocturne admirable, d'un duo dont la passion et la volupté s'accordent aux enchantements de la nature ; musique transparente comme le ciel africain, musique dont les inflexions ont la douceur de la brise chargée de parfums et du mystère de la nuit. Et c'est là, en vérité, une des plus belles pages de la musique française.
On a gravé sur la partition des Troyens cette phrase extraite des Mémoires de Berlioz : « O ma noble Cassandre, mon héroïque vierge, il faut donc me résigner, je ne t'entendrai jamais !... »
Béatrice et Bénédict fut représenté à Bade le 9 août 1862 — avant que le Théâtre-Lyrique montât les Troyens ; mais la partition fut commandée à Berlioz après qu'il eut achevé déjà celle de son grand ouvrage. Le livret, tiré de Beaucoup de bruit pour rien, datait de 1833, et il avait toujours remis d'en écrire la musique. Elle compte quinze numéros, d'une variété et d'un esprit charmants ; c'est l'œuvre la plus unie du maître ; ce n'est certes pas la plus grandiose, mais il y réussit exactement ce qu'il avait voulu : un chef-d’œuvre de sensibilité et de poésie. Une scène en est admirable : le duo nocturne du premier acte qui fit écrire à Gounod : « C'est un modèle achevé de ce que le silence du soir et le calme de la nature peuvent faire descendre dans l'âme de rêverie et de tendresse. Il y a dans l'orchestre des murmures divins qui trouvent leur place dans cette admirable peinture sans rien ôter aux voix de leur délicieuse cantilène ; c'est absolument beau et parfait. C'est immortel comme ce que les plus grands maîtres ont écrit de plus suave et de plus profond. »
Ainsi ce grand romantique tourmenté, aigri, déchiré par la vie, victime de son caractère autant que de l'incompréhension de ses contemporains, ce tempérament orageux et « volcanique » est cependant le musicien dont les chefs-d’œuvre expriment comme nul autre avant lui n'avait su le faire, la mélancolie, la résignation désespérée — et surtout, la tendresse : Marguerite attendant Faust qui « ne revient pas », Didon murmurant : « Tout conspire à vaincre mes remords... » ; et puis le duo de Béatrice et Bénédict...
Contemporain de Berlioz, Félicien David (1810-1876) rapporta de Turquie et d'Égypte où l'avait entraîné sa fidélité à la foi saint-simonienne, l'idée de ses « odes-symphonies » dont la première, le Désert, exécutée dans la salle des Concerts du Conservatoire le 8 décembre 1844, lui valut la célébrité. Il révélait aux musiciens un Orient qui n'était plus celui des conventionnelles « turqueries » du siècle précédent, mais un Orient vrai, ou du moins présenté sous un aspect directement inspiré du folklore. Lalla-Roukh, d'après le poème de Thomas Moore, que l'Opéra-Comique représenta le 12 mai 1872, n'est point une évocation aussi fidèle : la tradition européenne y trouve sa place, et assez grande ; mais si l'ouvrage contient des pages d'une réelle et fraîche poésie, comme l'introduction : « C'est ici le pays des roses », la cantilène de Noureddin, au premier acte « Ma maîtresse a quitté la tente », l'air de Lallah-Roukh : « O nuit d'amour », elles tranchent cependant moins vivement sur la production ordinaire de l'époque. Bien que Mme Miolhan-Carvalho ait obtenu en 1857 dans la Perle du Brésil un des plus grands succès de sa carrière, l'ouvrage de Félicien David n'avait point ce qui pouvait le sauver de l'oubli ; et Herculanum (Opéra, 1859) qui passa pour un chef-d’œuvre, apparaît à la lecture comme une œuvre un peu trop superficielle. Prétendant peindre le conflit du paganisme et du christianisme naissant, la musique s'en tient à l'anecdote, et l'éruption du Vésuve qui lui sert de conclusion ne suffit pas à lui donner de la force. Dans les Indes galantes, Rameau a fait mieux à l'entrée des Incas.
Pour compléter cette esquisse de l'art lyrique au temps du romantisme, il faut au moins citer Niedermeyer (1802-1861), qui, avant de fonder l'école de musique religieuse à laquelle son nom reste attaché, essaya du théâtre avec Il Reo per amore (1821), la Casa nel bosco, Stradella (Opéra, 1837), Marie Stuart (1844), la Fronde (1853), et ne put y réussir. Casimir Gide (1804-1868) vit son Roi de Sicile outrageusement sifflé à l'Opéra-Comique en 1830 ; mais la faute en était au livret de Frédéric Soulié ; il donna ensuite les Trois Catherine, les Jumeaux de La Réole, l'Angélus, Belphégor, collabora avec Halévy pour la Tentation, ballet représenté à l'Opéra le 12 juin 1832, violemment discuté, non pour la qualité de la musique qui fut jugée excellente, mais pour l' « immoralité » du sujet. Un autre ballet, Ozaï ou les Sauvages (Opéra, 1847), servit de début à la Priora et la partition en fut appréciée très favorablement.
Gastibelza, le Fou de Tolède, représenté à l'Opéra-Comique en 1847, imposa le nom d'Aimé Maillart grâce au succès de la « prière » et de la romance de l'homme à la carabine ; puis vinrent le Moulin des Tilleuls, la Croix de Marie, qui passèrent presque inaperçus, et enfin en 1856, au Théâtre-Lyrique, les Dragons de Villars dont les trois actes offraient au public tout ce qui peut satisfaire ses goûts. L'ouvrage resta au répertoire longtemps et le rôle de Rose Friquet servait traditionnellement pour les débuts des dugazons dans les théâtres de province.
François Bazin (1816-1878), élève d'Halévy comme Maillart, a fait représenter une dizaine d'opéras-comiques. La Farce de Maître Pathelin, en 1856, le Voyage en Chine (1865), eurent leur temps de succès. Le nom de Clapisson (1808-1866) serait aujourd'hui bien oublié, malgré Gibby la Cornemuse (1846), la Promise (1854), la Fanchonnette (1856), s'il n'avait été le fondateur du musée instrumental du Conservatoire, et si l'Institut, en 1854, ne l'avait élu en le préférant à Berlioz.
On parle aujourd'hui bien souvent du « divorce » qui sépare le public et les musiciens. L'exemple de Berlioz montre que cette répugnance pour l'originalité hardie de la forme ne date pas d'hier, puisque le succès est allé, au temps du romantisme, à ceux qui sont entrés si vite dans l'oubli.
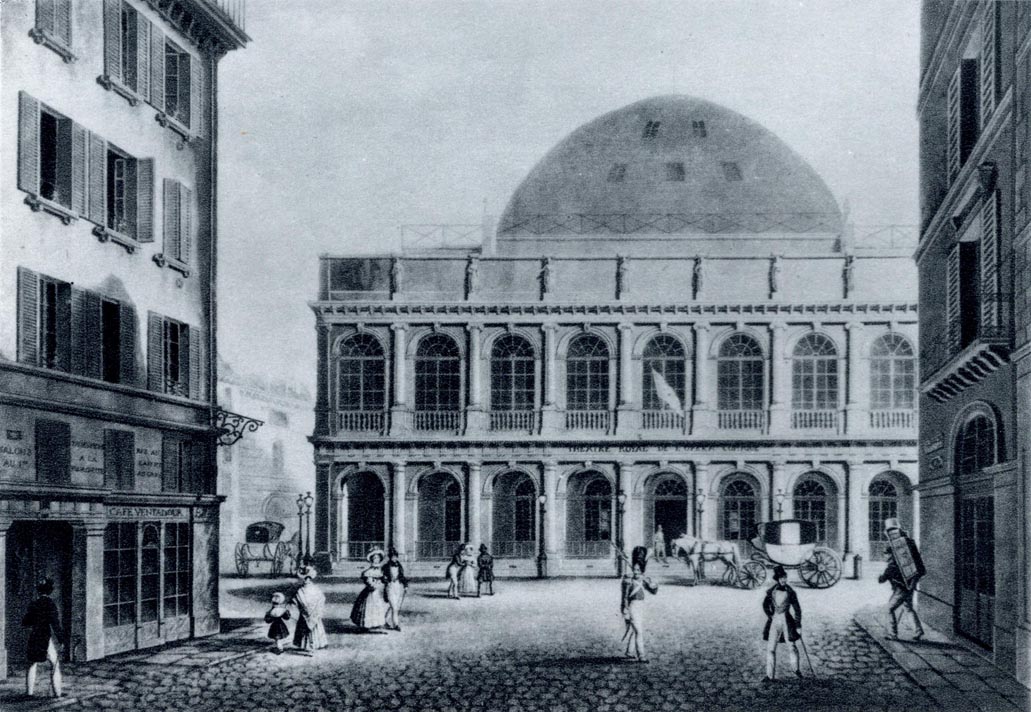
Théâtre de l'Opéra-Comique à Paris, salle Ventadour (1841-1870)
RICHARD WAGNER
Homme de théâtre avant tout, Richard Wagner occupe une place considérable dans l'histoire de l'art lyrique, non seulement à cause de la valeur, de l'originalité de ses œuvres destinées à la scène, mais aussi en raison de l'influence que ses écrits théoriques et l'application qu'il en fit dans ses drames, ont exercée sur la musique. On n'entrera point ici dans le détail de la biographie ; il suffit de rappeler que, dès la prime enfance, élevé par le second mari de sa mère, l'acteur Geyer, Wagner a vécu dans le monde du théâtre, et que ses deux sœurs, Rosalie et Clara, furent cantatrices. Deux faits sont à retenir : les visites de Weber et de Sassaroli, un ténor italien d'aspect colossal dont la voix quasi féminine contraste avec sa taille de géant ; tous deux sont amenés à la maison par Clara, qui vient de débuter à seize ans dans Cenerentola. Richard éprouve autant de sympathie, d'admiration pour l'auteur du Freischütz, dont la musique l'enchante, que d'antipathie pour Sassaroli. Autour de l'enfant, on parle : il entend dire que pour réussir, c'est vers la musique italienne qu'il faut se tourner. Nullement conformiste, il a déjà l'âme d'un révolutionnaire et le montrera bientôt : « Je me souviens qu'en ce qui me concerne, j'avais pris parti pour l'opéra allemand. Weber me charmait jusqu'à l'extase », écrit-il dans ses Souvenirs (*). Les impressions de l'enfance sont durables : toute sa vie, Richard Wagner va s'employer à tenter ce que Gluck n'avait pu : faire du drame musical un art « intégral », un art synthétique, et de cet art total un art allemand.
(*) Pages 45 et sq., t. I de la traduction française de Mein Leben (Ma Vie, 3 vol., Plon, 1911).

Richard Wagner [photographie]
L'histoire de sa vie est liée à l'histoire de ses œuvres. Sa carrière de chef d'orchestre n'est qu'une préparation souvent douloureuse à sa carrière de compositeur. En outre, il est poète. Il est armé d'une personnalité très forte, d'un solide orgueil qui n'est, à tout prendre, que la conscience de sa valeur. Dans le contact intime et journalier des œuvres d'autrui, il saura préserver son originalité, et s'il subit naturellement des influences, il saura n'en retenir que la substance propre à nourrir son génie. Son instinct d'artiste lui fait aisément éliminer le reste.
Ces influences apparaissent manifestement dans ses premiers essais, tous de musique pure, et c'est Weber, Beethoven, Marschner, Mozart dont on trouve le reflet dans ces compositions. En 1832, à Prague, il écrit le livret d'un opéra, un sombre drame, Die Hochzeit (les Noces), et, sur les conseils de Rosalie, il le détruit ; l'année suivante, à Wurtzbourg, il écrit le poème des Fées (Die Feen), d'après la Donna Serpente, de Gozzi. Si l'œuvre n'est point d'une originalité bien nette, elle est d'un caractère assez éloigné du goût italien alors à la mode pour que le théâtre de Leipzig la refuse ; et déjà on y remarque quelques passages, dans le deuxième acte en particulier, qui projettent d'éclatants rayons sur l'avenir.
S'inspirant très librement de Measure for measure, Wagner entreprend alors Liebesverbot (Défense d'aimer), puis abandonne cet ouvrage qu'il reprendra après deux ans d'oubli, après avoir épousé en novembre 1836 Minna Planer, l'amoureuse de la troupe qu'il dirige. La musique de Liebesverbot est totalement différente de celle des Feen. Celle-ci était toute imprégnée de romantisme, toute allemande dans la forme ; celle-là est toute légère, toute voisine des œuvres françaises ou italiennes à la mode ; mais elle n'en porte pas moins sa marque. Elle est jouée sans aucun succès à Magdebourg le 29 mars 1836. Cet échec fait réfléchir Wagner : il comprend qu'il n'est pas fait pour les œuvrettes de cette sorte, « de la musique à la Adam », comme il dit. Puisqu'il lui faut de grands sujets, il choisit celui qu'a traité Bulwer Lytton dans un roman publié en 1835 ; il en conserve le titre : Rienzi der letzte der Tribunen (Rienzi le dernier des tribuns). Nicolas Lorenzo, dit Rienzi par abréviation, fils d'un aubergiste, s'est grisé de lectures et entreprend de rendre à Rome sa grandeur passée en lui rendant la république, et en l'affranchissant de la tyrannie des nobles pendant le pontificat de Clément VI à Avignon. Il rencontre d'abord la faveur populaire, puis des intrigues se nouent. Rienzi les réprime ; le tribun devient bientôt l'objet de la haine de ceux qu'il a gênés. Le clergé lui retire son appui ; le peuple se soulève et il meurt dans un incendie allumé par les émeutiers. Wagner a traité avec enthousiasme le rôle de Rienzi : il y a mis l'ardeur de ses convictions révolutionnaires. Mais si les influences du style italien sont visibles dans son opéra, on y remarque déjà le retour de certains thèmes caractéristiques. L'ouverture est fort développée, l'instrumentation brillante. Malgré le respect de la coupe traditionnelle des airs, duos, ensembles, malgré le ballet-pantomime, les cortèges et les finales meyerbeeriens, Rienzi contient en germe ce que Wagner va bientôt apporter de nouveau au drame lyrique. Ce fut à Paris, après que des intrigues de théâtre l'eurent obligé de quitter Riga en 1839 que Wagner put achever Rienzi. L'opéra attendit jusqu'au 20 octobre 1842 pour être créé à Dresde, et bien que les spectateurs ne comprissent pas exactement la portée de l'ouvrage, ils l'accueillirent triomphalement, et il en fut de même dans les principaux théâtres de l'Allemagne.
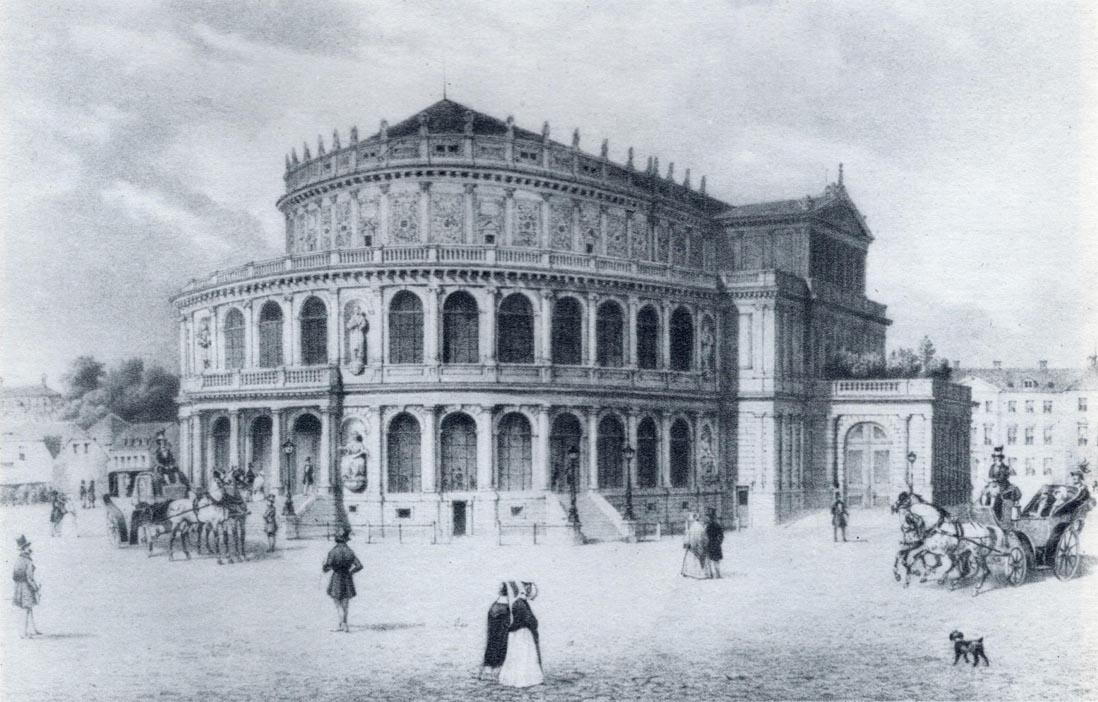
Théâtre de Dresde, où furent créés Rienzi et le Vaisseau fantôme de Wagner [gravure allemande]
Triomphe chèrement payé par les longs mois d'épreuve passés à Paris, les jours de misère et de famine, où il avait fallu accepter pour vivre des besognes épuisantes, céder même, pour cinq cents francs, le scénario du Vaisseau fantôme, dont l'idée lui était venue pendant la tempête essuyée au cours de la traversée de Riga à Londres. Mais il n'avait vendu ses droits que pour la France, et il pouvait, en quittant Paris en avril 1842, emporter la partition de Der Fliegende Holländer (le Hollandais volant, alias le Vaisseau fantôme). Refusé d'abord à Munich et à Leipzig, le succès de Rienzi le fit accepter d'enthousiasme à Dresde où il fut représenté le 2 janvier 1843 avec non moins de réussite, ce qui valut peu après à l'auteur la place de Kapellmeister de la cour de Saxe, devenue vacante à la mort de Rastrelli. Il allait y demeurer sept ans.
Le Vaisseau fantôme avait cependant déçu nombre d'auditeurs qui attendaient un opéra comme Rienzi, et qui trouvaient tout autre chose. Wagner avait lu dans Henri Heine la légende du Hollandais volant, condamné à errer éternellement sur les mers, avec un équipage de spectres, jusqu'à ce qu'une femme rachète son salut en se sacrifiant. Wagner trouve là une idée qui lui est chère, qu'il reprendra dans Tannhäuser, une idée romantique : la rédemption par l'amour. Le souvenir de la tempête essuyée dans la mer du Nord ne l'a point quitté non plus. Dans le Vaisseau fantôme, il va appliquer pour la première fois ses théories du leitmotiv et de la « mélodie continue ». Ce n'est encore qu'un essai, c'est à peine un « système » comme cela va bien vite le devenir. Le thème conducteur (leitmotiv) reparaît chaque fois que le personnage revient en scène, chaque fois qu'il y est fait allusion, chaque fois que l'idée dont ce thème est l'image sonore est évoquée consciemment ou non.
Les Fées, Défense d'aimer, Rienzi, étaient asservis aux formes habituelles du vieil opéra, à la division en « numéros » ; Wagner ne veut plus que l'obligation de donner aux chanteurs l'occasion de venir à tour de rôle cueillir à la rampe l'applaudissement du public, oblige le compositeur à rompre l'action dramatique. La mélodie sera continue comme l'est, dans la vie, le dialogue des êtres que meut la passion ; elle ne s'interrompra qu'aux instants où, naturellement, il n'y a plus de place pour les paroles, et c'est alors la symphonie qui traduira les pensées des acteurs du drame. La musique peut, doit, exprimer l'émotion qui se dégage d'une scène où l'on agit, d'un conflit de sentiments que le meilleur texte ne peut traduire aussi bien qu'elle.
Wagner a conté dans sa Communication à ses amis, en 1851, comment il avait composé le Vaisseau fantôme, en appliquant une théorie qu'il ne concevra clairement qu'un peu plus tard : « Je me souviens que, avant de passer à la réalisation proprement dite du Vaisseau fantôme, je composai le texte et la mélodie de la ballade de Senta au second acte. Inconsciemment, je déposai dans ce morceau les germes thématiques de la partition entière. C'était l'image concentrée du drame entier, si bien que l'ouvrage achevé, j'avais bonne envie de le dénommer « ballade dramatique ». Lorsque je passai à la composition, l'image thématique que j'avais conçue s'étendit d'elle-même comme une sorte de réseau sur l'œuvre entière. Sans que je l'eusse à proprement parler voulu, il me suffisait de développer dans un sens conforme à leur nature les divers thèmes contenus dans la ballade pour avoir, par devers moi, sous forme de constructions thématiques bien caractéristiques, l'image musicale des principales situations dramatiques de la pièce. Il m'eût fallu procéder avec tout l'arbitraire parti pris du compositeur d'opéra, si, au cours des diverses scènes du drame, j'avais voulu trouver, pour exprimer des états d'âme identiques, des motifs nouveaux et différents. Or, n'ayant pas le dessein de confectionner un recueil de morceaux d'opéra, mais simplement de créer une image aussi claire que possible de mon sujet, je ne me sentis pas la moindre velléité de procéder de la sorte. »
Voilà qui est net.
Le livret simplifie l'action extérieure ; tout le drame est, au contraire, intérieur, psychologique et réside dans le don de soi consenti par Senta. Dès que le Hollandais maudit sera introduit sous le toit paternel, la jeune fille renoncera à son fiancé. Mais au troisième acte, quand elle prendra congé de celui-ci, le Hollandais, trompé par les apparences, et entendant les protestations d'amour d'Érik que Senta éconduit, se croira trahi et reprendra la mer. Senta, désespérée en voyant le vaisseau appareiller dans la tempête, se jettera dans les flots. Aussitôt son sacrifice apaisera la colère divine et le navire fantôme s'engloutira. Ainsi le Hollandais et Senta seront à jamais unis dans la mort libératrice.
Les deux thèmes essentiels du Fliegende Holländer apparaissent dès l'ouverture où ils se joignent à une description fortement colorée de la tempête. De même ils forment la ballade du second acte. Le premier est comme un appel violent, et semble traduire l'aspiration du Hollandais maudit à la délivrance ; le second, tout de douceur, caractérise Senta ou la Rédemption. Un troisième thème, épisodique, se trouve dans l'ouverture : il servira à la danse des matelots au troisième acte. La recherche des tonalités, des harmonies, des timbres propres à faire naître chez l'auditeur l'émotion qui le met en accord avec les sentiments des personnages, est déjà très poussée, très wagnérienne. Le Vaisseau fantôme possède nettement toute la couleur harmonique et instrumentale propre à Wagner.
Avec Tannhäuser, Wagner va affirmer sa maîtrise ; mais comme l'ouvrage est plus complexe, il semblera parfois se rattacher davantage à la forme meyerbeerienne de l'opéra, et d'autant plus que le déroulement de la légende dans un cadre historique amène nécessairement des épisodes (chasse, procession de pèlerins, défilé des seigneurs dans le château du landgrave) tout semblables à ceux que l'on trouve chez Meyerbeer et Halévy. Mais, néanmoins, le système wagnérien se précise et s'amplifie. Le nombre des thèmes conducteurs augmente ; le procédé allusif de leurs retours se perfectionne. Parallèlement, l'orchestre acquiert plus de richesse encore (il faut d'ailleurs remarquer que les pages les plus brillantes, le Vénusberg, récrites pour la représentation de Paris en 1861, portent la marque de cette plénitude qui caractérise les œuvres de la maturité, qu'elles ont la beauté des meilleures scènes de Tristan, alors que certaines autres laissent voir un italianisme qui va disparaître totalement dans Lohengrin).
Le sujet de Tannhäuser est encore la rédemption par l'amour : Henri de Tannhäuser a quitté la cour du landgrave Hermann et est devenu l'amant de Vénus, car les dieux de l'Olympe, vaincus par le christianisme, ne sont pas morts. Tannhäuser garde, dans les délices du Vénusberg, le souvenir de la pure Élisabeth, fille du landgrave ; et c'est elle, c'est sa foi, offrant sa vie pour le rachat du pécheur, qui sauvera Henri.
L'ouverture est construite sur le modèle du Freischütz et présente un raccourci du drame en même temps qu'un exposé des principaux thèmes : marche des pèlerins, motif du Vénusberg, frissonnant, voluptueux, qui monte, s'enlace, se joint au thème de la bacchanale, et se résout dans un « hymne à Vénus » de forme assez italienne, puis fait place à un retour de la marche des Pèlerins. Il faut signaler dans cette partition d'une richesse déjà merveilleuse, les voluptueuses apparitions de Léda, d'Europe, accompagnées par un chœur de sirènes qui est une des trouvailles les plus magnifiques de Wagner ; au deuxième acte, au milieu du tumulte causé par le chant scandaleux de Tannhäuser, la supplication d'Élisabeth — autre page d'une inspiration sublime ; enfin au dernier acte, le récit de Tannhäuser, la prière d'Élisabeth où la clarinette basse répond à la voix de la soprano et qui, bien plus que la « romance à l'étoile » de Wolfram, mérite la célébrité.
La première eut lieu le 19 octobre 1845, et ne fut ni un triomphe, ni un échec : sept représentations. Mais l'ouvrage allait bientôt connaître le succès. Pendant l'été qui précéda cette création, Wagner, à Marienbad, conçut le sujet de Lohengrin, et celui des Maîtres chanteurs. Hésitant d'abord entre les deux, il se décida pour le Chevalier au Cygne, et composa sa partition en 1847. Le prélude fut écrit en dernier.

costumes de F. Heine pour la création de Lohengrin de Wagner au théâtre de Weimar (1850)
Maintenant le « système » a pris corps et Wagner va l'appliquer avec une aisance qui en dissimulera la rigueur. Lohengrin ne put être créé que le 23 août 1850, à Weimar, grâce au dévouement de Liszt, et Wagner n'assistait point à son triomphe — car cette fois, ce fut un éclatant succès. Compromis au cours des émeutes de Dresde en 1849, Wagner avait dû se réfugier près de Liszt qui dirigeait alors les répétitions de Tannhäuser ; ne se sentant pas en sûreté en aucun pays d'Allemagne, il gagna Paris, puis — non sans péripéties sentimentales — la Suisse, et c'est à Lucerne qu'il apprit l'accueil fait à son nouvel ouvrage. Il s'était fixé à Zurich ; mais, cherchant le calme, il était venu passer quelques jours sur les rives du lac des Quatre-Cantons, où son destin devait le ramener une quinzaine d'années plus tard pour y achever la Tétralogie de l'Anneau. Avec Lohengrin Wagner affirmait sa position et démontrait la solidité de son système. Si le livret n'offre rien de révolutionnaire, la partition rompt définitivement le moule ancien de l'opéra. Plus d'ouverture, un simple prologue. L'ouverture de Weber, celle des premiers ouvrages de Wagner offrent une sorte de résumé de l'ouvrage ; le prélude, beaucoup moins développé, n'a pour but que de créer l'atmosphère. Sauf pour les Maîtres chanteurs, Wagner n'écrira plus d'ouverture ; la forme traditionnelle est exclue du système wagnérien. Ici, le prélude est construit sur le développement d'un seul leitmotiv, le Graal, la coupe sainte qui contint le vin de la Cène et que conservent les chevaliers du Montsalvat. De même le colossal prélude de l'Anneau ne sera que l'épanouissement de l'accord de mi bémol majeur, thème du Rhin. Simplicité qui n'est pas une simplification : il faut toute l'habileté d'un Wagner pour résoudre le problème. Il n'y avait dans Tannhäuser qu'une demi-douzaine de thèmes conducteurs. Il y en a le double dans Lohengrin. Enfin le livret qui, apparemment, ne fait que conter une légende, exprime des symboles ; et les drames ultérieurs de Wagner offriront tous un sens que l'on pourrait dire ésotérique, et qui se juxtapose au sens explicite du scénario. Le rappel des thèmes aidera l'auditeur à pénétrer cette signification profonde de l'œuvre.
On s'abstiendra ici d'exposer en détail le sujet de ces ouvrages si connus, et l'on se contentera de quelques exemples. C'est bien à dessein que Wagner a choisi le thème du Graal pour en faire le prélude de Lohengrin, composé en dernier, une fois la partition complètement achevée. Lohengrin, le preux chevalier, fils de Parsifal, est un de ceux qui veillent sur le vase sacré qu'ils gardent au Montsalvat. Ils sont les défenseurs des justes lorsque la trahison ou la félonie les expose à périr, et Lohengrin est venu au secours d'Elsa de Brabant lâchement accusée d'un crime par Frédéric de Telramund et sa femme Ortrude. Il la sauvera, mais il ne doit point révéler qui il est ni d'où il vient. Et si les sombres machinations d'Ortrude et de Frédéric contraignent Elsa à questionner son sauveur, devenu son époux, c'est à ce moment, c'est dans la dernière scène de l'ouvrage, que sera dévoilé « le mystère du nom », le mystère du Graal, source de la surnaturelle puissance du chevalier au Cygne. A ce moment, lorsque devant le Tribunal du Roi, devant l'empereur d'Allemagne Henri l'Oiseleur, Lohengrin explique qui il est et d'où il vient, à ce point culminant du drame, le compositeur rassemble dans la symphonie les thèmes essentiels qui ont apparu au cours des trois actes.
A Zurich, en 1851, Wagner acheva le poème de l’Anneau du Nibelung, qu'il avait commencé par la dernière des quatre parties, la Mort de Siegfried (le Crépuscule des dieux) dans les derniers temps de son séjour à Dresde. Délaissée, reprise, interrompue pour toutes sortes de raisons et d'aventures, la partition de la Tétralogie ne devait être terminée qu'en 1874. Mais dans l'intervalle, Wagner avait écrit Tristan et les Maîtres chanteurs.
On sait quel drame intime eut pour fruit Tristan et Isolde, et pourquoi les personnages du poème tiennent sur la scène les rôles que tinrent dans la vie l'auteur et ses voisins, ses bienfaiteurs de Zurich : Tristan, c'est Wagner lui-même ; le roi Marke, c'est Otto Wesendonck, Isolde, c'est Mathilde Wesendonck. Et c'est à la transposition, à l'idéalisation d'un épisode sentimental douloureux que l'ouvrage doit son humanité profonde ; l'immense mérite de Wagner est d'avoir su élargir jusqu'au mythe l'histoire la plus banale ; c'est d'avoir revêtu d'une musique si personnelle et si neuve, si émouvante, un scénario auquel des mains moins habiles, et qui n'eussent pas été celles d'un poète, n'auraient pas su donner cette résonance dont l'écho réveille dans toutes les âmes quelque souvenir déchirant ou quelque espoir meurtri ; c'est d'avoir écrit un chef-d’œuvre sans analogue dans le passé et qui restera sans doute inimitable — car on ne voit point, après l'avoir entendu, ce qu'il serait possible d'écrire qui ne le répétât ou ne l'amoindrît.

scène de la création de Tristan et Isolde à Munich (1865)
Cette partition, pétrie de sa chair et de son sang, débute par un prélude presque aussi développé qu'une ouverture, mais dont le caractère reste essentiellement thématique. Construction d'une rigoureuse logique, et elle-même symbolique. Le premier des sept motifs qui vont y être exposés est l' « aveu » (ou « amour »), et il s'enchaîne immédiatement au « désir », puis au « regard ». Viennent après ces thèmes caractérisant des sentiments généraux, ceux qui auront pour objet d'évoquer les circonstances particulières du drame : « Le philtre d'amour » que Brangiine versera à Tristan au lieu de lui verser le « philtre de mort » que lui destinait Isolde ; le « coffret magique » d'où la suivante de la princesse d'Irlande a tiré ces breuvages, et enfin la « résolution de mourir dans l'amour » (Todesentschlusses), résolution partagée par les deux héros du drame. Voici donc un raccourci « purement humain » et l'on sait que ces deux mots résument l'esthétique de Wagner — le drame tout entier exposé dans son essence par le prélude. En même temps cette page symphonique crée l'atmosphère mystérieuse où vont se dérouler les trois actes : bien qu'ils se distinguent aisément les uns des autres, et tout autant par leur forme rythmique que par leur structure mélodique et harmonique, ces thèmes extrêmement simples et courts ont un trait commun : leur chromatisme qui est comme rehaussé par le choix des timbres auxquels Wagner les confie. Ce caractère chromatique restera celui de la partition tout entière : il a fait définir — abusivement — Tristan : une dissonance en trois actes. Boutade si l'on veut, mais il est certain que cette incertitude tonale crée exactement ce que Wagner désirait faire ressentir à l'auditeur : une sorte d'angoisse, de trouble mystérieux, où l'esprit et les sens s'égarent comme se perdent les deux protagonistes du drame à la poursuite de l'absolu.
Lavignac compte vingt-neuf thèmes conducteurs dans Tristan ; Carl Waack dans la préface de la partition chant et piano de Breitkopf et Härtel en énumère trente-deux (dont plusieurs se subdivisent eux-mêmes en fragments qui ont un sens déterminé et reparaissent isolément dans le cours de l'ouvrage, parfois avec des altérations du rythme) ; on pourrait en trouver davantage. Une telle richesse serait aisément une faiblesse ; la partition deviendrait une mosaïque, un assemblage gratuit de cellules mélodiques ou harmoniques juxtaposées si la liaison de l'une à l'autre n'était faite de main d'ouvrier ; ce travail, si parfaitement exécuté qu'il fût, n'aurait d'autre résultat que d'imposer à l'auditeur la recherche de la solution juste d'un véritable rébus sonore, s'il était indispensable de mettre un nom sur chaque motif conducteur au moment qu'on l'entend, au moment qu'on le lit sur la partition. Mais si naguère les wagnériens de stricte observance avaient appris par cœur les trente motifs de Tristan et les quelque quatre-vingt-cinq thèmes conducteurs de la Tétralogie, plus nombreux furent de tout temps, aujourd'hui surtout, les amateurs de musique capables de goûter ces ouvrages sans s'être donné la peine d'encombrer leur mémoire. En réalité — et c'est ce qui fait sa valeur, ce qui lui a conservé le pouvoir de durer malgré les changements du goût et les caprices de la mode — Wagner utilise pour la construction de ses drames un procédé qui lui réussit, mais qui n'est rien de plus qu'un instrument commode pour son génie, inefficace en d'autres mains. Ses épigones se sont chargés de démontrer le danger de s'approprier des méthodes et des formules qu'ils ont prises pour des talismans grâce auxquels il était possible de refaire ce que Wagner avait réussi. Moins heureux que l'apprenti sorcier de Goethe, ils ont été vite noyés sous un déluge sonore dont ils ne savaient se rendre maîtres.
Il n'est, en tous cas, nullement nécessaire de savoir que le long duo d'amour qui constitue la scène II du deuxième acte de Tristan fait entendre le Glückseligkeitsmotiv — la béatitude — après l' « impatience », « ardeur », puis le Liebesthema (chant d'amour), 1' « Invocation à la nuit », dite encore « Nuit libératrice », ou « Rêve d'amour » (Liebestraum harmonien) — et ces variations de la nomenclature sont bien la preuve de la laxité du sens strictement musical des thèmes, ils montrent l'inutilité de traduire par des mots, et d'étiqueter comme les fleurs desséchées d'un herbier ces harmonies vivantes. Les thèmes sont expressifs, et très suffisamment pour que la « mélodie continue » qui les enchaîne les uns aux autres traduise les sentiments des personnages et les situations du drame, et nul ne se trompera, au troisième acte, sur ce que dit aussi clairement que s'il articulait des paroles, le navrant solo de cor anglais, sur ce que signifie la progression haletante du dernier chant d'Isolde.
C'est à Paris que Wagner acheva le poème des Maîtres chanteurs en 1862, et la partition fut terminée deux ans plus tard. La première exécution eut lieu à Munich en juin 1868. Malgré ses dimensions, malgré l'ampleur des moyens musicaux, l'ouvrage garde le caractère d'une comédie musicale, pleine de vie et de gaieté, mais où passent des ombres de mélancolie : l'histoire de Hans Sachs c'est un peu, c'est beaucoup, l'histoire de Wagner lui-même, et c'est lui encore qui est Walther de Stolzing. Tristan, c'était la blessure de l'amour que la musique apaise sans la fermer ; les Maîtres, c'est la sensibilité de l'artiste, du novateur en butte à la routine et qui triomphe de la coalition des impuissants. Wagner se soulage par une satire et crée le personnage de Beckmesser, le greffier venimeux et jaloux, essayant lâchement de barrer le chemin au poète hardi Walther ; et dans le personnage de Sachs, il met à la fois une sérénité qui ne fut jamais sienne et ne le sera jamais, et son enthousiasme et sa confiance dans « l'art allemand » qui ne doit pas mourir — parce qu'il est là, lui, Wagner, pour le renouveler et le faire refleurir. Tel est le sens profond des Maîtres.

Delmas et Lucienne Bréval dans les Maîtres Chanteurs
Ici, l'ouverture, très développée, est à la fois un exposé de cinq leitmotive essentiels, et un résumé de la pièce : le large 4/4 avec ses accords parfaits solennels d'ut majeur, son rythme pesant, c'est le thème des Maîtres chanteurs dont les principes inébranlables sont fixés dans la Tablature, comme la Loi sur les douze tables d'airain des décemvirs ; un court épisode, quatorze mesures, fait passer le frisson de 1' « Amour naissant » à travers l'orchestre, après un trille, et c'est la flûte qui expose ce motif ; les trompettes, les trombones et les timbales attaquent ensuite le thème de « la Bannière » de la corporation, très proche du motif des Maîtres, auquel il restera presque toujours associé ; puis, violons et hautbois semblent poser une question à laquelle répondent les premiers violons par « la déclaration d'amour » qui parcourra tout l'ouvrage et servira pour le chant de maîtrise de Walther au dernier acte. Enfin pour conclure ce motif, apparaît l' « ardeur impatiente » du jeune gentilhomme qui se résignera à affronter les sévérités et la malveillance des maîtres jaloux afin d'obtenir la récompense promise au lauréat : la main d'Éva, fille de l'orfèvre et maitre chanteur Pogner, bourgeois de Nuremberg.
Le personnage de Beckmesser est caractérisé par un motif sautillant, brusque et saccadé, plein de dissonances, qui le peint fort exactement ; Sachs, au contraire, par une phrase large, affectueuse. Aucune partition de Wagner n'est plus artistement ouvrée. Le début du deuxième acte, lorsque, après le couvre-feu, Sachs installe son établi devant sa porte et se laisse envahir par une rêverie mélancolique, est d'une poésie intense, avec laquelle contrastent bientôt la burlesque sérénade de Beckmesser et le tumulte joyeux qui la suit, étourdissant charivari d'une exécution extraordinairement habile. Le prélude du troisième, où le violoncelle prolonge la méditation de Sachs, le finale sur la prairie qui borde la Pegnitz, où se rassemblent les corporations, le concours et le triomphe de Walther suivant le ridicule échec de Beckmesser, l'émotion qui se dégage de cette conclusion puissante et familière, font des Maîtres chanteurs une œuvre telle qu'il n'en existe aucune autre dans le répertoire lyrique.

Félia Litvinne, qui interpréta de nombreux rôles de Wagner
Avec l'Anneau du Nibelung, Wagner entendait enrichir l'art allemand d'un ouvrage réalisant l'objet même de sa « réforme » : opérer la synthèse dans le drame de la poésie et de la musique, faire du théâtre un art total, unissant en lui seul tous les arts du rythme. La musique est le complément de la poésie : si le lyrisme à de certains moments, domine, la parole s'efface devant la symphonie, sans que les voix s'éteignent nécessairement : elles sont alors comme des instruments mêlés à ceux de l'orchestre. D'où la nécessité pour le « poète-musicien » (et c'est ce qu'il veut être), de choisir des sujets ne s'adressant point seulement à l'entendement, mais à l'émotion, des sujets où tout est symbole, où les personnages eux-mêmes sont des symboles vivants. S'inspirant librement du vieux poème héroïque des Nibelungen, il l'interprète en le chargeant d'un sens philosophique qui vient en droite ligne du pessimisme de Schopenhauer. A travers le prologue et les trois journées de l'Anneau du Nibelung, c'est la résignation désespérée du philosophe qui s'exprime : l'homme tentera de racheter la faute des dieux, et apercevra comme eux que l'aspiration au non-être est la seule guérison aux misères de la vie.
A ce drame démesuré, il fallait un prélude colossal : on a dit déjà (p. 141) comment le développement du thème du Rhin sert de portique au prologue. L'Or du Rhin ne comprend qu'un seul acte, divisé en trois scènes. Chacune des trois autres journées — la Walkyrie, Siegfried et le Crépuscule des dieux, aura trois actes, auxquels un prologue s'ajoutera pour la dernière. Ouvrage démesuré, qu'il est impossible de résumer en quelques lignes, et trop connu d'ailleurs pour qu'il soit besoin d'entrer dans le détail. Il suffit d'en marquer l'essentiel. Les défauts d'abord — car si grand que soit le respect commandé par un tel ouvrage, si vive que reste l'admiration qu'il inspire, on ne peut demeurer insensible à ses longueurs, à l'obscurité de maints passages, à ce fait, surtout, que l'auteur s'est trouvé, comme il arrive souvent, entraîné à des explications qu'il jugea nécessaires et qui ne font qu'embrouiller davantage des situations arbitraires et confuses. Un auteur doit se faire oublier ; Wagner reste toujours présent, ou du moins trop souvent. Les beautés de la partition demeurent presque toujours assez magnifiques pour faire passer sur ces défauts. Wagner s'y révèle lui-même un colosse, cela est certain, et point inférieur à la tâche titanesque qu'il s'est fixée. La première scène de l'Or du Rhin, le finale de ce prologue, le premier acte de la Walkyrie, la scène de Brunehilde et de Sigmund au deuxième, la scène finale du troisième acte, Siegfried presque tout entier, le premier tableau du Crépuscule des dieux, une bonne partie du deuxième acte, et le troisième tout entier, sont parmi les pages maîtresses qu'il a laissées. Il y atteint les plus hauts sommets de l'art. Mais cet art exige des interprètes des moyens physiques quasi surhumains, et ceci encore est une faiblesse : elle le condamne à ne rencontrer qu'exceptionnellement les conditions dans lesquelles il peut être jugé comme il doit l'être. Réunir sur le plateau d'un théâtre des chanteurs possédant les voix amples, l'aspect physique qui rende tolérables leurs personnages athlétiques, pose des problèmes insolubles. L'effort exigé de l'orchestre et de son chef est tout aussi lourd, sinon plus que celui que doit fournir le plateau. A cet ouvrage hors des normes de la scène, il faut un théâtre fait pour lui. Bayreuth fut construit dans ce dessein. Hors de Bayreuth, et parfois même à Bayreuth, l'Anneau du Nibelung risque d'être trahi. N'y a-t-il point contradiction entre le vœu de Wagner : doter l'art allemand d'ouvrages qui devaient le régénérer, et le fait que ces ouvrages exigent des moyens matériels inusités, qui en font des œuvres d'exception ? Certes leur valeur spirituelle est considérable, mais bien moins efficace que si la forme extérieure, l'appareil scénique, eussent été plus simples, les livrets moins compliqués, les textes moins brumeux. La mythologie wagnérienne nébuleuse, le luxe des machines dont elle s'entoure, tout ce qui est moyens de théâtre et alourdit l'œuvre, appelait une réaction et faisait souhaiter le retour à un art plus dépouillé, ramené aux proportions humaines, et qui ne devrait sa grandeur qu'à son pouvoir de s'adresser directement à l'esprit en émouvant les cœurs.
Parsifal, tout en exigeant encore un grand déploiement de moyens scéniques, se rapproche bien plus que le Ring des conditions normales du théâtre lyrique. Le symbole est clair, plus qu'en aucun autre ouvrage de Wagner. Il s'agit encore de la rédemption par l'amour, mais ici l'amour s'élargit et se purifie, c'est l'amour au sens chrétien du mot, c'est la charité. L'instrument de la rédemption d'Amfortas, élu pour opérer le miracle, est Parsifal, die reine Thor, « le chaste Fol ». Et c'est parce que le Simple conserve un cœur pur, une âme qui devient « consciente par la pitié » qu'il réussit à rendre aux chevaliers du Graal la lance sainte dérobée par l'artifice de Klingsor, qu'il peut triompher des pièges tendus à ses sens par les Filles-Fleurs des jardins enchantés ; il y a une sorte de gradation par laquelle s'explique, d'acte en acte, cette ascension d'une âme vers la plénitude : le premier degré l'élève par la révélation de la souffrance qui fait naître en elle la pitié ; le second lui donne conscience de ce que la pitié doit être agissante ; le troisième enfin achève l'acte rédempteur parce qu'elle a maintenant pleine notion du devoir qu'il faut accomplir jusqu'au bout. Comme s'opposaient dans l'Anneau les Nibelungen souterrains aux dieux du Walhall lumineux, Klingsor et Kundry, l'enchanteur et l'impure, s'opposent à Parsifal. Mais celui-là sera la propre victime de ses maléfices, et celle-ci sera sauvée parce que, prenant conscience du mal qu'elle a fait, elle a brûlé du désir de l'expier. A trente ans de distance, Wagner retrouve en elle un autre Tannhäuser.

décor de Joukovsky pour la création de Parsifal de Wagner (acte III, scène 1) à Bayreuth, 1882
Le prélude résume le drame tout en créant l'atmosphère mystique où il évoluera, par le simple exposé des quatre thèmes essentiels : la Cène, le Graal, la Foi, la Lance. La lenteur du mouvement, sa reprise en mineur qui en accentue le caractère douloureux, de longs silences espaçant ces reprises, tout concourt à faire de ce motif de la Cène le symbole purificateur susceptible de mettre l'auditeur en état de grâce au seuil du temple où il va pénétrer. Puis il entend la promesse de la rédemption que formule le thème du Graal ; vient ensuite, et sans quitter le ton de la bémol, le motif de la Foi, net et fort, hautement proclamé par les cuivres ; enfin les quatre notes incisives, pénétrantes de Lance qui blessa jadis le flanc de Jésus sur la croix.
A deux reprises, au second tableau du premier acte et au finale du troisième, l'office du Graal est célébré. Un chœur invisible d'enfants, la première fois, annonce la venue du Simple pur qui mettra fin aux souffrances d'Amfortas ; au dernier, lorsque Parsifal, ayant touché de la lance sainte la blessure d'Amfortas et que la colombe céleste descend de la coupole, un chœur élève vers le Créateur l'alleluia des chevaliers en extase. Mais les paroles de ce chœur restent énigmatiques : Erlösung dem Erlöser « Rédemption au Rédempteur ! »
Ainsi, des Fées à Parsifal, Wagner accomplit son destin. Son énergie surhumaine, sa volonté de mener à bien la tâche entreprise : la réforme de l'art lyrique, triompha de tous les obstacles. Qu'il ait réussi ou échoué, peu importe : l'essentiel est qu'il ait laissé des œuvres durables. Nietzsche lui-même, qui, violemment, s'attaqua au colosse et s'efforça de montrer le péril où le wagnérisme entraînait la musique, a reconnu la grandeur de l'idole qu'il voulait abattre. « Malgré tout, il faut commencer par être wagnérien », a-t-il dit. C'est parce qu'il avait « commencé » par être wagnérien, et fanatique même, que Debussy a su rompre le charme et exorciser son art en se désenchantant lui-même. L'histoire est faite de ces réactions ; et Wagner fut assez clairvoyant pour recommander à ceux qui viendraient après lui de ne pas l'imiter.


à gauche : le ténor Ernest Van Dyck (1861-1923) dans Parsifal (Bayreuth, 1899 ) - à droite : le ténor Paul Franz dans Parsifal (reprise à Paris, 1914)
LES ÉCOLES NATIONALES AU XIXe SIÈCLE ET AU
DÉBUT DU XXe
I
A l’historien de la musique, la seconde moitié du XIXe siècle apparaît sous un aspect confus : Wagner grandit ; d'abord contesté, combattu, son influence finit par s'étendre si vite et si loin, qu'au moment de sa mort, survenue le 13 février 1883, elle s'exerce universellement. Le goût du bel canto persiste cependant en France comme en Italie ; mais beaucoup de compositeurs comprennent que la mélodie n'est pas tout l'art lyrique. Et, comme on assiste après 1870 à une véritable renaissance de la musique pure — musique de chambre et symphonique — le théâtre en subit les heureux effets.
Ceci ne va point cependant sans mécontenter les attardés. Pour certains critiques, traiter de « symphoniste » un compositeur d'opéras, c'est lui reprocher de ne rien entendre au théâtre : « Il me souvient, dit Saint-Saëns, des lances que j'ai rompues pour Galathée, notamment, avec les musiciens d'orchestre ; et comme je cherchais à connaître les causes de leur hostilité, je finis par découvrir cette chose affreuse : l'auteur, à maintes pages de sa partition, avait divisé les altos ! » Il était naturel que ceux pour qui la musique de Gounod, dans Faust, « planait dans les régions inaccessibles à l'intelligence des profanes (*) », ceux qui lui reprochaient « son goût pour les derniers quatuors de Beethoven, source troublée d'où sont sortis les mauvais musiciens de l'Allemagne moderne, les Liszt, les Wagner, les Schumann (**) » reprochassent pareillement à Victor Massé les « complications inutiles » de son instrumentation. C'est que Victor Massé (1822-1884), oublié aujourd'hui, fut pourtant un de ceux qui travaillèrent à transformer l'art lyrique en cessant de regarder comme négligeables les accompagnements. Les Noces de Jeannette (1853) sont presque aussi démodées aujourd'hui que Galathée ou la Reine Topaze. Elles ont longtemps charmé les cœurs sensibles, et l'Opéra-Comique les conserva au répertoire jusqu'à ces dernières années. Leur grâce bon enfant, un peu triviale, nous révèle le goût de la bourgeoisie du milieu du siècle. Les défauts de Victor Massé n'empêchent point qu'il ait fait preuve d'un souci d'écrire moins platement qu'il n'était d'usage en son temps.
(*) Dans un article du Guide musical du 28 février 1861, cité par Combarieu (Histoire de la Musique, t. III, p. 371), qui rapporte d'autres jugements aussi singuliers.
(**) Scudo, dans la Revue des Deux Mondes, 15 mars 1862.
D'une tout autre classe est Charles Gounod (1818-1893). Il a rendu à l'art lyrique français l'immense service de le libérer des influences étrangères, et particulièrement de Meyerbeer. Esprit clair, doué d'une sensibilité extrême, musicien savant, inventeur de mélodies pleines de charme, l'auteur de ce Faust qui, en moins d'un siècle, a été joué plus de deux mille cinq cents fois à l'Opéra devant des salles combles, a cependant été regardé comme un compositeur à qui « manquait le sens du théâtre ». Quand on lit les critiques consacrées à ses ouvrages en leur nouveauté, on croit rêver. La plupart reprochent à ce musicien si français, d'écrire une musique « allemande » ; s'il est vrai que Gounod admirait Bach — et cela se voit dans le sévère prélude de Faust — le caractère le plus net de son génie très divers est d'être si personnel qu'il suffit d'une phrase ou d'un thème pour le reconnaître immédiatement et sans erreur possible.
Il a écrit quatorze opéras ; mais il est regrettable que sa musique religieuse et sa musique symphonique soient aujourd'hui trop négligées : elles contiennent des pages qui les auraient certainement préservées de cet abandon, si les œuvres lyriques ne les avaient éclipsées. Il y aurait de même beaucoup à retenir dans les premières pièces de Gounod : il y a dans Sapho (1851), de fort beaux chœurs, et la cantilène que chante l'héroïne, au deuxième acte, accompagnée par un chœur de femmes, annonce déjà les plus heureuses trouvailles de Gounod. Mais Sapho n'eut qu'un succès médiocre, et l'année suivante la musique de scène pour la tragédie de Ponsard, Ulysse, représentée au Théâtre-Français, n'en put empêcher la chute. Elle vaut cependant par la simplicité des moyens avec lesquels Gounod, sans nul emprunt aux modes grecs, suggère (c'est le mot qui convient) l'antiquité. Elle vaut par cette même qualité des chœurs, par les trouvailles harmoniques, par le soin de l'instrumentation. La Nonne sanglante, sur un livret de Scribe et Casimir Delavigne, n'eut en 1854 que onze représentations à l'Opéra et il fallut que le compositeur attendit le 15 janvier 1858 pour remporter avec le Médecin malgré lui au Théâtre-Lyrique son premier succès, non point encore éclatant ; l'ouvrage faisait dire à Saint-Saëns qu'il avait fallu, pour l'écrire « ramasser la plume de Mozart ». Jugement exact : dans la farce, Gounod garde une distinction qui n'en diminue point la drôlerie et qui en rehausse l'esprit. Le pastiche de Lully en certaines scènes est une réussite étonnante ; mais le sextuor de la consultation est un chef-d'œuvre. Les récentes reprises du Médecin ont montré la vitalité de cet ouvrage.
Il avait cependant été composé impromptu, parce que la partition de Faust, presque achevée, dut attendre qu'un autre Faust, joué sur une scène dramatique, cessât une concurrence redoutée par Carvalho. Le 19 mars 1859, Faust commença sa carrière au Théâtre-Lyrique de la place du Châtelet (aujourd'hui Théâtre Sarah-Bernhardt). Le public ne lui fit point un accueil enthousiaste, et, comme on l'a vu, la critique se montra rétive. Cependant le succès se dessina bientôt, et alla grandissant. En 1869, Faust entrait au répertoire de l'Opéra avec des récitatifs remplaçant le dialogue parlé.

décor de Cambon pour Faust de Gounod (acte I, scène 1) (reprise à l'Opéra de Paris, 1869)
Il serait oiseux de s'étendre sur un ouvrage aussi connu. L'habileté des librettistes Jules Barbier et Michel Carré, et plus encore celle de Gounod, fut de ne prendre dans Goethe que les scènes « musicables », scènes souvent épisodiques dans le drame, mais dont le choix, comme le dit Riemann, ne défigure, ni moins encore ne trahit l'original. L'union du fantastique et du réel trouvait en Gounod le musicien le mieux préparé à la traduire. Dans l'ouverture, digne de J.-S. Bach, Gounod donnait la mesure de sa valeur : cette page symphonique est une des plus belles, des plus savantes, mais aussi des plus douloureusement humaines qu'un musicien ait écrites pour le théâtre. Hélas ! Elle est condamnée à ne jamais être jouée que dans le bruit que font les retardataires, exécrable engeance.
La partition de Faust demeure un modèle d'élégance : elle vaut par la perfection de l'écriture, par la qualité de la mélodie ; par la nouveauté et la hardiesse de l'harmonie, par les trouvailles de l'orchestration. Elle n'offre aucun signe de vieillissement au bout d'un siècle parce que tout y est mesure et vérité, parce que chaque détail est traité sobrement, parce que la musique fait oublier les quelques faiblesses du livret. Gounod a de la vigueur où il en faut, de la grâce où elle doit paraître. L'acte du jardin reste un chef-d’œuvre de poésie, comme la scène de l'église est un chef-d’œuvre d'émotion dramatique. La couleur de chaque épisode est variée et cependant l'unité de l'œuvre est complète : tout s'y tient, tout s'enchaîne sans longueurs ni disparates. Nous en jugeons mal aujourd'hui parce que l'ouvrage nous est trop familier ; aucun autre n'a été aussi souvent défiguré, avili : Faust est victime de son extraordinaire popularité ; et cependant chaque fois qu'on l'entend on éprouve le même sentiment d'admiration pour l'originalité d'une partition qui surprit les premiers auditeurs, mal préparés par le répertoire du temps, à en goûter la nouveauté. Gounod leur parlait un langage qui lui appartient en propre, et c'est ce langage qui a sauvé l'art lyrique français.
Si la réussite de Faust n'avait été si complète, on aurait été moins injuste envers Philémon et Baucis (Opéra, 18 février 1860) et la Reine de Saba (Opéra, 28 février 1862). Avec Mireille (Théâtre-Lyrique, 19 mars 1864) Gounod retrouvait un sujet mieux en accord avec son tempérament. Il alla chercher près de Mistral l'inspiration de sa musique en respirant l'air de Provence. Les lettres qu'il écrivit durant son séjour le montrent s'imprégnant, si l'on peut dire, de cette nature lumineuse et parfumée. « Si je ne me trompe pas, je n'ai pas encore eu une possession aussi tranquille de ce que j'écris. L'instrumentation elle-même me paraît se présenter avec précision et clarté. Je tâche d'entendre tout ce qu'il faut, et de n'écrire que ce que j'entends ; et, dans la paix où je suis, il me semble que j'ai l'oreille meilleure et plus sûre (*). »
(*) Camille BELLAIGUE, Gounod (Alcan, collection des Maîtres de la Musique, p. 103).

scène de la création de Mireille de Gounod (1864) ; acte II, scène 10 : les arènes d'Arles
La partition de Mireille doit ses qualités à cette communion de l'auteur avec la nature. On l'a beaucoup discutée, dès la création. On a dit qu'elle manquait de vigueur et de relief. Des reproches qu'on lui fit, un seul paraît justifié : c'est de n'avoir pas conservé dans sa naïveté exquise la cantilène O Magali, ma tant amado, et d'en avoir fait un duo. Et s'il est vrai que le chœur des magnanarelles au début du premier acte manque quelque peu de couleur, que de pages au contraire sont dignes de l'auteur de Faust ! Mais Mireille devait connaître au théâtre un singulier destin : après quarante et une représentations au Théâtre-Lyrique, où déjà, pour complaire à Mme Carvalho, Gounod avait accepté d'ajouter une valse chantée au premier acte, puis de modifier le dénouement pour que Mireille pût épouser Vincent — ce qui ôtait tout sens à l'ouvrage et en détruisait la poésie — la pièce fut reprise à l'Opéra-Comique en 1889. Là ce fut pire ; amputée de deux actes indispensables non seulement à l'action dramatique, mais à l'équilibre de la partition, Mireille y fit cependant une heureuse carrière. Il fallut la patiente sagacité de Reynaldo Hahn et d'Henry Büsser pour que l’œuvre, reconstituée dans sa forme première, pût être jouée en 1938 telle qu'elle n'aurait jamais dû cesser de paraître, avec l'acte du Rhône et l'acte de la Crau, qui sont précisément parmi les mieux réussis de l'ouvrage. Hélas, sur maints théâtres, Mireille ressuscitée, un cortège de noces villageoises demeure substitué au finale si sobrement dramatique voulu par Mistral et si bien compris par son musicien.
Écrit, comme Mireille, en Provence, Roméo et Juliette fut créé au Théâtre-Lyrique le 27 avril 1867. On a dit de Gounod qu'il était le « musicien de l'amour » ; et c'est peut-être plus encore dans Roméo et Juliette que dans Faust qu'il le fut : la partition renferme quatre duos. Si les premiers sont tels qu'on les pouvait attendre, le dernier semble résumer à lui seul tout l'art de Gounod ; il s'élève ici jusqu'au pathétique le plus déchirant, mais aussi le plus sobre, le plus humain. Gageure surprenante que cette progression sans précédent dans tout le théâtre lyrique et qui monte de la déclaration en forme de madrigal du premier acte, aux aveux du second puis à la scène passionnée du troisième pour aboutir à ce duo suprême dans la scène du tombeau. Pas plus qu'il n'avait trahi Goethe, Gounod ne trahit Shakespeare. Et si la ballade de Mercutio ne peut se comparer avec le scherzo de la Reine Mab, dans la symphonie dramatique de Berlioz, du moins est-ce encore une réussite, comme l'est aussi la chanson du page Stefano : « Gardez bien la belle », comme l'est la scène du duel qui la suit.
Pas plus que la Colombe, créée d'abord à Baden-Baden en 1860, puis donnée à l'Opéra-Comique en 1866, Cinq-Mars (Opéra-Comique, 1877) et le Tribut de Zamora (1er avril 1881, Opéra), Polyeucte (Opéra, 7 octobre 1878) n'eurent de succès. Ce dernier ouvrage, inégal, contient cependant de fort belles choses : l'invocation à Vesta, le chœur nocturne des lemmes, la lecture de l'Évangile faite à Pauline par Polyeucte dans la prison. Elles n'ont pas suffi à maintenir Polyeucte au répertoire ; on le regrette lorsqu'on les écoute. On conte ce mot de Saint-Saëns, lorsqu'il entendit la barcarolle de Sextus : « Si vous entourez le paganisme de telles séductions, quelle figure fera près de lui le christianisme ? — Je ne peux cependant pas lui ôter ses armes ! » répliqua Gounod. Cet équilibre assure la survie de ses chefs-d’œuvre : ils offrent bien plus que le reflet de la sensibilité d'une époque, ce qu'il y a de plus séduisant dans l'art français. On a pu s'y tromper, prendre cette séduction pour un désir immodéré de plaire ; ce n'est aucunement cela, pas plus chez Gounod que chez Mozart. Il se montre tel qu'il fut, et pour le bien juger, il faut tenir compte de l'époque où il donnait au théâtre Faust et Roméo, comparer ces ouvrages avec ceux des musiciens de son temps, ceux d'Ambroise Thomas, par exemple. On cite ce mot de Gounod : « Quand j'arriverai au Paradis — si j'y arrive — je saluerai d'abord Dieu, puis je demanderai : où est Mozart ? » Si au paradis comme aux Champs-Élysées des Anciens, les morts accueillent les morts, on peut être assuré que Mozart ouvrit les bras à Charles Gounod.

coupe longitudinale de l'Opéra de Garnier à Paris [d'après un dessin de K. Fichot et H. Meyer]

travaux pendant la construction de l'Opéra de Garnier
Georges Bizet n'a vécu que trente-sept ans, du 25 octobre 1838 au 3 juin 1875 ; il n'a donné au théâtre que quatre ou cinq ouvrages ; il est cependant un des compositeurs qui, le plus largement, contribuèrent à la gloire et au rayonnement de la musique française : Carmen partage avec Faust le privilège d'avoir conquis le monde entier et de demeurer l'une des œuvres les plus souvent jouées aujourd'hui en tous lieux. Musicien-né, merveilleux pianiste, prix de Rome à dix-neuf ans, auteur à cet âge d'une Symphonie en ut que l'on crut perdue durant soixante-dix ans et qui, retrouvée par miracle, sert de partition à l'un des ballets les plus réussis du répertoire de l'Opéra, Bizet avait, avant même d'être couronné par l'Institut, remporté, ex-æquo avec Charles Lecocq, le premier prix au concours d'opérettes institué par Offenbach. L'ouvrage portait le titre de le Docteur Miracle. Il a été donné récemment à un exercice d'élèves du Conservatoire et on a pu constater que le jeune musicien y révélait ses dons pour le théâtre. Un de ses envois de Rome est aussi un opéra bouffe, Don Procopio, dont le manuscrit longtemps égaré fut découvert en 1906 parmi les papiers qu'Auber avait déposés chez un banquier, et créé aussitôt à Monte-Carlo avec un succès point seulement dû à la curiosité. Il y avait chez Bizet un sens de l'humour très vif : certains couplets dans le Docteur Miracle font songer au Chabrier de l'Étoile qui est postérieure de vingt ans.
Sur le livret fort conventionnel de Carré et Cormon, Bizet composa les Pêcheurs de Perles (Théâtre-Lyrique, 1863). La partition est inégale et brillante : elle souffre de la médiocrité du livret. Les deux duos du ténor et du baryton (Nadir et Zurga), du soprano et du ténor, la cavatine de Leïla, sont célèbres, et l'instrumentation est remarquable. La Jolie Fille de Perth (1867, au même théâtre) et Djamileh (1872, à l'Opéra-Comique), ont, sans grand dommage, disparu du répertoire. Mais cette même année 1872, la musique de scène écrite pour l'Arlésienne d'Alphonse Daudet, bien qu'elle passât inaperçue dans la chute du drame, devait plus tard en assurer le succès, prolongé en d'innombrables reprises. La sûreté du commentaire musical, sa justesse, l'émotion profonde qu'il dégage, en font un chef-d’œuvre et malgré le risque de dispersion que lui faisait courir sa fragmentation en vingt-sept numéros, la partition est au contraire très cohérente, sans faiblesse ni banalité.
Le 3 mars 1875, Carmen parut à l'Opéra-Comique, et donna le signal d'une des révolutions les plus profondes qui se soient produites dans l'histoire du théâtre. Carmen imposait le réalisme dans le sanctuaire du conventionnel. En vain Meilhac et Halévy, librettistes prudents, s'étaient appliqués à affadir la nouvelle de Mérimée ; en vain, sacrifiant aux usages, avaient-ils introduit dans leur livret, en contrepartie de la gitane qui compte « ses amants à la douzaine », l'inopportune, l'ennuyeuse Micaëla et l'avantageux toréador d'opéra-comique, pour qu'il y eût au second acte un air de bravoure ; Bizet, par le sortilège de sa musique, allait rendre à Carmen son vrai visage de fille passionnée, en faire la créature de sang et de volupté pour qui rien ne compte hormis son caprice, hormis le plaisir de soumettre l'orgueil du mâle en l'abaissant jusqu'au déshonneur et jusqu'au crime. Commentaire d'un livret trop pâle, la musique de Carmen brûle de tous les feux du soleil d'Espagne. Des harmonies inattendues, hardies, colorent chaudement une mélodie dont les inflexions troublent les sens, comme le déhanchement lascif et les œillades provocantes de la gitanella. Un tel ouvrage ne pouvait que choquer un public habitué à des spectacles moins capiteux. Le succès fut médiocre au début ; il alla se fortifiant ; mais Bizet, découragé par l'absurdité presque unanime de la critique, mourut incertain de son avenir. Pourtant le succès s'affirma tant qu'il franchit frontières et océans et que Carmen prit place auprès de Faust dans le répertoire international, au premier rang des ouvrages français. Et lorsque Nietzsche voulut marquer le crépuscule de l'astre de Bayreuth, c'est la montée à l'horizon de cette « lumière méditerranéenne » répandue par Carmen qui lui parut en avoir donné le signal (*).
(*) Cf. la remarquable étude d'Henry MALHERBE, Carmen, Paris, Albin Michel, 1951).

Célestine Galli-Marié, créatrice du rôle de Carmen dans l'opéra de Bizet (1875)
Cette lumière, on en retrouve chez Reyer un reflet moins éclatant sans doute, parce qu'Ernest Reyer (1823-1909), musicien presque autodidacte, n'est pas un génie comparable à Bizet, mais quand même un compositeur qui posséda au plus haut point le don rare de l'invention mélodique. Il fut de mode, il y a peu, de le rabaisser excessivement, parce qu'en 1872 il écrivit Sigurd sans connaître — et pour cause — la tétralogie wagnérienne, et qu'il eut le malheur d'attendre 1884 pour que son drame lyrique parût à la Monnaie, et 1886 pour le voir entrer à l'Opéra. Mais il y avait déjà dans Maître Wolfram, dès 1854, dans la Statue (1861), dans Érostrate (Baden-Baden, 1862, Paris, 1871), maintes preuves de l'originalité de son talent (ou de son génie, si l'on se souvient de ce mot d'un de ses confrères, beaucoup plus vrai que celui-ci ne le croyait : « Reyer n'a pas de talent, il n'a que du génie. »). Il est sûr que peu de musiciens ont eu autant qu'Ernest Reyer le sentiment de la nature, le don poétique de trouver dans la mélodie la résonance profonde d'une situation dramatique. Flaubert l'avait choisi pour Salammbô. Il sut en rendre avec un rare bonheur l'atmosphère troublante, le charme lunaire, et sa partition contient des pages comme l'invocation à Tanit, au second tableau, et la scène entre Shahabarim et Salammbô qui sont d'un grand musicien de théâtre.
Si Camille Saint-Saëns (1835-1921) possède d'autres titres à la gloire, si la Symphonie avec orgue et les Concertos de piano en constituent les meilleurs, Samson et Dalila n'en reste pas moins un des chefs-d’œuvre de l'art lyrique. On lui doit une quinzaine d'opéras, un ballet (Javotte, 1896), et de nombreuses musiques de scène. Samson et Dalila qui devait être d'abord un oratorio, fut conçu et même ébauché dès 1859, donné sous cette forme à Bruxelles en 1872, créé en opéra à Weimar, grâce à Liszt, en 1877 et attendit le 3 mars 1890 pour être représenté en France, à Rouen, et le 23 novembre 1892 à l'Opéra. Saint-Saëns avait fait ses débuts à la scène avec la Princesse Jaune (Opéra-Comique, 1872), et le Timbre d'Argent (Théâtre-Lyrique, 1877) ; l'ouverture du premier de ces ouvrages, avec ses fraîches couleurs d'Orient conventionnel, une romance du second, les sauvent de l'oubli. Samson et Dalila garde de sa forme première une immobilité qui convient mieux à l'oratorio qu'au drame, mais la qualité de la musique, d'un bout à l'autre, reste sans faiblesse. Sans doute est-ce parer gratuitement Dalila d'une vertu patriotique que le Livre des Juges ne reconnaît point à la courtisane qui trahit Samson par simple appétit de lucre, et c'est une erreur aussi grave d'en faire une prêtresse de Dagon ; mais la valeur de la partition n'en est point altérée, et les plus belles pages, le chœur des vieillards, l'entrée de Dalila, le chœur qui l'accompagne, le troisième tableau tout entier où Samson tourne la meule en maudissant sa faute, la bacchanale et la dernière scène, atteignent une grandeur que Saint-Saëns ne retrouvera plus dans ses autres opéras. Étienne Marcel (quatre actes sur un livret de Louis Gallet) fut représenté à Lyon le 8 février 1879. Saint-Saëns, naguère encore wagnérien convaincu, revenait avec cet ouvrage au genre historique. La partition est un compromis, pas toujours heureux, entre le système de Wagner et la forme de Meyerbeer, plus voisin de celle-ci que de celui-là. L'évolution s'accentue avec Henry VIII, livret de Détroyat et Armand Silvestre, créé à l'Opéra le 5 mars 1883. Sujet pathétique, où, sans trop solliciter l'histoire, le conflit sentimental qui aura pour conséquence la séparation de l'Angleterre et de l'Église romaine, est habilement traité. Ce qui est remarquable ici, c'est la progression des sentiments marquée par la musique : la passion d'Henry pour Anne de Boleyn, le désespoir de Catherine d'Aragon, l'inquiétude d'Anne à la pensée que la reine possède une lettre de Gomez de Feria contenant des serments d'amour, enfin la scène finale où Catherine, mourante, brûle la lettre compromettante que le roi, en présence d'Anne, veut lui arracher. Ce pathétique assez sobre est parfois gâté par quelque complaisance aux effets dans les airs du roi.
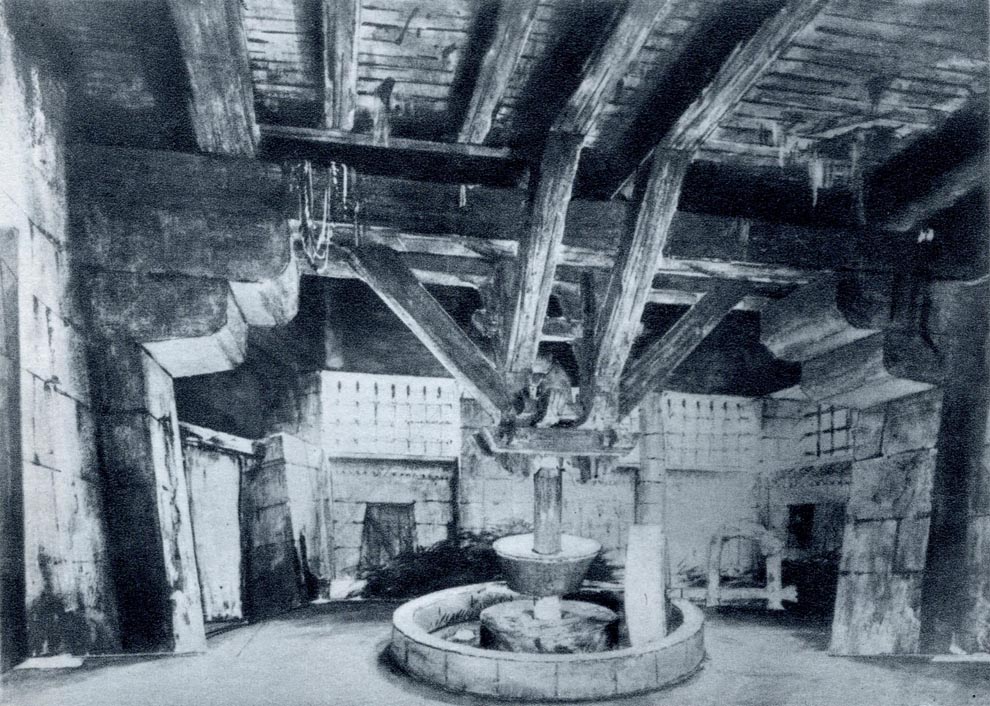
décor de Carpezat pour Samson et Dalila de Saint-Saëns (1892) ; acte III, 1er tableau
Le 16 mars 1887, l'Opéra-Comique donnait Proserpine, dont Louis Gallet fait une courtisane italienne du XVIe siècle que la jalousie pousse au crime, mais dont le dieu du théâtre fait la victime du guet-apens qu'elle a tendu à la fiancée de son amant. Le troisième acte, où dans la tempête, Proserpine invoque la déesse des enfers, est d'une violence qui s'oppose à la douceur angélique du tableau précédent, où après un remarquable solo de cor, Sabattino, le héros du drame, vient au couvent chercher sa fiancée. Mais l'œuvre est inégale. Quelques semaines après sa création, l'incendie de l'Opéra-Comique arrêtait sa carrière. Ascanio (Opéra, 21 mars 1890), sur le livret de Louis Gallet, aggravant les défauts de l'opéra historique, enchevêtre les épisodes et reste d'une froideur tout académique. Le ballet, seul, a survécu. Phryné (Opéra-Comique, 24 mai 1893), est au contraire une réussite complète, malgré le livret assez plat d'Augé de Lassus. Saint-Saëns y donne libre cours à sa verve, à cet esprit de blague qui fait la saveur du Carnaval des Animaux et qui semble, en dépit d'une perfection parfois laborieuse de la forme, s'épanouir librement dans l'opérette. Messager en orchestra le premier acte, et Saint-Saëns se plut à reconnaître avec quelle grâce. Charmante aussi la partition de Javotte (Lyon, 1896), où le compositeur s'est souvenu de Delibes. Avec Déjanire, donnée d'abord aux arènes de Béziers en 1898, puis reprise après transformation en opéra à Monte-Carlo en 1900, Saint-Saëns inaugurait la série des pièces qu'il allait donner dans la principauté : Hélène (1903), l'Ancêtre (1905). Mais ce fut l'Opéra qui créa les Barbares, le 23 octobre 1901. L'ouvrage n'a rien ajouté à la gloire de Saint-Saëns : il suffit, pour qu'elle demeure, de Samson et Dalila et d'Henry VIII. Musicien accompli, savant plus qu'aucun autre, il a été une sorte de Protée, capable d'écrire avec la même perfection de la forme n'importe quel genre de musique. On en a conclu qu'il manquait de personnalité, comme on a dit aussi qu'il était sec et dur. La réponse à ces reproches est dans son œuvre, dans quelques scènes de Samson, dans le rôle de Catherine d'Henry VIII.
Édouard Lalo (1823-1892) n'a que peu écrit pour le théâtre ; mais son apport est de premier ordre. En 1868, il prenait part à un concours ouvert par le Théâtre-Lyrique ; la partition de Fiesque fut écartée par le jury pour des raisons obscures. Les musiciens en vantaient cependant la valeur, et Perrin, directeur de l'Opéra, la retint. Il résigna ses fonctions avant d'avoir pu monter l'ouvrage. La guerre, la Commune, l'incendie du théâtre de la rue Le Pelletier retardèrent indéfiniment la mise en répétitions. A la Monnaie, Lalo n'eut pas plus de chance ; malgré les chaudes interventions de Gounod, l'ouvrage ne fut pas joué. Il publia la partition à ses frais et à petit nombre. Sans se décourager, Lalo entreprend le Roi d'Ys ; la malchance le poursuit encore. Il donne chez Pasdeloup, le 14 novembre 1876, l'ouverture, qui n'est pas bien comprise du public ; quelques fragments de l'ouvrage sont mieux accueillis dans les concerts, où l'auteur de la Symphonie espagnole est considéré comme un des maîtres de la musique contemporaine. Vizentini, au Théâtre Lyrique, reçoit le Roi d'Ys, mais fait faillite. Vaucorbeil l'accueille à l'Opéra dont il assure l'intérim ; une fois nommé directeur, il change d'avis, trouve le livret impossible et demande au malheureux musicien... un ballet. On lui impose un scénario absurde de Blaze de Bury (que celui-ci, ne pouvant parvenir à le mettre au point, repasse à Nuitter) ; on lui impose un délai ridicule de quatre mois. Surmené, malade, Lalo trouve en Gounod une aide fraternelle : l'auteur de Faust orchestre les dernières scènes, et Namouna entre en répétitions. Mais nouvelle difficulté : au premier acte, Mlle Sangalli doit allumer une cigarette et, tout en dansant en tirer quelques bouffées. Querelles à ce propos entre Petipa, le chorégraphe, et le danseur Mérante, qui veut se servir lui-même de cet effet dans un prochain ouvrage. On finit par s'accorder. Alors commence une campagne de calomnies : on répand le bruit que la musique de Lalo est insuffisante, qu'elle est « indansable ». Des querelles s'élèvent entre les danseuses ; les abonnés prennent parti, et si bien que le 6 mai 1882, Namouna est sifflé outrageusement malgré les protestations de musiciens dont le plus acharné à défendre Lalo est le jeune Claude Debussy. La partition est un chef-d’œuvre étincelant, qui, débarrassé d'un livret trop compliqué, et rendu à la danse pure, est aujourd'hui un des ballets les plus souvent applaudis à l'Opéra sous le titre de Suite en blanc. Ambroise Thomas, pressé de voir Françoise de Rimini, n'était pas demeuré étranger, a-t-on dit, aux intrigues qui l'avaient fait échouer.
Lalo en sortait épuisé. L'échec retentissant de Namouna n'était pas fait pour hâter l'entrée du Roi d'Ys au répertoire. Malgré l'insistance de Gounod qui, chez lui, chanta lui-même les scènes principales devant Carvalho, celui-ci le refusa pour l'Opéra-Comique. Grâce à une intervention de Roger-Marx, la direction des Beaux-Arts imposa le Roi d'Ys à Paravey, qui venait de succéder à Carvalho, et l'opéra de Lalo fut représenté le 7 mai 1888. Malgré une nouvelle cabale, le triomphe fut éclatant, et le soir de la première, Louis de Fourcaud pouvait dire : « Personne, excepté Wagner, n'a usé de l'orchestre aussi dramatiquement. Pas un compositeur allemand actuel ne pourrait écrire une œuvre de cette profondeur et de cet éclat. Cela est français, cela ne pouvait venir que d'un Français... » Ces lignes écrites dans l'enthousiasme ont gardé toute leur signification : aucune œuvre nouvelle, depuis Carmen, n'avait eu une importance aussi haute. Édouard Lalo, dans le Roi d'Ys, illustrait magnifiquement la légende de la ville engloutie, et en même temps, peignait des couleurs les plus justes l'âme même de la Bretagne caractérisée par les rythmes, la ligne mélodique d'une musique qui ne doit cependant presque rien au folklore, mais qui n'en semble pas moins un produit du terroir.
Aussi peu chanceux que Lalo, Emmanuel Chabrier (1841-1894) wagnérien passionné, n'a cependant, pas plus que Bizet ni Lalo, composé d'ouvrages qui doivent autre chose au maître allemand que leur architecture thématique. Nature exceptionnelle, Chabrier, tout jovial, tout de primesaut, a excellé d'ans la musique légère aussi bien que dans la musique symphonique, et l'on serait bien embarrassé de classer ses œuvres dans un genre ou dans l'autre, car c'est précisément le symphoniste auquel le Roi malgré lui, malgré ses rapports étroits avec le style de l'opérette, doit sa haute valeur. Le grand dommage pour Chabrier est de n'avoir rencontré que d'assez piètres livrets. Mais son esprit pétillant sut pourtant faire de l'Étoile (Bouffes-Parisiens, 28 novembre 1877) et d'Une Éducation manquée des chefs-d'œuvre annonciateurs du Roi malgré lui. Il n'est pas au monde de musique plus originale, plus essentiellement musicale que celle de Chabrier. Il a écrit un jour : « Moi, ma première préoccupation est de faire ce qui me plaît, en cherchant avant tout à dégager ma personnalité ; ma seconde est de ne pas être un c... Ils font tous la même musique, ça peut être signé de celui-ci ou de celui-là ; peu importe, ça sort du même atelier. C'est de la musique où l'on peut tout mettre et où il n'y a rien. Puis, dans cet ordre d'idées-là, on peut facilement être du passé dans dix ans (*)... » Il a su parfaitement faire de la musique où « il y a quelque chose », et cette chose est tellement du Chabrier qu'on reconnaît immédiatement « l'atelier » d'où elle sort, qu'il s'agisse des couplets et du trio du chatouillement de l'Étoile :
Ah ! c'est égal
C'est mal
Pour un' princess' de sang royal
Oui, c'est bien mal en somme,
De chatouiller un p'tit jeune homme !
du duo d'Une Éducation manquée, des pages bouffes du Roi malgré lui, aussi bien que de la « Fête polonaise » du même ouvrage. Représenté le 18 mai 1887, et arrêté au bout de trois représentations par l'incendie de l'Opéra-Comique, le Roi malgré lui est son ouvrage le plus complet, le plus réussi, parce qu'il est celui dont les situations, la cocasserie, fournissent le meilleur prétexte à la manifestation de son génie. Hélas, le livret n'est point excellent, et c'est sans doute la raison pour laquelle il a tant de peine à se maintenir au répertoire.
(*) Cité par Georges SERVIÈRES dans son livre sur Emmanuel Chabrier (Paris, Alcan, 1912, p. 43).
Moins bon encore est le poème que Mendès tira d'une légende contée par Augustin Thierry. Gwendoline, comme Judith, ira tuer le chef danois Harald, envahisseur du pays des Saxons. Mais elle s'éprend du guerrier, et, lui donnant le poignard qui devait le frapper, elle meurt avec lui. Gwendoline, jouée à Bruxelles en 1886 deux jours avant la faillite du théâtre, reprise à l'Opéra en 1893, n'a pu s'y maintenir au répertoire, malgré la qualité d'une musique qui ne peut rendre moins saugrenues certaines répliques. Le concert a gardé l'ouverture en ut mineur qui est construite sur les motifs de l'opéra, le chœur du premier acte : « Nous sommes les grands loups voraces », le dessin qui caractérise les Danois, des phrases du duo d'amour du deuxième acte, les thèmes d'Harald, de la Pitié, du Walhalla, celui-ci proclamé par les cuivres, dans le ton d'ut majeur.
Le premier acte de Briséis était seul terminé quand Chabrier mourut. Le livret de Mendès traitait le conflit du paganisme et du christianisme aux premiers siècles de l'ère nouvelle. Le compositeur semble avoir accumulé à plaisir les difficultés d’exécution dans cet acte, et peut-être eût-il éclairci cette gerbe trop fournie. Mais sous sa complication d'écriture, sa musique reste magnifique et mérite le jugement de Paul Dukas : « Ses partitions sont un véritable répertoire d'effets nouveaux qui n'appartiennent qu'à lui, et constituent, à vrai dire, sa physionomie artistique, plus que ne le fait sa conception particulière du drame chanté — adaptation au goût français du système wagnérien. »
Trois ballets et deux opéras-comiques assurent la survie de Léo Delibes (1836-1891). Mais ses ouvrages légers, le Serpent à plumes, Deux vieilles gardes, l'Ecossais de Chatou, l'Omelette à la Follembuche, ne méritent point l'oubli. Avec le Roi l'a dit (1873), il relevait, par le soin apporté à l'orchestration autant que par l'élégance des mélodies, la formule de l'opéra-comique ; Jean de Nivelle (1880) montre le même souci. Enfin Lakmé (1883) sur un livret de Gondinet et Philippe Gille, conserve un charme pénétrant qui se rehausse d'un orientalisme discret. Il appartenait à Delibes de rénover la musique de ballet. Il donna la Source, écrite en collaboration avec le Russe Minkus, en 1866, puis, seul, Coppélia, en 1870, et Sylvia en 1876, ouvrages dont la tenue montrait qu'une partition de ballet peut et doit être une excellente musique.
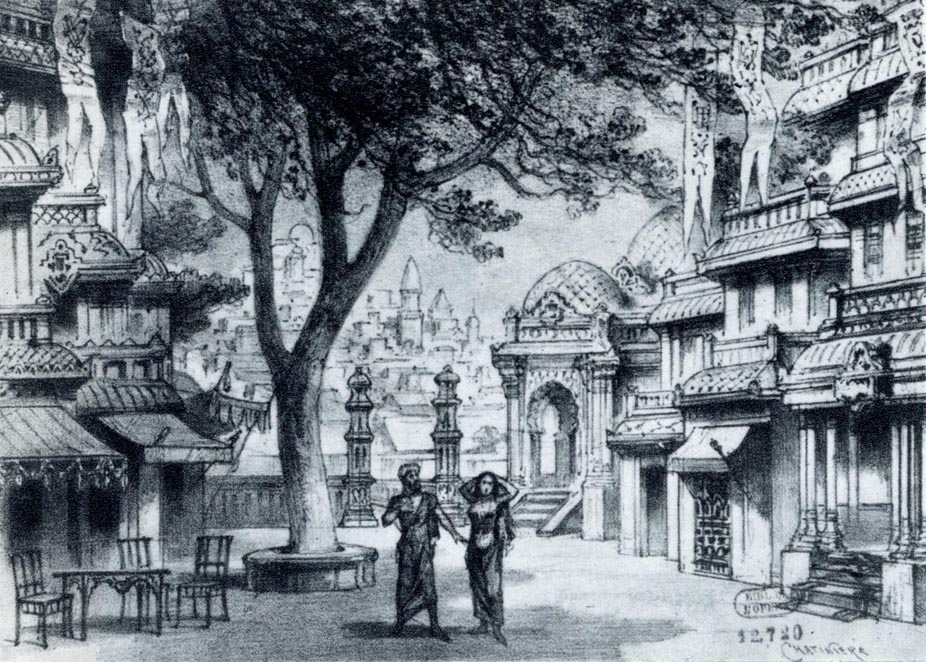
décor de la création de Lakmé de L. Delibes (1883)
Fils d'un grand prix de Rome qui s'était fixé à la Nouvelle-Orléans, Ernest Guiraud (1837-1892) obtint à son tour la même récompense, et ses opéras-comiques comme Sylvie (1864), le Kobold (1868), eurent quelque succès. Frédégonde qu'il laissa inachevée, fut orchestrée par Saint-Saëns, et représentée à l'Opéra en 1895. C'est par son ballet Gretna-Green (Opéra, 1873) qu'il survit, et peut-être plus encore par les entretiens qu'il eut avec Debussy, et dont Maurice Emmanuel a rapporté l'essentiel dans son volume sur Pelléas et Mélisande. Esprit ouvert, excellent professeur, il exerça une influence heureuse sur les élèves de sa classe de composition.
Émile Paladilhe (1844-1926) obtint le prix de Rome a seize ans. Le Passant (Opéra-Comique, 1872 sur le texte de Fr. Coppée) et surtout Patrie ! (livret de Victorien Sardou et L. Gallet, Opéra, 20 décembre 1886) lui valurent un vif succès. L'ouvrage est bien construit, et l'adieu pathétique de Rysoor au « pauvre martyr obscur » n'est point sans habileté ; mais ce qui manque à Paladilhe, c'est l'originalité.
Le charme de Massenet (1842-1912) durera longtemps parce qu'il y a d'abord dans sa musique une sensualité qui lui appartient en propre ; mais autre chose, et plus rare : une concision qui la retient de s'attarder au détail inutile et qui est la qualité essentielle au théâtre. Outre cela, un métier solide, un art d'équilibrer, de doser méticuleusement les sonorités des voix et de l'orchestre, une souplesse extrême, de l'esprit autant que de la sensibilité ; son art est bien celui d'une époque que l'on a jugée heureuse et frivole, mais qui fut pourtant inquiète. Lui-même, dévoré du besoin de plaire, fut quand même un grand musicien chez qui l'on prend une utile leçon de clarté.
Ses succès au concert auraient pu l'orienter vers la symphonie ; ses mélodies, son oratorio Marie-Magdeleine (intitulé d'ailleurs « drame sacré » et qui est le dernier envoi de Rome du lauréat de l'Institut), montrent cependant qu'il a déjà le sens du théâtre. Il y fut porté définitivement par le succès de la musique de scène des Erynnies, qui, en 1873, vengea l'échec de Don César de Bazan, à l'Opéra-Comique l'année précédente. La revanche fut plus complète encore avec le Roi de Lahore (Opéra, 27 avril 1877) qui eut trente représentations, et lui valut d'être élu à l'Institut à trente-six ans.
Le 19 décembre 1881, la Monnaie créait Hérodiade ; Paris l'entendit d'abord dans la traduction italienne par Zanardini du livret de Paul Millet et Henri Grémont (Théâtre italien, 1884). L'Opéra ne l'accueillit que le 24 décembre 1921. L'idée de faire naître chez le Précurseur un sentiment tendre pour Salomé est à tout le moins saugrenue. Massenet l'accepta cependant, et la partition accentue l'équivoque d'un travestissement du récit évangélique, qui fait de Salomé une mystique sensuelle : loin de demander la tête de Jean, elle essaie de le sauver. Malgré quelques passages assez virils, la musique reste presque constamment enlaçante et lascive ; il y circule une langueur morbide qui fit le succès immédiat de l'ouvrage, joué soixante fois devant une salle comble à Bruxelles, où des trains de plaisir amenaient les auditeurs.
Manon, dont le livret était dû à H. Meilhac et Ph. Gille, fut représentée à l'Opéra-Comique le 19 janvier 1884. Comme il en était advenu de la Carmen de Mérimée, le roman de l'abbé Prévost dut subir une transformation radicale pour paraître sur la seconde scène lyrique. Plus de Tiberge ; à quoi bon d'ailleurs conserver ce raisonneur, puisque Manon n'est plus qu'une coquette aimable, sachant profiter des occasions qui s'offrent, mais dépourvue de noirceur ; puisque des Grieux ne descend plus jusqu'au plus bas degré du déshonneur ; puisque Lescaut n'est plus le frère, mais seulement le cousin de la trop aimable fille, et qu'il n'est plus tout à fait le ruffian que l'on sait ; et puisque Manon va mourir sur la route avant d'être embarquée pour la terre de déportation des filles, puisque ainsi des Grieux n'aura point le chagrin de devoir tuer le fils du gouverneur — plus n'est besoin de Tiberge pour lui faire de la morale et tenter de le redresser. Mais si tout ce qu'il y a de fort, d'âpre et de violemment douloureux dans le livre a disparu du livret, si Manon devient presque touchante et des Grieux complètement béjaune, la musique se charge d'envelopper de sensualité un scénario trop bénin. La partition crée une atmosphère de boudoir où flottent des parfums de galanterie, une odeur capiteuse de fille. Elle crée, elle impose jusqu'à l'obsession une image exacte et profonde des deux amants liés l'un à l'autre par un attrait physique plus fort après chaque étreinte. Ce que les librettistes avaient ôté du roman, par convenance ou pusillanimité, le musicien l'a restitué avec une habileté qui en masque la violence. Mais elle y est, cette violence dans la passion, elle circule de la première à la dernière scène. L'œuvre est d'un compositeur qui semblait prédestiné pour l'écrire : séducteur, son art a toutes les grâces, tous les ensorcellements de la féminité. On a reproché à Manon de manquer de simplicité, d'unité, d'élévation. En vérité, c'eût été trahir deux fois Manon que de la faire toute simple, toute unie, et de donner à cette fille de « l'élévation » ! Massenet est de son temps, et ce temps est celui du naturalisme, de Zola et de Maupassant. Respectant la coupe par numéros des anciens ouvrages et le traditionnel parlé de l'Opéra-Comique, Massenet sut concilier avec la vraisemblance ces obligations illogiques. L'orchestre ne se tait qu'en de très rares endroits, mais il s'allège sous le « parlé », par exemple au moment où des Grieux dit à Manon : « Je ne suis plus mon maître, je vous vois, J'en suis sûr, pour la première fois, Et mon cœur, cependant, vient de vous reconnaître... » l'orchestre joue, très doucement le motif de Manon (la, sol, la, sol, fa)... procédé qui sera plus tard employé couramment lorsque l'on tentera de renouveler le genre lyrique par un retour aux formes anciennes du « mystère ».
En 1885, le Cid, à l'Opéra : il est périlleux de collaborer avec Corneille, et les qualités de Massenet ne le disposaient point à traduire l'héroïsme. Mais quelques belles scènes et le ballet du Cid sont demeurés. Esclarmonde, avec la présence de Sybil Sanderson sur la scène de l'Opéra-Comique le 15 mai 1889, constitua une des attractions de l'Exposition : cent représentations en marquèrent le succès. La chevalerie n'est ici que le prétexte de la volupté, et la partition est curieuse qui emploie le leitmotiv jusqu'à la satiété, qui teinte la musique d'un érotisme exaspéré, l'orchestre suggérant avec précision les détails d'une scène d'amour qui se passe derrière un rideau. Mais Esclarmonde reste, techniquement, la plus parfaite réussite de Massenet.
Le Mage (Opéra, 16 mars 1891) n'eut point de succès. L'œuvre contient cependant quelques belles pages, mais elle ne parvint point à intéresser. Werther, le 16 février 1892, offrit à Massenet l'occasion d'une revanche, à Vienne d'abord, puis le 16 janvier 1893 à l'Opéra-Comique. Le chef-d’œuvre de Goethe est suivi plus fidèlement par Blau, Milliet et Hartmann que ne l'avait été le roman de l'abbé Prévost, et il se trouve que la sentimentalité du musicien donne une sorte d'équivalent du romantisme goethéen. C'est une transposition, mais qui respecte les valeurs, et l'œuvre ne manque ni d'unité, ni même de profondeur. La musique est plus sobre, son leitmotivisme s'assortit plus strictement aux caractères, aux situations. Tous ces mérites font de Werther le meilleur ouvrage de Massenet ; et cependant, malgré le clair de lune, malgré la scène des adieux, il manque peut-être à Werther une sincérité qui est dans Manon.
Bien qu'à un degré moindre, ce qui fait la faiblesse d'Hérodiade se retrouve dans Thaïs : Paphnuce devient Athanaël dans le livret de Louis Gallet. Le changement de nom de l'anachorète mesure exactement la distance du roman d'Anatole France à l'opéra de Massenet, créé le 16 mars 1894. Il y a pourtant de l'émotion dans cette musique, et ce n'est pas la faute du compositeur si la fameuse « méditation » suavement chantée par le violon solo a trop été entendue ; mais s'il a réussi — il était là dans son élément — à bien peindre la courtisane, son goût du luxe et de la luxure, il a esquivé plutôt que traité le vrai sujet, la tentation de Paphnuce, le conflit qui le déchire et que l'explosion du finale ne parvient point à traduire.
Un poétique livret de Georges Boyer offrit à Massenet un Portrait de Manon, où, le 8 mai 1894, à l'Opéra-Comique on retrouva, non sans un délicat plaisir, des Grieux évoquant des souvenirs qui étaient ceux de la salle tout entière. La même année encore, le 20 juin, au Covent Garden, paraissait la Navarraise ; Massenet y rejoignait Mascagni à travers le livret vériste qu'Henri Cain avait tiré d'une nouvelle de Jules Claretie. Plus nuancé, plus délicat fut l'ouvrage dont le livret était tiré de la Sapho de Daudet par H. Cain et Arthur Bernède (Opéra-Comique, 27 novembre 1897), — un long duo d'amour en quatre actes, mais un amour orageux, l'amour d'une femme vieillissante et dont le passé est lourd, pour un homme trop jeune et qui sent peser la chaîne. Il y a chez Massenet un réaliste, et sincère aussi ; c'est là qu'on le trouve, comme on reconnaît le charmant séducteur dans la Cendrillon créée à l'Opéra-Comique le 24 mai 1899. Il y a dans ces quatre actes une trouvaille délicieuse et c'est l'arrivée de Cendrillon au bal, l'instant où les instruments se taisent — comme le dit Perrault — « car on était attentif à contempler les grandes beautés de cette inconnue ». La page est d'un poète, d'un musicien qui sait la valeur du silence — chose si rare.
Les deux ouvrages qui suivirent sont parmi ses meilleurs. Grisélidis, d'Armand Silvestre et Eugène Morand avait eu le plus vif succès au Théâtre-Français. Le « conte lyrique », paré de la musique de Massenet, n'en mérita pas moins à l'Opéra-Comique le 20 novembre 1901. La verve qu'il mit dans le rôle du Diable et de sa femme, la saine gaieté de leurs disputes, toute voisine de l'opérette, la tendresse de Grisélidis forment de savoureux contrastes, et l'on se demande pourquoi cette œuvre a disparu de l'affiche.
Même réussite, mais au pôle opposé du talent, dans le Jongleur de Notre-Dame (sur le livret de Maurice Lena, Monte-Carlo, 18 février 1902). Le Jongleur poursuit à l'Opéra-Comique depuis mai 1904 une carrière fructueuse. Paradoxe : l'ouvrage ne compte cependant point de rôle féminin. Chérubin (Opéra-Comique, 23 mai 1905), écrit d'abondance, est comme le dit René Brancour « un véritable kaléidoscope » de romances, de coquetterie, de galanterie et d'adresse, dont Fr. de Croisset et H. Cain avaient fourni les verres que le musicien colora. Il a alors soixante-trois ans, et les partitions se succèdent avec une incroyable rapidité. Malgré son étonnante aisance, Massenet y donne des signes d'épuisement. Chérubin n'a pu durer, et Thérèse (Monte-Carlo, 7 février 1907) n'eut pas une fortune plus heureuse ; mais Ariane, dans l'intervalle (Opéra, 31 octobre 1906, livret de C. Mendès) réussissait mieux, en dépit d'un poème bien médiocre. Celui de Bacchus, du même Mendès (Opéra, 5 mai 1909) est plus mauvais encore, et malgré un combat de singes contre les hommes — la scène se passe aux Indes — l'ouvrage tomba. Avec Don Quichotte (Monte-Carlo, 19 février 1910), Massenet trouve un sujet mieux à sa convenance et l'œuvre contient des scènes mélancoliques d'un réel intérêt, auprès d'épisodes de franche gaieté. Une récente reprise en a montré la persistante qualité.
Roma, le dernier ouvrage joué de son vivant (Monte-Carlo, 17 février 1912) n'eut qu'un succès d'estime, et cela ne fut point pour le consoler de l'échec de Bacchus. « Il n'accepta point, écrit Alfred Bruneau, cette aventure suprême sans protestations véhémentes, sans plaintes douloureuses. N'y a-t-il pas là une ironie trop cruelle du sort ? Après des succès tels qu'aucun musicien n'en remporta jamais d'aussi éclatants, d'aussi durables, une chute brutale, inattendue, cinglante, infligée au compositeur le plus chéri, le plus populaire, le plus admiré de son époque, empoisonnant ses dernières années ! Je ne connais aucun exemple pareil de l'aveugle férocité des foules. » Et dans l'article nécrologique publié par le Matin, au lendemain de la mort, le 14 août 1912, Claude Debussy constatait : « Ce n'est guère le moment d'exprimer un regret de sa prodigieuse fécondité, qui parfois semble lui avoir interdit la faculté de choisir. Et d'ailleurs a-t-on le droit d'exiger d'un homme qu'il soit justement le contraire de ce qu'il a été ? »
Ce regret, au bout de quarante ans, on l'éprouve devant l'œuvre de Massenet. Mais Manon, Werther, le Jongleur, suffisent à faire vivre son nom, et il manquerait beaucoup à l'art lyrique français si ces ouvrages n'avaient pas été faits.
Benjamin Godard (1849-1895) malgré le succès de Jocelyn (1888) et particulièrement de la « berceuse » du deuxième acte à laquelle Capoul fit un sort trop heureux, malgré la Vivandière (représentée à l'Opéra-Comique en 1895, quelques mois après la mort du compositeur), malgré les couplets « Viens avec nous, petit ! » qui valurent à Marie Delna un triomphe, est aujourd'hui fort oublié, et on ne peut dire qu'il y ait beaucoup d'injustice dans cet abandon.
II
Il appartenait à Giuseppe Verdi (10 octobre 1813-27 janvier 1901) de recueillir l'héritage de Rossini et de devenir le chef de l'école italienne. Homme de théâtre avant tout, Verdi a exercé une influence aussi profonde que durable sur l'art lyrique, et il est peu d'exemples de musiciens dont la gloire ait moins souffert de cette sorte d'éclipse qui suit ordinairement la mort des artistes créateurs. Sans doute Verdi doit-il cette prodigieuse survie à deux qualités des plus rares : la sincérité et la faculté qu'il eut de se renouveler tout en restant lui-même ; elles lui permirent à quatre-vingts ans d'écrire Falstaff où il montrait une extraordinaire jeunesse.

Giuseppe Verdi
Il débutait en 1839 à la Scala avec Oberto ; ce n'est point un chef-d’œuvre, mais c'est déjà un opéra essentiellement verdien. Au milieu des pires tourments — la misère, la maladie, les deuils, trois tombes ouvertes en deux mois (son fils, sa femme, sa fille) — il achève Un giorno di regno qui s'écroule dès le premier soir. Découragé, il croit ne plus pouvoir écrire, mais deux ans plus tard, à cette même Scala où l'on avait sifflé Un giorno di regno, Nabucco triomphe le 9 mars 1842. Succès prolongé par I Lombardi alla prima Crociata (Scala, 17 février 1843) ; puis, avec des fortunes diverses, les œuvres se succèdent régulièrement, mais sans trop de hâte : Ernani à la Fenice, le 9 mars 1844, I due Foscari, à Rome, le 3 novembre de la même année ; Giovanna d'Arco, à la Scala, le 15 février 1845 ; Alzira, à Naples, le 12 août 1845 ; Attila à la Fenice, le 17 mars 1846 ; Macbeth, à Florence, le 14 mars 1847 ; I Masnadieri, à Londres, le 22 juillet 1847 ; Il Corsaro, à Trieste, le 25 octobre 1848 ; la Battaglia di Legnano, à Rome, le 27 janvier 1849 ; Luisa Miller, à Naples, le 8 décembre de la même année ; Stiffelio, à Trieste, le 16 novembre 1850 ; Rigoletto, à Venise, le 11 mars 1851 ; Il Trovatore, à Rome, le 19 janvier 1853 ; la Traviata, à Venise, le 6 mars de la même année. Avec ces trois derniers ouvrages le nom de Verdi, déjà fort célèbre, gagnait une popularité qui s'étendait à l'Europe entière : à Paris, en quelques années, ses opéras furent chantés plus de mille fois en italien.

costumes pour Don Carlos de Verdi (1867)
C'est là, à l'Opéra, que le 13 juin 1855 furent créées les Vêpres siciliennes ; Simone Boccanegra fut joué à Venise le 12 mars 1857 ; Un ballo in maschera, à Rome, le 17 février 1859 ; la Forza del destino, à Saint-Pétersbourg le 10 novembre 1862 ; Don Carlos, à l'Opéra de Paris le 11 mars 1867 ; Aïda, au Caire (l'ouvrage avait été commandé à Verdi pour les fêtes de l'inauguration du canal de Suez) le 24 décembre 1871 ; Otello à la Scala le 5 février 1887, et Falstaff au même théâtre le 9 février 1893.

costumes d'Auguste Mariette pour la création d'Aïda de Verdi (Le Caire, 1871)
On a coutume de diviser en trois périodes la production de Verdi, et, comme pour Beethoven, on parle de ses trois manières, la première se terminant avec Luisa Miller, la seconde avec la Forza del destino ou Don Carlos ; à la vérité, rien ne marque une coupure nette dans une évolution qui fut continue, et tout au long de cette progression, le style de Verdi reste si personnel qu'il suffit d'entendre une phrase d'un de ses ouvrages, même du début de sa carrière, pour le reconnaître. Ce qui change, et surtout à partir de Don Carlos, c'est le procédé d'écriture, qui va se perfectionnant. Le style de Verdi diffère nettement de celui de ses devanciers, et s'il y a encore du Bellini dans Oberto, on y sent déjà le musicien résolu à subordonner plus étroitement la mélodie à l'expression des sentiments. Il s'abstient déjà des ornements superflus si chers à la génération précédente ; il veut que la musique soit la servante de la vérité — mais une servante pleine de noblesse. Et, chose essentielle, la vérité suprême, c'est pour lui, Italien, de ne point renier ses origines, c'est de refléter dans sa musique l'âme même du peuple dont il est sorti, de la nation renaissante pour laquelle il lutte, prêt à sacrifier sa vie. Et le patriote trouve des accents inspirés pour chanter l'Italie dans la Battaglia di Legnano, où un chœur resté célèbre, proclame la sainteté de l'union de tous ses fils :
Viva Italia ! Un sacro patto
Tutti stringe i figli suoi...

décor de Chaperon pour Aïda ; acte I, 2e tableau
A maintes reprises Verdi mit en garde les musiciens contre le danger de se laisser séduire par des formes, des procédés qui seraient en désaccord avec le caractère, l'esprit de la race à laquelle ils appartiennent : « Nous avons fait tout notre possible, écrit-il en 1879 au comte Arrivabene, pour renoncer à notre nationalité musicale ; encore un pas, et nous serons germanisés ! » En 1892, Hans von Bülow qui, jadis, avait formulé des réserves désobligeantes sur les opéras de Verdi, lui envoya une fort belle lettre où il s'en excusait, et lui disait son admiration pour Otello. En le remerciant, Verdi ajouta : « Votre lettre me cause un grand plaisir, non par vanité personnelle, mais parce que je vois que les artistes vraiment supérieurs jugent sans préjugé d'école, de nationalité, d'époque. Si les artistes du Nord et du Sud ont des tendances diverses, il est bon qu'elles soient diverses. Tous devraient maintenir les caractères propres de leur nation, comme Wagner l'a très bien dit. Heureux, vous qui êtes encore les fils de Bach !... Et nous, fils de Palestrina, nous avons eu un jour une école grande et nôtre. Maintenant, elle s'est faite bâtarde et menace ruine. Oh ! si nous pouvions recommencer ! »

décor de Cristini pour le Bal masqué de Verdi (Naples, Théâtre San Carlo)
Il s'y appliqua. Et c'est le sens du mot fameux qu'il a dit, et qu'on a si souvent interprété faussement : Torniamo all'antico, sarà un progresso ! Dans la même lettre où se trouve cette phrase, il avait dit aussi : « La musique de l'avenir ne me fait pas peur... » Quelle était sa pensée ? la même, exactement, qu'il exprime dans sa réponse à Bülow. Autant il est vain de refuser les enrichissements que l'on peut trouver lorsqu'un artiste, d'où qu'il vienne, perfectionne la technique, autant il est périlleux d'imiter le style des maîtres qui, eux, se sont efforcés de traduire ce qu'il y a de plus profond, de plus mystérieux dans l'âme d'une nation, qui est la leur. « La musique de l'avenir ne me fait pas peur », ajoutait Verdi, et il a montré en effet qu'il pouvait sans pour cela trahir son idéal, utiliser, mais en lui donnant une signification purement italienne, l'apport de Wagner à la technique de l'art lyrique. Ce faisant, il est demeuré fidèle au génie musical italien, et tout en restant « tourné vers les anciens » maîtres de son pays, il a fait accomplir à l'opéra italien le progrès dont Aïda, Otello et Falstaff sont la magnifique expression. Il a compris que si la musique est un langage d'universelle audience, elle risquerait pourtant de perdre tout sens en devenant une langue cosmopolite, car l'universalité d'une œuvre d'art est due à ce que l'artiste s'est élevé jusqu'au plan supérieur qui lui confère une portée humaine, au sens le plus général du mot, sans renoncer pour autant à lui conserver la marque de sa propre personnalité qui est elle-même l'expression de ce qu'il y a de plus pur et de meilleur dans sa race.
Il semble donc absolument faux de parler d'une sorte de « conversion » wagnérienne de Verdi après Don Carlos. Ce mot de conversion est aussi impropre que possible ici, car Verdi ne s'est pas tourné vers un idéal nouveau ; il n'a rien renié, rien abjuré. Utilisant seulement une harmonie plus riche, plus variée, usant d'une déclamation plus strictement modelée sur le sens des paroles, assouplissant les commentaires symphoniques, sa musique acquiert plus de mobilité pour suivre pas à pas l'action sans jamais la ralentir ; mais cette musique demeure tout autant italienne dans Otello et Falstaff que dans Il Trovatore ou la Traviata. Cette musique est avant tout sincère : Verdi, et c'est ce qui le rend admirable, aurait été incapable d'écrire ce qu'il ne sentait pas. C'est son âme qui parle le langage qu'il trace sur les portées : c'est elle qui s'exprime par la bouche de Desdemona dans la « Chanson du Saule », c'est elle qui s'exhale par la voix du soprano dans la déchirante imploration à la Vergine degli angeli de la Forza del Destino — et cette âme fut belle autant que son chant est pur.

la sortie du théâtre de la Fenice à Venise en 1868
Saverio Mercadante (1795-1870) fut au Conservatoire de Naples l'élève de Zingarelli ; il débuta en 1819 au San Carlo avec l'Apoteosi d'Ercole accueilli avec enthousiasme, et donna 61 ouvrages lyriques, ce qui ne l'empêcha point d'écrire quantité de musique sacrée et de musique symphonique. En 1820 Anacreonte in Samo rendit son nom célèbre et lui valut la commande de Scipione in Cartagine par l'Argentina de Rome. De ce moment, les opéras de Mercadante se succèdent à une cadence accélérée, et sont tour à tour chaleureusement applaudis ou reçus avec une extrême froideur ; en 1821, Elisa e Claudio triomphe à la Scala et fait comparer Mercadante à Rossini. De cette production inégale et qui mena Mercadante à travers l'Europe, de Venise à Paris et de Madrid et Lisbonne à Vienne, il ne reste aujourd'hui que quelques ouvrages joués encore en Italie et en Espagne. Au Théâtre italien de Paris, I Briganti, en 1836, n'eurent qu'un succès d'estime. Les meilleurs opéras de Mercadante sont sans doute la Rappresaglia, créée en 1829 à Cadix, le Due illustri rivali, accueillis à la Fenice avec enthousiasme en 1838, et dont le style est vigoureux, Il Giuramento qui est le plus souvent joué, Leonora (1844), Orazi e Curiazi (1846), Medea (1851), Pelagio (1857), Virginia (1866). Scudo a dit que Mercadante, musicien instruit et fort habile, n'avait point le don de l'originalité ; mais tout récemment M. Biagio Notarnicola consacrait un volume à l'auteur des Orazi et le prétendait supérieur à Verdi, parce que plus complet. Nous devons avouer que nous le connaissons trop mal en France pour qu'il soit possible de porter un jugement motivé sur lui (*).
(*) Biagio NOTARNICOLA, Saverio Mercadante (éd. Diplomanca, Roma, 1948-1949). B. Notarnicola voit dans Mercadante le père spirituel de Verdi et écrit (p. 155) : « Il grande genio di Dante potè chiamare Virgilio suo maestro ; il piccolo genio di Verdi ha potuto misconoscere Colui che lo aveva messo al mondo : Mercadante. » La rivalité des deux musiciens se poursuit donc aujourd'hui encore, malgré la gloire grandissante de Verdi et le déclin de Mercadante. Pour quelques Napolitains, celui-ci reste l'égal de Rossini.
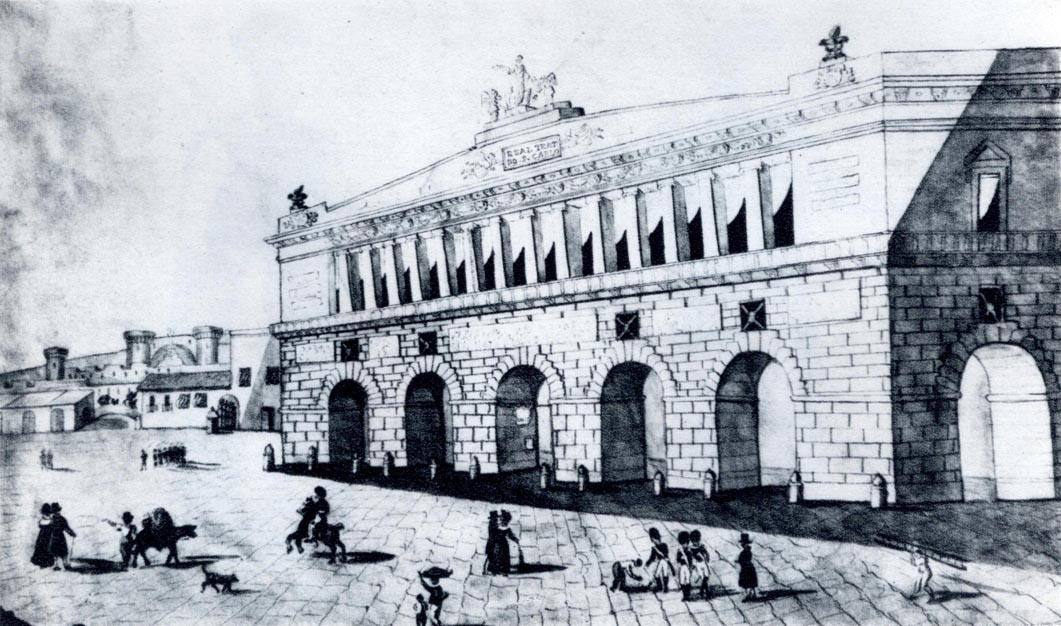
Théâtre San Carlo à Naples [aquarelle du XIXe siècle]
Luigi Ricci (1805-1859) et son frère Frederico (1809-1877) avaient été aussi les élèves de Zingarelli. Bien que souvent séparés (Luigi avait emmené à Odessa où il dirigea l'orchestre deux sœurs jumelles, Fanny et Lidia Stolz dont il était amoureux, et, à son regret, il ne put épouser que Lidia sans oublier Fanny), les deux frères collaborèrent souvent et leurs ouvrages obtinrent d'éclatants succès : la Prigione d'Edimburgo, en 1837, fut jouée partout en Italie, et en 1850, au San Benedetto de Venise, Crispino e la Comare commença une carrière qui allait le conduire à travers l'Europe. Le livret, inspiré d'une farce napolitaine, a été traduit en français sous le titre du Docteur Crispin, et l'ouvrage des Ricci, après avoir triomphé à Paris au Théâtre italien en 1865 dans le texte original, reparut à l'Athénée en 1869 pour de longs soirs. L'œuvre est d'un comique irrésistible, dû pour une bonne part à une musique spirituelle et endiablée.
Amilcare Ponchielli (1834-1886) débuta en 1856 avec un opéra tiré d'I Promessi sposi de Manzoni. Représenté à Crémone, il passa presque inaperçu jusqu'à sa reprise en 1872 au Teatro dal Verme de Milan, après un remaniement qui valut à Ponchielli une célébrité confirmée par son ballet le Due Gemelle (Scala, 1873), puis par Gioconda (Milan, 1876), encore très souvent joué en Italie (le ballet des Heures, qui en est tiré, est au répertoire de l'Opéra-Comique). On lui doit en outre Lina (Milan, 1876), refonte de la Savojarda (Crémone, 1861), qui s'est aussi maintenue dans la péninsule.
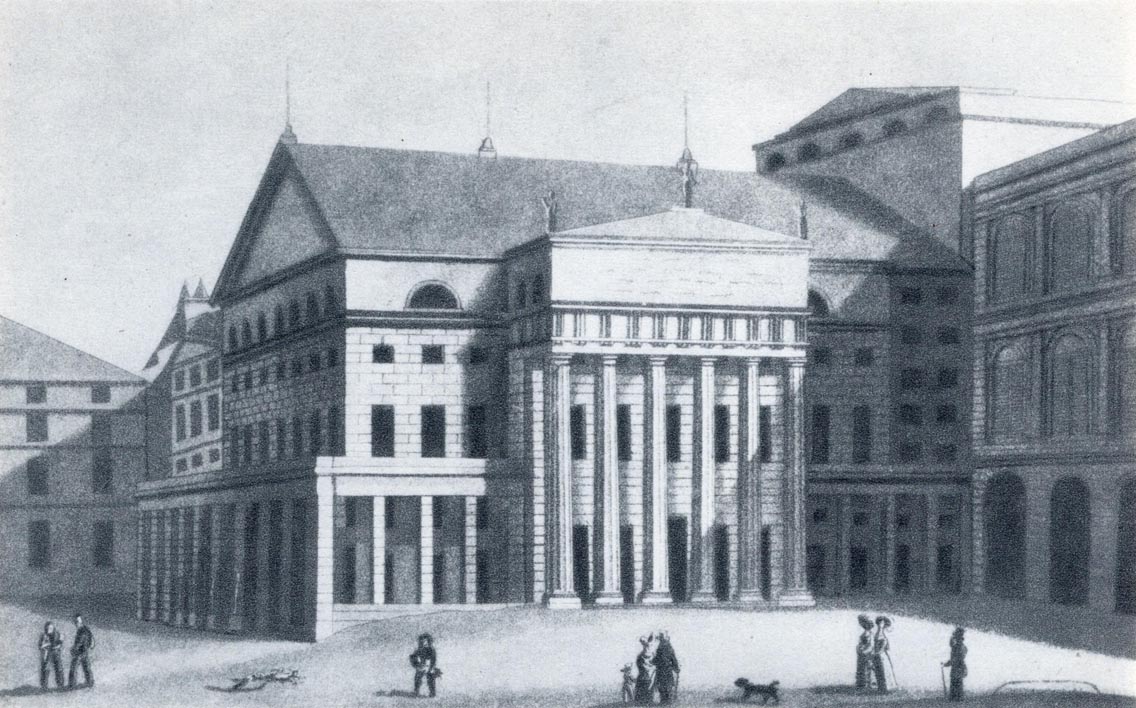
Théâtre Carlo Felice à Gênes [gravure du XIXe siècle]
Grand ami de Verdi, et son librettiste pour Otello et Falstaff, Arrigo Boito (1842-1918) vit son Mefistofele tomber lors de la création à la Scala en mars 1868 ; mais à Londres, en 1875, et à Bologne, la même année, le succès fut énorme et l'ouvrage s'est maintenu. Le scénario est tiré des deux Faust de Goethe — et de tous les ouvrages lyriques qui s'en inspirent, c'est celui qui les résume le plus complètement. La partition ne manque ni de force ni de vivacité. L'air Dai campi, dai prati, le duo de Faust et Elena, la scène du sabbat ont acquis un renom mérité par leur style clair, dépouillé même. Le grand reproche que l'on a fait à Mefistofele, est que le diable y apparaît un peu comme un montreur de marionnettes. Le prologue dans le ciel fait entendre des chœurs mystiques d'un effet très curieux. Boito laissa en mourant un Nerone, achevé depuis de longues années et qui ne fut joué qu'en 1924.
Musicalement, Boito marque la transition entre Verdi et l'école vériste, issue du mouvement littéraire lui-même dérivé du naturalisme français de Zola, et dont le romancier sicilien Giovanni Verga est le plus illustre représentant. Les véristes voulurent instaurer le réalisme dans la musique, et la distance est quand même assez grande qui sépare Mascagni, Leoncavallo et Puccini de Boito. Ce fut le 17 mai 1890 qu'au théâtre Costanzi de Rome, Pietro Mascagni fit représenter Cavalleria rusticana, première manifestation de la nouvelle école. Le drame était tiré d'une nouvelle rapide, brutale, de Verga. Mascagni (né en 1863), ancien élève de Ponchielli à Milan, poursuivait une carrière de chef d'orchestre lorsque l'éditeur Sonzogno institua un concours d'ouvrages en un acte. Il n'avait pas de livret ; deux de ses amis, Targioni-Tozzetti et Menasci se hâtèrent d'en écrire un d'après Verga, et, le délai étant fort court, le lui envoyèrent scène à scène. Le manque de temps n'empêcha point Mascagni de remporter le prix ; sans doute même lui fut-il favorable : on peut reprocher à la partition sa facilité, qui trop souvent même est vulgarité, mais on ne peut lui refuser une violence qui entraîne l'auditeur. Et jamais, dans ses compositions ultérieures, dans l'Amico Fritz (1891), Die Rantzau (1892), Radcliff (1894), sauf peut-être dans Il Piccolo Marat (1921), Mascagni n'a retrouvé cette concision qui fit le succès immédiat et triomphal de son début. Le sujet est un drame de la jalousie : Lola, fille coquette, abandonne son fiancé. Turridu, et épouse un charretier, Alfio. Mariée, elle est jalouse de celui qu'elle a dédaigné et n'a point de cesse qu'elle l'ait reconquis ; mais c'est au tour de Santuzza, qui aime Turridu, de vouloir se venger ; elle conte à Alfio la trahison de Lola, et celui-ci provoque Turridu et le tue dans un duel au couteau. Brutalité n'est pas exactement vérité ; il y a bien de la convention dans Cavalleria, surtout dans la musique, et les quelques accents dramatiques et puissants qu'on y trouve ne suffisent pas à l'améliorer.
Deux ans plus tard, le 21 mai 1892, le Teatro dal Verme donnait à Milan I Pagliacci, de Ruggiero Leoncavallo (1858-1919), également en un acte, et non moins brutal. En vain le musicien avait tenté de faire représenter ses premiers ouvrages, Chatterton, I Medici : ceux-ci ne le furent qu'après le succès foudroyant des Pagliacci. Le sujet est fort simple : c'est le drame de l'histrion qui va trouver dans la vie le rôle qu'il tient chaque soir sur les tréteaux. Trompé, fou de rage, il tuera sa femme qui joue avec lui la comédie, et, comme l'amant assiste au spectacle, il compte bien que celui-ci se trahira, et qu'il l'abattra lui aussi. Ce qu'il y a de meilleur dans l'ouvrage est le prologue où Tonio, le pitre, vient devant le rideau avertir le public que le drame n'est point imaginaire, mais une histoire vraie, dont les personnages ont vécu, et sont morts comme on le verra.
Il importe de noter que le succès de ces courts mélodrames réduits à un acte ou à deux tableaux reliés par un intermède symphonique (comme I Pagliacci) n'a pas été sans influence outre-monts : c'est la forme qu'adopta Richard Strauss.
Après I Pagliacci, Leoncavallo tenta de renouveler son coup de maître avec la Bohème (quatre actes, 1897), Zaza (1900), et quelques opérettes.
La fortune de Giacomo Puccini (1858-1924) fut plus heureuse. Élève de Ponchielli lui aussi, dès 1884 il obtenait un succès assez vif avec le Villi. Cinq ans plus tard, Edgar, créé aussi à la Scala, était accueilli avec plus de faveur encore. A Turin, en 1893, Manon Lescaut consacrait définitivement sa réputation. L'ouvrage se divise en deux parties, l'une gaie, pleine de vie, et qui est la meilleure, l'autre violemment dramatique, s'achève par la mort de Manon en Amérique — car le livret suit de très près le roman. Mais les derniers tableaux sont gâtés par un sentimentalisme facile, et c'est le défaut que l'on retrouve dans les autres ouvrages de Puccini, dans la Vie de Bohème (Turin, 1896), dans la Tosca (Rome, 1900), dans Madame Butterfly (Milan, 1904), la Fanciulla del West (New York, 1910). Son meilleur ouvrage est Gianni Schicchi (New York, 1918), débordant de verve et d'esprit ; Turandot que termina Franco Alfano (Milan, 1926), laissait deviner une évolution que la mort ne lui permit pas de poursuivre. Dans ses Musiciens d'aujourd'hui, Alfred Bruneau a porté sur les véristes ce jugement équitable : « Pour apprécier sans injustice leur musique, il faut avoir le courage de faire abstraction des habitudes artistiques de notre race et les écouter en oubliant notre code théâtral. Nous reconnaîtrons alors que certains d'entre eux ne sont pas négligeables, que leur métier, parfois si rudimentaire, suffit à leurs dons d'improvisation, et que, disant vite et sans recherche du beau langage ce qu'ils ont à dire, ils s'approchent peut-être de la vérité, essayant au moins de l'exprimer selon leur tempérament, et, par cela même, allant droit à l'âme de tous les publics, la sincérité étant encore le plus sûr et aussi le plus ingénu moyen à employer pour être compris de la foule. » Cela est vrai ; mais il est souvent difficile de discerner dans cette musique ce qui est parfaitement sincère de ce qui n'est que formule complaisante au succès. Verdi s'est gardé de ce qui nous semble excessif dans le vérisme qui a subi, outre celle du maître italien, l'influence de Massenet.
Franco Alfano, disciple de Puccini, donna à Bologne en 1921 une légende de Sakuntala, qui rompait avec le vérisme auquel se rattachaient étroitement ses précédents ouvrages comme Résurrection, d'après Tolstoï, l'Ombra di don Giovanni (Scala, 1914) où sa personnalité est marquée davantage. Vériste aussi la production de Riccardo Zandonai, où se remarque l'influence de son maître Mascagni (Il Grillo del focolare, 1908, Conchita, d'après la Femme et le Pantin, 1911, Melenis, 1912, Francesca da Rimini, 1914, la Via della finestra, 1919, Giulietta e Romeo, 1922, I Cavalieri di Ekebù, 1925, Giuliano, 1928). Italo Montemezzi doit à sa formation d'ingénieur une solidité qui fait le mérite de ses opéras : Giovanni Gallurese (1905), l'Amore dei tre re (1913), Hellera, la Nave (1918).
La vaste culture d'Ottorino Respighi (1879-1936), ses séjours à Pétersbourg près de Rimski-Korsakov, à Berlin, près de Max Bruch, son goût de la musique ancienne, l'ont préservé des excès du vérisme, et si ses œuvres symphoniques ont fait sa célébrité, il doit au théâtre de légitimes succès avec Re Enzo (Bologne, 1905), Semirama, 1910, Belfegor, 1923 et Marie l'Égyptienne, oratorio transporté au théâtre. Il y a de la vivacité dans sa pièce pour marionnettes la Bella addormentata nel bosco, et une heureuse réussite dans son adaptation pour les Ballets russes d'une musique de Rossini (la Boutique fantasque). Ildebrando Pizzetti a été le principal artisan de la réaction contre le vérisme. La qualité de l'inspiration, la pureté de la forme ont imposé ses ouvrages aussi bien au concert qu'au théâtre, et le rôle qu'il a joué à la direction du Conservatoire de Milan a complété heureusement ses publications dans les revues musicales. En 1915, il faisait représenter à Milan Fedra, d'après d'Annunzio qui déjà lui avait confié la Pisanelle, écrite pour Mme Ida Rubinstein, et représentée à Paris le 12 juin 1913. Il y mit non seulement de l'habileté, mais une sensibilité convaincante heureusement alliée à la vigueur. Lui-même écrivit le livret de Debora e Jaele (1922). Les mêmes qualités se retrouvent dans ses musiques de scène pour la Nave et pour Œdipe Roi.

intérieur de la Scala de Milan (au pupitre : Arturo Toscanini)
Plus jeune de deux ans (il est né en 1882) Francesco Malipiero est l'un des maîtres qui, en Italie, réagirent contre le vérisme ; ses ouvrages furent violemment discutés aussi bien dans la péninsule qu'à l'étranger, à Paris, aussi bien au concert qu'au théâtre, où il a donné Sogno d'un tramunto d'autunno (1913), Canossa (1914), les Tre Commedie Goldoniane (1920-1922), dont les Baruffe chiozzotte (les Disputes de Chioggia) et la Bottega del Caffè ont toute la verve du vieil opera buffa dans une forme audacieuse ; les Sette Canzoni provoquèrent des manifestations en 1919 à l'Opéra et furent reprises un peu plus tard par Mme Beriza qui les fit applaudir ; Filomela e l'Infatuato (1925), la Principessa Ulalia (Boston, 1925), Merlino, maestro d'organi (1927), des ballets : Pantea (Paris, 1919), la Mascherata delle Principesse prigioniere. Ses dons d'invention mélodique et rythmique, et de coloriste l'ont placé en tête du mouvement qui s'accomplit dans les années qui précédèrent et suivirent la guerre de 1914-1918. Vincenzo Tommasini (1880-1951) a surtout écrit de la musique symphonique, mais ses opéras Medea (1906), Uguale fortuna (1913), son ballet sur des thèmes de Scarlatti, les Femmes de bonne humeur (pour la troupe de Diaghilev, 1917) montrent qu'il eut le sens du théâtre.
Alfredo Casella (1883-1947) fonda la Corporazione delle nuove musiche et travailla avec ardeur au renouveau musical de l'Italie. Il a surtout écrit de la musique pure ; sa Giara, d'après Pirandello, écrite pour les Ballets suédois, déborde de gaieté et de vie. C'est aussi pour Diaghilev que Vittorio Rieti écrivit Barabau (1935), et le Bal (1929) ; on lui doit en outre un opéra de chambre, Teresa nel bosco, une Électre, d'après Giraudoux, et deux autres ballets : Robinson et Vendredi et David triomphant. Luigi Dallapiccola a obtenu plus récemment encore un vif succès avec le Prisonnier. Disciple d'Alban Berg, dont il applique avec discrétion les théories dodécaphonistes, il est un musicien d'une originalité puissante.
III
Le théâtre lyrique austro-allemand semble tomber en léthargie après mort de Wagner : l'éclat resplendissant du maître saxon offusque ses successeurs, et, seul, Richard Strauss parvient à rayonner à son tour.
Hugo Wolf (1860-1903), s'il a écrit un opéra-comique Der Corregidor d'après la nouvelle d'Alarcon dont Falla tirera son ballet le Tricorne, doit une gloire méritée à ses lieder et non à cet ouvrage lyrique, fort coloré mais dont la musique manque du mouvement nécessaire au théâtre. Gustav Mahler (1860-1911) n'a donné à la scène qu'une œuvre de jeunesse, Die Argonauten, et la musique pour une féerie : Rübezahl ; lui aussi a cherché ailleurs la célébrité. Comme Brahms et Bruckner, Max Reger (1873-1916), malgré sa fécondité, n'a rien donné au théâtre. Cependant la postérité spirituelle de Wagner est innombrable, et durant plus de trente ans, ses épigones ont imité le maître. De cette foule de musiciens secondaires, émergent quelques compositeurs qui surent faire montre d'une originalité relative, et d'abord Engelbert Humperdinck (1854-1921). Tout en restant fort attaché au système wagnérien, il s'écarta des sujets légendaires et symboliques et écrivit un petit chef-d'œuvre en utilisant le folklore enfantin des provinces rhénanes : Hänsel und Gretel. Cette féerie contient des scènes exquises, d'une poésie et d'une perfection d'écriture qui les assure de vivre. Ses autres ouvrages ont été injustement éclipsés par cette réussite : Die Königskinder, Dornröschen, Die Heirat wider Willen, Die Marketenderin et Gaudeamus.
Siegfried Wagner (1869-1930), d'abord tenté par l'architecture, ne put résister à l'appel de la musique, et l'étudia sous la direction d'Humperdinck. Héritier d'un nom trop lourd, il débuta comme chef d'orchestre, puis composa des opéras (Der Bärenhäuter, 1899 ; Herzog Wildfang, 1901 ; Der Kobold, 1904 ; Bruder Lustig, 1905 ; Das Sternengebot, 1908 ; Banadietrich, 1910 ; Schwarzwanenreich, 1916 ; An allem ist Hütchen schuld, 1917 ; Sonnenflammen, 1918 ; Der Schmid von Marienberg), dont il écrivit les livrets. Signés d'un nom moins illustre, ces ouvrages auraient sans doute été considérés plus favorablement. Hans Pfitzner (1869-1949) a écrit deux drames musicaux Der Arme Heinrich (1895), Die Rose vom Liebesgarten (1901) et une « légende dramatique » Palestrina (1917), dont la longueur, le déséquilibre (l'un des actes dure quatre-vingts minutes), accusent les partis pris. Il y a, non sans habileté, enchâssé dans sa propre musique la Messe du pape Marcel. Pfitzner reste attaché au néo-romantisme, mais non sans faire preuve d'un dédain de la sensibilité qui le rapproche des musiciens de l'époque suivante.
Max von Schillings, né en 1868, musicien de grande culture, chef d'orchestre réputé, débuta en 1894 avec Ingwelde, puis donna en 1899 Der Pfeifertag, en 1906 Moloch et en 1915 Mona Lisa, son meilleur ouvrage. On lui doit en outre de la musique de scène pour l'Orestie, pour le premier Faust de Goethe, des récitatifs pour l'Enlèvement au Sérail. Le chef d'orchestre célèbre Felix Weingartner a composé lui aussi quelques opéras : Sakuntala (1884), Maliwaka (1886), Genesius (1893), Orestes (d'après la trilogie d'Eschyle, 1902-1908), Kaïn und Abel (1914), Meister Andrea (1914), Dame Kobold (1915), Terakoya (1920) et Der Apostat ; d'une forme très soignée, ils laissent voir en lui un disciple de Wagner. La pantomime de Franz Schreker Der Geburstag Der Infantin (1908) lui valut la célébrité en Autriche où il avait fondé le Chœur philharmonique de Vienne. On lui doit en outre des opéras (Flammen, Der ferne Klang, Das Spielwerke der Prinzessin, Die Geseichneten, Der Schatzgräber, Irrelohe), où l'influence debussyste se manifeste chez un musicien curieux de subtilités harmoniques fort délicates.
Avec Richard Strauss (1864-1949) l'art lyrique allemand s'enrichit de chefs-d’œuvre dont l'importance et le rayonnement peuvent être comparés à ceux de Wagner. Sa réputation de chef d'orchestre et de symphoniste était déjà solidement assise lorsqu'il aborda le théâtre avec Guntram, représenté à Weimar en 1894. L'influence wagnérienne y est manifeste ; l'excessive durée de certains monologues imposés aux chanteurs lui valut des démêlés avec ses interprètes lorsqu'on reprit l'ouvrage à Munich. C'est que l'art de Richard Strauss n'a guère de commune mesure avec l'art de ses devanciers Son impétuosité, sa puissance vont se manifester librement dans les œuvres qu'il destine à la scène comme dans celles qu'il écrit pour le concert. Mais il obtiendra ce que nul autre avant lui n'avait réussi. Dans Feuersnot (littéralement : « nécessité du feu ») (Dresde, 1901), c'est une folle nuit de la Saint-Jean, tumultueuse autant que celle des Maîtres chanteurs, qui lui permet de donner cours à sa fantaisie, au déchaînement orchestral que l'on retrouvera dans Salomé avec un éclat plus vif encore. Il avait assisté à une représentation du drame d'Oscar Wilde traduit par Lachmann. Un an plus tard, le 9 décembre 1905, l'Opéra de Dresde affichait l'œuvre nouvelle. En même temps que la version allemande, Strauss en écrivait la version française. Sa correspondance avec Romain Rolland publiée (*) montre son souci scrupuleux de résoudre les problèmes de prosodie que lui pose l'accentuation du texte français. Il se fait minutieusement expliquer par son ami les nuances les plus subtiles de la langue parlée, et, docilement, suit ses conseils, non sans avoir parfois discuté : il veut comprendre, mais cède de bonne grâce dès qu'il a compris.
(*) Cahiers Romain Rolland, n° 3, Correspondance de Richard Stratus et de Romain Rolland. Albin Michel, 1951. Préface de Gustave Samazeuilh.
Sa musique commente avec un réalisme auquel on a souvent reproché sa brutalité, le drame de Wilde ; mais nul ne peut contester que le compositeur peint des couleurs les plus justes la corruption asiatique, la violence effrénée du désir chez le Tétrarque Hérode, la sensualité trouble de Salomé. C'est à sa franchise d'accent que la partition doit de s'être imposée et d'avoir finalement triomphé de l'hypocrisie des uns, de la jalousie des autres, de la surprise de tous devant un ouvrage audacieux et si neuf. Déjà Feuersnot n'avait qu'un seul acte : Strauss aime cette forme ramassée, et c'est elle que l'on retrouve dans Elektra créée à Dresde le 25 janvier 1909, drame plus brutal encore que Salomé. La tragédie de Sophocle inspire Hugo von Hoffmannsthal. Le poète qui devenait le librettiste attitré de Strauss, se trouve d'accord avec le musicien pour donner du drame atroce, une image dont le modernisme rejoint la fureur antique. Mais il y a dans cet acte qui ne serait sans cela qu'un crescendo de violence, une longue scène de détente, presque de tendresse : les effusions d'Elektra, prête à accomplir elle-même l'acte de vengeance, lorsqu'elle se convainc que le jeune étranger, venu pour apporter la nouvelle de la mort d'Oreste, n'est autre qu'Oreste lui-même. Page admirable qui est suivie d'un finale d'une étonnante vigueur.

costumes de R. Piot pour Elektra de Strauss (reprise à Paris, 1932)
Le succès du Chevalier à la Rose (Der Rosenkavalier) créé à Dresde le 26 janvier 1911 devait dépasser encore celui des deux ouvrages précédents et s'étendre plus rapidement encore. Le musicien renonçait à la coupe en un acte, et développait aux dimensions d'une vaste fresque le sujet d'une estampe galante. On lui reprocha ce « manque de mesure » ; mais on convint de la qualité d'une partition si riche, si entraînante, si pleine de beautés que les défauts de l'ouvrage disparaissent devant sa réussite éblouissante. Image composite où la poésie se mêle à la truculence, où le sentiment rejoint la grivoiserie, où des figures bouffonnes, comme celles du baron Ochs von Lerchenau, du bourgeois nouvellement anobli Faninal, côtoient l'innocence curieuse de Sophie, où la tendresse et la mélancolie trouvent cependant place auprès du libertinage, c'est un singulier mélange de styles, et c'est pourtant un ouvrage achevé, un chef-d’œuvre de l'art baroque, tel que l'ont voulu les auteurs, et qui offre la diversité que d'autres dispersent en dix ou vingt ouvrages. Il suffirait à un musicien d'avoir écrit les scènes finales — le trio surtout — du Rosenkavalier pour demeurer illustre.
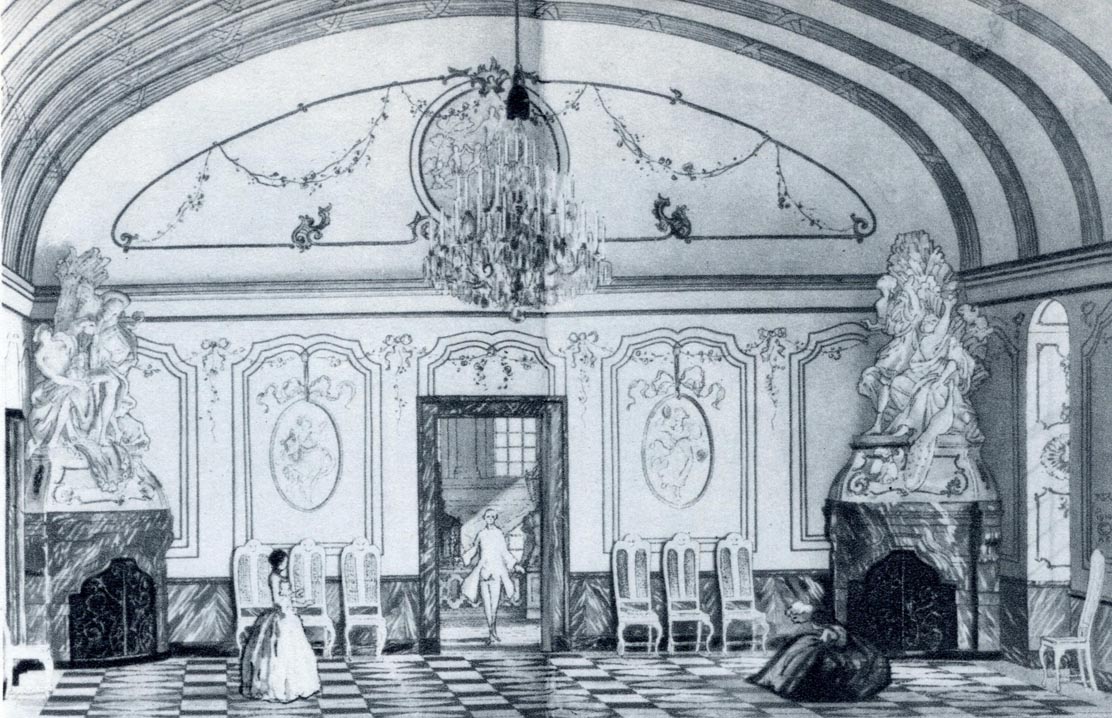
décor d'A. Roller pour le Chevalier à la Rose de Strauss (Berlin, 1911)
Ariadne auf Naxos, qui sous sa forme primitive fut un interlude destiné au Bourgeois gentilhomme, et que Strauss reprit trois fois pour lui donner son aspect définitif d'ouvrage indépendant, accentue plus encore l'évolution du musicien vers le style baroque avec son maniérisme, ses bizarreries, où la délicatesse, la grâce de Mozart se mêlent à la bouffonnerie débridée de la commedia dell'arte. M. Jourdain donne à ses invités le régal d'un opéra ; mais dans la version définitive, M. Jourdain devient un bourgeois de Vienne : le prologue nous fait assister aux préparatifs de la fête. Une fantaisie du maître de céans fera que le divertissement qu'il a commandé aux bouffons italiens s'entremêlera à l'opera seria, Ariane à Naxos, et que Zerbinette essaiera de remontrer à l'héroïne abandonnée par Thésée que les hommes ne valent pas qu'on les pleure. D'ailleurs, Bacchus apparaît bientôt qui la console. Sans pasticher le style de l'opéra de Lully, Strauss écrit là des airs d'une perfection étonnante, dont le modernisme s'accommode des formes anciennes, même du recitativo secco ; il y use d'un orchestre réduit qui sonne avec une pureté sans égale.
Die Frau ohne Schatten (la Femme sans ombre) en 1919, fut comparée à la Flûte enchantée sans doute à cause d'un sujet tout rempli de symboles, où deux couples doivent à un prodige de connaître le bonheur en retrouvant la simplicité. Intermezzo (1925) est une « comédie bourgeoise » dont le musicien écrivit lui-même le livret. Elle a pour point de départ une anecdote vraie, une méprise dont Strauss fut l'objet. Il l'a illustrée d'allusions parodiques. Il avait en chantier Die Egyptische Helena, dont Hoffmannsthal lui avait donné le livret, et qui le 6 juin 1928, fut représentée à Dresde. Le poète s'était inspiré d'Euripide qui, pour expliquer la guerre de Troie, suppose que Junon, irritée contre Pâris, a fait transporter en Égypte la véritable Hélène pour que le prince troyen n'ait entre ses bras qu'un fantôme. Ménélas retrouve ainsi une épouse fidèle. Le livret est faible, et la partition n'est point une des meilleures de Strauss. Au contraire, avec Arabella, due également à Hoffmannsthal, il retrouve la veine du Chevalier. Intrigue compliquée à souhait, rivalité amoureuse de deux sœurs, imbroglio qui se dénoue selon la tradition de l'opérette, et musique légère, passionnée, grâce à laquelle les fantoches prennent vie (Dresde, 1er juillet 1933).
Hoffmannsthal étant mort, Strauss demanda à Stefan Zweig d'adapter la Femme silencieuse de Ben Jonson (Die Schweigsame Frau). Pour traiter un sujet tout voisin de Don Pasquale, Strauss retrouve le style italien, et, déjà septuagénaire, montre une jeunesse étonnante dans sa partition. Josef Gregor écrit pour lui Friedenstag (Jour de Paix) qui, créé à Munich le 24 juillet 1938, est accueilli par les protestations des nazis. Il montre, dans une ville assiégée, le conflit du devoir militaire et des sentiments d'humanité. Le commandant est décidé à lutter jusqu'au dernier homme ; sa femme tente de lui remontrer l'inutilité de telles souffrances. Il va faire sauter la citadelle, lorsque les cloches des villages voisins sonnent : c'est le soir du 24 octobre 1646. Les traités de Westphalie sont signés, c'est le « jour de paix », également désiré par les deux adversaires. La musique, plus encore que le livret, traduit la noblesse des idées dont la lutte crée le drame. Le duo qui forme le point culminant de la partition réalise, par la vertu de la musique, l'unité de ces sentiments opposés, et cette unité traduit elle-même l'amour qui, malgré tout, ne cesse point d'unir deux êtres également nobles et déchirés. Cette belle page est encore dépassée par le chœur final, qui, après le carillon des cloches, monte, grandit, et atteint la plus haute expression pathétique dans une majestueuse simplicité.
Au même librettiste, Strauss doit encore la tragédie bucolique de Daphné. Le poète y suit la légende antique de la fille de la Terre et du fleuve Péné, aimée d'Apollon, et qui, aimant le berger Leucippe, est métamorphosée en laurier. Strauss a su rendre transparente l'atmosphère hellénique de sa tragédie.
Die Liebe der Danæ (l'Amour de Danaé) est une « comédie mythologique gaie » dont Hitler interdit la représentation au Festival de Salzbourg en 1941. Enfin Capriccio est une « conversation en musique » qui a pour cadre un château de l'Ile-de-France dans le dernier quart du XVIIIe siècle. Une jeune veuve, deux soupirants — un musicien et un poète — l'un gluckiste, l'autre picciniste : querelle sentimentale et dispute esthétique s'entremêlent et la jeune femme se tire d'affaire en chantant une romance dont les paroles sont de l'un, la musique de l'autre ; puis l'on va souper. Naturellement Strauss fait usage ici de citations qu'il emprunte même à ses propres ouvrages, et s'y montre le connaisseur éclairé à qui l'on doit les Suites de Lully et de Couperin si habilement orchestrées.
A cette production dramatique, si abondante et si variée, il faut ajouter les ballets : la Légende de Joseph, écrite pour Diaghilev (1914), et Schlagobers (Crème fouettée, Vienne, 1924).
On a souvent dit Richard Strauss l'héritier de Wagner. Il a bien vite montré sa personnalité qui demeure une des plus fortes de ce temps. Son écriture thématique dérive certes de Wagner ; mais il sait imprimer au leitmotiv plus de souplesse en même temps qu'il en élargit la valeur symbolique. Il a constamment pensé sa musique en fonction de l'orchestre, concevant ses motifs avec l'harmonie, les timbres qui leur confèrent une personnalité. Il y a dans ses ouvrages si bien ordonnés une sorte d'ivresse dionysiaque, et parfois quelque raffinement y fait entendre un écho mozartien. Ainsi le finale du Chevalier se dilue en harmonies d'une vaporeuse légèreté. D'autres fois la violence épique de ses tutti prend l'auditeur aux entrailles ; d'autres fois encore c'est la nostalgie désespérée d'une phrase des bois ou des cors qui fait ressentir jusqu'à l'angoisse le regret d'un impossible désir ; ou c'est ailleurs l'allégresse ou la truculence d'un tableau coloré à la manière de Téniers ; c'est aussi bien le chœur final de Friedenstag, ou ce sont des moyens d'expression jusqu'alors inconnus. Il fut une sorte de magicien de l'art sonore, et il reste un des musiciens dont on peut être sûr que les œuvres dureront bien au-delà du temps et de la mode qui en firent le succès.
L'art de Paul Hindemith est tout différent. Dans la musique de chambre et la symphonie, il a fait figure d'enfant terrible environ 1920, puis il est devenu le chef de l' « avant-garde ». Sa comédie musicale Neues vom Tag (Nouvelles du jour) et surtout son opéra Mathis der Maler (Mathias le peintre) montrent un musicien affranchi de toutes les traditions, répudiant le système tonal, et parvenant souvent à donner une impression de richesse dans le dépouillement.
IV
Jusqu'au XIXe siècle il n'y eut guère d'autre musique russe que celle de l'église et celle du peuple. Au temps de Catherine II, Fomine et Matinski composèrent des opéras ; mais Paul Ier étouffa ces tentatives de créer un art lyrique national, et le théâtre redevint un domaine italien ou français.
Mikhaïl Glinka (1804-1857) fut le père de cet art national qui allait rapidement se développer. Un voyage en Italie fortifia son désir de doter son pays d'opéras qui ne devraient rien à l'étranger. Le poète Joukovski lui donna l'idée d'Ivan Soussanine (la Vie pour le Tsar). Il y portait à la scène le dévouement d'un paysan qui se sacrifie pour sauver le jeune Romanov. Ce que Glinka avait acquis en Allemagne et en Italie ne lui servit qu'à donner plus de solidité à son ouvrage : le cadre historique en est la lutte russo-polonaise au XVIIIe siècle ; le compositeur sut, par le choix de ses thèmes, marquer si bien les caractères des deux pays, il utilisa avec tant de bonheur leurs mélodies populaires, que la Vie pour le Tsar surprit les habitués de l'Opéra le 27 novembre/9 décembre 1836. Quelques-uns ne comprirent pas, et déclarèrent que c'était là « musique de cochers de fiacre (*) » ; mais ceci n'empêcha point le triomphe de l'ouvrage. Encouragé, Glinka tira d'un conte de Pouchkine Rouslan et Ludmilla qui fut créé le 27 novembre/9 décembre 1842. Il avait cette fois fait usage de thèmes populaires du Caucase et l'ouvrage fut joué trente fois dans la même saison. Lors du séjour que le musicien russe fit à Paris en 1844, Berlioz exécuta la musique de Glinka au Cirque d'Hiver et, dans son feuilleton des Débats, le salua comme l'un des plus grands compositeurs du siècle. Il avait véritablement créé la musique russe. Il osa faire usage des mesures à 5 et 7 temps, adopter un rythme libre, sans nul souci de la carrure. Il sut unir « par les liens légitimes du mariage » les formes occidentales aux exigences de la musique russe, mais en les assouplissant, et, d'instinct, il employa les modes anciens conservés dans le folklore. Il avait noué d'amicales relations avec Stassov et Dargomijski qui lui firent connaître Balakirev. Ainsi s'établit le lien qui unit le fondateur de l'école au Groupe des Cinq.
(*) R. HOFMANN, Un Siècle d'opéra russe : de Glinka à Strawinsky (édit. Corrêa, 1946).

Mikhaïl-Ivanovitch Glinka [gravure russe]
Alexandre Dargomijski (1813-1869) appartenait comme Glinka à une famille noble. Fonctionnaire attiré par la musique, il compose une Esmeralda qui attend huit ans avant d'être jouée avec un vif succès à Moscou en 1847, mais qui n'a rien de spécifiquement russe, et laisse voir l'influence d'Auber et de Meyerbeer. Dans Roussalka (l'Ondine) (1856) d'après Pouchkine, l'inspiration et le style se rapprochent de Glinka. Il est plus réaliste, plus près de la terre, et son souci de la vérité le conduit à faire au récitatif une place prépondérante. Il accentue encore cette tendance dans le Convive de Pierre, qu'il laisse inachevé, et que Rimski orchestre. L'ouvrage fut représenté avec un épilogue de César Cui au Théâtre Marie en 1872.

Théâtre de l'Opéra de Moscou [gravure d'après Sadovnikoff]
Le Groupe des Cinq se composa d'amateurs dont la vocation fit vite des professionnels. Le terme « Cinq » est inexact — car les cinq principaux membres du « puissant petit groupe » comme les nomma Stassov, furent au moins six, avec Liadov qui se joignit à eux, en 1870, ou sept, si, comme il est juste, on compte parmi leurs fondateurs Dargomijski.
Mili-Alexandrevitch Balakirev (1837-1910) s'était voué aux mathématiques et aux sciences naturelles. Pianiste de valeur, admiré de Glinka, sa maison devint le centre musical le plus fréquenté de Pétersbourg. Ce fut lui qui réunit les Cinq, d'âges très différents mais professant tous, comme Dargomijski, « que le son doit exprimer directement l'idée. » D'où César Cui déduit que l'opéra doit être essentiellement musical, que la mélodie, au théâtre, doit correspondre exactement au sens des paroles, que les formes de l'opéra doivent naître, exclusivement et librement de la situation dramatique et des exigences du texte (*). En dépit de ce credo, chacun des Cinq suivra la pente naturelle de son tempérament ; il ne restera de commun entre eux que la volonté d'écrire une musique foncièrement russe. Balakirev n'a point composé d'opéra et n'a laissé, pour le théâtre, que la musique de scène pour le Roi Lear (1858-1861).
(*) R. HOFMANN, loc. cit., p. 83.
César-Antonovitch Cui (1835-1918) tout en poursuivant ses études scientifiques et en devenant professeur de fortification à l'Académie des Ingénieurs de Pétersbourg, ne cessa jamais de s'occuper de musique. Mais César Cui, dans ses opéras, s'est fort peu soucié d'art national. Non seulement il en emprunte les sujets le plus souvent à l'histoire et à la littérature occidentales, mais, sauf dans le Prisonnier du Caucase (1857) et dans la Fille du Capitaine (qui ne fut pas représentée), sauf encore dans le Festin pendant la Peste, il s'est beaucoup plus rapproché d'Auber que de ses amis russes.
Alexandre-Porfirievitch Borodine (1834-1887) est, au contraire, avec Moussorgski, le plus fidèlement attaché aux idées qui avaient présidé à la fondation du groupe. Sa famille était issue des princes Imeritinski, qui régnèrent en Imérétie, au Caucase. Musicien-né, il n'en devint pas moins médecin et chimiste, et enseigna à l'Académie militaire de médecine où il rencontra Moussorgski. Par celui-ci, il connut Balakirev. Il s'aperçut qu'il pouvait être autre chose qu'un amateur et combla les lacunes de son instruction théorique. Grand voyageur, il visita Liszt, qui l'encouragea, et même le mit en garde contre l'académisme et lui conseilla de suivre les impulsions de sa nature. On a fait à son opéra le Prince Igor (qu'il ne put achever, et qui fut terminé par Glazounov et Rimski, puis joué en 1890 à Pétersbourg) le reproche d'être une suite de mélodies sans lien entre elles, parce qu'il ne savait guère développer. Reproche peut-être juste, en théorie, mais ne vaut-il pas mieux avoir écrit les Danses Polovtsiennes, l'air de Iaroslavna, l'air d'Igor, tels qu'ils sont ; et les trois Symphonies, et les Steppes de l'Asie centrale, au risque de passer pour « autodidacte » — que d'avoir risqué de perdre cette originalité puissante dont Borodine a pétri ses ouvrages ?

Théâtre Alexandre (aujourd'hui Théâtre Lénine) à Saint-Pétersbourg [gravure en couleur d'après Courvoisier]
On a fait le même reproche à Modeste-Petrovitch Moussorgski (1835-1881) qui le mérite encore moins. Officier sans fortune au régiment de la Garde Préobrajinski, il abandonna l'armée jeune encore pour se consacrer à la musique. Mais sa situation précaire l'obligea à rentrer dans l'administration. Il s'aigrit, s'usa dans la lutte, et s'adonna à l'alcool — ce qui contribua à faire naître la légende de son incapacité. Une autre raison en fut les retouches faites par Rimski à Boris Godounov. Certes elles aidèrent le public à comprendre (si tant est qu'on puisse mieux comprendre un texte adultéré que l'original, puisque c'est autre chose qu'on entend). Mais il n'est pas douteux que la version originale eût été moins facilement acceptée en 1896 qu'aujourd'hui. Nous savons que l'ouvrage, présenté au Comité de lecture des Théâtres impériaux, fut refusé en 1870 ; que Moussorgski le remania aussitôt, et qu'il fut représenté pour la première fois sans aucun succès au Théâtre Marie le 24 janvier 1874. La version de Rimski date de 1896-1908. Lorsqu'on la compare avec l'original, on comprend que les audaces de Moussorgski — il se vantait d'ailleurs d'avoir inventé des moyens d'expression nouveaux, hors des lois qui jusque-là avaient régi la musique — pouvaient effrayer les auditeurs, musiciens ou non, à la fin du XIXe siècle. Dans une certaine mesure, Rimski rendit service à Moussorgski, et il eut la modestie de déclarer lui-même dans ses souvenirs que si l'avenir permettait de donner Boris dans le texte original, il souhaitait que l'on ne tînt point compte de ses corrections. Le malheur est qu'aujourd'hui ces corrections soient devenues une tradition. Le malheur est en outre que l'usage se soit établi d'inverser les deux derniers tableaux et de faire que l'ouvrage se termine sur la mort de Boris et non sur l'acte de la révolte et sur la déchirante complainte de l'Innocent. Enfin écourter, et même supprimer le rôle de Rangoni, comme on le fait parfois, est un non-sens qui fausse complètement le caractère de l'œuvre.

premier tableau de Boris Godounov de Moussorgski
Moussorgski s'était préparé au drame lyrique par la composition d'une Salammbô dès la publication du roman. Il l'abandonna assez avancée pour que des fragments aient pu lui servir pour Boris.
Qu'on ne s'en étonne point : Moussorgski est trop profondément russe pour concevoir une carthaginoise qui ne fût pas Moscovite, et, comme le dit R. Hofmann, « toute peinture musicale est forcément subjective ». Ce qui importe est que Moussorgski ait réussi un ouvrage tel qu'il le voulait faire et tel qu'il ne ressemble à rien de ce qui avait été fait avant Boris, un drame lyrique à la fois réaliste et symbolique, où le personnage principal, le tsar assassin, a pour partenaire essentiel un personnage multiple et divers, le peuple, dont le rôle est plus important encore que le sien. Drame de conscience, drame du remords, et drame politique, lutte des boyards contre le pouvoir de l'autocrate, lutte de l'église romaine, personnifiée par le jésuite Rangoni contre le schisme d'Orient ; lutte de la Pologne catholique contre le tsarisme ; tout cela est dans Boris Godounov, grâce à Pouchkine, certes, mais tout autant grâce à Moussorgski.
Quels moyens a-t-il employés pour faire tenir tant de choses dans un texte musical dont le caractère le plus frappant est l'unité de style ? Il s'est servi du leitmotiv mais en l'assouplissant. Le leitmotiv devient pour lui un « thème varié ». Ainsi, remarque R. Hofmann, le thème de Pimène, symbolisé dans sa chronique plutôt qu'en lui-même, par deux mesures sévères, sereines, religieuses, devient martial aussitôt que Pimène parle de la guerre, large comme un torrent lorsqu'il évoque le flot de l'histoire des hommes, très doux comme un cantique lorsqu'il peint le tsar Ivan assis dans une cellule de moine et conversant avec ses frères. On pourrait multiplier les exemples, particulièrement en suivant les transformations du thème de Dimitri, qui devient celui de Gregory dès qu'a germé, dans l'esprit de celui-ci, la pensée de se substituer au tsarévitch assassiné. Le mérite inimitable de Moussorgski est dans la simplicité de sa déclamation : il y a en ceci une sorte de miracle, car, chantée en russe ou dans la version française de Louis Laloy, la musique épouse si parfaitement l'action, les pensées, les gestes des personnages, qu'elle semble elle-même une traduction des paroles. Cela est vrai de toutes les scènes, qu'il s'agisse de la tragique hallucination de Boris, de sa mort, des propos fielleux de Chouiski, du long monologue de Pimène, la justesse des accents apparaît partout extraordinaire, et l'on ne s'étonne point de l'admiration de Debussy pour cette profondeur expressive. Certes, il y a des faiblesses dans la partition : le rôle de Marina est conventionnel, cela est bien sûr. Mais s'il existe des gaucheries dans Boris, que pèsent-elles auprès de ces merveilles que sont le tableau du couronnement, l'acte du couvent, la scène du carillon, la mort de Boris, l'acte de la révolte, et cette simple et déchirante lamentation de l'Innocent, pleurant sur la Russie — par quoi devrait s'achever l'ouvrage que Moussorgski put intituler sans exagération « drame national » ?

Feodor Chaliapine dans Boris Godounov
Avant Boris, outre Salammbô qui fut abandonné, Moussorgski avait écrit le premier acte d'un opéra le Mariage ; il ne l'acheva pas et entreprit après Boris, deux ouvrages, la Khovantchina et la Foire de Sorotchintsi qu'il ne put terminer. La Khovantchina contient des pages qui surpassent peut-être les meilleures scènes de Boris. Mais le poème, remanié à différentes reprises par Moussorgski, est obscur. Il avait trouvé dans le sujet ce qui pouvait séduire ses goûts : une peinture du conflit opposant la vieille Russie fidèle à ses traditions, à l' « occidentalisme » de Pierre le Grand, et il a mis toute sa foi dans les parties qui expriment le fond même de l'âme russe, son mysticisme. Le conflit sentimental, l'amour coupable de Marfa pour le jeune prince André Khovanski, n'est à la vérité que secondaire. Ce qui compte c'est le symbole, c'est l'esprit que représente La Khovantchina (le mot signifie : partisan du vieux prince Khovantski, défenseur des traditions), et c'est cela que traduit la mystérieuse introduction symphonique, c'est cela que l'on trouve dans les chœurs, dans la nostalgique chanson de Marfa au troisième acte. La Foire de Sorotchintsi est inspirée d'un conte de Gogol, et c'est, cette fois, l'esprit de l'Ukraine qui conduit le musicien. En intercalant la Nuit sur le mont Chauve dans la Foire, il voulait exprimer « la diablerie » paysanne. Moussorgski ne put l'achever, et la version que l'on joue au théâtre est due à Tcherepnine qui la termina et l'orchestra.
On a dit de Nicolas-Andréevitch Rimski-Korsakov beaucoup de bien — qui est mérité — et assez de mal, souvent injuste. Il fut incontestablement celui des Cinq qui acquit le métier le plus solide. Il n'a sans doute pas été le plus grand artiste, et, à ce point de vue, il n'a égalé ni Moussorgski ni Borodine. Ancien officier de marine, il laisse voir dans ses ouvrages un goût de l'ordre, on dirait même de la discipline qui n'empêche point d'ailleurs l'éclat, la fantaisie. Le compositeur qui a signé Antar, le finale de Shéhérezade, Sadko, Snegourotchka, Kitège et le Coq d'or est un des maîtres de la musique moderne; le symphoniste qui orchestra le Capriccio espagnol a donné un modèle de science instrumentale. Et si la croisière de trois ans que dut faire le jeune aspirant interrompit fâcheusement ses études musicales, il en rapporta au moins tout un monde fantastique qui allait singulièrement renouveler l'art lyrique de son siècle. Peu de temps après, il abandonna la navigation et devint le seul musicien professionnel du groupe des Cinq en acceptant la chaire de composition au Conservatoire de Pétersbourg. En 1873, la Pskovitaine — dont le sujet est la révolte de la ville de Pskov, domptée par Ivan le Terrible — fait dire à Moussorgski : « C'est absolument ça notre bonne vieille Russie ! » En 1880, Rimski fait jouer son second opéra, la Nuit de mai, inspiré du conte de Gogol. L'œuvre est très poétique avec ses clairs de lune, ses chants de Naïades, ses berceuses et ses complaintes. La même année, il écrit Snegourotchka (la Fille de Neige) dont il prend le sujet dans une pièce d'Ostrovski : un prologue symphonique traduit l'éveil de la nature aux premiers rayons du soleil printanier : la fille du vieil Hiver et de la Fée du printemps est consumée par Yarilo, le dieu-Soleil, et tout au long de la partition, on entendra les chants des oiseaux. Snegourotchka ne connaît pas l'amour ; quand elle en aura la révélation, elle fondra comme la neige. Sadko, créé à Moscou en 1897, est un conte qui pourrait être détaché des Mille et une Nuits, mais transporté en Russie : le riche marchand Sadko va faire commerce avec les peuples lointains. Immobilisé par le calme, pour apaiser le « Tsar des mers », Sadko se rend dans son palais sous-marin et le charme par son talent de musicien. Après bien des péripéties, il revient, retrouve son épouse fidèle Lioubava. La musique extrêmement savante, pittoresque, est d'une variété et d'une couleur merveilleuses. Elle fut triomphalement accueillie, et Rimski se mit à la composition de Mozart et Salieri, puis de Vera Scheloga et de la Fiancée du Tsar représentés en 1898 et 1899. Le Tsar Saltan (1900) est peut-être le chef-d’œuvre de Rimski. La partition, pleine de verve, évoque un monde fantastique où l'on voit le tsar terrible et bon enfant, la méchante Babarika, la touchante Militrissa, son fils Gvidon, et la Princesse-Cygne, qui semblent sortir d'un album enfantin. Les concerts ont popularisé le Vol du bourdon, qui sert de prélude au troisième acte.

costumes de J. Bilibine pour le Tsar Saltan de Rimski-Korsakov (Paris, 1929)
L'Immortel Katcheï porte pour sous-titre « Petit Conte d'automne » et Katcheï est un magicien qui retient sous un charme la fiancée d'Ivan le Terrible ; elle ne sera délivrée que le jour où la fille de Katcheï aura versé une larme de douleur ou d'amour. Ivan parvient à séduire la farouche Katchéïevna, et l'abandonne. Elle pleure. Le charme est rompu et Ivan peut s'unir à sa fiancée. L'œuvre reflète à la fois l'influence de Wagner et de l'impressionnisme ; elle est d'une habileté d'écriture extrême. En 1904 Rimski-Korsakov achevait la Légende de la ville invisible de Kitège, d'inspiration religieuse, où s'opposent la douce figure de la pure Fevronia et de l'ivrogne Koutierma qui sera sauvé par l'angélique douceur de la jeune fille, après que sa foi aura rendu la ville de Kitège invisible aux yeux des Tartares envahisseurs. La part faite à la symphonie dans Kitège, la beauté des chœurs ont fait comparer à Parsifal l'opéra de Rimski. Le Coq d'or, terminé en 1908, fut interdit par la censure : elle crut que le roi Dodon, son armée, ses courtisans, offraient une image certes dérisoire, mais trop reconnaissable du régime tsariste. La construction de l'œuvre est extrêmement curieuse : il y a trois personnages principaux : le roi, la reine de Chemakha et l'astrologue. Celui-ci est le centre du prologue et de l'épilogue ; le roi Dodon du premier et du troisième acte, et la reine du deuxième. La symétrie est complète. A noter que les deux motifs du Coq sont identiques, à cela près que le second est l'envers du premier (mi, do, ré, mi, fa, sol, mi — mi, sol, fa, mi, ré, do, mi) ce qui traduit à merveille en notes de valeurs égales le conseil donné à Dodon, par le premier : Règne et dors en ton lit clos ! — et l'avis qui présage sa mort : Ouvrez l'œil et garde à vous !
Rimski-Korsakov opère avec un rare bonheur la synthèse d'un apport wagnérien fort important et d'éléments spécifiquement russes. La couleur de son orchestre est éblouissante. Nature contemplative et optimiste, il a créé dans ses ouvrages lyriques un monde à sa ressemblance — et qui n'est pas fort éloigné du monde créé par Mozart.
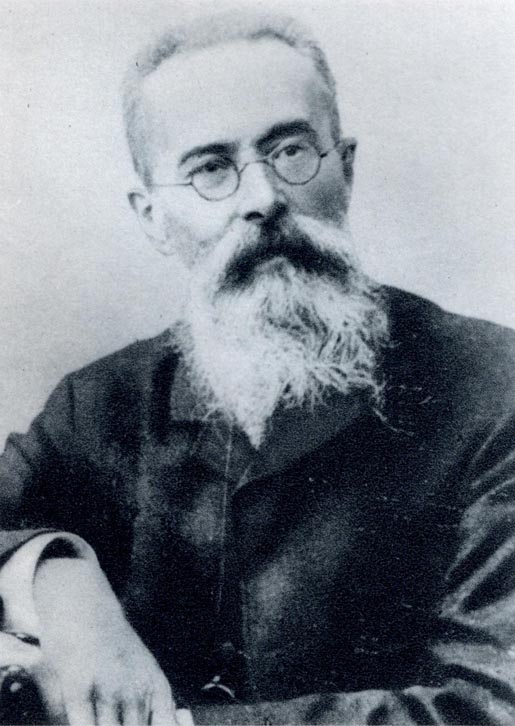
Nicolas-Andréevitch Rimski-Korsakov [photo Harlingue]
Tout différent est Pierre Ilijtch Tchaïkovski (1840-1893), dont la musique reflète le caractère tourmenté, mélancolique, que sa timidité rend profondément malheureux au milieu des plus grands succès. Musique inégale, d'ailleurs, que l'on juge occidentale en Occident, et plus russe qu'aucune autre en Russie. Différence qui tient à ce que Tchaïkovski est aux antipodes d'un Borodine et d'un Moussorgski, très loin aussi de Rimski, sans doute parce qu'il se soucie fort peu de « nationalisme », et que les thèmes empruntés au folklore perdent sous sa plume leur couleur.
Son premier succès fut une ouverture pour Roméo et Juliette (1869) dont on a fait un ballet. Il écrivit dix opéras et en détruisit deux, sauf des fragments : le Voïvode, 1868, et Ondine, 1869, dont il utilisera bien des passages dans le Lac des Cygnes, ballet en quatre actes (1876). Pour l'ouverture, il s'inspire, et de fort près, du motif « le mystère du nom » de Lohengrin. Mais l'œuvre est, en dépit de quelque vulgarité, fort bien écrite pour la danse, et toujours Tchaïkovski montrera dans ses ballets le même souci de fournir au chorégraphe toute la diversité de rythmes nécessaire pour varier les pas. La Belle au bois dormant (1889), et Casse-Noisette (1892), ont de semblables qualités et sont aujourd'hui classiques. Dans Opritchnik (1874), l'influence de Meyerbeer est manifeste, et César Cui en éprouve « un sentiment de commisération profonde ». En 1876, Vakula le forgeron n'obtient guère qu'un succès d'estime. Mais Eugène Onéguine, d'après Pouchkine, est mieux apprécié, le 23 janvier 1881, à Moscou, et s'impose au cours des représentations suivantes ; cette fois c'est l'influence de Gounod que subit le musicien, et elle lui est bienfaisante. L'ouvrage est regardé comme un des chefs-d’œuvre de l'art lyrique russe. Le sujet est d'une mélancolie profonde : le drame d'une vie manquée, un drame intime, un rêve de jeune fille, brisé par le destin, un duel tragique, et puis, au dernier acte, le triste constat par la femme et l'homme qui auraient pu être heureux, qu'il est trop tard, offraient à Tchaïkovski l'occasion d'épancher dans sa musique ses propres angoisses. Il a réussi à donner au théâtre un ouvrage qui est, dans le domaine lyrique, ce que l'Éducation sentimentale est dans le roman.
Ni Jeanne d'Arc (1881), ni Mazzeppa (1884), ni l'Enchanteresse (1887). ni Yolande (1892) ne peuvent être comparés avec Eugène Onéguine ni avec la Dame de Pique, son autre chef-d’œuvre, dont le livret est lui aussi tiré d'une nouvelle de Pouchkine. Traduite par Mérimée, elle est trop connue pour qu'il soit besoin d'en rappeler le sujet. La partition est construite sur trois thèmes principaux, dont l'un, celui de la vieille comtesse à qui Hermann, en la menaçant de mort, a arraché le secret des trois cartes qui doivent lui donner la fortune, crée dans l'esprit de l'auditeur une véritable obsession. Le musicien y montre une habileté extrême, mais qui est gâtée trop souvent par la facilité.
Il faudrait citer auprès de ces musiciens dont les œuvres ont duré, sans doute parce qu'elles offrent aussi bien aux Russes qu'aux Occidentaux un reflet plus ou moins marqué de l'âme russe, des compositeurs qui, bien que contemporains des premiers, ont écrit des opéras comme ceux d'Anton Rubinstein — dont César Cui put dire : « Ce n'est pas un compositeur russe, c'est un Russe qui est compositeur. » Feramors (1863), le Démon (1875), Nero (1879) se sont répandus principalement en Allemagne. Ils sont fort bien écrits, mais manquent de personnalité.
A Serge Rachmaninov (1873), on doit Aleko (1893), le Chevalier ladre (1900), Francesca da Rimini (1906) — qui n'ont point dans sa production l'importance de ses œuvres pour le piano et l'orchestre. Enfin, on retrouvera plus loin Igor Stravinski et Serge Prokofiev dont le rôle est si important dans l'évolution de la musique contemporaine.
L'école tchèque avec Smetana, Dvorak et Janacek enrichit l'art lyrique de quelques ouvrages remarquables. Friedrich Smetana (1824-1884), est l'auteur de huit opéras écrits sur des livrets tchèques. Deux d'entre eux ont acquis une renommée universelle : la Fiancée vendue (1865) la doit à son inspiration populaire, au rythme franc des motifs dont le compositeur a tiré adroitement parti. Son ouverture est célèbre et mérite sa renommée. Libussa (1881) est un grand tableau dramatique d'une sincérité chaleureuse ; qualités qui ont fait le succès de son beau poème symphonique Vlast (Ma Patrie).
Si les symphonies et les Danses slaves de Dvorak (1841-1904) lui ont valu la gloire, ses opéras le Roi et le charbonnier, Wanda (1876), Dimitri (1882), Rusalka (1901), Armida (1904), montrent qu'il était non moins doué pour le théâtre. D'essence plus populaire encore est l'art de Léos Janacek (1854-1928), dont les opéras Jarka, Pocatek romanu (1894), surtout Jenufa (1904) et Liska Bystrouska (le Petit renard rusé, 1922) mettent au service d'un art à la fois pittoresque et sobre, extrêmement personnel, une technique hardie, qui presque systématiquement proscrit la résolution des appogiatures (*). A Vitezslav Novak, né en 1870, on doit quelques opéras Zvikovski rarasek (1915), Karlstein (1916), Lucerna (1923) où se manifestent son sentiment de la nature et l'influence de l'impressionnisme.
(*) Cf. Daniel MULLER, Janacek (collection Maîtres de la Musique antienne et moderne, Rieder, 1930).
Karol Szymanowski (1883-1937) a surtout écrit pour le concert ; mais ses deux opéras Hagieth (1922) et le Roi Roger (1926), son ballet Harnasie représenté à l'Opéra en 1936, montrent que le maître polonais avait su retrouver le secret de la musique nationale. On doit à l'illustre pianiste Paderewski (186o-1941) deux opéras : Manru et Sakuntala. Alexandre Tansman et Henri Opienski, le premier avec la Nuit Kurde, le second avec Maria ont utilement travaillé au renom de l'école polonaise.
Bien que Peer Gynt ne soit pas un opéra, la part qui est faite à la musique dans l'ouvrage d'Ibsen pour lequel Edvard Grieg (1843-1907) écrivit une importante partition, a plus fait pour l'école scandinave que les œuvres lyriques des autres compositeurs, restées peu connues hors des pays nordiques. L'école belge a produit avec Jan Blockx (1851-1912) des œuvres puissamment colorées : Princesse d'auberge (1896), la Fiancée de la Mer (1901). Les deux frères Jongen ont donné, l'aîné, Joseph (1873) une légende mimée, l'Arka, et un opéra Jelyane ; le second, Léon (1884), l'Ardennaise, le Rêve d'une nuit de Noël et Thomas l'Agnelet. Victor Vreuls (1876-), outre la musique de scène pour le Songe d'une Nuit d'été, a composé un drame lyrique : Olivier le Simple (1922). Albert Dupuis (1877-), qui fut comme lui élève de d'Indy, a montré un tempérament dramatique dans la douzaine d'ouvrages lyriques qu'il a signés (l'Idylle, Martyle, Fidelaine, le Château de Bretèche, la Passion, etc.). A Louis Delune, on doit le Fruit défendu, le Diable galant ; à Marcel Poot (1901-), un opéra-comique : Moretus, des ballets (Pâris et les trois Divines), et de très curieuses partitions de « jeux radiophoniques ».
La Suisse romande a été très activement représentée dans la musique dramatique de la fin du XIXe siècle et du commencement du XXe par Jaques-Dalcroze (1865-1950) qui débuta à Genève en 1882 avec la Soubrette, puis donna le Violon maudit (1893), Janie (1894), Sancho Pança, le Bonhomme Jadis (Opéra-Comique, 1906), les Jumeaux de Bergame (Bruxelles, 1908) ; et par Gustave Doret (1866-1943) qui fut l'animateur des fêtes des Vignerons vaudois, tout en restant mêlé à la vie musicale parisienne. Les Armaillis (1906), la Tisseuse d'Orties furent créés à l'Opéra-Comique en 1906 et en 1926. Ernest Bloch, né à Genève en 1880 et qui depuis 1916 s'est fixé en Amérique, fit représenter à l'Opéra-Comique en 1910, Macbeth ; il a écrit un opéra, Jezebel. On retrouvera plus loin Arthur Honegger au chapitre consacré aux contemporains. Jean Dupérier (1886-) est l'auteur d'un charmant Zadig, que l'Opéra-Comique joua en 1939 et d'un Malade imaginaire, créé à Genève en 1934.
Aussi bien par ses travaux de musicologie que par son enseignement au Conservatoire de Madrid, Felipe Pedrell (1841-1922) fut le principal initiateur de la renaissance musicale en Espagne au XIXe siècle. Il a donné au théâtre El ultimo Abencerajo (1874), Quasimodo, la Celestina, la Matinada, Ramon Lull. Isaac Albeniz (1860-1909) dont l'essentiel de ses ouvrages est du domaine pianistique, a cependant enrichi l'art lyrique d'une féerie, The Magic Opal créée à Londres en 1893, et d'un opéra-comique, Pepita (Carlsruhe, 1905). Enrique Granados (1868-1915) débuta au théâtre avec Maria del Carmen (2898) et Folletto (1903) avant de tirer lui-même de son chef-d'œuvre, les Goyescas, un opéra. Mais il appartenait à Manuel de Falla (1876-1946) de réaliser dans sa plénitude la renaissance de l'école espagnole en la ramenant aux sources mêmes de l'art populaire, en lui rendant et sa vigueur et sa fraîcheur. Élève de Pedrell, il s'essaie dans des zarzuelas et commence la partition de la Vida breve, qui obtient le prix au concours national en 1905, l'année même où le pianiste excellent qu'est Falla se voit décerner le premier prix Ortiz y Cusso, récompensant le meilleur virtuose de la péninsule. Il arrive à Paris, ne croyant y demeurer que quelques jours, et il y reste sept ans. Il porte sa partition à Paul Dukas. Le maître s'enthousiasme : « Pourquoi ne vous jouerait-on pas à l'Opéra-Comique ? » Falla n'ose en croire ses oreilles. Ce ne fut pourtant qu'en 1913, à Nice, que la Vie brève fut créée, mais le retard ne fut point dû à Paul Dukas : grâce à lui Falla se trouvait accueilli parmi les artistes parisiens : ses compatriotes Albeniz et Ricardo Viñès, qu'il ne connaissait pas, Debussy, qui bientôt le traita comme un frère, Florent Schmitt, Maurice Ravel, Maurice Delage. Et c'est à Paris qu'il écrivit Nuits dans les jardins d'Espagne et les Siete Canciones.
Salud, une gitane de l'Albaïcin, a pour amant un riche bourgeois, Paco. Ils s'aiment ; il lui a juré qu'il n'aimerait jamais qu'elle. Et elle apprend qu'il doit épouser le lendemain une héritière. L'oncle de Salud veut tuer Paco. Salud descend au matin vers Grenade et, à travers les grilles du patio, elle assiste aux noces ; puis, se mêlant aux invités, elle entre avec son vieil oncle, crie la trahison dont elle est victime. Paco veut la chasser ; elle tombe morte à ses pieds : la vie est brève aux pauvres, longue et heureuse aux riches. Sur ce livret vériste de la Vida breve, Falla a écrit une partition d'inspiration nette et franche, parfois brutale, et qui rappelle à ces instants Mascagni. Mais la couleur dont il a paré cette musique, mais les danses qui forment la plus grande part du deuxième acte, mais, à la fin du premier, le soir qui tombe sur Grenade, ont une couleur, une poésie qui sont d'un maître symphoniste ; l'œuvre de début portait déjà la marque du grand musicien qui allait écrire le Tricorne et l'Amour sorcier. Le premier de ces ballets (El Sombrero de tres picos), fut créé par la troupe de Diaghilev à Londres le 22 juin 1919 avec une chorégraphie de Massine ; le livret de Martinez Sierra s'inspire d'une nouvelle d'Alarcon, et montre les plaisantes aventures d'un corregidor trop galant, berné par une jolie meunière. Le second (El Amor brujo) fut créé dans une première version par Pastora Imperio à Madrid en 1955. Falla l'avait écrit pour dix instruments ; il le réorchestra, et sous sa forme nouvelle, avec Argentina pour interprète, l'Amour sorcier devint vite une des œuvres les plus applaudies au théâtre comme au concert. Le scénario est dû au même librettiste ; mais cette fois, c'est chez les gitans qu'il nous conduit, dans une cueva grenadine où la tribu vit en troglodyte. La belle Candelas a aimé naguère un gitano qui la rendit malheureuse. Il est mort et le printemps venu, Candelas s'éprend de Carmelo. Mais chaque fois qu'elle veut l'étreindre, le spectre de l'autre se dresse devant elle. Un stratagème de Carmelo la délivre : la jolie Lucia va au-devant du spectre, l'entraîne loin de la cueva et Candelas peut s'abandonner à son amant. Le Tricorne nous offrait le visage de l'Andalousie « paysanne et narquoise » ; l'Amour sorcier nous montre son autre aspect tragique (*). Jamais art plus raffiné ne s'est approché davantage de l'art populaire. Jamais non plus la musique n'a traduit avec plus de vérité les sentiments élémentaires, la frayeur, le désir, la joie, et ne s'est faite incantatoire avec plus de puissance.
(*) Roland MANUEL, Manuel de Falla, edit. « les Cahiers d'Art », 1930.
El Retablo de Maese Pedro, « adaptation musicale et scénique d'un épisode de l'ingénieux chevalier Don Quichotte de la Manche », fut écrit entre 1919 et 5923 d'après les chapitres XXV et XXVI de la seconde partie du roman — la bataille contre les marionnettes, où le chevalier errant met en pièces une armée de carton. Mais les spectateurs de ce combat sont eux-mêmes figurés : ils entourent un gigantesque Quichotte, et un jeune garçon, muni d'une baguette, commente pour les assistants les épisodes de la délivrance de Mélisendre, captive des Mores, par son époux Don Gaïferos. Ici et là, interviennent « le récit du Truchement, les avis de Maître Pierre et les réflexions de l'Ingénieux Hidalgo. » En écrivant pour les marionnettes, Falla « a moins songé au comique qui se dégage invinciblement de leurs gestes brefs qu'à cette sorte de raideur hiératique qui ennoblit leurs pantomimes et fait de ces acteurs sans âme et sans voix, mais aussi sans vulgarité, les interprètes choisis de l'épopée populaire (*) ». L'orchestre est réduit, l'harmonie concise et austère, la ligne mélodique presque enfermée dans l'étendue d'un tétracorde. Par cette œuvre si forte, Falla « retournant à l'antique » y trouvait un point d'appui pour s'élancer vers une nouveauté que nul n'a dépassée.
(*) Cf. Roland MANUEL (loc. cit., pp. 48-50) a qui j'emprunte l'essentiel de cette analyse.
IV
Au milieu du XIXe siècle, apparaît l'opérette. J. Combarieu en fait remonter la naissance au XVIIIe ; il est vrai que les Singspiele, les comédies à ariettes, comme Doktor und Apotheke du Viennois Ditters von Dittersdorf, qui en écrivit une trentaine, ressemblent fort à des opérettes, ainsi que la centaine d'ouvrages légers de Wenzel Muller, son ami. Mais à ce compte, il faudrait ranger dans l'opérette toute la production de la Foire, et quantité d'opéras bouffes avec elle. Il semble plus juste de ne point chercher au genre des origines trop lointaines. L'opérette telle que la conçurent Offenbach et Hervé correspond aux goûts d'une époque assez dédaigneuse de la « grande » musique. La cour de Napoléon III ne s'en soucie guère. Berlioz n'y trouve aucun appui officiel ; mais Morny protège Offenbach. L'opérette fait fureur à l'instant que la société élégante montre un appétit de plaisirs faciles et veut, avant tout « s'amuser », sans trop regarder à la qualité de ses plaisirs. Pourtant il se trouve que ce ne sont point de mauvais musiciens — il s'en faut — ni de mauvais librettistes qui travaillent à la divertir. Ceux-ci, qui se nomment Crémieux, Ludovic Halévy, Henri Meilhac, ne manquent ni de culture ni de grâce spirituelle. Il y a dans leurs bouffonneries dont l'antiquité ou les grands du monde contemporain font les frais, une satire endiablée, une verve qui les sauvent de la platitude et les éloignent de la vulgarité. Les musiciens qu'ils s'associent, un Offenbach, un Hervé, rehaussent la cocasserie des couplets et la drôlerie des anachronismes par la singularité des rythmes disloquant la mélodie, aussi bien que par les trouvailles d'une orchestration ingénieuse. Au bout d'un siècle, Orphée aux Enfers (1858), la Belle Hélène, la Vie parisienne, la Périchole, la Grande-Duchesse, font toujours rire. Le public des Bouffes et des Variétés entre 1850 et 1870 était encore assez renseigné sur les héros d'Homère pour goûter les plaisanteries sur Calchas et son tonnerre, sur Ménélas et ses malheurs, et pour comprendre l'humour d'un chœur sur les paroles Oiè képhalè. Un petit goût de sacrilège se mêlait pour lui à la saveur d'une musique échevelée, parodiant volontiers des ouvrages lyriques célèbres. Offenbach ne voulut point seulement être un amuseur. Il écrivit les Contes d'Hoffmann, après avoir donné quatre-vingt-dix opérettes et voulut, dans cette œuvre mélancolique, mettre le meilleur de lui-même. Il y réussit, mais mourut le 5 octobre 1880, âgé de 61 ans, sans avoir eu le temps d'orchestrer complètement cet opéra-comique, que Guiraud termina et qui, représenté le 10 février 1881, est demeuré au répertoire en maintenant son succès.

costumes de Draner pour la Vie parisienne, opérette d'Offenbach (1866)
Florimond Ronger, dit Hervé (1825-1892) s'est peint au naturel dans Mam'zelle Nitouche, car il fut organiste à Saint-Eustache après avoir rempli les mêmes fonctions à l'asile de Bicêtre. En 1848, il interpréta lui-même avec son camarade Joseph Kelm son premier ouvrage, Don Quichotte, où sa verve débridée se donnait carrière et, en 1853, il obtenait de Morny le privilège des Folies-Concertantes pour y faire jouer ses opérettes. L'une avait pour titre le Compositeur toqué : le nom en resta à l'auteur. Il avait devancé Offenbach ; il demeura son rival, écrivant une cinquantaine de partitions : l'Œil crevé (1867), le Petit Faust (1869), la Femme à papa (1879), Mam'zelle Nitouche (1883) dont il fit lui-même les livrets.
Charles Lecocq (1832-1913) remporta concurremment avec Bizet le premier prix ex-æquo au concours institué par Offenbach sur le livret du Docteur Miracle (1857). Excellent musicien, formé par Halévy, il eut des débuts difficiles et ne trouva le succès qu'en 1868, avec Fleur d'été qui atteignit rapidement cent représentations. Les Cent Vierges, en 1872, puis, quelques mois plus tard, la Fille de Madame Angot — son chef-d’œuvre — la Petite Mariée (1875), le Petit Duc (1878), le Cœur et la Main (1883), rencontrèrent un accueil enthousiaste dû à l'élégance de leur facture, aux qualités d'un musicien dont le savoir et le goût ont haussé l'opérette jusqu'au niveau des meilleurs opéras-comiques. Edmond Audran (1842-1901) fut élève de l'École Niedermeyer où il fit d'excellentes études. L'Ours et le Pacha, créé en 1862 à Marseille, où son père dirigeait le Conservatoire, décida de sa vocation de compositeur d'opérettes, après qu'il se fut fixé à Paris. Le Grand Mogol (1877), la Mascotte (1880), Miss Helyett (1890) obtinrent un succès qui n'est pas encore épuisé. Robert Planquette (1848-1903) doit aux Cloches de Corneville (1877), à Rip (1882) et à Surcouf (1887) d'avoir survécu à son époque. Louis Varney (1844-1908) était le fils d'un chef d'orchestre qui dut la célébrité à la composition de la musique du Chant des Girondins, dans le drame de Dumas et Maquet, le Chevalier de Maison-Rouge (1847) et qui fut la Marseillaise de la révolution de 1848. Louis Varney écrivit une quarantaine d'opérettes dont les Mousquetaires au Couvent (1880), Fanfan la Tulipe (1882), Riquet à la houppe (1889), le Papa de Francine (1896).

costumes de Grévin pour la Fille de Madame Angot, opérette de Lecocq (1872)
Avec André Messager (1853-1929), un musicien de très haute valeur enrichit l'opérette de quelques chefs-d’œuvre tels que François les Bas bleus (1883), la Fauvette du Temple (1885), les Bourgeois de Calais (1887). La Basoche (1890), les P'tites Michu (1897), Véronique donnent au genre léger une perfection dont la conséquence imprévue est d'amener à l'opérette des compositeurs qui, dix ou vingt ans plus tôt, auraient dédaigné d'écrire de la musique bouffe ; et l'on peut dire qu'avec Chabrier, André Messager anoblit le genre sans lui ôter rien de sa gaieté. D'ailleurs, avec des ouvrages comme ceux qu'il écrivit dans la pleine maturité de son talent, la distinction est bien subtile qui sépare l'opérette de l'opéra-comique. Le « parlé » subsiste plus volontiers dans l'opérette ; mais Madame Chrysanthème (1893) est un ouvrage de demi-caractère, à peu près comme le délicieux Fortunio (1907) ; et c'est bien plutôt leur livret qui fait ranger parmi les opérettes des pièces comme Monsieur Beaucaire, Passionnément et Coups de roulis (1928).
C'est aussi l'élégance qui fut le caractère dominant de Reynaldo Hahn (1874-1947), musicien savant, qui traita tous les genres, montra dans tous la distinction d'un grand lettré, et excella dans l'opérette où son esprit pouvait plus aisément épancher son humour parfois voilé de mélancolie. Ciboulette (1924), Mozart (1925), Brummel (1931), Malvina (1936), ont rencontré le succès, renouvelé à chaque reprise. L'Ile du Rêve, en 1898, la Carmélite, en 1902, furent remarquées ; puis à l'Opéra-Comique, Reynaldo Hahn donna Nausicaa en 1919 et, en 1935, le Marchand de Venise à l'Opéra. Des ballets (le Bal de Béatrice d'Este, la Fête chez Thérèse, le Dieu bleu), une comédie musicale, jouée à l'Opéra-Comique après sa mort (le Oui des Jeunes Filles, 1949), et partout, il a répandu les dons qui, dès ses débuts, à l'âge où d'autres n'en sont encore qu'au balbutiement, lui avaient valu avec ses recueils de mélodies (Chansons grises, Études latines), la notoriété. Ses pièces de musique de chambre, ses Concerti pour piano, pour violon, ses œuvres symphoniques et ses chœurs pour Esther auraient suffi, à défaut de ses opérettes, pour qu'on ne l'oublie point.
Claude Terrasse (1867-1923) avait comme Messager passé par l'École Niedermeyer et commencé comme organiste sa carrière de compositeur d'opérettes. Excellent musicien, lui aussi, esprit délié, il enrichit le genre léger d'ouvrages charmants tels que les Travaux d'Hercule (1901), le Sire de Vergy (1903), Monsieur de La Palisse (1904) et donna à l'Opéra-Comique, en 1910 le Mariage de Télémaque, un chef-d’œuvre d'humour parodique, en parfait accord avec le spirituel livret de Jules Lemaître et Maurice Donnay.
Les centaines de représentations obtenues par les comédies musicales et les opérettes de Maurice Yvain (Dédé, Pas sur la bouche, Un bon garçon, Ta bouche, Chanson gitane, etc.) sont dues aussi bien au sens profond du théâtre qu'aux qualités du compositeur, à sa verve sans cesse renouvelée. L'éclatant succès de Moineau (1931) fit regarder Louis Beydts comme l'héritier de Messager (auquel il avait rendu dans cette opérette un délicat hommage) ; les Canards Mandarins, la même année, puis S. A. D. M. P. (1936), A l'aimable Sabine (1947), en même temps que ses mélodies et ses ouvrages destinés au concert, lui ont valu la juste réputation d'un des musiciens les mieux doués de sa génération.
Regardée en France, à ses débuts, comme un genre secondaire, l'opérette n'a point cessé d'attirer des musiciens de haute valeur. Elle a conquis ainsi une place fort importante dans la production contemporaine. Ni Vincent d'Indy, ni Albert Roussel, ni Claude Delvincourt, ni Jacques Ibert, ni Arthur Honegger, ni Marcel Delannoy ne l'ont dédaignée — et il faudrait joindre à ces noms, sans prétendre être complet, ceux de Maurice Ravel — dont l'Heure espagnole s'apparente à l'opérette ; de Roland-Manuel, de Manuel Rosenthal, P.-O. Ferroud, Henri Sauguet, Maurice Thiriet, Francis Poulenc, Germaine Tailleferre, Maurice Fouret, Hirchmann, etc.
Genre français, à ses débuts, l'opérette se répandit bien vite à travers l'Europe ; à Vienne, Johann Strauss fils dont les valses connaissaient un succès non moins vif que celles de son père, songeant à tirer parti de cette renommée grandissante donnait, en 1871, sa première opérette, Indigo (remaniée par Reiterer, elle prit pour titre la Mille et unième Nuit, en 1906.) Puis vinrent le Carnaval à Rome, en 1873 et enfin son grand triomphe, Die Fledermaus (la Chauve-Souris), en 1876, succès égalé par celui du Zigeunerbaron (le Baron tzigane, 1885). Son frère cadet, Joseph, utilisa lui aussi les mélodies de ses danses pour Die Schwalben aus dem Wienerwald (les Hirondelles de la forêt viennoise, 1906). Les valses firent de même la vogue des opérettes du Hongrois Franz Lehar (1870-1948), Wiener Frauen, Die Lustige Witwe (la Veuve joyeuse, 1905), Der Graf von Luxembourg (1909), le Pays du sourire, où il s'est trop souvent abandonné à la facilité.
Importées en Europe après la guerre de 1914-1918, les opérettes américaines y ont introduit les germes destructeurs du genre. Si la musique a toujours sa part dans les opérettes de Gershwin et de Youmans, elle obéit aux exigences du jazz, à ses rythmes binaires, à ses glissandi perpétuels, mais le pire danger est dans la formule de ces ouvrages à grand spectacle, nécessitant des effectifs énormes de boys, de girls, de danseurs, de figurants, des décors somptueux — entreprises purement commerciales où le plaisir, assez suspect, des yeux, passe bien avant l'intérêt de la partition, où il est bon même que celle-ci satisfasse les goûts les moins raffinés. Et c'est de cela que l'opérette française de Chabrier, de Messager et de Reynaldo Hahn est menacée de mourir.
FRANCKISME, RÉALISME
NÉO-CLASSICISME ET IMPRESSIONNISME
I
La génération qui arrivait à la maturité au lendemain de la guerre de 1870, et qui avait créé la Société nationale en prenant pour devise Ars gallica, n'en subit pas moins l'influence de Wagner. Mais les musiciens français qui admirèrent le maître de Bayreuth — et comment ne l'eussent-ils pas aimé ? — surent pour la plupart assimiler ses théories sans imiter servilement son style. Le « wagnérisme » de Vincent d'Indy n'est pas plus que celui de Chabrier le fait d'un épigone, et le groupe de la Schola doit tout autant à Bach, à travers Franck, tout autant à nos polyphonistes de la Renaissance, à travers Bordes, qu'à l'auteur de Parsifal.
César Franck lui-même — la remarque est de d'Indy — n'a donné au théâtre que deux « essais moins dramatiques que ses oratorios » ; et si la valeur musicale de Hulda (1885, représenté à Monte-Carlo en 1894) et de Ghisèle (1889, Monte-Carlo, 1896) est certaine, la médiocrité des livrets les a condamnés à l'oubli. Le ballet d'Hulda reste une belle page symphonique ; mais comme l'a bien remarqué Norman Demuth, les deux ouvrages paraîtraient à leur avantage à la radio, alors qu'ils ont tout à perdre au théâtre (*).
(*) Norman DEMUTH, Cesar Franck (Londres, Dennis Dobson, 1949). Dans cette étude, la plus complète qui ait été publiée sur Franck, le musicologue anglais signale un Stradella, œuvre de jeunesse dont V. d'Indy ne fait pas mention, et le Valet de ferme, abandonné par Franck.
Comme Wagner, Vincent d'Indy a composé lui-même les poèmes de ses ouvrages lyriques (exception faite de son opérette le Rêve de Cinyras (sur un livret de Xavier de Courville, 1927) ; et chacun d'eux offre un symbole (*) : le Chant de la Cloche (Concerts Lamoureux, 1886, représenté à la Monnaie en 1909) d'après Schiller, c'est, résumé en une série de tableaux, le destin de l'homme : joies, espoirs, tristesse et grandeur. Mais le Chant de la Cloche appartient bien plus au concert qu'au théâtre. Fervaal, au contraire, a été conçu pour la scène et fut créé à la Monnaie le 12 mars 1887, puis joué à l'Opéra de Paris en 1898. Le héros imaginé par d'Indy semble le frère de Parsifal ; sa pureté est le gage du salut de sa patrie, mais la mystique du drame n'est chrétienne qu'accessoirement : l'action se déroule dans les Cévennes aux temps druidiques, et Fervaal est le fils des Nuées. Les Sarrasins menacent la Celtide, et pour préserver la montagne sainte de Cravann, Fervaal, instruit par le druide Arfagard, devra résister à l'amoureuse Guilhen qui l'a recueilli blessé, et l'a soigné. Il succombe à la passion, mais, rappelé par Arfagard, il s'enfuit, combat l'armée de Guilhen, perd la bataille et cherche la mort. Arfagard le retrouve : Fervaal supplie le druide de le sacrifier aux dieux. Mais on entend un appel de détresse : Guilhen égarée dans les neiges de la montagne appelle son amant. Arfagard veut arrêter Fervaal. Celui-ci le tue, rejoint la Sarrazine mourante, l'emporte dans ses bras où elle expire. Le héros alors, dans une vision, croit apercevoir le sort de sa patrie, et, tandis qu'on entend le Pange lingua, il s'avance vers la Cravann nouvelle, « brillante de clarté » : l'Amour a vaincu la Mort. Tel est le symbole développé dans Fervaal. Les critiques furent divisés. Beaucoup reprochèrent au musicien l'emploi « excessif » du leitmotiv, et virent dans cette construction thématique une sorte de travail de marqueterie. Il suffit d'écouter sans parti pris pour trouver dans Fervaal une émotion purement humaine qui n'a point à souffrir de la rigueur d'un système. La partition atteste la différence existant entre l'orchestre de Wagner et celui de Fervaal. D'Indy évite les empâtements, garde partout une clarté, une légèreté de touche; et il en va de même de son écriture vocale. Nulle part on ne trouverait dans Wagner rien de comparable à l'enroulement délicat des Nuées chantant sans paroles dans la scène de l'évocation de 1a déesse Kaïto au deuxième acte. Nulle part on ne rencontrerait semblable présence de la nature dans la musique : le symbolisme de l'œuvre en est tout éclairé, et la science du technicien disparaît grâce à la maîtrise de l'artiste inspiré. Tout le dernier acte, cette progression qui trouve sa conclusion dans le Pange lingua, atteint la grandeur de la Cène de Parsifal. Fervaal est l'image même de d'Indy : on y trouve à la fois sa rude énergie et sa tendresse. Le musicien qui a signé la plainte de Guilhen délaissée, cette phrase dont la suavité passionnée est cependant d'un si ferme dessin, atteint les sommets de son art.
(*) Attendez-moi sous l'orme (Opéra-Comique, 1882) ne fut, au dire de d'Indy lui-même, qu'un essai sans importance. Sur V. d'Indy, cf. les deux volumes de Léon VALLAS (Albin Michel).

Théâtre de la Monnaie à Bruxelles [photo Neurdein]
Dans l'Étranger (la Monnaie, 7 janvier 1903) c'est encore le problème du sacrifice qui fait le fond du drame. L'Étranger est venu sur une côte sauvage parmi les pêcheurs. Vita lui dit son amour, et lui-même avoue qu'il l'aime. Pour lui elle abandonnerait son fiancé, le douanier André. Mais dès qu'il a fait à Vita l'aveu de son trouble, l'Étranger doit s'éloigner : « Adieu, Vita ! adieu ; moi je pars dès demain, car je t'aime d'amour ; et tu le savais bien ! » L'Étranger brave la mer déchaînée pour porter secours à une barque en péril. Vita l'accompagne ; mais comme Fervaal, l'Étranger a perdu, en prononçant les mots d'amour, la pureté qui faisait sa force. Et la tempête l'engloutit avec Vita.
La Légende de saint Christophe est l'illustration d'une page de Voragine : trois actes, de chacun trois scènes, où l'on voit Auferus se vouant au service du souverain le plus puissant ; il sert donc la Reine de Volupté. Mais vite convaincu qu'elle est moins puissante que le Roi de l'Or, il passe au service de celui-ci. Comme il le voit trembler devant le Bouc, il va servir Sathanaël jusqu'au jour où le Diable, passant avec lui devant une église, tremble en entendant s'élever le chant O Crux, ave, Spes unica. Alors Auferus se met en quête de cette Croix et de cet unique espoir, plus puissants que Satan. Et, devenu Christophe, il s'installe près d'un torrent et se fait passeur. Et le miracle se produit tandis qu'il porte un enfant sur ses épaules. Baptisé par le Christ, Christophe subit le martyre.
Représenté à l'Opéra le 9 juin 1920, l'ouvrage fut accueilli avec déférence, mais non sans grandes réserves, souvent dues au caractère du livret, à ses tendances antisémites. La musique, résolument tonale, est autant que celle de Fervaal, éloignée des lourdeurs wagnériennes, et l'interlude symphonique précédant le deuxième acte, la Queste de Dieu, est une page magistrale, l'une des plus belles du maître. Dans la Légende — comme il avait fait dans l'Étranger, mais d'une manière plus fréquente et plus ample — d'Indy utilise avec une rare habileté les thèmes liturgiques.
Dans le Rêve de Cinyras, sur le charmant livret de Xavier de Courville confondant astucieusement la guerre de Troie et la guerre de 1914-1918, d'Indy montre un esprit parodique et léger fort inattendu de ceux qui, sans le connaître, le jugeaient sur sa réputation. Il est dommage que l'ouvrage n'ait jamais été repris : il contribuerait à restituer au grand musicien son vrai visage qui savait sourire. En sortant de la première représentation de l'Étranger, Debussy écrivait ces lignes que l'on peut appliquer à tout le théâtre de d'Indy : « Libre celui qui y cherchera d'insondables symboles. J'aime à y voir une humanité que d'Indy n'a revêtue de symbole que pour rendre plus profond cet éternel divorce entre la Beauté et la vulgarité des foules. Sans m'attarder à des questions de technique, je veux rendre hommage à la sereine bonté qui plane sur cette œuvre, à l'effort de volonté à éviter toute complication, et surtout à la hardiesse tranquille de Vincent d'Indy à aller plus loin que lui-même. Et si tout à l'heure je me plaignais de trop de musique, c'est que çà et là elle me paraît nuire à cet épanouissement total qui orne d'inoubliable beauté tant de pages de l'Étranger… »
Le Pays, de Guy Ropartz, créé à l'Opéra-Comique le 16 août 1913 — et dont on s'étonne qu'il n'ait pas été repris après avoir obtenu sur d'autres scènes, comme à Paris avant la guerre de 1914, tant de succès — est une des œuvres les plus nobles de l'art lyrique français. Le livret, tiré de l'Islandaise de Le Goffic, est simple : Tual, pêcheur breton, est jeté par la tempête en Islande. Kathe soigne la blessure du jeune marin et s'éprend de lui. Il croit l'aimer assez pour demeurer avec elle. Mais la nostalgie le ronge ; il prend un cheval, se sauve — malgré l'enfant que Kathe doit mettre au monde. Il s'enlise dans les sables mouvants. Tout est sobre, puissant et ramassé dans ce drame lyrique, tout y est profondément humain. L'art dépouillé et cependant délicat du musicien a merveilleusement traduit l'âme bretonne ardente et mystique. Rien d'inutile, pas une note qui ne serve à marquer en traits d'une singulière justesse les caractères et les situations, les pensées secrètes, que l'on voudrait chasser et qui reviennent avec insistance. Le déchirement de Tual et de Kathe est traduit avec une habileté qui n'est que vérité. Et la savante architecture de l'ouvrage si parfaitement ordonné, le choix de thèmes extrêmement expressifs, l'orchestration qui les met en pleine lumière, tout révèle la main d'un maître.
La même noblesse anime les deux ouvrages d'Albéric Magnard, ami fraternel de Guy Ropartz, — Bérénice et Guercœur. Bérénice fut créée le 14 décembre 1911 à l'Opéra-Comique. Le livret, dû au musicien, suit la tragédie de Racine en y ajoutant quelques scènes exotiques. L'œuvre, pure et sobre, a fait comparer par Adolphe Boschot la partition à la musique de chambre, parce que l'émotion en est profonde mais tout intérieure. L'éloge est mérité, et pourtant l'ouvrage ne fut joué que huit fois et abandonné malgré l'admiration unanimement exprimée par la critique.
La « tragédie musicale » en trois actes Guercœur ne fut créée à l'Opéra en avril 1931 que grâce à Guy Ropartz, qui reconstitua l'orchestre du troisième acte, détruit en 1914 dans l'incendie de la maison de Magnard où l'héroïque musicien s'était barricadé pour résister aux Allemands. Guercœur, qui a sauvé sa patrie, obtient des divinités de revenir sur terre après sa mort. Il trouve remariée la femme qu'il aimait, et son pays retombé dans la servitude. Rien ne subsiste de ce qu'il a fait, rien de ce qu'il a chéri, et il meurt une seconde fois, emportant de ce retour à la vie le désir d'en perdre à tout jamais le souvenir. L'inspiration très noble de Magnard lui a dicté de belles et grandes pages symphoniques, des chœurs et des ensembles admirables. La sereine péroraison de l'épilogue, le quatuor vocal, est d'une souveraine beauté.
La Princesse lointaine, que G.-M. Witkowski fit représenter à l'Opéra le 22 mars 1934, ne modifie que dans quelques détails la pièce de Rostand. Le musicien composa sa partition avec le dessein — nettement exposé dans un article du Ménestrel et non moins franchement réalisé — de « sortir du système de la symphonie avec déclamation ajustée », « de rendre aux voix, sans diminuer l'intérêt de l'orchestre, la place expressive qui leur revient dans l'expression dramatique, et de renoncer à les submerger constamment sous le flot des thèmes et des dessins. » Witkowski, musicien de grande culture, sut donner à son orchestre des sonorités fluides, nacrées, argentines et son harmonisation audacieuse, la souplesse de la ligne mélodique font de la Princesse lointaine un ouvrage d'un caractère très nouveau.
Pierre de Bréville n'a laissé qu'un seul ouvrage lyrique : Éros vainqueur, sur un livret de Jean Lorrain, représenté à la Monnaie en 191o, et que l'Opéra-Comique ne se décida à monter qu'en 1932. Il avait, auparavant, écrit la musique de scène de la Princesse Maleine et des Sept princesses de Maeterlinck. Le livret porte sa date ; la musique point, et elle sembla rendre plus sensible encore le vieillissement du poème, de ses grâces préraphaélites. Le roi, leur père, prétend soustraire Argine, Tharsyle et Floriane aux dangers de l'amour et les fait élever dans un verger ceint de fortes murailles. Éros se rit des remparts et des lansquenets. Il enchante les trois princesses : deux le suivent, l'autre meurt, blessée par la flèche du dieu. La musique neutralise le « relent frelaté » du livret : l'instrumentation est fine, transparente ; les voix — ce qui n'étonne point de l'auteur des admirables recueils de mélodies — sont traitées magistralement. Des pages comme la vaporeuse introduction, le chœur des lansquenets, le sommeil des princesses et leur éveil, le tableau du gynécée, la vision d'Argyne en agonie, auraient assuré le succès vingt-cinq ans plus tôt. La réparation donnée à P. de Bréville ne vint qu'au moment où l'Opéra-Comique allait être emporté par la débâcle où il faillit sombrer : Éros vainqueur en fut victime.
Ernest Chausson n'a, lui aussi, composé qu'un drame lyrique, le Roi Arthus, et cet ouvrage créé à Bruxelles en 1903, n'a jamais paru sur une scène parisienne, bien qu'il ait été exécuté plusieurs fois au concert. L'influence de Wagner et de Franck s'y décèle aisément, mais l'ouvrage traduit dans sa trame musicale l'âme du compositeur tourmenté du désespoir de n'atteindre jamais le haut idéal qu'il s'était fixé, une âme mystique et douloureuse. Son drame s'inspire des amours de l'épouse du roi Arthus, Genièvre, et de Lancelot, que surprend Mordred. Celui-ci blesse Lancelot — comme Melot Tristan — et les amants s'enfuient. Arthus consulte Merlin qui lui prédit la ruine de la Table ronde. Il poursuit les fugitifs. Lancelot, bourrelé de remords, s'offre au combat. La prophétie de Merlin se réalise : les chevaliers de la Table ronde se sont entre-tués. Arthus, tandis que les esprits aériens chantent sa gloire et l'appellent dans l'au-delà, pardonne à Lancelot mourant. Le deuxième acte, avec la prophétie de Merlin, est d'une sombre et noble grandeur.
Sur un poétique livret de Maurice Magre, Déodat de Séverac écrivit le Cœur du Moulin, que l'Opéra-Comique représenta le 8 décembre 1909 : partition délicieuse, limpide, malgré quelques souvenirs wagnériens, musique d'une couleur et d'un parfum chauds comme la terre du Languedoc dont elle a jailli, musique toute proche de la nature, franche et droite comme le compositeur disparu prématurément sans en avoir vu une reprise souhaitée par tous. Ce que Séverac fit pour le Lauraguais et la Cerdagne, J. Canteloube l'a fait pour l'Auvergne, avec la même sincérité et le même bonheur. L'Opéra créait le Mas en avril 1929. Jan, à la ville, a oublié son Quercy natal. Il y revient ; on l'y aime, et Marie n'a d'yeux (qui sont beaux) que pour lui. Pourtant, il veut s'en retourner. Mais la terre lui fait entendre ses voix puissantes en sa chanson des saisons ; et Jan reste au mas familial. Sujet très simple : c'est la terre qui est le personnage principal du Mas ; c'est elle que l'on entend dans la symphonie, dans les danses paysannes, dans le murmure de la source, dans les pages où le musicien sait faire parler la nature en poète. Dans Vercingétorix (Opéra, 20 juin 1933), c'est l'esprit de sacrifice, le renoncement, la grandeur du héros gaulois, et c'est encore un chant d'Auvergne au milieu des évocations celtiques. Orchestration brillante qui, pour la première fois à l'Opéra, utilisait les ondes Martenot.
Paul Le Flem s'est, comme Guy Ropartz, inspiré de la Bretagne, son pays natal ; mais le fabliau modernisé avec esprit par Gandrey-Réty, lui a fourni le sujet d'une œuvre légère et gaie, le Rossignol de Saint-Malo (Opéra-Comique, 1943) : les roucoulades nocturnes du rossignol aident une épouse infidèle à berner son mari. Vingt ans plus tôt, Le Flem avait su ressusciter la « chantefable » d' Aucassin et Nicolette et y montrer autant d'esprit que de goût et d'érudition. Issu comme lui de la Schola, Jean Poueigh a célébré le pays basque dans Perkain, représenté à l'Opéra le 25 janvier 1934.
Le tempérament dramatique d'Antoine Mariotte s'était affirmé dès 1908 dans Salomé, créée à Lyon, et qui devait comme on sait, faire l'objet d'une retentissante querelle avec l'éditeur de Richard Strauss avant d'être donnée à l'Opéra en 1919. La prière des Nazaréens et le finale sont les meilleures pages d'une partition que celle de Strauss a fait pâlir. Les dons de coloriste de Mariotte éclatent dans Esther : le livret d'André Dumas et S.-Ch. Leconte lui proposait une juive farouche, telle que la Bible la montre. Mais la violence des situations, si elle trouve son équivalent dans la musique, n'exclut pas une belle simplicité de lignes, les rythmes franchement énergiques, sous un orchestre parfois trop fourni (Opéra, 28 avril 1925). Tenté depuis longtemps par le rire de Rabelais, Mariotte voulut transporter à la scène les géants du maître François, et le rideau de l'Opéra-Comique se leva le 15 février 1935 sur Gargantua, œuvre touffue, truculente autant qu'il se pouvait au théâtre, mais non sans longueurs. Gargantua contient de pleines réussites : la naissance du héros célébrée par un motet qui mêle plaisamment l'Adeste fideles à la Marseillaise, et qui grossit, devient énorme autant que le fils de Gargamelle, ou encore comme le duo de Gargantua et de Madeleine. L'orchestration, aussi savante que celle d'Esther, sonne plus clairement — comme le rire de Rabelais.
Officier de marine comme Mariotte et comme Albert Roussel (dont il sera parlé plus loin) Jean Cras retrouva la mer et ses enchantements dans le Polyphème d'Albert Samain et le mit en musique (Opéra-Comique, 31 décembre 1922). Si l'action est presque nulle, si le récitatif souvent psalmodique n'est point sans quelque monotonie, due à la difficulté d'écrire une mélodie sur des alexandrins, l'orchestre, les chœurs appelant les Nymphes des eaux et des bois, la scène finale où Polyphème exhale sa douleur devant Galathée endormie, et se fait conduire vers la mer sont d'une exquise poésie.
Bérangère, de Marcel Labey, fut primée au concours de la Ville de Paris en 1921 et créée au Havre en 1925. Le prélude du deuxième acte — entre autres — est une page symphonique d'une qualité remarquable. Le livret en est dû à Mme Sohy-Labey, elle-même élève de d'Indy, et auteur d'un drame lyrique, l'Esclave couronnée, représenté à Mulhouse en 1947 avec succès.
Arthur Coquart, disciple de Franck et ami de Lalo (c'est à lui que fut confié le soin d'achever la Jacquerie), a laissé des ouvrages lyriques trop oubliés aujourd'hui et cependant point négligeables : l'Épée du roi (Angers, 1884), le Mari d'un jour (Opéra-Comique, 1886), l'Oiseau bleu, au même théâtre (1894). Dans Jahel, créé à Lyon en 1900 et dans la Troupe Jolicœur (Opéra-Comique, 1902), Coquart a donné le meilleur de lui-même. Jouée après Louise, mais écrite antérieurement, la Troupe Jolicœur, inspirée d'une nouvelle d'H. Cain, met en scène avec un réalisme très vigoureux et sincère, le monde des forains ; la fête du 14 juillet, au premier acte, est d'une vie intense ; ailleurs c'est l'émotion, la pitié pour les humbles, que traduit avec discrétion une musique écrite avec un soin tout classique, mais qui n'est pourtant jamais froide. Le même souci de correction se retrouve dans Léone, de Samuel Rousseau (Opéra-Comique, 1910), œuvre posthume, qui a pour sujet une vendetta.
Bien que né à Bolzano qui alors se nommait Botzen, Sylvio Lazzari, Autrichien d'origine, choisit d'être Français par amour pour notre pays ; montagnard du Tyrol, il dut cependant à la mer et au terroir breton les pages maîtresses de son œuvre. Élève de Guiraud et de Franck, près desquels il paracheva une culture musicale déjà très solide, il subit, comme tous ceux de sa génération, l'influence wagnérienne sans que les dons de clarté qu'il possédait en fussent altérés. Ses drames lyriques unissent deux qualités rarement accouplées : un jaillissement mélodique extrêmement original, et une richesse harmonique qui n'est jamais de la lourdeur.
Il débute en 1887, avec une pantomime Lulu. En 1898, Armor est créé à Prague ; puis, séduit par le drame d'H. Bataille, la Lépreuse, il le met en musique. La partition, achevée en 1899, est reçue aussitôt à l'Opéra-Comique. Mais durant treize années, Lazzari dut soutenir une lutte acharnée, porter le conflit devant la justice et jusqu'à la tribune de la Chambre pour obtenir de Carré qu'il tînt ses engagements. Carré qui cependant n'avait pas retenu l'ouvrage sans en connaître le sujet, s'avisa tout à coup de la tristesse du livret : Alyette est lépreuse, elle cache son mal, parce qu'elle est passionnément aimée par Ervoanik. Les parents de celui-ci soupçonnent la vérité et s'opposent au mariage. Les amoureux partent ensemble pour un pèlerinage au Folgoët, espérant un miracle. La vieille Tili, mère d'Alyette, pousse diaboliquement sa fille à transmettre le mal maudit à Ervoanik. Au retour du Folgoët, celui-ci est lépreux avéré et doit quitter la ferme natale pour aller vivre dans une maison isolée près d'une fontaine, sans aucun contact avec les autres humains. Alyette repentante l'y rejoindra. Carré avait tort : la première représentation, le 7 février 1912, fut triomphale et la Lépreuse est restée au répertoire. La partition rend à merveille l'atmosphère de la Bretagne des calvaires et des pardons, mais le folklore n'y tient guère de place : Lazzari ne doit qu'à lui-même les couleurs de sa palette, comme il ne doit qu'à sa sincérité la puissance expressive des scènes capitales de l'ouvrage. Chaque acte est d'une justesse dramatique admirable, et, au troisième, le musicien, par les effets les plus simples, atteint dans la scène déchirante des adieux d'Ervoanik, au moment où on lui impose la cagoule noire, une émotion intense.

scène de la Lépreuse de Lazzari (reprise à Paris, 1943 ; sur scène L. Arnoult et M. Sibille) [photo Seeberger]
Le sujet du Sauteriot créé à Chicago en 1913, puis joué en 1920 à l'Opéra-Comique, est tiré d'une pièce de Keyserling ; une fillette, enfant naturelle qu'on nomme par dérision le sauteriot (la sauterelle), rudoyée de tous et désespérée, offre à la Vierge noire sa vie pour que soit sauvée la femme qui la maltraite et qui est mourante. Mais après avoir fait ce vœu, le sauteriot a la révélation de l'amour ; elle se reprend, tente de se délier, puis se convainc que son amoureux se moquait d'elle. Alors, elle boit d'un trait la potion destinée à la malade, et qui, à cette dose, sera mortelle. Et la Vierge noire prend sa vie en échange de la vie de la mourante. La partition est d'une justesse d'expression étonnante. L'orchestre est fluide, et cependant puissant. Il se peut que le Sauteriot soit le chef-d’œuvre — hélas, méconnu — de Lazzari.
La composition de Melœnis avait précédé celle du Sauteriot ; mais l'ouvrage ne fut créé à Mulhouse qu'en 1927, et malgré l'accueil enthousiaste qu'il reçut en Alsace, il ne fut point joué à Paris. En mai 1928, l'Opéra donnait la Tour de Feu. Lazzari attestait une fois encore son amour de la Bretagne par un drame où la mer tient le premier rôle, un drame de la jalousie, qui affole Yves, gardien de phare et le pousse à incendier la tour où il veille, pour que sa femme, Naïc, ne puisse rejoindre le riche étranger qui la devait enlever, et qu'il fasse naufrage. Ici encore, la puissance de la musique est en plein accord avec la fureur des éléments déchaînés et la violence des passions qu'elle évoque. Mais la partition ne vaut point seulement par le paroxysme des scènes finales : les danses paysannes, les chœurs populaires du premier acte ont une douceur idyllique. Sylvio Lazzari, âpre et ardent, sait aussi traduire les sentiments purs et le calme de la mer apaisée... Les neuf morceaux de la musique de scène pour le Faust d'Henri Bataille ont cette variété qu'ils doivent à un musicien de race : à travers l'adaptation française, Lazzari sait rejoindre la pensée de Goethe.
Si les œuvres symphoniques de Gabriel Pierné, ses morceaux de musique de chambre, ses délicieuses mélodies, tiennent une place importante dans sa production, son théâtre n'est pas moins remarquable : ce que l'homme avait d'exquis s'y reflète.
En 1895, il aborde le théâtre avec la Coupe enchantée, créée à Royan ; en 1897, il donne à Lyon Vendée ; en 1901, la Fille de Tabarin révèle ses dons dramatiques, sa force ; en 1910, On ne badine pas avec l'amour transpose dans une partition délicate la désinvolture et la mélancolie de Musset ; enfin son esprit, en même temps que son adresse, trouvent dans Sophie Arnould, en 1927, à l'Opéra-Comique, une affirmation plus manifeste encore. Un sujet périlleux, tout en nuances, une évocation d'amours anciennes, un instant ranimées, tout ce qui, chez d'autres, eût risqué d'être banal ou guindé, devenait sous sa plume miracle de grâce légère et attendrie.
Il est surprenant que le musicien de Saint François d'Assise ait été celui de Fragonard (1934), et avec le même bonheur. Le livret d'A. Rivoire et R. Coolus met en scène une aventure du peintre galant, s'amourachant de sa jeune belle-sœur, et, tiraillé entre sa femme, qu'il appelle « la Caissière », et sa maîtresse la Guimard — une aventure qui finit bien après avoir failli tourner mal. Il y a dans cette comédie musicale autant de mélancolie que de légèreté, et tout cela est d'une finesse de touche égale à celle du peintre dont l'ouvrage porte le nom. Il en est de même de Cydalise et le chèvre-pied, ballet sur un scénario de Robert de Flers et A. de Caillavet, créé à l'Opéra en 1923, et d'Impressions de music-hall (Opéra, 1927). Dans Cydalise, les danses des faunes et des nymphes, au premier acte, sur des modes grecs, le divertissement oriental au deuxième, sont des chefs-d’œuvre d'humour, et les Impressions résument avec une rare adresse les excentricités d'un spectacle de « variétés ».

scène de Cydalise et le Chèvre-pied de Pierné [photo Lipnitzki]
Georges Hüe dont les Pantins avaient été joués dès 1881, retint l'attention avec le Roi de Paris en 1901, et en 1910, avec le Miracle, joués à l'Opéra. Dans l'ombre de la Cathédrale, drame inspiré du roman de Blasco Ibañez (Opéra-Comique, 1921), opposait l'idéal religieux à l'idéologie socialiste ; mais l'ouvrage vaut surtout par la couleur espagnole que le musicien sut lui donner ; un ballet, Siang-Sin (Opéra, 1924), obtint plus de cent représentations ; l'ironie et la gaieté de Riquet à la houppe (Opéra-Comique, 1928) sont dues plus encore à la partition savante et légère qu'au livret. Aux frères Hillemacher — tous deux prix de Rome — et qui collaborèrent constamment, on doit le Régiment qui passe (Opéra-Comique, 1894), Circé (1907) et le Drac, créé à Carlsruhe en 1896, et donné à l'Opéra en 1942. Après la mort de Lucien, Paul Hillemacher écrivit Fra Angelico, joué à l'Opéra-Comique en 1925. Malgré l'habileté de leur écriture ces ouvrages sont oubliés. Le ballet de Ch.-M. Widor, la Korrigane, créé en 1880, reparaît de temps en temps à l'Opéra, grâce surtout à la « sabotière » qui en a fait le succès. Mais c'est à sa musique d'orgue, plus qu'à Maître Ambros, qu'aux Pêcheurs de Saint-Jean (Opéra-Comique, 1886 et 1906), qu'à Nerto (Opéra, 1924), que Ch.-M. Widor doit sa renommée et sa survie. Bien oubliés aussi sont les ouvrages que Paul Vidal eut la malchance de faire représenter à une époque où les opéras, selon le mot de Louis Laloy, tombaient les uns après les autres comme capucins de cartes : ni Guernica (1895), ni la Burgonde (1898) n'ont pu durer. Xavier Leroux eut plus de chance — méritée, — et qu'il doit à la chaleur, à la sincère véhémence de ses ouvrages (Astarté, 1901 ; la Reine Fiammette, 1904, où se reflète l'influence de Massenet ; le Chemineau, 1907, demeuré au répertoire de l'Opéra-Comique ; la Plus forte, 1924 ; Théodora, 1907). Le Carillonneur, d'après Rodenbach, renferme une page très habile : le concours des carillons.
Le Juif polonais (Opéra-Comique, 1900) valut à Camille Erlanger un succès durable — et qui se continuerait si l'ouvrage était repris. L'œuvre, adroitement écrite, est nourrie de folklore alsacien. En 1904, le Fils de l'Étoile était très favorablement accueilli à l'Opéra : la partition renferme les deux hymnes à Apollon restitués par Théodore Reinach. Dans Aphrodite, inspirée du roman de Pierre Louÿs, Erlanger utilisa les modes grecs ; il a su donner à sa partition une sorte de transparence voluptueuse bien en accord avec le sujet. Forfaiture, laissée inachevée, fut terminée à la hâte et subit un échec à l'Opéra-Comique.
Alfred Bachelet, l'un des meilleurs musiciens de sa génération, a pris une place de premier rang parmi les compositeurs de théâtre avec trois ouvrages d'une qualité exceptionnelle. Scemo, créé à l'Opéra en 1914, fut repris à l'Opéra-Comique en 1926. Le livret de Ch. Méré porte à la scène un drame de la superstition : le berger corse Lazzaro passe pour jeter des sorts : les paysans le bannissent. Il menace, se défend ; son accusateur Arrigo rentre chez lui, persuadé que le jettatore l'a ensorcelé, et il meurt de frayeur, dénonçant Lazzaro à la vindicte des hommes du clan. Ceux-ci s'emparent du berger pour le brûler vif et l'attachent à un arbre. Francesca, fille d'Arrigo, devra mettre le feu au bûcher. Pour ne point voir celle qu'il aime commettre cette atrocité, Lazzaro s'arrache lui-même les yeux. Un contrebandier le recueille et l'abrite dans sa grotte, où Francesca veut le rejoindre. Mais elle est devancée par son mari Giovann'Anto, qui veut tuer le jettatore. Il s'émeut de pitié : que Lazzaro le poignarde et qu'il vive avec Francesca. Lazzaro refuse, et quand Francesca arrive, il lui dit que l'amour s'est éteint en son âme comme son regard s'est éteint en ses yeux. Il ment, mais, trompée, Francesca s'éloigne avec Giovann'Anto ; et Lazzaro pleure son amour si généreusement nié, mais plus vivant que jamais en lui. Tout dans cette partition est d'une force concentrée, d'une justesse d'accents dédaigneuse de l'effet facile. Et la musique semble dégager le parfum capiteux de la Corse.
Quand la cloche sonnera est un drame non moins vigoureux que créa l'Opéra-Comique en 1923 : un acte qui dure une heure et demie et semble trop court. Les personnages essentiels sont ici les cloches qui doivent donner le signal attendu pour qu'un pont saute et coupe la route à l'ennemi — mais du même coup le fiancé de Manouchka, dont le propre père sonnera la cloche, sera anéanti. Le mystère qui plane, l'évocation par l'orchestre de la voix des cloches, sont rendus par le musicien avec une sûreté qui laisse l'auditeur haletant.
L'œuvre capitale de Bachelet, Un Jardin sur l'Oronte, fut créée à l'Opéra le 3 novembre 1932. Franc-Nohain avait tiré son livret du roman de Barrès, en lui laissant bien sa valeur de symbole : les amours du chevalier Guillaume et de la sultane Oriante c'est le conflit de deux races, de deux idéaux, et c'est ce qu'Alfred Bachelet sut exprimer. Ce n'est pas seulement en utilisant les vocalises orientales pour les voix sarrazines et la musique médiévale pour les Croisés qu'il y est parvenu ; c'est la substance même de son œuvre, sa sobre grandeur qui en fait la noblesse. Il a traduit en poète des sons la griserie des nuits voluptueuses dans les jardins embaumés de l'Oronte et le drame de conscience qui font du chevalier Guillaume un félon ; son ouvrage est d'un grand musicien.

décor de la création d'Un Jardin sur l'Oronte, opéra de Bachelet (Paris, 1932)
Au début du siècle, alors que le mouvement réaliste représenté par Bruneau et Charpentier entrait en lutte avec l'impressionnisme de Debussy (on sait combien impropres sont les termes par lesquels il est d'usage de désigner ces écoles, mais l'usage les impose), beaucoup de compositeurs obtenaient du succès qui restaient cependant fidèles à des formes plus traditionnelles, tout en subissant l'influence des idées nouvelles. Henri Rabaud donnait la Fille de Roland en mars 1904 à l'Opéra-Comique, et déjà ses ouvrages symphoniques lui avaient valu la notoriété. On retrouvait dans le drame lyrique écrit d'après la pièce d'Henri de Bornier la solidité constructive montrée par le musicien de la Procession nocturne ; ces qualités firent traiter Rabaud d'académiste. Classique ou même néo-classique eût été plus juste : Rabaud sut rendre au drame assez plat de Bornier un caractère épique, et l'on y trouve déjà les qualités qui feront, dans un tout autre genre, le succès de Mârouf, savetier du Caire, créé à l'Opéra-Comique en juin 1914. Cet ouvrage, tiré par Lucien Népoty des Mille et une Nuits, faillit être victime de la guerre. Le succès des premières représentations avait été cependant assez vif pour décider celui de la reprise. Puis l'ouvrage passa au répertoire de l'Opéra, où il s'est maintenu — chose rare — sans perdre son attrait. Sa réussite exceptionnelle n'est pas le fait du hasard qui mit entre les mains du musicien le plus habile un des livrets les meilleurs qui se pouvaient trouver. Elle est due plus encore à la finesse d'un compositeur qui, possédant mieux qu'aucun autre le sens du théâtre, a su teinter d'un orientalisme délicat son humour très français, et écrire une partition dont les pages se succèdent en allant de trouvailles en enchantements. Et pour affirmer, comme il l'avait fait déjà avec son second Job, qu'il était capable d'âpreté et de rudesse, Rabaud donnait en 1924 l'Appel de la mer dont il avait lui-même écrit le livret d'après Synge. Ici, plus de gentillesses, mais la simplicité nue d'un fait divers tragique ; plus de palais orientaux, mais la chaumière misérable d'une famille de marins dans l'île d'Aran : l'océan a déjà pris cinq de ses fils à la vieille mère ; le sixième se noie, et la pauvre femme pleure devant les lambeaux de vêtements qu'on lui rapporte — tout ce qui lui reste de son enfant. De cette rude et banale histoire, Rabaud sut tirer une douloureuse poésie ; son art, ici, se dépouille, gagne en force sans rien perdre de sa sensibilité.

décor de Quelvée pour le Ve acte de Mârouf, savetier du Caire, opéra de Rabaud (reprise à Paris, 1928)
Rolande et le mauvais garçon (Opéra, mai 1934) dont le livret est de Lucien Népoty, allie la fantaisie de Mârouf à l'amertume de l'Appel de la mer : une princesse s'éprend d'un garnement qui est aussi un poète, et qui est venu dans un dessein peu avouable, une sorte de Villon enjoué dont la belle humeur déride une cour maussade. Le prince jaloux fait enfermer les amoureux et demande à la débauche un remède à son désespoir. Il n'y trouve qu'un surcroît de chagrin. Alors il pardonne. Mais le pardon n'est pas l'oubli — et les trois héros de la triste aventure en gardent un souvenir qui les meurtrit. La partition offre une grande variété de facture : l'introduction du second acte, avec son solo de hautbois, la chanson de Turgis, la farandole du quatrième acte, la chanson à boire des lansquenets, la scène du page au cinquième, en sont les parties les plus particulièrement réussies.
En mai 1947, à Strasbourg, Martine apparut comme une gageure : la pièce de J.-J. Bernard est toute en réticences, et c'est moins ce que font, ce que disent les personnages, que ce qu'ils pensent et ne disent pas, qui constitue ce drame intime. Mais la musique sait préciser tout en demeurant secrète ce qu'un texte sous-entend, et elle le fait avec plus de délicatesse qu'aucune parole.
Dans le Ménestrel Max d'Ollone définissait en 1932 sa position, après avoir fait dans ses œuvres l'application de ses principes : il rejette le système wagnérien, et pense que si le public se détourne aujourd'hui du théâtre lyrique, c'est parce que les compositeurs, négligeant les voix au profit de l'orchestre, la mélodie au profit de la symphonie, ne lui offrent que de monotones récitatifs qui font regretter les airs et les cavatines de l'ancien opéra. Si la foule aime Wagner, c'est parce que Wagner est moins systématique ou pour mieux dire moins wagnérien que ses épigones ; les pages qui ont le plus vieilli dans ses ouvrages sont celles où il a suivi à la lettre ses théories.
Mais Max d'Ollone s'est gardé de revenir purement et simplement à la forme ancienne de l'opéra ; il sut assouplir lui aussi sa théorie : le Retour (1912), les Uns et les Autres (1922), l'Arlequin plus encore, en 1924, mais surtout, en 1937, la Samaritaine — à l'Opéra — montrent qu'il a l'étoffe d'un vrai musicien de théâtre. Dans ce dernier ouvrage, le Pater que dit Photine, et que le chœur reprend a cappella justifierait au besoin à lui seul l'entreprise de porter à la scène un poème qui étire sur trois tableaux les quarante versets du texte de saint Jean. Mais la sincérité du musicien sait traduire la pureté des scènes évangéliques aussi bien que la clarté du pays de Sichem. Et cela, qui était fort malaisé, il l'a réussi.
Henri Février qui fut le disciple de Massenet et l'ami de Messager, donna en 1906 le Roi aveugle à l'Opéra-Comique, et, en 1909 Monna Vanna à l'Opéra et à la Monnaie avec un succès éclatant. L'ouvrage resté au répertoire a été joué sur toutes les grandes scènes de l'étranger. Sans avoir rencontré un accueil aussi chaleureux, Gismonda, puis la Femme nue (Opéra-Comique, 1919 et 1932) ont fait une honorable carrière, due aux qualités de mouvement et de vie des partitions d'Henri Février.
Daphnis et Chloé, pastorale en un acte, représentée à l'Opéra-Comique en 1897, un ballet, la Ronde des Saisons à l'Opéra en 1905, Colomba à Toulouse, en 1920, les Noces corinthiennes, en 1922, à l'Opéra-Comique (reprises à l'Opéra en 1950), la Pie borgne, au même théâtre, en 1929, le Carrosse du Saint-Sacrement, en 1949, constituent l'apport d'Henry Büsser à l'art lyrique. Son écriture élégante, son orchestration claire et variée, qui n'écrase jamais les voix, les dons d'humour léger affirmés dans ces deux derniers ouvrages, l'aisance du musicien dans les sujets les plus divers, ont assuré son succès.
Raoul Laparra, que son hérédité attirait vers l'Espagne, doit à ce pays presque tous ses ouvrages. La Habanera (Opéra-Comique, 1908) est un drame du remords : par jalousie, Ramon a tué son frère Pedro, le jour qu'il allait épouser Pilar. Et le fantôme va causer la mort de Pilar et la folie de l'assassin. Musicalement, le remords est traduit par la habanera que dansait Pilar au moment du crime. L'œuvre est franche, directe; sa sincérité l'a maintenue au répertoire. La Jota s'opposait à la Habanera. Représentée en 1911, sur un scénario inspiré des troubles carlistes, elle n'eut point la même fortune que sa devancière, bien que le premier acte fût une réussite parfaite. Le Joueur de viole, au même théâtre, en 1925, fut mieux accueilli. Sujet simple, et poétique symbole de l'art consolateur ; la musique commente avec une adroite clarté l'allégorie des quatre cordes du luth, et des airs de danses anciennes, des thèmes populaires ornent cette partition délicate. L'Illustre Fregona, tirée des Nouvelles exemplaires de Cervantès (Opéra, 1931) est une zarzuela endiablée, pleine de gaieté et de vie.
La Cabrera (la Chevrière), valut en 1905 à Gabriel Dupont le prix Sonzogno : drame brutal, dont le livret dû à Henri Cain, était conçu selon la formule vériste. L'ouvrage, monté à l'Opéra-Comique en 1905, y fut joué une vingtaine de fois. Cinq ans plus tard, G. Dupont donnait la Glu à Cannes ; on préfère la Farce du Cuvier, dont la fantaisie bouffonne se rehausse de trouvailles ingénieuses, et surtout Antar, inspiré d'une légende orientale de Chekri-Ganem ; représenté à l'Opéra en 1921, après la mort prématurée de l'auteur, Antar fut repris en 1946 avec un succès dû à la grandeur simple d'une partition colorée, exempte d'emphase et orchestrée de main de maître. La dernière scène — la mort d'Antar — est empreinte d'une émotion d'une rare puissance où se retrouve la qualité d'âme de l'auteur des Heures dolentes.
Il y a mieux que de l'adresse dans la Rôtisserie de la reine Pédauque, que Charles Levadé donna à l'Opéra-Comique en 1920, et dans la Peau de chagrin, qui fut jouée au même théâtre en 1929 : la mort de Jérôme Coignard, dans le premier, est une réussite. Omer Letorey, outre une dizaine de musiques de scène pour le Théâtre-Français, a écrit d'après Molière le Sicilien ou l'Amour peintre (Opéra-Comique, 1930), qui ne manque ni de finesse ni de mouvement. Gabriel Grovlez, outre ses deux ballets (Maïmouna et la Princesse au jardin, Opéra, 1921 et 1941), composa deux opérettes où il mit beaucoup de grâce et d'esprit : le Marquis de Carabas, et Cœur de Rubis.
Plus que ses deux opéras, Sonia (Nantes, 1913) et Naïla (Opéra, 1927), les ballets de Philippe Gaubert constituent un apport important du compositeur à l'art lyrique. Dans Fresques, en 1923, il montrait de la grâce ; puis, tandis que sa réputation de symphoniste grandissait, il tirait de sa suite d'orchestre Inscriptions pour les portes de la Ville, un ballet, Alexandre le Grand, qui obtenait un vif succès en 1937 : en deux ans il dépassait cinquante représentations. Le Chevalier et la Damoiselle, également sur une chorégraphie de Serge Lifar, recevait le 6 juillet 1941 un accueil triomphal. Philippe Gaubert mourait subitement le surlendemain. L'ouvrage est resté au répertoire sans faiblir, tout autant par la grâce et la vigueur d'une partition dont les rythmes francs, les motifs expressifs font un chef-d’œuvre du genre, que par l'attrait d'une chorégraphie remarquable. Sa musique est l'image de l'homme que fut Philippe Gaubert : généreux, spontané et charmant.
Paul Ladmirault, qui, dans le domaine de la symphonie, s'est fait une place enviable, a su dans la musique de scène qu'il écrivit pour le Tristan et Iseult de Bédier et Artus, chanter sa chère Bretagne, et, dans la Prêtresse de Koridwen (Opéra, 1926), en exprimer les couleurs et le parfum, la mélancolie sauvage par une musique de technicien savant qui est aussi un poète.
Dans les sujets violemment dramatiques, comme Tarass-Boulba (1919) et Kerkeb (Opéra, 1951), ou voisins de l'opéra-bouffe, comme le Bon Roi Dagobert (1927), Marcel Samuel-Rousseau montre un égal souci de la forme, une pareille habileté, récompensés par le succès. Mais c'est peut-être dans ses ballets qu'il a mis le meilleur de son art : Promenades dans Rome, en 1936, puis Entre deux rondes, en 1940, sont pleins de vie et d'entrain. Dans Graziella, que l'Opéra-Comique représenta en 1925, mais que Jules Mazellier avait écrit quinze ans plus tôt, celui-ci faisait preuve d'un tempérament dramatique à la fois véhément et respectueux des conventions ; avec les Matines d'Amour (Opéra, 1927), il se montrait sensible à l'influence de Debussy sans manifester une originalité plus vive. Le Cloître de Michel-Maurice Lévy (Opéra-Comique, 1926) offrait cette particularité de n'avoir aucun personnage féminin. Le musicien, s'inspirant du drame austère de Verhaeren dont les rivalités monastiques font toute l'intrigue, y confessait sincèrement sa foi wagnérienne, et parvenait à émouvoir. Dolorès souffrit d'avoir attendu vingt-cinq ans sa création, en 1952, à l'Opéra-Comique.
II
Le répertoire de la Foire avait, dès la naissance de l'opéra-comique, introduit le réalisme dans l'art lyrique, mais un réalisme qui, pour prosaïque qu'il fût, demeurait conventionnel. A la fin du XIXe siècle, alors que le roman français appartenait presque entièrement au naturalisme, alors qu'Antoine et le Théâtre libre s'efforçaient de susciter parmi les auteurs dramatiques un « mouvement » qui fît écho sur la scène aux conceptions des romanciers, il était logique que le théâtre lyrique en subît aussi l'influence. On a dit déjà que Carmen, dès 1875, avait « ouvert les portes » de l'Opéra-Comique à l'art réaliste. Mais il y avait chez les librettistes de Carmen des timidités que Bizet dut consentir à respecter. Avec Alfred Bruneau, plus de concessions. Il aborda le théâtre en 1887, au Théâtre lyrique avec Kérim, après avoir obtenu le second prix de Rome ; mais c'est du jour où Frantz Jourdain le présenta à Zola qu'il devint lui-même.
Le Rêve paraît en 1888, et Bruneau demande aussitôt au romancier l'autorisation d'en tirer un livret. Louis Gallet se charge de l'écrire, et le musicien se met à la besogne. Le 16 juin 1891, l'ouvrage est créé à l'Opéra-Comique. On s'étonne de l'audace d'un compositeur qui fait chanter « des hommes en veston » sur la scène de la rue Favart ; on oublie que Figaro, le comte et Suzanne, au temps de Mozart, portaient des costumes pareils à ceux des spectateurs. L'essentiel n'est-il pas dans la qualité de la musique ? Et Chabrier écrit à Bruneau : « C'est tapé ! C'est un début de maître, absolument ! » Attendons la deuxième pièce, disent les envieux. La deuxième pièce, l'Attaque du Moulin, le 23 novembre 1892, est un triomphe. On avait redouté les réactions du public, et pris la précaution de transporter en 1792 l'épisode de la guerre de 1870 ; la réalité ne perdait rien à ce sacrifice : l'horreur de la guerre est de tous les temps, et la musique de Bruneau suggère des images de nature et d'humanité qui restent vraies pour toutes les époques.

scène du Rêve, opéra-comique de Bruneau (reprise à Paris, 1939) [photo Lipnitzki]
La collaboration du romancier et du musicien fut féconde : à l'Attaque du Moulin succédèrent en 1897, Messidor ; en 1901, l'Ouragan, en 1905, l'Enfant-Roi, puis, Zola étant mort, Bruneau tira de Naïs Micoulin un ouvrage créé à Monte-Carlo en 1907 ; la même année, il donnait à l'Odéon la musique de scène pour la Faute de l'abbé Mouret. Il faut citer encore le Roi Candaule (1920), le Jardin de Paradis (1923), Angelo (1928), enfin Virginie, qui, en 1930, à l'Opéra, contait l'histoire de Déjazet. Le musicien de l'Attaque du Moulin, de l'Ouragan et de Messidor a chanté le travail humain et la richesse de la terre ; il a développé des symboles pleins de noblesse et de pitié ; il a su rendre, par de larges touches, les aspects de la nature, la grandeur et la misère de la peine des hommes.
Au lendemain de la première représentation de Louise, le 2 février 1900, Catulle Mendès publiait dans le Journal un article prophétique : « Il semble que, ce soir, s'est produite, totale, cette réalisation longtemps attendue : une œuvre française de théâtre, où s'est manifestée abondamment une inspiration neuve qui, par la qualité de l'amour, de la douleur, de la mélancolie, de la joie, du désespoir, de toute la passion, s'affirme issue du propre cœur de notre race, et n'aurait pu sourdre d'aucune autre nation que la France. » Et il ajoutait qu'un tel ouvrage « était destiné à vivre en prenant rang auprès de Faust, de Carmen, de Manon ». En 1921, Louise atteignait la cinq centième représentation sur la scène de l'Opéra-Comique ; au cinquantième anniversaire de la création, on approchait la millième ; et c'est par dizaines de milliers que se comptent les représentations données dans les autres théâtres de France et de l'étranger.
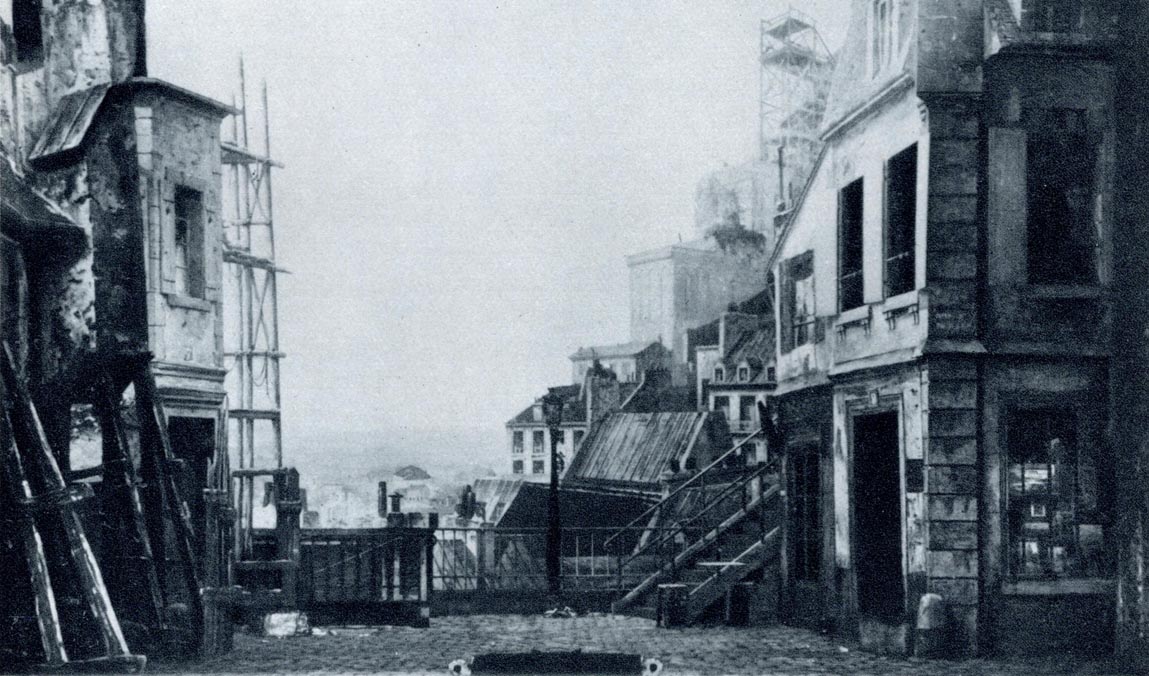
décor de la création de Louise de Charpentier (Paris, 1900)
Cependant, si l'ouvrage plut, dès sa naissance, aux musiciens de tendances les plus diverses, il n'en souleva pas moins de vives protestations : beaucoup lui reprochaient son « immoralité » ; d'autres cherchaient querelle au musicien sur son esthétique, sur son « réalisme grossier » dont l'arpège ascendant du thème de Louise leur semblait le symbole. Tout cela nous paraît aussi loin que la querelle des bouffons. Louise a triomphé de la pudibonderie comme du dénigrement des jaloux ; elle a dû sa victoire à la qualité de la partition. Quant à l'esthétique de Charpentier, le sous-titre de son ouvrage : « Roman musical », la définit clairement. Les quatre actes — le deuxième est divisé en deux tableaux — constituent chacun une « tranche de vie », comme disaient les romanciers naturalistes ; les personnages sont peints tels qu'ils sont, tels qu'ils vivent — sauf peut-être Julien, le poète, bien moins humain, et bien plus inconsistant que le Père, la Mère et Louise. Un hors-d'œuvre, peut-être : la fête du couronnement de la Muse, au troisième acte. Peut-on dire que c'est une tache, même légère ? Point : musicalement, le décor est lui-même aussi exactement décrit que les personnages sont évoqués. Il varie d'épisode en épisode, suggéré par la musique avec une justesse de touche merveilleuse. Trois thèmes essentiels : le fameux arpège, image du désir, de l'impatience amoureuse ; un second, calme, sage, un thème grave et noble : le père, son existence de travailleur point envieux ; et puis un autre encore, emprunté au folklore parisien : le plaisir, le cri des marchandes d'oublies. Et dix autres motifs, secondaires, et cette page étonnante au second acte : un thème large, en ré majeur, caractérise la grande ville. Paris qui s'éveille ; et de l'orchestre s'élèvent les cris qui, naguère, peuplaient le silence des rues au temps où les rues étaient encore silencieuses : la marchande de « mouron pour les p'tits oiseaux », la marchande de primeurs, offrant « la tendresse, la verduresse », le rempailleur de chaises, le flageolet du chevrier. Camille Bellaigue a dit de ce premier tableau du deuxième acte : « Avec les plus petites voix de la Grande Ville, avec les plus dédaignées, le musicien de Louise a su former le plus harmonieux, le plus attendrissant concert. Autant d'appels ou de cris dont on ne savait pas jusqu'ici tout ce que les pauvres notes pouvaient exprimer de lassitude et de peine, de charme souffrant, de triste sourire. Et l'atelier comme la rue nous reflète sa poésie et son âme — son âme féminine, son âme de langueur, de rêve, de désir et d'amour. »
C'est cela qui fait la valeur de Louise, c'est son humanité vraie. Peut-être, au moment qu'il l'écrivait, Charpentier a-t-il cru plutôt composer un « roman musical » à thèse ; l'œuvre a singulièrement dépassé l'anecdote qui en fait le sujet. Les tableaux qui se déroulent sous les yeux du spectateur, l'atelier de couture, la scène de la Muse conservent leur valeur pittoresque, certes, mais ce qui importe davantage, c'est ce qu'il y a de profond et de tragique dans ces humbles destinées, si banales en apparence. Ce qui hausse Louise au rang des grands ouvrages, c'est la vérité nue et simple du pathétique exprimé par la musique : sous le prosaïsme du dialogue, sous les mots du langage le plus familier, l'inflexion de la mélodie, ou quelque trouvaille harmonique, déterminent chez qui l'écoute une résonance qui émeut et bouleverse jusqu'aux entrailles : « Vous avez donné là — écrivait Romain Rolland à Charpentier — un bel exemple, non seulement à la musique, mais au théâtre, en lui montrant la tragédie profonde que contient la vie quotidienne la plus simple. »
Exemple difficile à suivre — et pour Charpentier lui-même. Le 4 juin 1913, l'Opéra-Comique donnait Julien, second volet du triptyque dont l'Amour au Faubourg devait être le troisième. Et Julien, malgré de belles pages — dont quelques-unes venaient de la Vie du poète, envoi de Rome de Charpentier — ne réussit pas. C'est que le symbole de la déchéance du héros y est matérialisé sous des formes allégoriques qui n'ont plus la simplicité directe des scènes de Louise. Élève de Massenet, Gustave Charpentier subit aussi l'influence de Berlioz vers lequel l'attirait une évidente parenté d'esprit, un fond de romantisme : il lui doit son amour de la couleur, et aussi son art de suggérer par quelques traits concis d'une étonnante justesse ce qu'il veut dire. A Massenet, il doit quelque chose de plus subtil, une perfection de l'écriture harmonique qui fait de lui un musicien complet. Ceux qui l'ont dénigré oublient que l'auteur de Louise a signé les Impressions d'Italie. Représentée au moment où le vérisme envahissait le théâtre lyrique, Louise, œuvre essentiellement française, a fait honneur à notre théâtre national.
Au réalisme se rattachent les drames lyriques de Francis Casadesus : le Moissonneur, 1909, Cachaprès, 1914, la Chanson de Paris, 1924, celle-ci toute parfumée du folklore bressan, et qui trouva le succès au Trianon-Lyrique avant d'entrer à l'Opéra-Comique.
La même esthétique guida Francis Bousquet lorsqu'il écrivit Sarati le terrible, d'après le roman de Jean Vigneau (Opéra-Comique, 1928). Mais dans Mon Oncle Benjamin, dont Georges Ricou tira le livret du chef-d’œuvre de Claude Tillier (Opéra-Comique, 1942), son réalisme faisait alliance avec la fantaisie pour produire une suite d'images d'Épinal hautes en couleur, et d'un humour léger.
III
Ce ne fut qu'après avoir abordé le théâtre par la musique de scène et enrichi d'admirables chœurs Caligula d'Alexandre Dumas (1888), d'interludes symphoniques, qui sont parmi les très hauts chefs-d’œuvre de notre musique d'orchestre, Shylock d'Edmond Haraucourt, et Pelléas et Mélisande de Maeterlinck, pour les représentations données à Londres en 1898, que Gabriel Fauré écrivit Prométhée. L'adaptation du drame d'Eschyle par Jean Lorrain créée aux arènes de Béziers en 1900 s'écarte quelque peu de l'original, mais elle en conserve suffisamment la grandeur pour avoir fourni au musicien l'occasion de construire un ouvrage d'une forme neuve. Presque point de scènes d'action, mais des épisodes lyriques, des chœurs très développés ; deux sortes de personnages, les dieux dont les rôles sont chantés, les héros qui disent un texte parlé. D'autre part la « tragédie lyrique » est destinée à une scène de plein air ; l'orchestre est donc traité d'une manière appropriée à l'exécution à ciel ouvert : les cuivres y tiennent un rôle essentiel; aux ressources locales — deux « sociétés d'harmonies » de la région (sans instruments à cordes), un orchestre à cordes recruté sur place — on ajoute une douzaine de harpes. Plus tard l'ouvrage fut réorchestré, et tous ceux qui entendirent Prométhée à Béziers ont préféré l'instrumentation originale. Mais ce n'est pas seulement cela qui lui donne un caractère si particulier : Fauré — le « doux » Fauré — y montre une puissance que ne soupçonnaient point ceux qui le tenaient pour un compositeur de musique de chambre, mal préparé à écrire une œuvre de cette ampleur. Il atteint la grandeur par la sobriété, par la pureté des lignes. Simplicité des rythmes, simplicité de la mélodie ; aucun détail inutile, mais un raffinement harmonique extraordinaire : cette musique sonne comme nulle autre ; elle est constamment appropriée non seulement au sujet, mais au plein air. Et une autre merveille est dans la manière dont Fauré sut traiter les chœurs : le premier est farouche, presque sauvage ; mais le Fauré des mélodies reparaîtra dans les trois chœurs des Océanides, au troisième acte. Le deuxième contient un épisode d'une beauté souveraine : les funérailles de Pandore, annoncées par une sonnerie funèbre, puis se déroulant tandis que l'orchestre et le chœur exhalent une longue plainte, variée, et selon le mot de Charles Kœchlin, faite de deuil, de virginité, de lumière et de jeunesse à la fois. Page merveilleuse, en vérité. Les épisodes de force restent cependant peut-être les plus beaux. Et cette force, Fauré la doit au parfait équilibre des moyens, mais point à leur violence.

création de Prométhée de Fauré aux arènes de Béziers (1900)
Le 4 mars 1913, au Théâtre de Monte-Carlo, Pénélope révélait un autre aspect, et tout autant hellénique, du génie de Fauré. Le livret de René Fauchois simplifiait sans la trahir la légende homérique : plus de Pallas, plus de Télémaque mais les deux figures centrales — le roi et la reine d'Ithaque — et les Prétendants : le drame du retour d'Ulysse devenait ainsi plus propre à inspirer un musicien dont l'art répugne aux complications vaines. Dès l'ouverture les deux thèmes essentiels : Pénélope, et sa longue attente fidèle au souvenir, sa mélancolie chaque jour plus douloureuse et pesante ; Ulysse, caractérisé par un motif d'une extrême simplicité, mais aussi d'une étonnante noblesse. Le rideau levé, trois scènes d'exposition montrent l'insolence et la cupidité des Prétendants. Puis c'est l'arrivée du mendiant, c'est la vieille Euryclée qui reconnaît sous les haillons le maître attendu, et c'est à la fin du premier acte et durant le second les scènes où le vieillard ranime l'espoir de la reine, avant de se faire reconnaître d'Eumée et des bergers ; c'est, au troisième acte, le stratagème de l'arc que lui seul peut bander, et dont il va se servir pour atteindre la cible vivante... Musique extraordinairement souple, mais d'une pureté toute grecque. La beauté de cette construction sonore est faite de sereine clarté : elle tient à la majesté simple, à l'harmonie des proportions. Il semble miraculeux qu'un musicien si moderne, si hardi, qui ne répudie rien de ses audaces harmoniques, se trouve si bien de plain-pied avec l'antiquité et restitue si parfaitement le charme archaïque de l'épopée homérique. Il use avec une sobre délicatesse des modes antiques, avec un naturel qu'il doit à son initiation au plain-chant. Il n'a fait aucune concession aux usages, aux routines du théâtre contemporain : sans parti pris d'archaïsme, et en utilisant les moyens d'expression les plus modernes, il se rapproche, grâce à cette complète indépendance d'esprit, dans ses deux grands ouvrages, du théâtre grec, comme il renouvelle la « pastourelle », en la transportant dans un décor de Watteau, avec Masques et Bergamasques. Tout cela si bien, que Charles Kœchlin peut dire que « son intuition créatrice donne l'exacte vie au décor, aux paroles, aux actes, aux âmes ». Grâce à cela, Pénélope a conquis le rang le plus haut, près de Pelléas et Mélisande, parmi les chefs-d’œuvre de l'art lyrique.

scène de Pénélope de Fauré (reprise à Paris, 1943) [photo Seeberger]
« Entre Wagner et Mozart — déclarait Debussy à son maître Guiraud — la différence est presque extérieure à la musique. Et c'est ici la nouveauté : Wagner tend à se rapprocher de la parole parlée, ou plutôt, il prétend s'en rapprocher tout en traitant la voix très vocalement. Il a une façon de déclamer qui n'est ni le récitatif à l'italienne, ni l'air lyrique : il surajoute les paroles à une symphonie continue, tout en subordonnant cette symphonie aux paroles. Pas assez, toutefois. Ses œuvres ne réalisent qu'en partie les principes qu'il a déclarés de cette subordination nécessaire ; il manque d'audace pour les appliquer. Il a trop de précision et de minutie; il ne laisse place à aucun sous-entendu. C'est très émouvant, mais c'est très compact. Et ça chante trop souvent. Il faut chanter seulement par endroits...
— D'où il suit, interrompt Guiraud, que vous êtes un wagnérien libéral ?
— Je ne suis pas tenté d'imiter ce que j'admire dans Wagner. Je conçois une forme dramatique autre : la musique y commence où la parole est impuissante à exprimer. La musique est faite pour l'inexprimable. Je voudrais qu'elle eût l'air de sortir de l'ombre, et que, par instants, elle y rentrât, que presque toujours elle fût discrète personne.
— Quel poète, demande Guiraud, pourra vous fournir un poème ?
— Celui qui, disant les choses à demi, me permettra de greffer mon rêve sur le sien, qui concevra des personnages dont l'histoire et la demeure ne seront d'aucun temps, d'aucun lieu, qui ne m'imposera pas despotiquement la scène à faire, et me laissera libre, ici ou là, d'avoir plus d'art que lui, et de parachever son ouvrage. Mais qu'il n'ait crainte ! Je ne suivrai pas les errements du théâtre lyrique où la musique prédomine insolemment, où la poésie est reléguée et passe au second plan, étouffée par l'habillage musical trop lourd : au théâtre lyrique, on chante trop. Il faudrait chanter quand cela en vaut la peine, et réserver les accents pathétiques. Il doit y avoir des différences dans l'énergie de l'expression. Il est nécessaire par endroits de peindre en camaïeu, et de se contenter d'une grisaille. Rien ne doit ralentir la marche du drame : tout développement musical que les mots n'appellent pas est une faute. Sans compter qu'un développement musical tant soit peu prolongé est incapable de s'assortir à la mobilité des mots. Je rêve de poèmes qui ne me condamneraient pas à perpétrer des actes longs, pesants, qui me fourniraient des scènes mobiles, diverses par les lieux et le caractère ; où les personnages ne discutent pas, mais subissent la vie et le sort. »

création de Pelléas et Mélisande à l'Opéra-Comique de Paris en 1902 (Pelléas : Perier ; Mélisande : Mary Garden)
Cet entretien fut tenu en octobre 1889 ; il nous a été rapporté par Maurice Emmanuel qui en fut le témoin et le nota en rentrant chez lui (*). Rien ne définit mieux la position de Debussy que ces propos : Pelléas en est l'application ; et la réussite de l'ouvrage, la démonstration. Elle fut donnée l'après-midi du 27 avril 1902, à l'Opéra-Comique, où eut lieu la répétition générale ; et l'on sait quelle fut, au lendemain de la première, la réaction du public et de la critique, comment l'œuvre si neuve faillit être étranglée par la cabale, comment il fallut qu'un petit groupe de fidèles, par sa persévérance, imposât Pelléas et Mélisande à un public mal préparé à en comprendre et le sens et la valeur. On ne s'étendra point sur les circonstances de cette création, non plus que sur l'analyse de l'ouvrage. Tout cela est trop connu et il suffit de noter que tout ce que Debussy disait à Guiraud se retrouve dans Pelléas. Art « impressionniste », dit-on alors. Le mot est impropre et il est pourtant resté. Observons seulement avec Maurice Emmanuel que Claude Monnet comme Claude Debussy ont fondé leur talent sur une sévère discipline. L'un et l'autre ont appris le métier et cherché la précision. « Et lorsqu'ils se sont mis à noyer leurs contours l'un sous les irradiations lumineuses, l'autre sous des harmonies flottantes, ils n'ont rien répudié de leurs acquêts anciens : ils les ont seulement enveloppés de mystère. A qui sait voir et entendre, la forme, chez ces deux artistes, reste ferme et pure. Ni l'un ni l'autre n'ont brisé avec la tradition des maîtres du « dessin ». C'est ce que remarquait Vincent d'Indy dans un article au lendemain de la première — et l'on y retrouve presque exactement ce que Debussy, douze ans plus tôt, avait dit à Guiraud : « Pelléas n'est, de toute évidence, ni un opéra, ni un drame lyrique au sens ordinaire de cette appellation, ni une pièce vériste, ni un drame wagnérien. C'est à la fois plus et moins. Moins, car la musique, en soi, n'y joue la plupart du temps qu'un rôle secondaire, celui que joue l'enluminure dans les manuscrits du moyen âge ; plus, car à l'encontre de ce qui se passe dans l'opéra moderne, et même dans le drame lyrique, c'est ici le texte qui est le point principal, le texte merveilleusement adapté, en sa conception sonore, aux inflexions du langage, et baignant en des ondes musicales diversement colorées, qui rehaussent le dessin, révèlent le sens caché, magnifient l'expression, tout en laissant la parole transparaître toujours au travers du fluide élément qui l'enveloppe. » Et d'Indy, comparant l'art de Debussy à celui de Monteverdi, montrait qu'à trois siècles de distance, deux chefs-d’œuvre avaient provoqué la même incompréhension...
(*) Cité par Maurice EMMANUEL dans son admirable étude sur Pelléas et Mélisande (Paris, Mellotée, pp. 30 et sq. passim). Cf. aussi Debussy et son temps par Léon VALLAS (Paris, Alcan, 1932).
Le 22 mai 1911, le Martyre de saint Sébastien était représenté au Châtelet. Ce que la collaboration avec Gabriele d'Annunzio, préméditée par Mme Ida Rubinstein, offrait à Debussy, était tout différent de ce qu'il avait trouvé dans le drame de Maeterlinck. La forme n'était plus la même : il s'agissait cette fois d'un mélodrame — au sens exact du mot, un drame parlé, pour lequel la partition était quand même plus développée, plus importante qu'une simple musique de scène habituelle. Mais le drame, fort touffu, mais les conditions matérielles de l'exécution, le trop court délai laissé au compositeur pour accomplir sa tâche, faillirent en compromettre la réussite. Il parvint cependant à faire du Martyre une œuvre d'une rare pureté, malgré le raffinement des combinaisons instrumentales qu'il y emploie. Les chœurs, depuis le premier acte, depuis le miracle de la danse sur les charbons ardents, jusqu'à l'Alleluia final, s'élèvent avec la suave majesté des prières. Assurément, Debussy prie — comme il l'a dit dans une interview — en panthéiste, en artiste qu'émeuvent les spectacles de la nature mystérieuse, bien plus que les rites d'un culte défini. Mais la musique est un langage qui exprime des pensées indéfinies et cependant sensibles à l'entendement. Celles que nous livre le Martyre ont l'élévation de la prière, et elles sont un complément du texte qu'elles prolongent en lui donnant une résonance pénétrante. L'étagement de l'orchestre et l'écriture des chœurs en font un chef-d’œuvre peut-être plus original encore que Pelléas.

décor de Bakst pour la création du Martyre de saint Sébastien de Debussy (Paris, 1911) [photo Vizzavona]
Outre le Prélude à l'Après-midi d'un faune, qui ne gagna rien à être porté à la scène, Diaghilev demanda à Debussy d'écrire pour Nijinski Jeux (mai 1913), et le compositeur réussit à mettre en musique un sketch dont une partie de tennis est le prétexte et un flirt le sujet. Musique mobile, traduisant les impressions du spectateur d'un match dont Éros serait l'arbitre. La Boîte à joujoux, composée pour sa fille en 1913, est un petit chef-d’œuvre d'humour léger ; et Khamma — commande d'une danseuse anglaise soucieuse d'animer une hiérodule égyptienne au temps des Pharaons — Khamma, abandonnée par Debussy pour le Martyre, et orchestrée par Charles Kœchlin, ne fut représentée qu'en 1947 à l'Opéra-Comique et n'y parut nullement mériter le dédain où son auteur l'avait tenue. Manuel de Falla a dit qu'il fallait considérer Debussy, « par la substance même de sa musique, comme l'un des plus profonds et réels créateurs ». Ces quelques mots définissent le rôle du compositeur de génie auquel l'art lyrique doit deux œuvres maîtresses qui l'ont orienté vers des destins nouveaux.
Cinq ans après Pelléas, le 10 mai 1907, l'Opéra-Comique affichait Ariane et Barbe-Bleue ; à Paul Dukas, comme à Debussy, Maeterlinck avait fourni l'occasion d'écrire un chef-d’œuvre. Le livret peut être résumé en quelques mots : Barbe-Bleue n'a point tué ses femmes ; il les tient enfermées dans un souterrain. Ariane, la dernière de celles qu'il a choisies pour épouses, est instruite de leur sort. Elle accepte de devenir la femme de Barbe-Bleue parce qu'elle veut libérer les captives ; elle ouvrira la porte qui jamais ne s'est rouverte sur aucune d'elles, et leur rendra la liberté. Mais aucune ne voudra la suivre ; et lorsque les paysans insurgés se seront emparés de Barbe-Bleue, lorsqu'ils l'amèneront ligoté, pour la vengeance de celles qu'il opprima, Ariane le délivrera lui aussi. Le sens de l'ouvrage, que la musique éclaire, Dukas l'a défini ainsi : « On préfère toujours un esclavage familier à cette incertitude redoutable qui fait tout le poids du fardeau de la liberté. Et puis, la vérité est qu'on ne peut délivrer personne. Il vaut mieux se délivrer soi-même. Non seulement cela vaut mieux, mais il n'y a que cela de possible... »
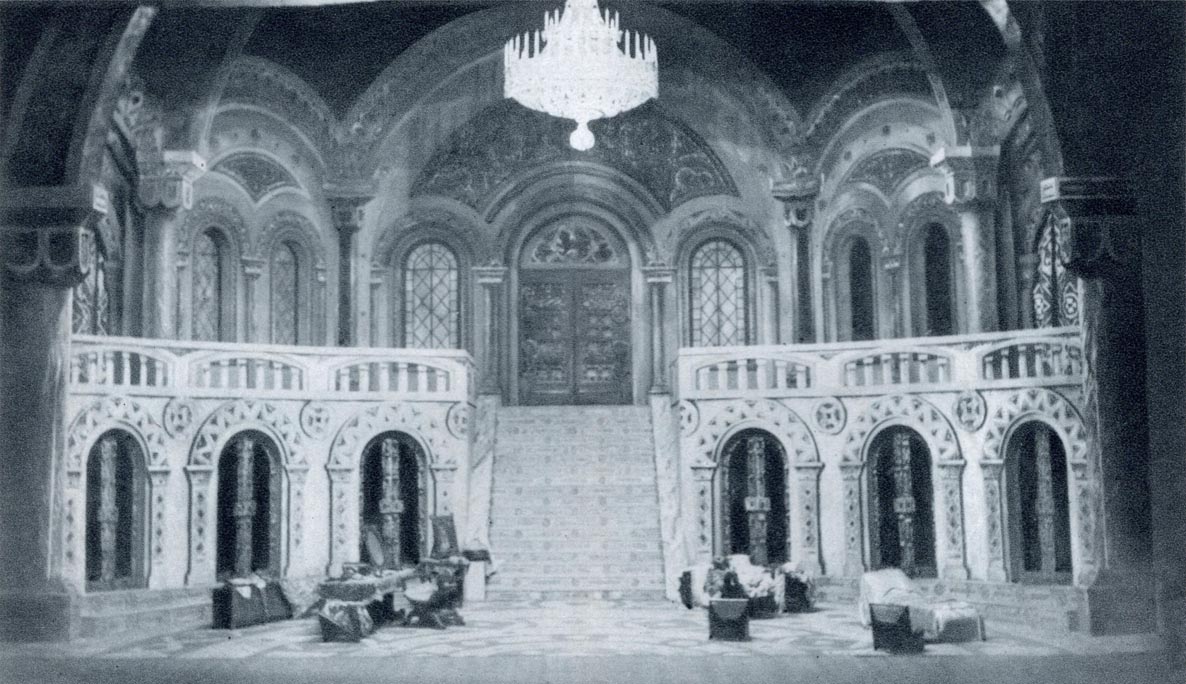
décor d'Ariane et Barbe-Bleue de Dukas (reprise à Paris, 1945) [photo Lipnitzki]
Tout est donc symbole dans ce drame : la musique y intervient pour développer, prolonger en traduisant ce que les mots ne peuvent exprimer, les pensées, les sentiments les plus secrets des personnages. La partition est d'une éblouissante richesse ; l'œuvre a été longuement mûrie, merveilleusement équilibrée. L'instrumentation est d'un art raffiné ; mais tant de science n'alourdit point l'ouvrage. On a trop souvent rapproché Dukas de Debussy ; si Ariane se classe près de Pelléas, c'est uniquement parce que, cinq ans après que Debussy avait renouvelé le genre lyrique, Dukas, par d'autres moyens qui lui étaient propres, réussissait un autre chef-d’œuvre. S'il existe entre les deux musiciens des affinités, les différences sont essentielles qui caractérisent leurs styles. Tous deux ont été de leur temps ; ils en ont parlé la langue comme il est naturel à des contemporains.
La somptuosité de Dukas se retrouve dans la Péri, ballet qui fut dansé par Mlle Trouhanova au Châtelet en avril 1912, et qui entra plus tard au répertoire de l'Opéra. Une fanfare, qui est elle-même un chef-d'œuvre, précède un mystérieux prélude, et l'on suit Iskander dans sa course vers la fleur d'immortalité qu'il ravit à la Péri endormie, puis qu'il se laisse reprendre. Bien que très souvent exécutée au concert, la partition de la Péri est essentiellement scénique, et sa structure obéit au plan chorégraphique qui lui-même est déterminé par l'action.
Humaniste de très grande valeur, Maurice Emmanuel fut un des maîtres auxquels la musique moderne doit d'avoir réappris à utiliser les modes anciens pour sortir de l'ornière où, depuis l'époque classique, le majeur-mineur de la gamme d'ut transposée dans tous les tons la tenait enfermée. Son Prométhée, dont le premier acte fut donné aux Concerts Lamoureux au lendemain de la guerre de 1914, est une très belle œuvre, originale et puissante. Elle est encore inédite, et ceci montre l'ingratitude dont Maurice Emmanuel a été la victime. L'Opéra créa Salamine en juin 1929. Th. Reinach s'inspirait pour son livret des Perses d'Eschyle ; Emmanuel, comme Fauré dans Prométhée, faisait alterner le parlé et le chant dans sa partition, sans restreindre pour cela la part de la musique : c'est elle qui exprime la terreur grandissante des Perses attendant les nouvelles de l'armée de Xercès ; c'est elle qui donne aux strophes parlées du coryphée, puis au songe de la reine, et enfin au récit du messager une profonde valeur expressive. Et le second acte ménage une progression pathétique du plus grand et du plus noble effet, avec l'apparition de Darius ; dans le troisième, le retour de Xercès après le désastre de Salamine, les insultes de la foule, la déploration du vaincu, le chant de deuil qui accompagne Atossa, sa mère, atteignent une grandeur épique sans cesser d'être douloureusement humains.
L'apport de Maurice Ravel à l'art lyrique est à la fois considérable et imprévu. Si l'illusionniste que voit très justement en lui Roland-Manuel, se tourna vers le théâtre, ce ne fut point pour se soumettre aux prétendues règles du jeu, mais bien pour plier aux exigences de sa propre esthétique et la matière et le sujet à traiter. Tout laisse croire à sa fantaisie dans les œuvres qu'il donne à la scène ; quand on les examine, on y trouve au contraire un plan d'une extrême rigueur, une construction méticuleuse autant que celle d'une pièce d'horlogerie où rien n'est abandonné au hasard. Par miracle, tout ce travail semble s'effacer, et à l'audition, la forme et l'idée sont en si parfait accord que tout paraît spontané de ce qui exigea un patient effort.
Lui-même a dit dans son Esquisse biographique que les Histoires naturelles l'avaient préparé à la composition de l'Heure espagnole qui est elle-même une sorte de conversation en musique. Ravel écrivit d'un trait les quelque cinquante minutes de musique de la partition en 1906-1907. Elle attendit cependant jusqu'au 19 mai 1911 pour être exécutée à l'Opéra-Comique. L'œuvre vaut par des qualités dont l'analyse ni même un commentaire détaillé ne peuvent donner l'idée. Le prologue crée l'atmosphère — la boutique de l'horloger de Tolède Torquemada — et c'est, jusqu'à l'obsession, le décor d'une sorte de volière mécanique. Tout à l'heure, au lever du rideau, lorsque les personnages engageront le dialogue, ce fond sonore reviendra souvent ; mais les vers « tantôt longs, tantôt courts » du délicieux Franc-Nohain, s'appuieront sur la musique de Ravel aussi légèrement que la prose de Renard dans les Histoires naturelles. Chef-d’œuvre d'esprit subtil, mais qui demeure humain par la sensibilité masquée d'ironie. Tout cela se colore des nuances chaudes de l'Espagne — mais par allusions presque indirectes, parodiques souvent même — rythmes de séguedille et de habanera, revenant dans un finale drôlement conventionnel et d'une irrésistible bouffonnerie.
D'un tout autre style est Daphnis et Chloé, « symphonie chorégraphique » composée en 1906-1910, et représentée par les ballets russes au Châtelet le 8 juin 1912. Le titre choisi par le musicien définit sa position, précisée d'ailleurs dans son Esquisse biographique : « Composer une vaste fresque moins soucieuse d'archaïsme que de fidélité à la Grèce de mes rêves qui s'apparente assez volontiers avec celle qu'ont imaginée les artistes français du XVIIIe siècle. L'œuvre est construite symphoniquement selon un plan tonal très rigoureux, au moyen d'un petit nombre de motifs dont les développements assurent l'homogénéité de l'ouvrage. » Et cet ouvrage est un des sommets de l'art ravellien. Riche de détails exquis, il est cependant d'une parfaite unité de style. Les suites d'orchestre qui en ont été tirées ont fait une célébrité universelle au « lever du jour », à l'adage qui le suit et à la danse générale par laquelle s'achève le ballet ; mais il est tout entier fait de pages aussi neuves, aussi belles, idylliques au premier tableau, farouches avec la danse guerrière du deuxième, et partout admirables. Les chœurs sans paroles ajoutent à la polyphonie instrumentale une nuance d'une délicatesse mystérieuse.

décor de Bakst pour la création de Daphnis et Chloé, symphonie chorégraphique de Maurice Ravel (Paris, 1912)

costumes de Bakst pour Daphnis et Chloé
L'Enfant et les sortilèges associait Mme Colette et Maurice Ravel. Créé à Monte-Carlo en mars 1926, l'ouvrage parut à l'Opéra-Comique le 1er février de l'année suivante. Le public comprit mal, d'abord, la tendre ironie des auteurs ; mais les reprises, à l'Opéra, puis rue Favart, décidèrent du succès. L'enfant rage sur ses devoirs, passe sa colère sur les bêtes et les objets familiers qui s'animent et se vengent. Mais devant un écureuil qu'il a blessé, l'enfant s'émeut : sa pitié le sauve. Donnée légère, d'une poésie toute en finesse, et musique qui suit le texte de très près, et exprime, avec une apparente facilité, les sensations et les sentiments les plus imprévus et les plus variés qui peuvent naître dans l'âme mouvante d'un enfant. Musique plus dépouillée qu'aucune autre du musicien, et qui laisse deviner plus aisément l'émotion, la pitié, pudiquement contenue. L'importance de l'ouvrage — au point de vue de l'histoire de l'art lyrique — est grande : par les moyens les plus modernes, c'est exactement la forme ancienne de l'opéra-ballet qui s'y trouve renouvelée : le chant y est constamment associé à la danse, et la chorégraphie naît de l'action, liée intimement à la danse.
On ne fera que mentionner les autres ballets de Ravel, Ma Mère l'Oye, Adélaïde ou le Langage des fleurs (qui est, sous une forme orchestrée, le recueil des Valses nobles et sentimentales), la Valse, le Boléro, la Pavane pour une Infante défunte : ces titres appartiennent au répertoire des concerts plus encore qu'au théâtre.

le danseur Fokine (1880-1942)

Nijinski et Karsavina dans Giselle

Nijinski dans le Spectre de la Rose
La Forêt bleue de Louis Aubert était écrite depuis vingt ans lorsque l'Opéra-Comique la représenta en 1924, après que l'Amérique dès 1911 lui eut fait un considérable succès. La partition est d'une haute valeur, elle la doit à sa parfaite convenance au sujet féerique qui porte à la scène, autour du Petit Poucet, les plus jolis contes de Perrault poétiquement liés ensemble par Jacques Chenevière. Louis Aubert s'y est montré lui-même poète délicat et sa musique a traversé le demi-siècle écoulé sans prendre plus de rides que le visage de la Belle au bois dormant dans son sommeil de cent ans. Musique d'un symphoniste qui sait aussi écrire pour les voix avec adresse, peindre un paysage, évoquer des états d'âme puérils mais profondément humains, montrer autant de sensibilité que de fraîcheur, user des procédés les plus modernes et ne faire cependant aucune concession à la mode d'un jour, ce pourquoi sa partition n'a rien à redouter des injures du temps.
Il en est de même des ouvrages que Roger Ducasse a destinés au théâtre : son Orphée, publié dès 1913, n'y parut qu'en 1926, grâce à Mme Ida Rubinstein. Roger Ducasse y tentait par des moyens originaux de rompre avec les traditions de la scène lyrique : Orphée est un mimodrame, mais fait une large place aux chœurs sans paroles, mêlés intimement à la polyphonie instrumentale. On a pu dire que dans cet ouvrage si nouveau, Roger Ducasse se montrait « audacieusement classique », par la pureté de son écriture. L'amour du pays natal lui inspira la partition de Cantegril. Il existait entre le musicien et son librettiste Raymond Escholier bien des affinités. Cantegril est un personnage représentatif, type du franc Gascon haut en couleurs, et c'est, autour de lui, toute la Gascogne qui vit et s'agite. Représenté à l'Opéra-Comique le 6 février 1931, Cantegril alla aux nues. Peu d'ouvrages sont aussi variés, aussi riches de substance musicale. Tout y est d'une justesse de ton, d'une qualité expressive hors de pair. Il n'est pas douteux que ce pur chef-d’œuvre fût demeuré au répertoire s'il n'avait exigé des soins qui, à notre époque, font écarter de l'affiche les opéras jugés trop « onéreux ».
L'Œdipe de Georges Enesco, représenté à l'Opéra en mars 1936, a permis au musicien, grâce à l'admirable livret d'Edmond Fleg, de donner à sa partition une grandeur et une noblesse qu'elle n'aurait pu atteindre sans cet appui. L'œuvre forme ainsi un tout complet, sans nulle tache, sans nulle faiblesse. Enesco a fait usage dans sa musique, et principalement pour le personnage d'Œdipe, du quart de ton, ce qui accentue le caractère douloureux du rôle et lui ajoute du mystère. Emploi discret, toujours justifié, d'un procédé qui ne pouvait être manié que par des mains aussi habiles. Depuis les premières mesures jusqu'à la scène finale, l'intérêt va croissant, et chaque pige atteint la beauté de l'antique par les moyens de l'art moderne
Ce fut avec le Festin de l'Araignée, au Théâtre des Arts en 1913, qu'Albert Roussel abordant le théâtre y conquit la notoriété. L'Opéra, en 1923, créait Padmâvatî, commencé avant la guerre. Le livret de Louis Laloy, inspiré d'une légende de l'Inde, offrait au musicien un symbole propre à inspirer une œuvre humaine et sensible, en même temps qu'un sujet lui permettant de renouveler la forme de l'opéra-ballet. Bien préparé à peindre l'Extrême-Orient par ses voyages, par les Évocations qu'il en avait rapportées, Albert Roussel utilisa avec bonheur les ragas, formules modales de l'Inde, pour rehausser sa palette ; mais en même temps, il sut donner l'impression de mystère, de passion et de violence qu'exigeait le drame : Padmâvatî, épouse de Ratan-Sen, roi de Tchitor, victime du conflit de l'honneur et de l'amour, et se sacrifiant finalement pour ne point survivre. Padmâvati, avec le chant du brahmane, les danses guerrières, les chœurs du premier acte, les danses religieuses et les adieux de l'héroïne au second, marque une date mémorable dans l'histoire de l'opéra. Avec la Naissance de la Lyre, dont Théodore Reinach avait tiré le poème des Limiers de Sophocle, Roussel reprenait en 1925 la forme employée par Maurice Emmanuel dans Salamine, et accordait en perfection les moyens d'expression nouveaux à la simplicité hellénique pour illustrer musicalement l'histoire du larcin d'Hermès, dérobant les bœufs d'Apollon et lui cédant, pour obtenir son pardon, son invention de la lyre. Les danses des Nymphes et des Satyres, le chant d'Hermès, s'accompagnant de la lyre dans la grotte de Kyllénè ont un relief saisissant ; la variété, la souplesse des rythmes, la grandeur sereine du finale assurent à cet ouvrage une valeur durable. Enfin dans ses ballets — Bacchus et Ariane, Æneas (où il emploie largement les chœurs), dans son opérette le Testament de tante Caroline, pochade dont la musique vaut beaucoup plus que le livret — Albert Roussel a montré la diversité de ses dons et l'originalité de son tempérament. Il est un des musiciens dont l'influence sur la jeune génération est à la fois la plus profonde et la plus étendue.
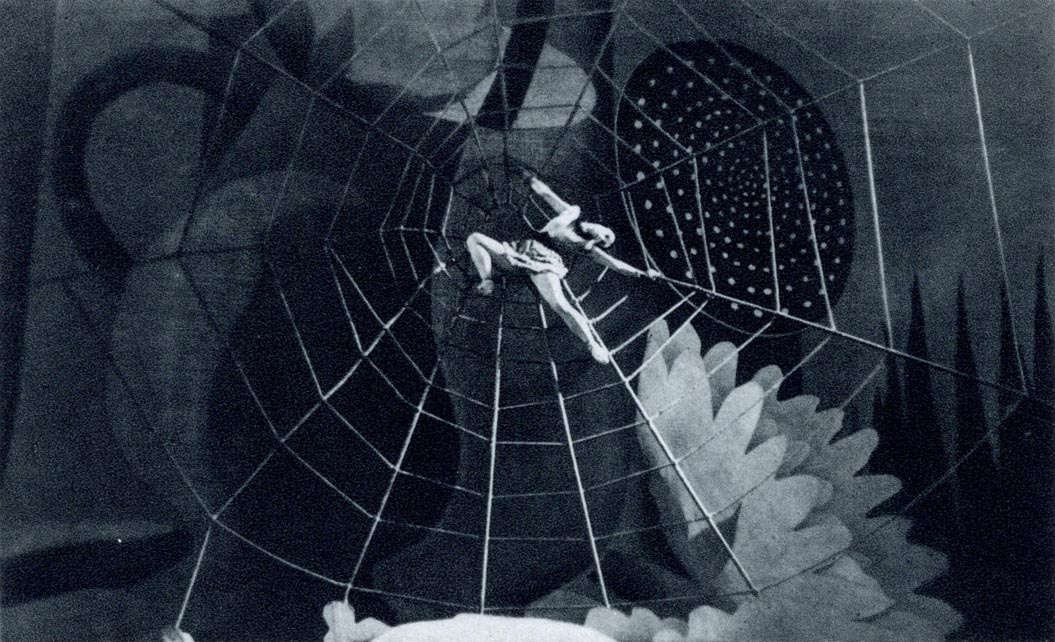
scène du Festin de l'Araignée de Roussel (reprise à Paris, 1939) [photo Seeberger]
ÉTAT PRÉSENT ET PERSPECTIVES D'AVENIR DU THÉÂTRE LYRIQUE
Il est difficile de porter un jugement sur l'état présent et sur les perspectives d'avenir du théâtre lyrique ; nous sommes trop près des œuvres contemporaines pour augurer de leur destin. A première vue, on serait tenté d'attribuer pour seules causes à une crise trop évidente la conjoncture économique et les faits politiques résultant des guerres. Mais l'art lyrique subit naturellement aussi les conséquences des querelles qui divisent le monde musical ; elles ont été fort vives depuis 1918 : à la réaction anti-debussyste des « jeunes » d'alors, à l'influence de Stravinski, succéda l'influence de Schönberg et de l'école dodécaphoniste ; au « retour » à Bach, au « dépouillement », un retour à l'expression. D'autre part, les genres naguère nettement divisés n'ont point cessé d'évoluer et parfois de se confondre. Partout on constate un besoin de renouvellement des formes plus ou moins usées, et le théâtre — hormis le ballet — tente de moins en moins les compositeurs. Il leur faudrait de l'héroïsme pour entreprendre d'écrire quatre ou cinq actes qui, à grand-peine, parviennent à être joués six ou sept fois, puis disparaissent le plus souvent sans espoir d'une reprise. L'opéra, l'opéra-comique, sont délaissés, et les ouvrages bouffes seuls se maintiennent relativement en faveur. Les causes de cette désaffection du public — et conséquemment des compositeurs — pour le drame lyrique sont nombreuses, et si nos contemporains préfèrent le ballet, c'est sans doute parce que l'élément visuel du spectacle les attire bien plus que sa qualité musicale. Habituée au mouvement, aux mises en scène luxueuses du film, la jeunesse ne s'accommode plus des lenteurs de l'opéra ni de l'inaptitude physique des chanteurs.
Ce n'est point le hasard qui a provoqué l'engouement des foules pour les représentations chorégraphiques. Au moment où le répertoire lyrique s'usait, les œuvres nouvelles ne parvenant plus à remplacer tant d'œuvres anciennes qui semblaient périmées, Diaghilev est venu. Ce qu'il apportait de nouveau, l'alliance qu'il proposait de la musique, de la danse et des arts décoratifs donnait aux ouvrages qu'il montait un caractère de nouveauté somptueuse d'autant plus séduisant qu'il s'entourait d'hommes de valeur ; il sut profiter des circonstances, et mieux encore les faire naître ; il sut n'épuiser jamais ses succès, et les renouveler en créant toujours autre chose que ce que l'on attendait. Au bout de trente ans le théâtre lyrique reste encore imprégné de ses idées, de ses réalisations.
C'est par leurs partitions chorégraphiques que la plupart des musiciens de la génération de 1910-1940 conquirent la renommée : Stravinski, Prokofiev, Manuel de Falla, Maurice Ravel, Florent Schmitt, tant d'autres avec eux se sont révélés aux Ballets russes, au Théâtre des Arts de Jacques Rouché, aux spectacles de Mme Ida Rubinstein, bien plutôt qu'à l'Opéra ou à l'Opéra-Comique. Cependant ceux-ci, et d'autres qui vinrent un peu plus tard, tentèrent résolument d'implanter au théâtre lyrique les hardiesses que le public d'avant-garde acceptait volontiers dans les soirées de ballets et dans les concerts. Milhaud assaisonna de dissonances non résolues tragédies antiques ou grands drames, les Choéphores, Médée, Christophe Colomb, Maximilien ou Bolivar, tantôt encore les livrets prosaïques de la Brebis égarée et du Pauvre Matelot — sans négliger les ballets : la Création du Monde, Salade (réussite délicieuse), ni sans parvenir par des moyens savamment simples à émouvoir profondément dans les Malheurs d'Orphée, à montrer une verve étincelante dans Esther de Carpentras. Georges Auric, dans ses musiques de scène, dans ses ballets (les Fâcheux, les Matelots, la Fontaine de Jouvence, le Peintre et son Modèle), rencontrait un succès qui allait s'accentuer encore avec Phèdre où Jean Cocteau transposait en action mimée et dansée la tragédie de Racine ; Poulenc n'était pas moins heureux avec les Biches et les Animaux modèles. Arthur Honegger montrait une tranquille grandeur dans Antigone après en avoir fait la preuve dans ses oratorios — grandeur qui ne le condamnait point à mépriser l'humour : le Roi Pausole, puis, en collaboration avec Jacques Ibert, les Petites Cardinal, suivant de près l'habile pastiche du grand opéra romantique qu'est l'Aiglon, en offraient une preuve convaincante. Enfin, Jeanne au bûcher, sur le texte de Claudel, obtenait un succès qui dépassait encore celui que l'ouvrage avait connu sous sa forme d'oratorio lors de sa création par Mme Ida Rubinstein, et apportait à l'Opéra une formule entièrement nouvelle.
A l'Opéra-Comique, avec un acte bouffe, Angélique, Jacques Ibert montrait lui aussi quelque chose de très neuf. Andromède et Persée à l'Opéra, le Roi d'Yvetot salle Favart, effarouchèrent sans doute les timides ; mais le succès de Diane de Poitiers aux spectacles de Mme Ida Rubinstein se renouvela quand l'Opéra reprit l'ouvrage et lorsqu'il créa le Chevalier errant — deux ballets où la symphonie se rehaussait de l'emploi fort habile des chœurs. De même avait fait quelques années plus tôt Florent Schmitt dans Oriane et le prince d'Amour, œuvre puissante qui porte la griffe du maître de la Tragédie de Salomé, du musicien si divers auquel on doit, dans un genre bien différent, ces deux chefs-d’œuvre que sont le Petit Elfe ferme l'œil et Reflets, tous deux à l'Opéra-Comique.
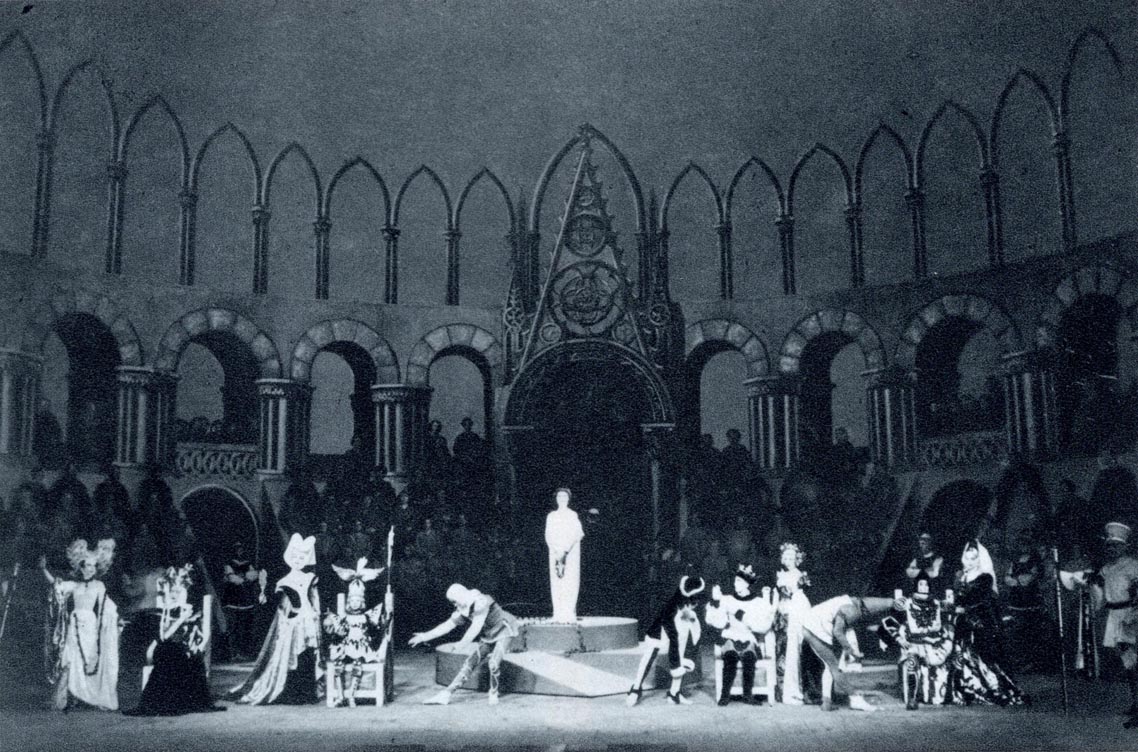
scène de Jeanne au bûcher d'Honegger (Paris, 1950) [photo Lipnitzki]

scène du Chevalier errant de Jacques Ibert (Paris, 1950) [photo Lipnitzki]
C'est aussi avec un ballet, le Bal vénitien, que Claude Delvincourt aborda le théâtre ; puis il donna la Femme à barbe, opéra bouffe d'un humour plein de finesse, avant d'entreprendre avec Lucifer de restaurer la forme oubliée du mystère. Destiné d'abord à Mme Ida Rubinstein, l'ouvrage récompensait à l'Opéra l'audace de son auteur et s'imposait par sa puissance concise, par la qualité de la langue harmonique et la nouveauté de la forme. Marcel Delannoy qui, avec le Poirier de Misère, scandalisait les habitués de l'Opéra-Comique, en 1924, tentait trois ans plus tard, avec le Fou de la Dame, d'élargir la forme du ballet chanté, puis, sans trop renier ses hardiesses, trouvait son équilibre avec la Pantoufle de vair dans le ballet, avec Ginevra et Puck dans la comédie et la féerie lyriques. Henri Sauguet écrivait pour la scène lyrique des œuvres bouffes comme la Contrebasse, le Plumet du Colonel, un grand opéra : la Chartreuse de Parme, et devait à ses ballets la Chatte, la Nuit, les Forains, les Mirages, de durables succès. Emmanuel Bondeville s'affirmait musicien de théâtre avec l'École des Maris, créée à l'Opéra-Comique et dont les reprises n'épuisèrent pas la vogue, puis donnait avec Madame Bovary un des ouvrages les plus significatifs de ce temps, non point que l'auteur y prétendît innover, mais parce qu'il offrait un exemple de ce que la sincérité — jointe bien entendu au talent — demeure le moyen le plus sûr pour un artiste de montrer son originalité.

scène de Madame Bovary d'Emmanuel Bondeville : la mansarde de Lheureux (sur scène R. Bourdin et J. Brumaire) [photo Erlanger]
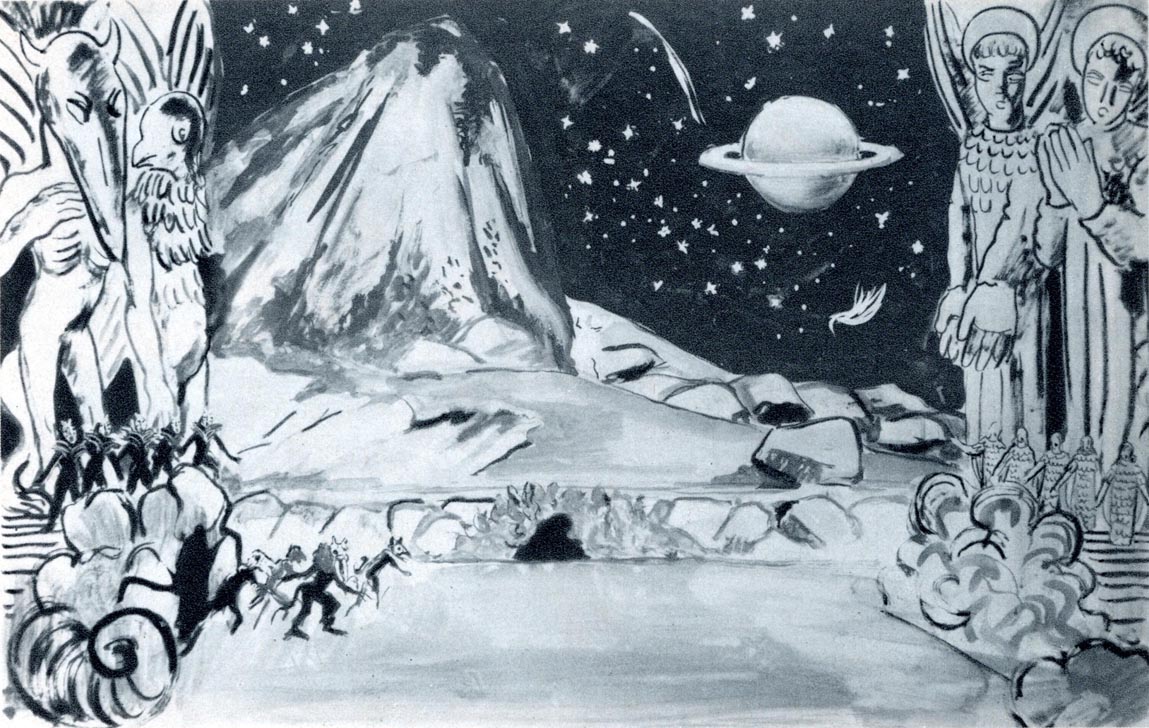
maquette du décor d'Yves Brayer pour Lucifer de Claude Delvincourt (Paris, 1948) [photo Lipnitzki]