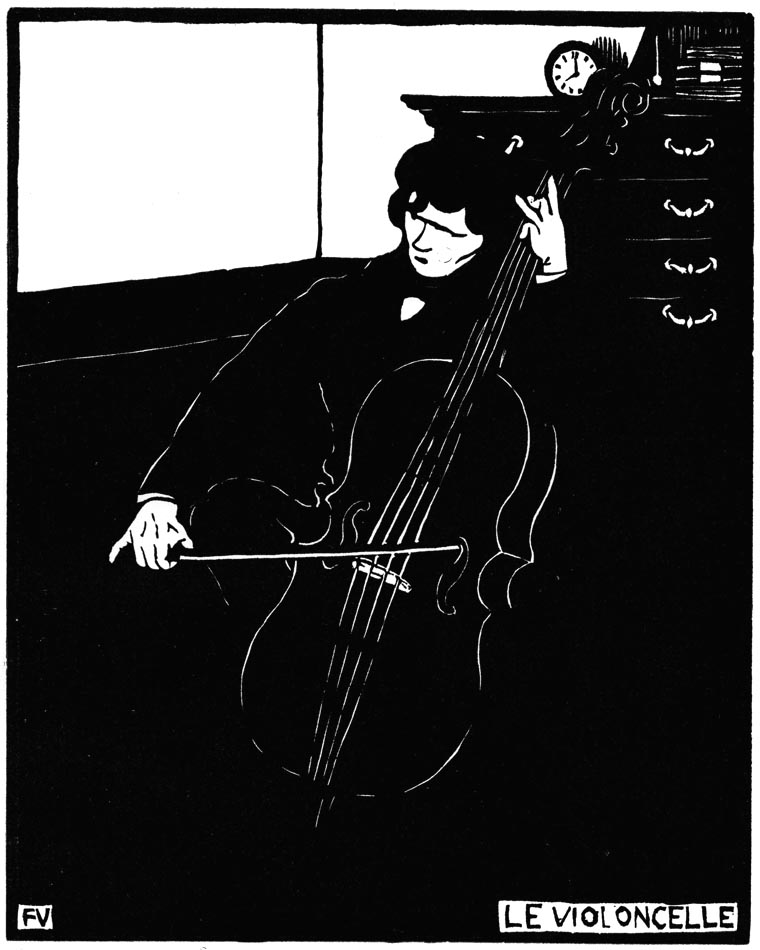
Cinquante ans de musique française (1874 - 1925)
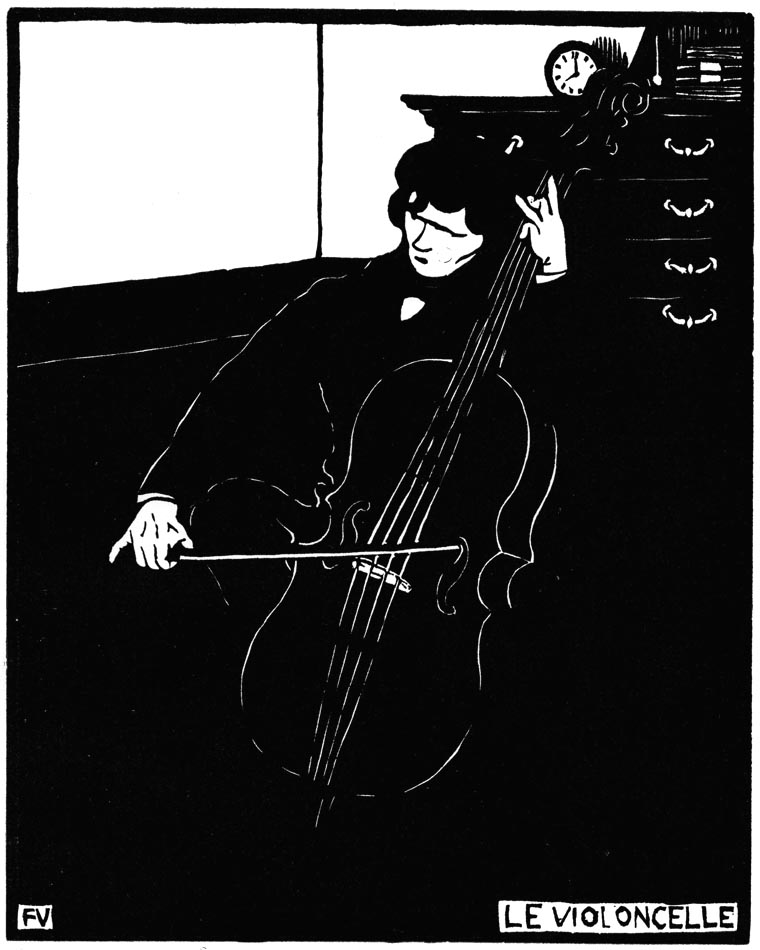
Félix Vallotton : le Violoncelle
GRANDS VIRTUOSES
par Raymond CHARPENTIER
On a le droit d'affirmer que les progrès accomplis dans la facture instrumentale au cours du XVIIIe siècle, ont provoqué l'évolution et l'épanouissement de la virtuosité. Cela ne saurait vouloir dire, certes, que les transformations de la matière soient les causes déterminantes de la transfiguration d'un art. La fonction crée l'organe. La technique musicale évoluait d'elle-même et devait réclamer des moyens d'expression nouveaux.
En maintes circonstances, la facture instrumentale a obéi aux exigences de la musique renouvelée dans ses sources vives. D'autres fois, elle a pu, par des découvertes hardies ou ingénieuses, montrer aux artistes des voies insoupçonnées et merveilleuses. Toujours, elle s'est adaptée, avec une souplesse et une intelligence admirables, aux aspirations mouvantes de la virtuosité.
L'histoire de celle-ci est étroitement liée aux améliorations que les techniciens ont victorieusement accumulées au prix d'un patient, régulier et laborieux acharnement.
Il faut donc, à la place d'honneur, inscrire au Livre d'or de la musique les noms de ces savants, de ces chercheurs modestes dont l'effort opiniâtre fut une source de conquêtes fécondes. Si, par exemple, le nom d'un Pascal Taskin (1730-1793), facteur de clavecins, est quelque peu connu de la postérité, pourquoi celui de Tourte n'éveillerait-il qu'un sourire incompréhensif de la part du public ignorant ? Tourte, ce fut ce fabricant, né et mort à Paris (1747-1835), qui arrêta la forme définitive de l'archet. Il en fixa la longueur à 0 m. 75, pour le violon et l'alto, à 0 m. 72 pour le violoncelle. Ayant constaté que le meilleur bois pour sa confection était celui de Pernambouc, jusqu'alors employé uniquement pour la teinture, il en détermina cette courbure précise qui assure son équilibre et sa souplesse.
Il serait superflu de retracer l'œuvre, connue de tous, d'Aristide Cavaillé-Coll, né à Montpellier en 1811, à qui nous devons, notamment, les orgues de Notre-Dame, de Saint-Sulpice, de la Madeleine, de la Trinité. Ce fut le facteur d'orgues anglais Barker (18061880) qui se fit l'inventeur du levier pneumatique, grâce auquel a augmenté la souplesse du toucher de l'orgue. Ce fut également lui qui, le premier, employa le mécanisme ancien par la transmission électrique. Faut-il citer également le Badois Merklin (1819), fondateur de la Société Merklin-Schutze, pour la fabrication des orgues d'églises. A l'autre pôle de la facture instrumentale, voici Adolphe Sax, né à Dinant, en Belgique (1814-1894), dont les inventions ont complètement transformé les corps de musique militaire, en y introduisant les saxhorns, les saxophones, les saxo-trombes, tous éléments nouveaux. Ami des vastes conceptions, Sax avait conçu le projet d'une salle de théâtre parabolique, dans laquelle l'orchestre eût été caché sous la scène, comme à Bayreuth. L'idée ne reçut pas de réalisation.
C'est lui qui, le premier, améliora la fabrication des clarinettes. Il trouva la loi des proportions qui régit les timbres. Au milieu des difficultés, des spoliations, des procès suscités par ses rivaux, il poursuivit ses recherches et classa en familles les instruments du même ordre. Enfin il simplifia la notation écrite par l'emploi d'une clé unique. Adolphe Sax fut professeur de saxophone au Conservatoire.
Adolphe Sax ne faisait que suivre l'exemple paternel. Charles-Joseph Sax, son père (Dinant 1791-Paris 1865) facteur d'instruments à vent, en bois et en métal, d'abord simple ouvrier, avait réussi, par son intelligence et son travail, à fonder la première fabrique d'instruments à vent à Bruxelles. Parmi de nombreuses inventions, il avait trouvé les lois régissant la longueur des divisions des corps sonores.
***
Presque à l'origine de l'histoire du piano, deux grandes firmes se dressent, deux firmes concurrentes; mais leur rivalité même nous apparaît plutôt, avec le recul des temps, comme révélant une unité et une communauté de dessein dans l'effort constant vers l'amélioration d'un instrument et le progrès d'un art. Loin de chercher à reconstituer leurs oppositions de méthodes ou de résultats, nous ne pouvons qu'unir, dans un même respect, Erard et Pleyel, de même que nous ne saurions, aujourd'hui, établir de vaines et stériles hiérarchies entre leurs successeurs et leurs continuateurs. A Sébastien Erard, « artisan de génie », mathématicien et mécanicien transcendantal, la France est redevable de l'espèce de suprématie qu'elle a occupée dans la fabrication du piano. Né à Strasbourg en 1752, Sébastien Erard avait débuté comme modeste ouvrier dans les ateliers d'un facteur parisien. Son intelligence et son habileté le mirent bientôt au premier plan. En 1776, il inventa le clavecin mécanique (« Flugel » avec registres). Ce fut l'année suivante qu'il construisit son premier piano, triomphalement exhibé dans les soirées de la Duchesse de Villeroy. A Marie-Antoinette il dédia son piano organisé, comprenant deux claviers: l'un donnant les sons du pianoforte, l'autre actionnant un jeu d'orgue. La Révolution devait provoquer son exil en Angleterre. A son retour, en 1796, il construisit son grand piano à queue de concert, d'après un système anglais perfectionné. Le maniement en était difficile. Erard chercha de nouveaux progrès. En 1808, le pianiste compositeur Dussek se fit entendre sur un nouveau piano Erard. L'instrument, sorti des ateliers du facteur français, remporta un triomphe. Il devait encore se perfectionner par la suite. Son principal mérite consistait dans le mode d'échappement des marteaux inventé en 1823. Ce système conférait une grande sensibilité aux touches du clavier et les marteaux faisaient résonner les cordes sous le plus délicat toucher. Il faut également porter à l'actif d'Erard l'invention de la harpe à double mouvement et celle de cet orgue d'église expressif sous la pression du doigt, et dont une partie a été utilisée pour la construction de l'orgue de la Salle des Concerts du Conservatoire. Quand Erard, qui s'était associé avec son frère Jean-Baptiste, mourut, le 5 août 1831 à la Muette, près de Paris, son neveu Pierre Erard se fit son continuateur.
C'est Chopin lui-même qui a formulé ce curieux parallèle entre les instruments Erard et ceux de la maison rivale Pleyel : « Quand je suis mal disposé, disait-il, je joue sur un piano Erard et j'y trouve facilement mon son fait. Mais quand je me sens en verve et assez fort pour trouver mon propre son « en moi », il me faut un piano de Pleyel ». Nous ne croyons pas qu'il convienne de tenir une telle appréciation, si suggestive soit-elle, pour une « définition » constante. Marmontel, jugeant les pianos Pleyel, s'extasiait sur « leur belle qualité de son, leur voix chantante, moelleuse, claire, argentine, l'homogénéité de l'échelle sonore, la docilité du clavier qui parle avec une grande facilité tout en conservant une résistance suffisante pour répondre avec justesse et précision à la pression intelligente des doigts ». En de telles matières, la caractéristique ne saurait évidemment être une. Elle ressortit au domaine de la relativité. Elle apparaît en des nuances diverses selon les sensibilités individuelles, essentiellement différentes et changeantes, le goût particulier et l'humeur variable des artistes eux-mêmes.
A l'origine de la firme qui porte son nom se trouve Ignace Pleyel, né en 1757 à Ruppersthal, près de Vienne, et mort en 1831. Son père, maître d'école, avait eu de deux mariages trente-huit enfants. Ignace Pleyel, né de la seconde épouse, était le vingt-quatrième ! Elève de Haydn, dont il avait été le pensionnaire de 1772 à 1777, il composa d'abondance. Après avoir visité l'Italie et donné à Naples Ifigenia, il était en 1793, Maître de Chapelle adjoint à Strasbourg. Douze ans plus tard, le Professional Concert de Londres l'appelait pour soutenir la lutte contre son ancien maître Haydn, qui donnait ses Symphonies à l'entreprise rivale d'Hanover-Square. Comme son émule Sébastien Erard, il ne traversa pas sans difficultés la tourmente révolutionnaire. En 1793, il était dénoncé comme suspect de sentiments réactionnaires. Pour échapper à la vindicte des maîtres de l'heure, il dut composer, séance tenante, la musique d'un poème célébrant l'anniversaire du 10 août. Ce pensum représenta sept jours et sept nuits d'un travail acharné. Ce fut sans doute, dans toute son existence, le seul labeur qui dut paraître amer à ce grand producteur. En 1795, Ignace Pleyel vint à Paris, avec sa famille, et fonda la maison d'édition à laquelle il devait adjoindre, un peu plus tard, la fabrique de pianos. Par une ironie, d'ailleurs fréquente, du sort, c'est à cette seule initiative qu'il doit sa célébrité, tandis que toute son œuvre de composition, émanation la plus directe de sa personnalité, presque totalement ignorée de la postérité, a sombré dans l'oubli.
Après la mort d'Ignace Pleyel, son fils Camille, (Strasbourg 1788-Paris 1855) avait pris la direction de la maison, lui donnant un nouvel essor. Puis, ce fut Auguste Wolff (1821-1827), neveu d'Ambroise Thomas et prédécesseur immédiat de M. Gustave Lyon, qui continua d'apporter de nouveaux perfectionnements à la fabrication des pianos. Mais, pendant quelques années, l'entreprise Pleyel avait eu à sa tête un facteur de pianos, originaire de la Souabe : Henri Pape, qui, dès 1815, s'établissait pour son propre compte. Il estimait que les cordes de pianoforte donnaient un son plus clair quand la table de résonnance était complètement fermée. Il adaptait à ses pianos la disposition adoptée par Streicher, en vertu de laquelle les marteaux frappaient les cordes par dessus. Ce procédé se généralisa dans les pianos droits. Au XVIIIe siècle, les instruments avaient revêtu les aspects les plus variés. On leur donnait la forme tantôt d'un meuble de salon, tantôt d'un secrétaire, d'une console, d'un bureau à cylindre. Seuls, le piano droit à cordes obliques de différents formats et le piano à queue, donnant l'illusion d'un grand clavecin à trois pieds, sont demeurés et n'ont plus guère subi de modifications sensibles. Ces modèles fixés une fois pour toutes, l'imagination des constructeurs s'est détournée de ces questions de disposition extérieure et a serré de plus près les détails de facture. Ils se sont attachés à rendre plus lent le désaccord de l'instrument, en insérant dans une plaque de fer les chevilles, auxquelles sont fixées les extrémités des cordes. La lourde plaque, qui augmentait gravement et inutilement le poids de l'instrument, a été remplacée par un cadre en fer forgé. L'emploi de l'acier trempé a permis aux cordes de gagner en solidité et en sonorité. En les croisant, on a pu construire des pianos à queue, dits d'accompagnement ou de cabinet, dont les dimensions modestes ont rendu l'usage plus courant.
Le compositeur Jean-Bernard Logier (Cassel 1777-Dublin 1846), avait inventé le chiroplaste, instrument destiné à corriger les positions vicieuses de la main dans l'étude du piano. C'était une machine compliquée qui eut un moment de vogue. Kalkbrenner notamment l'employa mais la remplaça plus tard par le « guide-mains » ! Autre engin miraculeux, depuis longtemps aussi délaissé.
D'une portée technique plus considérable encore, fut la découverte de la pédale de prolongation, construite par Debain à Paris en 1860, par Montal à Londres en 1862, perfectionnée par Steinway en 1874. Combien d'autres inventions encore, d'un intérêt artistique sans doute moindre, méritent d'être mentionnées à titre de curiosité : les claviers à transposition à l'usage des musiciens (!) incapables de transposer à première vue, la pédale artistique, le jeu de résonnance pneumatique zacharia, le piano éolien (Herz), dans lequel le prolongement du son était obtenu au moyen d'une soufflerie, enfin, les instruments sténographes, mélographes, pianographes, permettant de noter des sons produits par des points et des lignes tracées sur un cylindre, et les modernes pianolas, d'une vogue si constante aujourd'hui. Les services qu'est susceptible de rendre le piano double Lyon-Pleyel sont aisément concevables. Il comprend deux mécanismes complets, deux jeux de cordes, en partie croisées, mais sur une seule table d'harmonie, ce qui assure l'égalité des divers registres des deux pianos, leur homogénéité et leur interdépendance. La vibration sympathique des cordes recule les limites d'intensité. Le piano double était tout désigné pour servir d'agent à l'exécution des réductions des grandes compositions orchestrales. Erard et Pleyel devaient, l'un et l'autre, trouver bien plus que des concurrents, des continuateurs qui s'efforcèrent de parachever leur travail ou de suppléer aux lacunes inséparables de toute œuvre humaine. Kriegstein, Beller et Pfeiffer, Blanchet, Souffletot, Montal, Bord, Ancher, Gaidon, Pedzel, Martin, Flaxhand, Mussard, Boisselot, rivalisèrent d'ingéniosité. Et la maison Gaveau vint un peu plus tard apporter à la facture française un centre d'études et d'activité de plus.
Avec Clémenti, les virtuoses Steibelt et Dussek furent, sans doute, les deux artistes qui influencèrent le plus grandement les progrès de la virtuosité et le style des compositions pianistiques. Ils étaient grands amis des frères Erard. Ceux-ci s'ingéniaient à leur fournir des instruments dociles à leurs désirs de virtuoses, propres à faciliter leurs effets de sonorité. Mais Dussek et Steibelt, de leur côté, ne restaient pas étrangers aux perfectionnements de la facture. Ils « collaboraient », au sens intelligent du terme, avec les frères Erard, les aidaient de leurs conseils et de leurs suggestions et, par leurs exigences mêmes d'exécutants, exerçaient une action féconde sur les progrès réalisés dans la fabrication. Cette alliance des virtuoses et des facteurs n'est pas un cas isolé. Presque constamment, dans l'histoire du piano, artistes et artisans ont mêlé leurs efforts pour arriver à faire jaillir, de la matière brute, l'étincelle divine, à en extraire l'idéal « outil » de beauté et d'harmonie. Pour s'adonner à ces recherches, l'artiste devait, de toute nécessité, posséder une connaissance de son instrument que l'on souhaiterait à maints virtuoses de nos jours. Il est effarant de constater, chez les neuf dixièmes des apprentis pianistes, une ignorance totale de la matière même qu'ils sont censés pétrir ; une méconnaissance absolue, non seulement des lois physiques qui régissent l'équilibre sonore de leur instrument, mais même des organes fonctionnels primordiaux de l'édifice. A côté d'un Ignace Pleyel, à la fois technicien et artiste, de grands virtuoses de jadis, comme Kalkbrenner, Liszt, Chopin, Thalberg, signalaient eux-mêmes les améliorations à apporter sur un instrument dont ils connaissaient le principe et l'essence. Le célèbre pianiste Henri Herz fondait et dirigeait, avec l'aide de ses frères, Jacques et Charles, la maison de facture où l'on s'efforçait d'obtenir la solidité et la moelleuse qualité du son, la perfection du mécanisme et l'élégance de la forme. Les anciens pianos de 1824 avaient quatre ou cinq pédales modifiant la qualité de son et le timbre normal du piano. Marmontel raconte que l'une d'elles, à sa grande joie d'enfant, frappait sur un tambourin agitant des clochettes. On croit que cette addition avait été demandée par Steibelt pour l'exécution de ses pièces fantaisistes dites bacchanales.
Cramer, après avoir, vers 1832, passé quelques années à Paris entouré d'une cour d'admirateurs et de disciples fervents où figuraient C. Pleyel, Zimmermann, Boely, Kalkbrenner, était allé s'établir aux environs de Londres où il devait mourir à 87 ans, non sans avoir, comme son condisciple John Field, quelque peu cultivé la dive bouteille. En Angleterre, il devait exercer une influence notable sur les progrès de la facture. Il imitait en cela l'exemple de son maître Clémenti. Celui-ci avait créé une manufacture qui rivalisait d'activité avec la grande maison Broadwood. Il y eut une occasion, entre autres, où la facture instrumentale parut avoir merveilleusement flairé et annoncé un changement d'orientation musicale ; ce fut à la fin du siècle dernier lorsque se produisit l'essai de reconstitution du clavecin tenté par la maison Pleyel. Cette initiative n'avait pas seulement une portée pratique en ce sens qu'elle offrait à des artistes renommés le moyen de restituer les œuvres des clavecinistes telles que les avaient con. çues les compositeurs de jadis. Elle était surtout la marque d'un merveilleux opportunisme artistique, car elle traduisait par une réalité palpable l'évolution qui s'accomplissait dans la technique du piano, le retour à l'étude des grands maîtres du passé, la renaissance du style, de la méthode, presque de la technique des clavecinistes. Pour Marmontel, l'école moderne du piano, celle du moins que l'on désignait sous le titre générique d'école du style lié, scientifique et sévère, avait pour ancêtres, pour patriarches et pour tuteurs, les organistes, les clavecinistes, en principe tous les virtuoses célèbres du clavier, que leurs instruments se fussent appelés épinettes, manicordes, clavicordes, virginales, gravicymbalums ou clavecins. Marmontel, clairvoyant témoin, signalait déjà les prodromes d'une réaction qui ne faisait que se dessiner à cette époque, car les virtuoses de sa génération, que nous devons mentionner ici, furent loin d'échapper aux extrêmes influences de la période romantique du piano, celle qui est dominée par les trois grandes figures de Schumann, de Chopin et de Liszt et qui se caractérise, précisément, par le degré de perfection auquel on était parvenu dans la construction du pianoforte. On avait assisté là, sans doute, à la révolution la plus grandiose dans l'art musical. Le pianoforte substituait les marteaux aux becs de plumes des anciens clavecins. En 1777, la conversion de Mozart au nouveau mode d'expression était un fait accompli. De 1770 à 1780, l'étude de la sonorité, des nuances, la connaissance des contrastes, des effets à produire, transformaient les maîtres clavecinistes en pianistes habiles. C'était la grande vogue de Taskin, d'Ignace Pleyel, de Hermann et de Hullmandel. Il ne faudrait pas croire, pourtant, que la révélation du pianoforte eût déterminé directement et immédiatement une poussée hostile à la tradition des maîtres du clavier. L'éclosion de l'Ecole Romantique du piano a suivi un processus assez complexe. Elle aurait été plutôt à retardement et ses effets à longue échéance. Ceux-ci se faisaient sentir encore, non seulement sur les virtuoses de la fin du xix° siècle, mais sur ceux de notre temps. Tels de nos contemporains les plus proches en demeurent tout imprégnés. A l'époque où des transformations si profondes s'accomplissaient dans l'âme même de l'instrument, l'audition de Clémenti, à son premier voyage à Paris, en 1870, faisait sensation et exerçait une pénétrante influence sur le style des compositeurs pianistes. Or, l'art de Clémenti s'était formé à l'étude des œuvres de Bach, de Haendel et de Scarlatti. « Mais, écrit Marmontel, réchauffée par le feu de la verve italienne, elle offrait un type de perfection que les virtuoses parisiens prirent pour modèle ». Là, cependant, fut le point de départ de l'Ecole du style lié qui allait rallier les favoris de Clémenti, imposant état-major où voisinaient J.-B Cramer, J. Field, Mme de Mongerault, Pradher, Boely, Kalkbrenner, L. Adam, H. Herz, Boieldieu, Herold, etc... On a dit de Rubinstein qu'avec les fausses notes qu'il égrenait dans l'exécution d'un morceau, il y avait de quoi composer un autre morceau. En dépit de cette boutade, le célèbre pianiste fut admiré et, en quelque sorte, idolâtré. Il le serait peut-être moins aujourd'hui. L'interprétation musicale s'est profondément modifiée. Les virtuoses qui descendaient et procédaient directement de Liszt ou de Paganini, employaient le langage qui correspondait directement à la sensibilité artistique de leur époque. Les artistes de nos jours s'attacheront davantage à la recherche de la nuance, du détail, de l'infiniment petit. Ils ne brosseront peut-être pas fréquemment de géniales fresques, mais ils s'efforceront d'offrir à leurs auditeurs un travail fouillé, parachevé, semblable à un bibelot patiemment et adroitement ciselé. L'interprétation moderne se caractérise probablement, dans sa tendance générale, par l'abandon de tout romantisme échevelé. par le retour à la simplicité, à la clarté, au goût. L'intervention opportune de quelques éminents producteurs a suffi, dirait-on, à donner à la musique son visage nouveau. Là encore, les Maîtres ont changé l'orientation de la virtuosité. Là encore, la fonction a créé l'organe. Il ne pouvait être douteux que les œuvres de Debussy, de Fauré, de Ravel, trouveraient un jour des interprètes à leur mesure. Certes, l'exécutant professionnel traîne longtemps dans les sentiers battus. Il hésite à s'engager dans des voies non frayées. Son public met, d'ailleurs. un temps plus long encore, nous l'avons déjà déploré, à comprendre ce qui ce passe autour de son époque. Et c'est l'excuse, à la rigueur valable, des virtuoses qui, obligés à tenir compte des nécessités matérielles de leur carrière, se préoccupent surtout de fournir à leur clientèle sa pâture. A côté de ces résignés, il y a aussi les convaincus, les enflammés, les zélateurs de religions nobles mais résolues ; ceux qui fixent éternellement leurs yeux illuminés et jamais rassasiés sur le Dieu dont le règne est depuis longtemps arrivé et dont la gloire, acceptée par tous, n'est plus menacée par personne. Il est de très grands, d'illustres artistes dont les noms s'alignent ici et qu'un amour exclusif de Beethoven ou de Chopin semble avoir pour jamais détournés de consacrer leur talent à la défense des causes plus actuelles, plus hasardeuses et peut-être plus dignes d'efforts. Mais le désintéressement de ces virtuoses n'a d'égal que leur culte du passé. Par contre, on assiste au phénomène presque inverse parmi les jeunes couches musicales. Là, l'impérieux appel du présent reçoit de promptes et spontanées réponses. Les Maîtres de ces vingt dernières années trouvent, dans les « classes » d'après-guerre, leur contingent de défenseurs naturels et enthousiastes. Nous avons été témoin du cas de tel jeune virtuose, premier prix du Conservatoire, préparant son répertoire, en vue de Concerts dans les Grandes Associations, et qui, requis par ses maîtres de choisir, comme plat de résistance, la Wanderer-Fantaisie de Schubert-Liszt, protestait de tout son cœur qu'il n'y comprenait rien et que tel prélude de Debussy ferait beaucoup mieux son affaire. Ce n'était affectation ni snobisme de sa part. C'est un fait que nos jeunes exécutants pensent maintenant en musique selon le cœur et l'esprit d'un Debussy, par exemple. Les enfants qui sont nés l'année de Pelléas ont été nourris, élevés dans l'ambiance d'une ère nouvelle. Le jour où leur personnalité a pu se manifester, elle s'est révélée conforme à l'inconsciente pensée dont leur enfance avait été bercée. S'ils ont mis quinze ou vingt ans à la dégager, c'est qu'il leur fallait bien le temps de grandir. C'est pour cette raison que l'influence d'un événement, d'une doctrine ou d'un dogme est toujours quelque peu à retardement. Quand la semence est tombée, il lui faut le temps de germer. Tel est le secret des aspects changeants de l'interprétation musicale, des flux et des reflux apparents subis par certaines écoles, au cours de cette période de cinquante ans de musique française. A son aurore, Hector Berlioz (8 mars 1869) vient de mourir, Gounod et César Franck projettent la grande ombre de leur édifiante vieillesse sur le siècle. Mais à son apogée, Chabrier, Chausson, Lalo. se détachent en pleine lumière sur le fond de la production musicale. Et voici Gabriel Fauré, dont la fine silhouette se profile comme avec discrétion, et qui marque probablement le point de départ et la transition de l'école du piano moderne.
***
A l'origine de l'histoire du piano en France dans la seconde moitié du XIXe siècle, il n'y a pas seulement des virtuoses admirables qui ont été en même temps des professeurs éminents, tel un Zimmermann (1785-1853), élève lui-même de Boieldieu et fils du facteur de pianos, qui fut le maître d'Alban, de Prudent, de Marmontel, de Ravina, de Lacombe, d'Ambroise Thomas, de Bizet et de Gounod (ce dernier devint son gendre)... Il y a aussi une pléiade de théoriciens et de pédagogues. Nous avons nommé dans la rapide revue des exécutants étrangers Leschetitzki (Lemberg, 1831-Vienne 1916) qui forma Paderewski, Galston, Paul Goeldschmidt, Gabrilowitch... Le viennois Charles Czerny (1751-1857) universellement célèbre par ses Etudes, servant de base au travail dans tous les Conservatoires et dans toutes les Ecoles de musique, avait initié Liszt, Dœhler, Thalberg, Alb. Jaëll... Hortense Parent (Londres, 1837), 1er prix de piano en 1857 au Conservatoire de Paris, fondait en 1862, l'Ecole préparatoire au professorat du piano. En France, Albert Lavignac (Paris, 1846-1916), 1er prix de piano en 1861, d'harmonie et d'accompagnement en 1863, de contrepoint et fugue en 1864, 2e prix d'orgue en 1865, faisait beaucoup par ses travaux didactiques pour l'éducation première des jeunes musiciens et laissait, par certains de ses ouvrages, La Musique et les Musiciens, le Voyage à Bayreuth, un monument pouvant servir, pour les générations futures, de témoignage à l'art d'une époque. Lavignac payant davantage encore de sa personne, était en outre devenu professeur de solfège en 1882 et d'harmonie en 1887 au Conservatoire. Amédée de Méreaux (Paris, 1803-Rouen, 1875) illustrait en un recueil les clavecinistes de 1637 à 1750. Jeanne-Louise Dumont-Farrenc (1804-1875) épouse du renommé flûtiste-hautboïste, dirigeait brillamment une classe au Conservatoire de 1842 jusqu'en 1873. Lecarpentier (1805-1865) qui avait obtenu au Conservatoire quasiment toutes les récompenses, solfège, harmonie, accompagnement, contrepoint, fugue, (et même le second prix de Rome !) sauf celle de piano, léguait son nom à la postérité uniquement grâce à ses exercices, à ses études et à sa « Méthode » de piano. Enfin Félix Le Couppey surtout (1814-1887) prenait rang de guide révéré dans l'enseignement du piano. Elève de Dourlen, il était à 17 ans, professeur adjoint d'harmonie, à 23 ans, professeur de solfège, à 34 ans, professeur de piano au Conservatoire. C'est en 1848, qu'il succéda à Henri Herz à la tête d'une classe de femmes. Non seulement il faisait souche de disciples bientôt illustres, mais il élaborait, dans des ouvrages comme l'Enseignement du piano ou l'Art du piano, des traités qui ont été longtemps considérés comme la grammaire la plus complète et la plus claire de cet art.
Dans la génération même de ces esthéticiens, quelques virtuoses apparaissent un peu tels des météores, rapidement enfuis, mais dont le souvenir surnage quand même : tels les pianistes parisiens Henri Rosellen (1811-1876) et Maurice Decourcelle (1819-1888). Mais voici les deux Alkan, un couple d'artistes dont la gloire, ayant brillé très vive de leur vivant au firmament artistique, s'est cristallisée parmi les planètes de notable grandeur. Claude-Valentin Alkan, dit « l'aîné » (30 novembre 1813-29 mai 1888), naquit et mourut à Paris. A six ans, il fut admis au Conservatoire où il obtint le 1er prix de solfège en 1821, le 2e prix de piano en 1824 et celui d'harmonie en 1826. En 1831, il obtenait une mention au concours de Rome. Elève de Zimmermann, il excellait à interpréter dans le style approprié les grands maîtres du clavier. Son jeu offrait des ressources de sonorité singulières. En 1848 il donna, à la salle Erard, des « Concerts Historiques » dans lesquels furent passés en revue, sur les instruments particuliers à chaque époque, les chefs-d'œuvre de l'école du piano jusqu'à cette date. Chaque année il se faisait entendre dans des séries de matinées intitulées Petits Concerts, fêtes du goût et de l'audition musicale. Napoléon Morhange, dit Alkan, lui aussi remarquable pianiste, fut également 1er prix de solfège et de piano (1836-1836) 1er prix de Contrepoint et Fugue en 1845. Il décrocha même, en 1850, le « 1er second grand prix » de Rome. Il fut titulaire d'une classe de solfège au Conservatoire, de 1845 à 1896 et mourut le 29 août 1906, âgé de quatre-vingts ans.
Voici encore, pour mémoire, Quidant Joseph, dit Alfred, né le 7 décembre 1815, à Lyon, pianiste et compositeur, qui fut attaché, vers 1832, à la Maison Erard. Et l'on découvre l'une des figures assurément les plus considérables de la virtuosité et de la pédagogie musicale au XIXe siècle : Antoine-François Marmontel ; considéré, à juste titre, comme le père de plusieurs générations de pianistes. Il était né le 18 janvier 1816, à Clermont-Ferrand. Il n'avait pas trente ans lorsqu'il fut nommé professeur au Conservatoire, dont il était lauréat. En 1847, il dirigeait une classe de piano. Strict défenseur du style classique, il prêchait lui-même d'exemple dans son jeu, sûr, correct, élégant et coloré. Il transmit les rigoureux secrets des traditions, et, mieux encore, leur esprit et leur sens artistique, à Planté, à Diémer, à Théodore Dubois, à Guiraud, à Duvernoy, à Reitlinger. Son fils, Antoine-Emile-Louis Corbaz Marmontel fut, lui aussi, un virtuose accompli. Il était né le 24 novembre 1850. 1er prix de piano en 1867, professeur au Conservatoire à partir de 1902, il mourut le 23 juillet 1907. Il était nécessaire que l'influence d'un Marmontel, pondératrice et mesurée, se fît sentir au moment où certaines natures d'artistes français, volontiers impersonnelles, subissaient l'emprise de certaines modes et la tentation de certains exemples. C'est ainsi qu'un Henri Potier (1818-1875) et surtout un Emile Bennie Prudent, se laissaient gagner par la vogue de l'acrobatie, provoquée par les succès de Thalberg. Prudent, par exemple, se consacrait entièrement au culte de ce genre, d'ailleurs fructueux, mais superficiel : les imitateurs ne valaient pas le modèle. Prudent, né à Angoulême le 4 avril 1817, 1er Prix de piano du Conservatoire en 1833, s'affirmait, dès 1836, idolâtre du dieu Thalberg et membre de sa secte. Cela ne lui nuisit pas car il remporta, au cours de nombreux voyages, et tant en France qu'à l'étranger, des succès qui ne firent que grandir jusqu'à sa mort, survenue en 1863. Tout au rebours de ce « sujet », d'ailleurs exceptionnellement doué, Louis-Brouillon Lacombe, né à Bourges le 26 novembre 1818, 1er Prix du Conservatoire en 1831, avait reçu de Czerny le secret du style classique dont il restait pénétré. Il en démontrait la noblesse et les séductions au cours des nombreux concerts qu'il donnait en France et en Allemagne. A partir de 1842, de retour à Paris, il se livrait à la composition et augmentait le répertoire des pianistes. L'année même qu'il remportait son prix de piano au Conservatoire, y entrait Jean-Henri Ravina, né à Bordeaux le 20 mai 1818. Agé de 8 ans, il avait commencé de jouer dans les concerts. En 1834, à son tour, il était 1er Prix de piano, puis 1er Prix d'Harmonie et d'Accompagnement au piano. A la fin de 1835, il devenait professeur-adjoint de piano. Contrairement à d'autres artistes, qui abandonnent la carrière de virtuose pour l'enseignement, Ravina, en 1837, donna sa démission du Conservatoire pour se consacrer au concert. Dans ses voyages, il visita notamment, avec succès, la Russie et l'Espagne.
Trois pianistes du nom de Duvernoy, eurent, quoique de générations différentes, leur heure de célébrité à peu près vers le même temps. Henri-Louis-Charles Duvernoy, né le 16 novembre 1820, avait fait une véritable rafle de récompenses au Conservatoire où il devenait, par la suite, professeur. Alphonse Duvernoy, né à Paris le 30 août 1842, fils de Charles-François Duvernoy, chef du pensionnat du Conservatoire, était à la fois pianiste et compositeur, donnait des fragments symphoniques au Concert Colonne et voyait son œuvre, la Tempête, couronnée aux concours de la Ville de Paris de 1880. Son frère cadet, Edmond Duvernoy, pendant quelque temps chanteur à l'Opéra-Comique et qui se maria avec Mlle Franck, de ce théâtre, eut également des dons et une certaine science de pianiste, qu'il utilisa comme accompagnateur. Nous avons parlé du rôle qu'avait joué dans la maison Pleyel, à partir de 1852, Auguste Wolff, né à Paris en 1821, auquel on doit de nombreux perfectionnements de l'instrument et la fondation, dans sa manufacture, de la Société de Secours Mutuels et de la Caisse de prêts sans intérêts, innovations philanthropiques assez audacieuses pour l'époque. Auguste Wolff, 1er Prix de piano en 1839, fut également professeur au Conservatoire de 1842 à 1847. Il n'avait que le nom de commun avec Edouard Wolff, né le 15 septembre 1816, à Varsovie, venu en 1835 à Paris et qui s'y tailla de grands succès dans les concerts jusqu'en 1888, date de sa mort. Les maîtres de ce dernier avaient été : Zawadski, à Varsovie, et Winfel, à Vienne.
Georges Mathias (Paris 1826-1910) a été l'un des maîtres les plus écoutés et dont l'action s'est fait le plus énergiquement sentir sur des maîtres très proches de nous. Il avait été l'élève de Kalkbrenner et de Chopin. Professeur au Conservatoire de 1862 à 1888, il eut, dans sa classe, Pugno, Philipp et Chevillard. Jules Philippot, né à Paris le 24 janvier 1824, 1er Prix de piano en 1844 doit, plus qu'à sa carrière de pianiste, sa notoriété au triple Concours organisé en 1867 pour des ouvrages destinés à l'Opéra, à l'Opéra-Comique et au Théâtre-Lyrique, et auquel il obtint le prix avec son ouvrage le Magnifique, représenté à la Gaîté en 1876. Ainsi augmentait-il la liste déjà longue des pianistes-compositeurs dont le violon d'Ingres, si l'on ose dire, semblait leur piano, tout absorbés qu'ils étaient dans leur tâche considérable de créateurs. Henri Kowalski, né à Paris en 1841, auteur d'une Marche Hongroise, qui n'est qu'un pastiche banal de celle de Racockzi, semble avoir été du nombre. Et le bon Mathias lui-même n'échappa pas à cette prédestination, puisqu'il taquina Euterpe à ses heures !
Quelques pianistes de la même période doivent être mentionnés sans avoir marqué de hauts faits particuliers la partie militante de leur vie artistique. Tels Talexy (1821-1881), Ketterer (1831-1870), Adolphe David (1842-1897) et Frédéric Brisson, né à Angoulême en 1831, et qui, le premier, eut l'idée d'employer des notes de grosseur différente pour indiquer clairement à l'œil la marche des diverses parties dans un morceau, encore que cette « invention » soit généralement attribuée à Thalberg.
Doublement illustré, et par son père, le violoniste et par lui-même, fut le nom de Charles-Wilfrid de Bériot. Sa mère était Mme Garcia-Malibran. Né à Paris le 12 février 1883, il abandonna l'Ecole Militaire de Bruxelles, où il était entré en 1850, pour se livrer à la virtuosité. Il se fit remarquer surtout par son interprétation des classiques. En 1886, il était professeur à l'Ecole Niedermeyer et au Conservatoire en 1887. Parmi ses élèves figurent Viñes, Malats, Brière et Dumesnil. Georges Pfeiffer, né le 12 décembre 1835, fils de Mme Clara Pfeiffer, pianiste de mérite, et petit-neveu du facteur de pianos, remporta des succès de concert et fut également lauréat (comme compositeur !) de l'Académie des Beaux-Arts et de la Société des Compositeurs. Mme Davidson Arabella Goddard, d'origine anglaise, était née à Saint-Servan en 1836. Elève de Kalkbrenner et de Thalberg, elle était particulièrement fêtée en Angleterre et en Amérique et appréciée dans toute l'Europe. A partir de 1877, elle donna, à Paris, des concerts avec une assiduité particulière.
Théodore Ritter (1836-1886), parisien de naissance, fut élève de Liszt. On lui reprocha, en son temps, d'être plus remarquable dans l'interprétation de la musique légère et fantaisiste que dans la traduction des classiques. Son jeu, disait-on, était naturellement sec. Cette opinion trouve d'ailleurs sa contre-partie dans celles des critiques qui voyaient en lui « un virtuose aussi intéressant dans l'interprétation des classiques qu'étincelant de verve lorsqu'il exécutait ses propres œuvres, un interprète hors ligne et d'un style très élevé des Concertos de Beethoven. » Théodore Ritter s'était produit très jeune dans les Concerts. Il fit de nombreuses et fréquentes tournées. Il devint le pianiste attitré des Concerts Populaires de Pasdeloup. Il mourut en 1886, en plein succès.
Contemporain de Ritter, mais qui lui survécut sensiblement, Eraïm-Miriam, dit Elie Delaborde (Paris, février 1839-1914), fut l'un des plus brillants élèves de Moschelès et surtout de Ch. Valentin Alkan. Il continua le style de ce dernier. L'Angleterre, l'Allemagne, la Russie l'appelèrent tour à tour. Puis il se fixa à Paris et devint professeur au Conservatoire, en 1873. Il forma de nombreux disciples et, particulièrement, de remarquables élèves femmes.
Henri-Alexis Fissot était né le 24 octobre 1845, à Airaisne (Somme). Il obtenait les récompenses de piano en 1855, d'harmonie en 1857, d'orgue en 1860. A 18 ans, il avait achevé ses études au Conservatoire. La virtuosité et l'enseignement l'accaparèrent à la fin. On vantait son style, la qualité de sa sonorité, la sûreté de sa technique, la puissance, le charme et l'élégance de son mécanisme. En 1887, une classe de piano au Conservatoire lui échut. Il la conserva jusqu'à sa mort (Paris, 28 janvier 1896). Immédiatement avant lui avait professé une femme, qui, avec Marmontel, avait constitué comme l'un des piliers les plus solides de l'enseignement pratiqué Cité Bergère. Mme Massart, née Louise-Aglaé Masson, était la femme du violoniste célèbre. Née à Paris le 10 juin 1827, elle avait obtenu le 1er Prix de piano en 1840. Elle ne fit guère une carrière de virtuose. Mais, un nombre incalculable d'élèves avait défilé dans sa classe, subi le règne autoritaire de sa férule et reçu l'empreinte de l'enseignement sévère, consciencieux et fort ordonné qu'elle distribua de 1875 à 1887. Elle mourut à Paris le 26 juillet de cette année. Dans le même esprit et sur le même terrain, quoique dans une sphère plus modeste. Emilie-Charlotte-Leroy (19 septembre 1828-1907), devenue Mme Emile Rety, femme du Secrétaire Général du Conservatoire, avait, pendant des années, de 1856 à 1888, déblayé la besogne dans une classe de piano préparatoire et « apprêté » les élèves que Mme Massart recueillait au second degré, pour ainsi dire. Femme également, mais beaucoup plus impartie des qualités de l'exécutant que du professeur, Fanny-MarcelineCaroline Montigny-Rémaury, née à Pamiers, le 22 janvier 1843, 1er prix de piano en 1858, donnait en abondance des concerts avec orchestre à Paris et à l'étranger. La netteté de son jeu et l'allure classique de son talent la distinguaient de la masse de ses concurrents. Elle se fit entendre notamment avec le violoniste Léonard. Mme Montigny-Rémaury mourut en 1914.
Trois musiciens qui furent contemporains, et dont seule leur qualité de compositeurs a perpétué le souvenir, doivent être mentionnés ici comme ayant fait partie de l'école pianistique de l'époque. Ce sont Victor-Alfred Pelletier Rabuteau, né à Paris, le 7 juin 1843, qui fit ses études au Conservatoire, remporta le prix de Rome en 1868 et fut à la fois pianiste et violoniste, Francis Thomé, originaire de l'Ile Maurice (18 octobre 1850) et Augusta Holmès (1847-1903). Sensiblement plus jeune, Clotilde Kleeberg, née le 27 juin 1866 à Paris, mariée à un artiste belge, M. Samuel, a fourni la carrière la plus harmonieuse et la plus digne qui soit. Elle avait obtenu au Conservatoire la 1re médaille de clavier en 1877, et le 1er prix de piano en 1878. Elle s'imposa rapidement grâce à la pureté de son style, à la grâce et à la finesse de son jeu, à la fraîcheur de son expression. Elle possédait des dons de mémoire, de verve, et une grande facilité dans les traits. Mais surtout elle traduisait en parfaite conscience tous les maîtres depuis Bach jusqu'à Saint-Saëns en assignant à chacun son style propre. Clotilde Kleeberg se dépensa en tournées nombreuses. Elle était à la fois populaire et appréciée de l'élite. Nous avons retrouvé sous la plume du critique H. Imbert, ce portrait d'elle qui la restitue dans sa délicate et attachante physionomie « Voyez-la inclinée légèrement sur le clavier avec un laisser-aller charmant. Elle suit la pensée de l'auteur ; elle cause pour ainsi dire avec lui. Et ce sont des nuances exquises passant du forte le plus énergique au piano le plus discret, des sous-entendus délicieux, qui font venir en pleine lumière les compositions des maîtres ». Cette jeune femme si largement douée et fêtée est morte prématurément le 7 février 1905, à 43 ans.
Plus jeune encore Léon Delafosse est né à Paris, le 4 janvier 1874. La 1re médaille de solfège, les 1ers prix de piano et d'harmonie lui ont été décernés en 1885, 1887 et 1891. Il a fait tant en France qu'à l'étranger, une belle carrière de virtuose, variée et remplie.
***
« Lors de ma nomination à la classe de piano, a écrit Marmontel, Zimmermann m'avait prié de lui signaler, parmi mes élèves, ceux qui voudraient étudier sous sa direction le contrepoint, l'enseignement qu'il affectionnait particulièrement. Bizet fut un de ceux que je lui adressai ; et c'est ainsi qu'avant d'entrer dans la classe de l'illustre maître Halévy, Georges Bizet se trouvait déjà familiarisé avec le style du contrepoint, suivant les données si pures de Cherubini, dont Zimmermann avait recueilli la tradition. Il est aussi intéressant de rappeler quels étaient les camarades de Conservatoire de Bizet. Ma classe comptait alors parmi ses élèves Wieniewski, Thurner, Planté, Martin-Lazare, Lestoquois, Jules Cohen, Deschamps, etc... Brillante génération de virtuoses accomplis et de futurs compositeurs à laquelle se relient directement les élèves des années suivantes : Guiraud, Paladilhe, Dubois, Fissot, Duvernoy, Salvayre, et tant d'autres dont je n'attacherai pas sans mélancolie les célébrités toujours vivantes à la gloire sitôt éteinte de Georges Bizet ». Emouvant hommage rendu par la haute conscience artistique de Marmontel au grand compositeur qui fut aussi un maître du clavier. Mais le bon Marmontel prête peut-être une pérennité qui s'est quelque peu effacée, depuis lors, à la gloire d'un Alexandre Lestoquois dit Mugnier (Naples, 1832), 1er prix de piano en 1851, d'un Martin-Lazare (Bruxelles, 27 octobre 1828) 28 prix de piano en 1848, ou d'un Jacques-César Deschamps, 2e prix de piano en 1851. Leur génération une fois décimée, ces bons exécutants n'ont laissé qu'un nom estimé qu'aucun trait éclatant toutefois ne signale particulièrement à la postérité. Ce n'est que quelques années après le passage de cette pléiade de pianistes qu'il cite légitimement « à l'ordre du jour » que nous trouvons, dans la classe même de Marmontel, le maître toujours actuel point de jonction, s'il en est, d'hier et d'aujourd'hui, et avec lequel nous avens l'impression d'entrer de plain-pied dans le présent. Louis Diémer est en effet le plus vivant parmi les pianistes disparus depuis quelque temps déjà. Certes sa mort remonte à peu d'années (1918) et son souvenir n'a pas encore eu le temps de s'évaporer. Mais ce n'est pas tant l'homme lui-même qui survit dans notre mémoire, ni la vision, elle aussi périssable, de sa silhouette menue et souriante. C'est surtout l'exemple du maître qui demeure réel et tangible sous de multiples apparences. Diémer, comme avant lui Marmontel, a réellement fait souche, ce qui constitue le plus sûr garant d'une immortalité relative. Sans doute lorsque ses élèves, illustres ou seulement réputés, se seront les uns après les autres dispersés, éclipsés ou évanouis, le rôle de Louis Diémer — ainsi que celui de Marmontel nous apparaît maintenant — accusera un relief sensiblement moins accusé aux yeux des générations à venir. Mais en ce moment la plupart de ceux qui ont suivi son enseignement sont toujours au cœur de l'action. Ils constituent un lot encore en pleine vigueur. Et c'est, naturellement, un peu de Diémer lui-même qui revit en chacun d'eux. N'a-t-il pas d'ailleurs bien mérité qu'on le retrouve au fond de ces disciples, sur lesquels il a constamment étendu non seulement ses soins patients de professeur mais également sa sollicitude paternelle et souvent secourable ?
Louis Diémer était né à Paris, le 14 février 1843. Il eut en 1855 le 1er prix de solfège, le 2e accessit et le 1er prix de piano en 1855 et 1856, le 1er prix d'harmonie et d'accompagnement en 1855, le 2e prix d'orgue et le 1er prix de contrepoint et fugue en 1861. Quelque vingt années plus tard il succéda à son maître Marmontel comme professeur d'une des classes supérieures de piano. Soliste des Concerts Pasdeloup, Colonne, Lamoureux, de la Société des Concerts et de la Société de musique de chambre pour instruments à vent, Louis Diémer a eu, comme il était normal, un succès mondial. Partout on l'a acclamé ! Il est moins sûr qu'on l'ait toujours compris. Son jeu a souvent été accusé de sécheresse et d'inexpression. Il fallait évaluer, en contrepartie, la sûreté impeccable de cette virtuosité racée, la netteté et l'aisance du trait perlé, et surtout, chez ce styliste de la musique, la connaissance parfaite et respectueuse des traditions classiques. Louis Diémer s'était fait l'interprète passionné des vieux maîtres. Il avait révisé l'édition des pièces de clavecin de Couperin. En 1889, il organisa une série de concerts à l'Exposition afin de faire connaître la littérature du clavecin. Le succès de ces manifestations l'encouragea à persévérer. On ne saurait dire que Diémer ait jamais sacrifié exclusivement au culte du passé. Mondain, affable, cordial malgré des apparences parfois cassantes et revêches, il donnait régulièrement, assisté de sa compagne dévouée, entouré de ses élèves, de Rister, Cortot, Casella, Batalla, Lortat, de Lausnay, des séances musicales dans le salon de la rue Blanche, si familière aux musiciens. Des œuvres de genre très différent y étaient exécutées par des artistes en renom. Sans tomber dans l'esprit d'exclusive, Louis Diémer, s'est pourtant voué de toute son ardeur à la reconstitution de la musique des XVIIIe et XVIIIe siècles et s'est fait le fondateur de la Société des Instruments anciens.

Wanda Landowska au piano de Chopin
Il ne serait peut-être pas très exact de qualifier d'émule de Louis Diémer cette très grande claveciniste et pianiste d'origine polonaise, Wanda Landowska, qui a révélé une technique de virtuose admirable et dont on a pu dire qu'elle avait « deux mains droites ». Il n'en reste pas moins que Mme Wanda Landowska, s'étant assimilé, toute jeune, l'œuvre de J.-S. Bach, s'est prise d'un violent et profond amour pour les clavecinistes du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. Sortie du Conservatoire de Varsovie à peine âgée de 14 ans, elle vint en France, commença des recherches dans les bibliothèques, mit au jour des œuvres oubliées. Lorsqu'elle voulut les exécuter, afin de récréer autour d'elle l'atmosphère adéquate, elle étudia la production artistique et les mœurs de l'époque et travailla les formes de danses auxquelles certaines de ces œuvres se rattachaient. Elle procéda de même pour les écoles du clavecin d'Italie, d'Angleterre et d'Allemagne. On a vanté en maints lieux l'interprétation et le jeu si féminin de Wanda Landowska. Le 1er octobre 1921, elle a fait en Sorbonne une « Communication sur Bach et les clavecinistes français », à l'occasion du « Congrès de l'Histoire de l'Art », et deux jours après elle offrait aux Membres du Congrès, dans la galerie des Glaces du château de Versailles, un concert de musique française qui est resté mémorable. Elle y joua Chambonnières, Couperin, Le Grand, Rameau et Dandrieu. Wanda Landowska est l'auteur d'un livre remarquable intitulé « Musique ancienne ». Elle a joué avec le New York Symphony Orchestra sous la direction de Damrosch et a été décorée de la Légion d'honneur au titre des Affaires Etrangères en reconnaissance des services rendus à la propagation de la musique française. Au festival Bach de Eisenach en 1911, elle avait accepté de se mesurer sur le clavecin avec deux Allemands. On dit qu'elle franchit toujours la frontière avec un bagage de 400 kilos qui contient son instrument. En Espagne, où elle a interprété les Oratorios de Bach dans les églises, on l'appelle Sancta Wanda. Et n'est-ce pas chez nous Camille Saint-Saëns, qui nommait cette si pure et si rare figure de femme inspirée la Muse du Clavecin ?
Dans le même sillage, une artiste comme Mme Régina Patorini, a beaucoup et bien œuvré. M. Paul Brunold, né à Paris, le 14 octobre 1875, qui travailla au Conservatoire de Paris dans les classes de Pugno et de Leroux et reçut l'enseignement particulier de Marmontel et de Paderewski, s'est fait depuis dix ans le traducteur assidu des clavecinistes français.
Il est organiste de l'orgue de Saint-Gervais où il n'exécute, sur le vieil instrument des Couperin, que la musique des organistes français des XVIIe et XVIIIe siècles. Mais il s'est fait d'autre part entendre à Paris dans maints concerts et récitals.
Louis Diémer avait sans aucun doute été l'un des professeurs qui firent le plus honneur au Conservatoire de Musique de Paris. Ceux qui, avec ou après lui, détinrent une parcelle de cet enseignement officiel, et s'en acquittèrent avec des mérites inégaux, peuvent être réunis en un même groupe auquel viennent s'adjoindre naturellement les pianistes qui, sans être professeurs au Conservatoire, ont sans cesse gravité autour de cet enseignement.
Mme Sophie Chené (Paris, 1847) 1er prix de piano en 1867, professeur d'une classe préparatoire de femmes depuis 1870 (à la tête de laquelle sa fille, Mme Germaine Alem-Chené, lui a succédé), fut, au même titre que Mme Massart, ou Mme Rety, une physionomie bien caractéristique du Conservatoire. M. Paul Braud (Paris, 5 août 1860), 1er prix de piano en 1882, élève de Marmontel, a fait plusieurs fois l'intérim de certaines classes. Il occupa le poste de secrétaire [...] Conservatoire, fondée en 1917, brillamment secondé par son camarade Henri Schidenhelm, qui, sorti lui-même de notre grande école nationale, n'a cessé depuis lors de graviter autour d'elle avec un inlassable dévouement.

Isidor Philipp
R.-Isidor Philipp, né à Budapest le 2 septembre 1863, naturalisé français en 1878, a joué et continue de jouer un rôle important dans la formation des jeunes apprentis-pianistes. Elève de Stephen Heller, de Ritter et de Mathias, après son premier prix de piano remporté au Conservatoire de Paris, en 1883, il fit d'abord une carrière de virtuose qui se poursuivit à travers toute l'Europe. L'interprétation qu'il donna du Concerto de Rimski-Korsakov, de la suite de Lacombe, et, à l'orgue, des œuvres de M. Widor, fut tenue pour transcendante à certains jours.
Les ouvrages pour piano d'I. Philipp, ses arrangements des morceaux classiques lui valurent les médailles d'or à l'Exposition de 1900. En 1903, il était nommé professeur au Conservatoire. Son enseignement se distingue de certains autres par la technique approfondie et la grande probité d'exécution qu'acquirent avec lui les élèves.
Jame-Augustin Antonio dit Santigo Riera, né à Barcelone le 11 juin 1867, est lui aussi naturalisé. Il a mêmement passé par le Conservatoire de Paris où il a remporté en 1888 le 1er prix de piano. Elève de Ch. de Bériot, il a notamment donné des concerts en Amérique. Il fut professeur au Conservatoire de Bucarest avant d'être nommé en 1914 à celui de Paris.
Victor Staub, né à Lima (Pérou) le 16 octobre 1872, a conquis tous ses grades au Conservatoire ainsi que dans les salles de concert de Paris où le public apprécie le brio et l'élégance de son jeu. En 1885 il a été lauréat de solfège, puis de piano préparatoire en 1886. Dans les classes supérieures il fut l'élève de Diémer et en 1888 sortit premier prix. Il obtint également un 1er accessit d'harmonie (1890). Victor Staub fut d'abord professeur au Conservatoire de Cologne. Puis on le nomma à Paris en 1907.

Victor Staub (photo Manuel frères)
Mme Marguerite Long est née à Nîmes le 13 novembre 1874. Dans sa ville natale, sa sœur, également pianiste, fut son premier maître. Marguerite Long vint ensuite à Paris où elle eut au Conservatoire Mme Sophie Chéné et Fissot comme professeurs. Marmontel fut son maître également. En 1891 on lui décernait le 1er prix de piano. Mme Long devait devenir une de ces virtuoses, qui, pourvus d'une solide culture classique, s'adaptaient avec une harmonieuse spontanéité aux formes musicales nouvelles épanouies au commencement de ce siècle. Elle fut l'interprète fervente et initiée de Debussy et de Fauré. Quand Mengelberg l'appela à participer aux solennités musicales du Concertgebouw, elle sut, triomphalement accueillie à Amsterdam et à La Haye, révéler à ce public étranger la Ballade de Fauré et la Fantaisie de Debussy. La veuve de Joseph de Marliave, cet écrivain d'un esprit ni fin et d'une si pure musicalité, tout pénétré de la pensée de nos plus grand compositeurs, a été faite en 1921 Chevalier de la Légion d'honneur. Plus encore qu'au professeur renommé à l'enseignement si riche et qui a groupé autour d'elle depuis des années une multitude de disciples, c'est à la musicienne qui a honoré en tous pays et en toutes circonstances l'art français que cette haute distinction est échue. En 1906, Mme Long était nommé professeur d'une classe de piano préparatoire au Conservatoire. En 1920, elle devint titulaire d'une classe supérieure, et de celle-là même qu'avaient illustrée déjà Zimmermann, Marmontel et Louis Diémer. La continuité du grand enseignement pianistique se poursuivait.

Marguerite Long (photo Manuel frères)
Plus « nouveau » encore dans le corps enseignant du Conservatoire, bien qu'ayant à plusieurs reprises assuré l'intérim de Diémer (pendant 8 ans), de Staub (1915-1918) pendant la mobilisation de ce dernier, de Cortot enfin (1920), M. Lazare Lévy, né à Bruxelles de parents français le 18 janvier 1882, a été l'un des plus fidèles élèves de Diémer. A Bruxelles, dès 4 ans, il avait témoigné pour la musique des dispositions les plus surprenantes. Toutefois il ne prit sa première leçon qu'à l'âge de huit ans avec un professeur féminin, Mlle Ellis. A 12 ans il venait à Paris. Il était alors reçu au Conservatoire, le premier de tous les postulants. Il en sortit en 1998 avec le 1er prix. Il avait été également l'élève de Lavignac pour l'harmonie, de Gedalge pour la composition.
M. Lazare Lévy a fait, principalement avant la guerre, le métier de virtuose dans toute sa variété mouvementée. Il a été à Berlin, en Angleterre, en Belgique, en Hollande, en Espagne, au Portugal, en Suisse. II s'est fait applaudir dans toutes les Associations Symphoniques parisiennes et dans les plus grandes villes de France. Ajoutons que durant le temps qu'il dirigeait au Conservatoire, en remplacement de Louis Diémer, la classe de son maître, il eut l'occasion de donner des conseils à des artistes comme Batalla, Marcel Dupré, Lortat, Ancouët. C'est en octobre 1923 qu'il fut nommé titulaire d'une classe supérieure. Il remplaçait Alfred Cortot, démissionnaire.

Lazare Lévy (photo Manuel frères)
Parmi les « favoris » de Louis Diémer, nous avons vu déjà figurer Armand Ferté, né à Paris le 22 octobre 1881, pianiste et chef d'orchestre, fondateur des Concerts Symphoniques de Grenoble. A seize ans, il a remporté son premier prix et en 1900 jouait au Concert Colonne. A la Société Nationale, quand Rhené-Bâton fit ses débuts de compositeur. Armand Ferté exécuta les Variations de ce musicien : soirée mémorable où Marcel Labey, Paul Ladmirault et Jean Huré figuraient au programme pour la première fois. Toute une génération musicale faisait en chœur ses primes armes ! Ensuite Ferté parut chez Lamoureux, chez Pasdeloup, à la Société des Concerts, parcourant l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal, la Suisse, la Hollande. Tout jeune il devint le suppléant de Diémer au Conservatoire. Il y a peu de temps, sous les auspices de Mme Louis Diémer et de quelques admirateurs du maître, il fonda, dans une constante pensée de fidélité artistique à celui qui avait été son guide tant bienveillant, l'Ecole de piano Louis Diémer.
A peu près contemporains et de formations diverses ont milité en même temps mais sous des formes parfois opposées, Maurice Dumesnil, qui s'est fait apprécier dans les Concerts, et, depuis la guerre, principalement à l'étranger ; André-Bloch, né à Wissembourg, le 14 janvier 1873, 1re médaille de solfège en 1884, 1re médaille de piano préparatoire en 1886, 1er prix de piano en 1889, 1er prix d'harmonie en 1890, l'un des rares musiciens qui aient été Grand Prix de Rome à vingt ans (1893), pianiste, chef d'orchestre, professeur distingué, compositeur délicat et habile ; Georges d'Hombre de Lausnay (Paris, 15 mars 1882), 1re médaille de solfège en 1894, de piano préparatoire en 1896, 1er prix de piano en 1899, dont nous avons d'autre part indiqué le rôle comme chef d'orchestre, et que les grands Concerts ont consacré comme soliste (sa femme, Mme Georges de Lausnay est également une pianiste militante) ; Jean Gallon, né à Paris le 25 juin 1878, 1er prix de piano en 1897, d'accompagnement en 1899 ; Auguste Pierret, né à Bagnères (Hautes-Pyrénées) le 20 mai 1874, 1er prix de piano en 1891, professeur, mort tragiquement en 1914 ; Marcel Chadeigne (Paris, 2 janvier 1876) 1er prix de piano en 1895, professeur au Conservatoire et 1er chef des chœurs à l'Opéra ; Lucien Wurmser, né à Paris le 23 mai 1877, 1er prix de piano en 1893, élève de Ch. de Bériot, et qui, en marge d'une activité inlassable de chef d'orchestre, s'est fait entendre en de brillants concerts dans toute l'Europe et en Amérique.
***
L'apparition de Louis Diémer dans la famille des pianistes, le rayonnement si particulier de cette grande figure, puis l'intervention d'une longue théorie de ses disciples, nourris directement de sa doctrine et évoluant dans son sillage, nous ont fait pénétrer très en avant dans nos investigations parmi ces 50 années musicales. Mais en même temps nous nous détournions quelque peu de certaines autres entités du piano, laissant notamment de côté deux des plus admirables représentants de cet art.
C'est d'abord un très noble disparu qui s'impose à notre mémoire : Stéphane-Raoul Pugno, né à Montrouge le 24 juin 1852. Peut-être devait-il à ses origines italiennes cette chaude exubérance, qui, soigneusement dissimulée et contenue quand il convenait, se frayait le chemin certains jours à travers son sang français, vif et impétueux. Pugno avait fait d'abord de brillantes études chez Niedermeyer. Au Conservatoire il entra âgé de 14 ans. En 1866, il remportait une 2me médaille de solfège et, l'année suivante, la 1re médaille. D'emblée, en 1866, il avait obtenu son 1er prix de piano. Il eut encore : le 1er prix d'harmonie et d'accompagnement en 1867, le 1er prix d'orgue en 1869, le 2me prix de contrepoint et fugue en 1869. De 1872 à 1892, il demeura organiste de Saint-Eugénie. En 1874, il avait fait un court passage au Théâtre Italien (Ventadour) comme chef de chœurs. En 1892, il était nommé professeur d'harmonie au Conservatoire, en 1896, professeur de piano. Il garda cette chaire jusqu'en 1901. Pugno débordait d'une prodigieuse fécondité musicale. C'est à coup sûr la gloire d'un pianiste génial qui reste attachée à son nom. Mais il a consacré une grande partie de son existence à la composition, passionnément attaché à son labeur de créateur. Les résultats en fussent-ils parfois décevants qu'il trouvait là des joies d'artiste aussi complètes et peut-être plus profondes encore que dans ses plus beaux triomphes remportés sur l'estrade. Il cultivait agréablement tour à tour l'opéra bouffe, l'oratorio, le ballet, la mélodie, la musique de chambre. Sa grande Sonate pour piano alternait avec le Roman de la Marguerite, petit poème en prose pour piano et chant, la Résurrection de Lazare, oratorio très applaudi en 1879 chez Pasdeloup, avec Ninetta, opéra-comique en 3 actes, représenté à la Renaissance en 1882, et plus apprécié des musiciens que du public ! Les titres même de la plupart des ouvrages de Pugno ne forment-ils pas un contraste savoureux avec le tempérament artistique de ce musicien à la fois tumultueux et recueilli, toujours inspiré, et qui devait se représenter son art, semble-t-il, sous des traits d'une si austère pureté ! La Fée Cocotte (3 actes), les Papillons (1881), Viviane (5 actes, 1886), le Sosie, opéra bouffe (3 actes, 1887), le Valet de cœur, opérette (3 actes, 1888), le Retour d'Ulysse (Bouffes, 1889), la Vocation de Marius (4 actes, 1890), la Petite Fauvette (Renaissance, 1891), la Danseuse de corde, pantomime (3 actes, 1892), Pour le drapeau (3 actes, 1895), le Chevalier aux fleurs, ballet (1887), Mélinne, les Pauvres gens, telles sont les principales étapes de Raoul Pugno, compositeur. Il partageait ainsi son temps entre son travail personnel, l'enseignement et ses obligations de virtuose. Sous ce dernier aspect il s'égalait aux plus grands et pouvait supporter toutes les comparaisons. L'ancien et le nouveau monde étaient conquis à son prestige unique. A Paris les annales du Concert sauraient-elles enregistrer une sensation d'enthousiasme comparable à celle qui éclatait en ces prodigieuses séances de la salle Pleyel où Raoul Pugno communiait avec Ysaye dans la religion de Beethoven, de Franck, et de Fauré ? Un tel encens d'admiration montait autour de lui que les plus proches et les plus sincères parmi les amis du maître en étaient parfois attristés. Car un artiste à l'âme si sincère, à la nature si spontanée, décourageant par avance toute concurrence, incapable de porter un défi à quiconque, n'aurait dû susciter nulle rivalité. Or, des dents grinçaient parfois au seul bruit de toute cette gloire. De très grands artistes même, d'un concept musical diamétralement opposé à celui de Pugno, s'irritaient presque inconsciemment contre ce génie d'une essence si rare et si âpre qu'il devenait agressif à leurs yeux. Nous avons entendu à ce propos autrefois un vieillard, qui fut mêlé de très près à l'histoire de la musique, singulièrement du Conservatoire, conter cette anecdote. « J'ai eu deux fois, disait cet homme, la tentation de battre un musicien. D'abord lorsque Saint-Saëns, à la veille de la guerre, parla en ma présence contre Wagner, ce même Saint-Saëns qui, répondant un jour à une apostrophe du Kaiser : « Vous êtes le Mont-Blanc de la musique ! » lui avait dit : « Et vous, sire, vous êtes l'Himalaya du monde ! » La seconde fois que cette envie me prit, ce fut lorsque Diémer, devant lequel je venais de faire allusion à un concert donné par Pugno, m'interpella avec ce sourire narquois qui retroussait ses lèvres : « Comment dites-vous ? Pugno ? Tiens, il donne donc des concerts, il joue donc du piano, Pugno ? » Je songeais qu'il serait doux de calotter l'insolent. Mais je me retins et me contentai de lui répondre, avant de lui tourner le dos : « Non, Monsieur, Pugno ne joue pas du piano : il fait de la musique, LUI ! »
Nous pouvons, le recul du temps aidant, considérer avec sérénité et juger sans sévérité ces petits antagonismes qui, de leur vivant, vinrent opposez plus ou moins deux artistes, égaux en célébrité, différents par la formation et par l'expression. Quoi d'étonnant à ce qu'un Diémer, dont le talent était toute netteté, toute clarté, tout classicisme, toute précision, se soit parfois montré rebelle au charme enveloppant du jeu d'un Pugno — jeu fait de sonorités onctueuses, de douceur et d'intense puissance, mais dont la grandeur lyrique, dont le romantisme tumultueux s'accompagnaient aussi d'une désinvolture superbe capable de donner parfois l'impression d'un certain laisser-aller et de quelque confusion ?
Disparus tous deux aujourd'hui, Diémer et Pugno ont été surpassés dans le temps, si l'on peut dire, par Francis Planté, interprète de génie, vieillard solide et laborieux, et qui, après une carrière exceptionnellement longue, dévouée toute entière au culte de la musique et des musiciens, réunit à présent aux yeux de ses descendants émerveillés tous les traits du patriarche et de l'apôtre.
François Planté naquit le 9 mars 1835 à Orthez, dans les Basses-Pyrénées, d'une famille originaire de Basse-Navarre. Presque encore au maillot il partait pour Paris et, détail sans poésie mais historique, accomplissait le voyage sur une chaise percée. Son père se fixa boulevard Beaumarchais. Là, le jeune Francis commença ses études à l'âge de 4 ans, sous la direction d'une élève de Franz Liszt, Mme de Saint-Aubert. Le 5 janvier 1845 il était admis à suivre comme auditeur les classes de Marmontel, le père, au Conservatoire. L'année suivante, il était reçu élève, et, en juillet 1850, partageait avec Jules Cohen le 1er prix de piano. Il avait 11 ans, son camarade 15. Son succès était assombri par le demi-échec de son grand ami Lestoquois, qui n'avait obtenu qu'un 2me prix. Le morceau de concours imposé avait été la finale de la Sonate de Thalberg. Planté suivit ensuite le cours d'harmonie de François Bazin. En 1854 il remporta le 1er accessit et en 1855 un 2me prix d'harmonie et d'accompagnement pratique. Carafa avait été, dit-on, émerveillé par l'aisance avec laquelle le jeune concurrent avait supporté la lecture à vue de sa partition Mazaniella. Entre temps, l'heureux lauréat avait eu l'honneur insigne d'être choisi par Alard et Franchomme pour participer à leurs séances de trios de piano, violon et violoncelle.
Francis Planté, devant qui s'ouvrait, dès sa plus tendre jeunesse, un avenir fructueux, riant, rempli de promesses, devait se distinguer par le calme, la sérénité, la maîtrise de soi dont il faisait preuve en face du succès naissant. Très éloigné de l'agitation fébrile de ceux qui, presque encore enfants, impatients de triomphes et de gains, voudraient forcer la victoire avant même de savoir porter les armes et se jetteraient volontiers aux naseaux de la gloire dans l'espoir de la saisir au passage, Planté recherchera de bonne heure l'isolement paisible et fécond. « Je suis né retiré » disait-il. Dans cette parole est un peu du secret de son existence si fière et si pleine d'unité. Sa première retraite eut lieu à Paris même. Madame Erard l'accueillit dans son château de la Muette, dans cet endroit appelé primitivement la Meute où par ordre de Louis XV on élevait les chiens destinés aux chasses du bois de Boulogne. Là, le Roi Frivole abritait également ses amours avec Mlle de Romans et dont l'abbé de Bourbon fut le fruit. C'est dans ce château que s'était tenu, en 1790, le Banquet de la Fédération. La Révolution l'avait ensuite ravagé. Nous avons déjà montré Sébastien Erard installé dans ce château. Il l'avait acquis sous Louis XVIII. Du vivant de Pierre Erard, sous le second Empire, Thalberg et Moschelés, Marie Jaell et Rubinstein, Franz Liszt lui-même s'y faisaient entendre, ainsi que, tout jeunes, Sarasate et Planté. Berlioz, Jules Janin, Gounod, Emile Ollivier étaient dans l'auditoire.
Planté avait inspiré à Liszt une très vive affection. Celui-ci, en souvenir de leurs rencontres à la Muette, qu'il appelait la Mecque des pianistes, lui avait donné son portrait de la sorte signé : « Le vieil enfant gâté ». Ils se retrouvaient aussi chez Emile Ollivier. Planté fréquentait encore le salon de Rossini, rue de la Chaussée d'Antin. Mme Rossini l'aimait tendrement.
Chez elle, Planté dînait avec Félicien David ; puis, dans le nouveau domicile de Rossini, avenue Ingres, près du Ranelagh, il faisait la connaissance de la Patti. Rossini, qui était gourmet, écrivait à son jeune ami ce mot amusant : « C'est Dieu qui vous aura inspiré en m'adressant les Hortolans (!) si désirés. J'étais souffrant mais, à la vue de ces jolies petites bêtes, j'ai été guéri à moitié et la douce mastication a complètement achevée (!) ma guérison. Soyez béni des hommes et de Dieu et de celui qui vous dit : composez. Et croyez-le pour toujours votre affectionné de cœur » (1).
(1) A. Dandelot : Francis Planté. Une belle vie d'Artiste.
Francis Planté se livra peu, ou en tous cas fort discrètement, à la tentation de la composition. Mais, sans emballement, avec une décision réfléchie, mettant tous les intervalles qui convenaient entre ses tournées et ses concerts, il répondit à l'appel de la vocation d'interprète. Le 10 février 1861 il avait joué triomphalement à la Société des Concerts. En 1869, on l'entendit à Monte-Carlo. Puis il partit pour Naples. Thalberg l'y reçut et l'installa dans une villa où il fit spécialement envoyer un piano à queue. On raconte que Planté pour remercier les porteurs de leur dérangement leur joua la Tarentella de Rossini.
A Rome, Liszt le chargea de faire entendre à la princesse de Wittgenstein, sœur du cardinal de Hohenlohe, la Légende de Saint-François de Paule marchant sur les flots. On jugeait alors que le morceau était inexécutable ! A Florence, à Milan où il eut comme partenaires Mme Miolan-Carvalho et Delphin Alard, il donna plusieurs séances. En 1873, il participa au concert donné à Nancy pour la fête de la délivrance du territoire. Alors il entreprit de grandes tournées. En France, le violoniste Sivori fut souvent son compagnon de voyage. On acclama Planté à Petrograd — dans des séances avec orchestre que Rubinstein dirigea lui-même — à Moscou, en Espagne, en Belgique. Ces triomphes semblaient devoir se répéter indéfiniment quand le virtuose fêté et admiré se retira brusquement à Mont-de-Marsan, par un caprice eût-on dit : en réalité par cette volonté lucide et forte que l'on retrouve présidant à tous les actes et à toutes les attitudes de son existence.
M. Marrast, qui avait épousé Louise Planté, tante de Francis, faisait construire à Mont-de-Marsan l'actuelle « Maison Planté ». Sans enfant, il la légua au neveu tendrement aimé qui avait tant de fois cherché refuge et silence dans ses murs. Après son mariage avec Mlle Jumel, dont il eut cinq enfants, Francis Planté alla passer plusieurs années à Pau. Il y resta de 1887 à 1895, puis avec joie retourna dans la maison familiale de Mont-de-Marsan. Enfin il se fixa d'une manière définitive dans ce domaine de Saint-Avit où le respect et l'affection populaire l'entourent et auquel ne l'arrachent que de rares circonstances — toujours les mêmes. Car Planté, dans son apostolat d'artiste, croit discerner à certains moments les signes d'une mission supérieure et humaine à laquelle il ne se dérobe jamais. Dès 1878, il ébauche en quelque sorte une préface à la longue suite d'actes de dévouement charitable qui vont désormais jalonner sa vie. Le 26 octobre, avec le concours de Mlle Engaly, de Faure, et de l'orchestre de la Société des Concerts, il participe au Trocadéro à un grand gala au bénéfice de l'Association des Artistes Musiciens. En 1893, il se fait entendre à la chapelle du Dépôt de Mendicité à Bordeaux. Dans cette ville il joue encore à la Société Philharmonique ou à la Société Sainte-Cécile. Sous le proconsulat de Gabriel Marie il y donne un concert que dirige Vincent d'Indy. Il joue la Fantaisie avec chœurs de Beethoven, les Variations Symphoniques de César Franck, la Symphonie sur un chant montagnard de d'Indy.
En 1896, à l'église de Mont-de-Marsan, avec l'organiste Joseph Daene, il organise une audition de pièces pour piano et orgue de Camille Saint-Saëns. A Cauterets son vieux maître Marmontel a la joie de l'entendre.
Les dimanches 10 et 27 avril 1902, Planté effectua sa rentrée à Paris : apparition de courte durée mais combien mémorable ! A la Société des Concerts il joua le Concerto en ré mineur de Mozart et, avec Hennebains et M. Nadaud, le Concerto en ré majeur pour piano, flûte et violon de J.-S. Bach. Il fallut qu'il ajoutât à ce programme l'Etude pour la main gauche de Chopin et une Danse Hongroise de Brahms. Edouard Colonne, de son côté, organisa avec son concours quatre concerts avec orchestre à la salle Erard. En 1903, après avoir accepté de figurer dans le jury du Prix Diémer, (dont faisaient également partie Saint-Saëns, Massenet, Théodore Dubois, Paladilhe, Paderewski, Pugno, Rosenthal, Chevillard, Philipp, Wormser, de Greef et Lavignac), Francis Planté entra à nouveau dans une période d'isolement.
Il joua pourtant au profit de la Maison de Retraite de Pont-aux-Dames, sur la prière de Constant Coquelin. Puis les mardi 18 et jeudi 20 juin 1907, au bénéfice de la Société mutuelle des professeurs du Conservatoire fondée par Alph. Duvernoy, il donna deux Festivals au cours desquels il joua à deux ou trois pianos avec Louis Diémer, Raoul Pugno, Edouard Risler et Alfred Cortot. Mme Rose Caron faisait un intermède vocal. Paul Taffanel dirigeait l'orchestre des élèves du Conservatoire. Dans ce programme, les Variations de Schumann furent interprétées dans la version primitive, avec deux violoncelles et un cor. En mars 1913, le secrétaire général de la Société des Concerts, le clarinettiste Mimart, avait en vain sollicité Planté de jouer un Concerto de Beethoven. L'Ermite semblait désormais violemment attaché à sa retraite.
Mais la guerre allait le contraindre à s'en évader Francis Planté trouvait, dans la tragique actualité des événements, matière à se dévouer de toutes manières. L'œuvre du « Noël du soldat Landais », puis celle du « Convoi Landais » (automobiles de radiographie et de stérilisation qui furent utilisées par la 5e armée, 18e corps) requirent successivement son activité. Puis Francis Planté commença cette inoubliable série de Concerts au profit des soldats et des blessés.
« Fuyant les salles brillantes, la grande lumière, l'estrade bien en vue, écrit M. A. Dandelot, Francis Planté, afin d'enlever tout caractère de fête ou de réclame personnelle, veut jouer derrière un rideau de verdure, caché aux regards, impersonnel, dans l'asile de la prière, choisissant de préférence les chapelles les plus modestes, parfois situées en des faubourgs écartés ». Sainte-Madeleine de Mont-de-Marsan, Saint-Vincent-de-Saintes à Dax, la chapelle des Dominicaines de Biarritz, Notre-Dame-de-Pau, la chapelle Saint-Louis-de-Gonzague de Bayonne, les chapelles de Bordeaux, d'Orthez, de Saint-Sever, d'Arcachon, d'Ayre-sur-Adour, de Nérac, de Toulouse, de Saint-Jean-de-Luz, de Morieux sont les lieux choisis pour ces séances où l'artiste officie en musique, mélodieuse expression d'un pieux élan collectif vers toute la misère du monde qu'il s'agit de soulager. Puis le jeudi 29 juin et le mardi 4 juillet 1916, ce sont les deux grandioses concerts spirituels donnés en la Crypte de l'Annexe de Saint-Honoré d'Eylau, et dont le retentissement moral et le résultat moral dépassèrent toute attente.
Laissons encore la parole au fidèle historiographe de Planté :
« Folie, disait-on ! Comment songer à remplir un tel vaisseau pour un simple récital de piano ? Comment aussi espérer qu'un public se placera avec ordre dans un tel espace où l'on ne dispose pas moins de cinq mille places ?
Sans se soucier de tout cela, Planté fait transporter un Erard à la crypte, y surveille la confection de son entourage de verdure, tandis qu'on procède à une organisation très méthodique des diverses places en ménageant de nombreuses entrées et des passages suffisants. Pendant ce temps la location est ouverte. En moins d'une semaine toutes les places sont retenues pour les deux séances projetées, et nombre de retardataires ne peuvent trouver le moindre coin ».
Au programme du premier de ces concerts, Planté avait inscrit Beethoven, Chopin, Liszt et auprès d'eux Saint-Saëns, d'Indy, Widor, Théodore Dubois, d'Indy, Chabrier, Gabriel Fauré et Albéric Magnard. Le second programme comprenait également des œuvres de A. Rubinstein, C. Franck, Albéniz, Granados et Claude Debussy.
Planté organisa encore les 11 et 12 juillet deux séances de musique de chambre chez le Prince Jacques de Broglie au bénéfice de l'Association Nationale Française pour la protection des Familles des Morts pour la Patrie. La jeune violoniste Noëla Cousin, André Hekking exécutèrent avec lui le Trio op. 8 de Chopin, la Sonate de Rachmaninov pour piano et violoncelle et celle de Saint-Saëns pour piano et violon, enfin le Concert en ré majeur op. 21 d'Ernest Chausson avec un quatuor où figuraient André Hekking, G. Tinlot, Le Béranger et H. Benoît. C'est M. Pierre Lalo qui faisait remarquer, précisément à l'issue de ces concerts, que, tandis que Liszt, devenu vieux, privé de sa force première, ne semblait plus jouer qu'en demi-teintes, tandis que Saint-Saëns, toujours impeccable, accentuait la sécheresse de son jeu, Francis Planté, au contraire, non seulement conservait ses qualités de style et d'interprétation, mais semblait acquérir avec les ans, plus de puissance, d'éclat et de valeur. A chacune de ses nouvelles apparitions, bien loin d'avoir à déplorer une déchéance, on a pu avoir l'impression que ses dons prodigieux s'étaient comme développés, fortifiés. C'est que jamais la retraite dans laquelle Francis Planté s'enfermait n'a été consacrée au repos. Jamais le solitaire de Saint-Avit ne s'est drapé dans sa gloire pour s'en faire un linceul. Nul n'a été plus que lui éloigné de tout orgueil. Chaque jour de sa vie a été un exemple de labeur acharné, de modestie, presque d'humilité. Levé dès l'aube, il s'asseyait devant son Erard et jusqu'au soir, tard souvent dans la nuit, ne se laissant distraire par quelque soin domestique ou familial que pour revenir aussitôt prendre sa place. Il égrenait les heures dans son studieux effort, s'astreignant aux exercices d'élèves, travaillant ses doigts inlassablement et, surtout, s'attachant avec une patience presque anxieuse, un doute de soi-même touchant, à surprendre la vraie intention du musicien jusque dans les moindres nuances de son œuvre : jamais satisfait d'une interprétation qui lui semblait toujours au dessous de ce qu'eût voulu le compositeur.
A 80 ans comme à 40, Planté est rarement rentré d'un concert sans reprendre d'un bout à l'autre le programme qu'il avait exécuté pour étudier et corriger les défauts qu'il avait remarqués dans son interprétation et ramener un peu celle-ci vers les régions de la perfection qu'il entrevoyait toujours en un rêve et vers lesquelles il avait toujours les yeux fixés, sans penser pouvoir jamais les atteindre.
Francis Planté, en raison de son grand âge et de sa longue expérience, aurait pû, comme d'autres, rester attaché aux formes d'art du passé. Or personne ne s'est montré plus passionnément curieux de l'évolution musicale. Nul n'a porté un intérêt plus agissant à l'éclosion de l'école moderne de la musique et du piano. Nul n'a davantage aimé les grands promoteurs de ce mouvement. Gabriel Fauré, Vincent d'Indy, Claude Debussy furent ses amis. Il accueillit Pierre de Bréville, Roger Ducasse, Gustave Samazeuil. Lors des séances de Saint-Honoré d'Eylau, Debussy, cruellement malade, vainquit souffrances et fatigue pour être présent dans la crypte et Planté, au dernier séjour qu'il fit à Paris du vivant de l'auteur de Pelléas, consacra au grand malade d'affectueuses visites.
La qualité de patriarche offre cet amer privilège de voir naître, vivre et mourir ceux que l'on admirait et ceux que l'on aimait. Mais Francis Planté par cette longue vie, qui est comme le noble témoin de plus de trois quarts de siècle de la musique française. évoque l'image de ces sommets qui prennent leurs racines dans les entrailles obscures et lointaines de la terre et dont la cime neigeuse plonge au cœur azuré des insondables espaces. Clara Sansoni, élève d'Albéniz, a reçu ses conseils ; Diémer, Busoni, Cortot, Viñes, Marguerite Long, Paul Loyonnet ont été appréciés et encouragés par lui. Et, à l'égal d'Alard, de Sivori ou de Franchomme autrefois, il a admiré Jacques Thibaud ou Pablo Casals, avec lesquels il eut d'ailleurs l'occasion de jouer. Pas une page de l'histoire de la musique française depuis 1850 ne saurait être écrite, dirait-on, sans que le nom de Francis Planté revienne sous la plume. Son génie vivace est un lien, une transition, un exemple et une leçon.
Edouard Risler a sans doute été l'objet d'un amour particulier de la part de Francis Planté. Il était né à Baden le 23 février 1873, de parents alsaciens. Au Conservatoire, où il entra en 1886, il remporta en 1887 la 1re médaille de solfège et de piano préparatoire. En 1889, il était 1er prix de piano. Il eut aussi un second prix d'harmonie en 1892, un 1er prix d'accompagnement en 1897. Lavignac et Decombes avaient été ses professeurs de solfège et de piano préparatoire. Puis il entra dans la classe de Diémer dont il devint l'un des plus merveilleux disciples. Les maîtres français du XVIIIe siècle, Bach, Mozart, puis Schumann, Chopin, Liszt devinrent rapidement ses dieux. Il eut également une admiration wagnérienne. En 1893 et en 1894, il donna chez Pleyel le 1er acte de Siegfried avec des partenaires tels qu'Engel, Pagès, Jean Giret, Alfred Cortot. En 1896, il était répétiteur au temple de Bayreuth. Il effectua des tournées éclatantes dans toute l'Europe et particulièrement en Russie en 1899.
Mais c'est principalement dans l'interprétation de Beethoven que Risler s'est élevé jusqu'aux sphères les plus sereines de l'interprétation. « Risler c'est Beethoven, et Beethoven c'est Risler » a-t-on dit par une boutade. Pour la première fois en 1905, il donna l'audition intégrale des 32 Sonates. Il a lui-même expliqué comment il comprenait et il aimait l'œuvre beethovénienne :
« Si je cherche ce qui différencie l'exécution de la musique de Beethoven de celle de toute autre musique, affirme Risler, il me semble trouver ceci : elle exige à son degré supérieur le respect, l'amour quasi religieux de l'art. Beethoven m'apparaît comme le Christ de la musique.
Sa musique a une révélation divine; tout en elle est pur, dégagé des sens, tendu vers l'infini. L'exécutant appelé à jouer ses œuvres doit donc jeter bas les vaines prétentions du virtuose ; il devient un prêtre et sa seule ambition doit être celle d'émouvoir les cœurs, d'élever les âmes. A ces considérations supérieures, s'ajoute un conseil pratique : le travail.
C'est pour cette musique surtout qu'on peut dire : le génie est une longue patience. Rien n'est plus difficile que la 3me manière de Beethoven et une vie ne suffit pas pour en pénétrer toutes les subtilités. Joachim jusqu'à sa mort travaillait avec son quatuor avant chaque concert. Capet prévoit 300 répétitions avant la série qu'il doit donner bientôt, et j'ai entendu Nikisch répéter pendant des heures l'Héroïque avec un orchestre qui le jouait pourtant depuis vingt ans. »
Noble conception de l'art et du labeur qu'il commande. On voit qu'avec Francis Planté, Edouard Risler nourrissait le culte de l'effort.
Lorsqu'en 1923 il fit son apparition à l'Æolian Hall, Saint-Saëns, qui l'avait entendu, établit une comparaison entre Risler, Busoni et Friedhein : « S'il fallait donner un prix, je le donnerais, disait-il, à M. Risler pour la façon magistrale dont il interprète la grande Sonate en si mineur ».
Edouard Risler n'a pas borné son royaume aux œuvres de Bach, Mozart ou Beethoven. Il a excellé dans le romantique : Weber, Schubert, Schumann, Chopin. Enfin, en une certaine époque, Chabrier, d'Indy, Debussy, Ravel, Mariotte lui furent redevables de belles et probantes exécutions. Le premier il a joué à Paris la Sonate en mi bémol de Paul Dukas.
Ajoutons qu'en 1900 il fut nommé professeur au Conservatoire. Il y resta peu de temps. Cet artiste au grand cœur et à la conscience haute, digne de toute l'affection d'un Planté, a été fait Chevalier de la Légion d'Honneur seulement en 1923, c'est-à-dire à cinquante ans. Mobilisé pendant presque toute la durée de la guerre, Risler a senti peser lourdement sur ses épaules le poids de ces années-là. Très éprouvé par ailleurs à son propre foyer, il vit depuis lors, avec cette admirable simplicité qui fut toujours sienne, dans une sorte de demi-obscurité, sans même paraître conserver le souvenir de ses pourtant inoubliables triomphes.

Alfred Cortot (photo Manuel frères)
La carrière de M. Alfred Cortot offre plusieurs points d'analogie avec celle d'Edouard Risler. Né le 26 septembre 1877, à Nyon (Suisse) de parents français, il vint tout enfant à Paris avec sa famille et reçut de ses sœurs ses premières leçons de piano. Au Conservatoire il fut, lui aussi, l'élève de Decombes, l'un des derniers disciples de Chopin, puis de Louis Diémer dans la classe duquel il remporta un 1er prix de piano en 1896. Chez Colonne et Lamoureux on applaudit son interprétation des Concertos de Beethoven. Puis les tournées européennes le réclamèrent. Il affirma avec éclat devant l'étranger la vitalité de la nouvelle école française de piano. On l'entendit au Gewandhaus de Leipzig, à la Philharmonie de Berlin, au Royal Philharmonic et au Queen's Hall Orchestra de Londres, à Saint-Pétersbourg, à la Société Impériale de Moscou, à la Philarmonique de Madrid, aux Concerts Ysaye de Bruxelles, aux concerts Hallé de Manchester, aux Classical Concerts de Liverpool, au Museum de Francfort, à la Société del Quartetto de Milan, à La Haye, à Genève, au Concertgebouw d'Amsterdam.
Entre temps, comme Risler, il était répétiteur à Bayreuth. Alfred Cortot avait une nature beaucoup trop active et complète pour se satisfaire des succès, même très considérables, qu'il remportait comme virtuose. A 24 ans, il faisait ses débuts de chef d'orchestre, directeur de théâtre et metteur en scène en donnant la 1re représentation à Paris du Crépuscule des Dieux et des représentations de Tristan et Yseult.
En 1903, il fondait la Société du Festival Lyrique, puis l'association des grandes auditions chorales. Au Nouveau-Théâtre il donna pour la première fois à Paris les premières auditions de Parsifal, de Sainte-Elisabeth de Liszt. Il exécuta la Messe Solennelle de Beethoven, le Requiem de Brahms, des œuvres nouvelles d'Albéric Magnard, de Roussel et de Ladmirault. En 1904, il était nommé chef d'orchestre de la Société Nationale. Pendant 4 ans, il dirigea également l'orchestre des Concerts Populaires de Lille. En 1905, il fonda avec Jacques Thibaud et Pablo Casals, ce trio dont les séances eurent un retentissement mondial.
En 1917, M. Alfred Cortot était chef du Cabinet du Sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts. C'est lui qui encouragea M. Dalimier à instituer l'Association des Anciens Elèves du Conservatoire et c'est lui qui se fit le premier animateur de cette Société une fois créée.
Alfred Cortot a maintenant repris son bâton de pèlerin. Il continue ses tournées à l'étranger, et, dans l'intervalle, se fait entendre parfois à Paris. Pas plus que Risler il n'était susceptible de se laisser river trop longtemps au même endroit par un poste officiel. C'est pourquoi il abandonna en 1923 la classe de piano qui lui avait été confiée en 1907 au Conservatoire et dans laquelle il succédait à Marmontel et à Raoul Pugno. Pendant ces seize années de professorat, fréquemment absent, il avait été supplié à maintes reprises, et notamment par M. Lazare Lévy, qui lui succéda en titre, ainsi que nous l'avons vu.

Madame Roger Miclos (photo Manuel frères)
Mme Marie-Aimée Roger-Miclos a occupé une place marquante dans les programmes des concerts parisiens et provinciaux. Née le 1er mai 1860 à Toulouse, elle a fait ses premières études dans sa ville d'origine. Elle est venue ensuite au Conservatoire de Paris, en 1874. En 1877, elle y a remporté un 1er prix de piano et, l'année suivante, un 2me accessit d'harmonie et d'accompagnement. Soliste appréciée des Concerts Colonne et Lamoureux, elle avait débuté par l'exécution d'un Concerto de Godard. Après la mort de son premier mari elle se consacra au professorat. Elle épousa en 1905 M. Henri-Charles Battaille.
Marie-Blanche Selva qui a joué un rôle important de par la situation qu'elle occupa à la Schola, est née à Brives (Corrèze) le 29 janvier 1884. Elle fit ses premières études au Conservatoire. En 1895, elle obtenait la ire médaille de piano préparatoire. Par la suite elle passa dans le camp adverse puisqu'elle devint l'un des piliers du dogme scholiste sous l'autorité de M. Vincent d'Indy. Mme Blanche Selva, qui enseigne le piano dans l'école de la rue Saint-Jacques, a paru dans tous les grands Concerts et rallié autour de son talent, expressif et souvent puissant, de nombreux admirateurs tant en province qu'à Paris.

Marie-Blanche Selva (photo Manuel frères)
Nombreuses sont les pianistes-femmes dont le nom a fréquemment figuré sur l'affiche de nos principales salles : Mmes Marguerite Hasselmans, fille de pianiste, Monteux-Barrière (23 mars 1875) 1er prix de piano en 1887, Laloy-Babaïan.
Céline Cailley-Richez, née à Lille le 15 mai 1884, a d'abord obtenu le 1er prix de piano au Conservatoire de Lille en 1895, puis le 1er prix au Conservatoire de Paris en 1898. Elle a débuté en 1899, jouant en public avec son professeur Pugno. En Angleterre ultérieurement, elle a également joué à deux pianos avec Saint-Saëns. Soit seule, soit avec le quatuor Chailley (dirigé par son mari) elle a fait en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Hollande, en Amérique du Sud, des tournées de propagande française.
Pianiste d'une pénétrante finesse et d'une profonde compréhension musicale, Mlle Emma Boynet a été l'élève d'Isidor Philipp au Conservatoire où elle a obtenu le 1er prix ainsi qu'un 1er prix d'harmonie (classe Dallier). A Bordeaux, Limoges, Vire, Toulouse, Rouen, Lorient, Genève, Bruxelles, elle a donné des concerts, jouant avec Gaston Poulet, Henry Wagemans, Asselin. Aux Concerts Pasdeloup son interprétation de la Ballade de Fauré fut unanimement goûtée. On l'applaudit à Vichy dans le Concerto de Rimski-Korsakov, avec l'orchestre Sechiari.
Berthe Bert (19 mars 1894) après avoir commencé ses études à 5 ans à Bordeaux, sa ville natale, et les avoir continuées au Conservatoire de Paris dans la classe Marmontel (1er prix à 13 ans) travailla avec Pugno et Cortot, et, en Allemagne, avec Fritz Steinbach. Pendant la guerre, elle donnait à Londres, 12 Récitals. Installée à New York en 1921-1922, elle fut professeur dans une école française. En 1922-1923 l'école de musique David Mannes à New York l'engagea comme professeur des classes supérieures. Elle devint répétitrice de la classe Cortot.
Mme Geneviève Dehelly est sortie du Conservatoire de Bruxelles (1er prix de solfège à 5 ans, de piano et d'harmonie à 13 ans dans les classes d'Adolphe Wonters et de Joseph Dupont) et du Conservatoire de Paris (classe Delaborde) où, en 1903, elle obtint le 1er prix, 1re nommée. Ses premiers Récitals à la salle Erard datent de 1905. Elle a parcouru depuis l'Angleterre, l'Espagne, la Belgique, la Russie, l'Autriche et l'Allemagne.
Madeleine Fourgeaud-Grovlez, née à Poitiers le 2 juillet 1889, est un peu l'enfant gâtée du monde musical parisien. Douée d'un solide et délicat talent d'interprète, femme du chef d'orchestre et compositeur qui a lui-même remporté le 1er prix de piano en 1899, cette charmante fille aux yeux rieurs, au jeu sensible et séduisant a reçu l'accueil le plus chaleureux sur toutes les estrades où elle a paru. Elle s'est fréquemment rendue à l'étranger où le même succès lui a été réservé.
Mlle Jane Blancard (Paris, 4 octobre 1884) a obtenu elle aussi en 1899, le 1er prix au Conservatoire. En mars 1901, elle donna chez Colonne une exécution très remarquée du Concertstück de Weber. Elle eut l'occasion de se faire entendre sur le piano double avec Mme Madeleine Boucherit (Morlaix, 1879), sœur du violoniste, qui est elle-même une interprète de valeur. Mme Boucherit s'est consacrée en partie depuis plusieurs années au professorat et au piano d'accompagnement.
Il pourrait sembler paradoxal d'introduire, à côté d'artistes qui, presque tous, ont fait une carrière de virtuoses, les noms de musiciens qui se sont spécialisés dans une forme d'activité plus effacée. Mais, par ailleurs, leur rôle, modeste en apparence, est trop important et trop utile à la musique pour que d'excellents pianistes-accompagnateurs tels que Eugène Wagner, Estyle, Maurice Faure ne soient pas ici au moins mentionnés.
M. Edouard Garès (Toulouse, 1883) a travaillé avec Diémer. Un 1er prix (1er nommé à l'unanimité) a couronné ses études au Conservatoire en 1902. Il a été par la suite lauréat du Concours Diémer, professeur suppléant au Conservatoire. Soliste de la Société des Concerts, des Associations Colonne et Lamoureux, il a fait une importante carrière étrangère et provinciale.
M. Gontran Arcouet, né en 1885, est un des pianistes en lesquels on apprécie un talent personnel, vigoureux, une compréhension souple des maîtres qu'il interprète. Sa formation musicale, très solide, s'est accomplie d'après un rythme curieux. Au Conservatoire d'abord il obtint, en 1899, une médaille de piano préparatoire dans la classe de Decombes puis, dans la classe de Diémer où il était entré en 1900, un 1er prix en 1902, à 16 ans et demi. Pendant son stage cité Bergère il avait été en outre l'élève de Kaiser pour le solfège, de Xavier Leroux pour l'harmonie, de Ch. Lefebvre pour la musique d'ensemble, de Bourgault-Ducoudray pour l'Histoire de la Musique. Il reçut des conseils de Paderewski, travailla avec Planté, avec Sgambati à Rome, Leschetitsky et Fishof à Vienne.
Plus suivie a été l'éducation de M. Georges Boskoff (Jassy, Roumanie, 2 septembre 1884) qui prit les leçons de Jules Wiest au Conservatoire de Bucarest et à Paris de Diémer, dans la classe duquel il remporta un 2me prix en 1904. Parmi les concerts les plus marquants de M. Boskoff, il sied de citer notamment les Récitals Historiques de Bach à Debussy. En même temps que lui concourait, en 1904, M. Maurice Amour qui fut récompensé d'un 1er prix, se fit entendre par la suite en Italie, en Angleterre, en Belgique, et devint professeur aux Maisons d'Éducation de la Légion d'Honneur.
M. Edmond Trillat, 1er prix du Conservatoire en 1907, fondateur d'un trio connu, a professé dans une classe supérieure du Conservatoire de Lyon. Dans cette ville il a joué à deux pianos avec Risler. Il s'est fait entendre à l'étranger. Parmi les virtuoses qui ont, au point de vue de l'art français, la plus heureuse influence hors de nos frontières, il convient de mettre au premier rang M. Motte-Lacroix, qui a vaillamment défendu, en Amérique principalement, la cause de la musique française moderne. Il a été professeur au Conservatoire de Strasbourg et chargé des classes supérieures de piano au Conservatoire de Boston, dans ce « New England Conservatory » qui compte 3.500 élèves. A signaler également le grand succès remporté par M. Motte-Lacroix à Copenhague, en compagnie de M. Albert Roussel et de Mme Yvonne Astruc. Autre vaillant pionnier de la même cause et d'autant plus précieux que son beau talent s'impose partout, le pianiste Paul Loyonnet, l'un des membres du Trio Capet, a joué notamment à La Haye, Bruxelles, Rotterdam, en Suisse et en Italie. Un élève de l'école Niedermeyer, qui obtint dans cet établissement le 1er prix de piano dans la classe de Bériot et le 1er prix d'accompagnement dans celle de Viardot, M. Jean Courbin est devenu lui-même professeur de la classe supérieure de piano de l'Ecole. En 1920, il a été nommé directeur du Conservatoire de Montpellier. Il a été en tournée à Londres, Vienne, Bucarest, Belgrade, etc... M. André Andoli, professeur au Conservatoire de Marseille, sa ville natale, est issu du Conservatoire de Paris. M. Paul Peracchio est passé du Conservatoire de Saint-Etienne à celui de Bruxelles (classe de Greef), tout en travaillant à Paris avec Mme Weingartner et Diémer. Il a donné des concerts avec le quatuor Zimmer et « tourné » en France avec Pugno, en Belgique avec Mark-Hambourg.

Paul Loyonnet (photo Manuel frères)
Tous les pianistes qui composent les nouvelles générations musicales n'ont pas été requis par des postes provinciaux ou des voyages de propagande continuels à l'étranger. Ils forment une pléiade de jeunes, ardente, militante dans laquelle l'œuvre de Debussy et de Fauré trouve des interprètes d'une musicalité adéquate. Leurs noms reviennent le plus souvent au programme des Concerts parisiens. Avec un Yves Nat dont le merveilleux et puissant talent, la pénétrante virtuosité constituent l'une des plus admirables illustrations de l'interprétation classique française du piano, Robert Lortat occupe presque le rang et l'importance de chef de file. Né à Paris, le 12 septembre 1885, 1re médaille de solfège en 1899, 1er prix de piano en 1901 et prix Diémer en 1905, il s'est imposé par ses rares qualités d'interprétation et de technique. Il a joué à Berlin, à Leipzig, à Dresde, à Breslau, à Cologne et effectué d'heureuses tournée, notamment dans les pays scandinaves.
A Londres, il y a quelques années, il a donné l'œuvre intégrale de Chopin. Le premier, au printemps 1914, il a révélé au public, en quatre séances de l'Université des Annales, le monument pianistique constitué par les ouvrages de Gabriel Fauré.
Plus tard il fut naturellement l'un des principaux participants à la manifestation organisée en Sorbonne en l'honneur du maître. Dans une triomphale tournée en Amérique, Robert Lortat a fait acclamer les principaux compositeurs français. Au Conservatoire il fut pendant quelque temps professeur intérimaire de la classe Cortot.

Yves Nat (photo Manuel frères)
M. Adolphe Berchard (Le Havre, 30 juin 1882) a été lauréat de la classe Diémer (1er prix) en 1903 et de la classe Lenepveu (2me prix de contrepoint et fugue) en 1907. Ses débuts remontent à 1908. Cette année-là, il fut en Allemagne. A Londres il se fit connaître en 1905 sous le patronage de la reine Alexandra. En mars 1910 il était engagé par le Concert-Direction de M. Hanson à New York, pour une tournée de récitals et de concerts avec orchestre aux Etats-Unis et au Canada. Le 4 novembre 1910 il débuta à Chicago avec l'orchestre Thomas. A son retour des Etats-Unis il fut engagé pour une série de concerts en Russie. Le 21 décembre 1911 au Conservatoire de Paris, à la séance annuelle des envois de Rome, il interpréta la Fantaisie pour piano et orchestre de Louis Diémer. Engagé par le directeur de l'orchestre de la Cour de Russie pour un cycle de concerts faisant l'historique du concerto pour piano et orchestre, il exécuta à la salle de la Noblesse de Petrograd, les 4, 7, 10, 12, 14 mars 1913, les concertos de Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms, Chopin, Liszt, C. Franck, Saint-Saëns, d'Indy, Tchaïkovski et Rachmaninov.
Le marseillais Jean Batalla, né en 1888, a commencé ses études à 6 ans. Son premier concert à Marseille, à l'âge de 9 ans, est une révélation. Au Conservatoire de sa ville natale il obtient le 1er prix de solfège en 1893 et le 1er prix de piano en 1901. L'année suivante, à 13 ans, il est admis au Conservatoire de Paris, le premier de tous les candidats. Il entre dans la classe de Diémer, et, à son premier concours, il décroche la récompense suprême, premier nommé. En 1906, le grand prix triennal Diémer lui fut décerné à l'unanimité. Les Concerts Colonne, la Société des Concerts, les Soirées d'Art, les Concerts Hasselmans et Sechiari et aussi ceux dits de « l'Art Mineur » l'accueillirent successivement. Jean Batalla joue à Scheveningue, à Strasbourg, à Barcelone, à Manchester. Il n'a plus cessé d'être l'un des virtuoses aimés du public averti.
M. Marcel Ciampi, né à Paris le 29 mai 1891, obtint en 1905 la 1re médaille de piano préparatoire et de solfège (classes Falkenberg et Rougnon) en 1905 le 1er prix de piano (classe Diémer). Une tournée avec Jacques Thibaud en 1906 le mit en lumière. Malade, il reparut en public en 1913. Sa carrière fut de nouveau interrompue par sa mobilisation. Hospitalisé au Val de Grâce, il fut réformé. Il effectua sa rentrée en interprétant les Variations Symphoniques de C. Franck. Puis il commença de donner des concerts avec Mme Yvonne Astruc, devenue sa femme. M. Marcel Ciampi est le fils de M. et Mme Ezio Ciampi et il semble que son aïeul Théodore Ritter lui ait laissé en héritage quelques-unes de ses belles qualités de vibrant interprète.
M. Jean Duhem fait apprécier presque tous les ans la variété de ses dons et de sa nature dans des programmes qui sont soit un commentaire de Beethoven, de Schumann, de Chopin et de Liszt, soit un hommage à un compositeur moderne, comme son Récital Ravel de 1923. M. Victor Gilles, élevé dans un milieu essentiellement artistique, pieusement entretenu par son entourage dans le culte de la musique pure, s'est en quelque sorte voué à l'interprétation de Chopin dont il traduit l'œuvre avec amour et religion, en des attitudes extasiées, et en un sentiment d'ailleurs le plus souvent apprécié. M. Victor Gilles, se rendant comme en pèlerinage au pays même de Chopin, a donné une série de Concerts en Pologne.

Victor Gilles (photo Manuel frères)
M. Robert Schmitz, né en 1889, de père français et de mère italienne, a pensé d'abord se consacrer au violon. Il commença ses études musicales à 12 ans. Puis au Conservatoire il entra dans la classe Diémer d'où il sortit avec un 1er prix.
En 1912, il a fondé la Société d'orchestre et chœurs pour faire connaître la production contemporaine. La Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, la Hollande, la Suisse ont été les lieux
de ses principales tournées. Après trois ans et demi de front passés dans les autos-canon et 8 mois d'hôpital, Robert Schmitz a été envoyé aux Etats-Unis en mission de propagande française. Virtuose d'une expression très puissante, technicien consommé, il s'est livré à des recherches approfondies dans le but de déterminer la valeur qualitative et l'intensité possible des sons sur le clavier. Robert Schmitz est un des pianistes qui, semblables en cela aux virtuoses des origines, possèdent le mieux la connaissance de la structure même et de l'âme de son instrument.

Robert Schmitz
M. Gil-Marchex, né le 16 décembre 1893 à Saint-Georges de l'Espérance dans l'Isère, a obtenu dans la classe de Diémer un 1er prix décerné à l'unanimité en 1911. Il a fait partie des classes de musique d'ensemble, de composition, de contrepoint et fugue de Lucien Capet, Xavier Leroux et Paul Vidal. Il a travaillé également avec Cortot. Sorti du Conservatoire, il a connu le « bel engagement » de 2 ans en Amérique (Etats-Unis et Canada). Après sa mobilisation il a parcouru la Suisse, la Belgique, l'Autriche, l'Angleterre. Soliste des Concerts Lamoureux et Pasdeloup, de la « Société », du Queens Hall de Londres, il a donné plus de 80 concerts à Paris. On l'a entendu aux côtés de Lucien Capet et de Koubitzky. En 1923, c'est lui que l'on choisit pour interpréter les œuvres françaises au Festival international de Salzbourg. C'est également lui qui est désigné pour interpréter au Festival Ravel de Londres, en mai 1924, les œuvres de piano du maître. Issu également de la firme Diémer, M. Léon Kartun (Paris, 1895) a été admis en 1911 au Conservatoire et, cette même année, a remporté un 1er prix incontesté. Soliste des quatre grandes Associations, il a donné vingt-cinq Récitals à Paris, joué en province et à l'étranger. Il s'est fait entendre fréquemment avec Georges Enesco et M. Gérard Hekking.
M. Henri Etlin qui joint à sa jeune maîtrise de pianiste un joli talent d'artiste peintre et de dessinateur est entré au Conservatoire à 17 ans. Il y a obtenu le 1er prix en 1907. Il a travaillé avec Diémer, Saint-Saëns et Planté. En 1909, il débutait en Amérique et obtenait en 1912, les prix Diémer et Musica. En Belgique, en Suisse, en Angleterre, en Russie et en Amérique, il accomplit successivement des tournées ainsi que dans les principales villes de France : Lyon, Rouen, Bordeaux, Nancy, Orléans, Mulhouse et Montpellier. L'interprétation de M. Henri Etlin, toujours propre et minutieuse, se recommande par une grande distinction et beaucoup d'élégante application.

Henri Etlin (photo Manuel frères)
M. Jean Wiéner, né le 19 mars 1896, se consacra de bonne heure au piano et travailla surtout avec André Gedalge. Dès après la guerre, il dévoua sa juvénile ardeur au service des Six, de Stravinsky et de Satie. Il se fit entendre fréquemment à l'étranger. Il appartient à ce qu'on a convenu d'appeler les groupes d'avant-garde. C'est un militant dans toute la force du terme.
Autre jeune chevalier servant de la musique avancée, mais plus attaché à la forme debussyste. M. Marius Gaillard, né à Paris. le 13 octobre 1900, est sorti du Conservatoire de Paris, avec le 1er prix d'excellence de piano (Classe Diémer) en 1916. A 17 ans, il faisait entendre à la salle Gaveau les Goyescas, de Granados, que seul l'auteur avait interprétées avant lui. En mars 1919, il fut l'un des premiers à jouer Gaspard de la nuit, de Ravel. Au cours de ses récitals en province et à l'étranger, Bach, Mozart. Schumann, Chopin, Balakirev, Ravel, mais surtout Debussy, auquel il consacra une conférence après l'armistice, lui fournirent la matière de ses programmes. En novembre et en décembre 1920, à la salle Gaveau, il interpréta l'œuvre intégrale pour piano de Debussy. Après les concerts qu'il donna aux Champs-Elysées, en mars 1922, il partit en juin pour l'Amérique du Sud. En vingt séances, notamment à Buenos-Aires et à Rosario, il put faire de bonne propagande pour la musique française. A Lisbonne, il révéla de nombreuses pièces de nos compositeurs. Retournant à New York, il se fit connaître ensuite à l'International Composers Guild. A Rome, en 1923, il exécuta des morceaux de Debussy et de Ravel à l'Académie Sainte-Cécile.
M. Robert Casadesus est né le 7 avril 1899. Il est le benjamin d'une famille dans laquelle on est musicien par principe et par tradition et dont la généalogie, à ce titre, est savoureuse. Son grand-père, Louis Casadesus, d'origine espagnole, naturalisé français en 1870, pour s'engager dans notre armée, était un mélomane passionné. Il avait eu treize enfants et voulait que tous devinssent musiciens. L'aîné, François, dit Francis, est l'auteur de la Chanson de Paris. Henri, altiste du quatuor Capet, a fondé la Société des Instruments Anciens. Robert, père de Robert, a été directeur du Théâtre dramatique Français de New York. Marcel fut violoncelliste du quatuor Capet. Mme Patorni-Casadesus est la claveciniste distinguée dont nous avons déjà loué le talent. L'art du violon est représenté dans la famille par Marius. M. Robert Casadesus, de la plus jeune génération, a commencé ses études de piano à 3 ans et demi sous la direction de sa tante Rose Casadesus. A 6 ans, il donnait son 1er concert avec assez de succès pour recevoir en récompense un magnifique ballon. Il entra au Conservatoire dans la classe Diémer et la quitta à 13 ans avec un 1er prix.
Son 1er récital date de 1917. Il alla successivement jouer en Suisse, en Belgique et en Espagne. Il alliait à des goûts très classiques le culte de Fauré, de Debussy et de Ravel. Il était revenu au Conservatoire dans la classe d'harmonie de Xavier Leroux. Il avait obtenu en 1920, c'est-à-dire après la mort de son professeur, un 1er premier prix. C'est dans la classe Diémer, en 1916, qu'il connut sa future femme, Mme L'Hôte-Casadesus, qui, pour sa part, obtint le 1er prix de piano en 1918 et le prix Claire Pagès.
Bien antérieurement au couronnement de cette virtuose devant laquelle s'ouvre l'avenir, le Conservatoire a donné naissance à tout un essaim de pianistes qui forment actuellement un bouquet d'interprètes des plus talentueuses et des plus agréables. Toutes sont encore de jeunes femmes ; plusieurs ont déjà acquis, sinon la célébrité, du moins une juste réputation qui y confine ou plutôt y mène. Hélène Léon, née à Paris, le 26 février 1890, élève du Conservatoire de 1901 à 1906 et 1er prix de piano de cette année-là, a joué chez Colonne, chez Lamoureux, chez Sechiari, à la Nationale, à la Société Bach, aux Concerts Classiques de Marseille et d'Angers. Son champ d'action s'étendait aisément, ainsi que le prouve une récente tournée à travers toute la France. Musicienne accomplie, solidement cultivée, sensible et sans forfanterie, elle est actuellement l'une de toutes premières interprètes de musique classique et moderne. Sa modestie seule est peut-être cause qu'on ne le dit et qu'on ne le sait pas tout à fait autant qu'il conviendrait. Elle appartient au demeurant à une famille de musiciens : sa sœur aînée. Lucie Léon, professeur dit-on remarquable, se consacra exclusivement à l'enseignement. Elle est actuellement la coadjutrice officielle de Mme Marguerite Long au Conservatoire. Quant à leur cadette, Alice (aujourd'hui Mme Gautier), jadis brillant 1er prix chez Cortot, quoique pourvue de dons exceptionnels de virtuose, elle emploie également les loisirs que lui laisse son existence désormais familiale dans le professorat. Lucie Caffaret, parisienne fine et sympathique a obtenu à 11 ans, à l'unanimité son 1er prix de piano. Ses débuts aux Concerts Colonne furent sensationnels. Elle est devenue soliste chez Lamoureux et chez Pasdeloup. Ses récitals de musique classique et moderne à Paris et en province, ses tournées en Hollande et en Allemagne, en Suisse, en Espagne et au Portugal, ne sauraient se compter. Mlle Rachel Blanquer, née à Paris, le 14 septembre 1897, est 1er prix de 1914 au Conservatoire. Schumann, Chopin et Liszt, ont trouvé en elle une traductrice de premier ordre. Madeleine de Valmalète, élève de Philipp, 1er prix du Conservatoire, prix Philipp, en 1916, a déjà à son actif une carrière remplie et glorieuse dont les étapes sont aux concerts Colonne, Lamoureux, aux Séances classiques de Monte-Carlo, à Ostende, en Suisse Romande et dans la plupart des grands centres symphoniques étrangers. Suzy Weltie, dont le 1er prix au Conservatoire ne remonte qu'à 1914, s'est spécialisée, en quelque sorte, d'ans les concerts de musique française moderne. Tel est aussi un peu le cas de la simple et charmante Maïa Le Duc dont Ravel, Roussel, Louis Vuillemin, connaissent la conscience artistique et apprécient tout particulièrement le talent. Madga Tagliafero, Marcelle Meyer, Yvonne Lefebure possèdent, toutes jeunes, une autorité, une personnalité et, si cette expression est permise, un brillant tableau de chasse. Nous voudrions citer encore, d'une façon moins hâtive Yvonne Herr-Japy, élève de Delaborde, Riera et Cortot, Denise-Molié. née à Bellac, Haute-Vienne, le 24 juillet 1903, dont les maîtres sont Marguerite Long, Hélène Léon et Philipp et qui, pour la première fois à Paris a fait entendre l'œuvre entière de Chausson, les 2 et 18 mars 1921 ; Juliette Lampre (Paris, 1898), Hélène et Mathilde Coffer, Marguerite Illingworth, française, malgré son nom, 1er prix de piano en 1913, Léone Jankowky, Emilienne Weit-Bompard, 1er prix en 1917 et prix Musica, Marcelle Herrenschmitt (Paris, 1895) 1er prix en 1915, Paule Piedelèvre, une jeune scholiste de talent, Antoinette Veluard, qui fut, elle aussi, scholiste, après avoir obtenu son 1er prix au Conservatoire. La liste de ces jeunes s'allonge et je ne voudrais pas oublier de rendre ici un triste hommage à Juliette Meerovitch, cette séduisante pianiste, dont la fin prématurée a brutalement interrompu une merveilleuse carrière. Juliette Meerovitch, née en 1896, élève d'Alfred Cortot avait obtenu à l'âge de 14 ans son 1er prix au Conservatoire. Rarement tempérament plus puissant et personnalité plus affirmée se firent remarquer chez une enfant si jeune. Tous les musiciens qui avaient eu l'occasion de l'entendre fondaient les plus grands espoirs sur elle. Le 12 avril 1920, à 24 ans, Juliette Meerovitch revenait d'un triomphal concert à La Haye. Elle s'arrêta à Bruxelles et c'est dans cette ville que, subitement, elle expira. Jamais souriante et fertile destinée ne fut plus brutalement ni plus injustement interrompue.

Lucie Caffaret (photo Aspers)
La Musique Française peut faire actuellement confiance aux jeunes stagiaires que notre Conservatoire a mis en liberté ces dernières années et qui commencent déjà à prendre leur place dans les concerts. Si Magdeleine Brard-Borgo, 1er prix de 1916, richement mariée en Italie, Tatiana de Sansvitch, 1er prix de 1918, la Candela, 1er prix de 1917, se sont plus ou moins retirées de l'arène en ces derniers temps, Marie-Louise Darré et son rival du prix d'excellence de 1919, M. Perlemuter, Jacques Février, Daniel Encourt, Jacques Dupont, René Dreyfus, Webster et d'autres encore sont entrés ou s'apprêtent à entrer victorieusement dans la lice. Sans la moindre emphase, on peut affirmer qu'ils y trouveront la trace glorieuse de leurs aînés, qui forment, échelonnée depuis près d'un demi-siècle, une longue théorie d'interprètes et de virtuoses admirables à bien des titres.
Le piano est sans doute l'instrument qui a trouvé en France les adeptes les plus nombreux et formé l'école la plus valeureuse. Quelques très hautes silhouettes dominent chaque génération. Mais les plus modestes chaînons de la chaîne, professionnels maltraités par le sort ou amateurs animés du feu sacré, ont travaillé, plus ou moins consciemment, à faire de cet art ce qu'il est actuellement dans notre pays.
***
Tous les pianistes que nous avons énumérés ici ne furent pas, il s'en faut, des « toucheurs d'orgue ». Mais il est permis par contre de constater que la plupart des grands organistes qui ont exercé la maîtrise la plus incontestée sur les claviers de nos églises, ont parallèlement ou à la fois, marqué leur place, à un titre quelconque, dans l'histoire du piano — et de la composition pareillement.
Aucun autre art, peut-être, n'est davantage tissé de traditions vénérables et arides à pénétrer. Le génie propre de certains grands organistes de la période moderne a pu paraître quelquefois s'éployer, comme à vide et sans appui profond. C'est que le talent de ces artistes ne prenait pas des racines assez solides dans le passé et que la liaison entre eux et leurs prédécesseurs avait été peu ou pas assurée. Un exécutant habile, comme Lefebure-Wely (1817-1870, Paris) qui fut également pianiste renommé, avait une popularité d'improvisateur, mais une réputation médiocre en tant qu'organiste classique. Ce qui ne l'empêcha pas, d'ailleurs, de tenir l'orgue à Saint-Roch, à Saint-Sulpice et à la Madeleine. Il avait travaillé cet instrument avec Séjean et Benoit. Parmi ses contemporains, les plus renommés, il faut citer Besozzi (Versailles, 1814-1879), Edouard Alexandre (1824-1888), Edouard Batiste (1820-1877). Ch. Chauvet (1837-1871) qui avait été élève d'Ambroise Thomas et passait lui aussi pour un savant improvisateur. Il mourut jeune après avoir pendant deux ans seulement, tenu l'orgue de la Trinité. Renaud de Vilbac, né en 1829 à Montpellier, mort en 1884, pianiste dont les compositions firent longtemps les délices des pensionnats de jeunes filles (parce que ces ouvrages offraient maintes transcriptions pour 4 mains de partitions d'opéras) avait été reçu en 1841, sur la demande de Halévy, dans la classe de composition de celui-ci. Benoist l'avait pris dans la sienne en 1843 et en avait fait un an après un 1er prix d'orgue. Renaud de Vilbac fut sur cet instrument, un virtuose accompli. Il maniait la palette des timbres avec une aisance et un brio remarquables. On s'accordait à trouver que son style n'était pas celui de la musique d'église. Peut-être pourrait-on en dire autant de Vasseur, né le 28 mai 1844, à Bapaume, élève de son père qui était lui-même organiste de cette ville, et reçu ensuite boursier à l'école Niedermeyer. La place d'organiste de Saint-Symphorien à Versailles lui avait été attribué au concours. Vasseur devait d'ailleurs par la suite changer quelque peu son fusil d'épaule, puisqu'il devint en 1879, directeur du Théâtre Taitbout qui prenait le titre de Nouveau Lyrique.
La Belgique produisait un groupe de quelques artistes qui allaient assurer la transmission des secrets et la pérennité de la grande école de l'orgue. Schlosser, Loret, professeur à l'Ecole Niedermeyer et le grand César Franck en étaient les plus représentatifs. Mais, plus encore que Franck dans sa tribune de Sainte-Clotilde, Lemmens (1823-1881) allait propager cette connaissance du style et faire souche durable. Il était né à Anvers et en 1849, professait au Conservatoire de Bruxelles. Trente années phis tard, il créait l'école d'organistes de Malines. C'est lui qui fut le professeur de Guilmant et de Widor.
Félix-Alexandre Guilmant était né le 12 mars 1837, à Boulogne-sur-Mer. Avant de travailler avec Lemmens, il avait été l'élève de son père. Il participa à l'inauguration des nouvelles grandes orgues de Saint-Sulpice et de Notre-Dame et quand Chauvet mourut, il lui succéda à la Trinité et se fixa dès lors, à Paris. Très ouvert à tous les développements de l'orgue moderne, il possédait à fond le style ancien. Il fut professeur au Conservatoire en 1896. Il est mort en 1911.
Camille Saint-Saëns ne fut pas seulement le petit prodige qui étudiait le piano à 2 ans et demi et composait sa 1re œuvre à 5 ans. A partir de 7 ans et durant 5 années, il avait travaillé avec Stamaty. En 1851, il sortit du Conservatoire avec le 1er prix d'orgue. En 1853, il siégeait à la Tribune de Saint-Merry et en 1858, à celle de la Madeleine. Il était professeur à l'Ecole de Musique religieuse. Là, il eut l'occasion de former un certain nombre de disciples parmi lesquels son ami le plus cher, presque son fils, Philippe Bellenot. Maître de chapelle actuel de Saint-Sulpice, ce dernier fut l'un de ceux qui recueillirent le plus précieusement la tradition de la musique religieuse. Faut-il rappeler que l'école Niedermeyer avait nourri également, de sa substantielle pâture, Gabriel Fauré qui, pendant de longues années répandit les accents de son doux génie sur les fidèles de l'église de la Madeleine. Le maître Vincent d'Indy, lui, le futur promoteur du mouvement scholiste, avait fait ses classes d'orgue entre 1874 et 1876, au Conservatoire.
Autre rejeton de l'école Niedermeyer, Eugène Gigout né le 23 mars 1844, à Nancy, avait reçu des leçons de Niedermeyer, lui-même, de Saint-Saëns et de Clément Loret. En 1862, il était professeur de solfège et de plain-chant, puis d'harmonie, de contrepoint et fugue et de piano, avant de prendre la succession de son maître Loret à la classe d'orgue. En 1885, il devait ouvrir, salle Albert Le Grand, une école d'orgue et d'improvisation. Il avait suppléé fréquemment Saint-Saëns à l'orgue de la Madeleine, et était organiste attitré des concerts Eugène d'Harcourt. Il eut comme élèves : Gabriel Fauré, Alexandre Georges, Messager, Albert Roussel, Terrasse, Henri Expert et aussi son cher enfant d'adoption, Léon Boellmann, né à Ensisheim en Alsace en 1862, et mort très jeune en 1897. Ce dernier fut un compositeur et un organiste de mérite et promettait de devenir un virtuose universellement admiré.
Le bon maître Gigout, homme d'un cœur supérieur encore, si possible à son immense talent a répandu sur plusieurs générations, du haut de sa tribune de Saint-Augustin l'écho des inspirations de sa ferveur et de ses rêves. Son jubilé fut fêté, il y a 3 ans, au Conservatoire, en une manifestation inoubliable. Le maître Fauré était là. Tous deux sont disparus aujourd'hui. Eugène Gigout, peu de temps après Fauré, s'est éteint au mois de décembre 1925.
Charles-Marie Widor était né un an après Gigout, le 22 février 1845. Ce lyonnais avant d'être organiste à Saint-Sulpice (1869) avait fait ses études à Bruxelles, sous la direction de Fétis et, comme nous le rappelions tout à l'heure de Lemmens, Widor peut, lui aussi, compter parmi les héritiers du pur style. Sans doute sa virtuosité s'affirme-t-elle parfois plus étourdissante que réellement religieuse, dans ses exécutions, comme dans telles de ses compositions (l'entraînante et célèbre Toccata, par exemple). Pourtant M. Ch. Widor a dirigé en 1882, à Paris, une admirable audition de la Passion selon Saint-Mathieu que, d'aucuns n'hésitèrent pas à regarder comme la suite et le prolongement naturel de l'audition qui avait eu lieu le 11 mars 1829, sous la direction de Mendelssohn lui-même et un siècle après la 1re audition.
Presque contemporain de Widor, Donnay, né en 1841, avait été nommé à 14 ans, organiste de Notre-Dame du Havre ; 69 ans durant, il y officia. Son remplaçant, M. Charles Legros ne prit sa place qu'en 1923. Il est à remarquer d'ailleurs que nombre d'organistes ont régné durablement dans leur église d'élection. Eugène Sergent (1829-1920) passa plus d'un demi-siècle à Notre-Dame.
Parmi les modernes organistes qui ont pris la place de ces gloires dont beaucoup sont aujourd'hui des souvenirs, Jean Huré, né à Gien (Loiret) qui a fait ses humanités à Angers et complété ses études dans un Monastère, a pris place à la tribune de Saint-Augustin, Il y aurait beaucoup à dire sur l'activité de ce profond musicien qui ne se contente pas d'interpréter les œuvres des maîtres, mais tâche aussi, le cas échéant, à prêcher d'exemple et ne perd jamais l'occasion de batailler pour la constitution d'un fond musical national et contre l'invasion de l'exotisme, M. Alexandre Sellier, né à Molières-en-Sèze (Gard) en 1883, a été formé à l'Ecole de Diémer, de Leroux, de Guillmant et de Widor. Son prix d'orgue au Conservatoire date de 1908. Il a été l'organiste du cercle protestant l'Etoile, de la société Bach et des Concerts Touche, où il a donné les douze Concertos d'orgue de Haendel. Plus ancien est Abel-Marie-Alexis Decaux, organiste de la basilique de Montmartre, professeur à la Schola Cantorum, né à Auffray, le 11 février 1869. Widor a été son éducateur, puis à la Schola, Guillmant. En 1903, le jury qui l'a nommé titulaire de son poste à la Basilique de Montmartre était composé de Guilmant, Widor et Vierne. Decaux a été désigné par la suite pour prendre la direction des classes d'orgue à Rochester (Etats-Unis).
François Benoist, né à Nantes en 1794, mort à Paris en 1878, 1er prix de piano et Grand Prix de composition au Conservatoire en 1859, était encore professeur d'une classe d'orgue en 1872. Auguste-Marie Durand (Paris, 18 juillet 1830-1909), compositeur et éditeur connu, père de M. Jacques Durand, avait d'abord été organiste de diverses paroisses.
M. Joseph Bonnet, né à Bordeaux en 1884, organiste à Saint-Eustache, succéda à son professeur Guilmant à la Société des Concerts. Edouard-Henri Dallier, né à Reims le 20 mars 1849, remplaçait en 1878 Ed. Batiste à ce même orgue de Saint-Eustache. Plus tard il succédait à Gabriel Fauré au grand orgue de la Madeleine. Il était l'élève de Fr. Bazin et de C. Franck.
Louis Vierne, élève de Widor et de Guilmant, pouvait se réclamer de la tradition de Bach. En 1894, il était le 1er prix d'orgue au Conservatoire. En 1900, il était organiste à Notre-Dame.
M. Marcel Dupré, né à Rouen en 1886, avait un grand-père, Aimable Dupré, qui était l'ami personnel de Cavaillé-Coll et fut pendant 30 ans organiste de Saint-Maclou. Albert Dupré, père de Marcel, élève de Guilmant, était titulaire du magnifique orgue de Saint-Ouen. Le jeune Marcel, grandissant dans la calme maison de la rue du Vert-Buisson, était donc initié à la meilleure école. Il avait 4 ans lorsque Ch.-M. Widor, inaugurant l'orgue de Saint-Ouen, lui laissa un souvenir ineffaçable. Il posait à Cavaillé-Coll des questions sur le nombre et la composition des jeux des orgues de Saint-Sulpice et de Notre-Dame. A 7 ans, il exécuta en public le Prélude et Fugue en mi mineur du 3me livre, la Petite Fugue en sol mineur du 4me, les Choral du 5me. Guilmant qui l'entendait à cette réunion l'encouragea. Il avait 12 ans, lorsque son père lui annonça qu'on construisait un orgue dans l'église Saint-Vivier. Marcel Dupré déclara sans hésiter qu'il posait sa candidature aux fonctions d'organiste. Son père en appela au jugement de Guilmant qui prit l'enfant comme élève pour le piano, l'orgue, l'harmonie, le contrepoint, l'improvisation et la composition. Au Conservatoire, Dupré obtint en 1905, le 1er prix de piano (Diémer), en 1907, celui d'orgue (Guilmant), en 1909, le 1er prix de Fugue et en 1914, le Grand Prix de Rome. En 1906, il avait fait la connaissance de Widor qu'il suppléa quelque temps à Saint-Sulpice. Il interpréta avec une maîtrise, un style, une rectitude de tenue qui faisaient l'admiration des connaisseurs, les maîtres anciens et modernes de son instrument. Du 25 janvier au 26 mars 1920, il donna dans la salle d'orgue du Conservatoire dix récitals consacrés à l'œuvre intégrale de J.-S. Bach. Il exécuta par cœur cent cinquante-quatre pièces. Après le 10e récital, M. Widor déclara que « cette date du 26 mars 1920, méritait d'être gravée à côté de celle du jour où Mendelssohn donna son premier concert des œuvres de Bach délaissées depuis un siècle. »
Dans une allocution, M. Widor s'exprimait ainsi :
« Vos dix séances, qui ont commencé le 23 janvier pour finir aujourd'hui 26 mars, constituent un événement dans l'histoire de la Musique. Quel plus respectueux hommage à la gloire de celui que nous appelons Notre Saint-Père le Bach ! Cet hommage en rappelle un autre — et le rapprochement ne peut vous déplaire — celui de Mendelssohn à propos du monument de l'immortel Cantor. Mendelssohn qui, à vingt ans, avait exhumé la Matteus-Passion devant le public berlinois, donnait en 1840, à Leipzig, ce concert d'orgue dont Schumann nous a laissé le compte rendu enthousiaste ».
N'est-il pas curieux de reconstituer la façon dont la tradition classique de l'exécution des œuvres de Bach put être recueillie ? Les œuvres du Cantor ne portaient aucune indication de mouvements, ni de nuances, ni de registration. Berner, contemporain du dernier petit-fils de Bach (Wilhelm-Friedrich-Ernst) et Futtel purent donner des renseignements à Hesse de Breslau, ami intime de Mendelssohn, qu'il conseilla, lorsque celui-ci voulut remettre au jour la Passion selon Saint-Mathieu. Hesse de Breslau les transmit à son tour à Lemmens, son disciple. Alexandre Guilmant et Widor reçurent de celui-ci la tradition et l'enseignèrent à leur tour à leurs élèves, notamment à Louis Vierne et à Marcel Dupré. Louis Vierne d'ailleurs, élève de Widor et suppléant de Guilmant pendant 17 ans dans sa classe du Conservatoire, a été comme le trait d'union entre les deux maîtres et a déclaré qu'il n'avait pas constaté une seule divergence dans leur exécution respective des œuvres de Bach.
Ainsi tandis que la tradition du Cantor se perdait complètement dans son pays, elle passait d'Allemagne en Belgique pour se perpétuer finalement en France.
***
Plusieurs de nos compositeurs actuels ont acquit sur l'orgue une virtuosité de bon aloi. Nous avons déjà nommé le regretté Claude Terrasse (1867-1823), élève de Gigout et d'Alexandre Georges, chez Niedermeyer, qui conciliait gentiment la muse légère et la muse sacrée et fut organiste dans diverses églises de Paris, notamment à la Trinité (1896-1899). Sylvio Lazzari, né à Botzen (Tyrol) en 1858 a été l'élève particulier de Franck ainsi que Charles Tournemire (Bordeaux, 1870). Félix Raugel, Orner Letorey, Paul Fauchet, André Marchal, organiste du grand orgue de Saint-Germain-des-Prés, Mlle Nadia Boulanger, titulaire de nombreuses récompenses au Conservatoire, musicienne accomplie, font partie de cette pléiade de jeunes qui maintient très haut à l'heure actuelle la renommée de l'art de l'orgue français.
***
Si le cadre de cet ouvrage le permettait, il faudrait consacrer un chapitre spécial à la prodigieuse floraison de la virtuosité italienne ou allemande sur l'archet, ainsi qu'à l'importance didactique d'un Jean-Marie Leclair (Paris 1687-1764). Contentons-nous d'indiquer ici les principales branches de l'arbre généalogique étranger : il faut bien avant de passer en revue les essentielles étapes de l'interprétation du violon en France, mentionner les sources auxquelles elle s'est nourrie à ses origines et nommer au moins ceux qui furent, non seulement ses précurseurs, mais même ses pères spirituels. On verra plus loin, au cours de l'énumération des violonistes français combien les premiers de ceux-ci par ordre chronologique (ne furent-ils pas aussi les plus illustres ?) doivent à un Viotti (1753-1824), chef de la branche italienne qui compte également un Paganini (1784-1846), un Sivori (1815-1894), et des prodiges sans doute météorique, mais néanmoins mémorables comme les sœurs Milanollo.
Face à un tel quadrige, l'Allemagne alignait un Spohr (1784-1859), un Romberg (1767-1821), un Joseph Batta. Mme Normann-Neruda, Wilhelmy, Remenyi, Hugo Hermann, Marie Tavas, Wolff, leur faisaient cortège. Et, plus proche de nous, apparaissaient un Joachim (1831-1907), venu de Hongrie, dont le génie a laissé dans la mémoire de nombre de nos contemporains une impression que rien n'a jamais pu égaler ni effacer, et Kreisler (Vienne, 1875) qui vint cueillir son premier prix en 1887 dans notre Ecole Nationale de Musique et dont nous avons nous-mêmes pu subir, il n'y a pas longtemps encore, la prodigieuse emprise. L'Europe Centrale nous a envoyé encore un Henri Ernst (1824-1865) né à Moravie, un Lipinsky (17501861) né à Hadzin (Pologne), un Henri Wieniawski, né à Lublin (Pologne) le 10 juillet 1835, mort à Moscou le 1er avril 1880, 1er prix de notre Conservatoire en 1846, un Jacques Dorfmann (Odessa, 1851) naturalisé plus tard français et formé également au Conservatoire de Paris ; enfin un Georges Enesco. Celui-là est né le 7 août 1881 à Cordareni (Roumanie). On ne sache pas qu'il ait jamais été naturalisé français. Mais combien sa formation et son art semblent de chez nous. A Paris il fut l'élève de Gedalge, de Massenet, de Fauré. Au Conservatoire, il fut 2me accessit de contrepoint et fugue en 1897, 1er prix de violon en 1899. Les violonistes français ont beaucoup glané dans les traditions et dans la science des artistes des autres pays. Mais Georges Enesco, lui, a beaucoup de reçu de nos musiciens. Il est de chez nous. Nulle part il n'a été davantage fêté. Il forme la vivante liaison entre la musique de notre pays et le mouvement très intense qui se dessine dans sa patrie.
D'Espagne, Sarasate, né le 10 mars 1844 à Pampelune, venait lui aussi recevoir au Conservatoire de Paris le 1er prix de solfège et de violon en 1857, le 2me accessit d'harmonie en 1859. Albert Geloso, né à Madrid le 11 juillet 1863, 1er prix en 1883, faisait de même et s'imposait définitivement chez Pasdeloup, Colonne et Lamoureux, dès avant que d'avoir adopté la nationalité française. Grand artiste de souche étrangère, il n'a quitté Paris que pour de courtes journées, notamment en Allemagne. L'enfant prodige Dangrémont, né à Rio de Janeiro le 19 mars 1866, mort à Buenos Aires en 1896, cherchait en France la consécration de sa jeune et éphémère renommée. Pour tous ces artistes la France était la terre d'élection, l'art français le point de mire, l'exemple tutélaire. Mais, tout proche du nôtre, et antérieurement, s'était formé, sous l'influence allemande bien assimilée, une école du violon belge qui allait fournir aux artistes français quelques-uns de leurs maîtres les plus illustres et leurs plus précieux modèles.
Roberechts (Bruxelles, 1757-1860) avait été l'élève de Viotti, et, professeur de Ch. de Bériot, faisait la chaîne entre l'école italienne et la naissante pléiade belge. Charles de Bériot (Louvain, 1802-1870) mari de la Malibran, virtuose hors ligne et compositeur, instruisait Vieuxtemps (Verviers, 1820-1881), admiré par toute l'Europe. Hubert Léonard (1819-1890) né à Bellaire, professeur au Conservatoire de Bruxelles, avait été l'élève de Habeneck, comme Lambert Massart (Liége, 1811-1892) mari d'Aglaé Massart, fameux titulaire d'une classe de violon au Conservatoire de Paris de 1843 à 1890, avait été celui de Kreutzer et César Alard, né à Gosselies, celui de Servain. Un courant inverse établissait donc une espèce de réciprocité entre les échanges artistiques de la Belgique et de la France. Pierre Marsick, né à Jupille le 10 mars 1847, 1er prix au Conservatoire de Paris en 1869, demeurait à l'orchestre de l'Opéra de 1868 à 1870. Il avait été au Conservatoire l'élève de Léonard et de Massart, auquel il succéda en 1892 (jusqu'en 1900). Mais il avait travaillé aussi avec Joachim.
Armand Parent, né à Liège en 1863, avait été l'élève de Heyenberg au Conservatoire de Liège. Venu à Paris professeur de violon à la Schola, il fonda en 1892, le quatuor qui porte son nom. Il s'attacha à la diffusion des œuvres modernes françaises et donna un nombre considérable de premières auditions. A ce titre il a fait plus peut-être qu'aucun autre pour l'interpénétration musicale entre son pays natal et son pays d'adoption. Son compatriote et émule, Nestor Lejeune, a suivi cet exemple. Professeur à la Schola, il a lui aussi fondé un quatuor qui interprète des œuvres très rarement exécutées de la littérature musicale internationale. Le professeur de Lejeune avait été Ysaye. Né le 11 juillet 1898 à Liège, le plus illustre violoniste belge, on pourrait ajouter : l'un des plus illustres du monde entier, avait étudié avec Lambert Massart, puis Wieniawski. La rencontre de Vieuxtemps avait été décisive pour sa formation. Raff, Hiller, Clara Schumann l'encouragèrent par la suite. En 1880, il était engagé comme violon solo à l'orchestre Bilse de Berlin. C'est en 1883 qu'il se fixa pour un temps assez long à Paris. Maintes fois il y est revenu depuis. Mais c'est de cette époque que date la grande et familière amitié qu'a nouée Ysaye avec toutes les célébrités de la musique française, amitié qui n'a d'égale que la sympathie admirative du public parisien pour le maître — aujourd'hui lion vieilli.
***
Le 16 février 1774, à Bordeaux, naissait Rode, le chef de toute la lignée moderne des violonistes français. Son premier maître fut Fauvel aîné. Mais Viotti, avec lequel il travailla ensuite, lui transmit la tradition de l'école italienne. En 1790, il entra, par l'entremise de son illustre professeur, à l'orchestre du théâtre Feydeau comme chef des seconds violons. Viotti présenta également son jeune élève dans les concerts de la Semaine Sainte. Son succès fut complet. L'effet qu'il produisit sembla quelque peu moindre en Hollande, à Hambourg, à Berlin et à Londres, où il se fit entendre vers 1754 avec le chanteur Garat. En 1795, il rentra à Paris et devint professeur à l'Ecole Nationale de Musique. Puis il alla à Madrid où il se lia avec Boccherini. A son retour à Paris, il était à l'apogée tout à la fois de son talent et de sa fortune. Le Premier Consul l'avait attaché comme violon-solo à la musique de sa chambre. En 1803, il partit pour Saint-Pétersbourg avec son ami Boieldieu et fit une profonde impression à la Cour Impériale où il resta cinq années. Il avait formé avec Baillot et Lamarre un trio dont les séances étaient le point de mire artistique de l'époque. Mais à son retour de Russie, en 1808, il ne retrouva plus le triomphe d'antan. Son dépit le porta à partir pour l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse. Il se fixa à Berlin et ne revint en France qu'en 1828. On jugea alors qu'il n'était plus que l'ombre de lui-même. L'accueil qu'on lui réserva fut seulement poli. Son étoile, définitivement pâlie, s'éteignait lentement et tristement. Le chagrin de Rode était vif. Il mourut cependant dans son ingrate patrie, le 25 novembre 1830, au château de Bourbon dans le Lot-et-Garonne. Rodolphe Kreutzer était l'aîné de Rode. Sa naissance à Versailles remontait au 16 novembre 1766. Marie-Antoinette l'avait protégé enfant. En 1817, il était chef d'orchestre à l'Opéra et professeur au Conservatoire dès la fondation. Dédicataire de la plus célèbre Sonate de Beethoven pour piano et violon, il avait peu d'instruction classique, mais un instinct musical d'une justesse peu commune, une verve et une chaleur de sentiment intarissables. Il mourut à Genève le 6 janvier 1831, moins de deux mois après Rode. Son neveu Léon-Charles-François Kreutzer (Paris, 23 septembre 1817-Vichy, 6 octobre 1868) fut compositeur de musique instrumentale et vocale. Charles-Philippe Lafont (Paris, 1er décembre 1781-Bagnères-de-Bigorre, 14 août 1839) avait débuté à Paris dans les concerts. Les plus grandes villes d'Europe l'avaient fêté. A Milan, un match fameux l'avait mis aux prises avec Paganini. En 1815, il était 1er violon de la musique de la chambre du roi, et accompagnateur de la duchesse de Berry.
Baillot (Pierre-Marc-François de Sales), survécut à Rode et Kreutzer. Plus encore qu'eux on peut dire qu'il a fait souche en matière d'enseignement du violon. Il était né à Passy en 1771. Il succéda à Rode comme professeur au Conservatoire. Sa réputation devint bientôt européenne dans les morceaux de musique de chambre et de virtuosité pure. Chef d'école sans aucun doute, il mourut en 1842. Son fils René Baillot fut professeur d'ensemble (musique de chambre) au Conservatoire de 1848 à 1886. Pantaléon Battu (1799-1870), violoniste de l'orchestre de l'Opéra et de la Chapelle Royale, second chef d'orchestre à l'Opéra en 1846, était élève de Rodolphe Kreutzer, ainsi que Jean-Marie Becquié de Peyreville (1757-1876), toulousain qui joua à l'orchestre du théâtre italien et prit également les leçons d'Auguste Kreutzer. L'année 1828 vit naître deux futurs violonistes de juste renom : Horace Poussard (1828-1898) et Adolphe Blanc (1828-1885) né à Manosque. Tout un essaim de remarquables interprètes est accroché aux générations voisines. Delphin Alard, né à Bayonne le 8 mars 1815, mort le 22 février 1888, réputé pour le brio et l'aisance de son jeu, était l'élève de Habeneck. En 1843, il succéda à Baillot comme professeur au Conservatoire. Il a publié une « Ecole du violon » qui a servi de charte aux jeunes apprentis-virtuoses en maints pays.
Maurin (1822-1894) né en Avignon, élève de Baillot et de Habeneck, avait fondé en 1846, avec Chevillard le père pour le violoncelle, Mas pour l'alto et Sabatier comme second violon, une Société de Musique de Chambre qui se chargea spécialement de faire connaître à Paris les derniers Quatuors de Beethoven. En 1875, il fut nommé professeur au Conservatoire. Léonce Cohen, né à Paris le 12 février 1825, élève de Leborne au Conservatoire, était violoniste au théâtre Italien. Armingaud né à Bayonne le 3 mai 1820, mort à Paris en 1900, avait été refusé au Conservatoire en 1839 comme « trop avancé dans ses études ». Il les avait commencées dans sa ville natale. Cette proscription ne l'empêcha pas d'entrer à l'orchestre de l'Opéra et de former avec Léon Jacquard, Mas et Edouard Lalo ce célèbre quatuor qui s'adjoignit plus tard quelques instruments à vent pour devenir la « Société classique ». Edouard Lalo, né à Lille le 28 janvier 1823, mort à Paris le 22 avril 1892, ne fut pas seulement l'admirable compositeur du Roi d'Ys. Il pratiqua l'alto et le violon avec un rare talent. Il était issu d'abord du Conservatoire de Lille. Pour son instrument, dont il connaissait à fond les ressources et les exigences, il écrivit la Symphonie Espagnole, dédiée à Sarasate, deux Concertos et plusieurs Sonates. Benjamin Godard, sur un plan moins élevé, compositeur et violoniste, dotait la littérature du violon de plusieurs ouvrages, notamment de ce Concerto romantique joué dans tous les Concerts Symphoniques. Marie Tayau en était l'interprète attitrée. Benjamin Godard mourut jeune à Cannes en 1895. Sa sœur, Madeleine Godard, est violoniste et héritière de la renommée fraternelle.
Charles Dancla, né à Bagnères-de-Bigorre en 1918, mort à Paris en 1907, fut professeur au Conservatoire en 1857 et sut grouper autour. de sa chaire une équipe de disciples qui comptèrent parmi les premiers des violonistes français. Il écrivit beaucoup d'ouvrages consacrés à l'enseignement du violon. Son collègue, Eugène Sauzay (Paris, 1809-1901) était élève de Baillot et 1er prix du Conservatoire en 1828. Il professa officiellement de 1860 à 1892. Il succédait à Girard. L'année de son premier prix, il avait exécuté au Concert d'inauguration de la Société des Artistes du Conservatoire un Concerto inédit de Rode. Il fit partie du quatuor formé par Baillot et devint le gendre de son ancien maître. Plus tard il organisa chez lui des séances privées de musique classique qui devinrent ensuite publiques. Dans sa classe du Conservatoire, Sauzay groupait déjà autour de lui Colonne, Carembat, Laforge. Là encore la jonction des générations différentes s'accomplissait selon le même rythme régulier et harmonieux qui avait fait la force et la gloire de l'enseignement du piano français. La dynastie des Tolbecque, à l'origine de laquelle se trouve un chef d'orchestre de bals (1794-1871) a produit un certain nombre de virtuoses, violonistes ou violoncellistes, les uns nés à Hanzinne (Belgique) les autres à Paris. L'aîné Isidore-Joseph avait eu trois frères : Jean-Baptiste Joseph, qui fut violoniste à l'orchestre des Italiens, altiste à la Société des Concerts, chef d'orchestre à Tivoli et aux bals de la Cour. Auguste Joseph, 1er prix du Conservatoire en 1821, fut 1er violon à l'Opéra et à la Société des Concerts, violon-solo du théâtre de la Reine à Londres, et donna de brillants concerts ; Charles Joseph, 1er prix du Conservatoire en 1824, fit également partie de la Société des Concerts à sa fondation. Il fut chef d'orchestre au théâtre des Variétés.
Le violon, qui peut effectivement fournir le plus sûr critérium de ce que l'on appelle « l'oreille musicale » semble avoir été l'instrument de prédilection de la plupart des chefs d'orchestre. Le nombre de ceux d'entre eux qui ont manié à la fois la baguette et l'archet, est considérable. Nous avons eu déjà l'occasion de citer Constantin, Deldevez, Deloffre, Habeneck, Tilmant, Colonne, Jules Garcin, Lamoureux, Danbé et parmi les modernes, Rühlmann. Monteux, 1er prix de violon en 1896, qui se consacra surtout à l'alto et joua dans les grands quatuors parisiens, et Pierre Sechiari, 1er prix lui aussi de 1896, et qui fut longtemps premier violon-solo des Concerts Lamoureux.
A. Lefort, né en 1852 à Paris, professeur au Conservatoire en 1892, ne se consacra au professorat qu'après une carrière personnelle fort active. Il a pris sa retraite il y a peu de temps. Guillaume Rémy, qui fut longtemps son collègue au Conservatoire, est né en 1856 à Ongrée (Belgique). Mais il a été trop intimement et trop officiellement mêlé à l'enseignement national pour ne point trouver place parmi les interprètes français. Violon solo des Concerts Colonne, il devint professeur au Conservatoire en 1896. M. Paul Viardot, né le 20 juillet 1857, au château de Courtandael, commune de Vandiers (Seine-et-Marne) était le fils de Louis Viardot, homme de lettres, critique d'art, et de la chanteuse Pauline Viardot, petit-fils de Garcia, neveu de Manuel Garcia, de la Malibran et de Ch. de Bériot. Ses études de violon s'accomplirent en Allemagne, en Angleterre, puis en France avec Léonard. En 1875, il débuta chez Pasdeloup. Avec Raoul Pugno et Holmann il créa la Société Moderne à la salle Pleyel. Il fit partie à leur origine de la Société Nationale que présidait Romain Bussine et de la Société de la Trompette fondée par Lemoine. Plusieurs tournées furent entreprises en Europe et en Amérique par lui, avec, parfois, le concours de Rubinstein, de Saint-Saëns et de Pugno. C'est en 1906 qu'il fonda la section musicale de la Société Nationale des Beaux-Arts qui tous les ans fait entendre au Grand-Palais des œuvres d'auteurs vivants admises par un jury. L'activité de Paul Viardot comme animateur a d'ailleurs bien d'autres aspects. Il a ressuscité les Concerts Symphoniques d'Alger, dirigé les Concerts Populaires de Lille de 1890 à 1894, partagé pendant quelques mois avec Taffanel et Madier de Montjau la baguette de chef à l'Opéra... Il allonge et couronne dignement la liste des violonistes qui ont pratiqué l'art du chef d'orchestre.

Augustin Lefort
Edouard Nadaud est né à Paris en 1862. Violon-solo de la Société des Concerts, il a donné un nombre incalculable de séances de musique de chambre. En 1900, il a été nommé professeur au Conservatoire (son 1er prix dans cette maison remontait à 1881). Edouard Nadaud exerce toujours dans cette chaire un enseignement dont les bénéficiaires se reconnaissent à une technique remarquable et comme au reflet, dirait-on, de cette incomparable virtuosité que le maître a fait valoir pendant des années dans ses concerts. M. Nadaud est le fondateur d'un Prix Triennal qui porte son nom et qui est attribué à l'un des premiers prix de violon du Conservatoire en un concours analogue aux Concours Diémer et Claire Pagès
Presque du même âge que Nadaud, Th. Laforge était né à Paris en 1863. Il eut son premier prix de violon en 1886 et l'année suivante fut nommé alto solo à l'Opéra. Il fut au Conservatoire le premier titulaire et quasiment en 1894 le fondateur de cette classe d'alto, sur laquelle règne présentement avec compétence Maurice Vieux. Il est mort en 1919.
Maurice Hayot, également né en 1862, à Provins, avait obtenu le 1er prix de violon en 1883 au Conservatoire. Il y fut professeur de 1894 à 1896. Son quatuor, créé en 1894, fut des plus beaux de ce temps.
Henri Berthelier, né à Limoges en 1856, fut violon solo de l'Opéra et de la Société des Concerts. Nommé en 1894 professeur au Conservatoire, il conserva sa classe jusqu'à sa mort survenue en 1918. Comme Rémy, Alfred Brun, quoique étranger (il est né à Séville le 18 avril 1864), s'est étroitement incorporé à la famille des interprètes français. Il a obtenu dans notre Conservatoire le 1er prix de violon en 1885. En 1884, il est entré à l'orchestre de l'Opéra où il est devenu, douze années plus tard, violon-solo. En 1886, il débutait à la Société des Concerts. En 1896, il fut chargé d'une classe de violon préparatoire au Conservatoire. Pendant près de trente ans, il a conservé ce poste. Alfred Brun vient d'être nommé professeur d'une classe supérieure en remplacement de Lefort, retraité.
C'est dans la classe de Lefort que Jules Boucherit, qui est maintenant le plus jeune collègue de Rémy, de Nadaud et de Brun, a remporté son premier prix en 1892. Il naquit à Morlaix le 29 mars 1877. Rapidement il s'affirma, au cours de ses auditions à la Société des Concerts Colonne ou dans ses nombreux concerts privés, comme l'un des premiers virtuoses français. Sa jeune maîtrise a été en quelque sorte officiellement consacrée par l'investiture qu'il a reçue en 1919 comme professeur au Conservatoire. Il a commandé à une classe où la musicalité marche de pair avec la virtuosité.
M. Lucien Capet, né à Paris en 1873, 1er prix au Conservatoire dans la classe Maurin en 1893, professeur d'ensemble instrumental au Conservatoire, est le fondateur de cet admirable quatuor (1903) qui en 1911 participa à Bonn aux fêtes organisées en l'honneur de Beethoven et fit entendre en Europe non seulement les Quatuors de Beethoven mais les œuvres de Mozart, de Schumann, de Brahms et de Debussy.
Lucien Capet, qui, tout jeune, étudiait avec passion les quatuors de Beethoven et formait avec ses camarades du Conservatoire une équipe consacrée à glorifier ce dieu, s'est voué, par la suite, à une manière d'apostolat non plus seulement pour Beethoven, mais, plus simplement, pour la musique.
Firmin Touche, né à Avignon en 1875, est devenu à son tour, professeur au Conservatoire, violon solo des Concerts Colonne et de l'orchestre de l'Opéra. Lui aussi élève de Garcin, Gabriel Willaume, né à Rumilly-sur-Seine, aujourd'hui retiré du monde après une existence mouvementée, a obtenu au Conservatoire le 1er prix en 1895. Il a fondé un quatuor à cordes qui eut son heure de célébrité en France et en Angleterre. Ces quatuors se sont d'ailleurs multipliés au cours de ces dernières années. Plusieurs, comme l'excellent quatuor Poulet, commandé par l'un des violonistes les plus appréciés du moment, les quatuors Carembat, Krettly, Loiseau, Bastide, Capelle, sont des groupements de premier ordre. Citons également les quatuors Andolfi, Casadesus, Chailley, Duttenhoffer, F. Touche, Gaston Courras, Le Feuve, Tourret, et celui de la Société des Instruments Anciens.
Sur le nombre de ces interprètes groupés dans de studieux et très utiles cercles de musique d'ensemble, tranche nettement mais non point violemment, la romantique et sympathique personnalité d'un Jacques Thibaud, le plus célèbre de nos violonistes modernes, le plus fêté sans doute aussi. Il est né à Bordeaux le 27 septembre 1880. Son père l'initia à la musique et, dès 1892, le révéla aux Concerts d'Angers. A 13 ars, il était à Paris et, au Conservatoire, dans la classe de Marsick, obtenait la première année un accessit et, en 1894, un 1er prix. Attaché à l'orchestre Colonne, il y fut nommé peu après violon-solo. Alors commença sa carrière de virtuosité pure. Ysaye l'apprécia et le patronna en Belgique. Tour à tour l'Allemagne, la Russie, l'Autriche, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre l'acclamèrent. L'Amérique l'appela ensuite. A intervalles assez réguliers, Jacques Thibaud revient en France et se fait entendre dans des concerts de musique de chambre et des séances de sonates principalement. Ses programmes sont la plupart du temps consacrés à la musique classique et romantique. Ce virtuose enthousiaste et profondément sensible ouvre plus parcimonieusement la porte aux compositions de musiciens modernes. Cette attitude est à l'opposé de celle de violonistes moins illustres, mais extrêmement appréciés des maîtres de ce temps, tels Bilewski, à peu près contemporain de Thibaud, né à Angers le 8 janvier 1884, 1er prix au Conservatoire en 1903, ou, dans les générations plus jeunes, Hélène Jourdan-Morhange, 1er prix de la classe Nadaud en 1906, élève de L. Capet, Geloso, G. Enesco, soliste des Associations Colonne et Lamoureux, et qui, interprète fine et compréhensive, traduit avec une lumineuse précision les pages empreintes de la technique musicale la plus avancée. C'est ainsi que Mme Jourdan-Morhange a obtenu, ces dernières années, les succès les plus vifs en jouant notamment en première audition certaines œuvres de Maurice Ravel et de Florent Schmitt, qui lui sont dédiées, qu'elle a défendues et fait triompher non seulement à Paris, mais à l'étranger.

Joseph Bilewski
Mme Yvonne Astruc, née à Paris en avril 1889, élève de G. Enesco, 1er prix du Conservatoire en 1909, a également fait à l'étranger de la meilleure propagande musicale. Elle est la femme du pianiste Marcel Ciampi.
M. Louis Carembat, 1er prix en 1908, dans la classe Lefort, lauréat d'harmonie en 1912, dans la classe Leroux, a fondé en 1909 ce quatuor que nous citions plus haut, avec Gaston Poulet, Massis et Cruque, tous 1ers prix du Conservatoire. Après la guerre, Massis remplaça au pupitre de second violon Poulet, qui, si l'on ose dire, s'établissait pour son propre compte. Pierre Villain prit la place d'alto et M. Chizalet succéda à Cruque. C'est par cette association ainsi reconstituée que furent exécutés, avec le concours d'André Salomon, les quatuors de Laurent Cellier et de Jean Cras en première audition à la Société Nationale ou à la S. M. I. André Deblauwe, professeur à l'Ecole Normale de Musique de Paris, fondateur des auditions de la Bonne Soirée, avait, avec Denayer et André Kekking, formé la seconde équipe du quatuor Hayot, primitivement constituée de Trulet, Denayer et Salmon. Seul ou avec ses camarades il accomplit des tournées en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Suisse et en Espagne.

Louis Carembat (photo Méjat)
M. Robert Krettly, né à Faris le 27 juillet 1891, débuta à 15 ans chez Colonne. Son 1er prix au Conservatoire date de 1905. Après avoir suivi les cours d'ensemble de Salmon et de Chevillard, il joue comme soliste au Casino de Dieppe pendant 3 ans, puis à l'orchestre du Théâtre des Champs-Elysées. Il fut er violon du quatuor de la Société Mozart.
Mlle Noëla Cousin, parisienne, mandoliniste à l'âge de 5 ans, sortit du Conservatoire en 1913, avec un 1er prix décerné à l'unanimité. Soliste chez Colonne et chez Lamoureux, elle entreprit une série de tournées qu'elle n'a plus interrompues. Partenaire appréciée du bon maître Planté, elle a joué avec lui, tout récemment encore, au cours d'une de ces rares séances qu'il consent à donner de loin en loin dans son cher Midi.
M. Robert Soëtens, né à Montluçon, le 19 juillet 1897, est entré au Conservatoire de Paris en 1910. Benjamin de la classe Berthelier, il a obtenu son 1er prix en 1915, sous le règne intérimaire de L. Capet. Il prit également en particulier des leçons avec Jacques Thibaud. Il devint soliste des orchestres d'Aix-les-Bains, de Cannes, d'Angers, et du Conservatoire de Nancy.
Mlle Fernande Capelle, née à Paris le 13 février 1897, 1er prix de violon (classe Berthelier) en 1916, a pris le premier pupitre et le commandement de ce quatuor que nous citions parmi les plus recommandables.
André Asselin, né à Paris le 24 avril 1895, élève de Brun, de Berthelier, de Capet et de Geloso, 1er violon de la Société des Concerts, violon solo des Concerts Populaires d'Angers, membre du quatuor Firmin Touche, est 1er prix de l'année 1917, ainsi que Mlle Lydie Demirgian, qui obtint l'année suivante le Grand Prix d'Honneur.
M. Gabriel Bouillon, né à Montpellier en 1898, élève de son père, professeur au Conservatoire de cette ville, a été récompensé d'un 1er prix unanime après avoir travaillé à Paris dans la classe de Berthelier, suppléé ensuite par Capet. Il joua chez Colonne le Poème de Chausson, et Jacques Thibaud le désigna pour le remplacer à la Société des Concerts où il exécuta le Concerto de Mendelssohn. En sorte que Gabriel Bouillon peut revendiquer l'honneur d'avoir eu, à l'aurore de sa carrière, Jacques Thibaud pour parrain, comme celui-ci avait eu Ysaye.
La stricte justice voudrait que l'on consacrât une longue étude à la carrière laborieuse et féconde de virtuoses qui ont tous rempli leur mission et servi leur art avec une égale conscience et un talent souvent éclatant : Soudrant, Tracol, Mme Gillart, Maurice Clerjot, Railhet, Bailly, Loiseau, Andolfi, Bas, Cantrelle, Heifetz, Cézard, Bleuzet, Lopez, Charles Dorson, Bastide, Carmen Forté, Yvonne Curti, Mache, Englebert, Arnitz, Mendels, Gront, Mlle Tronche, Toussaint, Elcus, André Tourret, Siohan, Reitlinger, Thérèse Combarieu, Quiroga, Quattrocchi, Elzon, Nerini, Claude Lévy, Marckel, Jean Godard, 2me violon du Quatuor Krettly, membre des Concerts Hasselmann, Neitthoffer, Oubradous, Zigetti, Renée Chemet, Hewitt, Marcel Husson, soliste chez Pasdeloup, Simone Hersent et René Benedetti, 1er prix du Conservatoire de 1918. Les dimensions de cet ouvrage nous font une obligation de les citer seulement. Mais la simple honnêteté commande de les égaler aux meilleurs ouvriers de l'art du violon.

André Tracol (photo Manuel frères)
***
La tâche du violoncelliste est plus ingrate et même dans l'orchestre, souvent plus obscure que celle du violoniste. Beaucoup plus rare sont les adeptes de cet instrument qui ont réussi à émerger de l'océan des instrumentistes pour faire une carrière personnelle. Plusieurs, cependant, ont pris rang honorablement dans les annales de la virtuosité. Parmi les étrangers, les frères Batta, originaires de Maestricht, Jacques Offenbach, né à Cologne (1819-1880), Bernard Romberg (1770-1841) né à Dinklage, Norblin (2 décembre 1781-14 juillet 1854) originaire de Varsovie, Henri Bertini (Londres, 1798-1876) ont atteint à la célébrité. De nos jours, Joseph Salmon (La Haye, 1864) élève de Franchomme, 1er prix en 1883, membre fondateur du Quatuor Hayot en 1894, a joué comme soliste chez Pasdeloup, Colonne, Lamoureux et à la Société des Concerts. Il est resté violoncelliste des Concerts Lamoureux pendant 14 ans.
Enfin, l'admirable Pablo Casals, né à Vendrell (Espagne) en 1877, a fait une carrière entièrement dévouée à la musique. Il travailla premièrement avec son père, organiste, qu'il remplaçait souvent à l'orgue de Vendrell.
A 12 ans, à Barcelone, il étudia la composition et le violoncelle. La reine Marie-Christine lui donna une bourse pour faciliter son séjour à Madrid. Il travailla Bous la direction du Comte de Morphy avec les renommés professeurs Monsaterio et Thomas Breton. Après un court séjour à Bruxelles, il retourna dans sa patrie pour raison de santé. Professeur au Conservatoire de Barcelone, il fonda, avec Crikboom, la Société des Concerts et la Société des Quatuors. Ses débuts, à Paris, qui furent décisifs, eurent lieu chez Lamoureux, en 1898. On sait quel rôle Pablo Casals a joué par la suite dans la défense et l'illustration de la musique française moderne.
En France, le parisien Battanchon (9 avril 1814-juillet 1853) représente l'une des plus anciennes générations de violoncellistes. Il était contemporain du belge Franz Servain, né à Hal (6 juin 1807-26 novembre 1866) professeur en 1848 au Conservatoire de Bruxelles où son fils lui succéda. Chevillard le père était né à Anvers (1811-1877). Il fut professeur au Conservatoire en 1860. Son fils Camille Chevillard, a donné à son nom, honorablement connu, un lustre et une pérennité qu'il n'aurait peut-être pas eu sans lui. Immédiatement après François Benoist (1795-1878) intervient, chronologiquement, Franchomme (1809-1884), lillois d'origine, élève de Norblin, ami intime de Chopin, professeur au Conservatoire de 1846 à 1884.
Jules Delsart, né près de Valenciennes en 1844, mort à Paris en 1900, lui succéda en 1884 au Conservatoire où professa, en 1877, également L.-J. Jacquart (Paris, 1826-1886).
Hippolyte Rabaud, ré à Salelles d'Andes en 1839, mort à Paris en 1900, à été depuis 1891, professeur en ce Conservatoire que son fils devait diriger plus tard.
Fernand Pollain, né à Reims en 1879, 1er prix en 1896, a accompli l'une des carrières les plus complètes et les plus heureuses comme virtuose du violoncelle. Né à Bordeaux, en 1867, André Hekking avait eu pour seul maître son oncle Charles Hekking. Il donna de fréquentes auditions à la Société des Concerts, chez Colonne et chez Lamoureux et le premier participa à des récitals pour violoncelle avec orchestre. André Hekking qui pouvait, à juste titre, passer pour chef d'école, fut nommé en 1919, professeur au Conservatoire. Il conserva sa chaire jusqu'à sa mort, survenue prématurément au début de 1926. Son cousin, Gérard Hekking, violoncelliste et artiste peintre, né à Nancy, le 22 août 1879, 1er prix du Conservatoire en 1899, resta un an à l'orchestre de l'Opéra. Il entreprit de nombreuses tournées européennes et fut professeur au Conservatoire d'Amsterdam.
Ernest Cros-Saint-Ange, né à Paris le 11 septembre 1855, 1er prix du Conservatoire en 1870, a joué à la Société des Concerts et dans les Quatuors Alard, Maurin et Nadaud. En 1900, il a été nommé professeur au Conservatoire.
Jules Loeb, né à Strasbourg en 1892, élève de Chevillard et 1er prix en 1872, occupe depuis 1872 une classe de violoncelle au Conservatoire. Il a maintenant pour jeune collègue Paul Bazelaire, né à Sedan (Ardennes) le 4 mars 1886, 1er prix en 1897, qui a donné de fréquents concerts avec sa femme et formé l'ensemble Bazelaine de trente violoncelles ! Lui-même pianiste accompli, M. Paul Bazelaine a été nommé cette année-ci professeur au Conservatoire en remplacement du regretté André Hekking.
Francis Touche, né à Toulouse le 25 février 1872, 1er prix de violoncelle en 1892, membre de l'orchestre Colonne, a, parallèlement à sa carrière de violoncelliste, affirmé une activité hautement louable de chef d'orchestre, dirigeant les Concerts Rouge, à partir de 1895 et fondant cette entreprise des Concerts Touche, véritable apostolat de la musique qui n'a disparu, tout récemment, que devant la coalition des événements, après des années de luttes et de difficultés surmontées.
M. André Lévy, né à Paris le 1er novembre 1894, élève de Loeb, 1er prix en 1912, a parcouru la Belgique, l'Espagne, le Portugal, la Hollande. Louis Ruyssen, 1er prix du Conservatoire de Lille en 1905, et à Paris en 1909 (classe Loeb) a fait partie à sa sortie de l'Ecole, du Quatuor Geloso.
Le belge Jules-Victor Marneff, né à Namur le 16 mai 1874, 1er prix en 1894, a été violoncelliste à l'Opéra, au Quatuor Firmin Touche et à Lille.
Jean Bedetti, né à Lyon, le 13 décembre 1883, a donné son premier concert dans cette ville à 11 ans. En 1902, à Paris, dans la classe Loeb, il a obtenu le 1er prix. Avant d'être appelé en 1919 au Boston Symphony Orchestra, il a été violoncelliste de l'Opéra-Comique, chez Colonne et chez Monteux.
R. Dangréaux, né à Paris en 1892, élève de André Hekking, a fait partie des orchestres Hasselmans, Monteux, Pasdeloup, Colonne, du Quatuor Bastide et joué aux Concerts Rouge, à la Société Nationale, à la S. M. I., etc.
M. Louis Fournier, né à Aix le 8 juillet 1877, élève de Delsart et de Cros-Saint-Ange, a remporté le 1er prix au Conservatoire de Paris en 1901, après avoir passé par celui de Lille. Mme Caponsacchi-Jeissler, née à Bordeaux le 5 mars 1884, 1er prix de la classe Loeb après un an d'études, soliste de Colonne, de Lamoureux et de Pasdeloup, a accompli, depuis 1905, de fréquentes tournées.
Louis-Auguste Feuillard, né à Dijon, le 20 juin 1872, a obtenu le 1er prix au Conservatoire en 1894, préface d'une carrière bien remplie dans les différents orchestres et le professorat.
M. Dussol, 1er prix du Conservatoire, soliste chez Colonne a donné de remarquables exécutions du Concerto avec orchestre de Saint-Saëns. Il fait partie du Quatuor Carembart. Il est professeur au Conservatoire de Montpellier. Guy, Reitlinger, Paul Mas, Hippolyte Lopès, Courras, Crinière, Delgrange, Gurt, Alexanian Diran, Alfred Zigéra, Adèle Clément, Camille Delobelle, 1er prix de 1917, Lucienne Radisse, Marcel Hubert, Roger Mendez, Marika-Bernard, mériteraient d'être cités et commentés plus abondamment à des titres divers.
Dans le royaume de la contrebasse on ne trouve guère aujourd'hui qu'un Nanny dont l'art parfait puisse évoquer le célèbre ancêtre Bottesini, l'un des rares adeptes de cet instrument et qui, en de nombreuses tournées, ait remporté des succès personnels. On l'appelait le Paganini de la contrebasse ! Nanny, né à Saint-Germain-en-Laye le 24 mars 1872, a obtenu au Conservatoire le 1er prix en 1892. Soliste chez Lamoureux et à l'Opéra-Comique, il est professeur au Conservatoire.
Plus rares encore sont les musiciens qui réussissent à se faire un nom et une situation de virtuose sur des instruments habituellement sacrifiés et classés comme des utilités modestes de l'orchestre : la harpe, la flûte, la clarinette. Il y a pourtant des cas, et même des cas de virtuoses qui cumulent plusieurs de ces titres.

Pierre Jamet (photo Rudomme)
Nous avons l'exemple curieux d'Alphonse Leduc (Nantes, 1804-Paris, 1868), qui, avant de fonder en 1814, sa célèbre maison d'édition avait été virtuose du piano, du basson, de la flûte et de la guitare !
Antoine-Marcel Lemoine (Paris, 1763-1817) guitariste, fonda lui aussi une de nos plus anciennes maisons d'édition.
Forcé de se réfugier en France pour avoir pris part au soulèvement militaire de Riego en 1820, Trinité-François Huerta y Caturla, né à Orihuela près de Cadix, en 1803, avait été forcé, se trouvant sans ressources, de tirer parti de son talent de guitariste. Sa venue soulevait en France, comme en Amérique, en Belgique ou en Orient, un enthousiasme indescriptible. On lui attribua plus tard le Chant National Espagnol l'Hymne de Riego.
Le 9 mars 1870, était mort à 65 ans, Théodore Labarre, ancien élève de Dourlen, d'Eler et de Fétis, second Grand Prix de Rome en 1823, et qui avait remporté des succès considérables de harpiste. Il s'était adonné à cet art dès son enfance. De 1847 à 1849, il avait succédé à Girard comme chef d'orchestre de l'Opéra-Comique. En décembre 1851, Napoléon III le nomma directeur de sa musique particulière. Il avait également écrit quelques opéras dont un Pantagruel que l'Empereur avait fait interdire après sa première représentation et un ballet, le Roi d'Yvetot, dont le véritable auteur était, disait-on, le prince Richard de Metternich. En 1867, il succédait à Prumier comme professeur de harpe du Conservatoire.
Le harpiste Godefroid qui était né à Namur le 24 juillet 1818, a publié plusieurs morceaux pour harpe. Il a même laissé un petit opéra dont le titre porte la marque professionnelle : la Harpe d'Or.
Alph. Hasselmans (Liège, 1845-Paris, 1912) père de Louis Hasselmans a professé au Conservatoire de 1884 à sa mort. Zabel (Berlin, 1835-Petrograd, 1910) a laissé maintes pièces pour harpe. Le sexe féminin est proportionnellement nombreux dans ce groupe. Mlle Henriette Renié (Paris, 1876) élève de Alph. Hasselmans, 1er prix du Conservatoire en 1887, a elle aussi beaucoup composé pour son instrument. Parmi ses jeunes émules, il convient de citer Mmes Meunier-Jendrot, André Amalon, Bastide-Geoffroy, Mlles Micheline Kahn et Lily Laskine, musiciennes de race et de goût. De même Mme Marie-Louise Casadesus et son jeune quatuor de harpes chromatiques qui fait connaître à l'étranger des pièces de nos compositeurs les plus modernes.

Lily Laskine
Charles-Marie-Léon Salzedo, né à Arcachon le 6 avril 1885, lauréat du Conservatoire, Marcel Grandjany, né à Paris en 1891, élève de Tandon, de Caussade et de Vidal, 1er prix de harpe à 13 ans, s'inscrivent en brillante place parmi les interprètes de cet instrument ingrat en soit et qu'un Labarre ou un Cœur ont exceptionnellement illustré.
L'un des clarinettistes les plus justement renommés Arnold-Joseph Blaes (Bruxelles, 1814) était en 1842, professeur au Conservatoire de Bruxelles.
***
Jean-Louis Tulou (Paris, 1786-Nantes, 1865), fils d'un professeur de basson au Conservatoire, avait obtenu un 2e Prix de flûte en 1795. L'année suivante, il méritait la première récompense, mais pour le garder une année encore et le forcer de parachever ses études, le jury, exceptionnellement, décida de lui décerner un second Prix d'Honneur. En 1801 il eut enfin son 1er Prix. Il entra à l'orchestre du Théâtre-Italien en 1804, à celui de l'Opéra en 1813. Il menait une vie de plaisir qui devait provoquer à une assez brève échéance la ruine de son talent. Un instant il avait eu à lutter contre son rival Drouet. Mais l'on raconte qu'après un certain nombre de péripéties, la façon magistrale dont Tulou imitait le chant du rossignol, avec une volubilité et un sentiment incroyables dans le Rossignol de Lebrun, lui assurèrent une suprématie définitive ! Quand son maître Wunderlich mourut, Tulou, dépité de ne pas être appelé à lui succéder, quitta l'orchestre de l'Opéra en 1822. En 1826 on le rétablit dans ses fonctions. Il fut nommé ensuite au Conservatoire en 1827 et conserva sa chaire jusqu'en 1859. A noter que Tulou préconisa toujours l'emploi de l'ancienne flûte en bois et s'opposa tenacement à l'introduction de la flûte métallique du système Boeh.
A sa suite vient une longue et brillante lignée de flûtistes comme Altès (Rouen 1826-1893), directement issu de l'enseignement de Tulou et qui succéda à Dorus (Valenciennes, 1812) comme professeur au Conservatoire en 1868 ; Louis Balleron, Auguste Cantré, Alfred Guesnay, Eugène Portré, Ernest Million, René Deschamps, Georges Barrère, Bertram, Jules Herman, Edouard et Léopold Lafleurance, André et Daniel Magnarre, Adolphe Hennebain ; Paul Taffanel, qui, dans sa classe du Conservatoire, forma Philippe Gaubert, Gaston Blanquart, le regretté Louis Fleury, Jean Boulze, soliste à l'Opéra et chez Lamoureux, George Laurent, du Boston Symphony Orchestra, Marcel Moyse, de l'orchestre de l'Opéra-Comique et de la Société des Concerts, Paul Krauss, professeur au Conservatoire de Strasbourg, Bladet, du Boston-Symphony Orchestra, Urbain Bauduin et René Grisard des Concerts Colonne, Henri Brouillard, professeur au Conservatoire de Lille, George Delangle, de l'Opéra, Albert Manouvrier, de la Société des Concerts, Lucie Dragon Bergeron, professeur au Conservatoire de Bordeaux. Enfin Lucien Lavaillote, de la Société des Concerts et Gaston Crunelle, de l'Orchestre Pasdeloup ont obtenu chacun leur premier Prix dans la classe de Philippe Gaubert.
Chez les hautboïstes Vogt et Verroust (Hazebrouck, 1814-1863), professeurs au Conservatoire en 1853, apparaissent comme des chefs de file. D'année en année se succèdent dans les classes et aux principaux pupitres Charles Trielbert (Opéra), Lavigne, Cras, Garimond, Casteigner, Pabon, virtuose et compositeur, Degouy, Boulu (Musique de la Garde), Bruyant (Opéra-Comique et Société des Concerts), Colin, Lalliet (Opéra), Raoul Trubert, Fargues, Georges Gillet (Opéra), Boulland (Opéra-Comique), Dorel (Opéra-Comique et Lamoureux), Lamotte, Sautet (Colonne), Bas (Opéra, Société des Concerts et de Musique de Chambre) Harel (Lamoureux), Longy (Colonne et Opéra-Comique), Basson, professeur à Nantes, Gaudard (Colonne), Barthel (Opéra-Comique), Creusot (Lamoureux), Foncanet, professeur à Nancy, Leclerc, soliste à l'Opéra-Comique, tué pendant la guerre, Bleuzet, professeur au Conservatoire, Fernand Gillet, 2e soliste à l'Opéra, Mondain, Paul Brun, l'excellent artiste des Concerts Colonne, etc... Il convient de nommer encore, parmi les virtuoses distingués des instruments à vent un Allard, professeur de trombone au Conservatoire, Eugène Bourdeau, 1er Prix de Basson en 1868 et professeur en 1891, Léon Letellier, bassoniste, né à Marseille en 1859, les clarinettistes Klosé (Lyon 1808-Paris 1880), Prosper Mimart, soliste de la Société des Concerts, professeur au Conservatoire en 1878 ; Claude Turban (Strasbourg 1845-Paris 1805) 1er Prix en 1865, professeur au Conservatoire en 1900, enfin Cyrille Rose (18301902) élève de Klosé, 1er Prix en 1847 et professeur au Conservatoire de 1876 à 1900, H. Lefèvre, Gaston Hamelin, les cornistes et cornettistes Arban (Lyon 1825-Paris 1889), professeur au Conservatoire et chef d'orchestre des Bals de l'Opéra, François Brémond, Jules Violet, Damprat, Franquin, 1er prix de Cornet à pistons en 1871, professeur de Trompette à pistons au Conservatoire de 1889 jusqu'en 1912, Eugène Vivier, né à Brioude le 04 décembre 1817, mort à Nice le 24 février 1900.
Eugène Vivier était devenu « corniste » par un curieux procédé personnel qui lui permettait de tirer simultanément plusieurs sons de son instrument. A un seul cor il faisait produire trois sons à la fois d'égale intensité. Tout Paris se rua à ces séances dans lesquelles Vivier faisait ses démonstrations. On entendait notamment l'exécution par lui seul de petits trios, dont l'un était intitulé la Chasse, de sa composition.
Joseph-Jean-Baptiste-Laurent Arban (Lyon, 1825-Paris 1889) avant de devenir le chef d'orchestre réputé de Frascati avait d'abord été renommé pour son habileté sur le « Cornet à piston ». Il fut professeur au Conservatoire de 1869 à 1874 et de 1880 à 1889.
***
Tandis que l'interprétation de la musique pure se dégageait lentement mais sûrement des emprises exotiques pour rejoindre les sources du génie racial, que se passait-il dans le domaine du théâtre lyrique ? Presque constamment celui-ci était demeuré soumis aux influences de la culture française. Il en avait, dans une large part, maintenu les traditions. Même au plus fort de la tourmente wagnérienne qui tournait bien des cervelles de « Symphonistes », par un paradoxe les compositeurs de théâtre maintenaient les distances et conservaient leur personnalité. Les fournisseurs de l'Opéra et de l'Opéra-Comique s'appelaient tout de même Gounod, Bizet, Lalo. C'étaient leurs œuvres, qui, avec des éclipses diverses, tenaient l'affiche — et la tenaient bien. On disait de Bizet qu'il « reméditerranéisait » la musique. Ce n'était guère exact, car la musique de théâtre avait, moins que toute autre, besoin de cela à ce moment. Seulement, tandis que la musique symphonique et instrumentale échappait peu à peu à l'influence allemande, l'art lyrique, demeuré jusque là relativement vierge, allait abdiquer devant le vérisme italien. Ce fut le coup le plus terrible porté au goût français. Que celui-ci s'accommodât d'une certaine adaptation à la formule de plusieurs créateurs italiens, notamment des auteurs de l'Opéra-Bouffe qui se tenaient sur le terrain de la musique universelle, c'était une concession non seulement admissible, mais nécessaire. Il était plus difficilement acceptable qu'il passât sous les fourches caudines des véristes italiens, ceux-là mêmes que les véritables descendants de la grande lignée italienne réprouvaient et reniaient dans leur propre pays. Or, le public français les adopta, moutonnier comme à l'ordinaire. Il les adopta sur la recommandation discrète, mais habile, des directeurs de théâtre, prompts à passer des marchés avec le diable et enclins à faire sur leur affiche la part belle aux spécimens de l'art étranger le plus inférieur.
A l'heure actuelle, l'état de notre production lyrique se ressent gravement de cette intrusion qui se prolonge et triomphe depuis des années. La conséquence directe de cette longue suite de soumissions est qu'aujourd'hui nos virtuoses des cordes vocales se trouvent, s'ils veulent se refranciser, et surtout refranciser leur goût, dans la nécessité de se « décrasser » littéralement, comme ont eu la volonté et le courage de le faire, sur un autre plan, leurs camarades instrumentistes. La tâche des chanteurs est peut-être plus ingrate et plus méritoire, car la tentation est si forte pour eux ! Puccini et Leoncavallo se sont livrés à une véritable surenchère démagogique en ravalant l'art du chant à la forme la plus basse, la plus dévoyée, la plus caricaturale de ce bel canto, où brillèrent les Tamberlinck, Nicolini, Tamburini, Scartia, Rubini, Ronconi, Persiani, Emile Naudin, Rosina Penco, Pasta, Giuseppe Mario, Judith et Giulia Grisi, Albani, Marietta Alboni, Fraschini, Delle Sedie et son élève Ezio Ciampi, Borghi-Mamo, Patti..., etc.
Gagnés aux promesses de cette démagogie vocale, pris aux mirages de « l'effet » facile et fascinateur, les chanteurs actuels en sont venus tout naturellement à reprocher à l'Ecole Debussyste de n'avoir pas de substance vocale et de supprimer pour eux toute possibilité de succès personnel. Il est naturel qu'un chanteur veuille d'abord chanter, et nous ne prétendons pas qu'il n'y ait pas lieu pour les jeunes compositeurs de tenir compte d'un vœu si légitime. Debussy lui-même dans ses Mélodies avait su concilier les « effets » en question avec sa volonté d'expression si simple, frisant la déclamation modulée, ondoyante. Il n'est pas impossible d'imaginer une déclamation qui tienne compte des deux éléments en cause. N'est-ce pas celle que l'on trouve, concrétisée au moins partiellement, chez Gabriel Fauré, dans ses lieds et dans Pénélope ? Le jour de la réconciliation des chanteurs avec la musique pure n'est donc peut-être pas très éloigné. Du moins espérons-le.
L'histoire du chant en France se confond presque exclusivement avec celle de l'art lyrique. Raconter l'évolution de l'Opéra ou de l'Opéra-Comique, comme l'ont fait avec talent, dans cette publication, nos confrères Louis Laloy et Henry Malherbe, c'est en même temps retracer les différents aspects de l'interprétation vocale et en évoquer les grandes figures. Laloy et Malherbe n'y ont pas manqué. Il ne saurait être question pour nous de marcher sur leurs brisées. Seule une rapide synthèse s'impose ici à nous, sans que nous puissions prétendre à nommer tous les dignes émules et successeurs de Dugazon, de Garat, de Levasseur, de Adolphe Nourrit, de Cinti-Damoreau, de Cornélie Falcon, de Gustave Roger, de Ponchard, de Pauline Viardot... Un Ismaël qui, en 1871, débutait à l'Opéra-Comique après avoir créé les Pêcheurs de perles au Théâtre-Lyrique semble avoir été le continuateur direct de ces précurseurs. Il avait débuté comme chanteur ambulant, puis comme choriste. Seul il avait appris à lire, à écrire et... à chanter. Il succéda à Obin comme professeur d'une classe d'Opéra au Conservatoire. Il était né à Agen le 28 avril 1827. Mme Ugalde (Paris, 3 décembre 1829), créatrice du Caïd, des Monténégrins, du Songe d'une nuit d'été, de Galatée, de Psyché, finissait à peine sa carrière théâtrale vers 1876. Elle prolongea son activité musicale par le concert et les tournées provinciales.
Léon Achard (Lyon, 16 février 1831) était encore à l'Opéra-Comique vers 1876. Il y créait Piccolino. Ses plus grands succès avaient été d'abord récoltés à Lyon. En 1887, il devint professeur au Conservatoire. Mme Caroline Miolan-Carvalho (Marseille, 31 décembre 1827-juillet 1895) continuait la tradition de Duprez qui avait été son maître. Ses débuts à l'Opéra-Comique s'étaient produits dans l'Ambassadrice le 29 avril 1850, à l'Opéra dans les Huguenots le 11 novembre 1868. Cinq mois plus tard (18 avril) elle y créait Faust qu'elle avait chanté précédemment au Théâtre-Lyrique. La carrière de Mme Carvalho se passa dans un incessant va-et-vient entre l'Opéra et l'Opéra-Comique. Elle n'abandonna la scène qu'en 1885. Louis Delaquerrière (24 février 1858) fit à l'Opéra-Comique son chemin comme ténor léger. Il avait été refusé au Conservatoire. Il débuta dans le Chalet, chanta, à la Monnaie, David des Maîtres Chanteurs et créa à l'Opéra-Comique le Roi malgré lui.
Christine Nilsson, comtesse de Casa-Miranda (Suède, 3 août 1843), élève de Wartel et Victor Massé, créa Ophélie d'Hamlet à l'Opéra. Taskin (Paris, 18 mars 1853), élève de Bussine et Ponchard, fit ses premières armes à Amiens dans les Mousquetaires de la Reine. A partir de 1880, il chanta à l'Opéra-Comique où il fit les créations de Jean de Nivelle, les Contes d'Hoffmann, Manon, Esclarmonde, etc...
Gabrielle-Marie Krauss qui avait suivi l'enseignement de Mme Marchesi, était née à Vienne le 24 mars 1842. Après avoir remporté maints succès dans sa ville natale et en Italie, elle se produisit à Paris, d'abord au Théâtre Italien (1868) où elle chanta Freischütz et Fidelio, puis à l'Opéra. Elle y créa Polyeucte (1878), Aïda (1880), le Tribut de Zamora (1881), Henri VIII (1883), Patrie ! (1886). Marie Van Zandt (New York, 8 octobre 1861) ne parut à Paris que le 20 mars 1880 à l'Opéra-Comique dans Mignon. Le 14 avril 1883, elle fut la créatrice de Lakmé. Son engagement fut résilié à la suite de plusieurs représentations tumultueuses de Lakmé et du Barbier. Jean-Baptiste Faure (Moulins, 15 janvier 1830) chanta à l'Opéra-Comique pour la première fois le 20 octobre 1852 dans Galathée (Pygmalion). Il doubla Battaille dans presque tous ses rôles. Le 4 avril 1859, il créa le Pardon de Ploërmel. A l'Opéra il chanta le répertoire et Pierre de Médicis. Après des séjours à Londres et en Russie, il fit sa rentrée en 1872, et resta à l'Opéra jusqu'en 1876. C'est à cette époque qu'il entreprit ses grandes tournées à l'étranger et s'orienta plutôt vers le concert et le professorat. Galli-Marié (Paris, 1840) immortalisait sa carrière, pendant son second séjour à l'Opéra-Comique, qu'elle avait une première fois quitté en 1872, par la création de Carmen (3 mars 1875). Boudouresque (La Bastide-sur-l'Hers, Ariège, 28 mai 1835), ancien employé de chemins de fer et entrepreneur d'éclairage à Marseille, puis cafetier dans cette ville, débutait, cette même année 1875, à l'Opéra, dans le rôle de Brogni de la Juive. Il chantait jusqu'en 1884 tous les grands rôles de basse. Bouhy (Pepinster, Belgique, 18 juin 1848), après avoir chanté Méphistophélès de Faust à l'Opéra, créait Carmen à l'Opéra-Comique, Paul et Virginie au Théâtre-Lyrique (1878), Samson et Dalila à l'Eden-Théâtre (1890). Nicolas Bouvet, né à Liège, ayant débuté dans le rôle de Figaro à l'Opéra-Comique, le 8 novembre 1884, allait être de toutes les créations de ce théâtre depuis le Chevalier Jean, Maître Ambroise, le Roi malgré lui, jusqu'au Roi d'Ys, le Rêve, l'Attaque du moulin et même Werther et la Navarraise. Mme Isaac-Lelong (Calais, 8 janvier 1854) élève de Duprez créait les Contes d'Hoffmann, Egmont et le Roi malgré lui. Capoul (27 février 1835), vieux chêne altier abattu seulement il y a deux ans, Marie Roze (2 mars 1846), Melchissédec (7 mai 1843), Victor Maurel (11 juin 1848), Engel (15 février 1847), Gailhard (Toulouse, 1er août 1848) appartenaient ensemble à cette charmante époque — époque héroïque ! — où le Premier jour de bonheur voisinait avec Paul et Virginie et Zampa, avant que Falstaff ne prolongeât et ne renouvelât la tradition de l'Opéra-Comique.
Il y avait encore Mme Fides-Devriès (Nouvelle-Orléans, 22 avril 1852) : création de Lohengrin à l'Eden, 3 mai 1887, Dereims (Montpellier, 26 avril 1846) ténor de répertoire, créateur d'Henri VIII, Escalaïs (Cuxac d'Aude, 9 août 1861) élève d'Obin, pilier du répertoire meyerbeerien, Sigurd, Guillaume et Samson de haute envolée (si l'on ose dire en évoquant Escalaïs !), Madame Lureau-Escalaïs (Montreuil-sous-Bois, 24 février 1863), créatrice du Mage, la basse Fournets (Pau, 2 décembre 1858) : créations le Roi d'Ys et Samson et Dalila ; Jérôme (Monplaisir, Rhône, 5 avril 1860), créateur d'Esclarmonde et de l'Attaque du Moulin ; Nicot (Mulhouse, 1843) qui, après sa rentrée à l'Opéra-Comique en 1875, créait les Amoureux de Catherine, les Surprises de l'Amour, l'Amour Médecin, Suzanne, la Taverne des Trabans, jusqu'en 1883 ; Mme Molé-Truffier (Paris, 1861) ; Plançon (Fumay, Ardennes, 12 juin 1854), créateur de Cinq-Mars, d'Etienne-Marcel, du Cid, d'Ascanio ; Cécile Ritter (Paris, 1860) créatrice du rôle de Virginie dans l'ouvrage de Victor Massé ; les deux frères : Edouard de Reszké (Varsovie, 1856) créateur d'Aïda en Italie, du Cid et de Patrie ! à l'Opéra, et Jean de Reszké (Varsovie, 1853) qui créa Jean dans Hérodiade (30 janvier 1884), la Dame de Monsoreau (1888) et le Cid avec son frère en 1885. Marguerite Vaillant-Couturier (Paris, 1860) qui, au début de sa carrière, inaugurant la tradition révolutionnaire de sa postérité, entra en conflit avec le Ministre des Beaux-Arts et fut condamnée à 20.000 francs de dommages-intérêts pour avoir débuté à la Monnaie de Bruxelles dans Mireille et n'être pas restée à la disposition des subventionnés français après avoir obtenu un triple 1er prix au Conservatoire. Marguerite Ugalde (Paris, 1862) élève de sa mère, créatrice de Nicklausse des Contes d'Hoffmann et interprète fêtée d'opérette ; Ada Adiny (Boston, 1863), Charlotte-Marie Agussol (Toulon, Var, 29 novembre 1863) toutes deux pensionnaires de l'Opéra, Mme Rosa Bosman, née à Bruxelles, créatrice de Patrie !, du Cid, d'Ascanio, de Stratonice. Emma Calvé (1864) élève de Marchesi et de Puget, créait Aben Hamet au Théâtre Italien (1884), le Chevalier Jean (1885) à l'Opéra-Comique puis Cavalleria rusticana (1892) et la Navarraise. Mme Carrère-Xanrof (Bordeaux, 1869) débutait en mai 1892 à l'Opéra dans le rôle de Marguerite de Faust et chantait tout le répertoire du soprano léger.
Ernest Carbonne (Touloupe, 30 juillet 1866) commençait par le rôle de Sylvain des Dragons de Villars la carrière la plus laborieuse qu'il allait terminer comme régisseur de l'Opéra-Comique. Il avait créé des rôles dans la Basoche, Benvenuto, les Folies Amoureuses, etc... Mlle Auguez (Amiens, 29 mars 1868) après un stage d'opéra s'orientait avec succès vers l'opérette. Mme Chrétien-Vaguet (8 mars 1872) passait en 1893 de la Monnaie de Bruxelles à l'Opéra. Alfred-Auguste Giraudet poursuivait jusqu'en 1893, une carrière commencée en 1866. Il était né le 28 mars 1848 à Etampes. Lassalle (Lyon, 1847) chantait tour à tour à l'Opéra (1872), à Ventadour (1874), à la Gaîté (1876) puis rentrait à l'Opéra après le départ de Faure et créait le Roi de Lahore, Henri VIII, Patrie !, Ascanio.
En 1885, débutait à l'Opéra Mme Melba, née à Melbourne, qui chantait successivement Roméo et Juliette, Lucie, Faust, Hamlet. Cécile Simonnet (Lille, 4 mars 1863) avait remplacé dans Lakmé Van Zandt après le départ de celle-ci. Elle créait Rozenn du Roi d'Ys et Angélique du Rêve. Albert Vaguet (Elbeuf, 16 juin 1865) après avoir chanté la Favorite, Robert le Diable, Salammbô et Patrie !, créait Gwendoline, la Vie du Poète, Othello, et Tannhäuser. Blanche Deschamps-Jehin (18 septembre 1859) créait le Roi d'Ys à l'Opéra-Comique, Samson et Dalila et la Walkyrie à l'Opéra. Cossira (Orthez, 1857) après avoir gravi les échelons normaux du répertoire, créait à la Monnaie Tristan et s'inscrivait à côté de l'incomparable Isolde, Felia Litvinne, élève de Mme Viardot, et de Victor Maurel, au même titre que le grand Van Dyck, comme l'un des plus grands noms de l'interprétation wagnérienne. Celle-ci a réuni dans nos théâtres ces dernières années Alvarez (débuts à l'Opéra en 1892), Delmas (Lyon, 11 avril 1861), Etienne Gibert (Jonquières, 3 décembre 1859), Imbart de la Tour (Paris, 26 mai 1865), Jean Noté (6 mai 1860), Gresse (22 juillet 1845), Maurice Renaud (Bordeaux, 1826), Albert Saléza (Bruges, Basses-Pyrénées, 18 octobre 1867), Affre (Saint‑Chirian, Hérault, 21 octobre 1858), Hippolyte Mondaud (Bordeaux, 1864), Balbous Riddez (La Bassée, 1875), Rousselière (17 janvier 1875), Fabert, Lucienne Bréval (9 décembre 1807), Rose Caron (17 novembre 1857), Louise Grandjean (27 septembre 1870), Myriam Héglon, Jane Hatto (30 janvier 1879), Jeanne Raunay, Marius Chambon (31 mai 1864), Mme Lucy Isnardon, Charlotte Lormont, etc...
A l'heure actuelle, Franz, Marcel Journet, Gresse le fils, Yvonne Gall, Lapeyrette apparaissent comme les héritiers et les solides gardiens du grand style wagnérien. Un Muratore, avec ses moyens admirables, pouvait, s'il l'eût voulu, recueillir lui aussi ce style ainsi que la succession de ces rôles héroïques. Il a donné ses préférences au répertoire d'Opéra-Comique dans lequel il n'a, d'ailleurs, pas remporté de négligeables succès. De ce côté de la barricade nous avons vu des artistes comme Bilbault-Vauchelet et Bréjean-Gravière, Delna et Merguillier, Charlotte Wyns et Ackté, Lise Landouzy, Guiraudon, Alquié, Marié de Lisle, Jane Marignan, Marie Delorn, Pierron, Tiphaine, Cécile Eyreams, Aline Vallandri, Alice Raveau et leurs camarades masculins Mouliérat, Belhomme, Jacques Isnardon (dont la carrière est restée longtemps hésitante entre l'Opéra et l'Opéra-Comique), Maréchal, Julien Leprestre, Talazac, Salignac, Allard, Clément, l'un des rares ténors qui ait su allier au culte de son organe le respect de la musique et ménager assez judicieusement ses forces pour conserver dans sa demi-retraite des moyens intacts ; Rothier, Azéma, Beyle, Albers, Bourbon, le regretté Soulacroix, Dupré, Lapelletrie, Francell, Ch. Fontaine, Marcellin, David Devriès, Ansseau, Allard, Vigneau : tous ont honoré la troupe et le répertoire de l'Opéra-Comique.

Mademoiselle Léonec (photo Manuel frères)
Beaucoup ont disparu. Plusieurs restent encore sur la brèche. Parmi ceux-ci on distingue toujours, comme on l'apercevait parmi leurs devanciers, la silhouette tutélaire et cordiale du doyen Fugère (Paris, 22 juillet 1848) dont l'admirable carrière commencée aux Bouffes en 1874, s'est poursuivie presque sans interruption à l'Opéra-Comique depuis 1877.
A soixante-douze ans, Lucien Fugère offre encore à ceux qui l'écoutent, au public comme à ses jeunes camarades, une perpétuelle leçon de chant. Il leur montre comment il est possible que le chant, dans ce qu'il a de plus noble et de plus émouvant, survive à la voix même par le secret d'une diction totalement épurée et par les ressources d'une musicalité très sûre. Un Fugère, témoin d'une époque musicale fort lointaine, a assisté sans s'insurger et sans s'étonner à l'évolution et à la succession des choses et des gens. Là est la sagesse.
La création de Thaïs (1884) à l'Opéra-Comique (1889, 1893) avait mis sur le piédestal Sybil Sanderson. La création de Louise (2 février 1900) marquait les débuts de Marthe Rioton (18 février 1878) : 22 ans, la cantatrice ce jour-là avait l'âge du rôle ! Pelléas et Mélisande trois ans plus tard réunissait ce magnifique quatuor composé de Mary Garden, de Dufranne, de Jean Périer et de Vieuille. La création du Chemineau consacrait Mme Frichet, celle de la Habanera Mlle Hélène Demellier. Mme Marguerite Carré, qui a remporté tant de succès dans des ouvrages du répertoire, s'est plutôt classée par la belle création qu'elle faisait d'une œuvre comme la Lépreuse, Mlle Chenal par ses incarnations si diverses d'Angélique du Rêve et de Chrysis dans Aphrodite. Les plus jeunes chanteurs de ces quinze dernières années, Marthe Davelli, G. Vix, Mathieu-Lütz, Nicot-Vauchelet, Germaine Lubin, la pauvre Vorska, Mad. Mathieu vérifiaient l'exactitude de ce principe. Depuis la guerre Mme Yvonne Brothier et M. Charles Friant, deux des chanteurs les plus populaires de l'Opéra-Comique ont accumulé les créations à leur actif et souvent dans des rôles dont l'écriture soumettait leur tessiture à un rude exercice. On peut d'ailleurs avoir confiance dans l'avenir de la jeune troupe de l'Opéra-Comique. Celle-ci, en effet, si un Baugé l'a abandonnée pour suivre dans l'opérette les traces de sa charmante mère, Mme Tariol-Baugé, de Rosalia Lambrecht, d'Anne-Marie Judic, de Théo, et de sa gracieuse camarade Edmée Favart, compte des éléments sains et robustes, qui ont déjà commencé de tenir leurs promesses : Suzanne Balguerie, vibrante interprète d'Ariane et Barbe-Bleue et de Pénélope, Madeleine Sibille, Hubert Audoin, Roger Bourdin et beaucoup d'autres.
Certains éléments étrangers comme Mme Fanny Heldy et M. Huberty, tous deux belges, ou M. Vanni-Marcoux, italien, renforcent le prestige des troupes de nos théâtres lyriques, ainsi que jadis — avant la guerre — un Chaliapine et un Titta Ruffo.

Madame Jane Bathori (photo Arroyo)
Enfin, il serait injuste de ne pas faire l'éloge de quelques chanteuses qui mènent, dans le domaine du Concert comme dans celui du théâtre, le bon combat en faveur de la mélodie et du chant pur : Mmes Ninon Vallin, Ritter-Ciampi, Claire Croiza, Bathori, Lucy Vuillemin, Gabrielle Gills, Madeleine Caron, Gabrielle Paulet, Panzéra, etc...
Nous déplorions plus haut le divorce trop fréquent du chant et de la musique. Ces artistes travaillent à les rapprocher. Les succès qu'ils remportent et les émules qu'ils suscitent témoignent d'un retour certain au goût de la musique essentiellement française, harmonieusement concrétisée aujourd'hui dans l'œuvre vocale de Fauré et Debussy.
***
Le domaine vocal a déjà été largement exploré dans les chapitres sur les théâtres lyriques. Nous n'y sommes revenu nous-mêmes que pour compléter, par cette dernière et rapide esquisse, le tableau de l'interprétation au cours du demi-siècle passé. Cet aperçu se borne presque à une sèche énumération. Encore celle-ci n'est-elle pas limitative, puisque, laissant délibérément de côté nombre de jeunes chanteurs, espoirs en graine, nous n'avons même pas nommé Maints artistes de poids, comme, par exemple, un Trantoul, qui ténorisa fréquemment avec succès sur la scène de nos subventionnés, ou une Madeleine Caron qui se fit souventes fois remarquer dans les mêmes lieux, voire au concert, chantant ici Charlotte de Werther, la Mère de Louise, Carmen, Fricka, et là, en première audition des œuvres de compositeurs contemporains. Nous avons encore passé sous silence jusqu'à un Lafont, l'éminent partenaire de cette cantatrice dans le Père de Louise, l'inoubliable Coppélius des Contes d'Hoffmann, créateur par surcroît de la plupart des grands rôles des œuvres montées ces dernières années, salle Favart — la Rôtisserie de la Reine Pédauque ; Quand la cloche sonnera ; le Hulla ; la Forêt bleue, etc...
Dans le présent fascicule dont les pages nous ont d'ailleurs été mesurées, le travail sur le chant français n'est donc qu'ébauché : l'ouvrage complet, circonstancié, reste à écrire. Mais la liste déjà si longue qui précède prouve que le chant français n'est pas dans l'état lamentable où d'aucuns se plaisent à le peindre. De ce côté, tout n'est certes pas parfait. On pourrait faire mieux, beaucoup mieux. L'enseignement officiel a, pour sa part, souvent mérité une bonne moitié des véhémentes critiques qui lui furent adressées. Il n'en demeure pas moins certain qu'en face de divers étrangers qui exploitent sans vergogne la pseudo-supériorité de nos rivaux et ravalent avec une rare malice notre école vocale, il suffit de faire l'appel des innombrables artistes français que nous venons de citer pour discréditer des moyens de propagande aussi puérils.
Dût la nomenclature à laquelle nous avons procédé n'atteindre encore que ce résultat, le temps employé pour l'établir n'aurait pas été dépensé en vain.
On ne saurait mener à bien un travail de documentation comme celui qu'exigeait l'étude de l'interprétation des Cinquante Ans de Musique Française sans puiser à toutes les sources, abondantes et curieuses, qu'offre au chercheur la bibliographie musicale. C'est ici pour nous un devoir agréable de louer notamment, comme ils le méritent, des ouvrages tels que les livres de Marmontel sur les musiciens et particulièrement les pianistes, celui de Maurice Clerjot sur le violon, le dictionnaire musical de Bisson et Lajarte, la considérable étude consacrée au Conservatoire par Constant Pierre, ou l'histoire de la Société des Concerts brossée par notre ami A. Dandelot. Mais nous devons surtout exprimer à M. Jean Gandrey-Rety toute notre reconnaissance pour la précieuse collaboration qu'il a bien voulu nous prêter incessamment.
Raymond CHARPENTIER.

Félix Vallotton : la Flûte