
Cinquante ans de musique française (1874 - 1925)

Henri Matisse : la Leçon de piano, Henriette et ses frères (1923)
MUSIQUE DE CHAMBRE ET PIANO
par Pierre HERMANT
On a souvent reproché aux compositeurs de notre pays d'avoir une tendance naturelle à s'occuper davantage de musique de théâtre que de symphonie ou de musique de chambre. Ce reproche se trouve, en effet, souvent fondé et particulièrement au milieu du XIXe siècle — d'où vint la réaction à laquelle on a assisté depuis un peu plus de cinquante ans et qui détermina, dans le sens de la musique pure, un mouvement très généralisé et accentué.
Il ne faudrait pas en conclure cependant que la préoccupation en est nouvelle et n'exista jamais jusque-là en France. Il suffit de rappeler les pièces de clavecin — seul ou en concerts — de Jean-Philippe Rameau (1683-1764) — celles aussi de François Couperin, dit le Grand (1668-1733), dont le style fut pris quelquefois comme modèle par J.-S. Bach, dans sa jeunesse.
Au milieu du XVIIIe siècle, François-Joseph Gossec (1724-1829) — qui devait être, par la suite, le compositeur quasi officiel de la République et se faire connaître par les hymnes et les chants qu'il conçut pour ses fêtes patriotiques — écrivait son premier quatuor à cordes, précédant en cela J. Haydn lui-même, comme il l'avait précédé de cinq années pour la composition de sa première symphonie (1754). Grétry (1741-1813) composa, également avant Haydn, plusieurs quatuors et sonates, ainsi d'ailleurs que des symphonies : l'évolution musicale amenait par là, et conjointement dans les deux pays, la création des formes nouvelles.
Mais c'est seulement en Allemagne que ces formes devaient d'abord, comme chacun sait, se développer et donner lieu à d'impérissables chefs-d’œuvre — et tandis que Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann y consacraient leurs magnifiques imaginations, le génie français ne s'y essayait, à la vérité, que rarement ou, surtout, ne produisait que des ouvrages dont le médiocre intérêt a motivé depuis le complet et légitime oubli. Ce n'est pas qu'il n'y ait eu, même au début du XIXe siècle, quelques adeptes convaincus du genre naissant qui nous occupe — si l'on en juge, tout au moins, par le nombre imposant de leurs œuvres. Témoin Onslow (1784-1852), membre de l'Académie des Beaux-Arts, qui ne produisit pas moins de trente-quatre quintettes... Témoin Reber (1807-1880), membre aussi de l'Institut (il devait laisser son fauteuil à C. Saint-Saëns) qui, à côté d'opéras-comiques, écrivit un assez grand nombre d'œuvres de musique de chambre.
De célèbres exécutants s'assemblaient dans le même temps en quatuors, le réputé violoniste Baillot (1771-1842), son gendre Eugène Sauzay (1809), qui s'appliquèrent à faire connaître les œuvres de Haydn, Mozart, Beethoven, y compris les derniers quatuors du maître de Bonn — pour lesquels Sauzay écrivait, en 1861, un essai et un catalogue thématique — les violoncellistes Duport, Franchomme, le violoniste Alard, etc...
Il y avait, à cette époque, une véritable hardiesse à jouer les dernières œuvres de Beethoven, que la plupart trouvaient incompréhensibles ou même confinant à la folie. Il en fallut longtemps encore après, puisque, vers 1886, Alb. Magnard disait qu'il était nécessaire, pour les entendre, d'aller en Allemagne, et que, vers 1893, c'était presque un événement que d'assister à des auditions comme celles organisées à l'Institut Rudy par le quatuor Geloso, Tracol, Monteux, Schneklüd — séances religieusement suivies par les jeunes d'alors qui portaient nom entre autres : A. Magnard, P. Dukas... C. Chevillard, dont on ne soupçonnait pas la future carrière de chef d'orchestre, y prenait de temps en temps part comme pianiste.
Les compositions importantes de musique de chambre, qui seules nous soient restées, ont donc été rares ou peu marquantes, en France, jusque tout au moins en 1842, où nous notons les quatre trios de C. Franck, le maître de Liège, que nous aurons à étudier par la suite comme auteur de modèles inoubliables. Puis, avant 1865, d'intéressantes productions d'Ed. Lalo. Enfin, avant 1874, le quintette, le trio en fa et la première sonate pour violoncelle de C. Saint-Saëns. Toutes ces œuvres se trouvent, comme on le voit, signées de noms fort proches de nous — et qui, en réalité, sont ceux des premiers musiciens français ayant réussi à donner de puissantes et originales productions de musique de chambre. Il convient de saluer ici ces premiers ancêtres qui ont montré, dans des temps héroïques et difficiles, la route depuis à tant d'autres et solidement posé les fondations de notre école moderne. C'est grâce à eux qu'elle a pu s'établir, se développer et aboutir à cette extraordinaire efflorescence qui en fait maintenant, sans doute, la principale école de musique européenne.
***
Il y a un peu plus de cinquante ans un effort fut définitivement tenté pour développer parmi nous la production de la musique de chambre. Ce fut celui des fondateurs de la Société Nationale, en 1871. Jusque-là, et comme nous venons de l'indiquer, les tentatives avaient été éparses et sans grands liens. Un noyau de disciples cependant, dans les quelques années qui précèdent, s'était groupé autour de C. Franck, dès avant la nomination de ce dernier au poste de professeur d'orgue au Conservatoire (1872) : Arthur Coquard, Alb. Cahen et Henri Duparc, puis Alexis de Castillon — ensuite (à partir de 1872) V. d'Indy, A. Holmès, E. Chausson — plus tard P. de Bréville, L. de Serres, G. Ropartz, Ch. Bordes — enfin G. Lekeu — qui furent les élèves, les fils de celui qu'on a dénommé si justement le Père Franck.
Quant à Saint-Saëns, très indépendant et désireux de conserver une liberté lui permettant de voyager à sa fantaisie — de quitter la place impromptu, fût-ce à la première exécution d'un de ses opéras, pour s'évader aux Iles — il n'a guère formé réellement que deux élèves : MM. G. Fauré et A. Messager. Il n'a pas souhaité, semble-t-il, constituer un groupe, établir une véritable école, ainsi que cela s'est passé pour C. Franck et ensuite pour M. V. d'Indy qui, lui, a estimé, plus que tout autre, que ce devait être un des buts, un des devoirs de sa vie — devoir qui, par la suite, a donné naissance, sous son impulsion et celle de Ch. Bordes, à un nouveau Conservatoire indépendant et de tendances nettement particulières : la Schola Cantorum (1900), où l'on cultive de préférence la musique pure, abandonnant les études plus théâtrales à l'ancien Conservatoire officiel.
Tous ces musiciens contribuèrent plus ou moins à l'institution de la Société Nationale, dont A. de Castillon, en qualité de secrétaire, rédigeait les statuts.

Henri de Toulouse-Lautrec : le Piano
Il faut noter également parmi eux — car il était très lié avec la plupart — Em. Chabrier, qui devait avoir, dans un avenir éloigné, une action considérable sur notre musique en général et notamment sur celle de piano.
D'autres apparaissent dès l'origine, et on peut constater par la lecture des programmes du début, des premières auditions d’œuvres de MM. Th. Dubois, Widor — de Bizet, Massenet, Chauvet, Guiraud, Bourgault-Ducoudray.
Mais c'est à Saint-Saëns que revient véritablement l'honneur de la fondation, ainsi qu'à R. Bussine, professeur de chant au Conservatoire. Des concerts réguliers furent donnés depuis le 17 novembre 1871 (en tête de la première séance : le trio en si bémol de Franck, exécuté par Garcin, Jacquard et l'auteur) — les programmes de ces séances étaient d'abord écrits à la main... Puis l'importance et l'influence s'augmentant, toute une série de jeunes musiciens — toujours plus nombreux — encouragés, il semble, par la perspective de voir leurs productions exécutées et goûtées d'un public sympathisant avec eux, s'éprirent du désir d'écrire des œuvres de musique pure et de s'essayer dans un genre élevé, loin du théâtre, de son faux brillant et de ses mécomptes.
Cependant, au bout de quelques années (1881), l'autorité de Franck ayant considérablement grandi, son ascendant sur ses élèves, sur le mouvement musical français, étant apparu au premier plan, Saint-Saëns commença à se désintéresser de l'œuvre qu'il avait créée. Au début, seuls les ouvrages des compositeurs vivants de notre pays devaient alimenter les programmes. M. d'Indy ayant proposé que l'on y adjoignit ceux des classiques et des étrangers, et cette proposition ayant été adoptée, R. Bussine et Saint-Saëns donnèrent leur démission, Franck devint président, M. d'Indy, secrétaire — puis, à la mort de Franck, président à son tour avec, comme successeur au secrétariat, M. de Bréville.
Depuis, les tendances s'étant diversifiées, d'autres mouvements s'étant manifestés — sous l'impulsion surtout de M. Fauré et de Debussy — une scission se produisit parmi les compositeurs français et donna lieu à une nouvelle société : la Société musicale indépendante qui fut fondée, en 1909, sous la présidence de M. G. Fauré.
***
Si l'on recherche quelles sont les diverses influences qui ont contribué à la formation du style des musiciens devant servir, pour ainsi dire, de piliers à notre école moderne, si en déclin par ailleurs depuis la fin du XVIIIe siècle — à part H. Berlioz, qui ne fut pas précisément un adepte de la musique dite « pure » — ces influences s'étant trouvées forcément allemandes, puisque la musique pure moderne s'était, jusqu'alors, développée en Allemagne seulement (depuis ce qu'on peut appeler sa création par J. Haydn), on doit constater que C. Franck dérivait, du moins à beaucoup de points de vue, de Beethoven ; Ed. Lalo se rapprochait davantage des romantiques, surtout de Schumann ; Saint-Saëns semble un descendant quasi direct de Mendelssohn — et Chabrier, dont nous avons à nous occuper ici au point de vue du piano, se trouve être une sorte d'intermédiaire entre R. Wagner et la future jeune école française des premières années du XXe siècle. Il en fut, comme nous le verrons plus loin, une sorte de Philippe Emmanuel, semeur généreux et très inconscient de toutes les nouveautés extraordinaires et inattendues qui devaient germer grâce à lui, plus tard, pour notre joie, chez un Cl. Debussy ou un M. Ravel. Sa personnalité qui, de prime abord, a pu sembler moins importante que celle d'un Franck ou d'un Saint-Saëns, était ainsi destinée — avec celle de M. G. Fauré — à favoriser la naissance de l'évolution qui a définitivement libéré notre école, sinon de toute influence étrangère, du moins de l'influence allemande, et permis son épanouissement propre.
Il semble qu'au début C. Franck ait été appelé à une sorte de mission d'épuration et d'assainissement du style français, embourbé au milieu du XIXe siècle dans des marécages singulièrement vaseux. Déjà Ch. Gounod avait réagi contre les productions des Meyerbeer et des Halévy, contre les mélanges sans nom des mauvais sous-Weber ou d'italianismes pires encore. Mais, son activité s'étant donné carrière au théâtre, il n'a pas trait à cette étude et resta d'ailleurs fort frelaté. Il était réservé à Franck d'être l'apôtre, d'honnêteté et de pureté, qui sût faire choix des matériaux, les ordonner, les cimenter et tenter de nouvelles architectures, dérivées très directement, certes, des architectures allemandes, mais cherchant à atteindre, par leur vie propre, un idéal d'une grande et particulière noblesse. Ses élèves sont restés, avec des tempéraments divers, dans la voie qu'il avait tracée. L'un d'entre eux, M. V. d'Indy, doué d'une personnalité plus forte, et subissant en même temps l'action d'autres ascendances — Berlioz, Wagner, les romantiques allemands — a continué son œuvre, en la modifiant assez profondément, dans une direction qu'il est permis de juger différemment et, formant à son tour école, l'a menée à un épanouissement trop parfait peut-être et qui aurait en tous cas besoin de recevoir à nouveau les bienfaisants effluves de la vie.
Ce n'est pas ici le lieu d'apprécier la manière dont s'est fait sentir chez Franck et ses disciples l'influence beethovenienne, et nous comptons y revenir par la suite de ce travail.
L'influence schumannienne qui a touché — d'ailleurs d'assez loin — Ed. Lalo s'est présentée depuis chez de nombreux compositeurs et d'une façon moins définie que l'influence beethovenienne, sans doute parce que d'un caractère moins général que celle de Beethoven.
Celle de Mendelssohn est, chez C. Saint-Saëns, plutôt une certaine parenté de tempérament qu'une influence d'école. Lalo n'a pas laissé de postérité bien directe. Quant à Saint-Saëns, fort isolé lui aussi, on doit tout au plus dire qu'il a, en tant qu'aîné, contribué à l'établissement du style de M. Fauré, mais la filiation, qui peut s'établir entre ces deux maîtres et leur ancêtre Mendelssohn, est bien plus en profondeur qu'en surface, bien plus en esprit que dans les arrangements sonores, et M. Fauré est aussi éloigné en apparence de Saint-Saëns que M. Ravel, élève de M. Fauré, et troisième terme de cette descendance, est assurément distant de son maître.
Il n'est pas niable pourtant, pour celui qui cherche à mettre un ordre, à établir des groupements dans les directives de nos musiciens, que l'on peut dire : il y a d'une part C. Franck, ses disciples, M. d'Indy et ses descendants — d'autre part une école, ou, si l'on veut, une tendance, beaucoup moins nette à la vérité, mais commune à ces esprits si divers : C. Saint-Saëns, M. G. Fauré, M. M. Ravel — auxquels il convient naturellement d'adjoindre les élèves directs de M. Fauré, que leur originalité moindre a laissés davantage soumis à l'ambiance de leur maître. J'étudierai par la suite la haute personnalité de M. G. Fauré, à qui il est au demeurant fort difficile de fixer des antécédents, mais que l'on peut considérer bien plus, à l'évidence, que C. Saint-Saëns, comme le premier musicien véritablement français des cinquante dernières années.
De même que M. d'Indy a renouvelé l'école de Franck par l'adjonction d'influences que Franck n'avait pas subies, de même M. Ravel n'a pu renouveler celle de M. Fauré qu'à la suite de l'apparition d'une autre personnalité, celle de Cl. Debussy.
C. Franck et ses élèves, puristes que l'on pourrait appeler les Parnassiens du mouvement musical, aboutissant à une sorte de scientisme sous l'action de M. d'Indy — M. Fauré, resté très classique de forme, mais avec une orientation vers le chatoiement, la joie des amalgames sonores, pris pour eux-mêmes dans une sorte d'indifférence extasiée, le plus loin possible de l'humanité — entrave à l'épanouissement divin de la musique — une troisième école devait venir qui, décidément, coupe les attaches liant encore la musique française et la musique allemande. C'est celle qui a pris naissance avec Cl. Debussy.
Des influences diverses et aussi complexes que l'art auquel il a donné naissance : musicales, poétiques, picturales, influences qui, passant par dessus l'Allemagne, vont chercher des éléments de régénération dans l'école russe, principalement chez Moussorgski — qui, se laissant attirer par l'Extrême-Orient même, ne sont pas étrangères au japonisme, aussi à ces danseuses javanaises qui furent la joie de Paris à l'Exposition Universelle de 1889 — des désirs de faire participer la musique aux théories picturales de l'impressionnisme — bien d'autres antécédents encore (Em. Chabrier notamment) présidèrent à la formation du génial créateur de Pelléas et Mélisande, des Nocturnes, du Quatuor — et à l'adresse unique du metteur en œuvre de ses théories propres dans ses nombreuses compositions pour piano.
Après les puristes et les classiques mendelssohniens, nous trouvons en lui le fondateur d'une sorte d'impressionnisme en musique. Ce qu'on pourrait appeler sans exagération sa réforme du style français a rencontré de nombreux adeptes qui le suivirent avec conviction, jusqu'au jour où la lassitude du vague et de l'imprécision a amené, comme cela devait avoir lieu fatalement, une réaction. Et, ces dernières années, a apparu un nouveau mouvement qui recherche, par contre, la précision, la netteté, tout en essayant de pousser plus loin encore que Debussy les recherches de tonalité. Après le chromatisme romantique, venu d'Allemagne, après ce que Wagner — par ironie pour lui-même — avait appelé : « l'orgie dégoûtante des modulations modernes » — mais qui, tout au moins, participait de tonalités nettement définies, Debussy avait évolué vers l’imprécision tonale. Les jeunes musiciens actuels, par une surenchère, aboutissent à la superposition, à la simultanéité de tonalités différentes.
***
Tels semblent être, en un aperçu très succinct et synthétique, la genèse, l'évolution, les aboutissements du mouvement très important qui s'est établi en France depuis environ un demi-siècle. De toutes ces tendances, musicalement si intéressantes, tant en ce qui concerne l'architecture de la mélodie — je l'entends non seulement pour C. Franck mais aussi pour Cl. Debussy, dont nous verrons plus tard que c'est l'intérêt maître —qu'en ce qui a trait à l'architecture harmonique et tonale. le moins qu'on en puisse dire c'est qu'elles constituent un effort d'une diversité et d'une puissance qui ne le cèdent en rien aux meilleures périodes du passé.
Il y a cependant un point de vue qui avait été estimé jusque là comme le principal, notamment en Allemagne, à la fin du XVIIIe siècle — je veux dire le point de vue de l'humanité — qui est passé chez la plupart de nos musiciens — beaucoup moins chez Franck, et Debussy, en tous cas, excepté — au second plan. Presque tous ont eu, en général, l'ardente préoccupation d'être des spécialistes. Ils ont compris la musique, en tant que forme, comme devant être le but unique de leurs efforts. Ils n'ont pas voulu apercevoir qu'elle était non un but, mais un moyen — et, qu'au demeurant, quelque attrait de surface que puisse avoir telle ou telle œuvre, la valeur sensible de l'homme qui établit ces architectures, ces joyaux ou ces prestidigitations reste toujours plus à considérer que les productions mêmes et, en dernière analyse, seule à retenir. Chez Haydn, de même que chez Mozart ou chez Beethoven, ou depuis chez Schumann — et auparavant de même chez J.-S. Bach — le jeu des sonorités était nettement dépendant de l'état d'âme de l'auteur au moment où il composait et sa recherche principale était d'exprimer cet état d'âme. Chez eux la musique servait, elle ne dominait pas. Elle n'était, suivant en cela un ordre supérieur, qu'un moyen, un truchement employé par un homme comme les autres, quoique musicien — et je crois que les noms cités plus haut sont ceux de grands et purs musiciens — pour confier à un autre homme, l'auditeur, le secret de sa force ou de ses angoisses, de ses joies ou de ses douleurs — toute la gamme, en un mot, des sentiments qu'il éprouvait, que nous sommes susceptibles d'éprouver nous-mêmes, mais que seul il savait exprimer avec cette clarté, cette intensité. En même temps que nous jouissons, à l'audition de leurs œuvres, d'une pure satisfaction dérivée de la magnificence de leurs architectures, de l'éclat ou des nuances de leurs harmonies, du rythme génial de leurs conceptions, en même temps ils ne croyaient pas que ces beautés pures et froides devaient se contenter d'exister seules et sans but — quasi entre ciel et terre. C'était un langage qu'ils parlaient, langage que l'on peut considérer en soi, mais qui n'a pas en soi sa fin. Et cette fin c'était de traduire d'abord des sentiments, des émotions humaines. On ne peut venir dire que les temps sont changés : il y a des choses qui ne peuvent changer.
Faudrait-il croire, d'autre part, qu'il y aurait là une conception particulière, française, de l'art musical, s'opposant à celle des Allemands, par conséquence des qualités propres de notre race ? L'élégance, le raffinement, l'esprit, l'ironie ou — aussi bien — l'équilibre, la raison ne peuvent nous faire dénier cependant par ailleurs le mouvement, la passion et l'enthousiasme. Et quelques-uns de nos musiciens, tout en restant bien français, ont eu ces dernières qualités : Berlioz, et, combien loin de Berlioz, Debussy — qui, dans plusieurs de ses œuvres, a su trouver des accents traversant la surface d'un merveilleux décor pour atteindre le fond bouleversant des émotions humaines.
Racine a dit dans la préface de Bérénice : « La principale règle est de plaire et de toucher : toutes les autres ne sont faites que pour parvenir à cette première... ».
Blaise Pascal a dit aussi, dans une pensée qu'il serait bon sans doute de méditer : « Quand on rencontre une fois le style naturel, on est étonné et ravi : on croyait trouver un auteur et on trouve un homme ».
CÉSAR FRANCK. — César-Auguste Franck est né à Liège le 10 décembre 1822. Il peut sembler au premier abord étonnant de faire figurer dans un travail sur la musique française un auteur né en dehors de nos frontières — et qui ne fut naturalisé qu'à l'âge de cinquante ans. Mais outre qu'il a toujours été français de cœur, sa vie presque entière s'est écoulée en France, sa culture est française — il fit ses études au Conservatoire — et son action sur nos musiciens a été tout à fait directe et puissante, tant par son œuvre que par ses leçons. Il convient néanmoins de dire que, très certainement, sa personnalité est restée bien de son pays de naissance — peu éloigné, il est vrai, de nos provinces du Nord, de même langue, — et beaucoup moins différente de celle d'un habitant de Lille ou de Tourcoing que ceux-ci peuvent l'être d'hommes du Midi. Il serait cependant bien inexact de croire qu'une signature au bas d'un acte de l'état civil est plus force que les origines et les atavismes.
Ayant commencé de bonne heure à s'occuper de musique sur l'exigence de son père qui désirait que ses deux fils fussent musiciens, il entreprenait, à l'âge de onze ans, une tournée de virtuose pianiste en Belgique. Mais, dès l'année suivante (1835) Franck venait à Paris et commençait des études sérieuses de contrepoint, fugue et composition avec Reicha, qui lui donnait des leçons particulières. A la disparition de son professeur, en 1837, il entra au Conservatoire — classes de Leborne, pour la composition, et de Zimmermann, pour le piano — et emporta, dans cet établissement, une série de hautes récompenses : grand prix d'honneur de piano, prix de fugue, 2e prix d'orgue. A ce moment son père, trouvant qu'il avait fait des études suffisantes, ne le laissa pas concourir pour Rome et l'obligea à reprendre la carrière de virtuose : il espérait sans doute pour son fils les succès retentissants et rémunérateurs d'un Liszt ou tel autre virtuose du clavier. Il fut dans le même temps astreint à écrire une série de pièces pour piano (1842) qu'il fit alterner avec la composition des trios dont nous avons déjà parlé. Ces travaux l'occupèrent deux ans, puis il rentra à Paris, qu'il ne devait plus quitter, et, à partir de ce moment, élabora diverses œuvres dont nous n'avons pas à nous occuper ici : un oratorio, Ruth (1846) ; un opéra, le Valet de ferme (1852) qui ne vit jamais les feux de la rampe C'est ce qu'on a appelé la première période, la première manière de son style, fort influencé alors de Beethoven, Liszt, Méhul et les musiciens français de la fin du XVIIIe siècle. Entre temps, Franck était devenu organiste de Saint-Jean-Saint-François au Marais, puis maître de chapelle de Sainte-Clotilde, et enfin organiste du grand orgue de cette église, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort et où il put s'adonner avec joie à ses dons d'extraordinaire improvisateur.
La deuxième époque de sa vie comprend ses œuvres de musique religieuse : messe, motets, pièces d'orgue, le Panis Angelicus, l'oratorio de Rédemption. Dans cette période il commença à se transformer et à dégager sa personnalité des influences très directes subies jusqu'alors.
Enfin, à partir de 1872, au moment où il devenait professeur d'orgue au Conservatoire, en remplacement de son maître Benoît, il atteignait la troisième période de sa vie, où, débarrassé des hésitations du début, mûri par le travail et les réflexions, il put créer ses œuvres les plus importantes et les plus significatives : les Eolides ; Trois pièces d'orgue ; le Quintette en fa mineur ; les oratorios : les Béatitudes, Rébecca ; le poème symphonique : le Chasseur maudit ; ses grandes œuvres de piano avec ou sans orchestre (les Djinns ; les Variations symphoniques ; Prélude, Choral et Fugue ; Prélude, Aria, Finale ; Danse lente) ; la Sonate piano et violon ; Psyché, poème symphonique avec chœurs ; des mélodies ; le Psaume CL ; deux opéras : Hulda et Ghisèle (inachevé) ; enfin la Symphonie en ré mineur, le Quatuor à cordes, et Trois chorals pour orgue. Cette composition fut la dernière et le maître s'éteignit le 8 novembre 1890.
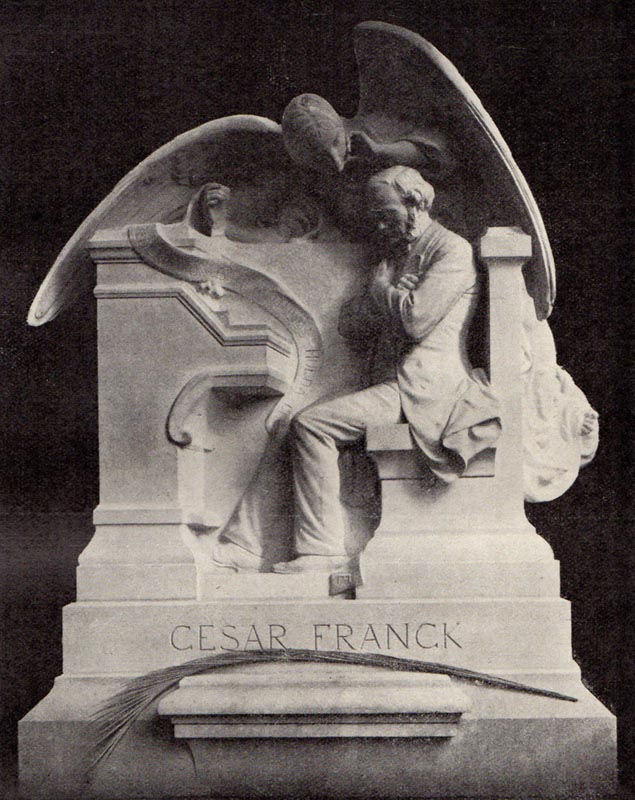
A. Lenoir : monument à César Franck, Square Sainte-Clotilde, Paris.
Les œuvres de musique de chambre et de piano de C. Franck que nous avons à analyser ici sont donc toutes situées dans sa troisième manière, à savoir :
Quintette en fa mineur pour piano, 2 violons, alto et violoncelle, composé en 1878-79 et exécuté pour la première fois à la Société Nationale, le 17 janvier 1880 (Paris, Hamelle).
Prélude, Choral et Fugue, pour piano (1884). Première audition : Société Nationale, le 24 janvier 1885 (Paris, Enoch).
Danse lente, pour piano (1885, Paris, Schola Cantorum).
Sonate en la majeur, pour piano et violon (1886) (Paris, Hamelle).
Prélude, Aria et Finale, pour piano (1886-87). Première audition : Société Nationale, le 12 mai 1888 (Paris, Hamelle).
Quatuor en ré majeur, pour instrument à cordes (1889). Première audition : Société Nationale, le 19 avril 1890 (Paris, Hamelle).
***
Dédié à C. Saint-Saëns qui tenait la partie de piano lors de la première audition, assisté du quatuor Marsick, Rémy, Van Woefelghem et Loys, le Quintette en fa mineur est la première et très importante œuvre de musique de chambre que Franck ait composée depuis ses premiers trios. Il s'était donc écoulé près de trente-cinq années entre ces deux productions et ce n'était plus un jeune homme de vingt ans, mais un homme âgé de cinquante-six ans, dans toute la maturité de son talent et plein d'expérience, qui s'essayait de nouveau dans un genre longtemps délaissé.
Cependant un premier trait, et sans doute le plus important, reste commun à ces deux tentatives — en apparence si distantes — et qui contribuerait à prouver combien toute personnalité se trouve formée dans son essence dès la jeunesse, dès la première enfance, — l'éducation ou tout apport étranger n'ayant qu'une importance des plus relatives dans la formation de cette personnalité. Ce trait commun, qu'on a appelé depuis « le Cyclisme » est une des principales caractéristiques du style de Franck.
Franck a été, avant toutes choses, un homme dûment équilibré, un solide architecte des sons, un organisateur dans toute la force du terme. Que sa sensibilité ait été touchante, qu'il ait été, dans son genre, un passionné — et aussi loin que possible de l'indifférence indolente, chère à tels autres de nos musiciens — un homme de foi qui marche de l'avant sans se demander pourquoi (du moins jusqu'à une certaine limite) et qui entraînerait, comme malgré eux, ceux mêmes qui sont loin de partager cette foi — cela est possible et même certain, mais toutes ces qualités apparaissent secondaires à côté de la structure, de la charpente intime de cet architecte musicien, qui fut toujours préoccupé avant tout d'ordre et d'organisation — et cela à un moment où le courant moderne entraînait tous ses contemporains, au contraire, vers le mouvement, fut-il désordonné ou même, en apparence, déséquilibré.
Un de ses ancêtres les plus directs, Beethoven — qui a bénéficié de cette extraordinaire fortune d'être d'abord un homme du XVIIIe siècle, participant des qualités de ce temps, commençant par avoir, lui aussi, et plus normalement, une éducation d'ordre et de clarté — a continué depuis à être pleinement de son époque et a su, sur des bases solides, établir une œuvre de fougue et de mouvement. Il a été, sinon le premier des romantiques — on pourrait faire remonter le romantisme jusqu'à J. Haydn, si absolument différent de J.-S. Bach et tous les compositeurs précédents — du moins éminemment expressif de la période qui va de la Révolution de 89 à celle de 1830.
Alors que toute une série d'artistes étaient à ce moment épris d'une fièvre de mouvement, d'agitation, qui leur semblait instinctivement l'expression particulière et nettement nouvelle de toutes les aspirations bouleversées du XIXe siècle, alors qu'il surgissait un Delacroix en peinture, un Hugo en poésie, un Berlioz ou un Schumann — tant d'autres — en musique, Franck, fut, lui, un réacteur, et au fond fort peu un romantique. On pourrait, comparant R. Wagner à Delacroix, le comparer lui-même à Ingres. Il est difficile, d'autre part, de ne pas remarquer ici que si Franck fut un organisateur, Wagner le fut également, et cela pour mettre de l'ordre dans les forces du présent, tandis que Franck le faisait pour celles du passé.
Il se dressa de tout son instinct, sans même que sa volonté eut pour cela à intervenir, contre les tendances nouvelles, et il n'eut qu'une idée, qu'un désir, se rattacher aux traditions anciennes, comme dans un regret de tout ce qu'on avait perdu en les répudiant, avec une secrète persuasion que ces qualités traditionnelles ne subissaient qu'une fâcheuse éclipse et luiraient à nouveau quand « les troubles auraient passé », comme disaient autrefois les partisans déchus de l'ancien régime.
Il est sans doute nécessaire qu'il se présente ainsi de par les temps des esprits qu'on pourrait appeler « équilibreurs », qui semblent appelés à ramasser les forces du passé et faire sentir à nouveau son action bienfaisante, afin de mettre un ordre dans des tentatives quelquefois trop téméraires. Cependant cette tendance ne va pas pour eux sans le fâcheux et obligatoire abandon de qualités plus directes et plus vivantes : il demeurent un peu à côté et en dehors de leur temps, et, outre qu'ils peuvent avoir à en souffrir durement, comme il est advenu pour Franck, leur œuvre reste empreinte d'une certaine froideur, d'une certaine tristesse qui l'empêchent, malgré tout, de pouvoir se comparer, s'apparenter à celle d'artistes plus réellement animés d'un esprit moderne.
Le cyclisme, commun aux premiers trios et aux œuvres de la troisième manière de Franck, est un dérivé des dernières créations de Beethoven. Il consiste dans l'emploi, pour une charpente générale, d'éléments thématiques successivement exposés (dont un principal) et qui deviennent par la suite communs à ses différentes parties — se développant et se transformant comme des personnages agissant et en butte aux contrecoups des événements de la vie. Ces éléments mettent ainsi une sorte de lien entre le premier allegro, l'andante, le scherzo et le final, subdivisions traditionnelles des œuvres de musique de chambre depuis J. Haydn, dont les cadres restent par ailleurs intacts.
Le désir d'unifier davantage et d'une façon plus visible les quatre mouvements d'une production de musique pure n'a pas été une idée absolument nouvelle chez Beethoven. Ce maître, qui a su concilier d'une façon si extraordinaire la tradition et le modernisme, n'a fait en cela que renouveler un procédé qui apparaît à l'état embryonnaire dès le XVIIe siècle chez les premiers compositeurs de sonates (suites) italiennes.
Les opinions peuvent être diverses sur sa nécessité et il est loisible de penser qu'une œuvre peut avoir une unité très suffisante sans qu'il ait à intervenir. Il n'y a pas d'idées cycliques chez Mozart, pas plus dans ses œuvres de musique pure que dans ses opéras (sauf dans Don Juan, une esquisse, au début de l'Ouverture, de la scène finale), et il serait fort naïf de croire que l'unité des conceptions de celui qu'on a appelé à juste titre le « divin » s'en trouve affaiblie. Mais on a l'esprit plus ou moins tendu vers l'ordre, on est porté de nature plutôt vers des compositions d'aspect synthétique, en relief et avec une charpente très apparente — ou, au contraire, vers la variété, le charme complexe, fuyant des détails. En résumé, le cyclisme est un procédé et vaut ce que valent tous les procédés, c'est-à-dire seulement par la façon dont il est employé et en tant que véhicule de l'Emotion, en dernière analyse seule en cause.
Toujours est-il que Franck attacha — et après lui ses disciples — une grande importance à son emploi. Il sut en tirer un parti puissant et le développer jusqu'à ses extrêmes conséquences avec ordre, richesse et plénitude — s'appuyant pour cela sur les moyens qui avaient profondément préoccupé Beethoven dans ses dernières œuvres : haute variation et renouvellement de la fugue. Il atteignit ainsi, dans l'ordre instrumental, des résultats très apparentés avec ceux obtenus par Wagner dans l'ordre dramatique — mais, cependant, il n'y a pas là, à proprement parler, découverte, mais application à la musique pure d'un procédé qui préoccupait dès longtemps tous les esprits, apparaissait dans les rappels de motifs employés pour ses ouvertures par Weber, devenait systématique dans la Symphonie fantastique de Berlioz (il est vrai sans transformations thématiques — mais Berlioz n'était guère enclin à ce genre d'habileté) et finalement s'épanouissait dans les drames de Wagner, tous antérieurs, sauf Parsifal — et de bien peu — au cyclisme des dernières œuvres de Franck.
Le Quintette en fa mineur est une œuvre de magnifiques proportions, grande composition décorative, qui pourrait faire penser à ces riches tapisseries du XVIe siècle, où les personnages sont savamment ordonnés et groupés, les plans sagement distribués et judicieusement équilibrés. Composition particulièrement dramatique, et animée d'une chaleur, d'une passion intérieure (senza agitatione, indique l'auteur), que Franck n'a pas toujours atteintes à ce point. Etablie en trois parties seulement — son sujet émotif et l'importance de chacune de ces parties ayant dû entraîner pour l'auteur la croyance en la nécessité de suppression du scherzo — l'œuvre débute, quatuor sans piano, par une invocation douloureuse, paraissant plutôt l'interprétation du sentiment d'un personnage étranger à l'auteur et distant, que l'expression de son sentiment personnel. Franck marque ici — comme souvent par ailleurs — une certaine défiance de soi, une difficulté à cet abandon total, éperdu de la volonté que l'on trouve si rarement et seulement dans des natures de la générosité d'un Beethoven. La fin de l'introduction lente, très émouvante, amène, par un trait de piano agité et hardi, l'exposition d'allegro qui se développe ensuite normalement, suivant les principes classiques. La seconde phrase — chantante, féminine et opposée à la première, rythmique, masculine, comme l'avait imaginé autrefois Beethoven — est préparée d'abord en ut dièse majeur pour s'exposer ensuite au relatif de fa : la bémol majeur. Et tout à coup — ici se révèle la tendance cycliste — cette phrase est traversée par un rappel du premier thème, d'un effet extrêmement frappant.
Par la suite de l'œuvre, ces deux thèmes se développeront, le second surtout très visible et donnant lieu à des transformations rythmiques intéressantes — puis se mêleront avec les nouveaux thèmes exposés dans la deuxième et la troisième partie.
Pour ce qui regarde la première, il faut remarquer le bel arrangement de ce que Franck appelait la réexposition : la seconde phrase coupée par des retours de l'introduction qui la renouvellent et en même temps lui donnent un parfait équilibre.
Je ne puis m'empêcher de faire remarquer ici combien semblent peu harmonieux et sans réelle utilité les mots employés couramment, depuis bien des années déjà, pour désigner les différentes étapes du discours musical. Pourquoi appeler « pont » le passage de la première à la deuxième idée de l'exposition ? Cette expression se comprendrait dans la bouche d'un ingénieur, non pas d'un architecte : elle souligne une fâcheuse tendance à trop considérer la charpente musicale comme un mécanisme scientifique. Et quant aux mots : réexposition, développement terminal, leur lourdeur devrait les condamner à disparaître pour faire de nouveau place à ceux de : conclusion, péroraison, employés dans le discours parlé, modèle du discours en musique.
Il ne peut être question d'analyser dans cette étude, mesure par mesure, chacune des œuvres dont le nombre important nous sollicite.
La douce mélancolie du « Lento » s'opposant au thème rythmique qui deviendra deuxième thème de la troisième partie — coupée de rappels des thèmes de la première, modifiés, et se terminant par la cadence la plus inattendue : la tonalité de si bémol majeur retombant sur celle de la mineur avec un naturel inimitable — le drame reprenant, presque orchestral dans la troisième partie, tous les motifs de l'œuvre se pénétrant de plus en plus et se superposant, toujours sans abandonner le cadre traditionnel — et enfin la péroraison où domine la sérénité triste, la sérénité à laquelle Franck semble désespéré d'atteindre jamais, ayant cependant une foi profonde qu'elle existe et existera éternellement — tout cela forme un ensemble d'une beauté puissante et durable et marque, pour la première fois sans doute en France, l'atteinte d'un sommet dans l'art de traiter la musique de chambre.
***
De même que Franck avait délaissé cette dernière pendant fort longtemps, de même il n'écrivit rien pour le piano pendant près de quarante ans — et sur le catalogue de ses œuvres il n'apparaît aucune composition entre le Duo à quatre mains, pour piano, sur Lucile, de Grétry (1846), et Prélude, choral et fugue (1884).
Franck, toujours très personnel et en dehors des recherches de ses contemporains — ou aînés de dix ans comme Chopin, Schumann, Liszt — était d'avis, vers le printemps de 1884, que, en tous cas en France, la production des pièces pour piano était fort négligée et inférieure à celle des pièces de musique de chambre ou d'orchestre jouées en première audition aux concerts de la Société nationale. Son instinct d'architecte des sons le poussait à trouver que, si les découvertes pianistiques avaient été, les dernières années, d'une richesse incomparable, si la virtuosité avait conquis un domaine d'une étendue et d'une variété jusque là insoupçonnées, les formes classiques, par contre, semblaient s'être étiolées, au lieu de progresser, et menaçaient ruine. C'était la conséquence de la même disposition d'esprit que nous avons vu présider à l'élaboration du Quintette en fa mineur. Préoccupé toujours d'ordre et de stabilité, attachant moins de prix à l'élan qui passionne les grands explorateurs de l'avenir, — qui les pousse toujours de l'avant et, malgré d'inévitables faux pas, leur fait découvrir des régions inconnues de leurs aînés, — qu'à la fixation, à la prise de conscience fouillée et tranquille d'un état donné et dûment reconnu, Franck, lorsqu'il se résolut à écrire pour le piano, avec toutes les ressources de son talent maintenant éprouvé, ne fut pas intéressé par le désir de rechercher, lui aussi, des effets de piano, des effets propres uniquement à cet instrument, dans la couleur, la fougue et la passion. Il vit seulement, avec tristesse, que les formes classiques n'étaient plus cultivées et se résolut à les relever, à leur infuser de nouveau la vie. Certes ces formes étaient encore susceptibles, sous l'impulsion d'un homme de la valeur de Franck, de donner lieu à des œuvres sinon nouvelles, sinon équivalentes aux anciennes, du moins renouvelées et le plus savoureuses possible — et Franck l'a prouvé par deux productions qui, musicalement plus que pianistiquement (cela est bien plus important), sont des monuments d'une solidité destinée, semble-t-il, à défier l'atteinte des siècles.

Auguste Renoir : Jeunes filles au piano [les filles de Catulle Mendès et d'Augusta Holmès], 1888
La première de ces œuvres : Prélude, Choral et Fugue, dédiée à Mlle Marie Poitevin, qui en fut la créatrice, est un essai de renouvellement de la forme : Prélude, fugue qui devait tenter un esprit nourri chaque jour par le style substantiel du grand cantor, J.-S. Bach. Mais si Franck percevait pour lui-même l'instinctive nécessité de s'appuyer sur la tradition lorsqu'il composait une œuvre (rarement le mot : compositeur, n'a pris autant tout son sens que pour le maître de Liège), cet appui n'allait jamais sans quelque tentative d'en tirer des conséquences personnelles, nouvelles, bien que solidement enracinées par la base dans le passé. Aussi sa première conception d'écrire un prélude et une fugue s'élargit-elle peu à peu et, par l'adjonction d'un choral, intermédiaire, donna lieu à une architecture, succédanée de la forme ancienne, mais se dressant isolée, comme une conséquence inattendue, imprévue de cette forme.
De plus, fidèle à sa théorie cycliste, Franck établit son œuvre avec plusieurs éléments générateurs qui se poursuivent et se développent à travers les trois parties de l'œuvre pour se rencontrer enfin, superposées, dans la péroraison : le rythme du prélude, le choral, et le thème de la fugue. Celui-ci, indiqué dès le prélude, puis plus présent dans la deuxième partie où il donne lieu à une phrase pleine d'expression qui se développe entre les trois expositions, les trois affirmations, pourrait-on dire, du choral, domine la fin de l'œuvre.
Des trois parties, c'est sans doute la première qui est le plus véritablement pianistique — la dernière se rapprochant davantage du style de l'orgue. Cette première partie semble la description du lieu où va se passer l'action idéale qui se déroulera devant nous : tristesse et hésitations qui s'affermissent ensuite et, sous la bienfaisante action du choral — qui semble une sorte de pardon descendu du ciel sur la terre — aboutissent, dans un élan d'amour mystique et passionné, à l'affirmation d'une Foi maintenant assurée. Transformés dans la péroraison, le rythme du prélude, le choral, la fugue, tout devient alors joyeux, plein de force et de lumière, et se termine dans un carillon grandiose et paradisiaque.
***
La Sonate en la majeur, pour violon — que beaucoup considèrent comme le chef-d’œuvre de Franck, et même le chef-d’œuvre des sonates piano et violon — dédiée à E. Ysaye, est un modèle de la recherche cycliste, de la transformation, à l'aide des procédés de la grande variation, de fragments thématiques premiers — cette transformation s'opérant, non par variations successives et nettement séparées les unes des autres, comme l'avaient fait les classiques et plus spécialement Beethoven dans ses dernières œuvres, mais suivant le cours de l'œuvre (comme l'avait également indiqué Beethoven) en personnages agissant par eux-mêmes ou aussi agis par les événements.
Le thème principal, exposé dès le début, est empreint d'une confiance douce et sereine. Franck, dont toute la vie était dirigée par de fortes convictions religieuses, catholiques, bien significatives de son esprit d'ordre et d'organisation, en a inscrit toujours dans ses œuvres la préoccupation mystique et philosophique. Foi souvent, d'abord, on dirait inquiète, attristée ou même douloureuse, mais qui, peu à peu, surmonte les obstacles, s'élève et enfin s'établit dans la Joie. Ici, dès les premières mesures, le but apparaît, légèrement estompé, et s'exprime, dans un morceau tout à fait classique, de la forme que l'on appelle forme-sonate (c'est-à-dire à deux idées opposées, la deuxième dans la tonalité de la dominante et, en conclusion, dans la tonalité principale) mais sans développement — ce qui lui donne, sinon la charpente, du moins l'expression d'une sorte de prélude à l'action qui va suivre.
Et celle-ci commence dans la deuxième partie, également de forme-sonate, mais dramatique et présentant au début de son développement l'exposition d'un deuxième thème cyclique — sorte de prière, d'offrande en désir humble d'apaisement, le thème dramatique plusieurs fois coupé par des apparitions angoissées du premier thème cyclique.
La troisième partie amène l'apaisement, sous l'arabesque d'un dessin d'une grande pureté de ligne qui fait penser à S. Bach, et cet apaisement — venu d'En Haut — s'affirme par le troisième thème cyclique de l’œuvre, alternant avec une phrase mélodique, en réponse, sorte de Domine non sum dignus étonné et glorifiant la divinité.
La quatrième partie est un rondeau, écrit le plus souvent en canon à l'octave, procédé des plus fréquents chez Franck et qu'on pourrait considérer comme la signature authentique de sa personnalité, à la fois affirmatif par sa proposition et poétique — d'une poésie spéciale et très nette — par l'enveloppement de sa réponse. Comme un hymne charmant de reconnaissance et d'amour, il s'expose (conséquence du premier thème cyclique) — couplets tirés des thèmes précédents, refrain se déroulant dans une tranquille joie, développements, rappels des thèmes principaux.
Peut-être pourrait-on seulement reprocher à cette œuvre, si belle d'expression par ailleurs, son extrême terminaison (reproduisant la fin d'exposition de la quatrième partie) un peu empreinte de vulgarité — et aussi la quadruple répétition textuelle de la phrase mélodique qui alterne avec le troisième thème cyclique dans la troisième partie, sans aucune transformation, ce qui ne laisse pas d'étonner — mais le premier morceau seul de l'œuvre suffirait à la désigner comme une réussite particulièrement parfaite et accomplie.
***
Prélude, aria et finale — exécuté pour la première fois par Mme Bordes-Pène, à qui Franck l'a dédié — est, comme Prélude, Choral et Fugue, un essai de renouvellement d'une forme classique, mais, cette fois, de la forme-sonate. Le premier allegro se trouvant supprimé (il y en a plusieurs exemples chez Beethoven), l'andante est représenté par le prélude ; l'aria, phrase calme, exposée deux fois et précédée d'une introduction qui se répète à la fin, remplace le scherzo absent ; le final est classique (forme-sonate). Suivant le système habituel à Franck des rappels de motifs fortifient l'unité de l'œuvre. Cette fois il y a, en effet, plutôt rappels de motifs que développement cyclique. On peut remarquer cependant dans la première partie des
amorces des thèmes suivants, notamment du thème du final. De même l'aria réapparaîtra dans la troisième partie, soit par son thème, soit par son introduction ou tel autre fragment. Mais le thème du prélude et celui de l'aria sont exposés à nouveau dans le final sans modifications mélodiques — uniquement avec des modifications d'atmosphère rythmique — ce qui offre évidemment un moindre intérêt.
Le thème du prélude est une très longue phrase (quarante-deux mesures) se terminant sur un trille soutenu par une fusée ascendante de la main gauche. Il est difficile de ne pas penser, en entendant cette phrase, à quelque marche de pèlerin, chantant et affirmant sa foi. Après la douce assurance d'une paix future et sans fin que chante l'aria, et l'agitation du début du final, une joie sainte anime le pèlerin qui, à la fin de l'œuvre, peu à peu s'éloigne et disparaît — rappelant ainsi, quoique dans un sentiment bien différent, Harold en Italie, de Berlioz.
Dans cette œuvre, Franck emploie la plupart de ses moyens coutumiers. Lorsqu'il développe un thème, il s'attache à en choisir les fragments principaux et les plus visibles, sans inutile rouerie. Ses rythmes sont francs et simples — il affectionne tout spécialement les superpositions binaires et ternaires. Ses harmonies sont non seulement solidement établies, mais aussi souvent fort recherchées — à la limite, semble-t-il, de ce que lui permettait son style. Mais c'est toujours l'architecture générale de la mélodie qui est le côté le plus remarquable de son génie, ainsi d'ailleurs que la marche des modulations, toujours savamment graduée et donnant lieu souvent à de véritables trouvailles. Parmi celles-ci il faut remarquer surtout l'admirable modulation au demi-ton supérieur (fa majeur par rapport à mi) à la dernière page du prélude — qui est d'une douceur et d'un charme prenants, suivie d'un retour au ton de mi, souple et naturel.
Comme aucune œuvre humaine n'est parfaite, il est permis de regretter que Prélude, aria et finale soit écrit trop souvent — et beaucoup plus que Prélude, choral et fugue — dans un style véritablement d'orgue, instrument qui, malgré la parenté du clavier, est fort éloigné par sa stabilité — sa pesanteur même souvent — de la prestesse, de la légèreté du piano. On entend le pédalier, les changements de clavier... et, toujours préoccupé d'architecture sonore, Franck a peut-être un peu trop oublié, en écrivant des séries d'accords qui exigent une extension de main inusitée, que les mains moyennes se trouvent par suite dans l'obligation d'arpéger trop souvent contre sa pensée et contre l'effet voulu, nécessaire.
Mais la fin qui, par l'interposition de vapeurs successives et de plus en plus denses, masque peu à peu le pèlerin qui s'éloigne, à un charme précis et parfait qui fait vite oublier ces défauts passagers.
***
Le Quatuor à cordes en ré majeur est un monument remarquable et imposant. Ecrit tout à fait à la fin de sa vie — Franck n'avait pas osé jusque là se mesurer avec cette forme redoutable... et après de patientes études des quatuors classiques, cherché et travaillé longuement — tout au moins la première partie, plusieurs fois recommencée, — ce quatuor restera une des productions les plus importantes et les plus solidement établies de la musique de chambre. Très évidemment, depuis les prodigieux derniers quatuors de Beethoven : le douzième, le quatorzième, le quinzième, rien de semblable n'avait été encore écrit.
Des quatre parties qui le composent, la première est sans contredit la plus étonnante, avec sa double charpente d'andante et d'allegro qui se pénètrent et se développent simultanément sans jamais de confusion et, au contraire, dans un ordre d'une lumineuse clarté. Franck a réussi ce quasi tour de force d'obtenir une extension de l'introduction lente — souvent employée comme frontispice aux premiers allegros — en faisant réapparaître cette introduction, développée, vers le centre de la pièce, tel le milieu d'un andante, et encadrant finalement avec elle l'allegro dont tous les développements habituels (exposition des deux idées opposées, développement central et conclusion) trouvent par ailleurs leur place normale.
Après un scherzo, sorte d'intermède, l'andante ou plutôt le larghetto en si majeur (Franck tenait en grande affection les tons diésés) expose une phrase d'une émotion, d'un équilibre et d'une simplicité qui atteignent à la pure beauté.
Vers la fin de la dernière partie, dont les deux idées sont comme des souvenirs de la première, le rythme du scherzo peu à peu fait rentrer la phrase du larghetto qui plane et termine ce chef-d’œuvre.
Le jour de sa première audition (par MM. L. Heymann, Gibier, Balbreck et C. Liégeois), l'impression fut telle que tous les assistants du concert, donné salle Pleyel par la Société Nationale, se levèrent avec enthousiasme, acclamant le maître dont c'était, hélas ! le premier succès, quelques mois seulement avant sa mort... Cette gratitude envers l'homme que sa vie intègre, sa sincérité, sa magnifique pureté de style désignent plus que tout autre à l'admiration, lui fut un réconfort bien tardif — mais dont sa foi, certes, n'avait pas eu besoin, quels qu'aient pu être ses regrets : comme il l'a chanté lui-même dans la Quatrième Béatitude : « Bienheureux ceux qui souffrent pour la Justice, car le royaume des cieux leur appartient. »
ÉDOUARD LALO. — Victor-Antoine-Édouard Lalo, né le 27 janvier 1823 à Lille, est mort à Paris le 22 avril 1892. Comme beaucoup d'habitants de nos provinces du Nord, Lalo était de pure extraction espagnole, ses ancêtres établis dans le pays dès le moment de sa conquête par Charles-Quint et Philippe II, au XVIe siècle. Il commença ses études au Conservatoire de Lille — violon et harmonie — puis vint en 1839 à Paris, où il fut élève du Conservatoire, pour le violon, d'Habeneck. Il prit ensuite les leçons de composition d'un second prix de Rome de 1847, Crèvecœur. Nous le trouvons en 1855 tenant la partie d'alto dans le quatuor Armingaud, Jacquard. Il avait à cette époque publié déjà (depuis 1848) quelques mélodies, ayant commencé à composer vers 1845. Dix ans plus tard il écrivait plusieurs œuvres de musique de chambre mais, devant l'insuccès rencontré par ce genre de productions auxquelles le public était alors indifférent, il cessa bientôt de composer, cela jusqu'à son mariage en 1865. Sa femme, douée d'une belle voix de contralto, devait chanter souvent, depuis, et avec succès dans de nombreux concerts.
Se tournant vers le théâtre, il prit part au concours organisé par le Théâtre-Lyrique en 1867 avec Fiesque, opéra en trois actes — mais il ne fut pas heureux et sa partition, qui n'obtint que la troisième place, ne fut jamais représentée. Il se mit alors à composer pour le concert et trouva enfin le succès avec un Divertissement, joué chez Pasdeloup en 1872, puis surtout avec son Concerto pour violon, exécuté en 1874 aux Concerts Colonne par Sarasate. Ce furent ensuite la Symphonie espagnole (1875), le Concerto pour violoncelle (1876), d'autres encore, finalement la Symphonie en sol mineur (1885) et un Concerto pour piano (1889). L'année précédente, son chef-d’œuvre : le Roi d'Ys, opéra en trois actes, avait été joué, le 7 mai 1888, avec un succès considérable, à l'Opéra-Comique. Un opéra inachevé : la Jacquerie, fut terminé par Arthur Coquard (Opéra-Comique, 1895).
Edouard Lalo n'a rien produit pour le clavier, sauf deux petits morceaux pour piano à quatre mains : la Mère et l'enfant (1873) — mais un assez grand nombre d'œuvres de musique de chambre, la plupart datant d'avant 1865 : plusieurs pièces pour piano et violon, les deux premiers trios, une sonate pour piano et violon et une pour violoncelle. Nous n'avons pas à nous en occuper ici. Deux seulement rentrent dans le cadre de cette étude : le Quatuor à cordes en mi bémol, qui date à la vérité d'avant 1855, mais fut repris, notamment pour ce qui concerne le final, en 1880 (Hamelle, éditeur), et le Troisième trio en la mineur, pour piano, violon et violoncelle (1881, Durand, éditeur).
L'atavisme espagnol d'Edouard Lalo est très certainement fort important à considérer pour la compréhension de sa personnalité musicale — bien plus influencée par cette origine lointaine que par l'apparence superficielle de sa naissance flamande. La fierté, la vigueur, de l'esprit d'aventures, un certain exotisme, la couleur et surtout le sentiment du rythme, présentés en un amalgame imprévu par suite du mélange de son ascendance avec le caractère de notre pays, ont abouti à composer en lui une figure curieuse qui devait avoir sa part importante d'action sur le mouvement musical français dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Respectueux de la forme classique qu'il n'a pas cherché à modifier et qu'il voulut simplement continuer, à la suite de Schumann, semble-t-il, il subit fortement l'influence du maître allemand, avec moins de personnalité, d'originalité toutefois, mais plus d'ordre. Lalo est doué d'une écriture particulièrement ferme et toujours intéressante. Il dit exactement ce qu'il veut, ne se perd pas dans des développements oiseux. Puissant, trapu, pourrait-on dire, il trouve moyen d'allier cette puissance à de la finesse. Ses compositions sont comme ramassées sur elles-mêmes et présentent de perpétuels contrastes entre des élans — plus de force que de passion — et des recherches de transparence qui interviennent toujours à temps pour que cette force, nerveuse surtout, ne tombe jamais dans la lourdeur. Ses œuvres respirent l'honnêteté, le désir de se satisfaire soi-même, sans aucune préoccupation de succès. Visiblement intéressé par la recherche de faire parler ses instruments en complète indépendance les uns vis-à-vis des autres, avec une abondance sobre, il n'a pas visé la pureté de lignes d'un Franck, mais un style continuellement expressif, d'une expression un peu distante et dont il nous donne seulement comme un extrait concentré. Personne moins que lui n'est porté à l'afféterie, au maniérisme et ne s'écarte plus de l'emphase. Son harmonie, pleine de fermeté, est loin de toute déliquescence. Le rythme est pour lui chose directe : il l'atteint presque sans le poursuivre. Tout naturellement il apparaît comme l'intérêt principal de ses compositions.
Ces qualités, visibles peut-être davantage dans les œuvres d'orchestre de Lalo, se présentent néanmoins en partie dans sa musique de chambre. Le peu d'entre elles qui ait paru depuis 1874 en restreint ici l'étude de façon regrettable.
Le Quatuor en mi bémol présente les différentes caractéristiques que nous venons d'analyser : la solidité, la variété de l'écriture, l'intérêt bien distribué entre les quatre instruments, dont chacun tient la place qui doit lui revenir, la finesse rythmique avec ses qualités d'allant et de variété qui, chose curieuse, ne sont pas pour cela alliées à de la souplesse — Lalo semblant toujours ramener à lui son expansion et avoir comme un scrupule, une pudeur à la faire partager aux autres — la crainte des développements trop longs et prétentieux, une sincérité quasi absolue.
Le Troisième trio, en quatre parties comme le quatuor, s'expose d'abord de façon très schumannienne. Des martellements de piano et des basses expressives, presque orchestrales font bientôt reconnaître le style de l'auteur du Roi d'Ys. Très agité, avec de perpétuels entrecroisements de rythmes — expression directe d'un tempérament — le premier mouvement fait place à un scherzo où les rythmes sont plus intéressants encore, sans jamais d'excès ni de bizarrerie. La troisième partie est pleine de grandeur et empreinte de cette tristesse spéciale à l'homme qui avait rêvé, sans doute, une existence plus pleine et s'épanouissant — et avait dû renfermer en lui une expansion, prête à s'échapper, mais que les événements de la vie avaient réfrénée.
La sombre fierté, agissant, allant de l'avant quand même et malgré tout, que nous voyons dans le final, corrobore cette idée et complète l'expression de sévérité assez austère, de couleur soutenue, mais fine aussi et cherchant à s'éclaircir dans la transparence, qui caractérise la belle personnalité musicale d'Edouard Lalo.
CAMILLE SAINT-SAËNS. — Charles Camille Saint-Saëns est né à Paris le 9 août 1835 et mort à Alger le 16 décembre 1921. Il connut à peine son père et fut élevé par sa mère et sa grand’tante. Cette dernière, fort bonne musicienne, le mit au piano dès l'âge de deux ans et demi.
Elève de Stamaty alors qu'il atteignait sept ans à peine, il avait déjà composé des mélodies lorsqu'il prit, de Maleden, ses premières leçons d'harmonie. Son extrême facilité lui permit de faire de rapides progrès, non seulement à ce dernier point de vue mais à celui de l'exécution et, dès le 6 mai 1846, âgé de dix ans et demi, Camille Saint-Saëns donna son premier concert à la salle Pleyel.
Entré au Conservatoire l'année suivante dans la classe de composition d'Halévy, puis dans celle de Benoist (orgue) il remporta le premier prix d'orgue en 1851, mais ne fut pas récompensé lorsque, l'année suivante, il concourut pour Rome.
Longtemps il resta sans tenter une nouvelle chance de réussite et, bien qu'ayant fait entendre dans l'intervalle avec succès plusieurs œuvres fort importantes : l'Ode à Sainte-Cécile (couronnée par cette dernière société en 1852), trois symphonies (dont la première — 1853 — fut seule publiée), l'Oratorio de Noël (1858) etc..., lorsqu'il se soumit une seconde fois, en 1864, au jugement de l'Institut il ne fut pas plus heureux que naguère. Organiste de Saint-Mercy en 1853, il passa, dès 1858, au grand orgue de la Madeleine, poste qu'il occupa jusqu'en 1877. Nommé en 1861 professeur de piano à l'école Niedermeyer, il se produisit fréquemment, à cette époque de sa vie, comme virtuose — piano et orgue, laissant la composition un peu au second plan. En 1867 il sortait de ce silence relatif pour prendre part à un concours de l'Exposition Universelle avec les Noces de Prométhée. Son envoi, qu'il avait désiré anonyme, fut primé. En 1868 il commençait à écrire Samson et Dalila (partition qui ne devait être terminée qu'en 1877), et, en 1871 — alors qu'il venait de fonder avec Romain Bussine la Société Nationale — entraîné par l'exemple de Liszt, qu'il fréquentait (ainsi que Berlioz, Gounod, Rubinstein), il commença la série de ses poèmes symphoniques qui devaient mettre le sceau à sa réputation. De nombreuses œuvres de théâtre — puis le Déluge (1875), la Lyre et la Harpe (1879) — une deuxième, et surtout une troisième Symphonie en ut mineur avec orgue (1886), de la musique de piano et de la musique de chambre, en nombre important et que nous allons suivre dans le détail, complètent, avec de nombreuses mélodies et des œuvres de toutes sortes, le catalogue particulièrement abondant des compositions de Camille Saint-Saëns.

fac-simile d'un autographe de Camille Saint-Saëns (Bibliothèque du Conservatoire)
Son œuvre aura été considérée comme classique de son vivant et, de tous temps, il rechercha la pureté de forme des maîtres du XVIIIe siècle, non pas dans la sévérité mais dans l'élégance. Il fut d'une habileté, d'une adresse naturelles que peu de compositeurs ont su atteindre — sachant en effet allier ces deux qualités qui, généralement, ne se rencontrent pas chez le même auteur : l'adresse instinctive, la facilité, écartant d'habitude, rendant inutile la poursuite de la science et disposant à quelque paresse celui qui en est doué. Chez lui la science musicale est venue sans peine. Aussi ne la montre-t-il pas avec complaisance et, au milieu d'une abondance souvent trop aisée, éprouve-t-on par moments quelque surprise de voir surgir tels fragments plus complexes que bien peu auraient pu écrire avec cette perfection. Malheureusement la facilité était, chez lui, vraiment trop grande. Victime d'un fâcheux éclectisme — cause et conséquence de manque de conviction — il laisse nombre d'œuvres indifférentes dont on s'étonne qu'il ait pu les écrire. Sa parenté spirituelle la plus directe semble être Mendelssohn, et les influences modernes qu'il a subies, entre autres celles de Berlioz, de Liszt, il semble les avoir absorbées en lui pour les faire seulement contribuer à l'établissement d'un style — combien loin d'eux — toujours uni, clair, facile, d'une surface polie et égale. Il a touché à tout, a fait le tour de tous les sentiments et de toutes les tentatives et nous en montre, avec une ironie elle-même indifférente, l'inanité. Sa verve jamais ne se déchaîne, mais toujours reste dans les limites d'un équilibre parfait. Bien français à ce point de vue, quoique dépendant toujours étroitement des musiciens allemands, il est sans lourdeur et a un piquant, loin de leur nature, qu'ils pourraient nous envier. On a dit de lui qu'il avait l'esprit d'un gamin de Paris et on a parlé de son caractère fantasque — il l'avait en effet et a prouvé maintes fois son indépendance par ses voyages, ses départs subits au loin, lorsque, las des succès et des réclames faites autour de son nom, il fuyait en Afrique et recherchait la solitude — sous l'étonnant prétexte d'une santé qui a résisté jusqu'à quatre-vingt-six ans. Cet homme qui a tant produit s'est-il réellement livré ? On pourrait en douter. Il ne fut pas, comme l'a été depuis son élève, M. Gabriel Fauré, un grand et aristocratique indifférent. Sa connaissance trop complète de toutes les productions de ses devanciers n'a pas amené chez lui la lassitude et le dégoût, tous sentiments trop appuyés lui étant étrangers. Mais élégant et facile, il a mené parmi nous une existence heureuse que sa plume a transcrite au jour le jour avec une inimitable aisance, sans efforts.
***
Les productions pour piano de Camille Saint-Saëns sont relativement moins importantes que ses œuvres de musique de chambre (Durand, éditeur).
Jusqu'à 1874 il n'avait fait paraître à ce point de vue que Six bagatelles, deux Mazurkas, une Gavotte et une Romance sans paroles. A partir de ce moment nous notons : Six études, op. 52 (1877) ; Menuet et valse, op. 56 (1878) ; Troisième Mazurka, op. 66 (1882) ; Album, op. 72 (1884). Cette dernière œuvre comporte six morceaux : 1. Prélude ; 2. Carillon ; 3. Toccata ; 4. Valse ; 5. Chanson napolitaine ; 6. Final — le premier, bon spécimen de l'écriture pianistique de Saint-Saëns, avec son début et sa fin calmes, séparés par un milieu agité : clarté et intérêt des traits que nous retrouverons par la suite. Le Carillon à sept-quatre montre que Saint-Saëns ne dédaignait pas de se servir, à l'occasion, de mesures rares. La Toccata rappelle, sans aucune lourdeur, que l'auteur était organiste (il est rare quand on a l'habitude de l'instrument-pape, comme l'appelait Berlioz, que l'on échappe à sa hantise, ainsi qu'à la hâte obligée des improvisations). La Valse, d'écriture coulante, la Chanson napolitaine, assez mendelssohnienne, et le Final, franc d'allure, avec un trait de milieu à cinq doubles croches, d'une fantaisie vive et légère — telles sont les étapes de ce recueil.
Nous trouvons ensuite : Souvenirs d'Italie, op. 80 (1887) ; les Cloches du soir, op. 85 (1889) ; Valse canariote, op. 88 (1890), écrite sans doute par Saint-Saëns à la suite d'un de ses séjours favoris aux îles du Cap Vert. On y chercherait en vain la préoccupation du pittoresque et cela n'est pas sans étonner nos habitudes actuelles ; mais, indifférent, l'auteur conserve, chose curieuse, intacte sa personnalité — pourtant si dédaigneuse par ailleurs de se caractériser de manière trop spéciale — au milieu des paysages exotiques dont il nous donne une vision parisienne et bien de son époque : le second empire.
Suite, op. 90 (1892), se compose de quatre morceaux : 1. Prélude et fugue ; 2. Menuet ; 3. Gavotte ; 4. Gigue. Dans le Prélude, le style de J.-S. Bach règne en maître et, après les œuvres précédentes, on éprouve une première surprise qui se répétera souvent par la suite, surtout en ce qui concerne la musique de chambre. Cette facilité accueillant toutes idées se présentant de prime abord, et les exposant avec clarté, dans un ordre parfait, apparaît ici comme pouvant manier aussi bien des formes plus complexes. Et il est évident que le contraste s'établissant entre la difficulté du travail entrepris et l'extraordinaire aisance avec laquelle il est mené à réussite constitue un des principaux motifs — le principal — de l'intérêt des œuvres de Camille Saint-Saëns. Ses idées, qu'il dédaigne généralement de choisir, donnent souvent l'impression du « déjà entendu ». Cela est pourtant, en fait, inexact : comme l'a fort bien fait remarquer M. Romain Rolland, on ne trouve pas chez lui de réminiscences positives — et cela s'explique, car l'auteur qui en est la victime est d'habitude celui qui a des idées vagues, ne sachant trop construire un thème — comme on construit un développement — et se laissant aller à un état de pseudo-inspiration favorisant l'évocation inconsciente et involontaire des « thèmes des autres ». Evidemment il y a bien des manières d'avoir des réminiscences : il y a celle d'un Wagner qui transforme — ne le fit-il pas quelquefois consciemment ? — les idées de ses devanciers, et, de pauvretés, fait des thèmes admirables — témoin (entre combien d'autres) le thème de l'annonce de la Mort, dans la Walkyrie, qui est peut-être une réminiscence de la Symphonie écossaise de Mendelssohn, mais qui exprime tout ce que ce dernier n'aurait jamais pu concevoir. On ne saurait blâmer un auteur de pratiquer la réminiscence de la sorte : elle implique d'ailleurs la compréhension éminente de la valeur de ces idées-mères, moins nombreuses à la vérité qu'on ne l'imagine et qui ne peuvent se transformer que lentement à travers les siècles.
Saint-Saëns n'a pas eu de réminiscences parce qu'il connaissait trop bien la musique de ses prédécesseurs, il avait une idée trop précise, une mémoire trop fidèle de leurs productions pour risquer jamais de rééditer involontairement des thèmes connus. — On ne peut guère lui reprocher davantage d'avoir imité les styles anciens, mais, bien plutôt, d'en avoir fait un amalgame composite qui en atténue les défauts mais aussi bien les qualités et le relief. Cela donne lieu cependant au « faire » qui lui est spécial.
Le Prélude et la courte fugue de la Suite, op. 90, font place à un Menuet et une Gavotte plus près de notre XVIIIe siècle, mais bien superficiellement, et se termine par une Gigue.
Si nous continuons à feuilleter les œuvres pour piano, nous rencontrons par la suite : Thème varié, op. 97 (1894) ; Souvenirs d'Ismaïlia, op 100 (1895), de même genre que la Valse canariote ; plusieurs valses : Mignonne, op. 104 (1896) ; Nonchalante, op. 110 (1898) ; Langoureuse, op. 120 (1903) ; Gaie, op. 130 ; de nouveau : Six études, op. 111 (1899) et six autres pour la main gauche seule, op. 135 ; enfin, Six fugues, op. 161.
Plusieurs œuvres sont écrites pour piano à quatre mains, d'autres pour deux pianos, parmi lesquelles les célèbres Variations sur un thème de Beethoven, op. 35 (1874). Cette composition peut être considérée comme un modèle d'art académique. Il est difficile de voir, poussée plus loin, l'imitation d'un style et on serait tenté de croire que, si Beethoven avait connu ces variations, il se serait demandé s'il ne les avait pas composées lui-même et depuis oubliées. L'incroyable adresse avec laquelle Saint-Saëns réussit à y introduire des formes de Beethoven (18e sonate en ré mineur au début, scherzo de l'Héroïque, etc...), la conviction que, visiblement, il a de l'importance — pourtant superficielle — de ces formes pour évoquer la figure de l'auteur de la Neuvième, sont une cause d'étonnement.
***
En musique de chambre, Camille Saint-Saëns avait produit, avant 1874, un Quintette, piano et cordes, op. 15 (1855), un Trio en fa, op. 18 (1863), une Sonate piano et violoncelle, op. 32 (1872) et quelques autres œuvres de moindre importance.
En 1875 paraît son Quatuor, piano et cordes, op. 41 en si bémol majeur. C'est une composition d'une clarté et d'une simplicité d'équilibre général qui atteint, dans son genre, la perfection classique. Montrant son absorption complète par la grande école allemande de la fin du XVIIIe siècle, mélangeant savamment les styles de Beethoven, Mozart ou Haydn — de Schumann beaucoup moins — mais sans chercher à imiter directement ces styles, Saint-Saëns a répandu la fine lumière de France dans ces conceptions d'une période dont les merveilleux résultats ont fait longtemps oublier l'intérêt, la beauté des périodes antérieures. Il n'y a pas ici la verdeur de Haydn, la grâce de Mozart ou le drame tumultueux, la profondeur philosophique de Beethoven. C'est quelque chose de plus superficiel, beaucoup plus de son époque — et justement par là — qu'il ne paraît tout d'abord. Saint-Saëns, qui atteignit la vingtième année sous le second Empire est — d'autre manière que Gounod — une expression de son temps. Sa musique montre qu'il participa à la vie d'alors — ce qui le différencie également de Franck, isolé dans l'orgue de Sainte-Clotilde et dédaignant les modes qui passaient. Gounod est le musicien français (je mets à part l'opérette et Offenbach) qui évoque le plus le règne de Napoléon III : il a certainement été pris, entraîné complètement par les courants de son siècle et il est impossible, en entendant sa musique, de ne pas imaginer les crinolines et les « Suivez-moi, jeune homme », qui ornaient les belles dames se pâmant à Faust ou à Roméo. Saint-Saëns est resté plus à part, un peu distant, et n'était pas d'un caractère à croire autant à ces choses. Sa musique, de la bonne société, et en dehors des excès, accueille ces moments de prospérité — dont on ne veut pas se demander s'ils dureront — et les exprime dans la tranquillité, sans trop vouloir approfondir, mais sans grande confiance. Il en résulte un style qui semble classique, par l'éloignement que l'auteur maintient entre lui-même — sa pensée, son émotion — et ce qu'il en exprime, comme s'il parvenait à lui donner une portée véritablement générale. Malheureusement la conception qu'avait Saint-Saëns du classicisme s'appliquait non pas à la valeur intrinsèque de ce mot à travers les âges, mais à une époque seulement. Pour lui, le classicisme c'était Haydn, Mozart, Beethoven — Bach aussi, évidemment — et les siècles suivants n'avaient plus qu'à imiter, toujours respectueusement, ces admirables exemples — j'entends à la lettre. Il n'a pas compris, non plus que ses contemporains, qui lui ont décerné la qualité si enviable de « classique », que les musiciens de la fin du XVIIIe siècle, qu'il admirait, n'avaient été réellement, eux, classiques que parce qu'ils avaient su approfondir les secrets intimes de la musique et par suite la transformer — comme l'avaient fait les classiques précédents — être, en un mot, non des élèves dociles, mais bien et nettement des révolutionnaires. Que l'on prenne la lignée ininterrompue des génies successifs dont les œuvres ont victorieusement résisté au temps, chacun d'eux est en réaction plus ou moins violente contre ses devanciers et a été renié par les pseudo-classiques d'alors. Mais ces derniers étaient seulement académiques, ce qui est fort différent.
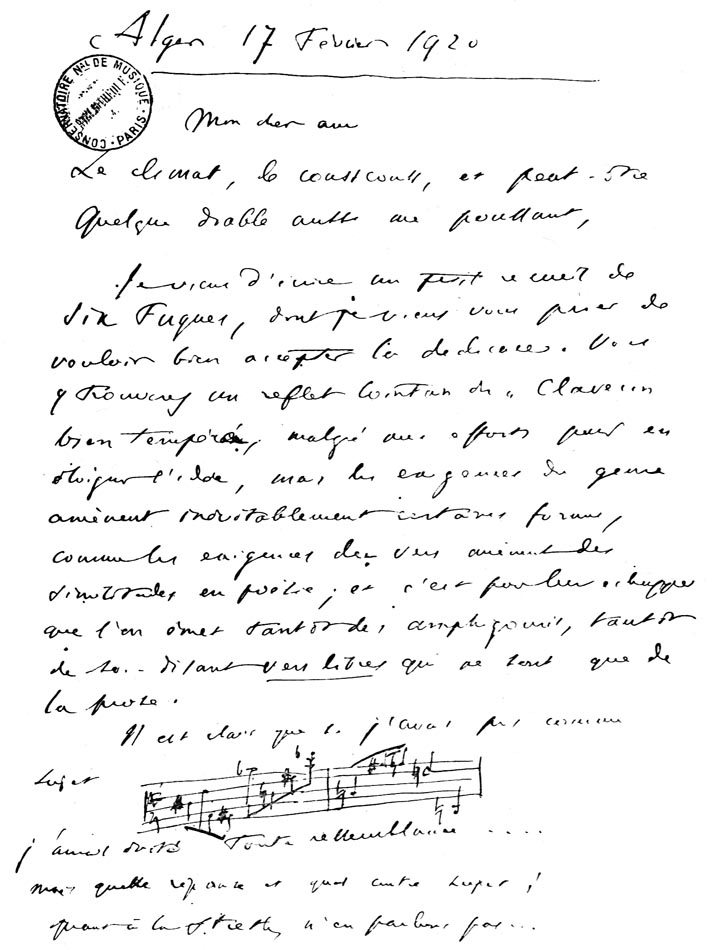
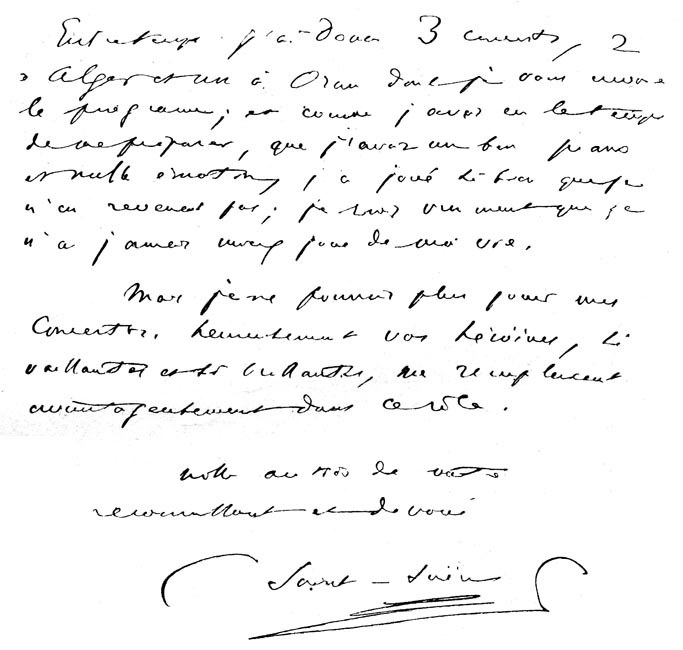
fac-simile d'une lettre autographe de Camille Saint-Saëns (Bibliothèque du Conservatoire)
Dans le Quatuor en si bémol, Saint-Saëns a recherché, comme Franck, un style quelque peu cyclique, mais sans rapport avec celui du maître de Liège. Il n'a pas fait d'ailleurs, comme lui, de cette théorie le but de sa vie et s'il s'est adonné parfois dans ses œuvres de musique de chambre à des recherches plus personnelles que le cyclisme, il ne s'est jamais astreint à un procédé plus qu'à un autre, se laissant aller à sa fantaisie du moment, à son éclectisme, revenant de préférence et le plus souvent à la pure charpente classique.
Il n'y a d'ailleurs pas, dans le Quatuor en si bémol, transformation de motifs premiers à travers les différentes parties, mais plutôt des souvenirs, ou de nouveaux développements de ces motifs.
La première partie, légère et de sonorité aérienne : allegretto — dont nous trouverons des rappels dans le final — est suivie d'une seconde : andante maestoso qui semble la plus remarquable de l'œuvre. Sa franchise d'allure se poursuit du début à la fin sans que les complications, surgissant sous les pas du compositeur par suite du développement logique de sa pensée, gênent en rien cette franchise et viennent jamais la diminuer, l'embrumer. Sorte de choral — destiné à couronner l'œuvre entière — que chantent d'abord les cordes (le piano poursuivant le contre sujet rythmique qu'il vient d'exposer), puis le piano (le même rythme passant cette fois aux cordes), les conséquences de ces divers éléments, entrecoupés de gammes rebondissant aux différents instruments — le thème diminué puis de nouveau dans son rythme premier — forment un ensemble d'une richesse, d'une animation intenses, manière d'improvisation qui n'est pas sans rapports avec Haendel.
Viennent ensuite un scherzo assez développé, puis le final, sorte de rondeau qui ramène après sa deuxième exposition un développement du thème du choral, accompagné de figures rythmiques qui avaient apparu dans le premier mouvement. Troisième exposition analogue à la seconde, avec des souvenirs de rythmes secondaires du scherzo. Puis péroraison imposant le début du premier morceau ; son second thème qui fait contre-sujet sur le thème du choral — et, pour terminer, ce dernier alternant avec le thème du final.
Telle est cette œuvre d'une écriture extrêmement adroite, ne laissant jamais refroidir l'intérêt et si directe qu'elle cause à l'auditeur la joie — souvent éprouvée à l'exécution des compositions de Saint-Saëns — de collaborer pour ainsi dire avec l'auteur, tant sa pensée poursuit une route simple et normale.
***
Le Septuor en mi bémol, pour trompette, piano, deux violons, alto, violoncelle et contrebasse, op. 65 (1881), est dédié à M. E. Lemoine, et fut composé pour les séances de « la Trompette » — intéressante fondation d'un groupe d'anciens élèves de l'école Polytechnique, ayant à leur tête E. Lemoine, et qui a donné un grand nombre de concerts de musique de chambre. Il est formé de quatre parties : 1. Préambule ; 2. Menuet ; 3. Intermède ; 4. Gavotte et final, et Saint-Saëns y a recherché de nouveau une unité générale par l'emploi de motifs se répétant le long de l’œuvre. C'est ainsi que le thème du Préambule sert de conclusion au dernier morceau — que, dans le même Préambule, un rythme est exposé sous un chant expressif, esquisse de ce que sera l'Intermède. Cette œuvre d'extrême simplicité de lignes, modulant à peine — sans doute pour cadrer avec l'allure naturelle de la trompette simple — et presque uniquement aux tons voisins, est un modèle de classicisme académique. C'est une sorte de divertissement, avec l'Intermède plus grave. Très mélodique, elle donne lieu dans le Menuet — surtout le trio — et la Gavotte à des phrases qui se fixent de suite dans la mémoire et, par ailleurs, à des passages fugués traités avec l'adresse coutumière à l'auteur. Tout y est clair et sobre et pourtant tout y a un sens bien défini.
***
La Première Sonate pour piano et violon, en ré mineur, op. 75 (1885), est contemporaine de la Troisième Symphonie en ut mineur avec orgue, op. 78 (1886). Elle est écrite, comme elle, en deux parties — construction inédite, toute particulière et originale qui constitue la tentative la plus intéressante qu'ait imaginée Saint-Saëns pour la composition d'œuvres de musique pure. Conservant, malgré cette subdivision en deux parties seulement, les quatre mouvements traditionnels, Saint-Saëns a cherché à en resserrer certaines parties, dans une intention de modernisme, d'évite de répétitions auxquelles notre hâte est de plus en plus rebelle. L'ensemble reste parfaitement équilibré, la première partie contenant l'allegro habituel de début — arrêté dans ses développements et conduisant à l'andante, celui-ci plus court aussi que naguère. La deuxième partie est formée du scherzo qui s'enchaîne au final.
Cette conception curieuse s'exprime — en ce qui concerne la sonate qui nous occupe — par une exposition classique : première phrase en ré mineur, rythmique, menant à une deuxième, chantante, au ton du relatif : fa majeur ; puis, par un développement (rééditant d'abord le départ de l'exposition, suivant un procédé employé plusieurs fois par Saint-Saëns) avec parties fuguées (autre procédé fréquent chez lui); ensuite par une exposition de nouveau de la deuxième idée, entière, cette fois en sol majeur — ce qui, à part la tonalité, donne presque l'impression d'une conclusion. Le développement, au lieu de déterminer la conclusion, aboutit alors à la péroraison (premier thème) dont le développement nous conduit à ce qui va constituer l'enchaînement vers l'andante — à l'aide de la deuxième idée — dont la nouvelle exposition, entière au milieu du développement central, permet ici ingénieusement le simple rappel, très écourté.
Ayant atteint, par cet enchaînement qui calme l'agitation du début, le ton de mi bémol majeur, Saint-Saëns impose l'andante. Le défaut de la conception est de donner à cet andante plutôt l'aspect d'une « coda » que d'un véritable morceau lent et en entrave quelque peu l'épanouissement. Il se réduit ainsi à une courte phrase, un milieu et une conclusion répétant avec quelques modifications la première phrase expressive. On peut trouver, d'autre part, que cette expression ne manque pas d'être un peu théâtrale, l'adresse vraiment unique de Saint-Saëns réussissant par ailleurs, dans le milieu intermédiaire, à répéter cinquante-sept fois de suite le même dessin au violon, avec les moyens les plus simples, sans qu'on ait d'autre impression que la satisfaction d'une incroyable aisance.
La deuxième partie qui, comme nous l'avons dit, débute par le scherzo, présente de même un rythme, à l'infini répété, de la plus surprenante facilité. Le trio le poursuit, en accompagnement d'un chant de violon, un peu « choral ». La conclusion, répétition du scherzo, est — suivant le principe général de l'œuvre — très hâtée, le chant de violon (trio) réapparaissant au piano, cette fois tout à fait avec une allure d'orgue et conduisant au départ du final (sur la dominante du ton général). Celui-ci, établi sur les « cinq doigts » en doubles croches, est écrit de verve, avec des passages plus passionnés (deuxième idée — le morceau est de forme-sonate) et parents du style de l'opéra. Dans la péroraison, Saint-Saëns fait réintervenir la seconde idée chantante de son premier allegro qui, en se développant, s'appuie bientôt sur le rythme (au piano) des doubles croches continues — motif de ce final — puis apparition à nouveau de la phrase passionnée du final et terminaison dans les gammes toujours plus animées et de mouvement endiablé.
***
Le Trio en mi mineur, op 92 (1892) pour piano, violon et violoncelle présente la particularité d'être divisé cette fois en cinq parties. Ne voulant pas sans doute se laisser enchaîner par l'emploi, toujours, des mêmes procédés, Saint-Saëns s'est ici dirigé à l'extrême opposé de l'œuvre précédente — du moins pour ce qui concerne la charpente générale — restant au fond équivalant à lui-même et de même style. Aussi bien il a renoncé à tous rappels de motifs, chaque morceau formant un tout et ne se liant aux autres que par l'unité générale de la conception, comme le faisaient les classiques allemands du XVIIIe. La première partie est de forme-sonate, la dernière apparentée au rondeau — au milieu de l'œuvre (troisième partie) un andante assez court, établi sur un seul membre de phrase, est précédé et suivi de deux scherzos (deuxième et quatrième parties). Beethoven avait fait quelque chose d'approchant dans son treizième quatuor. L'andante central n'est pas sans analogie avec Schumann et d'un romantisme rarement employé par Saint-Saëns, mais qui, par son équilibre, s'éloigne du musicien allemand et rejoint l'académisme du maître français. L'œuvre entière est d'ailleurs assez tournée vers le romantisme avec sa première partie nostalgique — cet andante central — et le deuxième scherzo (un peu une « allemande »). Elle se termine par une sorte d'évocation de la « Bénédiction des poignards » des Huguenots — sans réminiscence précise toutefois — qui prouve l'affection assez difficile à admettre de Saint-Saëns pour l'ancien opéra historique.
***
La Deuxième Sonate pour piano et violon, en mi bémol majeur, op. 102 (1896), ne présente pas la même recherche d'intérêt général que la première, et Saint-Saëns semble avoir renoncé dans cette œuvre, ainsi que dans la Deuxième Sonate pour piano et violoncelle, op. 123 (1905), à toute tentative de renouvellement des formes classiques. Par contre, son écriture devient de plus en plus adroite, elle se complique tout en gardant la même clarté. Elle atteint à une transparence absolument remarquable dans la Romanza, qui fait troisième partie de la Deuxième Sonate pour violoncelle. Dans cette dernière un scherzo, avec huit variations, est d'une habileté, d'une variété extrêmes. L'originalité de cette forme — variations appliquées à un scherzo — la richesse avec laquelle elle est traitée, l'écriture du violoncelle lui-même, si bien adaptée à l'instrument, sont d'un haut intérêt.
***
Il faut noter encore d'autres œuvres de musique de chambre de moindre importance : Romances, pour violon, violoncelle, op. 48 et 51 ; Allegro appassionnato, pour violoncelle et piano, op. 43 ; Wedding cake, caprice-valse pour piano et quatuor d'archets, op. 76 ; Caprice sur des airs danois et russes, pour flûte, hautbois, clarinette et piano ; le Cygne, charmante mélodie pour violoncelle et piano, extraite du Carnaval des animaux (1887) ; Morceau de concert, pour cor et piano, op. 94 ; Barcarolle, pour violon, violoncelle, harmonium et piano, op. 108 ; Fantaisie, pour violon et harpe, op. 124 ; des Sonates, pour hautbois, op. 166, pour clarinette, op. 167.
Il faut noter enfin deux Quatuors à cordes, le premier en mi mineur, op. 112, le deuxième en sol, op. 153, où la parfaite mise en œuvre et l'équilibre remarquable des parties a assuré à Saint-Saëns une excellente réussite dans cet art difficile que bien peu d'auteurs sont capables de tenter avec succès.
***
Telle est la production, souvent hâtive et accueillant des idées d'un choix quelquefois insuffisant, d'un des maîtres les plus abondants que présente l'histoire de la musique en tous pays. Le dédain naturel qu'il a toujours manifesté pour les outrances et les modes — passant indifférent à travers les engouements d'un moment — nous a valu une œuvre très égale, très unie, trop académique sans doute et de peu de don de soi, mais modèle de forme habile et aisée — et qu'aucune apparition des météores les plus lumineux de la musique n'a pu faire dévier un instant de sa ligne, toujours droite et sans heurts.
EMMANUEL CHABRIER. — Alexis-Emmanuel Chabrier, né à Ambert (Puy-de-Dôme) le 18 janvier 1841, mort le 13 septembre 1894, commença de très bonne heure l'étude du piano. Entré à dix ans au lycée de Clermont-Ferrand, il prenait en même temps des leçons d'accompagnement du violoniste Tarnowsky et cherchait déjà à composer. Son père, ne s'opposant pas formellement à ce qu'il s'adonnât à la musique, exigeait cependant qu'il prît, à côté, une carrière rémunératrice et, venu à Paris en 1856 pour achever, jusqu'au baccalauréat, ses études au lycée Louis-le-Grand, il dût commencer ensuite son droit. Ne perdant pas de vue la musique qui, seule, l'intéressait, il fut, à cette époque, élève d'un pianiste polonais, ami et condisciple de Chopin : Edouard Wolf. Chabrier devint rapidement exécutant remarquable, d'une habileté, surtout de main gauche, unique. Semet fut son maître pour ce qui concerne l'harmonie, le contrepoint et la fugue, et Aristide Hignart pour la composition. Devenu, une fois licencié en droit, modeste employé au Ministère de l'Intérieur où il resta dix-huit ans de 1862 à 1880, Chabrier se prit d'amitié pour P. Verlaine et surtout pour Manet et les peintres impressionnistes — dont il sut réunir et collectionner plusieurs œuvres importantes — puis il fit la connaissance des jeunes musiciens notoires de sa génération ou un peu plus jeunes : MM. Fauré, d'Indy et les élèves de Franck.
Ses premières publications remontent à 1860, mais il faut atteindre 1877 pour que sa réputation commence à s'affirmer avec une œuvre en trois actes jouée aux Bouffes-Parisiens : l'Etoile. Ayant accompagné M. Henri Duparc à Munich, en 1880, pour assister à des représentations wagnériennes, Chabrier fut à ce point enthousiasmé qu'il se décida à définitivement supprimer toute entrave à ses occupations musicales en abandonnant son emploi au Ministère. C'est à cette époque qu'ayant fait la rencontre de Lamoureux, il accepta de devenir son secrétaire et chef des chœurs. A ce dernier titre il dirigea les études de Lohengrin et de Tristan et Isolde. Puis, en 1883, à la suite d'un voyage en Espagne, il écrivait son éblouissante rhapsodie orchestrale : España, qui mit son nom tout à fait au premier plan. Deux ans plus tôt (1881), il avait publié ses Dix pièces pittoresques, pour piano ; en 1883, les Trois valses romantiques ; en 1885, Habanera.
Puis ce furent de nombreux déboires : Gwendoline, opéra en trois actes, refusé à l'Opéra, joué une seule fois à Bruxelles (1886) — la direction ayant fait faillite — et ne parvenant à être représentée en France qu'en 1893, après avoir passé par plusieurs théâtres allemands — le Roi malgré lui, joué à l'Opéra-Comique en 1887 et arrêté dès les premières représentations par l'incendie de ce théâtre. En 1890 paraissaient des mélodies et le chœur : A la musique ; en 1891 Bourrée fantastique, pour piano. Il ne put achever sa dernière œuvre : Briséis dont un acte seulement fut écrit (depuis exécuté par Lamoureux en 1897 et représenté à l'Opéra en 1899) une longue et cruelle maladie aboutissant à la paralysie cérébrale ayant terrassé la verve joyeuse et fantasque du malheureux musicien. Air de ballet et Cinq pièces posthumes furent publiés après sa mort, en 1897.
***
Très évidemment, l'intérêt principal de l'œuvre d'Emmanuel Chabrier (Enoch, éditeur) est bien plutôt dans le maniement prestigieux qu'il a su avoir de l'orchestre qu'au point de vue spécial qui nous occupe de la musique de piano. Pour ce qui regarde la musique de chambre, il n'eut jamais et ne pouvait avoir la tentation d'en écrire. Toutefois, si nous nous trouvons ici en présence d'inspirations plus intimes où sa verve devait forcément s'apaiser, celle-ci se montre souvent — bien qu'atténuée du coloris de l'orchestration — et beaucoup de pages nous dévoilent le côté tendre, la sentimentalité primesautière, si sympathique de son talent, ou l'esprit, plutôt la roublardise instinctive du bon garçon qu'il fût. Ayant horreur de la banalité — malgré quelque vulgarité — et épris de toutes les nouveautés, de tous les modernismes qui ont mis en branle plus tard l'imagination de ses cadets il fut le père, très inconscient, des musiciens les plus avancés des dernières années du XIXe siècle ou surtout des premières de celui-ci.

fac-simile d'un autographe d'Emmanuel Chabrier
Sa caractéristique principale paraît être le « mouvement ». Bien de son temps, admirant et respectant les maîtres classiques, mais beaucoup plus soucieux de regarder devant lui qu'en arrière, son enthousiasme se rassasiait des maîtres disparus, Beethoven, Wagner surtout et aussi de ses contemporains, fussent-ils fort éloignés de lui-même, comme Franck (dont il prononça, avec combien d'émotion, l'éloge funèbre). Esprit ouvert à tout ce qui lui semblait généreux, « artiste », à l'affût de toutes les manifestations nouvelles : poésie, peinture aussi bien que musique, certainement peu critique et quelquefois s'égarant, Chabrier nous a laissé une œuvre très inégale, mais d'un intérêt considérable, qu'il ne soupçonnait pas lui-même et que beaucoup ne soupçonnaient guère dès l'abord. Berlioz, Schumann — combien d'autres — mais surtout Wagner l'ont influencé. Il a commencé à montrer quelles conséquences imprévues un français pouvait, à l'aide d'inépuisables imaginations de rythmes, tirer de l'œuvre du maître de Bayreuth. Wagner a été un homme si extraordinaire, si prodigieux et passionnant — ce dont on semble ne plus se rendre compte aujourd'hui — que toute une génération en a subi et devait justement en subir l'emprise, l'envoûtement, à peine atténués par ailleurs par l'influence de Franck. Mais beaucoup ne voyaient que tel ou tel côté de son génie et, généralement, s'acoquinaient à marcher dans ses traces, sans renouvellement. Pour Chabrier, Wagner n'a pas été un modèle qu'il cherche à suivre pas à pas et à copier mais seulement un formidable animateur. Guidé par l'enthousiasme qui seul est susceptible de donner naissance à des œuvres véritablement vivantes, qui agissent sur l'avenir et qui restent — quelle erreur de croire que la durée est réservée aux œuvres froidement et solidement écrites ! Celles là au contraire dureront, vivront qui ont su être d'abord et avant tout vivantes à l'origine — et conduit surtout par le génie du Rythme que sa verve prévoyait et faisait naître sous ses pas, toujours imprévu et divers, Chabrier a semé généreusement pour les musiciens qui l'ont suivi. Ce n'est pas lui qui devait rentrer la récolte ; mais, sans lui, les Debussy, les Ravel auraient-ils été possibles ? Franck, resté attaché à la tradition, préoccupé certes de la renouveler, mais tout entier tourné vers le passé, peu compréhensif du modernisme ou, instinctivement, en déniant l'intérêt, a laissé, à la vérité, des œuvres fort belles mais qui, essentiellement, ne pouvaient être génératrices d'avenir. L'imitation pure et simple de Wagner, plus ou moins amalgamée de Franck, aboutissait à un état stationnaire — et, qui n'avance pas recule. Avec Chabrier, au contraire, nous trouvons comme un passage, très vague, très indécis et inconscient vers quelque chose d'encore inconnu, imprévisible. Mais, par lui, la vie se dirige, se coule, irrésistible. L'esprit généreux, la sensibilité curieuse, avide de nouveautés se font jour, malgré toutes les difficultés, à travers les buissons trop touffus et les ronces et — sans vouloir regarder en arrière, se défiant du passé trop beau et trop attirant — se dirigent, avec la véritable foi, vers les clairières libératrices et illuminées de nouveaux rayons, que d'autres atteindront peut-être mais vers lesquelles il aura seul montré la route. C'est ainsi qu'autrefois, après ce sommet indépassable : J.-S. Bach, son fils Philippe-Emmanuel, irrésistiblement poussé par son temps, sema le grain qui devait lever avec J. Haydn. Après R. Wagner, autre sommet également indépassable, Chabrier annonça le mouvement qui engendra l'impressionnisme, s'affirma chez Debussy et ses successeurs.
***
Les Dix pièces pittoresques commencent par un Paysage dont le titre est assez difficilement explicable. Il fait penser cependant aux modes picturales de l'époque (le plein air). La couleur en est — comme pour la plupart des autres pièces — vive, séduisante par sa gaîté, sa joie. La charpente générale est suffisamment équilibrée, mais sans grande recherche. Chabrier est très respectueux des formes établies, il note ses effets avec le plus grand soin, de la façon la plus méticuleuse et semble fort préoccupé d'écrire correctement et dans les règles. Cela forme un contraste curieux avec, dans le détail, une verve pétaradante, toujours prête à démolir les obstacles — non à les sauter avec élégance. Cette verve, si elle n'avait pas été réfrénée par le respect, si elle s'était laissée aller davantage, aurait pu nous donner des résultats bien plus importants — mais tel n'était pas le rôle qui était attribué à Chabrier dans l'évolution musicale et quelqu'ait été son élan vers l'avenir, il manifestait de la sorte qu'il était encore, un peu malgré lui, lié au passé. Respect aussi pour les « développements » souvent laborieux, les « conclusions » qui répètent un peu trop longuement et sans assez les modifier les « expositions ».
Le n° 2 : Mélancolies, avec son tempo « sempre rubato », si employé depuis et de tendance à rompre la monotonie d'une exécution trop uniforme, présente des mesures alternées à 9/8 et 6/8, dans une atmosphère de tendresse. Vers la fin, un canon à la double octave grave, puis à la quinte grave — sans s'y attarder cependant...
Le n° 3 : Tourbillon, d'une animation qui fait songer à l'Ouverture de Béatrice et Bénédict, de Berlioz, harmonies de l'époque, mais avec désirs de faire des frottements inédits, encore dans l'enfance toutefois. Il n'insiste jamais sur un rythme : d'abord franc, il le laisse bien vite pour un plus complexe et insinuant.
N° 4 : Sous bois — un des plus remarquables de la série, bien « débuts de l'impressionnisme ». Sur un ingénieux trait de piano, se poursuivant d'un bout à l'autre, s'établit une mélodie heureusement coupée, appuyant les contretemps et agrémentée de gruppetti schumanno-wagnériens, avec une grande finesse de rythmes et un milieu particulièrement intéressant comme piano. Imitations, canon même, avec deux éléments — de bons développements presque purs.
N° 5 : Mauresques, morceau d'une fantaisie charmante, malgré son apparence un peu démodée : effets de sourdine, notes piquées — ancêtre des Nuits à Grenade (Debussy) et autres exotismes pittoresques.
N° 6 : Idylle, qui porte l'indication : avec fraîcheur et naïveté — une naïveté non exempte de quelque roublardise... Un chant, accompagné de notes piquées, puis liées, d'un sentiment assez campagnard — un des plus connus, à juste titre, de la série.
N° 7 : Danse villageoise, où l'entrain de Chabrier se donne carrière, tout en montrant sa connaissance des classiques — quelques éléments rappelant même la 25e Sonate de Beethoven (Sonatine), mais avec indépendance et sans traditionalisme étroit.
N° 8 : Improvisation, la plus remarquable des Dix pièces, fantasque et passionnée, avec la plus grande variété de rythmes, l'inauguration de certains procédés employés depuis par Debussy et d'autres (quatre croches pointées dans une mesure à 6/8 par exemple). Ce six-huit devient, par moments, presque du trois-quatre ou du deux-quatre, ces différentes mesures se superposant. Malgré toute liberté ce morceau n'est pas décousu, ferait penser à quelque fantaisie de Mozart. Son titre, fort bon, ramasse des impressions diverses, de la passion — schumannienne — de la gravité à certains moments, quelque séraphisme qui explique son admiration pour Franck — une fin presque géniale. Tout cela n'est pas soutenu par une intelligence très profonde, comme chez Schumann, mais est aussi intéressant et sympathique que possible.
N° 9 : Menuet pompeux, allegro « franco », sorte de transformation, d'élargissement des menuets de Mozart modernisés.
N° 10 : Scherzo-valse, morceau plein de mouvement et d'originalité rythmique.
***
La Bourrée fantasque (1891) est une des œuvres de piano les plus célèbres de Chabrier. Sa verve, ses recherches qui atteignent la plus grande complexité harmonique, ses modulations, toujours inattendues, ses ingénieux frottements, la variété de ses rythmes, présentent une particulière surabondance. Les sentiments s'y opposent perpétuellement. L'animation du début fait place, dans le milieu, à des passages de tendresse et de douceur devenant par moments plus chaleureux, avec l'intervention d'un thème de haute fantaisie se développant par quintes mélodiques — par croches d'abord, puis ensuite augmenté — le tout s'entrecroisant avec des rappels du thème principal. Quand celui-ci réapparaît, à la conclusion, il devient d'une agitation forcenée qui fait penser à celle d'España, et d'autant plus expressive que le thème venait de s'exposer « avec mélancolie ». Le Brio des traits en doubles croches de la main droite l'enveloppe d'une lumière étincelante. La fin, à l'aide du thème du milieu, est des plus curieuses dans la violence de son désir de dislocation, et l'intervention inopinée, dans les dernières mesures, de l'accord de sous-dominante (cadence plagale) au sommet de la force, termine à souhait cette œuvre de hardiesse où l'on se plairait à voir une sorte de poème dédié par Chabrier à son pays natal.
***
Des Cinq pièces posthumes : l'aubade, joyeuse — le Ballabile dont la fin, par augmentation, poétise un début simple mais de charmant mouvement — le Caprice, avec ses appogiatures inférieures wagnériennes, — mais quelle différence entre la couleur profondément allemande de Wagner et celle de Chabrier, toujours lumineuse et gaie ! — commence passionnément et s'efface peu à peu dans le calme, la mélancolie teintée de derniers espoirs — le Feuillet d'album, jolie signature attendrie — la Ronde champêtre dont le début est assez « Grétry » (la danse n'est pas ce que j'aime de Richard Cœur de Lion), avec ses traits harmonieux et enveloppants, sa spirituelle modulation de la mineur en si bémol majeur conduisant à un milieu très animé et où l'on sent, comme dans la plupart de ses compositions pour piano, l'orchestre éclatant de l'auteur d'España, invisible, mais toujours présent.
***
Les Trois valses romantiques, pour piano à quatre mains (orchestrées depuis par Felix Mottl — comme la Bourrée fantasque — ainsi que les numéros 4, 6, 7 et 10 des Pièces pittoresques) complètent l'œuvre de piano de Chabrier dans le brio et la vie.

Autour du piano. D'après le tableau d'Henri Fantin-Latour (1885, musée du Luxembourg). Au piano, Chabrier ; appuyé au piano, Edmond Maître ; debout à droite, Vincent d'Indy.
M. GABRIEL FAURÉ. — M. Gabriel-Urban Fauré, né le 13 mai 1845 à Pamiers (Ariège), quitta son pays natal dès l'âge de neuf ans pour venir à Paris faire ses études musicales à l'école Niedermeyer. Il y travailla avec le directeur lui-même et avec Dietsch — mais principalement avec C. Saint-Saëns. Ayant obtenu la plupart des récompenses qui pouvaient lui être décernées dans cet établissement, il quitta l'école pour tenir l'emploi d'organiste (janvier 1866) à l'église Saint-Sauveur de Rennes. Nous le retrouvons, à partir de 1870, à Paris, où il devient accompagnateur successivement dans plusieurs églises, puis maître de chapelle et enfin organiste du grand orgue de la Madeleine (1896). Nommé la même année professeur de composition au Conservatoire, il passe directeur en 1905 et est élu membre de l'Institut, en 1909, en remplacement d'Ernest Reyer. En 1909, également, il est choisi comme président de la Société musicale indépendante (S. M. I.) lors de sa fondation.
Ses premières mélodies avaient été chantées dans les concerts du début de la Société Nationale. Une Suite d'orchestre en fa, puis les Djinns précèdent l'apparition de sa première œuvre de musique de chambre : la Sonate en la, pour piano et violon (première audition par Maurin et l'auteur, le 5 juillet 1878, aux Concerts du Trocadéro), sonate qui fut célébrée alors par Saint-Saëns avec un véritable lyrisme. Depuis, M. G. Fauré, outre de nombreuses mélodies — un des plus beaux fleurons de sa couronne — et de plus rares œuvres d'orchestre — une seule œuvre de théâtre : Pénélope, nous a donné de nombreuses pièces pour piano et d'importantes productions de musique de chambre.
Musique de piano :
Cinq impromptus : les trois premiers de 1883, op. 25, 31 et 34 ; le quatrième (1906), op. 91 ; le cinquième (1910), op 102.
Quatre valses caprices : op. 30 (1883) ; op. 38 (1884) ; op. 59 (1891) ; op. 62 (1894).
Une mazurka : op. 32 (1883).
Treize nocturnes : les trois premiers de 1883, op. 33 ; le quatrième, op. 36 (1884) ; le cinquième, op. 37 (1884) ; le sixième, op. 63 (1894) ; le septième, op. 74 (1898) — le huitième est la dernière des huit pièces brèves, op. 84 (1898-1902) — le neuvième, op. 97 (1908) ; le dixième, op. 99 (1909) ; le onzième, op. 104, n° 1 ; le douzième, op. 107 ; le treizième, op. 119.
Treize barcarolles : la première, op. 26 (1883) ; la deuxième, op. 41 (1885) ; la troisième, op. 42 (1885) ; la quatrième, op. 44 (1886) ; la cinquième, op. 66 (1895) ; la sixième, op. 70 (1896) ; la septième, op. 90 (1906) ; la huitième, op. 96 (1908) ; la neuvième, op. 101 (1910) ; la dixième, op. 104 n° 2 ; la onzième, op. 105 ; la douzième, op. 106 ; la treizième, op. 116.
Pour piano à quatre mains : Dolly, six pièces, op. 56 (1893-1896) : 1. Berceuse ; 2. Mi-a-ou ; 3. le jardin de Dolly ; 4. Kitty-valse ; 5. Tendresse ; 6. le Pas espagnol.
Musique de chambre :
Première Sonate, piano et violon, op. 13 (1876) ; Premier Quatuor en ut mineur, piano et cordes, op. 15 (1879) ; Berceuse, violon et piano, op. 16 (1880) ; Elégie, violoncelle et piano, op. 24 (1883) ; Deuxième Quatuor en sol mineur, piano et cordes, op. 45 (1886) ; Romance, violoncelle et piano, op. 69 (1895) ; Andante, violon et piano, op. 75 (1898) ; Papillon, violoncelle et piano, op. 77 (1898) ; Sicilienne, violoncelle et piano, op. 77 (1898) ; Quintette en ré mineur, piano et cordes, op. 89 (1906) ; Sérénade, violoncelle et piano, op. 98 (1908) ; Deuxième Sonate, piano et violon, op. 108 (1917) ; Impromptu et Une châtelaine en sa tour, pour harpe ; Première Sonate, violoncelle et piano, op. 109 (1918) ; Deuxième Quintette, piano et cordes, op. 115 (1921) ; Deuxième Sonate, violoncelle et piano, op. 117 (1922) ; Trio, piano, violon et violoncelle (1923).
A part la Première Sonate, piano et violon, éditée chez Breitkopf et Haertel, et le Premier Quintette, chez Schirmer, à New York, toutes les autres œuvres sont éditées chez Hamelle, jusqu'à l'op. 89, puis, jusqu'à l'op. 103, chez Heugel, et, en dernier lieu, chez Durand.
***
M. G. Fauré est éminemment personnel et il est des plus difficiles de lui assigner une ascendance précise, comme nous l'avons vu dans l'introduction. C. Saint-Saëns et, par delà Saint-Saëns, Mendelssohn ; Chopin, Schumann — toutes ces influences sont bien vagues — celle de Saint-Saëns a pourtant quelque réalité. On a souvent appelé M. G. Fauré le « Schumann français ». Il me semble qu'il n'y a rien de plus faux que cette comparaison, la recherche de M. Fauré étant, avant tout, décorative et non expressive comme celle de Schumann. Celui-ci, romantique, attaché à la tradition beethovenienne, a eu une tendance à en exagérer plutôt l'expression, l'humanité — laissant, par ailleurs, le côté architectural qui gênait sa fantaisie, sa passion. Tout en poursuivant des harmonies chromatiques, perpétuellement changeantes, mobiles — ce qui est bien différent de Beethoven — il avait, en les ouvrageant, et malgré tout leur intérêt purement musical, un but qui apparaît en soi essentiellement différent de celui de M. Fauré. Le maître français est, lui, classique — mélodiste dirigeant la ligne sonore avec une fantaisie indolente qui lui est bien propre, mais instinctivement ordonnée — et quelques complexes et fuyants qu'en soient les détours, il les ramène volontairement à des cadences parfaites et de simplicité inattendue qui retombent juste au moment nécessaire pour en fermer le sens de façon précise et dans la clarté. Son architecture, pour être traitée avec quelque indifférence, et acceptant le cadre traditionnel plutôt que cherchant, comme C. Franck, à le renouveler, est toujours simple et équilibrée — ce que n'était pas celle de Schumann. Pour ce qui regarde l'expression, l'humanité, il les laisse intentionnellement au second plan, les combinaisons sonores lui paraissant plus désirables, plus attrayantes qu'un développement excessif de passion ou une philosophie, une intellectualité qui, pour lui, s'éloignent par trop de la pure conception musicale.
Classique, il l'est intimement, profondément — mais sachant comprendre l'esprit du classicisme et, conséquemment, en renouveler la lettre à laquelle d'autres restent indifféremment attachés. La façon dont il en accepte les architectures prouve à quel point le sentiment classique est chez lui direct, naturel : il est de la grande famille méditerranéenne qui a produit la beauté grecque, les œuvres ancestrales d'ordre et de lumière, éternels modèles de perfection jamais, depuis, dépassés, à peine atteints. Un certain manque de conviction peut être reproché à son maître, C. Saint-Saëns : ce manque de conviction, en s'épurant, en prenant un sens et de la noblesse, est devenu l'Indifférence fauréenne, un sentiment, une conviction, au contraire, que l'artiste doit être, par rapport aux humanités quotidiennes un peu distant, un peu méprisant et qu'il doit sacrifier l'expression de trop particulières, trop journalières émotions — auxquelles il dénie sans doute l'intérêt — à la pure beauté des lignes et des couleurs.
Se dépouiller d'humanité pour devenir quasi-divin, exprimer sa sensibilité non directement mais en la transformant dans une sorte de sensibilité purement sonore qui reste si vivante qu'une de ses principales caractéristiques est la volupté — être classique de lignes tout en les compliquant normalement à notre temps, et, pour la couleur, atteindre un chatoiement, des irisations jusque là inentendues, telles sont, semble-t-il, les directives auxquelles a obéi M. G. Fauré et qui ont abouti aux œuvres les plus personnelles, les plus françaises, faisant honneur au génie gréco-latin, au génie de notre race et l'exprimant bien loin des influences étrangères et, spécialement, germaines.
M. G. Fauré a eu la plus grande action sur les générations qui l'ont suivi. Il a définitivement engagé notre école dans une voie qui lui soit propre et — plus encore peut-être que dans la suite Cl. Debussy — de notre climat, de notre ciel léger et changeant, des lignes familières de nos paysages coutumiers. La longue carrière qu'a parcourue déjà M. G. Fauré — et qu'il poursuit, pour notre joie, avec une maîtrise chaque jour plus grande et plus assurée, à un âge où la plupart se reposeraient ou produiraient des œuvres de moindre intérêt — ne peut manquer de donner lieu, lorsqu'on la regarde d'ensemble, à des subdivisions toutes naturelles, suivant que l'on considère la jeunesse, la maturité ou la verte vieillesse du maître.

fac-simile d'un autographe de Gabriel Fauré (Bibliothèque du Conservatoire)
Contrairement, on pourrait le dire encore, à Schumann qui s'était exprimé tout entier dès les Papillons ou le Carnaval, et s'est fort peu modifié par la suite, M. Fauré, tout en ayant montré très complètement, lui aussi, sa personnalité originale dès ses débuts (témoin sa Ballade, pour piano et orchestre) n'a pas cessé d'évoluer, d'épurer sa conception tout le long de sa vie et il y a fort loin de sa première, et charmante, Barcarolle en la mineur à la troisième, puis à la septième. Mêmes différences entre le premier Nocturne et le sixième, puis le neuvième. Ligne souple de la mélodie, chatoiements harmoniques sont toujours là et dès les premières productions, mais quelles différences entre l'expression un peu superficielle et mondaine de la période de jeunesse et la maîtrise affirmée de la maturité, ou, depuis, le dépouillement, devenu définitif, de toutes formules, le renoncement à tout laisser-aller hâtif, à toute acceptation qui l'éloignent de son but — chaque étape de la composition longuement mûrie et consciemment, minutieusement établie pas à pas vers l'idéal qui lui est propre.
***
Il est significatif que M. Fauré n'a jamais voulu donner de titres à ses compositions (excepté une seule fois : Papillon, pour violoncelle et piano) et s'est contenté de les dénommer d'appellations toutes générales comme Barcarolles, Nocturnes, Impromptus, etc. , inspirations de fantaisie ou de sentiment, dans un mouvement rapide ou lent, et rien de plus. Le motif de nature ou intime qui a donné naissance à ces inspirations reste volontairement dans l'ombre. L'auteur en a-t-il pris lui-même conscience ou s'en est-il d'habitude peu soucié ? Je pencherais volontiers vers cette dernière probabilité.
Si l'on parcourt d'abord les treize Barcarolles, dès la première on sent que l'on se trouve en présence d'un véritable écrivain de piano. La souplesse, l'agilité, la variété des dessins, des rythmes simultanés sont bien propres à l'instrument et conçues pour lui seul. Il n'y a pas là de souvenirs d'orgue (M. Fauré est pourtant organiste lui aussi, mais nous verrons qu'il en fut touché autrement) comme chez C. Franck. On ne se trouve pas en présence d'une sorte de réduction d'orchestre ou d'une composition qui évoque la possibilité d'une orchestration après coup, comme chez tant d'autres. Arabesques et arpèges qui agrémentent une mélodie toujours chantante, distribués avec une ingéniosité toute naturelle et une extrême variété aux différents étages du clavier, sans jamais d'excès, mais en se servant judicieusement de tous les degrés de force — pédales sans que leurs effets en soient poussés à des particularismes exagérés — l'exécution de ces pièces en prouve la finesse, le goût, la distinction sonore.
Les premières Barcarolles sont conçues dans un style assez mendelssohnien, mais coloré et d'un charme enveloppant qui attire et séduit. M. Fauré s'y laisse quelque peu aller par moments à un lyrisme, alors un peu superficiel, auquel il a renoncé avec raison depuis. Intéressé dès ce moment par des subdivisions colorées, des nuances harmoniques auxquelles il donnait instinctivement tous ses soins, cette recherche qui va à l'encontre d'un don plus profond de l'être ne pouvait lui permettre une réussite en même temps à l'autre point de vue. La deuxième Barcarolle présente une terminaison d'une adresse et d'une élégance que nous retrouverons par la suite dans presque toutes les autres productions de M. Fauré. Il semble que le maître a toujours eu une coquetterie spéciale pour ces fins qui, toutes, sont des trouvailles laissant une impression de perfection et de charme auxquels on ne peut résister.
La troisième Barcarolle nous révèle une évolution savoureuse dans le style de l'auteur. La fluidité des traits, la légèreté dans l'expression, l'habileté dans les silences et les rentrées, la distribution charmeuse de tous les éléments choisis, la complexité des modulations qui s'éloignent sans s'égarer et reviennent avec une inimitable grâce à leurs points de départ, décèlent une abondance d'imagination sonore, une variété qu'on pourrait dire éblouissante si elles ne se maintenaient toujours dans la mesure la plus classique et atténuées par une élégance, un raffinement distingués à l'extrême. La quatrième, fort courte, est un tableau achevé ; la cinquième, qui atteint à la limite de la complexité fauréenne, a des alternatives de douceur et de puissance, des accents lyriques et passionnés — qui, plus discrets dans la sixième, tendent à s'effacer vers des traits à juste titre plus impersonnels et indifférents.
A partir de la septième, et dans les suivantes, nous trouvons ce qu'on pourrait appeler le troisième style de M. G. Fauré, dépouillé de trop de surabondance, renonçant à ce qui lui apparaissait comme touffu à l'excès, ne conservant que la fleur de ses trouvailles. Le phrasé devient plus sévère, s'établit par de courts fragments et s'éloigne souvent de la mélodie plus facile, populaire et carrée que l'on rencontrait précédemment. Les éléments rythmiques simultanés sont moins nombreux. Par contre les recherches harmoniques deviennent de plus en plus curieuses et la préoccupation de la pure musique s'affirme encore davantage, malgré quelques accents relativement lyriques qui sont plutôt des oppositions assez brusques de force (huitième) pour faire valoir des passages plus doux. Les dernières Barcarolles participent des mêmes qualités : la neuvième, harmoniquement plus simple et s'obstinant au ton de la mineur ; la dixième, avec ses enharmonies passagères, sa tendance aux quarts de ton ; la onzième, nerveuse, de préciosité harmonique et de mouvement ; la douzième, plus mélodique, sorte de mandoline dont la conclusion présente l'intérêt d'un canon à l'octave, puis à la sixte grave (M. Fauré emploie maintenant beaucoup ce moyen — comme C. Franck — mais combien différemment) ; la treizième enfin, une des plus mélodiques, dans le sens populaire du mot, simple et charmante.
***
Dans les Nocturnes, où M. Fauré, laissant de côté la légèreté de la fantaisie, s'abandonne à la rêverie et recherche un style plus soutenu — qui n'exclue pas pour cela des oppositions de souplesse et d'animation — nous retrouvons les mêmes subdivisions de style que dans les Barcarolles. Le premier, avec ses croisements de mains et les notes répétées de sa conclusion brodant un délicat accompagnement sous un chant expressif ; le deuxième, et ses doux frottements de secondes alternant avec un centre agité, un peu mendelssohnien ; puis le troisième et le quatrième, qui font songer assez nettement à Chopin ; le cinquième, qui, de nouveau, présente un « allegro » en son milieu — nous conduisent à l'incomparable Sixième Nocturne en ré bémol, dont la phrase, doucement conduite à l'aide de moyens et d'harmonies aussi simples qu'imprévus, retombe d'abord par trois fois, avec combien de naturel, sur la cadence parfaite. L'architecture de cette pièce, plus cherchée et complexe que d'habitude — M. Fauré est plus attiré vers les raffinements de détails que vers les ensembles — présente un équilibre parfait à l'aide de trois fragments différents : un adagio, un allegretto moderato qui, par l'entremise d'un retour de l'adagio, amène un allegro moderato. Symétriquement l'allegretto réapparaît, puis de nouveau l'allegro qui fait revenir par une rentrée savoureuse la conclusion « adagio ». Peut-être pourrait-on seulement reprocher à cette pièce l'emploi trop fréquent — il apparaît assez souvent par ailleurs — de progressions harmoniques qui, pour s'établir sur des modèles d'une grande complexité et d'une extrême richesse, n'en ont pas moins de la froideur et ne constituent pas, à vrai dire, de véritables développements — mais le charme de la sonorité et la beauté, le brillant du vêtement harmonique joliment tissé font oublier vite toute critique. Le Septième Nocturne, en ut dièse mineur, avec son début plus sévère, et profond, fait place à un milieu animé et de fantaisie et, après la rentrée du « molto lento », se termine en ré bémol majeur dans la douceur et l'apaisement. Il prépare, par l'élévation de la pensée et la pureté de sa tendance, l'évolution prochaine. Après les doubles croches continues et d'une souple aisance environnant le chant expressif du huitième — qui fait partie des Huit pièces brèves — nous atteignons, dans les cinq derniers Nocturnes, un style équivalent à celui des dernières Barcarolles. Le neuvième, le dixième, où s'expose une phrase très simplifiée et de courts fragments — qui parvient, par les chemins les plus inattendus et semblant devoir encore s'éloigner, à la modulation classique et subite à la dominante — se poursuit toujours mélodique, mais d'une mélodie qui semble plutôt le développement d'un thème que l'auteur dédaigne de nous faire entendre dès l'abord. La douce mélancolie du onzième — la curieuse série d'affirmations que présente en son début le douzième, par quatre fois répétées, faisant place à des jeux de doubles croches avec frottements de demi-tons, et s'élevant enfin peu à peu jusqu'à une lamentation passionnée qui retombe à la terminaison, indécise comme déjà dans la Dixième Barcarolle — entre le majeur et le mineur, pour s'achever à ce dernier — la pureté d'écriture distante et aristocratique du treizième, d'une tristesse, dans le milieu, près de la désespérance — toutes ces œuvres montrent le pur musicien attaché à ses recherches, bien loin de toute autre préoccupation musicale que les siennes propres, qui lui suffisent et qu'il poursuit dans l'éloignement, avec une définitive maîtrise.
Exquises irisations harmoniques, simplification, dépouillement qui dissipe les derniers voiles pouvant masquer encore l'originalité intime, essentielle de sa pure conception, nous trouvons dans ces œuvres récentes un admirable modèle de l'Œuvre idéale et un exemple des résultats que peut donner une pensée persévérante, attachée à se développer sans cesse depuis les premiers débuts.
***
Des cinq Impromptus, les trois premiers sont des commencements de la carrière de M. Fauré et datent de 1883. Le quatrième a été écrit fort longtemps après, en 1906, et le dernier date de 1910. C'est dire la distance qui les sépare. Mais elle est ici moins apparente, étant donné le genre de ces œuvres qui sont comme des délassements, des improvisations — à la vérité fort ouvragées et raffinées. Le premier n'est pas le moins intéressant harmoniquement — et aussi, avec le cantabile expressif du milieu, mélodiquement. Il conserve l'expansion de la jeunesse et sa conclusion est amenée avec beaucoup d'adresse. Les deux suivants sont peut-être de qualité moindre, surtout le troisième dont l'allure est plus facile et mondaine, à part un milieu fort heureux. Le quatrième, chose curieuse, n'est pas aussi différent des précédents qu'on pourrait l'imaginer, sauf — surtout dans la partie médiane (adagio) — l'expérience due à la maturité. Le cinquième, par l'usage presque continu de la gamme par tons, prouve que ce moyen peut être employé comme n'importe quel autre (aussi bien la gamme par demi-tons : chromatique), avec l'expression la plus différente suivant les personnalités : elle est ici bien loin des intentions debussystes.
Thème et Variations, dédié à Mlle Thérèse Roger, pourrait faire penser aux Etudes symphoniques de Schumann, mais le thème — assez romantique — et les onze variations dont il est suivi ont plus d'équilibre et de tenue, sont d'un style plus uni que chez le génial maître allemand. Habilement opposées et toujours pianistiques, effaçant, éloignant l'idée mère ou la précisant et la rapprochant, déformant son rythme de variation en variation et en faisant passer l'expression du « soutenu » à la légèreté, au « marcato », à la fantaisie. Au « staccato », ces variations se terminent par une dernière, cette fois majeure, page de la plus remarquable maîtrise d'écriture — toujours pleine de liberté et de hardiesse — où le thème déformé, mais bien visible, à la basse est comme absorbé par les parties supérieures de l'harmonie qui le calment et déterminent un apaisement final d'une grande pureté.
Les Valses-caprices, toujours riches de musique et pleines d'ingéniosité, très développées et variées ; la charmante suite à quatre mains intitulée Dolly — douceur de la Berceuse ou du Jardin de Dolly, et spirituelle fantaisie du Pas espagnol ; l'écriture pure et chatoyante des Préludes — beaucoup plus récents (1910) et du dernier style de l'auteur — complètent l'œuvre de piano si séduisante, pleine de personnalité, de distinction et de volupté sonore du maître français. Certainement, jusque là, rien de semblable, au point de vue pianistique, n'avait été écrit dans notre pays. Depuis, des recherches plus récentes, plus modernes, ont modifié, compliqué la technique du clavier, mais les compositions de M. Fauré, dans leur classicisme bien vivant, de par leurs tendances harmoniques ont devancé leur temps, ont montré la voie et indiqué des territoires encore jusque là inexplorés — dont M. Fauré a lui-même pris possession, en en montrant les replis les plus cachés, les plus secrets. Ses découvertes à ce point de vue sont neuves, les joyaux qu'il a sertis ont un éclat, des feux, des irisations si inimitables et défiant toute comparaison dans le passé ou, par la suite, toute possibilité d'imitation dans l'avenir — qu'ils suffiraient à eux seuls pour affirmer la valeur d'une œuvre unique dans l'histoire de notre musique, et dont elle peut, à juste titre, s'enorgueillir.
***
Les compositions de M. Fauré en musique de chambre ne sont pas d'un moins haut intérêt que celles pour piano. On peut les subdiviser comme elles suivant les différences de style de l'auteur : d'abord la Première Sonate, piano et violon, les deux Quatuors et les différentes pièces pour violon et violoncelle — puis, après un assez long intervalle, les dernières œuvres (les deux Quintettes, la Deuxième Sonate, piano et violon, les deux Sonates, piano et violoncelle, le Trio).
La Première Sonate, piano et violon, fut le premier essai de M. Fauré en musique de chambre et l'on peut, avec C. Saint-Saëns, en célébrer l'importance et la réussite qui devait, depuis, être suivie de tant de chefs-d’œuvre et avoir si grande influence sur les générations nouvelles. M. Fauré est resté, pour ce qui concerne la charpente générale de ces œuvres, dans la donnée classique, dans celle aussi de C. Saint-Saëns (dont on voit ici, bien plus que dans les pièces pour piano, l'influence). Il en a poursuivi, moins encore que ce dernier, le renouvellement et paraît, pour tout dire, en avoir eu peu de souci. Sa recherche est toujours dans le maniement de la modulation, les colorations qu'il en obtient de plus en plus nuancées et subtiles dans une fantaisie de jeu qui l'éloigne de sa tonalité principale, nous la faisant perdre de vue — mais ne l'oubliant pas lui-même et la ramenant toujours au moment le plus inattendu.
Tous les organistes ont toujours subi grande influence de l'instrument qu'ils manient journellement et dont la préoccupation plus ou moins consciente apparaît çà et là dans leurs œuvres. Nous avons vu que chez Franck la technique des claviers d'orgue a eu une action sur sa façon de concevoir la musique de piano. Chez Saint-Saëns on aperçoit également de nombreuses traces de sa pratique de l'orgue — mais à un point de vue déjà moins particulier. Chez M. G. Fauré l'influence a pris un caractère plus général encore. Ce n'est pas l'instrument d'église qui a agi sur sa manière (il a su rester très indépendant au point de vue des formes, qu'il a toujours avec raison choisies pour le piano en rapport avec la technique particulière à ce dernier) mais bien l'atmosphère du plain chant, l'audition habituelle — et qui devait l'attirer — de musique écrite dans les modes antiques. Ce goût des modalités disparues, se combinant avec son instinct de pur classique — et aussi avec les tendances modernistes qui le sollicitaient — a donné lieu à un style, amalgame des plus particuliers, où les tonalités anciennes reprennent leur caractère d'origine, c'est-à-dire non pas liturgiques, mais bien en deçà : païennes. Le modernisme, avec ses subtilités, son imprévu, ses équivoques donne un charme actuel et jeune à cet assemblage plein de saveur et éminemment de notre temps — et à quoi on pourrait reprocher seulement quelque excès de croyance à la tradition, tout au moins aux bases aristocratiques, raffinées de cette dernière — sans assez de souci, avec quelque oubli des instincts, plus forts, qui leur ont donné naissance.

fac-simile d'un autographe de Gabriel Fauré (Bibliothèque du Conservatoire)
La Première Sonate, piano et violon, montre, dès l'abord, la préoccupation de colorations harmoniques imprévues, par un début de tonalité assez indécise qui semblerait plutôt en ut dièse mineur que dans la tonalité principale de la majeur. La deuxième idée, très apparentée à la première, débute aussi en ut dièse pour se reposer, classiquement, sur le ton de mi majeur. L'écriture des deux instruments, perpétuellement mobile et concertante, développe ces motifs avec toutes les tendances à l'extrême souplesse et à la fantaisie, à travers les chatoiements et le charme des modulations. Un andante, d'élégante écriture, un scherzo à un temps, plein de verve rythmique, un final mendelssohnien (comme l'andante) dont la phrase chantante se déroule et se développe dans une délicieuse sonorité — des pédales de dominante et de tonique fort curieuses à la basse vers la fin — telles sont les différentes étapes de cette œuvre, jeune encore, mais montrant une abondance de musicalité, une facile originalité, sûres garantes pour l'avenir de résultats plus importants.
***
Le Premier quatuor, pour piano et cordes, en ut mineur, une des œuvres les plus célèbres de l'auteur — et de la musique de chambre française — en quatre parties, comme la Sonate, ne présente pas non plus de particularités générales, les données classiques acceptées — mais une présentation, une application tout à fait particulières de ces données, dans une sonorité d'un charme vivant et voluptueux qui ferait penser à Mozart.
Exposé aux cordes sur des accords parfaits que scande le piano, le thème de la première partie, très franc d'allure, devient peu à peu plus ondoyant et chromatique dans une écriture très serrée où les deux groupes : cordes et piano, s'opposent nettement. Porté par des arpèges, son développement nous conduit à la deuxième phrase exposée par l'alto, qui montre, plus que l'expression, le désir d'établir surtout une sonorité bien équilibrée dans la rondeur et comme un éclat atténué. C'est là qu'est visiblement la préoccupation de l’auteur : ne pas se servir de la forme pour l'expression d'un sentiment humain trop particulier, mais rechercher une sonorité qui soit non seulement excellente musicalement, mais atteigne par elle-même à l'expression — une expression très générale. Le sentiment de l'œuvre — et des autres œuvres de M. Fauré — reste ainsi comme éthéré, assez loin et dédaigneux de nos douleurs et de nos joies et il est par là bien difficile d'assigner à chacune de ces productions un motif humain quelque peu différencié. Cette conception semble certainement très classique ou du moins très apparentée à celle des époques ainsi dénommées — un peu exclusivement. On pourrait s'étonner cependant que tant d'indifférence tranquille — expression naturelle des siècles atteignant une apogée normale, comme celui de Périclès, par exemple — se trouve être celle de notre époque hâtive et tourmentée. Mais les sonorités trouvées par l'auteur sont si pleines de délicatesse et si justes qu'on aurait peine à lui faire reproche de son idéal particulier à qui nous devons de si voluptueuses jouissances. — Les développements s'établissent avec transparence, du style le plus aisé et coulant, chaque instrument chantant à souhait, tantôt en évidence, tantôt entrecroisé avec ses partenaires. Ils sont assez longs et touffus, mais sans excès et toujours dans une donnée d'évidente clarté. La conclusion et la péroraison restent dans la plus parfaite mesure.
La deuxième partie est un scherzo fort développé. Un art comme celui de M. Fauré ne peut manquer de s'intéresser spécialement à cette forme légère qui semble, mieux que n'importe quel autre, faite pour exprimer son idéal. Léger et indifférent, pizzicati et gammes doucement sonores, que le redoublement d'octaves rend plus pleines, changements ondoyants de rythmes alternant ou superposant le six-huit et le deux-quatre, souvenirs de quelque gondolier des Romances sans paroles, trio avec sourdine — rien ne peut exprimer le piquant de cette pièce où M. Fauré s'est complu à nous détailler toutes les délicatesses exquises que sait lui suggérer une imagination musicale entre toutes.
Par contre, la troisième partie — l'adagio — est assez courte — l'équilibre général de l'œuvre y obligeant. C'est une sorte de cérémonie funèbre, avec une phrase majeure apaisante, où l'on retrouve l'habitué des imposantes cérémonies religieuses du catholicisme.
Le final, ingénieusement bâti sur la gamme mineure (avec sixte majeure) est une pièce remplie de force et d'éclat avec une seconde idée de douce expression. Son exposition se termine dans une mélancolie atténuée d'où repart la deuxième idée pour conduire, par des développements de la première, à la conclusion. Celle-ci, coupée en son milieu par une courte cadence au moment de la rentrée de la deuxième phrase, prépare cette dernière par un gracieux contre-chant appuyé de trilles lents au piano. En péroraison les différents motifs de ce final sont successivement présentés avec une animation et un brio qui terminent l'œuvre dans une sorte de joie dionysiaque.
***
La Berceuse, exquise pièce avec sourdine pour violon et piano, justement célèbre et posée sur tous les pupitres ; l'Elégie, pour violoncelle et piano, fort connue elle aussi, furent les seules productions instrumentales de M. Fauré entre ses deux Quatuors. Le deuxième, en sol mineur, est une œuvre de maturité, plus accomplie encore que le premier au point de vue du maniement des formes. En quatre parties également, avec un scherzo venant aussi en seconde ligne — assez développé, mais moins que celui du Quatuor en ut, l'adagio — troisième partie — semble avoir été l'objet des soins particuliers de M. Fauré. Un final mouvementé, de même animation que le final précédent, clôt cette belle œuvre, tel quelque magnifique ensemble de ballet classique.
Peut-être trouverait-on ici plus de romantisme que dans le premier Quatuor et même une quasi possibilité d'interprétation extra musicale : une mélancolie, un certain désir, dans cette première partie, d'évasion vers les lointains pays... Les rythmes, plus nettement différenciés, donnent lieu à un développement plus dramatique, moins indifférent que de coutume. Mais une expressive idée nouvelle, exposée au début du développement, ramène, à la fin de celui-ci et par diminution, l'allure habituelle de M. Fauré, de même que la conclusion, par l'apaisement du motif principal et la rentrée de cette troisième idée. Il est à remarquer que la deuxième phrase est exposée la première fois dans le ton de la sous-dominante qui accentue encore l'impression de mélancolie...
Je ne puis m'empêcher d'imaginer aussi le scherzo comme le départ décidé vers les pays entrevus et attirants... Les thèmes de la première partie, qui réapparaissent ici, d'abord le second (dans le scherzo), puis le premier (dans le trio) et donnent à cette pièce un caractère de très grande originalité de facture, ne peuvent manquer, par leur « cyclisme » (il s'agit ici non de simples souvenirs mais de transformation de motifs), de tendre à évoquer des émotions plus dramatiques que celles plus simplement lyriques faisant généralement l'objet des recherches fauréennes. L'architecture de cette seconde partie est des plus curieuses et intéressantes avec le déroulement de son trait de piano (diminution du thème de chant de la première partie) et cet emploi du thème rythmique du premier mouvement pour remplacer le trio — intimement soudé au scherzo — et ramenant ensuite le symétrique de celui-ci, toutes expositions changeant d'instruments, le déroulement passant légèrement aux cordes pour revenir finalement au piano — ensemble formant une sorte de développement chaudement coloré et merveilleusement rythmé.
Une phrase tranquille d'alto, suivant de doux tintements de cloches, semble montrer l'arrivée au port souhaité et expose un des adagios les plus parfaits et accomplis qui aient jamais été écrits. Par trois fois l'âme de l'auteur s'épanche et de la douceur monte jusqu'à la passion, retrouvant ensuite l'apaisement dans la sonorité des cloches qui, une quatrième et dernière fois, par une péroraison harmonieuse et assourdie — un peu accentuée par l'alto et le violoncelle — amène la paix.
Le final serait le retour après ce « beau voyage » où la perfection de l'écriture, le charmant équilibre des sonorités, la fluidité instrumentale, les cordes, le piano alternant dans des dialogues toujours judicieux et nourris, sans inutiles excès, composent un ensemble de perfection.
***
Après plusieurs courtes pièces pour violoncelle et piano (Romance, Papillon, Sicilienne) et un Andante pour violon et piano où nous retrouvons les procédés mélodiques et harmoniques de l'auteur donnant lieu à mêmes réussites et mêmes plaisirs voluptueux de l'oreille, nous atteignons son premier Quintette en ré mineur, pour piano et cordes, paru vingt ans après le deuxième Quatuor, où on peut apercevoir les changements de style que devait déterminer pareil intervalle. Une Sérénade, pour violoncelle, le sépare de la Deuxième Sonate en mi, pour violon et piano, œuvre écrite longtemps encore après (1917). Il est intéressant de voir quelle différence, à la vérité considérable, s'établit entre cette sonate et la première — qui avait fait la réputation de M. Fauré — et curieux de constater que, pendant quelque quarante ans, l'auteur charmant de tant d'œuvres de musique de chambre n'eut pas le désir de donner un pendant à sa première tentative, du moins dans la même forme
Ecrite en trois parties, comme les deux sonates pour violoncelle, l'auteur supprime, cela est remarquable, le scherzo. On ne peut s'empêcher de constater — à part toutes les plus personnelles recherches de forme et de présentation — combien l'influence de C. Saint-Saëns aura été plus profonde et réelle sur M. G. Fauré qu'elle n'apparaît à un premier examen superficiel. Elégance — combien plus brillante ; facilité et aisance d'écriture — moindres, mais serait-ce possible au milieu de ces raffinements que ne poursuivait guère, à la vérité, Saint-Saëns ? Et par instants ce classicisme — devenu académisme chez Saint-Saëns — ici retour à un paganisme voluptueux qui, à chaque nouvelle œuvre de M. Fauré, s'affirme toujours plus près de l'antique, avec des recherches actuelles certes, mais qui n'en détruisent pas pour cela le caractère, assez éloigné de nos préoccupations modernes.
M. Fauré, qui a été fort peu touché par le franckisme, n'a pas dédaigné de se servir ici, de façon assez analogue à Saint-Saëns, des rappels de motifs et c'est ainsi que l'on voit apparaître, dans le final, la phrase chantante puis la phrase rythmique du premier mouvement. Cette phrase de chant, environnée d'arpèges, avait servi, assez longuement développée, dans la péroraison de la première partie (autre analogie) après avoir donné lieu à une conclusion dans le ton principal, précédant (procédé de l'ordre inverse) le retour de la première phrase (dont un rythme lui sert d'ailleurs de soutien).
Mais ces détails de charpente générale sont fort peu importants ici et, comme toujours, comme auparavant dans les derniers Nocturnes et les dernières Barcarolles, ce sont les détails d'une écriture raffinée à l'extrême, où la fantaisie modulante atteint les dernières possibilités de nuances chatoyantes, sans s'égarer et revenant toujours à de simples cadences, qui fait l'intérêt principal de cet art aux choix exquis.
Qu'il s'agisse de cette Sonate ou du deuxième Quintette ou des deux si intéressantes Sonates pour violoncelle, le style de M. Fauré, de plus en plus dirigé vers une mélodie volontairement conduite par les harmonies les plus nuancées, émanation pour ainsi dire de ces harmonies — avec un dédain qui s'augmente pour la variété des rythmes (la suppression du scherzo est significative à cet égard) et les complexités de l'écriture — se dépouille et se simplifie, se spécialisant dans sa recherche personnelle. Rien ne semble plus l'attirer que ces flexions toujours plus curieuses et surprenantes des harmonies, la mélodie elle-même en dépendant étroitement. Il en résulte un procédé dont l'intérêt en se restreignant, pour ainsi dire, à un seul des éléments possibles de musique, donne à cet élément un particularisme, une effervescence inouïe, qui montrent tout ce que peut obtenir la croyance sincère en la valeur de la seule culture loin de la nature et des forces vives de l'instinct. L'œuvre du maître français, pur joyau de notre école moderne, est destinée à montrer dans l'avenir la vitalité, demeurée parmi nous et de notre temps, de tout le côté le plus séduisant des qualités de notre race : mesure classique, élégance, raffinement — et il semblerait que, à travers les âges, M. Gabriel Fauré a su ranimer le flambeau jadis échappé des mains défaillantes de Rameau, le faisant briller à nouveau pour la joie voluptueuse et extasiée de notre sens musical.
L'ÉCOLE DE CÉSAR FRANCK. — C. Franck, comme nous l'avons vu dans l'introduction, avait réuni autour de lui tout un groupe d'élèves, dont sa haute valeur — si supérieure à celle des maîtres officiels d'alors — avait su attirer la confiance aussi bien que l'affection, on peut dire passionnée. Les principaux, qui font objet d'étude dans ce chapitre, non seulement ont suivi ses conseils mais en sont restés imprégnés leur vie durant — fervent hommage à un enseignement qui fut de pure beauté.
D'autres, pour ne pas avoir été directement ses élèves, n'en ont pas moins subi fortement l'emprise de son style et de ses idées et doivent tout naturellement être désignés à leur suite.
Le premier en date à étudier ici devrait être Alexis de Castillon. Il a eu avec son maître, ainsi qu'avec Ed. Lalo et C. Saint-Saëns, une action importante sur le mouvement d'expansion de la musique de chambre en France, ces cinquante dernières années. Mais A. de Castillon, né en 1838, a écrit toutes ses œuvres de 1868 à 1873, et est mort à cette date ; il n'a donc pas place dans notre étude, qui commence à 1874.
Je parlerai, dans le chapitre suivant, du plus remarquable de tous, le premier après Castillon, par ordre de naissance, M. V. d'Indy, véritable continuateur de la pensée du maître de Liège et devenu lui-même chef d'école.
Plus jeune de quatre ans que M. V. d'Indy, Ernest-Amédée Chausson, auquel nous parvenons ensuite, est né à Paris le 21 janvier 1855 et mort à Limay (Seine-et-Oise), le 10 juin 1899, d'un accident de bicyclette. S'étant adonné relativement tard à la musique, il entra au Conservatoire, en 1880, dans la classe de Massenet, mais ne fit qu'y passer et devint presque aussitôt élève de Franck (1880-83). Actif secrétaire de la Société nationale pendant une dizaine d'années, cette Société, ainsi que les Concerts Lamoureux et Colonne, exécutèrent ses œuvres : Viviane, poème symphonique (1882) ; Symphonie en si bémol (1890) ; Poème pour violon et orchestre (1896) ; pour voix et orchestre : le Poème de l'Amour et de la mer (1892) ; la Chanson perpétuelle (1898). Il composa également des chœurs, de la musique de scène, du théâtre (le Roi Arthus, drame lyrique en trois actes et six tableaux, représenté à la Monnaie de Bruxelles, après la mort de l'auteur, le 30 novembre 1903), un assez grand nombre de mélodies, des œuvres de piano et de musique de chambre (Rouart et Lerolle, éditeurs).
Ernest Chausson, malheureusement, est mort avant d'avoir pu réaliser entièrement l'art qu'il cherchait et vers lequel tendaient tous ses efforts. Il nous a laissé de belles œuvres, mais, très certainement, la fatalité qui l'a fait disparaître juste au moment — à la quarante-cinquième année — où il atteignait la maturité, a empêché en quelque manière l'épanouissement complet de son style propre. Il est peu d'hommes que leur œuvre montre aussi sympathiques. Compositeur classique, dans le beau sens du mot, ayant le goût d'architectures de vastes proportions, bien ordonnées et d'équilibres savants, Chausson resta toute sa vie attaché à ses premières admirations : Franck et aussi Wagner. Venu au moment où son maître, magnifiquement, remplissait la mission d'épuration à laquelle il était prédestiné, il fut convaincu, plus que n'importe quel autre, de la nécessité d'établir des œuvres d'une beauté de forme quasi absolue et s'y adonna tout entier. Mais, en même temps, il pressentait — et c'est, sans doute, le côté de sa personnalité le plus remarquable qui, par la suite se serait développé — que l'humanité devait être (et avait été chez les maîtres) en musique, comme dans les autres arts, le principal de la recherche. Il avait tendance à considérer la forme, non comme une maîtresse dont on se fait l'esclave, mais comme un bon serviteur qu'il faut respecter parce que, dans sa pureté seule, il est capable d'exprimer l'Emotion Son condisciple, M. V. d'Indy, a dit que le but de l'art était l'Education. Oui, mais par la Sensibilité, non par la Raison, la Science.
Chez Chausson, l'émotion est profonde, pleine de modestie et d'humilité. Il nous touche par sa sincérité toute nue, par son désir intense, et qui s'appuie, de s'élever, de nous mener avec lui vers les horizons de lumière qu'il entrevoit... L'indécision, conséquence de la recherche et l'attirance vers Wagner et son humanité, l'ont poussé à se servir, de même que ce dernier, de développements qui s'étirent dans des élans semblant toujours près d'arriver au but et toujours repartant, mais dans un tout autre esprit. Chez Wagner, l'instabilité tonale, qui en est fatalement la conséquence et en régit d'autre part l'expression, était la résultante d'un parti pris. Sa surprenante volonté semble celle d'un homme qui vous prend d'autorité par la main et vous mène, fût-ce par les chemins les plus tortueux, là où il a décidé d'avance qu'il vous mènerait, ce chemin hérissé et complexe, perpétuellement varié, et qu'il connaît, — qu'il crée de toute la puissance de son imagination — étant le seul qui doive mener à son but. Chez Chausson le chemin est devenu moins complexe, moins varié, il le connaît moins bien et semble chercher avec vous où il mène — mais, comme il le poursuit de toute son âme, de tout son effort, de tout son désir passionné !...
On a quelquefois comparé Chausson à Puvis de Chavannes, et cette comparaison semble en effet lui mieux convenir qu'à son maître. Bien que catholique convaincu, comme ce dernier, ses compositions n'évoquent pas autant que celles de Franck les imaginations chrétiennes, mais, tout au contraire, les conceptions antiques. Cela tient peut-être à ce qu'il avait surtout le tempérament d'un homme de théâtre. Je vois assez le final du Concert ou le premier morceau du Quatuor en la comme quelque Ludus pro Patria, et le Concert surtout semble avec son violon solo — personnage principal, son quatuor — le chœur, son piano — l'orchestre, évoquer quelque scène décorative où des groupes évoluent dans de nobles attitudes et donnent lieu à des balancements nombreux et habilement eurythmiques.
***
Un Trio, pour piano, violon et violoncelle, op. 3 (1882) ; le Concert, pour piano, violon et quatuor d'archets, op. 21 (1890-91) ; le Quatuor, pour piano, violon, alto et violoncelle, op. 30 (1897) ; un Quatuor à cordes, inachevé, op. 35 (1899) forment l'œuvre de Chausson au point de vue de la musique de chambre.
Le Concert — titre assez spécial, mais Sextuor n'aurait pas convenu — car il s'agirait ici plutôt d'un sonate piano et violon, dont la partie accompagnante prend une grande extension par suite de l'adjonction d'un quatuor — se compose de quatre parties : 1. Décidé ; 2. Sicilienne ; 3. Grave ; 4. Final. La première partie, sorte de départ vers la vie, confiant, plein d'espoir, appuyé sur une phrase tendre de femme, — se développe classiquement avec juste souci dans la conclusion d'éviter, autant que possible, des redites, tout en réservant l'équilibre, c'est-à-dire par suppression, écourtement mais remplacement par longueurs similaires des éléments que leur première exposition devait amener fatalement par la suite à modifier. La deuxième partie : Sicilienne, est une délicieuse évocation élyséenne, qui fait songer à Gluck. Après le départ pour la vie, c'est le port, la paix future dans une harmonie libre de toute tristesse et sans longueurs. Le titre, dans son évocation un peu lointaine — un peu près aussi — est admirablement choisi. La forme en est d'une pureté parfaite, d'un équilibre charmant — et grec, remplaçant le scherzo italianoallemand et évoquant les, lignes familières de nos climats méditerranéens. Pondérée et remplie de distinction — Chausson n'a pas à cet égard les défauts que l'on peut reprocher à Franck — cette pièce, où l'intérêt est soigneusement distribué, est une des conceptions les meilleures et les plus réussies d'Ernest Chausson. Dans le Grave (troisième partie) le compositeur nous montre le fond de sa nature, faite de noblesse et de gravité. C'est une sorte de lamentation funèbre, désespoir toujours classique et touchant. On pourrait y voir comme un pressentiment de la mort prématurée... On dirait qu'il y a, chez Chausson, comme une idée, par avance, que ses efforts seront inutiles puisqu'il est prédestiné à mourir avant d'avoir eu le temps matériel d'en recueillir les fruits. La dernière partie est un final plein de vie, mais où réapparaît la phrase de lamentation — car Chausson était sincèrement partisan du cyclisme de Franck, ainsi que des superpositions de motifs, — avec moins de précision et de logique toutefois dans les transformations. Sa caractéristique personnelle reste cependant la tendance à l'humanité. Il croyait, d'éducation, à la nécessité de paraître indifférent et lointain. Mais les passages où il marque cette indifférence sont assez pâles et effacés. Puis, comme malgré lui, l'expression humaine et douloureuse se glisse...
Le Quatuor en la nous montre les mêmes qualités du Concert avec ses deux morceaux animés encadrant un Lento, dont l'inspiration émouvante est proche parente de Parsifal. — Pour le piano, Chausson a laissé peu de chose : Quelques danses (Dédicace, Sarabande, Pavane, Forlane et Paysage). On retrouve dans l'une et l'autre de ces œuvres le compositeur classique, qu'on serait tenté d'appeler néo-grec — pureté de l'écriture, jeu nuancé des harmonies, sobriété des moyens. On retrouve surtout ce sentiment, cette évocation du théâtre lyrique pour lequel Chausson était fait — sa seule tentative dans ce sens n'ayant été réalisée, hélas ! qu'après sa disparition...
***
M. Pierre de Bréville, né à Bar-le-Duc (Meuse) en 1861, fut destiné d'abord par ses parents à la diplomatie et fit, dans ce but, des études de droit, mais en même temps il suivait, au Conservatoire, la classe d'harmonie de M. Th. Dubois. Ayant bientôt et définitivement abandonné la « carrière », il devint élève de C. Franck dont il n'a cessé d'être un des plus zélés disciples et admirateurs. Il a écrit de la musique religieuse, une messe, des motets ; une scène mystique : Sainte-Rose de Lima ; des pièces d'orchestre : Ouverture pour la Princesse Maleine, de M. Maeterlinck ; des pièces pour chant et orchestre ; un drame lyrique : Eros vainqueur, représenté à la Monnaie de Bruxelles, etc...

fac-simile d'un autographe de Pierre de Bréville
M. de Bréville a composé également plusieurs œuvres de piano et de musique de chambre qui ont toutes été jouées en première audition à la Société Nationale — dont il s'est sans cesse occupé, notamment, comme nous l'avons dit, en qualité de secrétaire.
Fantaisie pour piano : introduction, fugue et final (13 avril 1889).
Méditation, pour instrument à cordes, harpe et orgue (21 mars 1890), tirée de la Messe.
Portraits de maîtres : Gabriel Fauré, V. d'Indy, E. Chausson, C. Franck (23 avril 1892).
Stamboul (rythmes et chansons d'Orient) : Stamboul — le Phanar — Eyoub — Galata (2 mai 1896) — le n° 2 ajouté après coup (1922).
Impromptu et Choral (23 mars 1912) — pour piano.
Sonate, pour piano et violon (20 mars 1920).
Un flûte dans les vergers, pour flûte et piano (15 janvier 1921).
Prélude et fugue, pour piano (14 avril 1923, Rouart et Lerolle, éditeurs).
M. de Bréville a mis en action le principe de Franck : faire peu d'œuvres, mais qu'elles soient parfaites. Il est difficile en effet de parvenir à une présentation aussi complète et aussi pure de ses idées. D'une grande élégance, sobre et distinguée, certainement toujours préoccupé et respectueux des enseignements de son maître, M. de Bréville a été attiré de bonne heure vers des recherches personnelles de rythme qui se manifestent dès les premières mesures de sa Fantaisie pour piano. Cette œuvre importante qui étroitement dépend, comme il est naturel à des débuts, de Prélude, Choral et Fugue, s'établit sur un thème (il fait penser aux premières notes du Chant des bateliers de la Volga), mystérieux et solennel et montre dès l'abord une grande intelligence dans le maniement des rythmes, une tendance à des curiosités à cet égard. Après l'introduction, une fugue dont le sujet vient d'être préparé, expressive et d'une grande pureté d'écriture, se développe assez longuement et s'enchaîne à un final. Très pianistique et d'une architecture solide mais transparente, cette œuvre fut suivie de plusieurs autres, également importantes, entre autres : Stamboul, rythmes et chansons d'Orient. Pareil sujet devait tenter un auteur naturellement porté à s'intéresser à la flexibilité des rythmes. Dès le début de cette suite, qui évoque Sainte-Sophie et ses muezzins, les mesures alternent, complexes : sept-huit, sept-seize dans la seconde partie, — neuf-quatre se décomposant non par trois, mais par quatre plus deux, plus trois dans la troisième — d'autres encore. Cette œuvre curieuse n'est pas — comme beaucoup l'auraient fait — directement, profondément inspirée de l'Orient et de sa musique. Tout en cherchant à évoquer l'un et l'autre, et cela par des moyens rythmiques apparentés, M. de Bréville est resté l'occidental qui, venu à Constantinople et impressionné, conserve sa mentalité et sa culture, ne cherche nullement — et sagement — à les modifier, et montre seulement sa curiosité de ces exotismes qu'il regarde, se tenant toutefois à distance. Beaucoup de recherches harmoniques et une grande clarté complètent l'intérêt et le particularisme de cette suite.
La dernière production pour piano de M. de Bréville : Prélude et fugue, prouve l'attachement persistant de l'auteur aux formes sévères et bien ordonnées.
Parmi ses œuvres de musique de chambre, la Sonate, piano et violon, en ut dièse mineur, de proportions considérables, est très certainement une évocation de la guerre et sans doute l'histoire du dédicataire, mort glorieusement pendant la lutte. Cette base d'humanité, bien dans les données classiques, ne pouvait manquer de donner une vie intense à cette production qui présente, en même temps, les qualités de pure musique habituelles à l'auteur.
La sincérité, l'aristocratique désintéressement, l'éloignement des séductions trop superficielles — le culte pour le Maître disparu, avec la volonté de poursuivre sans faiblesses son art noble entre tous, — composent en M. de Bréville une figure de haute tenue morale et de pureté, un musicien de race dont l'œuvre aura été ciselée au défi du temps.
***
M. Guy Ropartz est né en Bretagne, à Guingamp, le 15 juin 1864. D'abord élève, au Conservatoire, de Th. Dubois et de Massenet, il le devint, par la suite, de C. Franck. Il a abordé, dans ses nombreuses compositions, tous les genres : théâtre (le Diable couturier, légende bretonne ; Pêcheurs d'Islande, musique de scène ; le Pays, trois actes, représentés à l'Opéra-Comique) ; orchestre (trois Symphonies, dont la dernière avec chœurs : Dimanche breton, suite en quatre parties ; Lamento, Sérénade) ; un Psaume avec chœurs ; des pièces pour chant et orchestre ; de la musique de chambre (deux Quatuors à cordes ; deux Sonates pour violoncelle et piano ; deux pour violon et piano) ; de la musique religieuse ; des chœurs ; des pièces pour piano ; des mélodies, etc...

fac-simile d'un autographe de M. Guy Ropartz
Les caractéristiques du talent de M. Ropartz sont une grande noblesse de pensée, une honnêteté extrême et plus que dédaigneuse de la mode : semblant, pour ainsi dire, l'ignorer — beaucoup de solidité et d'équilibre mis au service d'une pensée naturellement disposée à la recherche du développement symphonique et répugnant, par contre, aux effets pittoresques et faciles. Il a porté pendant longtemps l'empreinte de Franck — mais s'est peu à peu dégagé et a su réagir contre une sorte d'envoûtement que son admiration fervente pour le maître de Liège n'avait su éviter tout d'abord. Le style mélodique de M. Ropartz est d'un haut intérêt, perpétuellement varié et sachant obtenir un phrasé sinueux et savant par un emploi toujours conscient des divers éléments de ses thèmes. Peut-être la complication de cette ligne — surtout dans les dernières œuvres — bien que très nette à l'analyse, nuit-elle un peu, à l'audition, à un effet frappant. Elle est, de plus, assez en contradiction avec l'allure toujours franche et la simplicité générale des compositions de M. Ropartz. Mais celles-ci, tout en étant toujours fort vivantes et bien plantées, ne cherchent point à séduire, et l'auteur se soucie peu sans doute de voir sa pensée saisie de prime abord et à la volée. Ayant une forte conscience, — et justifiée — de la valeur de son travail et des recherches qu'il poursuit, il est en droit d'exiger le même sérieux, le même effort de la part de son auditeur.
L'harmonie, bien loin de tendre aux raffinements de la déliquescence, est vigoureuse et saine, d'une sévérité de coloris qui lui vient sans doute de son pays de naissance, auquel il est resté intimement attaché bien que les hasards de la vie l'en aient tenu presque toujours éloigné : dès 1894 il prenait la direction du Conservatoire de Nancy, donnant les auditions d'orchestre les plus intéressantes et, depuis la guerre, il a pris celle du Conservatoire de Strasbourg.
M. Ropartz est un adepte convaincu des théories cyclistes de Franck, qu'il a appliquées dans ses propres œuvres, avec ingéniosité et personnalité, ce qui lui a permis d'obtenir des aspects de grande unité et d'une forte charpente.
Un long intervalle de temps sépare les deux Sonates pour violoncelle — la première de 1904, la seconde de 1919 (Durand, éditeur), et fait voir l'évolution de l'auteur, la seconde bien plus finement ouvragée que la première.
Celle-ci, comme beaucoup d'autres œuvres de M. Ropartz, va droit devant elle, semblant ne pas vouloir d'obstacles à sa pensée que ceux qu'elle lui suscite elle-même. Partant d'un sentiment, l'auteur le soutient et le poursuit d'un bout à l'autre d'une pièce, dédaignant de le varier pour pouvoir se livrer tout entier aux recherches purement musicales. Il en résulte quelque monotonie que la charpente générale, acceptée classique (et cyclique) sans autrement de nouveauté, ne rompt peut-être pas assez. Ces deux sonates sont, l'une et l'autre, en trois parties et se terminent par un final d'allure populaire — l'œuvre de M. Ropartz est nettement bretonne.
La deuxième Sonate piano et violon (1917) présente la particularité d'être en deux parties, comme l'avait fait naguère Saint-Saëns. Mais, au lieu, comme ce dernier, de réunir dans la première l'allegro et l'andante et dans la seconde le scherzo et le final, M. Ropartz a placé le scherzo comme fin de la première partie, et l'andante, pénétrant intimement le final, se développe alternativement avec lui. De plus, le premier allegro et le scherzo ne sont nullement écourtés, comme l'avait fait Saint-Saëns — dont le but était de supprimer des répétitions souvent lassantes. Ici d'ailleurs la richesse extrême des moyens permet ces répétitions — de plus très variées — et l'emploi d'un thème principal cyclique, dont les conséquences apparaissent çà et là le long de l'œuvre, ajoute encore à son intérêt.
Le Quatuor à cordes en sol mineur (Rouart et Lerolle, éditeurs), d'une excellente écriture à quatre parties, un peu compacte toutefois et manquant d'air, se ressent peut-être encore des bancs de l'école, mais l'auteur a la noble ambition de remonter aux sources et y montre dès l'abord la fertilité d'une imagination qui se meut avec aisance par des développements abondants et touffus.
Parmi les œuvres de piano, notons la suite : Dans l'ombre de la montagne, 1913 (Durand, éditeur), composée de sept pièces : Prélude ; Sur la route ; Paysage ; Vieille église ; Ronde ; Quand la lumière s'en est allée ; Postlude, qui présente les caractères de largeur — de finesse aussi ; d'instinct des développements ; de goût pour les thèmes populaires — et de même certaines recherches d'écriture moderniste, où intervient par moments la gamme par tons, chère à Cl. Debussy — qui font de M. Ropartz un musicien extrêmement complet et dont la noble sévérité est faite pour attirer une respectueuse et admirative sympathie.
***
M. Paul Dukas, né à Paris le 1er octobre 1865, entra au Conservatoire en 1882, après avoir achevé son éducation classique au lycée Charlemagne. Elève de Mathias pour le piano, de M. Th. Dubois pour l'harmonie, et deux ans plus tard d'Ern. Guiraud pour la composition, il remportait, en 1886, le prix de contrepoint et, en 1888, le second prix de Rome, — mais, n'ayant pu, en 1869, obtenir le premier, il quitta l'école. M. d'Indy raconte que M. Dukas, peu satisfait des études qu'il y avait faites, les recommença alors entièrement dans la solitude. Il devait atteindre ainsi à une maîtrise particulière dans l'entente de l'architecture musicale et du développement. Bien que n'ayant jamais été en réalité élève de Franck, son nom mérite, autant que celui des disciples directs de ce maître, d'être placé à côté d'eux, M. P. Dukas ayant fortement subi l'empreinte de son style.
Ses œuvres sont rares, mais ont eu, toutes, de grands retentissements. Après une Ouverture pour Polyeucte (1892), M. Dukas donna, la même année (1897), une Symphonie en ut majeur, exécutée aux concerts de l'Opéra, et l'Apprenti sorcier, scherzo pour orchestre d'après une ballade de Goethe (Société Nationale). En 1900, paraissait sa Sonate pour piano en mi bémol mineur et, en 1903, des Variations sur un thème de Rameau. Sont venus ensuite Ariane et Barbe-Bleue, conte musical en trois actes (M. Maeterlinck), première représentation à l'Opéra-Comique : 10 mai 1907 ; la Péri, poème dansé en un acte (1910).
Notons enfin un Prélude élégiaque sur le nom de Haydn (1909), une pièce écrite pour le Tombeau de Debussy, une Villanelle pour cor et piano (1906) (Durand, éditeur).
La Sonate pour piano en mi bémol mineur est une production d'imposantes proportions, dont on a dit qu'elle était la plus belle œuvre de cette forme écrite depuis Beethoven. Peut-être cette opinion est-elle empreinte de quelque exagération — d'autant que l'auteur n'y avait pas encore atteint à la parfaite unité de style et à la couleur que devaient révéler ses plus récents ouvrages. Elle constitue néanmoins un effort du plus haut intérêt où on ne peut qu'admirer une mise en œuvre de surprenante habileté dans le maniement des moyens les plus complexes. Solidité qui ne va pas sans lourdeur — défaut qui s'atténuera par la suite — développements longs et touffus, établis à la fois dans la grandeur et la recherche méticuleuse du détail, pureté et clarté de l'écriture, l'auteur a tenté une construction à tous points de vue considérable, souvent influencée de Franck, mais surtout de la conception beethovenienne. Sans s'attarder à des critiques de surface, il est difficile de ne pas trouver ici, même au point de vue thématique — le début de la quatrième partie en fait foi — une préoccupation un peu près peut-être du formidable op. 106 du maître de Bonn. Si nous ne rencontrons pas dans la sonate de M. Dukas la puissance intérieure, quasi inaccessible, du maître allemand qui, dans l'œuvre prodigieuse dédiée à l'archiduc Rodolphe, semble sur le point de faire éclater les formes, se brisant sous l'irrésistible poussée de son génie, s'il en reste plutôt quelque imitation, surtout extérieure, il faut cependant reconnaître que la tentative était généreuse et a donné lieu dans chacune de ses parties à des qualités de premier ordre. Le mélancolique et passionné premier mouvement, l'andante noble et pur, la verve du scherzo, le final dont les deux idées pleines de richesse thématique ou d'expression — la fin d'exposition est moins heureuse — se développent avec fougue et surtout une rigoureuse logique sont les différentes et solides assises de ce monument.
Fervent des dernières formes qui avaient tenté le génie beethovenien : la fugue et la grande variation, dont il a su pénétrer les difficiles secrets, M. P. Dukas a écrit depuis sur un thème de Rameau : Variations, interlude et final, où les mêmes qualités, amplifiées à la fois et affinées, ont donné lieu à un nouveau chef-d’œuvre de facture et d'habileté consommée qui le désignent comme un des plus importants compositeurs actuels, magistral et pur ouvrier des équilibres sonores.
***
Guillaume Lekeu est né le 20 janvier 1870 à Heuzy, près de Verviers, en Belgique. Mort le 21 janvier 1894, à Angers, d'une fièvre typhoïde, il ne vécut donc que vingt-quatre ans. Mais les quelques œuvres qu'il a laissées quoique, naturellement, jeunes encore et inexpérimentées, sont tellement pleines d'avenir, si remplies de passion, d'expression forte et profonde qu'elles méritent plus que beaucoup d'autres de durer, d'être rappelées dans cet historique. On ne peut se défendre d'une émotion douloureuse à la pensée que ce tempérament destiné, semblait-il, à s'exprimer, lors de la maturité, par des productions véritablement géniales, a disparu à peine éclos, brutalement fauché. Il n'avait pris goût pour la musique que vers 1885 et déjà, quatre ans plus tard, il faisait jouer une œuvre symphonique, ayant eu pour toute éducation la lecture quotidienne des chefs-d’œuvre de Bach, Beethoven et Wagner. Venu à Paris, en 1888, il compléta son éducation harmonique avec Gaston Vallin — puis, présenté par Gabriel Séailles à C. Franck, il prit de ce maître quelques leçons — pas plus d'une vingtaine — et, à la mort de Franck, devint élève de M. d'Indy.

fac-simile d'un autographe de Lekeu (communiqué par M. Lerolle)
Il nous reste de lui — outre plusieurs pièces symphoniques — pour piano, une Sonate (1891) — en musique de chambre, une Sonate pour piano et violon (1892) ; un Trio pour piano, violon et violoncelle, enfin un Quatuor, piano et cordes, inachevé et terminé par M. d'Indy (Rouart et Lerolle, éditeurs).
On pourrait presque dire que la marque spéciale de G. Lekeu est le génie. Il sut, instinctivement, comprendre que la musique doit être avant tout le résultat d'une sensibilité se donnant de toute son âme, de tout son cœur. Peu importent les moyens, fussent-ils simples, fussent-ils pauvres si par eux la richesse d'une âme généreuse, d'une âme extasiée dans la contemplation de la Beauté nous est révélée. L'œuvre de G. Lekeu est profondément émouvante. Se donnant de tout son être, il a brûlé sa vie en quelques années. En dix ans, pas même, il s'est épuisé, de toute sa générosité, nous laissant l'infini regret qu'il n'ait pas eu le temps de réaliser d'uniques promesses.
Par ailleurs — comme on peut le voir par exemple dans sa Sonate piano et violon — il était préoccupé des problèmes de son temps : le cyclisme, des superpositions de thèmes fréquentes (dès les premières pages), les modulations enharmoniques coupant un peu trop souvent le discours musical. Sa jeunesse, sa passion ardente et concentrée emportent par moments tout ce qu'on peut lui voir de défauts — de même que, brusquement, tel accent inattendu et violent, ou au contraire le déroulement tranquille de la mélodie de la deuxième partie qui s'apparente à J.-S. Bach, ou telle modulation passagère qui paraît oublier un instant les recherches pour descendre, s'absorber au plus profond de son être intime nous sont des révélations d'une vie dépassant les réalités et les banalités quotidiennes et qui était en communion avec un monde supérieur.
La curieuse Sonate pour piano, écrite la plupart du temps en style fugué, l'admirable Trio, de magnifique envolée, de structure cyclique toujours commandée par une sensibilité enthousiaste, avec son andante de sentiment intense, son fougueux scherzo, son final, ouvrent des horizons de lumière que la mort a voilés, hélas ! trop tôt, mais après nous avoir fait entrevoir, nous avoir montré une fois encore, ce que peut la véritable musique, loin des combinaisons froides et stériles.
***
Bien que ne faisant pas partie en réalité de ce que l'on appelle « l'Ecole Franck », il semble naturel de parler ici d'un musicien qui prit, lui aussi, des leçons du maître, remporta le prix d'orgue dans sa classe et lui succéda, à sa mort, à la tribune du grand orgue de Sainte-Clotilde. Je veux parler de M. Gabriel Pierné, né à Metz le 16 août 1863.

fac-simile d'un autographe de M. Gabriel Pierné
Venu à Paris à la suite de la guerre de 1870, il entrait au Conservatoire et, dès l'âge de dix ans, remportait sa première récompense — bientôt suivie de toutes celles, ou à peu près, que l'on pouvait lui décerner, y compris finalement le prix de Rome en 1882, avant d'avoir accompli sa dix-neuvième année. Au milieu de productions de toutes sortes et extrêmement nombreuses qui ont touché à toutes les formes de l'art musical : théâtre, musique de scène, musique symphonique, musique de chant, M. Pierné a écrit un certain nombre de pièces pour le clavier et des œuvres de musique de chambre, notamment une Sonate pour piano et violon (1900, Durand, éditeur). Dans cette sonate d'intéressante structure, l'auteur tire une nouvelle conséquence de l'idée qu'a eue Saint-Saëns de présenter le premier allegro et l'andante en une seule partie de début. Mais, chez M. Pierné, au lieu que l'andante termine cette partie, il en est le centre, précédant la conclusion classique et habituelle de l'allegro. L'exposition se fait à l'aide d'un rythme curieusement flottant, à dix-seize, que précise par la suite le violon et qui se continue sous le commencement de la deuxième phrase. Ce rythme passera au violon, lorsque le piano dira à son tour le chant et il ne sera abandonné qu'à la fin du développement, lorsque celui-ci se dirigera vers l'andante. La phrase d'andante elle-même réapparaîtra au début de la troisième et dernière partie, précédant un final faisant de nouveau usage du rythme de la première, mais modifié adroitement à six-huit. Des fragments du rythme premier et des éléments de développement précédemment employés donnent à cette sonate une allure de cyclisme qui apparente l'œuvre au style instauré par C. Franck bien que l'inspiration en soit à la vérité fort éloignée. Le sentiment « calme et rêveur » de la pièce centrale, sorte de scherzo chantant moins positivement scherzando que la pièce précédente — est bien personnel à l'auteur et exprime la séduction d'un talent qui, sans s'attarder à des complications trop voyantes, montre l'esprit le plus averti et une souple adresse dans le maniement des formes les plus modernes.
***
Enfin plusieurs musiciens indépendants doivent trouver place ici comme continuateurs plus ou moins directs des maîtres que nous avons étudiés : Franck, Saint-Saëns, M. G. Fauré. Je citerai M. Vreuls, auteur notamment d'une Sonate piano et violon ; L. Boëllmann, M. D.-Ch. Planchet, auteurs ; le premier d'un Quatuor, d'une Sonate piano et violoncelle ; le second d'une Sonate violon, d'un Trio, tous deux sortis de l'Ecole Niedermeyer et ayant puisé à la source l'enseignement de Saint-Saëns, de MM. G. Fauré, Eug. Gigout, organiste — prestigieux improvisateur — de Saint-Augustin, qui composa lui-même, entre autres œuvres, une Sonate pour piano.
M. VINCENT D'INDY ET SES ÉLÈVES. — M. d'Indy (Paul-Marie-Théodore-Vincent), né à Paris le 27 mars 1851, est originaire du département de l'Ardèche, descendant d'une vieille et aristocratique famille du Vivarais. Ayant perdu sa mère, et son père s'étant remarié, il fut élevé par sa grand'mère qui lui fit commencer le piano dès l'âge de neuf ans, lui donna comme professeur Diémer de 1862 à 1865, puis Marmontel. Il travailla à cette époque l'harmonie avec M. Lavignac et publia ses premières œuvres en 1870. Entré à la classe d'orgue de Franck, au Conservatoire, en 1873, il en sortit en 1875, avec un premier accessit, pour devenir organiste de Saint-Leu, puis timbalier et chef des chœurs aux Concerts Colonne. A la suite de voyages en Allemagne — il assista, en 1876, aux premières représentations de la Tétralogie à Bayreuth — il fut choisi par Lamoureux pour diriger les études des chœurs de Lohengrin (1887). Après plusieurs productions pour piano, chant ou orchestre, un Quatuor avec piano, apparût sa première œuvre importante : Wallenstein, trilogie d'après Schiller. Exécutée d'abord par fragments, elle fut entendue en son entier, en 1888, aux Concerts Lamoureux, et l'objet d'un succès considérable. L'auteur, entre temps, avait remporté (1885) le prix de la Ville de Paris, avec le Chant de la Cloche, légende dramatique. Depuis, M. V. d'Indy a fait paraître de nombreux ouvrages dans tous les genres : pour orchestre, deux symphonies ; Istar (variations) ; Jour d'été à la montagne ; Souvenirs ; — pour le théâtre : Fervaal ; l'Etranger ; la Légende de Saint-Christophe ; ainsi que des œuvres pour piano, chant, musique de chambre.
Depuis 1890 président de la Société Nationale, il fonda, en 1897, la « Schola cantorum », avec Charles Bordes. Ardemment convaincu de ses idées propres, trouvant que le principal but de l'art est l'enseignement et que cet enseignement est, au Conservatoire, dirigé trop uniquement vers le théâtre, il voulait créer une nouvelle école qui, par contre, mit au premier plan les études de musique pure. La « Schola » est devenue une pépinière aussi bien d'instrumentistes que de compositeurs et les élèves de M. d'Indy, continuateur de la pensée de Franck, forment maintenant un important groupement d'où sont sorties, comme nous le verrons par la suite de ce chapitre, plusieurs personnalités des plus intéressantes, continuant à leur tour la pensée de M. d'Indy.
M. V. d'Indy est, sans contredit, le musicien actuellement le plus savant, le plus habile. Elève de Franck, mais doué d'une originalité à certains points de vue très éloignée — de plus en plus — de celle de son maître, ses idées, aussi bien en art qu'en morale ou en religion, forment un bloc étroitement lié, d'une unité et d'une ordonnance complètes. Attaché avant tout à la tradition, porté de nature vers la clarté, la logique, la science, il voulut connaître et faire connaître l'évolution de la musique depuis ses premiers balbutiements, peut-on dire, jusqu'aux tentatives les plus récentes, dans un ordre plein et rigoureux — alors que, jusqu'à lui, on ne s'intéressait qu'à quelques chefs-d’œuvre isolés, ignorant à peu près tout, notamment, des maîtres du XVIe siècle. Grâce aux publications, aux recherches dues en grande partie à son initiative et à son activité, on peut maintenant se rendre compte, sans interruptions, de tous les stades de l'évolution musicale — et cette connaissance, cette érudition ont eu, bien entendu, une grande influence sur les idées et les procédés des compositeurs en général et principalement de ceux attachés avec conviction aux enseignements de la Schola Cantorum. Lui-même l'inscrit dans son œuvre.
Certes Franck avait été un homme d'ordre et d'organisation. Mais c'était en même temps un homme de foi, d'enthousiasme, et ces deux dernières qualités ont chez lui importance de premier plan. Franck croyait comme un enfant, sans chercher à savoir pourquoi il croyait et s'il avait, logiquement, raison de croire. M. d'Indy présente cette différence avec son maître qu'il croit, mais qu'il veut expliquer, pour ainsi dire, sa croyance, en prouver, par le raisonnement, le bien fondé. Systématique s'il en fut, il pose des prémisses et est bien plus intéressé par tous les développements, les conséquences qu'il en tire que par elles-mêmes. Il en résulte une œuvre, outre l'expression particulière qu'elle tire de la continuelle communion de pensée du fondateur de la Schola avec le Moyen âge — autre différence avec Franck qui s'était contenté du temps qui l'avait immédiatement précédé (M. d'Indy pense que la Renaissance a été une erreur funeste) — une œuvre bien plus fouillée, complexe et recherchée que celle du maître de Liège, M. d'Indy ayant par ailleurs subi toutes sortes d'influences que Franck avait peu suivies ou n'avait pas connues : les romantiques allemands, Wagner. Son originalité propre, sa haute habileté en font une des figures les plus considérables de notre mouvement musical.
***
Sans m'attarder à la Petite Sonate (op. 9, 1880), qui fut publiée dix ans après l'op. 1 (Trois romances sans paroles), je parlerai d'abord du Poème des montagnes, suite pour piano. Cette œuvre importante (op. 15, 1881, Hamelle, éditeur) se compose de trois parties : 1. le Chant des bruyères ; 2. Danses rythmiques ; 3. Plein air — les trois parties encadrées par une introduction et un postlude intitulés : Harmonie. Dédié à Em. Chabrier — ce qui est curieux et prouve l'influence de l'auteur de Gwendoline, non seulement sur les musiciens modernistes, mais aussi sur les traditionnalistes — le Poème des montagnes est une des œuvres les plus significatives de la jeunesse de M. d'Indy. Le début (Harmonie), sorte d'invocation, est heureux par son sens et sa réalisation bien pianistique. L'idée de l'avoir répétée à la fin et symétriquement donne à l'œuvre un aspect plein de grandeur. Une des caractéristiques du Poème des montagnes est que, tout en étant — suivant les principes de Franck — très charpenté, cyclique et architectural surtout, il obéit en même temps à une sorte de plan littéraire, dramatique, souligné à l'aide de titres, non seulement en tête des morceaux, mais aussi dans le courant de chacun d'eux. La Bien-Aimée — évoquée comme dans une sorte d'incantation dans la première partie, après un Brouillard fort habile, et fouillé jusqu'à l'extrême précision habituelle à l'auteur, et des souvenirs de Weber — réapparaît dans les morceaux suivants. Son thème, qui est comme une émanation du Chant des bruyères, interviendra de nouveau dans les Danses rythmiques (intéressants entrelacements de mesure) après la Valse grotesque (ici s'explique la dédicace à Chabrier). Le numéro 3, Plein air, est une scène assez complexe — où les indications Hêtres et Pins, Coup de Vent situent l'action — et qui semble une sorte de promenade avec la Bien aimée. Cela aboutit à un A deux et Amour où, un instant absorbé par la personnalité de l'Aimée — d'abord toute au premier plan, puis s'effaçant comme une vision qui passe — l'auteur est tout naturellement ramené à la contemplation des montagnes (Harmonie) qui lui montre le peu de valeur de toutes choses devant la majesté de Dieu. L'écriture de cette « Suite » présente les qualités, alors déjà définitivement formées, de M. d'Indy : clarté et élégance aristocratique, habileté dans le maniement des rythmes et du contrepoint (canon franckiste sur le thème de la Bien aimée, dans le numéro 3), emploi du piano dans les données naturelles à l'instrument, mais aussi dans un esprit orchestral rappelant les procédés beethoveniens, style très pur et qu'on pourrait appeler : classique renouvelé, se défiant par dessus tout de la volupté et des séductions, du charme.
***
Les œuvres suivantes pour piano (Hamelle, éditeur) : Quatre pièces (Sérénade, Choral grave, Scherzetto, Agitato (op. 1882) ; Helvétia, trois valses : Aarau Schinznach, Laufenburg (op. 17, 1882) ; Nocturne (op. 26, 1886) ; Promenade (op. 27, 1887) ; Schumanniana, trois chants sans paroles (op. 30, 1887), sont de moindre intérêt, et nous atteignons les Tableaux de voyage (op. 33, 1889). Cet ensemble, composé de treize courtes pièces : 1. ? ; 2. En marche ; 3. Paturage ; 4. Lac vert ; 5. le Glas ; 6. la Poste ; 7. Fête de village ; 8. Halte au soir ; 9. Départ matinal ; 10. Lermoos ; 11. Beuron ; 12. la Pluie ; 13. Rêve — n'est pas exempt, comme beaucoup d'autres productions de l'auteur, de quelque sécheresse par une poursuite trop exclusive d'une rigueur logique dans l'établissement des formes.
***
Vient ensuite la remarquable Sonate en mi (op. 63, 1907, Durand, éditeur). La volonté de continuer je ne dirai pas l'esprit beethovenien, car nous en sommes ici, à l'évidence, fort éloignés, mais les dernières tendances de l'auteur des trente-deux Sonates, est inscrite dans cette œuvre de la façon la plus certaine. Après un préambule qui, textuellement, réapparaît au début de la troisième et dernière partie et n'est qu'une déformation rythmique du thème cyclique, celui-ci s'expose et est suivi de quatre variations, formant un premier mouvement lent, par suppression d'un allegro de début. La deuxième partie est un scherzo. Dans la dernière, le thème, de plus en plus large et puissant, couronne ce monument imposant. Haute variation et extrême extension du cyclisme, tel est le but que s'est proposé M. d'Indy, dans sa conviction de la nécessité, où nous devons nous placer, de simplement poursuivre les conséquences des idées des anciens maîtres. Cependant, outre que les procédés employés par Beethoven dans ses dernières œuvres étaient, forcément, passagers — non seulement pour Beethoven lui-même mais pour ses successeurs — et qu'il les aurait peut-être rejetés (comme les précédents) s'il avait vécu vingt ans de plus — il paraît difficile d'admettre que l'évolution doive se faire toujours dans le même sens, par simple amplification, sans heurts ni réactions violentes — ce qui est au contraire fréquent et historiquement démontré. Dans cette sonate, comme dans les œuvres de musique de chambre que nous allons parcourir, M. d'Indy semble se livrer surtout à un habillage extrêmement modernisé des idées anciennes auxquelles il s'attache étroitement.
***
Le Quatuor en la, pour piano et cordes (op. 7, 1878-88, Durand, éditeur), est une production de jeunesse, d'une sentimentalité romantique bien répudiée depuis par l'auteur, son écriture déjà complexe et fouillée — clavier multipliant les arpèges composés et les gammes, instruments indépendants et agissants — œuvre intéressante à étudier pour comprendre le chemin parcouru par M. d'Indy qui ne devait pas être préoccupé alors, autant que depuis, d'idées traditionnalistes et se laissait encore aller à la fougue de la jeunesse.
***
La Suite en ré dans le style ancien, pour trompette, deux flûtes et instruments à cordes (op. 24, 1886, Hamelle, éditeur), se compose d'un Prélude, une Entrée, une Sarabande, un Menuet, une Ronde française. De sonorité franche, restant, non comme l'avait fait C. Saint-Saëns pour son septuor, dans un style académique parent de la fin du XVIIIe siècle, mais bien dans celui qui avait précédé Haydn, et utilisant les harmonies chromatiques qui rapprochent les modernes des anciens, M. d'Indy a écrit cette Suite avec une grande variété et sa coutumière habileté. La mélodie est distribuée avec élégance. Le Menuet et la Ronde française — celle-ci utilisant des formes savantes (fugue sur un thème, exposé ensuite par mouvement contraire) sont d'un effet particulièrement aisé et naturel.
***
Dans le Trio, pour piano, clarinette et violoncelle (op. 29, 1887, Hamelle, éditeur), nous retrouvons le style de pureté classique, transposition moderne des idées beethoveniennes, dont j'ai parlé au sujet de la Sonate pour piano, qui est la marque particulière de M. d'Indy, mais se montrant de façon beaucoup plus simple. Merveilleusement écrit et proportionné, avec variété mais sans excès de complications, coloré des harmonies de son époque, la partie de piano de grand intérêt rythmique, c'est une œuvre de clarté et de perfection. Une grande unité thématique règne dans ses quatre parties (Ouverture, Divertissement, Chant élégiaque, Final), le thème du scherzo presque identique à celui du premier allegro — qui sert de base aux accords de l'adagio, et renaît en entier vers la fin du développement du final dont il établit, par fragments, la péroraison. A cette époque de sa vie M. d'Indy, ne s'obligeant pas encore à une subdivision excessive de sa pensée, paraît avoir trouvé un équilibre excellent entre les divers éléments de la composition, qu'un certain laisser aller développait avec une facilité heureuse à la fois et châtiée, sans laisser la forme empiéter sur le sujet émotif choisi.
***
Deux Quatuors à cordes, écrits à plusieurs années de distance, le premier en ré (op. 35, 1890), le second en mi (op. 45, 1897, Durand, éditeur), s'inscrivent ensuite au catalogue des œuvres de M. d'Indy. L'auteur, qui pense, à juste titre, que l'écriture d'un quatuor à cordes ne peut donner lieu à réussite que chez un maître éprouvé et d'expérience, était fait plus que tout autre pour se mesurer avec la forme la plus difficile et la plus pure de la musique de chambre. Il n'attendit pas, comme son maître, un âge avancé pour s'y risquer, mais s'il n'atteignit pas à la puissante originalité architecturale du Quatuor de Franck, il nous donna néanmoins, comme on pouvait le prévoir, des œuvres que l'intérêt et la variété de l'écriture rendent de véritables modèles. La puissance du premier mouvement (Quatuor en ré), l'expression pondérée du second, dont les deux thèmes se superposent si aisément, le chant populaire de la troisième partie qui alterne avec une danse d'une charmante légèreté et la verve joyeuse du final — les rappels et développements cycliques, notamment dans ce dernier, du thème lent — les silences distribués habilement et laissant partout l'air circuler — tous les moyens employés avec ordre et justes proportions forment une œuvre excellente et bien traitée.
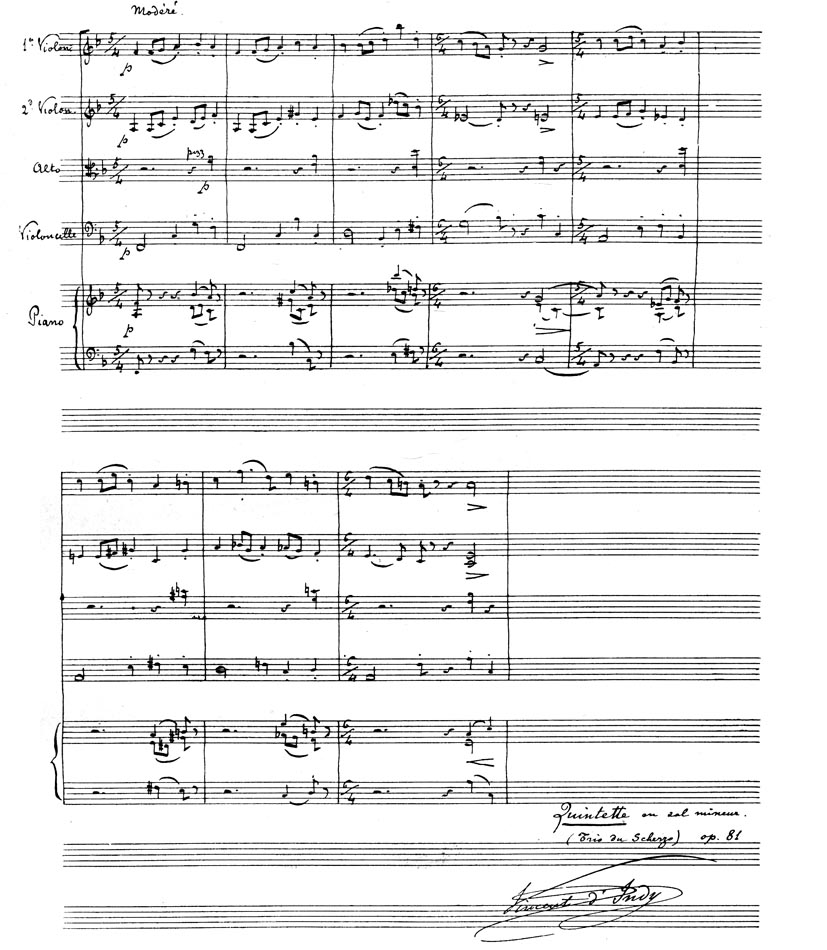
fac-simile d'un autographe de Vincent d'Indy
Le second Quatuor, plus simple peut-être que le premier, quoique plus récent, appartient comme lui à la manière ancienne de M. d'Indy, alors qu'en pleine possession de son talent, il lui faisait exprimer classiquement ses impressions journalières. Ecrit, l'on dirait de verve — l'auteur prouve son incomparable adresse en semblant plus à l'aise peut-être encore dans cette forme de maniement dangereux que dans n'importe quelle autre — la souplesse élégante des rythmes, de la mélodie qui coule de source, les dons de couleur, l'évite naturelle de toute banalité, font de ce Quatuor le digne pendant du premier. Un simple changement de rythmes donne les thèmes des quatre pièces et les différencie si bien que chacune de ces conséquences de l'idée-mère a tout le relief personnel désirable aussi bien que s'ils étaient nettement dissemblables. Pareil talent dans le travail thématique, sans rien de trop appuyé ou voyant, justifierait à lui seul la réputation de supérieure dextérité qu'a acquise justement M. d'Indy.
***
Dans la Sonate pour piano et violon en ut majeur (op. 59, 1904, Durand, éditeur), nous trouvons, comme dans la Sonate pour piano, un style sensiblement différent. L'auteur a renoncé dans l'une comme l'autre de ces deux œuvres à ce qui lui paraît peut-être une trop grande facilité. Dans son désir de dévoiler pas à pas sa pensée, il s'est attardé à une extrême multiplicité de détails, toujours fort clairs, certes, et admirablement conçus et déduits, mais dont la complexité n'a pu être ouvragée qu'au détriment de la ligne générale qui perd de la souplesse, de la vie, est moins assimilable et frappante. La science, la logique ne sont pas le fait principal de l'œuvre d'art et cet aboutissement du style de M. d'Indy semble la rançon d'une conviction poussée sans doute à l'excès de la trop grande valeur de l'habileté dans l'élaboration de l'œuvre. L'habileté d'ailleurs ne peut consister à subdiviser les effets de telle sorte que tous disparaissent dans une abondance de contrecoups que l'imagination de l'auditeur n'a pas le temps d'enregistrer, donnant à chacun une proportion, une progression auxquelles elle soit suffisamment sensible. Il est nécessaire de varier la mélodie, sachant tirer des conséquences expressives des éléments premiers du thème, mais il est obligatoire, la musique étant faite non pour la lecture mais pour l'audition, que les fragments thématiques employés soient d'un relief saisissant et dès l'abord reconnaissables.
***
M. d'Indy, par son talent considérable qui fait le plus grand honneur à notre moderne école française, aura montré des qualités vraiment uniques de logique et de clarté. Comme beaucoup d'autres l'ont déjà remarqué — et comme il est évident — la clarté est la marque distinctive de cette haute personnalité qui aura eu si grande influence sur toute une génération et qui aura su attirer son admiration, sa confiance. Nul plus que lui n'était capable d'enseignement, par sa science, sa connaissance approfondie de l'évolution musicale depuis ses plus anciennes manifestations Avec lui rien de hâtif, rien de superficiel, aucun point obscur ou incompris. L'éducation ainsi établie, sur de telles bases d'un traditionalisme excellent, ne pouvait être que fructueuse : libre à chacun d'en déduire des idées nouvelles. Si l'on peut reprocher à M. d'Indy d'avoir été un peu le prisonnier des Prédécesseurs et de n'avoir peut-être pas tiré des conséquences assez générales et de notre temps de ce que nous enseigne le passé, on doit cependant reconnaître qu'il a toujours été avide de nouveauté, fut-ce relative, et ne s'est jamais complu dans de stériles imitations. Il a toujours recherché l'intérêt à tous points de vue de musique : architecture générale de la mélodie, tonalités, rythmique, ne se restreignant pas à l'un plus qu'à l'autre. Son imagination s'est donné carrière dans tous les domaines, y laissant des traces durables avec variété et d'un esprit prévoyant les importances relatives des éléments entrant en jeu dans la composition de l'œuvre. La logique y tient une place bien grande — par ce qui peut sembler un singulier manque de foi — mais la souplesse d'un talent hors de pair lui a évité — tout au moins au début de sa production — un manque de naturel fréquent chez les artistes scientifiques, surtout — ce qui n'est pas le cas — quand leur science n'est pas, comme chez lui, admirablement éprouvée.
***
Parmi les premiers élèves de M. V. d'Indy, il faut citer Albéric Magnard, né à Paris en 1865. Fils du directeur du journal le Figaro, il avait été d'abord destiné par son père à la carrière du barreau et ne commença qu'assez tard des études musicales. Entré au Conservatoire, en 1886, comme auditeur à la classe de M. Th. Dubois, et devenu élève l'année suivante, il obtient dès la fin de cette même année le premier prix d'harmonie. Passé à la classe de Massenet, pour y suivre les cours de contrepoint, il y séjourna peu de temps et profita à partir de ce moment des conseils de M. d'Indy, qui arrivait alors à la célébrité. Magnard a composé plusieurs grandes œuvres d'orchestre : quatre symphonies ; un Hymne à la Justice ; un Hymne à Vénus ; trois drames lyriques : Yolande, un acte joué à Bruxelles ; Bérénice, trois actes représentés à l'Opéra-Comique ; Guercœur, encore irréalisé scéniquement — des œuvres pour chant, musique de chambre et piano. On sait la fin tragique du compositeur, révolté de voir sa maison envahie par les Allemands au début de la guerre, et ayant payé de sa vie cette révolte.
Plus porté par sa nature à l'élaboration d'œuvres d'orchestre, il nous a laissé néanmoins pour le piano une Suite intitulée : Promenades (Durand, éditeur), qui évoque les environs de Paris : Saint-Cloud, le Bois de Boulogne, Versailles, Rambouillet — et, en musique de chambre : un Quintette, pour flûte, hautbois, clarinette, basson et piano ; une Sonate, pour piano et violon ; un Quatuor à cordes ; un Trio, pour piano, violon et violoncelle ; une Sonate, pour piano et violoncelle (Rouart et Lerolle, éditeurs). Le style de Magnard, tout en dépendant des classiques allemands ou de l'école française — Franck notamment — est des plus particuliers. Il est impossible de pousser plus loin que lui le souci presque exclusif de l'architecture musicale. Les données générales de ses ouvrages tendent toujours à un équilibre d'aspect solide et sobre, évitant, remplaçant les conclusions par des présentations très différenciées des expositions, l'intérêt par suite continu et également distribué aussi bien à la fin qu'au début de chaque pièce. La volonté — une volonté forte jusqu'à la violence ; l'affirmation robuste de ses convictions dans un complet dédain de ce qu'on pourrait en penser ; la largeur, la puissance du sentiment (très au second plan) se développant presque uniquement avec une antipathie — qu'on n'a peut-être jamais dépassée — pour les mollesses séduisantes et le charme sont les signes distinctifs d'un tempérament dont le relief est remarquable. A la lecture, les œuvres de Magnard frappent par la pureté des matériaux employés — toujours avec une conscience nette de leur valeur, de leur possibilité musicalement expressive : pas un détail qui n'ait un sens, qui ne soit présenté de façon originale. Mais ces matériaux sont malheureusement en eux-mêmes de sonorité quelconque et, à l'audition, si l'on peut apprécier la valeur et l'intérêt des grandes lignes de l'architecture, on éprouve en même temps la sécheresse d'un manque d'invention sonore qui tendrait à prouver que l'établissement d'une charpente solide est peut-être fort importante en musique, mais moins que l'expansion de la sonorité — seul domaine particulier de notre art. Cette mise en valeur d'une maçonnerie très indispensable — et magnifiquement établie chez les maîtres qui savaient s'en servir en lui donnant sa juste place — laisse complètement de côté l'abandon normal à la sensibilité et, confondant le charme avec l'affectation, oublie trop ou néglige de comprendre qu'il ne s'agit pas, en le poursuivant, de rechercher la volupté mais bien le conduit magique qui relie notre vie, ses vibrations à la spiritualité et à la beauté.
Magnard reste cependant un homme d'une haute valeur. Sa sincérité, son désintéressement, sa préoccupation de renouveler les formes traditionnelles à l'aide de moyens bien de son temps, la noblesse et le courage de son effort suffisent à surabondamment le prouver.
***
M. Albert Roussel, né à Tourcoing le 5 avril 1869, s'était destiné d'abord à la Marine. Entré à l'Ecole Navale en 1887, aspirant de marine, puis enseigne de vaisseau, il navigua plusieurs années en escadre dans l'Atlantique, l'océan Indien et les mers de Chine. Mais la musique l'attirait à ce point, qu'il démissionna, en 1894, pour s'y consacrer exclusivement. Venu à Paris, il fut l'élève de M. E. Gigout, puis de M. d'Indy, à la Schola Cantorum, avant de devenir lui-même professeur de contrepoint à cette même école, de 1902 à 1913. M. Alb. Roussel sera sans doute considéré dans l'avenir comme l'élève le plus remarquable, le prototype même de l'enseignement de la Schola — ayant su en recueillir les meilleurs fruits, sans laisser pour cela absorber sa personnalité qui tend chaque jour à se dégager davantage. Sa science, éprouvée à tous points de vue musicaux : développement, harmonie, rythme, le désigne comme un des compositeurs actuels les plus habiles. Recherchant les sonorités, les frottements de notes du plus extrême modernisme, il sait si bien les équilibrer qu'il fait passer les agrégations les plus osées — jamais dures ou gauches. Le soin extrême avec lequel il établit notamment les progressions des rythmes donne une perpétuelle variété à chacune de ses œuvres. Son talent, orienté surtout vers la précision, l'équilibre est bien dérivé, par l'entremise de M. d'Indy, de l'école de C. Franck, et aussi éloigné que possible des théories décadentes ou impressionnistes, tout en montrant par ailleurs une continuelle préoccupation des arrangements les plus nouveaux, une curiosité jamais satisfaite de l'inédit et aussi de l'inentendu. On pourrait reprocher sans doute à M. Roussel de ne pas s'abandonner assez et de poursuivre ses compositions à un point de vue trop exclusivement analytique, qui l'intéresse davantage que le point de vue synthétique. Pour lui l'œuvre doit être non le résultat de l'instinct, mais bien de la logique et de la raison et, étant donné le genre d'effets que sa finesse et sa sincérité lui suggèrent, il sait à merveille les proposer, les développer et les déduire dans toutes leurs conséquences. Mais on voudrait, et on espère pour lui, dans l'avenir, que sa grande science se dépouillera peu à peu et, sans perdre ses qualités personnelles, atteindra tout naturellement l'ère du synthétisme et de la sensibilité maîtresse.

fac-simile d'un autographe d'Albert Roussel
La production, déjà abondante, de M. Roussel comprend, outre les œuvres d'orchestre et de théâtre, d'abord au point de vue du piano :
Des heures passent (op. 1), recueil de quatre pièces (1898) ; Rustiques (op. 5), recueil de trois pièces : Danse au bord de l'eau ; Promenade sentimentale en forêt ; Retour de fête (1904-06, Durand, éditeur) ; Suite (op. 14) : Prélude, Sicilienne, Bourrée, Ronde (1909) — ces deux dernières exécutées à la Société Nationale par Mlle Bl. Selva (Rouart et Lerolle, éditeurs) ; Sonatine (op. 16), Mlle Dron, à la Société Nationale (1913, Durand, éditeur) ; l'Accueil des Muses (écrit pour le Tombeau de Debussy — Durand, éditeur). Et en musique de chambre : Trio (op. 2), pour piano, violon et violoncelle (Soc. Nationale, 1905) ; Divertissement, pour instruments à vent (1906) ; Sonate, piano et violon — Rouart et Lerolle, éditeurs — (Salon d'automne, 1908, par Mlle Dron et M. Parent) ; Impromptu, pour harpe seule (1919, Mlle Laskine et à la S. M. I.).
Parmi les pièces pour piano je retiendrai la Suite en fa dièse : son Prélude où se déroule une sorte de procession orientale — M. Roussel a gardé souvenir de ses lointains voyages et nous décrit dans plusieurs de ses œuvres les fortes impressions qu'il en a reçues et su conserver — sa charmante Sicilienne, ondoyante et enveloppée ; sa Bourrée, pleine de verve, et sa Ronde joyeuse forment un ensemble extrêmement réussi et remarquablement écrit pour l'instrument. Architecturale certes, mais en même temps pianistique, avec ses traits, ses arpèges agrémentés à souhait de notes de recherche, l'allure toujours animée ou souple de cette Suite obéit, comme il convient, à la technique, à l'agilité spéciale au piano.
La Sonate, pour violon et piano, de grandes dimensions, écrite en trois parties étroitement liées entre elles, à l'aide d'un thème cyclique qui apparaît dès le début du premier allegro — après avoir été préparé dans l'introduction — et donnera lieu, à la fin de la troisième partie, à une péroraison pleine de chaleur — montre toutes les qualités d'adresse de l'auteur. De sonorité extrêmement fouillée où chaque détail est ouvragé avec des soins méticuleux, aussi bien dans la délicatesse que dans la puissance, cette œuvre, qui mériterait une analyse pas à pas pour en goûter la qualité, fait le plus grand honneur à la noblesse avertie d'un esprit curieux de nouveautés bien et dûment équilibrées.
Finesse, droiture, habileté de tout premier ordre — qualité beaucoup plus rare actuellement que beaucoup ne l'imaginent — tels sont les dons de M. Alb. Roussel — une des personnalités les plus remarquables de ce temps.
***
Déodat de Séverac (Joseph-Marie), né à Saint-Félix-de-Caraman en Lauraguais le 20 juillet 1873 mort, jeune encore, en 1920, commença par faire des études de droit à la faculté de Toulouse. Mais, fils d'un artiste peintre de talent, en même temps que musicien, il se trouva tout naturellement porté à s'intéresser à la musique et passa bientôt de la Faculté au Conservatoire. Il vint à Paris, en 1896, au moment de la fondation de la Schola Cantorum, et en fut un des premiers élèves — pour le contrepoint avec Albéric Magnard ; pour la composition avec M. V. d'Indy ; il devait y rester dix ans, d'avril 1897 à juillet 1907.

Déodat de Séverac (photo Rouart, Lerolle et Cie)
Depuis, D. de Séverac a fait de longs séjours dans le Midi, vivant à la campagne la plus grande partie de l'année, comme dans une communion toujours plus intime avec cette Terre qu'il a chantée, avec la nature dont le sentiment imprègne si profondément ses œuvres. Personnalité diverse s'il en fut, et des plus originales, D. de Séverac — qui sembla un moment une sorte de précurseur du mouvement de ces dernières années, un lien entre Debussy, l'impressionniste vaporeux que nous allons bientôt étudier et les recherches âpres, violentes, précises qui dominent actuellement — a accepté d'abord, de toute sa bonne volonté, les idées, les théories en honneur à la Schola. Sa musique, qui manque de souplesse et d'adresse, ne manque pas, par contre, de puissance, elle se détache en relief, en arêtes vives, elle est pleine de sincérité et, avant tout, de couleur.
Il eut le goût des longs poèmes pour piano — d'une écriture combinant toutes sortes d'effets des plus « pianistiques », notant soigneusement les pédales, les sourdines, indiquant des « laisser vibrer » de sonorité curieuse, se servant souvent de « petites notes », appogiatures brillantes — proches parentes des notes d'agrément de nos anciens clavecinistes. Quoique « mélodiste » né et non sans sentimentalité, son phrasé — surtout au début — est fait de fragments fort courts, comme dans une hésitation à un laisser-aller, un épanchement qui, au fond, lui étaient naturels. Très attiré par les théories, il n'échappait pas à quelques procédés réapparaissant régulièrement, plus par préoccupation de volonté que de sensibilité — telle la terminaison de presque toutes ses pièces, non sur l'accord parfait simple, mais sur celui avec la sixte-ajoutée. Malgré tous ses défauts, le coloris, la générosité, la chaleur, l'originalité de D. de Séverac sont telles qu'on est amené à oublier vite une facture malheureusement fruste et assez lourde pour ne goûter que l'émotion souvent profonde et toujours si sympathique de cette réelle personnalité.
Il nous a laissé, pour le piano, trois Suites des plus importantes : le Chant de la Terre, poème géorgique en sept parties : Prologue ; 1. Labour ; 2. les Semailles ; Intermezzo (Conte à la veillée) ; 3. la Grêle ; 4. les Moissons ; Epilogue (le jour des noces) (1900). En Languedoc, suite en cinq parties : 1. Vers le Mas en fête ; 2. Sur l'étang le soir ; 3. A cheval dans la prairie ; 4. Coin de cimetière au printemps ; 5. le Jour de la foire au Mas (1904) ; Cerdana, quatre études pittoresques : 1. En tartane ; 2. les Fêtes ; 3. Ménétriers et glaneuses ; 4. le Retour des muletiers (1910). Ainsi que Baigneuses au soleil, étude pittoresque (1908) ; En vacances, album de petites pièces romantiques (1910) toutes ces œuvres éditées chez Rouart et Lerolle.
Le Chant de la Terre, dont l'idée première paraît être née en quelque analogie avec le Poème des Montagnes, de M. V. d'Indy, montre dès son début les tendances puissantes, voire brutales et tout opposées à la souplesse de Debussy, qui sont les caractéristiques du talent de Séverac — avec ses harmonies tourmentées sous un chant simple, sa tonalité de ré sortie du premier mode du plain-chant — qui fait l'introduction (sans barres de mesure, dans un rythme libre issu également du plain-chant).
En Languedoc est une œuvre plus arrivée, également imprégnée d'un sentiment, d'un amour profond de la nature, du pays natal et aimé. Le premier morceau, malgré des passages où l'auteur est si désireux de sortir du déjà entendu qu'il préfère plutôt rester parfois dans un rythme vague, une tonalité hésitante, poursuivant des séquences courtes et un peu bizarres, malgré aussi quelque vulgarité, se termine par des recherches tout à fait curieuses et génératrices d'avenir. La troisième partie, que l'on a entendue souvent à part dans les concerts sous les doigts agiles de M. Ricardo Viñes — l'interprète-né de M. Ravel, de Séverac, de bien d'autres — est d'un rythme nerveux et coupée en son milieu d'une halte à la fontaine — la fontaine qui rafraîchit de son eau limpide et quasi sonore ces paysages brûlés du soleil du Midi. Et, après la quatrième, qui est pleine d'émotion, la dernière, par sa verve, son originalité, fait le couronnement d'une des œuvres les meilleures et les plus importantes de notre école moderne du piano.
Elle semble préférable à Cerdana qui, pour
être plus aisée et souvent charmante, est moins particulière.
Baigneuses au soleil, dédiée à M. Alf. Cortot, évoquant un bord de mer de
lumière aveuglante, comme des gouttes de soleil et d'écume mêlées où évoluent de
gracieuses formes féminines, montre les qualités habituelles de l'auteur, ses
recherches un peu trop voulues d'ordre, un ordre pour lequel sa solidité native
le prédestinait pourtant s'il s'était laissé aller davantage, s'il avait eu plus
confiance en la générosité si sympathique de sa nature.
***

fac-simile d'un autographe de M. Marcel Labey
Bien d'autres compositeurs de talent sont sortis de la Schola Cantorum, élèves de M. V. d'Indy. Qu'il me suffise de citer M. Marcel Labey, très direct élève du maître, dont les œuvres jouées à la Société Nationale ont fait apprécier les qualités de style et de très pure écriture musicale (Quatuor à cordes, Quatuor avec piano, Sonate pour violon et piano, Sonate pour alto et piano) — de M. G. Samazeuilh, dont le Chant de la Mer, pour piano, fait pendant au Poème des Montagnes, de M. d'Indy, et au Chant de la Terre, de Séverac, auteur également d'un Quatuor à cordes, d'une Sonate, piano et violon — de M. J. Cras (Paysages, pour piano ; Sonate, piano et violoncelle ; Quintette, piano et cordes), marin, comme le fut M. Alb. Roussel — dont un Polyphème a été récemment applaudi à l'Opéra-Comique — de M. de Castera (Trio, Sonate, piano et violon).

G. Samazeuilh
Tous ont suivi de plus ou moins près, la direction que leur avaient donnée les plus excellentes études musicales. Parmi les tout derniers venus, un talent jeune encore, mais destiné, semble-t-il, à réaliser plus que des promesses — par des qualités aiguës de sensibilité, un charme prenant venu des pays slaves : M. L. de Rohozinski, polonais de culture française, et récemment naturalisé, nous a fait applaudir ces dernières années une Sonate, piano et violon, une Suite brève, pour alto, flûte et harpe (M. Sénart, éditeur), des pièces de piano — où des sonorité savoureuses, d'un goût sûr et vivace appuient le sentiment le plus sincère, un humble don de soi-même des plus rares.
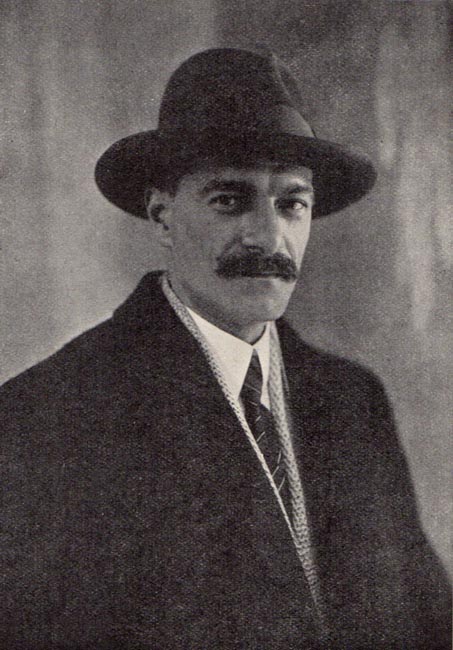
Ladislas de Rohozinski (photo Nadar)
CLAUDE DEBUSSY. — Claude-Achille Debussy, né à Saint-Germain-en-Laye le 22 août 18S2, est mort à Paris le 26 mars 1918. Avec lui nous atteignons un stade nouveau et de première importance dans l'évolution de la musique en France ces cinquante dernières années. L'influence considérable qu'il a eue sur ses contemporains ou les générations qui l'ont suivi, le désigne plus que tout autre comme un chef d'école, ayant été amené à diriger ses recherches dans un domaine que personne jusqu'à lui — sauf, très vaguement, Em. Chabrier — n'avait pu encore soupçonner. Jusqu'ici tous les musiciens que nous avons étudiés étaient restés plus ou moins dans les données classiques, dérivés des premiers et inoubliables modèles laissés par l'école allemande de la fin du XVIIIe — à part quelques plus jeunes que l'ordre de ce travail nous a conduits à faire apparaître avant lui, quoique venus à sa suite et influencés par sa manière. A partir de Debussy est née l'école contemporaine, d'abord directement inspirée de ses idées, puis répudiant certaines d'entre elles pour se développer dans un sens nettement différent, semblant même opposé, mais cependant conservant avec lui plus d'attaches qu'avec aucun autre.
Entré au Conservatoire en 1873, dans la classe de solfège de Lavignac, Debussy en obtint successivement les trois médailles — de même qu'un accessit et un second prix dans la classe de piano de Marmontel. Un premier prix d'accompagnement, un accessit de fugue, le second puis le premier grand prix de Rome (classe d'Ern. Guiraud) complètent les divers lauriers recueillis par lui à l'école. Il faut noter son échec aux concours d'harmonie : cet inventeur subtil des agrégations les plus savoureuses et les plus rares a été jugé incapable à cet égard dans sa jeunesse !...
L'un des envois qu'il fit de la Villa Médicis fut : la Damoiselle élue, poème lyrique pour voix de femmes : soli, chœurs et orchestre. Plusieurs mélodies : Ariettes oubliées (1888) ; cinq poèmes de Baudelaire (1890) ; des morceaux de piano (entre autres : Suite bergamasque, de la même année) ; le Prélude à l'après-midi d'un faune (orchestre, 1892) ; le Quatuor à cordes (1893) ; les Proses lyriques (1894) ; les Chansons de Bilitis (1898) ; Trois Nocturnes (orchestre, 1899) ; Pour le piano (Prélude, Sarabande, Toccata, 1901) — précédent l'apparition de son chef-d’œuvre, commencé dès 1892, et représenté à l'Opéra-Comique, le 30 avril 1902 : Pelléas et Mélisande, drame lyrique en cinq actes, écrit en collaboration avec M. Maeterlinck — une des dates les plus importantes de notre histoire musicale.
Depuis, Debussy nous a donné de nombreuses œuvres de piano : D'un cahier d'esquisses (1903) ; Estampes (1903) ; l'Isle joyeuse (1904) ; Images, deux séries (1905 et 1907) ; la Mer, trois esquisses symphoniques (1905) ; Children's Corner (le Coin des enfants) (1908), pour piano, de même que l'Hommage à Haydn (1909) ; Images, troisième série pour orchestre (1909) ; la musique de scène du Martyre de Saint-Sébastien (cinq actes de M. G. d'Annunzio, 1911) ; de nouvelles mélodies ; vingt-quatre préludes en deux livres, pour piano, ainsi que des études (1915) ; enfin trois œuvres de musique de chambre : Sonates, pour flûte, alto et harpe ; pour violon et piano ; pour violoncelle et piano (Durand, éditeur). Et sa production se trouva ainsi achevée en pleine maturité.
Parvenu à la terminaison de ses études au moment où R. Wagner prenait possession de la mode en France — à la suite des éclatantes auditions du premier acte de Tristan et Isolde, données par Ch. Lamoureux en 1884 — Debussy commença par vouer une enthousiaste admiration au maître de Bayreuth. Mais sa personnalité — diamétralement opposée — son éducation qui l'avait amené à subir, au début, l'ascendant de nos musiciens français, notamment celui de Rameau — aussi bien, cela est d'évidence, celui de J. Massenet — ne le portaient guère à s'attarder, comme tant d'autres, sur les traces du musicien allemand. D'une nature très voluptueuse et sensuelle, très sensible aux tendances de la fin du siècle qui l'appelaient vers les théories préraphaélites ou picturales de l'impressionnisme, intéressé par les poètes récents : Baudelaire, Verlaine, Mallarmé — il trouva, peu de temps après son retour de Rome, son chemin de Damas dans une occasion qu'il eut de connaître la version primitive de la partition de Moussorgski : Boris Godounov. L'intense émotion qu'il éprouva à cette audition pénétra sa vie entière et contribua dès lors, plus que toute autre, à le former, à le révéler à lui-même, lui permettant de s'évader hors des sentiers suivis par ses devanciers et de découvrir un art inédit, qui ne devait rien à la lettre de l'art wagnérien — et s'éloignait autant qu'il est possible de ses caractéristiques germaines — mais en continuait, à bien des points de vue, l'ascension vers l'avenir.
Appelé inconsciemment par un instinct, dont l'extrême finesse nerveuse lui donnait la sensibilité comme d'une plaque photographique, enregistrant sans contrôle (sans l'intervention de la volonté qui ne l'eût plus permis) toutes les « images » particulières de son siècle — aussi bien les maladives — il créa de toutes pièces un style, d'aspect quasi étrange, où, pour la première fois peut-être à ce point, l'absence de volonté — qui ne veut pas dire l'absence d'ordre — l'abandon, jamais autant, à la sensibilité, unis à de l'esprit — dans le sens le plus étendu de ce mot, aboutirent à une expression nouvelle, manifestation lumineuse de son époque.
Avec elle il réagit contre tout ce qui devait être, dans l'art wagnérien, particulièrement antipathique à notre nature nationale : les excès de puissance, où il voyait de la boursouflure (il faut cependant distinguer entre un Wagner et un Strauss...) qu'il remplaça par de la mesure, de la réserve, de la douceur ; les longueurs, l'abondance des développements ne faisant grâce d'aucune conséquence lointaine auxquelles il opposa du choix, du synthétisme, le goût du raffinement ; la logique très à découvert et appuyée à laquelle il substitua un cheminement soigneusement voilé de sa pensée, qu'il fit adroitement subtile. Contre la force magnifique, mais enténébrée, du Goliath germain, il usa, nouveau David, de l'intelligence et surtout de l'adresse.
Nul ne fut plus merveilleusement adroit. Ne se laissant pas engluer par une imitation stérile du musicien russe qui avait éveillé son avenir, il réussit à s'en écarter, ne s'assimilant pas ses qualités, mais ne songeant pas à se prendre à ses défauts. Autant Moussorgski avait été un primitif, simple, naïf, véridique, brutal, autant il fut cultivé (non en soi, mais bien par atavisme), complexe, retors, fuyant et raffiné jusqu'à la déliquescence. Ce n'est pas à dire — loin de là — qu'il est sans défauts et dans cette figure qui restera, de par son génie, une des plus importantes non seulement de notre musique, mais de la musique européenne, ils sont très visibles et certains. Amorcer une idée mélodique et ne lui donner un aspect spécial qu'en en coupant de façon inattendue l'exposition normale est plutôt une négation qu'une affirmation, plutôt tourner la difficulté que la résoudre. Se refusant aux développements classiques, répéter trop souvent des mesures identiques dans une sorte de balbutiement de pseudo primitif n'est pas non plus un réel renouvellement. Se servir, dans ces mêmes développements, des éléments les moins marquants de ses thèmes plutôt que des principaux, de telle sorte que, dans une composition un peu étendue, on est quelquefois embarrassé de savoir si tel fragment est la conséquence de tel thème ou tel autre, n'est pas toujours de la subtilité, mais aussi bien du manque d'affirmation, voire une certaine propension à quelque mensonge. Employer des successions de quintes, ou mieux encore de neuvièmes ou d'accords plus chargés, dans un mouvement direct à toutes les parties qui nie l'écriture classique sans la remplacer, peut donner lieu au début à des effets inoubliables, par intervention d'une sensibilité touchante à l'extrême, mais devient à la longue un procédé lorsque, cette même sensibilité n'agissant plus — c'est elle seule qui était ici intéressante — il ne reste qu'une imitation voulue et paradoxale de maladresse. D'autre part, la peur du « colossal » devait l'amener, par excès contraire, à un emploi trop fréquent de la nuance pianissimo, de la sourdine, à une évite exagérée des sentiments graves pour s'en tenir trop souvent à de la nonchalance, de l'affectation. La grosse pierre d'achoppement à laquelle s'est heurté Debussy — conséquence de ses qualités de sensationniste, de surtout instinctif et délicat enregistreur — c'est le manque de volonté qui, avec le manque de franchise — inconscient semble-t-il, et, en tous cas, direct, sans hypocrisie — apparaissent à l'origine de son œuvre.
Quant à l'influence russe, était-elle, en réalité, très normale à subir pour un esprit latin ? — j'entends l'influence de la mentalité — car les caractéristiques musicales russes, au fond, existent peu : l'art de ce pays n'est-il pas simplement l'adaptation à notre culture que leurs musiciens n'ont guère su renouveler — du folklore oriental ? La pure beauté occidentale a peu à faire de ces apports étrangers et quelque peu barbares, autrement que pour en alimenter sa vitalité — devant se garder de modifier l'essence de sa conception, en soi éternelle. Et la crainte des influences allemandes, déjà trop loin de nous, ne s'explique plus si elle est remplacée par l'envoûtement oriental, encore plus distant.

fragment d'un autographe de Claude Debussy (Bibliothèque du Conservatoire)
Nombreuses apparaissent donc les critiques que l'on peut formuler contre l'art debussyste. Mais nombreux sont aussi, à tous points de vue musicaux, les mérites qui le distinguent. La difficulté qu'il avait de vouloir — subissant, sans peut-être s'en douter, la réaction que devait fatalement produire l'outrance à ce point de vue du maître allemand — l'a amené à l'élaboration d'un art subtil et mystérieux où rien n'est assuré, tout est effleuré et perpétuellement masque le mécanisme de la composition : rythmes qui, craignant de s'opposer de façon trop voyante, finissent par aboutir à des ondulations imprécises ; mélodie dont la ligne, en apparence vague, suit une route — à l'analyse conduite — mais cachée ; emploi continuel d'altérations qui nous laisse à dessein toujours entre deux tonalités, comme dans l'inquiétude de prendre parti (essai de renouvellement qui lui suffit un moment pour modifier, profondément bouleverser, sembla-t-il, les possibilités expressives de l'art musical). Il avait une prescience étonnante de ce que peut obtenir une architecture générale, s'établissant sous l'impulsion d'une imagination qui se donne carrière avec fantaisie et en toute liberté. Se lançant hardiment dans l'improvisation (mot dont il a compris le sens aussi loin que possible pour le véritable artiste du vague et du « lâché »), il a trouvé des équilibres nouveaux. Son courageux abandon à l'Inspiration — qui, obéissant à un ineffable compromis entre des apparitions successives au premier plan du sentiment et de la raison, permet seule à des œuvres vraiment vivantes de s'épanouir — nous fait constater, après coup, combien ses œuvres obéissent davantage aux principes généraux et immuables, à travers les siècles, de la composition que celles qui s'en tiennent à l'imitation étroite des productions considérées jusqu'ici, avec raison d'ailleurs, comme les chefs-d’œuvre de l'art. Son invention harmonique, pleine de saveur et de délicieuse expansion, a un charme qui séduit et enivre ; dans ses plus grandes hardiesses, la sonorité exquise et suave dépend toujours de la sensibilité, jamais d'une logique laborieuse et froide ; leur originalité est directe, naturelle, non péniblement cherchée, les trouvailles abondent. A la polyphonie classique il a substitué une polyphonie rythmique ondoyante, souple et riche, dans laquelle il montré une fois de plus son esprit de mesure qui n'évite pas les complications quand elles sont nécessaires, mais ne se perd pas dans la surabondance et les excès. Mais surtout ce fait demeure qui reste évident : Debussy nous a donné, principalement dans ses productions d'orchestre, et tout au moins jusqu'à Pelléas — plus rarement depuis — de nombreuses preuves de génie, dans le sens propre de ce mot qui dépasse la musique, l'artifice pour atteindre l'humanité — dont il nous a révélé des aspects jusqu'à lui encore inexprimés. Telles de ses œuvres sont parentes des plus belles œuvres connues, dignes de leur être comparées, de marcher de pair avec elles, et les ont continuées, phares jalonnant et éclairant la « route du Beau » (Baudelaire). Qu'importent les défauts — et l'analyse — quand on rencontre, après Mozart, Schumann, Berlioz ou Wagner, un homme qui sût souvent comprendre que le jeu ne s'établit pas seulement entre les notes — mais bien entre elles et l'émotion, la sensation, la vibration humaines qui nous intéressent davantage — est-il besoin de le dire ? — que les plus admirables décors, lorsqu'ils n'en sont pas l'épanouissement, la simple conséquence, dérivée et directe ?
***
L'œuvre de piano de Cl. Debussy est très abondante. Elle commence à Deux arabesques, morceaux de jeunesse, où l'on sent encore l'élève frais sorti du Conservatoire : œuvres claires, bien et nettement présentées, mélodiques — mais Debussy comprendra autrement par la suite le sens du mot : « arabesque ». Il est significatif cependant qu'il l'ait employé dès l'abord.
Chabrier, son précurseur, était toujours désireux de recherches harmoniques, rythmiques — et ses œuvres sont pleines de trouvailles à cet égard : il sacrifiait tout à leur poursuite, mais, dans sa verve, se laissait aller aussi à quelque vulgarité. Ici, au contraire, on se trouve en présence d'un tempérament ordonné — la recherche viendra plus tard. Ce qui apparaît en premier lieu, c'est le désir d'arriver surtout à un harmonieux ensemble, par des moyens sobres, sans excès, point trop nombreux — et distingués. Il y a lieu d'en faire la remarque, car Debussy a été pris, bien à tort, par quelques-uns comme un désorganisateur : certes, il a désorganisé, mais il a aussi reconstruit — ses œuvres réussies sont toujours des merveilles d'équilibre et de pondération.
***
Passant sur la Suite bergamasque, de personnalité encore vague, Petite Suite, et Pour le piano (Jobert, éditeur), où celle-ci s'affirme davantage (Sarabande qui semble comme une esquisse du futur Hommage à Rameau), nous trouvons dans Estampes une des premières productions pour piano tout à fait originales de Debussy. Ayant à cette époque (1903) donné la plupart de ses admirables ouvrages pour orchestre, l'auteur de Pelléas commence à renouveler la technique du clavier. Pagodes, première pièce de cette série, est un morceau en si majeur, qui ne module presque pas, reste fort longtemps sur les mêmes accords — ils durent jusqu'à dix mesures de suite. L'élément thématique très simple sur lequel il est bâti se répète sans cesse, il ondule capricieusement : toujours sur le point de se mettre en route, il semble incapable de se décider vers l'un ou l'autre but ; de légères modifications rythmiques suffisent à lui donner la variété indispensable.
Un des côtés particuliers de Pagodes (qui se retrouvera par la suite des œuvres de piano) est la recherche d'une extension verticale de la sonorité, résultat obligé de ce que nous ne sommes plus ici en présence, comme chez les anciens, de simples parties superposées, mais bien de groupes de notes, d'accords qui s'établissent aux différentes hauteurs de l'harmonie — semblables entre eux d'ailleurs (il n'est pas encore question chez Debussy de superpositions de tonalités). Au lieu de se servir de personnages solistes, chantant simultanément pas jeux de demandes et réponses, Debussy semble faire parler des chœurs, des groupes de personnages, forcément plus vagues, ce qui contribue à former l'atmosphère cherchée, estompée, impressionniste (dans le sens dérivé que l'on donne généralement à ce mot).
La charpente générale du morceau présente toutes les données classiques, mais avec la plus grande liberté. Il y a bien un second thème, dans le ton de la quinte et chantant, mais ce second thème est si bref, il est tellement une simple émanation du premier (procédé renouvelé des débuts de la Sonate, de Haydn) que c'est à peine s'il s'en distingue. Après avoir exposé, à peine, ce deuxième thème et avoir comme esquissé un court développement de son thème rythmique — cela dans le ton principal et sans moduler — il donne la conclusion du deuxième thème un peu plus longuement, mais toujours dans le ton de la dominante — au lieu, classiquement, de la tonique — obéissant, avec fantaisie, au système de l'ordre inverse, avant d'accomplir la conclusion du thème principal — qu'il ne cherche à modifier en aucune manière — pour aboutir à une péroraison —qui serait plutôt une troisième exposition — très agogique, sous forme d'un trait de piano à la main droite de neuf triples croches par temps (cinq et quatre), sorte d'estompage du thème avec adjonction d'une appogiature supérieure de la sixte (par conséquent la sensible — descendant toujours et ne voulant pas monter) qui enveloppe le thème exposé comme la première et la deuxième fois, mais ici forcément dans le grave (à la main gauche restée libre). Vers la fin, la main gauche redit les chœurs graves (d'hommes) en les élargissant, et le morceau se termine sans résoudre les appoggiatures sur l'accord de tonique avec sixte ajoutée — dérivé d'une des plus chères admirations de Debussy : Rameau.

fragment d'un autographe de Claude Debussy (Bibliothèque du Conservatoire)
Dans cette pièce, le sens du mot « arabesque » semble définitivement compris et donne lieu à un art d'un charme particulier, encore jamais entendu. Chacun des chœurs superposés dit à sa manière l'élément mélodique choisi. Très précis d'abord, avec des valeurs de notes nettement différenciées, l'effacement progressif de ces différences semble comme l'évaporer. Toutes les modifications rythmiques qui se présentent à l'esprit nonchalant de l'auteur : augmentations, diminutions, rythmes précis, rythmes assouplis, simultanéité de fragments élargis et de répétitions très raccourcies (jusqu'à une sorte de trille) expositions directes ou contraires, ou fragmentairement contraires, précipitation du rythme, élargissement ou restriction de la densité jusqu'aux extrêmes... tout lui sert pour atteindre le but. Et ce but c'est le renouvellement de l'architecture. Car, comme chez un Claude Monet, l'intérêt principal est dans le dessin, ici il est dans la charpente mélodique — dans la compréhension qu'elle n'a pas de raisons d'être immuable, d'être toujours comprise de la même façon. Autre chose est de chercher à imiter toujours — même en l'accommodant à notre temps — l'architecture classique, autre chose est d'en comprendre le sens directeur caché, pouvant donner lieu par la suite des temps à tous les styles nouveaux, expressions de chaque siècle qui passe. L'intervention judicieuse d'une libre fantaisie, mais guidée surtout par de la sensibilité à laquelle il « lâche les rênes » (en sachant bien qu'il pourra les reprendre, le moment venu) avait permis à Debussy de créer de toutes pièces un nouveau style, ce qui vaut seul, à proprement parler, le nom d'art.
Deux autres morceaux complètent la série Estampes : la Soirée dans Grenade et les Jardins sous la pluie. Il faut remarquer que Debussy a toujours donné des titres à ses œuvres. La multiplicité des intentions de cet esprit qui ne se crût pas obligé, tout en ouvrageant des musiques exquisément sonnantes, d'éviter les évocations littéraires ou picturales — bien au contraire — exigeait d'être ainsi soulignée. Ces titres sont toujours choisis avec ce goût inné, unique, qui est une des marques distinctives de son génie. Cependant ce goût, généralement si parfait, n'a pas su toujours écarter quelques influences moins heureuses et, dans un morceau comme la Soirée dans Grenade, malgré son charme, sa poésie, ses délicieuses sonorités évoquant dans le lointain, par une nuit d'étoiles, des danses exotiques — malgré aussi les mouvements parallèles, des fragments de gammes par tons (une des caractéristiques, un des procédés de son style), une composition complexe, un peu trop peut-être, et dont les divers éléments réapparaissent successifs sans grand développement, elles ne laissent pas de se montrer. La richesse de la sonorité, néanmoins, est incomparable.
Les Jardins sous la pluie sont un prétexte, par leur rythme obstiné de quatre doubles croches par temps, à un morceau brillant (net et vif, suivant l'indication du mouvement). Bâti sur deux thèmes populaires : « L'enfant dormira tantôt » et « Nous n'irons plus au bois », c'est la rêverie hallucinée d'un enfant de nos jours, trop actuel hélas ! et trop averti, devant l'averse qui cingle les vitres et brouille les paysages lointains. Ici Debussy a marqué le côté décadent de sa recherche — dans, quelquefois, sa trop grande complaisance à écouter les langueurs d'un siècle qui, après de magnifiques bouillonnements, touchait à l'agonie : la véritable qualité de ces thèmes serait la fraîcheur, la naïveté, loin des sensibilités surchauffées et trop factices...
***
Laissant de côté l'Isle joyeuse, sorte de Venusberg français, où Chabrier et Massenet se donnent la main — dans une charpente trop uniformément attachée au ton de la, nous atteignons les six pièces des plus intéressantes qui forment les deux séries intitulées : Images. La première, Reflets dans l'eau, est un incomparable paysage, suavement ordonné, où l'on sent passer — dans l'ombre de Chopin — comme des souvenirs de la fontaine de Mélisande : enlacements mystérieux et profonds, sentiment de la nature — un thème de trois notes, soupir d'aise tranquille sous les ombrages des grands arbres — l'être comme absorbé dans la sensation d'un beau jour. Et en effet la nature prend la première place et apparaît la source qui bondit... Ces reflets ne sont-ils pas de l'âme de l'auteur, qui mire dans l'eau indifférente ses inquiétudes nostalgiques, se lamentant avec quelque complaisance sur son sort malheureux d'homme moderne ? Après cette seconde exposition — en variation classique — l'eau maîtresse l'attire, il y trouve un réconfort, s'abandonne éperdument à la passion qui, toujours, au fond l'agite — s'en lasse, semble s'égarer puis, inconsciemment appelé par son instinct d'ordonnateur vers la tonalité du début, se repose tout à coup doucement sur un merveilleux accord d'ut mineur — que l'eau fouette d'un arpège tranquille. Dans une troisième et dernière exposition qui atténue les rythmes, le thème tout à fait transformé — pastoral — consomme l'anéantissement définitif de l'être dans le paysage (Debussy est humain, mais — déliquescent — il tend surtout à exprimer l'abandon, l'absorption de l'âme humaine dans la nature, en une sorte de communion finale) et une sonorité « harmonieuse et lointaine » détermine l'apaisement, sous un dernier et lumineux reflet...
Hommage à Rameau : Le XVIIIe siècle apparaît à nos yeux sous couleur de fantômes qui s'agitent gravement, ont des repos impressionnants. Toujours le principe des chœurs, soit masculins au début, soit, dans le centre, féminins, dans une sorte de lamentation. Un instant, un arpège fulgurant semble vouloir écarter les voiles de brume qui masquent les personnages. Mais, énoncé une seconde fois, il s'atténue, s'assombrit et la conclusion symétrique du début s'établit, avec, vers la fin, l'effacement progressif du thème principal. Extension et plénitude de la sonorité, que l'on dirait d'orgue — conséquence lointaine des effets wagnériens.
La troisième pièce : Mouvement, animée « avec une légèreté fantasque et précise » (Chabrier). Morceau des plus simples avec son début, son milieu, la répétition symétrique du début (textuelle), sa péroraison qui s'éloigne et disparaît, sur l'accord classique de sous-dominante. Sorte de fête, mouvement exubérant de foule : sur un fond de piétinement (rythme obstiné de triolets de doubles croches) s'élève un cri collectif, émanation naturelle de cette foule, exclamation à laquelle répond un strident appel de cor. Et dans un milieu chromatique, une plainte passionnée, éperdue, s'énonce, d'intéressantes harmonies doublées aux deux mains (recherche toujours d'effets dynamiques) se développent sur une pédale de dominante, qui voyage autour de cette plainte de l'extrême grave à l'extrême aigu ; foule qui cherche « quelque chose » (comme aurait dit M. Maeterlinck), un instant douloureusement. Et les triolets, qui pas un instant ne cessent, reviennent au premier plan, monotones, après ce milieu plus âpre, pour se perdre dans les hauteurs du clavier tandis que le thème central s'évapore en son milieu.
Dans la deuxième série d'Images — ces images que quelque tsar Boris semble faire feuilleter à son fils — nous retrouvons les mêmes tableaux, les mêmes scènes que dans la première. Cloches à travers les feuilles ; Et la lune descend sur le temple qui fut ; Poissons d'or montrent l'épanouissement que faisaient prévoir les œuvres précédentes. Ici l'auteur se décide à écrire d'un bout à l'autre sur trois portées — ce qui éclaire ses combinaisons pianistiques. Emploi systématique de la gamme par tons (N° 1). Souci de l'accord, de l'amalgame rare, en même temps qu'évocation, sous la douce clarté de la lune, des hautes colonnes d'un temple de rêve autour desquelles se déroule une procession (N° 2). Ordre toujours d'un riche et parfait équilibre, naturel dans les imaginations des sons simultanés, qui se succèdent sans heurts, sans apparente recherche d'originalité, tant elle est ici innée (N° 3) — et, toujours aussi, les thèmes si déformés dans leurs développements qu'on ne peut comprendre qu'à la lecture la raison du charme subi. Mais n'est-ce pas là le but que Debussy s'était proposé : développant consciemment et musicalement, mais ne laissant à l'auditeur que la jouissance, se refusant à lui en permettre sur le moment l'analyse ?
***
Combien d'autres œuvres solliciteraient notre intérêt ou notre plaisir ! Sans nous arrêter à Children's Corner, qui nous montre une des faces du talent de Debussy : le côté spirituel, un peu amoindri toutefois ; passant également à l'Hommage à Haydn, la Plus que lente, valse..., nous parvenons aux vingt-quatre Préludes en deux livres.
Pièces spirituelles ou charmantes, décelant de l'anglomanie (Minstrels, Général Lavine, Pickwick) bien de la génération de l'auteur ; ou évoquant, dans la joie et la lumière, le ciel de l'Italie (les Collines d'Anacapri) ; ou s'adonnant — chose rare chez Debussy — à l'expression large et grandiose (la Cathédrale engloutie), nous y trouvons encore le caprice aérien avec des appels de trompettes argentines (Danse de Puck) ; ou l'impressionnisme avec l'Ondine — proche des Sirènes (Nocturnes) — avec Brouillards, Feux d'artifice : fêtes populaires (toujours avec combien de distinction d'esprit), bouquets de fusée et dernier soupir de la Marseillaise...
Si l'on ajoute à ces œuvres diverses les Douze études en deux livres, écrites par l'auteur à la fin de sa vie, et dédiées à la mémoire de Frédéric Chopin — études extrêmement musicales et ingénieuses où l'esprit, un peu trop à l'aise cependant de l'homme arrivé au port, se donne surtout carrière pour l'amusement de jeunes gens non dépourvus de snobisme, nous touchons à la fin de la production pianistique de Debussy qui, pour ne pas atteindre les sommets de son art — Prélude à l'après-midi d'un faune, Chansons de Bilitis, Premier Nocturne, Pelléas — n'en montrent pas moins, et de nombreuses fois, les qualités profondes et subtiles qui le distinguent.
***
Debussy s'est relativement peu adonné à la musique de chambre. Au commencement de sa production, il a écrit son célèbre Quatuor à cordes (Première audition à la Société Nationale le 29 décembre 1893). En 1910, nous trouvons de lui une rhapsodie pour clarinette et piano, depuis orchestrée. Enfin, il avait entrepris dans ses dernières années la composition de six Sonates pour divers instruments, dont il n'a pu écrire que les trois premières.
Le Quatuor à cordes en sol mineur est divisé classiquement en quatre mouvements et bâti d'après les principes cyclistes, l'idée initiale servant avec des modifications rythmiques, de thème de scherzo, et se retrouvant, par augmentation, en son trio. L'andantino (3e partie), quoique beaucoup plus éloigné du thème, n'est pas sans rapports avec lui, non plus que son milieu. Dans la quatrième partie (développement et péroraison) apparition intégrale du thème cyclique, dont les trois premières notes, augmentées, terminent l'œuvre. Debussy se trouve avoir ainsi obéi aux courants d'alors et tenté de poursuivre les idées de Franck au sujet du cyclisme. Il est pourtant difficile de trouver deux esprits plus distants... et d'ailleurs tout, dans cette œuvre, est aussi éloigné que possible de l'esprit franckiste, à part ce procédé portant la marque de son temps. Mouvement, couleur se partagent l'intérêt, loin des recherches de pureté un peu froide et trop stable de l'écriture, dans un esprit de hardiesse aventureuse, guidé par un goût sûr, de l'ordre instinctif. La poursuite du renouvellement s'appuie franchement ici sur la musique russe. Dès les premières mesures, la phrase, au lieu de conclure par un retour symétrique sur elle-même, s'évade et fuit vers une expression comme de « gestes éperdus » — ainsi qu'on disait alors — qui souvent, par la suite, interviendra et donnera à l'œuvre un caractère moderniste un peu affolé — le sens de la direction semblant, à force d'ivresse de mouvement, momentanément perdu, l'esprit anesthésié n'ayant ni le courage — ni même le désir — de chercher à s'affermir et à la reprendre. L'œuvre, malgré ce côté peu malsain, reste néanmoins extraordinairement vivante et de la plus séduisante sonorité, pleine de nouveauté et d'une écriture qui, pour ne pas s'en référer aux procédés classiques jusque là employés dans le maniement du quatuor à cordes, est perpétuellement ingénieuse et intéressante Toute critique tombe devant le charme, surtout s'il atteint à cette profondeur, à cette humanité dont les accents angoissés ou mélancoliques étreignent l'âme bien au delà de la surface sonore, quelqu'en soit l'éblouissement passager. Quiconque a entendu, lors de son apparition, le Quatuor de Debussy sait quelle joie, quelle intime satisfaction, plus jamais obtenues après les auditions wagnériennes, il donna, quelles promesses d'avenir, depuis réalisées pleinement par l'auteur de Pelléas. Subtilité de la charpente mélodique — le deuxième thème n'apparaissant dans le premier mouvement qu'au début du développement (et dans le ton si éloigné de fa dièse mineur), et se fondant, s'absorbant dans le premier de façon si nouvelle à la péroraison — pizzicati environnant d'une ambiance quasi irréelle le rythme obstiné du thème cyclique dans le scherzo — et surtout la pure merveille de l'andantino dont la fin, à elle seule, est un chef-d’œuvre — extrême animation, sourdement passionnée, du final — variété, naturel, ce naturel si rare dans l'originalité — chez tant d'autres péniblement recherchée — toutes les qualités d'un génie jeune et vainqueur sans luttes se retrouvent ici.
Parmi les dernières œuvres, la Sonate pour alto, flûte et harpe, surtout, nous a donné à nouveau les délicieuses impressions de l'atmosphère debussyste. Le choix charmant de ces instruments, bien dans la manière de l'auteur, une sorte d'évocation faunesque rappelant, continuant une de ses premières tentatives — pour laquelle sa nature ironique et sensuelle était particulièrement faite — le même équilibre subtil et parfait de la sonorité, le sortilège d'une sensibilité toujours humaine et touchante sont un peu le chant du cygne de ce génie — souvent menu certes — mais ayant su nous parler le langage le plus séduisant et, pour tout dire, envoûter à nouveau, à peine las de Tristan, les wagnériens ravis de trouver chez lui une fois encore, mais profondément modifiée, l'essence même de la musique : à travers des sonorités exquises et jamais encore entendues, l'Emotion, le mouvement de l'âme qu'elles expriment et qu'elles servent.
M. MAURICE RAVEL ET LES ÉLÈVES DE M. G. FAURÉ. — Les musiciens français qui ont commencé à produire au début de ce siècle, à la suite de l'efflorescence du debussysme — élèves par ailleurs non de Franck ou de M. d'Indy, mais de M. G. Fauré, dont ils affectionnaient le génie si plein de charme et de saveur — ont combiné dans leurs œuvres, pourrait-on dire, les influences si diverses de ces deux maîtres — plus ou moins portés, suivant leur nature, vers l'esthétique de l'un ou de l'autre.

fragment d'un autographe de Maurice Ravel (propriété de la maison Durand et fils)
L'un d'entre eux, dont la personnalité est directement issue, non de M. Fauré mais bien de Debussy, qu'il a continué avec des différenciations certaines et une grande originalité propre, est M. Maurice Ravel, né à Ciboure (Basses-Pyrénées) en 1875. Il entra au Conservatoire, en 1889, dans la classe de piano de M. Anthiome, puis, deux ans plus tard, dans celle de M. de Bériot. Il fut, par la suite, élève de M. Émile Pessard pour l'harmonie, de M. André Gedalge pour le contrepoint et la fugue, de M. G. Fauré (1897) pour la composition. Second grand prix de Rome en 1901, il ne réussit pas dans les concours des deux années suivantes et, après un an d'intervalle, en 1905, ne fut même pas admis à monter en loge — l'apparition de ses premières compositions ayant indisposé contre lui les membres du jury.
L'ostracisme dont il était ainsi victime le mit dès lors en vedette, de même que la hardiesse de ses œuvres de début : Sites auriculaires (1896), Ouverture de Schéhérazade (jouée au concert d'orchestre de la Société Nationale, en 1898), Jeux d'eau, pour piano (1902).
Sa production pour le clavier, qui fait suite à cette dernière pièce, semblerait, dans un premier examen, fort influencée de la manière de Cl. Debussy — et, très évidemment, M. Ravel a été en grande partie amené à ses procédés propres par l'apparition de ceux de son aîné. Mais lorsqu'on se familiarise avec les œuvres de M. Ravel on peut constater à quel point son style, sa personnalité sont loin de ceux de l'auteur de Pelléas. Même les qualités qui leur sont communes ou qui ont, tout au moins, entre elles une parenté — je pense au côté spirituel — se présentent chez l'un et l'autre sous l'aspect le plus différent. Si l'on se trouve feuilleter des albums de dessins avec légendes — que l'on passe de celles d'un Gavarni ou d'un Daumier à celles d'un Forain, ou, plus tard, d'un Abel Faivre, on est frappé combien l'ironie en devient de plus en plus amère, agressive. Il en est un peu de même de l'esprit de M. Ravel par rapport à celui de Debussy. Autant l'ironie de ce dernier est légère et sans aigreur, toujours disposée à se tourner vers le rêve et la poésie, autant l'esprit de M. Ravel est acéré et tendu vers de la sécheresse et quelque froideur. A peine influencé de M. G. Fauré dont il s'est éloigné de plus en plus — plutôt de Chabrier — sans compter même, dit-on, Richard Strauss, avec lequel il n'a pourtant pas beaucoup de rapports — M. Ravel est avant tout lui-même : une personnalité nerveuse, colorée, hardie jusqu'à la témérité. Il est grand amateur de risque — ce qui lui a valu d'être considéré, après Debussy et dès ses premières œuvres, comme le musicien d'avant-garde par excellence, le porte-drapeau, signe d'espoirs d'avenir de tous ses jeunes camarades.

Daumier : Soirée musicale
Jeux d'eau (Eschig, éditeur) est, comme la plupart des autres productions pour piano de M. Ravel, un morceau d'une difficulté d'exécution transcendante. Son écriture, précise à l'extrême, son chatoiement harmonique, sa netteté rythmique sont essentiellement différents de l'enveloppement poétique que l'on rencontre dans les œuvres de Debussy. Construite avec toute la fantaisie d'un véritable « moderne », fantaisie qui n'exclue pas une obéissance, mais très libre et désinvolte, aux plans classiques dont il conserve l'ordonnance générale, l'œuvre présente d'abord une exposition rythmique très positivement, semble-t-il, en ut dièse mineur (en évitant la plupart du temps les accords consonnants pour se servir plutôt de septièmes et d'altérations) qui passe tout à coup par une fusée de six notes à la phrase de chant dans le relatif : mi majeur. M. Ravel conçoit, en effet, à juste titre, qu'au XXe siècle il ne sied plus de s'attarder et, lorsqu'il quitte une idée pour une autre, le fait en toute prestesse sans vouloir établir des « ponts » laborieux ou développant un nombre d'arches trop respectable.
Lorsqu'il aura dépassé les développements du milieu de la pièce — tels ceux d'un allegro de sonate — il en fera attendre la conclusion par une longue pédale de dominante, précédée d'une appoggiature donnant le la grave, dernière note du clavier, qui est la trouvaille la plus spirituelle et la plus réussie...
Et la conclusion, très raccourcie — les redites devenant de plus en plus antipathiques à nos habitudes — et des plus modifiées se confond avec une sorte de « péroraison-cadence » qui précède la dernière exposition de la seconde phrase — que l'auteur laisse dans son premier ton de mi majeur — pour terminer dans une tonalité indécise sur l'accord même par où il avait commencé. Veut-il nous poser cette énigme : en quel ton véritablement doit-on considérer qu'est composé Jeux d'eau : ut dièse mineur ou mi majeur ? ou bien M. Ravel considérerait-il, comme Beethoven, que ces deux tonalités n'en font qu'une ?
Tous les dessins et les plus hardis (telle la jonglerie de secondes majeures à la main droite au-dessus du thème de chant qui, à la conclusion, atteignent une vélocité exigeant un mécanisme spécialement éprouvé), toute la rocaille d'harmonies modernes amenant les rencontres de notes les plus imprévues mais les mieux sonnantes, tous les rythmes donnant lieu à une prestidigitation de mouvement qui se poursuit sans arrêt du commencement à la fin... Jeux d'eau est assurément, sauf quelque sécheresse, un des morceaux de piano les plus curieux qui ait jamais été écrit — comme il est par ailleurs des plus significatifs du tempérament de l'auteur.
Miroirs (1905) est une série de cinq pièces intitulées : Noctuelles ; Oiseaux tristes ; Une barque sur l'océan (depuis orchestrée) ; Alborada del gracioso ; la Vallée des Cloches (Paris, Eschig).
Les titres seuls indiquent la tendance de M. Ravel à un romantisme exaspéré — mais dépouillé en même temps aussi complètement que possible de toute sentimentalité : des dessins, des arpèges composés, l'absence généralement de « phrases » pour s'en tenir à l'emploi de simples éléments thématiques, se développant avec précision certes, mais dans l'évite définitive de toute carrure, de toute allure de chant, d'épanchement intime ou profond ; l'arabesque impersonnelle et s'apparentant plus avec la musique du passé (par delà les classiques de la fin du XVIIIe) — combien transformée — qu'avec celle qui nous a directement précédés.
Aussi est-ce une surprise quand on rencontre, comme dans la Vallée des Cloches, une véritable phrase, largement chantée et déclamée : mais la froideur des tintements qui s'éloignent en ensevelit bientôt le souvenir dans le suaire d'un lointain oubli.
Noctuelles — Oiseaux tristes (l'Oiseau prophète de Schumann) titres dont on a vraiment un peu abusé depuis — de même qu'on avait abusé de la pluie dans les jardins après Debussy : la franchise et l'éclat du soleil deviennent bien désirables après ces rêveries maladives... Et la verve d'Alborada del gracioso qui montre le tempérament basque — ni espagnol ni français — de M. Ravel — maigreur musclée et teint chaud — est un réconfort et une joie : glissandos de quartes, glissandos de tierces, notes répétées, arpèges sèchement détachés et serrés — tout un pays, toute une race si curieuse et si complètement à part qui se campe devant nous en des attitudes d'un pittoresque encore inentendu.
Quand on lit l'argument du recueil de trois poèmes pour piano, d'après Aloysius Bertrand, intitulé : Gaspard de la nuit, on ne peut être surpris qu'ils aient séduit M. Ravel. Rien que — dans Ondine, le premier de ces poèmes — la phrase « ... ou se moquent du saule caduc et barbu qui pêche à la ligne » devait l'attirer et l'inciter à traduire des impressions similaires dans un décor musical.
Dans ces pièces la complexité du style romantique de M. Ravel semble avoir atteint son sommet : toutes espèces de batteries, de traits brillants environnent et enveloppent le chant de l'Ondine — curieusement conduit et se poursuivant de bout en bout — dans le Gibet, un si bémol obstiné se fait entendre lugubrement sans arrêt — et Scarbo étincelle, valse et virevolte dans une variété, une débauche de rythmes, une richesse d'harmonies colorées et nuancées qui montre une souplesse, une ingéniosité d'imagination jamais à court d'invention, de vivacité et de trouvailles.
Sans atteindre à l'émotion qui est — on ne peut pas dire le point faible de M. Ravel, car elle est visiblement dédaignée par lui et très consciemment considérée telles ces vieilles lunes, mondes morts dont on ne parle plus et qui glissent solitaires et silencieux à travers les espaces indifférents — la Sonatine en fa dièse (Durand, éditeur) montre un peu plus de recherche expressive, un phrasé plus chantant que les œuvres précédentes dont l'intérêt était essentiellement décoratif. Cela n'empêche pas d'ailleurs M. Ravel de conserver dans cette œuvre le caractère spirituel auquel sa nature ne peut — fort heureusement — échapper. La fausse entrée du début ; l'ironique menuet, ses cadences sans sensible — apparition inattendue de modes antiques — et ses scintillantes appoggiatures qui évoquent dans le lointain des personnages on dirait XVIIIe, brillants fantômes disparus ; l'animation du final, ses recherches harmoniques et ses mouvements parallèles, dérivés de ceux de Debussy, mais bien particuliers — tel est l'ensemble de cette œuvre que sa tendance un peu tournée vers la jeunesse — le titre l'indique — a parée de grâce et de quelque expression, volontairement désuète.
Un peu de même ordre se trouve être la Suite pour piano à quatre mains intitulée Ma Mère l'Oye. Ce sont cinq pièces enfantines : 1. Pavane de la Belle au bois dormant ; 2. Petit Poucet ; 3. Laideronnette, impératrice des Pagodes ; 4. les Entretiens de la Belle et la Bête ; 5. le Jardin féerique (1908, Paris, Durand).
Ce recueil, depuis orchestré et devenu ballet (la représentation en a eu lieu au Théâtre des Arts lors de la direction de M. Rouché) plein d'ingéniosité de couleur et de finesse, met en scène pour l'amusement, non seulement des petits, mais des grands, qui en goûtent le plaisir délié, les vieilles légendes et les contes de fée de Ch. Perrault et de Mme d'Aulnoye. Dessins, cadences, chutes inattendues, oppositions si drôlement appuyées entre le charme de la Belle et la brutalité de la Bête, poésie brillante du « Jardin féerique », du jardin où se rencontrent toutes les imaginations de l'enfance...
La série Valses nobles et sentimentales était destinée, elle aussi, à devenir ballet, sous le titre : Adélaïde ou le langage des fleurs.
La dernière et importante œuvre pour piano de M. Ravel : le Tombeau de Couperin (Durand, éditeur), comporte six morceaux : 1. Prélude ; 2. Fugue ; 3. Forlane ; 4. Rigaudon ; 5. Menuet ; 6. Toccata. Les intentions en sont diverses : tombeau à la fois de Couperin, dont l'auteur nous donne une imitation savoureusement modernisée, et de toute une série de jeunes gens fauchés pendant la guerre à qui ces différentes pièces sont dédiées (la composition en est datée de 1914 à 1917). M. Ravel, en prenant comme modèle le célèbre classique français, s'est trouvé naturellement porté hors des recherches romantiques qu'il avait affectionnées jusque là ; mais, musicalement, il n'a pas abandonné pour cela les frottements sonores, les harmonies audacieuses et neuves qu'il prend toujours plaisir à ouvrager. L'agrément et la délicatesse de ces pages — le prélude, ruisseau coulant par groupes de doubles croches continues, aux heurts légers — la fugue, si originale de rythme et de mains croisées — la forlane aux charmantes harmonies — les qualités d'improvisation toujours adroite et semant à chaque pas les trouvailles qui parsèment de même les autres pièces, font de ce recueil un album de vif intérêt pour le jeu de notre piano, moderne clavecin.
M. Ravel a également écrit plusieurs œuvres de musique de chambre : un Quatuor à cordes (1902-1903) ; Introduction et allegro, pour harpe à pédales avec accompagnement de quatuor à cordes, flûte et clarinette (1906) ; un Trio en la mineur, piano, violon et violoncelle (1915) ; une Sonate pour violon et violoncelle (1922, Durand, éditeur). Le Quatuor en fa expose d'abord une phrase empreinte de douceur et d'émotion, l'auteur un moment attendri et laissant de côté son ironie un peu sèche et amère, mais non pour cela sa personnalité — ce qui tendrait à prouver qu'il pourrait en tirer à nouveau des effets, s'il n'était pas, à son habitude, si dédaigneux de sensibilité, autre que très légèrement à la surface. Cette première idée, assez longuement développée — comme dans le Quatuor de Debussy — fait place à une deuxième fort courte au relatif mineur qui réapparaîtra à la fin sans modification mélodique, mais harmonique. La préoccupation du mouvement donne lieu dans les intervalles des passages plus particulièrement chantés aux quatre instruments — à des dessins et des rythmes presque orchestraux, M. Ravel, suivant l'esthétique actuelle, recherchant davantage l'animation et la qualité de la sonorité que la beauté du contrepoint.
Vient ensuite un scherzo — là encore il est difficile de ne pas penser à Debussy, les pizzicati s'obstinant longuement à tous les instruments mais, comme toujours, quelle différence entre ces deux tempéraments si opposés ! C'est une danse bien évocatrice du pays de l'auteur, le thème issu de la deuxième idée du premier mouvement faisant place en son centre à une phrase pleine d'expression qui, disparaissant un moment devant les développements du début de ce scherzo, plane bientôt au-dessus d'eux. Le trio se trouve ainsi très uni avec le scherzo lui-même, puisqu'il en est, dans les seconds plans, le développement. La conclusion répète l'exposition.
La troisième partie, avec sourdine en son début et sa terminaison — comme précédemment, au contraire, le centre de la deuxième partie — est d'une composition très diversifiée. Prenant son point de départ dans un fragment du thème du scherzo qui forme introduction, c'est d'abord une phrase expressive en sol bémol majeur, entrecoupée de rappels du thème de la première partie — ce qui montre que M. Ravel se laisse à l'occasion séduire par le cyclisme. Le retour de l'introduction dans la nuance « forte » et sans sourdine, alternant plusieurs fois avec un dessin aérien (où la sourdine est à nouveau prescrite) amène de façon inattendue une seconde idée qui atteint ici jusqu'à la passion — et le doux souvenir du thème de la première partie nous rend ensuite l'idée en sol bémol qui s'expose comme la première fois, symétriquement suivie d'un rappel de l'introduction, puis d'une dernière évocation du thème cyclique. L'ensemble est d'une grande variété et d'un charme lointain — un instant rapproché — toujours prenant, sorte de nocturne doux et lumineux.
Le final, assez court, dans l'agitation d'un curieux cinq-huit, enveloppe des émanations de thèmes précédents et termine l'œuvre dans la fièvre et le mouvement.
La perpétuelle recherche d'arrangements particuliers et ingénieux, de sonorités bien « quatuor » et souvent chantant à plusieurs parties mais souvent et dans d'autres cas indépendantes à l'extrême possible les unes vis-à-vis des autres, la plus grande diversité de moyens mélodiques, dans une unité poursuivie avec âpreté et heureusement obtenue — de moyens harmoniques, modulations, chutes de phrases ou détails savoureux — enfin et par dessus tout de moyens rythmiques — telles semblent être les qualités de cette œuvre remarquable et qui avait montré chez un jeune homme de vingt-huit ans des dons tout à fait exceptionnels.
M. Ravel en a continué l'application dans ses plus récentes productions de musique de chambre : le Trio, la Sonate pour violon et violoncelle.
Le Trio, en quatre parties : 1. Modéré ; 2. Pantoum ; 3. Passacaille ; 4. Final, est de la plus séduisante originalité. La première partie se déroule comme une procession quasi orientale, dans ce sentiment volontairement lointain et comme évocateur d'émotions passées, sourdes ou au contraire à l'éclat aigu, incisif, qui est le propre de son style : pédales, mouvements parallèles, pizzicati, sons harmoniques, accords abondants et serrés au piano, arpèges au violon ou au violoncelle, celui-ci souvent à l'extrême aigu, sonorités lumineuses ou, à la fin, perdendosi — tout est mis en œuvre pour obtenir l'effet qui est le plus souvent trouvé et frappant. — Le Pantoum (scherzo), comme son nom l'indique, est une accumulation de moyens de la plus extrême variété, débordant de rythmes et de volontaires complications, fêtes et valses, foules, joie et au-dessus de l'agitation, planant, une phrase expressive et large en résumant la poésie particulière. — La Passacaille, danse lente, commence et se termine à l'extrême grave du clavier, avec un éclat passager au centre. — Le Final, qui débute par un effet de lumière lointaine des plus curieux, s'achève dans le plus extraordinaire scintillement de trilles. Nous sommes loin certes de la conception ancienne de la musique de chambre. Orchestral s'il en fut, ce Trio comporte néanmoins tant d'éléments d'intérêt et — malgré l'abus peut-être de longs et fréquents passages en octaves au violon et au violoncelle — le particularisme, l'âpre poursuite de l'originalité sont ici partout et si continuellement présents que l'on ne peut en vouloir à un auteur qui sait si bien nous tenir en haleine et jeter à pleines mains tant de fleurs sonores de l'effet le plus plaisant, le plus étonnant et, pour tout dire, amusant que l'on puisse concevoir.
La Sonate pour violon et violoncelle, tout à fait récente — extension d'une pièce composée par M. Ravel pour le Tombeau de Debussy — nous montre ses tendances actuelles qui semblent souvent préoccupées, comme chez beaucoup de musiciens nouveaux, de polytonalité — aboutissement assez logique et synthétisé de tant de tonalités confondues et, en puissance, déjà superposées. Il se sert de ce procédé d'une façon toujours très musicale et très personnelle ; mais on n'est pas sans y démêler comme un souci, après avoir lui-même montré le chemin à toute une génération, de ne pas rester en arrière, de ne pas marquer le pas, se laissant à son tour diriger par d'autres (ce qui en est pourtant le résultat). C'est la rançon du modernisme lorsqu'il est un peu conduit par des préoccupations de mode à l'excès. Mais l'honneur restera à M. Ravel d'avoir si bien senti son époque qu'il l'aura un moment exprimée de la façon la plus vivante, avec ses qualités et aussi ses défauts, premier venu après Debussy qui ait pu s'en détacher suffisamment et dire une fois de plus des mots nouveaux. Chose curieuse, cette tendance ultra moderniste s'allie chez lui à une certaine sentimentalité pour le passé, comme s'il imposait malgré tout des regrets... Le sentiment véritablement « moderne » est-il inscrit ici sous ces vêtements de la plus haute nouveauté ? C'est à l'avenir d'en juger d'après le document par ailleurs si expressif de notre temps que laissera plus et mieux que tout autre l'incontestable et merveilleux talent de M. Ravel.
***
Un des meilleurs élèves de G. Fauré, M. Florent Schmitt, né le 28 septembre 1870 à Blamont (Meurthe-et-Moselle), commença ses études musicales à Nancy. Venu à Paris, il entra, en 1889, dans la classe de M. Th. Dubois — remplacé l'année suivante par M. Lavignac — puis dans celle de Massenet, remplacé lui-même par M. G. Fauré, en 1896. Prix de Rome en 1900, il prépara à la Villa Médicis plusieurs envois importants, entre autres une étude symphonique d'après le Palais hanté, d'Edgar Poe et le Psaume XLVI, pour soli, chœurs, orgue et orchestre. Auteur d'œuvres nombreuses et intéressantes — notamment la Tragédie de Salomé, ballet créé, en 1907, au Théâtre des Arts et représenté depuis à l'Opéra — M. Schmitt a écrit aussi des pièces de piano, des mélodies, des chœurs, de la musique de chambre. Pour le piano : Soirs, dix préludes (1895) ; Musiques intimes, deux recueils (1897 et 1903) — à quatre mains : Musiques foraines (1901) ; Feuillets de voyage (1903) ; Reflets d'Allemagne, huit valses (1905), écho d'un séjour en Allemagne — et, plus récemment : Ombres, trois pièces (1918) ; Mirages (1922) ; Sur le nom de Gabriel Fauré (1922), ces dernières éditées chez Durand. En musique de chambre, M. Fl. Schmitt nous a donné deux œuvres considérables : un Quintette, piano et cordes (1905-1908, Mathot, éditeur), et une Sonate, piano et violon (1920, Durand).

fac-simile d'un autographe de Florent Schmitt
M. Schmitt, qui est maintenant directeur du Conservatoire de Lyon, a commencé par subir les influences de ses devanciers, celles de M. G. Fauré, de Franck, davantage celle de Cl. Debussy, mais surtout celle d'Em. Chabrier. D'un tempérament vigoureux, aimant les écritures d'un aspect de particulière complication, avide de toutes les nouveautés qu'il poursuit avec âpreté, il se modifie chaque jour dans le perpétuel désir de ne rien laisser échapper des effluves modernistes qui passent. Il semble convaincu que l'intérêt des moyens devient toujours plus fragile et plus rapidement désuet, que telle musique, dans la fleur de sa nouveauté aujourd'hui, perd ses attraits au bout de peu de mois. Ne serait-ce pas que la véritable musique — qui est éternelle — est bien au-dessus de ces contingences d'intérêt en effet médiocre et que l'art en réalité commence où elles finissent ?
Une habileté supérieure dans le maniement des moyens les plus récents, habileté qui se déploie à l'aise dans les développements de vastes proportions et les agencements orchestraux d'envergure, a souvent consacré le talent très divers, les recherches brillantes et fortes de M. Fl. Schmitt.
Laissant de côté les premières compositions pour piano, que l'auteur maintenant dédaigne, je m'en tiendrai à ses dernières publications : Ombres (op. 64), trois pièces : 1. J'entends dans le lointain... ; 2. Mauresque ; 3. Cette ombre, mon image. Presque constamment écrit sur trois portées (à part la seconde pièce qui semble un peu antérieure), ce recueil montre la plus extrême variété de traits, de dessins, de mélodies-chœurs entrelacés. La première porte en épigraphe : « J'entends dans le lointain des cris prolongés de la plus poignante douleur. » Et c'est, en effet, comme une lutte entre un déchirement passionné — qui donne lieu à toutes sortes de batteries et d'arpèges éminemment pianistiques, rarement simples, le plus souvent détaillés à l'extrême — entre ce premier thème rythmique et un second plus calme et modéré, féminin et chantant : l'être souffrant, l'être submergé par cette amère douleur. Le piano ainsi compris semble la réduction d'un orchestre compliqué et rutilant dont les divers éléments : cordes, bois, cors, cuivres, nous sont évoqués avec une surprenante maîtrise, cela dans les sonorités les plus audacieuses, les agrégations les plus hérissées de dissonances qui soient. On dirait que l'auteur veut accumuler dans son œuvre toutes les tendances, entre elles heurtées, gouffre insondable et attirant d'où s'échappent, en puissantes émanations, ses nostalgies, ses rêveries ou ses effrénées violences. L'art de M. Schmitt n'est pas un art sobre, il s'en faut et on ne peut s'empêcher de concevoir à sa suite et à la suite de M. Ravel — bien modéré à côté de lui — une réaction nécessaire vers la simplicité, le synthétisme, vers l'élaboration d'essences peu à peu et savamment réduites jusqu'à tenir dans quelques notes, élixir résumé et choisi. Mais on ne peut dénier à sa conception une grande intensité de passion, un effort d'outrance particulière qui constitue, plus que chacun des moyens qu'il emploie pris en soi, le meilleur et le plus réel de sa personnalité.
La troisième pièce : « Cette ombre, mon image, qui va et vient cherchant sa vie » (Walter Whitman), met en œuvre les mêmes procédés, dans le calme et la mélancolie : deux thèmes, l'un chantant et rêveur, l'autre rythmique, l'environnant d'abord de ses voiles, se développent assez longuement, parsemés de touches sonores qui font vibrer toutes les couleurs du clavier. Un milieu plus simple et ondoyant, influencé des musiques slaves, nous mène par un retour du premier mouvement à un élargissement du second thème qui s'impose dans la force pour s'estomper par la suite et se perdre peu à peu.
Art du piano directement issu de celui de Debussy, dont M. Schmitt a su tirer des conséquences lointaines, beaucoup plus nombreuses et dans la volonté au lieu de la volupté, la répétition des mêmes procédés : accords à six, sept et huit parties au-dessus de pédales à plusieurs parties également ; fins indécises, vibrations se perdant à l'extrême possible des mélanges sonores ; direction du développement moins sûrement menée, moins variée aussi que chez l'auteur de Pelléas — sont la conséquence d'une poursuite sans doute trop exclusive d'une outrance étonnante dans la complication. M. Schmitt, cependant, réussit à réaliser avec une clarté, une netteté parfaite, des compositions que bien peu seraient capables d'établir et nous conduit à travers ce dédale d'une main sûre et que rien ne fait faiblir, sachant donner à chaque plan sonore la place qui lui revient et, tout en guidant la mélodie, ouvrant autour d'elle tous les horizons, toutes les perspectives de lumière plus ou moins colorées, aiguës ou atténuées... Le parti qu'il sait tirer de ces deux mains dessinant sur le clavier tant d'aspects simultanés, rapides ou expressifs, aura amené la technique du piano à un degré de puissance et de complexité psychologique qu'il semble difficile de surpasser.
Bien d'autres pièces pourraient donner lieu à analyse : la Tragique chevauchée, op. 70 (1922), recherche de sonorités brutales qui attirent M. Schmitt et ne sont pas sans analogie avec celles de l'auteur du Sacre du Printemps, M. Stravinsky — M. Schmitt n'ayant d'ailleurs aucun autre rapport avec le musicien russe qui est lui, simple surtout, instinctif et sobre. — Sur le nom de Gabriel Fauré, pièce écrite en hommage au maître de l'auteur et où il introduit à nouveau ces amalgames violents et de sonorité difficilement discernable.
Le Quintette en si mineur (piano et cordes), exécuté en avril 1909 au Cercle Musical et, peu de jours après, à la Société Nationale, par M. M. Dumesnil et le quatuor F. Touche, avait consacré la réputation de M. Fl. Schmitt. Il est considéré avec raison comme une des tentatives récentes les plus importantes dans le genre qui nous occupe. Ses dimensions formidables, son abondante musicalité, pour laquelle il faudrait une analyse longue et minutieuse, nous montrent, après quelque franckisme, la véritable origine du talent de M. Fl. Schmitt qui est Em. Chabrier. L'auteur de Gwendoline avait amené lui-même, à l'orchestre, jusqu'à l'hypertension l'art de R. Wagner — le dirigeant toutefois vers l'impressionnisme. M. Schmitt, dont la violence de tempérament devait avoir tendance naturelle à s'apparenter avec Chabrier, a voulu porter jusque dans le genre intime de la musique de chambre cette exubérance, ce pittoresque, cette animation forcenée chers à Chabrier. Son talent considérable nous a donné par là une œuvre d'une chaleur intense et passionnée, dont il a depuis beaucoup répudié les procédés, mais qu'une vie ardente, un effort à beaucoup de points de vue atteignant une sorte d'étonnant record désignent comme devant rester, durer, prototype de l'idéal de toute une génération.
La Sonate piano et violon, par contre, fait usage de toutes les recherches récentes de M. Schmitt. Conservant un certain caractère rêveur, dont le développement mieux que tant d'efforts de surface musicale aurait pu, chez lui, atteindre à une expression de données plus générales — et, pour tout dire, émouvantes — conservant aussi son goût du pittoresque dérivé de Chabrier, qu'il exprime maintenant par des agrégations sonores de terrible brutalité qui semblent d'intérêt restreint, sans expansion — M. Schmitt a néanmoins donné dans cette œuvre une preuve nouvelle d'un talent qui reste de tout premier ordre, reflet d'un âme tourmentée, harcelée d'un désir puissant et jamais assouvi de renouvellement des formes.
***
M. Roger Ducasse, élève de M. G. Fauré, et plusieurs fois lauréat du Conservatoire, où il remporta, entre autres récompenses, le second grand prix de Rome, a composé un grand nombre d'œuvres diverses : Variations plaisantes sur un thème grave (harpe et orchestre) ; Au jardin de Marguerite (orchestre et chœurs) ; Nocturne de printemps ; Suite française (pour orchestre) ; Orphée, mimodrame en trois actes ; de la musique vocale et instrumentale. Il a écrit plusieurs œuvres remarquables pour piano : Petite Suite ; Six Préludes ; trois Barcarolles ; Chant de l'aube ; Esquisses ; des Etudes ; un Impromptu ; trois Arabesques ; Rythmes ; Sonorités — et, en musique de chambre : un Allegro appassionato (violon et piano) ; une Romance (violoncelle et piano) ; un Quatuor (piano et cordes) ; une Barcarolle, pour harpe ; un Quatuor à cordes (Durand, éditeur).

fac-simile d'un autographe de Roger Ducasse
Ce qui frappe dès l'abord chez M. Roger Ducasse,
c'est une extrême solidité musicale, nourrie par un commerce assidu avec les
maîtres — notamment J.-S. Bach — et établie dans un style coloré où les
recherches des heurts sonores sont poussées fort loin, plus dans la plénitude et
dans la rondeur que dans la finesse. Son inspiration mélodique a de la
nonchalance, qu'il tient de son maître et aussi de Debussy — mais sa volonté,
plus agissante que chez eux, dirige avec fermeté cette nonchalance à laquelle il
n'a pas naturelle tendance à se laisser aller Son art est éminemment sincère et
probe, sa conviction de la nécessité d'une grande habileté dans le maniement de
la forme, à la suite de M. G. Fauré et des classiques français — non de C.
Franck — s'inscrit dans ses œuvres, ainsi que des désirs, souvent manifestés,
d'expression tendre, dérivée de notre XVIIIe siècle, et particulière dans ce
temps dont il ne doit pas apprécier la sécheresse et l'amoralité.
Traditionnaliste, on pourrait dire à l'excès, un abandon plus grand à soi-même,
une plus juste appréciation de la valeur relative des agencements sonores
permettraient à sa nature, à tant de points de vue généreuse, de trouver une
expression définitivement personnelle, plus loin des procédés d'écriture
éprouvés — qu'il renouvelle d'ailleurs avec une grande souplesse, beaucoup
d'ingéniosité et de modernisme — dans la foi en l'instinct et son génie propre.
La grande culture de cet esprit distingué, qui sait apprécier la valeur du
charme et rester très pur musicien, sans se croire obligé à des apparences de
froideur et d'inhumanité, en fait un des meilleurs représentants de notre école
actuelle, continuant et honorant l'évolution française.
Ses pièces de piano, d'abord relativement simples, se sont par la suite
compliquées à l'extrême. L'écriture très classique et faisant habile emploi des
ressources de l'instrument, se poursuit généralement à quatre parties, mais
souvent aussi (comme dans Sonorités) à un plus grand nombre : cinq, six
et même davantage — dans un élargissement de l'étendue proche parent des
recherches de Debussy, mais ne visant pas, comme lui, à des effacements
impressionnistes, au contraire affirmant la solidité voulue de la structure
musicale. Cette dernière pièce et Arabesques... sont parmi les plus
intéressantes et marquent davantage les ressources personnelles de M. R. Ducasse
qui, sans atteindre à l'originalité et aux géniales trouvailles de l'auteur de
Pelléas, a su, plus que ce dernier, acquérir une science méthodique et
patiemment assouplie.
Son Quatuor, piano et cordes, en sol mineur, d'un style vigoureux, se développe longuement dans la première partie, les deux thèmes poursuivis à chaque instrument avec une extrême abondance et une grande variété. Un rythme (triolet suivi de deux croches) en impose avec beaucoup de force la conclusion. Le charmant scherzo, danse pleine d'élégante distinction sur laquelle se détache un chant de premier violon doucement expressif, son trio joliment rythmé, la grâce de sa conclusion — l'écriture si souple et si ferme à la fois de l'adagio qui atteint à une plénitude grandiose en son sommet et se termine, avec sourdines, dans la simplicité expressive — le final joyeux où nous retrouvons les thèmes des trois parties précédentes, celui du scherzo (marié au thème de l'adagio) ramenant le thème brillant du début et participant à la péroraison font de cette œuvre un monument — restant dans le pur style de la musique de chambre — où les qualités d'habileté et de souplesse de M. Roger Ducasse se sont donné carrière avec un rare bonheur.
***
De M. Louis Aubert, également élève de M. G. Fauré, auteur d'un assez grand nombre d'œuvres de piano — ainsi que de musique de chant, d'orchestre, de théâtre (la Forêt bleue, conte lyrique en trois actes, non encore représenté) — nous notons : Romance (op. 2) ; trois esquisses : Prélude, Nocturne, Valse (op. 7) ; Valse caprice (op. 10) ; Lutins (op. 11) ; deux pièces en forme de mazurka (op. 12) ; enfin Sillages, recueil de trois pièces : 1. Sur le rivage ; 2. Socorry ; 3. Dans la nuit. Prenant son point de départ dans une admiration toute instinctive et innée pour M. G. Fauré — qui s'inscrit très à découvert dans les Trois esquisses, œuvre de jeunesse, dont les moyens sont encore un peu sommaires et ne font pas prévoir l'efflorescence à laquelle parviendra par la suite le talent de M. L. Aubert — en aimant la musicalité ordonnée et pleine de charme, de hardiesse persuasive, porté tout naturellement vers un lyrisme à tendances passionnées, s'exprimant par des sonorités voluptueuses et distinguées, dans un enveloppement flottant de traits de piano (la Valse en esquisse, avec hésitation, l'avenir), M. Aubert commença à se dégager dans Lutins, pièce d'élégante facture et de jolie apparence pianistique. Dédié à son maître, L. Diémer, ce morceau montre l'auteur averti, par pratique personnelle, de toutes les ressources du clavier. De fait, en général, l'œuvre de M. Aubert s'attache tout spécialement à tirer parti de ces ressources et à écrire dans une technique uniquement propre à l'instrument. Les traits, les arpèges très musicalement ornés de notes de recherche, broderies, notes de passage, ne chôment presque jamais et la mélodie en s'épanouissant au-dessus de tous ces battements flottants, grâce à de savantes pédales, n'en semble que l'émanation naturelle, la synthèse. C'est du moins ce qu'on peut voir et apprécier dans la production beaucoup plus importante qui fait suite à ces premières pièces : Sillages, œuvre que l'auteur semble avoir longuement méditée et travaillée si l'on s'en rapporte à l'inscription : 1908-1912, qui la surmonte. Celle-ci montre la maturité à laquelle est définitivement parvenu le talent de M. Aubert — fait de la plus extrême souplesse, comportant abondance de détails savoureux et complexes, attirance vers un modernisme à la fois très libre et très ordonné. L'influence de M. G. Fauré reste grande — un peu tempérée par celle de Debussy — l'art en est bien français, raffiné — lyrique en même temps, avec des effets de sentiment d'envergure, visant souvent à la puissance, d'une rêverie poétique et aussi incisive et mordante — dualité qui pourrait donner lieu dans l'avenir à une personnalité plus marquée.
L'auteur attache visiblement un prix égal à l'intensité de son émotion, ce dont il faut le louer, et à l'attrait chatoyant, habilement ouvragé de ses moyens : rythmes, harmonies, vaporeuse polyphonie, et nous aura laissé dans Sillages une œuvre des plus remarquables et d'une très rare adresse.
***
Nombreux sont les élèves qui ont eu la joie de se former au très pur enseignement de M. G. Fauré, M. Ph. Gaubert, l'éminent chef d'orchestre de la Société des Concerts, dont la Sonate, pour flûte et piano, de délicieuse sonorité, restera comme le vivant souvenir de son incomparable virtuosité sur l'instrument que lui enseigna Taffanel — le maître disparu qu'il a depuis remplacé et égalé. — M. L. Vuillemin, à la fois compositeur et musicographe de haute valeur, qui a écrit plusieurs œuvres intéressantes pour le piano : En Kernéo (en Cornouailles) recueil de sept pièces — d'autres encore qui continuent parmi nous la tradition du maître français, M. Alb. Bertelin, M. G. Grovlez.

fac-simile d'un autographe de Gabriel Grovlez
De M. Paul Paray, grand prix de Rome, élève de M. Widor, distingué successeur de C. Chevillard â la tête de l'Association des Concerts Lamoureux, nous avons, comme de Chevillard lui-même d'importantes pièces de musique de chambre, entre autres un Quatuor à cordes (Jobert, éditeur).

fac-simile d'un autographe de Maurice Delage
A la suite de M. Ravel — les élèves de M. Fauré formant à leur tour des disciples — s'inscrivent M. M. Delage, auteur de pièces de piano, M. R. Manuel, auteur de Idylles, pour piano, d'un Trio à cordes, critique souple et averti, d'esprit ouvert à toute tentative nouvelle.

Roland Manuel (photo G.-L. Manuel frères)
Notons enfin les noms de Joseph Boulnois (Sonate violoncelle et Trio) ; de M. Rhené-Baton, le réputé chef des Concerts Pasdeloup ; de MM. F. Leborne, P. Dupin, Max d'Ollone, Jean Huré, A. Cellier, P. Le Flem, J . Pillois, Ingelbrecht, R. Doire, R. Siohan, altiste et compositeur — G. Migot, dont le Quintette piano et cordes obtint, en 1920, le prix Halphen (M. Senart, éditeur).

fac-simile d'un autographe de M. Rhené-Baton

fac-simile d'un autographe de M. Max d'Ollone

portrait de M. Jacques Pillois

fac-simile d'un autographe de M. D. Ingelbrecht

portrait de M. Robert Siohan
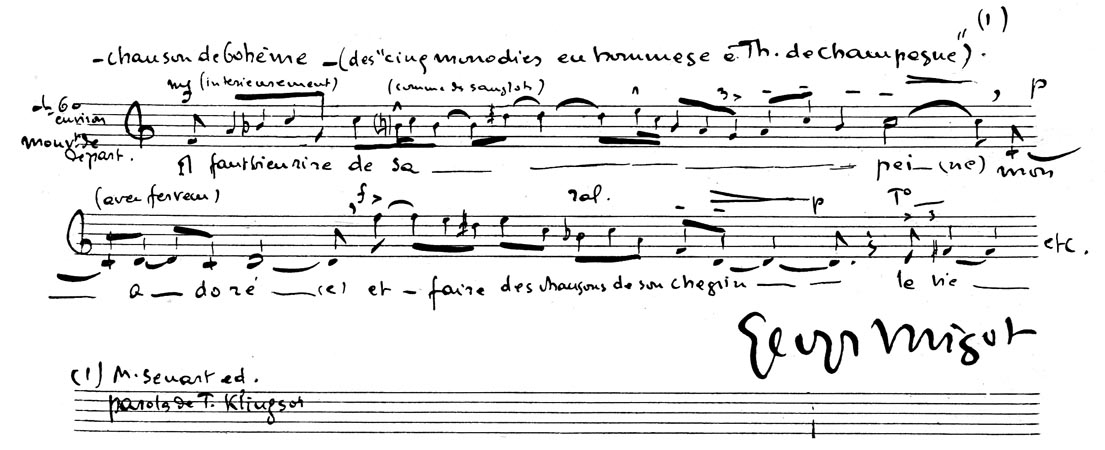
fac-simile d'un autographe de Georges Migot
L'auteur de ces lignes [Pierre Hermant], outre des œuvres pour orchestre (poèmes symphoniques : la Reine de Saba, Amphitrite, le Printemps ; Suite d'orchestre en ut dièse mineur, etc.), pour le théâtre (l'Archange, pièce lyrique en trois actes ; la Robe de plumes, Il Pulcinella in Francia, les Maories — ballets en un acte), pour chant (Sagesse, douze poèmes de Paul Verlaine ; Sept poèmes de Ch. Baudelaire ; Trois sonnets de Stéphane Mallarmé ; etc.), a composé pour le piano une Sonate en fa mineur, plusieurs fantaisies, des sonatines et des préludes — et, en musique de chambre, des sonates pour violoncelle, violon, flûte (et piano), un quatuor piano et cordes.

fac-simile d'un autographe de Pierre Hermant
Un musicien du plus grand talent, qui n'est pas sans avoir quelque parenté — quoique lointaine — avec M. G. Fauré : M. Ch. Kœchlin, esprit à la fois de finesse et d'extrême hardiesse, nous a donné, dans plusieurs Sonates (flûte, violon, violoncelle — M. Sénart, éditeur), dans des Sonatines pour piano — Mathot, éditeur — (M. Kœchlin est l'auteur de nombreuses productions de tout ordre), des œuvres d'un style coulant et lumineux où la préoccupation des tonalités, des rythmes et surtout du contrepoint ancien s'allie avec les tendances les plus nouvelles. De peu d'années plus jeune que Debussy, il avait été attiré, comme on le fut à son époque, vers les Primitifs, mais de façon tout autre. Ses recherches harmoniques, qui vont jusqu'à la polytonalité, répudient avant tout les brutalités et sont, au contraire, savoureuses et pleines de délicatesse. De musicalité charmante, d'habileté consommée, l'orientation de son style qui a tendance à s'éloigner du flou et de l'estompe vers la clarté et la netteté, dans un esprit avide de nouveauté de toutes sortes, le désigne comme un des précurseurs du mouvement récent.

fac-simile d'un autographe de Ch. Kœchlin
TENDANCES ACTUELLES. CONCLUSIONS — Il reste à parler des tendances actuelles, des recherches que les jeunes générations ont entreprises pour essayer à leur tour de renouveler l'intérêt de surface de notre musique. Bien des années ont passé maintenant depuis la tentative debussyste, l'apparition d'un art ondoyant et vaporeux, préférant plutôt suggérer qu'appuyer, subtiliser qu'affirmer avec éclat. Toutes les conséquences qu'en pouvaient tirer, avec des tempéraments divers, les musiciens issus de l'auteur de Pelléas, étant venues à jour, la lassitude de cette nouvelle poursuite devait fatalement amener à son tour une réaction. Cette réaction s'est-elle jusqu'ici produite normalement et a-t-elle donné lieu à un mouvement généreux, heureux, qui se soit exprimé par de belles œuvres expressives de leur temps, de façon à la fois similaire et différente des œuvres du passé ? Il ne semble pas, jusqu'à présent, que les résultats acquis, sinon à l'étranger, du moins en France, justifieraient une réponse affirmative à cet égard. A l'étranger, en effet, un musicien russe extraordinairement doué, M. Igor Stravinsky, a révélé, sous forme de ballets, une personnalité d'un modernisme nouveau, tout à fait à l'opposé des recherches de Debussy — tandis qu'en Allemagne, M. Arnold Schoenberg exagérait toutes les tendances de l'impressionnisme sans aucunement en avoir les qualités. Autant Debussy avait voulu un art sans affirmations voyantes, sans heurts, où tout était doucement enveloppé, autant M. Strawinsky a poursuivi les oppositions brutales, la dissonance pour elle-même, ardente et barbare, dans l'enivrement d'une richesse vivante qui est aussi, à tout prendre, une magnifique ironie, car lui seul a su, bien autrement que ses prédécesseurs — que Wagner — pousser jusqu'à leur limite dernière (il y en a une) les duretés sonores : introduites auparavant dans la trame musicale en en atténuant pour ainsi dire les angles de façon à ne pas déchirer le tissu, M. Stravinsky, lui, les a données pour ce qu'elles étaient, dans toute leur violence pure ; et on apercevra peut-être un jour — quoiqu'il soit difficile d'être prophète à cet égard — qu'en même temps il nous délivrait sans doute de leur hantise qui date de loin, qui date de Tristan. Combien d'autres possibilités en effet pourraient surgir du désir de renouvellement des formes musicales que cette éternelle question de la dissonance toujours plus âpre ? Le passé est là pour montrer qu'on n'a pas toujours suivi la même route dans la complication et la subtilité harmoniques. Après les raffinements de Rameau, Gluck semble avoir considéré qu'il y avait autre chose à chercher que raffiner encore... après tant d'harmonies chromatiques chez J.-S. Bach, l'école allemande de la fin du XVIIIe siècle a porté ailleurs ses pas... Il ne serait pas surprenant que les subdivisions poursuivies forcément par chaque génération, ne doivent aboutir, dans un avenir prochain, à des résultats fort éloignés de ce qu'imaginent les esprits au fond timides qui, entraînés par des courants de mode, s'égarent très inconsciemment sur les pas du dernier élu.
Sous l'influence très certainement — quoique plus ou moins directe — de M. Stravinsky, un mouvement s'est dessiné en France depuis quelques années, se proposant lui aussi des formes heurtées, à angles durs, et la poursuite d'harmonies ultra dissonantes. Mais bien loin de se développer dans la vie, dans la santé, dans un débordement de joies sonores qui entraînent, quoiqu'ils en aient, les tempéraments les plus latins, les plus éloignés de ces orientalismes truculents — le résultat obtenu par nos jeunes compositeurs est pauvre, froid, empreint d'une frappante et lugubre tristesse. Se référant à un musicien d'une autre génération qui avait autrefois intéressé Debussy et qu'il a pris, de façon assez inattendue, comme chef : M. Erik Satie, un groupement s'est formé et a, un peu trop manifestement, joué des coudes pour obtenir parmi nous la vogue et la renommée. Imitant — toujours — les « Cinq » russes, il s'est composé de six musiciens, qui sont loin d'ailleurs d'être indifférents et non sans talent, comme M. Darius Milhaud ou surtout M. Arthur Honegger, à qui nous devons — ainsi qu'à leurs amis — quelques œuvres de piano ou de musique de chambre (outre celles qu'ils ont composées pour orchestre).

fac-simile d'un autographe d'Erik Satie (propriété de la maison Rouart et Lerolle)
M. Erik Satie, dont la blague à froid — je dirai même : à la glace, qui veut boire ? pour rester dans le style — est un humoriste très pâle qui a eu une existence effacée jusqu'au jour où le snobisme a découvert dans ses productions des dessous que longtemps il avait laissés insoupçonnés. On ne peut nier cependant qu'il n'y ait quelque chose d'assez particulier dans la manière de cet auteur. Il a su tirer en tous cas un parti très pur de la pauvreté de ses moyens. Cela est pauvre et nu — mais du moins sincèrement et sans phrases. Cette pauvreté évidente et « exacte » ne laisse pas même d'être assez sympathique, chose curieuse. Et il y a, jusque dans les titres baroques employés : Airs à faire fuir, Danses de travers, Fugue à tâtons, une humilité, non feinte, qui vaut mieux que les prétentions et les masques de tant d'autres (à l'analyse doués en réalité d'aussi peu de richesse). Mais, tout de même, il ne faudrait pas attacher trop d'importance à une dégénérescence, qui s'avoue, mais dont le spectacle seul est déjà moralement malsain.
M. Darius Milhaud a écrit une Suite pour piano, deux Sonates pour violon et piano, plusieurs Quatuors à cordes, Saudades do Brazil, suite de danses en deux recueils (1922). Il y met en pratique les recherches de polytonalité et aboutit à des œuvres hâtives et trop faciles dont la dure sonorité — venue souvent avec brusquerie au milieu de passages bien plus ordinaires — est sans raisons expressives valables.

fac-simile d'un autographe d'Arthur Honegger
M. Arthur Honegger paraît être, et de beaucoup, le plus important du groupe des Six, destiné à s'en dégager dans l'avenir. D'un sentiment humain grave, à tendances intérieures (très dérivé de Moussorgski) son talent, fait d'habileté, d'équilibre et de clarté, le désigne comme un très bon musicien à la fois de nature et d'éducation. Il semblerait qu'avec ces qualités, à la fois humaines et de bonne musicalité, il devrait se laisser aller à de la sensibilité intime, à la pure joie d'imaginer des sonorités expressives et touchantes — aussi bien dans la nouveauté. Bien au contraire, l'éducation ayant pris chez lui le premier pas, il déduit seulement avec une rigueur logique et froide des agrégats sonores rares et inédits, réservant de plus en plus ses soins à faire uniquement se rencontrer des notes qui ne s'étaient pas jusque là — avec raison — superposées. On peut espérer cependant que sa personnalité, assurément digne d'intérêt par son sérieux et sa sincérité, saura se dégager d'entraves dont il comprendra sans doute un jour le caractère passager, le particularisme étroit. Nous avons de lui une Sonate piano et violon, une piano et violoncelle (M. Sénart, éditeur), un Quatuor à cordes, Sept pièces brèves, pour piano, etc... (éditions de la Sirène). M. Francis Poulenc, assez jeune encore et inexpérimenté, mais non sans talent, Mlle G. Tailleferre, M. Georges Auric, M. Louis Durey complètent le groupe des Six — qu'accompagnent bien d'autres jeunes gens, fort naïvement désireux de se tenir au courant des dernières nouveautés de la mode.
***
Que réservent les années qui viennent, quand le mauvais vent de la guerre aura passé ? Pour certains la vulgarité profonde, la sécheresse d'âme, l'amoralité, pour d'autres un accablement, une pesanteur, un navrement si compréhensibles et qui éveilleraient au contraire de la sympathie apitoyée, semblent, en effet, l'expression de l'inconsciente course à l'abîme qui a précédé la guerre européenne ou de l'effrayante dislocation qui en a été, depuis, la conséquence — période barbare dont il faut espérer que le souvenir peu à peu s'effacera pour faire place à de nouvelles formes d'art, l'art fruit de la paix... Mais qu'un trouble passager ne nous fasse pas oublier tout ce que les cinquante dernières années ont amené d'heureuses trouvailles de tout ordre dans une école exceptionnellement florissante et montrant des ardeurs toujours plus vivantes et plus dignes d'avenir. Pour sortir de ce mauvais pas il suffit de s'en référer aux idées qui n'ont cessé d'être, dans le passé, génératrices de générosités et de possibilités créatrices — écartant volontairement ou, du moins, mettant à leur vraie place, des préoccupations qui doivent être très secondaires par rapport au but que l'Art s'est de tous temps proposé. Que le décor musical doive être modifié de génération en génération, l'évolution est là pour montrer qu'il en a toujours été, qu'il en sera toujours ainsi. C'est un jeu, une fantaisie quasi hasardeuse, rendue nécessaire surtout par la faiblesse de notre nature, obligée au changement pour pouvoir vibrer à nouveau, et, grâce à cette vibration, entrer en communion avec les forces spirituelles qu'elle veut atteindre et embrasser. Mais rester fasciné devant ce décor, lui donner tous ses soins sans en réserver un seul pour la besogne principale qui est de trouve le trait d'union entre le monde extérieur auquel il reste attaché et le monde intérieur qu'il peut, par une idéale transparence, faire entrevoir, c'est faire un travail qui a moins d'utilité que tout autre travail matériel restant dans sa sphère et ses modestes nécessités sociales, c'est s'arrêter sur le pas de la Porte. Or l'intérêt est de la franchir et un unique moyen existe pour passer le seuil : l'appel à la sensibilité, à l'instinct qui peuvent seuls nous mettre en ineffable communion avec la synthèse des forces universelles. Pour cela il faut la foi humble — non celle qui, orgueilleusement, prétend garder pour elle seule l'explication des causes finales. Il faut aussi ne pas se laisser enchaîner par la préciosité, la volupté des sons, qui sont une attache, une entrave empêchant les derniers et éternels épanouissements. L'œuvre d'art n'a pas besoin d'être si ouvragée : un Moussorgski, pauvre par sa forme, resplendit intérieurement et restera quand tant de musiques passeront. Toutes ces recherches qui semblent, un court moment, si neuves, tous ces néologismes — dont leurs créateurs ne se doutent guère qu'il est bien plus facile d'inventer un mot nouveau que de rendre leur sens aux mots anciens devenus exsangues et sans vie, mais toujours capables d'expression pour ceux qui savent la saisir (« donner un sens plus pur aux mots de la tribu », a dit Mallarmé) — sont appelés à disparaître à peine éclos. Les auteurs, qui ont la terreur de ne pas être originaux, entassent les « découvertes » piquantes et n'écriraient pas deux enchaînements de suite sans les parer de quelque attrait, à leur sens inédit. Cependant, jusqu'à ce jour, aucun des maîtres véritables et reconnus comme tels par des générations, n'a agi de la sorte — laissant leur sensibilité se servir la plupart du temps de vieux moyens pour, de temps à autre seulement, mettre en valeur, bien en vue, telle trouvaille que, par passage, leur suggérait l'imagination. Ils leur lâchaient alors la bride par jeu, mais avec quelque dédain : réveiller la fibre nerveuse que l'usage a lassée ne saurait être le But... et ce but est plus loin, loin et haut derrière les notes — qui attrapent à leur piège les malins.
Pierre HERMANT.

le Groupe des Six [sauf Louis Durey] (à gauche, de bas en haut, Germaine Tailleferre, Darius Milhaud, Arthur Honegger ; en haut, de g. à dr., Jean Wiéner, la pianiste Marcelle Meyer, Francis Poulenc, Jean Cocteau ; assis à dr., Georges Auric).
D'après le tableau de Jacques-Emile Blanche (1923, musée de Rouen)