
Cinquante ans de musique française (1874 - 1925)

maquette du décor exécuté pour la représentation de Carmen aux arènes de Nîmes par M. Diosse
L'OPÉRA-COMIQUE
par Henri MALHERBE
Le centre dominant de toute l'activité musicale a été, depuis cinquante ans, à Paris. C'est en ce vaste enclos qu'il faut se trouver, si l'on veut juger, avec quelque certitude, des mouvements de l'art sonore. Trois générations de musiciens s'y disputent encore la couronne de sagesse. Les deux premières y ont des représentants illustres. Mais la dernière venue entre dans le monde au moment où l'univers est en proie à mille troubles. Elle est encore dans toute sa nouveauté. En caractérisant, comme il convient, ses aînées, nous nous approcherons de l'école actuelle. Nous pourrons en donner. dans sa rapidité, une esquisse libre et véridique.
Il nous est loisible de dégager, aujourd'hui, dans une lumière juste, les lignes et les perspectives du tableau musical du dernier demi-siècle français. Jamais notre science sonore ne fut plus inventive, plus raffinée et, dans le même temps, plus aimable. « On devrait admettre, écrivait Claude Debussy, que l'art est absolument inutile à la foule... C'est de la beauté en puissance qui éclate au moment où il le faut, avec une force fatale et secrète. » Le génie de la musique française du dernier demi-siècle trouve, seulement à présent, son moment de rayonnement.
Lorsqu'on dénombre les réalités amères de cette guerre, lorsqu'on voit les destructions inouïes de ces cinq années de lutte et de férocité, notre angoisse est si forte que le cœur s'arrête de battre et les regards n'ont plus de larmes.
La mélancolie et le désespoir des artistes sont nourris par ces mêmes destins tragiques. Les ruines proprement morales dépassent peut-être encore les dévastations matérielles.
Il n'y a pas que des églises détruites, des maisons éventrées, de vastes terres, jadis verdoyantes et fleuries, aujourd'hui ravagées, mornes et bouleversées. Dans l'âme humaine, aussi, s'est creusé un vide, de rares et magnifiques constructions se sont écroulées. Nos chefs les plus lucides se plaignent du désastre de la pensée. Les préoccupations spéculatives se font, chaque jour, plus rares. Et la guerre nous a ravi des millions de civilisés, formés par des siècles de labeur intellectuel, civilisés à qui des pères passionnés avaient transmis avec un tremblement de tout leur être des dépôts sacrés d'art et d'harmonie. Tant de grandes voix, annonciatrices de beauté, se sont tues, que nos artistes regardent, avec crainte, autour d'eux et hésitent à se produire devant un public neuf et qu'on dit brutal.
Mais quoi ? L'art n'a-t-il pas une existence pure, farouche, indestructible ? N'est-il pas doué d'une force étrangère à toutes les actualités, heureuses ou non, d'un continent ? Si de telles convictions ne nous soutiennent pas, toute activité généreuse de l'esprit s'éteint. Il n'est pas inutile, aux heures de découragement, de nous tourner vers un passé encore proche. Evocation démodée, dira-t-on. Tant pis ! Il faut nous rappeler qu'au lendemain de la guerre de 1870 nos aînés n'ont pas désespéré. C'est après une défaite que jaillit l'admirable musique française moderne. Mais aujourd'hui, après cette longue guerre, après cette victoire éclatante et têtue, que ne devons-nous pas attendre de nos compositeurs encore nonchalants ?
Il y a un demi-siècle, nos musiciens s'unissaient, dans une fraternité ardente et décidaient que la musique française, elle, n'était pas vaincue.
***
Nous sommes actuellement à un tournant de notre histoire lyrique. Sans doute, la science de la composition musicale n'est pas une science positive et dont les lois soient déterminées avec une rigueur intangible. Plusieurs systèmes sont également recommandables et, de chacun d'eux, peut jaillir une œuvre pleine d'élévation et de pureté. Tout musicien peut en raisonner à sa fantaisie. La fréquentation des maîtres et un secret sentiment de la musique conduisent toutes les idées sur ces matières. Les factions des cornificiens, des scolastiques et des nihilistes n'ont pas cessé d'exister, pourtant. Elles ressuscitent plus nombreuses, au bruit des disputes actuelles.
Afin de prendre un sentiment net de la musique nouvelle, il est indispensable d'établir le bilan des acquisitions précédentes. Cette constatation peut suffire à nous consoler quand on nous jette tant d'avis désespérés sur la production contemporaine. Au cours de délibérations exactes et libres, nous nous efforcerons à un reclassement de valeurs. Par un jugement plus solide de nos tendances, nous pourrons procéder à la délimitation de nos frontières esthétiques.
Le rôle joué par le Théâtre National de l'Opéra-Comique dans la musique française, ces dernières années, est proprement considérable. Avant de devenir romancier et philosophe social, M. Romain Rolland était l'un de nos meilleurs critiques musicaux. Dans son livre intitulé « Musiciens d'aujourd'hui », l'auteur de Jean-Christophe, s'exprimait ainsi sur le compte de la Salle Favart : « L'Opéra-Comique a su prendre une part active à l'évolution contemporaine de la musique... Il n'est guère d'œuvre importante, non seulement parmi les comédies musicales, mais parmi les drames musicaux de ces vingt dernières années, qui n'y ait été exécutée. Dans ce théâtre, qui vit en 1875 la première de Carmen, en 1884, celle de Manon et en 1888 celle du Roi d'Ys furent joués les principaux drames de M. Bruneau, Louise de M. G. Charpentier, Pelléas et Mélisande, de M. Claude Debussy, Ariane et Barbe-Bleue, de M. Paul Dukas (M. Romain Rolland pourrait ajouter à cette liste, aujourd'hui, Aphrodite, de Camille Erlanger, la Habanera, de M. Laparra, le Pays, de M. Guy Ropartz, la Lépreuse, de M. Sylvio Lazzari, Pénélope, de Gabriel Fauré, Mârouf, de M. Henri Rabaud, Bérénice d'Albéric Magnard et peut-être même, la Brebis égarée de M. Darius Milhaud)... Ainsi le théâtre de l'Opéra-Comique est devenu le foyer des tentatives les plus audacieuses du drame musical. »
Notre dessein est d'étudier, dans ses grandes lignes, l'activité si vigoureusement influente de l'Opéra-Comique, depuis cinquante ans. La première date qui arrête notre regard est celle de la création de Carmen : le 3 mars 1875.
La deuxième Salle Favart fut ouverte au public jusqu'au jour où elle fut incendiée, le 25 mai 1887. Du 15 octobre 1887 jusqu'au 30 juin 1898, l'Opéra-Comique s'installa dans la salle de l'ancien Théâtre-Lyrique, place du Châtelet. Du 30 juin au 6 septembre 1898 il donna ses spectacles au Théâtre du Château-d'Eau. Le 6 décembre 1898 eut enfin lieu l'inauguration de la salle actuelle de l'Opéra-Comique, place Boieldieu.
Plusieurs directeurs, plus ou moins heureux, ont présidé aux destinées de l'Opéra-Comique : du 20 juillet 1870 au 20 janvier 1874, Du Locle et De Leuven ; du 20 janvier 1874 au 5 mars 1876, Du Locle, seul ; du 5 mars au 14 août 1876, Emile Perrin, par intérim ; du 15 août 1876 au 25 mai 1887, Léon Carvalho ; du 26 mai au 31 décembre 1887, Jules Barbier, par intérim ; du 1er janvier 1888 au 1er janvier 1891, Paravey ; du 2 janvier 1891 au 31 décembre 1897, Léon Carvalho ; du 15 janvier 1898 au 31 décembre 1913, M. Albert Carré ; du 1er janvier 1914 au 15 octobre 1918, MM. Gheusi et Emile et Vincent Isola ; enfin du 16 octobre 1918 et encore actuellement, MM. Albert Carré, Emile et Vincent Isola.
Nous ne nous attarderons pas à étudier en détail chacune de ces directions. A la vérité, ce n'est que depuis une vingtaine d'années que la Salle Favart a pris son importance dans l'art lyrique moderne et monté des œuvres qui intéressent véritablement les esprits actuels. Du Locle avait fait des difficultés pour jouer Carmen. C'est par hasard que Paravey dont la gestion avait été malheureuse, garde dans l'histoire de la littérature lyrique l'honneur d'avoir monté le Roi d'Ys.
Aussi bien, il serait inutile de parler trop longuement ici des nombreux spectacles qui ont été représentés pendant ce demi-siècle à l'Opéra-Comique. Nous nous arrêterons surtout à quelques grandes dates, aux ouvrages importants qui demeurent encore aujourd’hui les ornements glorieux de notre seconde scène lyrique. Leur influence s'est étendue sur toute la musique contemporaine.
Carvalho avait fait ses plus importantes créations au Théâtre-Lyrique, avant que d'être directeur de la Salle Favart. Place Boieldieu, il a surtout repris certaines œuvres révélées avant la guerre de 1870. Il a laissé un souvenir de grand directeur de l'Opéra‑Comique, davantage par la troupe incomparable qu'il y avait constituée et qui comprenait : Mmes Miolan-Carvalho, Zina Dalti, Chapuy, Chevalier, Ducasse, Brunet-Lafleur, Bilbaut-Vauchelet, Engally, Isaac, Van Zandt, Heilbronn, Sanderson, Cécile Mezeray, Vergine, Salla, Emma Calvé. MM. Duchesne, Nicot, Ismaël, Cobalet, Bouhy, Morlet, Talazac, Taskin, Melchissédec, Barré, Lucien Fugère, Bouvet, Mouliérat.
Léon Carvalho avait, d'autre part, fait une véritable révolution en supprimant le parlé sur la scène de la Salle Favart. Le traité consenti par la Société des Auteurs à l'Opéra-Comique stipulait il y a encore trente ans qu'un ouvrage n'y pouvait être joué qu'avec dialogues et récits parlés.
***

Georges Bizet à 25 ans, par Giacomotti (appartient à M. de Choudens)
Pendant ce demi-siècle de musique française à l'Opéra-Comique, le compositeur qui occupe la première place est Georges Bizet. Il n'est pas inutile, avant que d'étudier son chef-d’œuvre Carmen, d'avoir quelques renseignements sur sa vie et ses autres ouvrages.
Georges Bizet est né à Paris le 25 octobre 1838. Entré au Conservatoire à l'âge de 13 ans, il suivit la classe de piano de Marmontel, celle d'orgue de Benoit et celle de contre-point de Zimmermann. Après avoir obtenu les premiers prix d'orgue, de piano et de fugue, il devint le plus brillant élève d'Halévy, pour la composition. En 1857, à l'âge de 19 ans, il remporta le grand premier prix de Rome. A la villa Médicis il composa un Te Deum pour orchestre et écrivit la musique d'une farce italienne, Don Procopio.
A son retour de Rome, après la mort de sa mère, il mène une vie misérable et laborieuse. Il est réduit, pour vivre, à donner des leçons, à écrire et transcrire pour le piano des œuvres italiennes, allemandes et françaises, que la maison Heugel publia sous ce titre : le Pianiste chanteur.
Mais il est connu, protégé. Carvalho, qui lui témoigna toujours le plus vif intérêt, lui commande, sur un livret de Michel Carré et Cormon, les Pêcheurs de Perles. Georges Bizet, qui avait déjà écrit un acte, la Guzla de l'Emir, sur un poème de Michel Carré et Jules Barbier s'empressa de terminer son opéra en trois actes et s'opposa à la représentation de sa première partition. Les Pêcheurs de Perles furent créés à l'Opéra-Comique le 28 septembre 1862. Bizet n'avait que vingt-quatre ans. Excellent juge de lui-même, presque trop pointilleux, il nous a dit quels passages devaient être appréciés dans cette œuvre.
Il n'en retient au premier acte que le duo de Nadir et de Zurga, la romance de Nadir : « Je crois entendre encor, caché sous les palmiers », au deuxième acte, le chœur chanté dans la coulisse et la cavatine de Leïla, et enfin, au troisième acte, l'air de Zurga. L'ouvrage n'eut que treize représentations.
Mais Bizet ne se décourage pas. Il compose Ivan le Terrible. Comme la Guzla de l'Emir, Ivan le Terrible ne fut jamais représenté.
Un an avant sa mort, Georges Bizet, inflexible, détruisit ces deux partitions ainsi que des fragments de Calendal, de Clarisse Harlowe et d'une Grisélidis que, le 26 février 1871, il considérait « très avancée ». Il jugeait ces ouvrages indignes de lui. Peut-être se montrait-il trop sévère pour ces productions qui, pour le moins, nous eussent donné de précieuses indications sur le développement de sa personnalité.

caricature de Bizet dans le Diogène à propos de la Jolie Fille de Perth
La Jolie Fille de Perth fut créée le 16 décembre 1867 au Théâtre-Lyrique. Après la première représentation, Georges Bizet écrit : « Mon ouvrage a obtenu un vrai et sérieux succès. Je n'espérais pas un accueil aussi enthousiaste et à la fois aussi sévère. On m'a tenu la dragée haute, on m'a pris au sérieux et j'ai eu la vive joie d'émouvoir, d'empoigner une salle qui n'était pas positivement bienveillante. J'avais fait un coup d'état : j'avais défendu au chef de claque d'applaudir. » Il devait bientôt revenir de son enthousiasme. « La presse est bonne, dit-il, quelques jours plus tard ; le public ne vient pas. » Cet insuccès ne le rebute pas, et c'est alors qu'il écrit, gardant un contrôle rigoureux de lui-même : « J'ai fait cette fois des concessions que je regrette, je l'avoue. L'école des flonflons, des roulades, du mensonge, est morte, bien morte ! Enterrons-la sans larmes, sans regrets, sans émotion... et en avant ! »
Et Georges Bizet se remet au travail. En 1867, trois concours avaient été ouverts dans chacun des théâtres lyriques subventionnés par l'Etat, afin de favoriser la musique française. Emile Perrin, directeur de l'Opéra, qui faisait partie du jury, voulant décider le jeune maître à prendre part à ce concours, lui écrivit : « Ne vous inquiétez pas du jury, qu'il soit en jambon de Mayence ou en pâtes d'Italie, j'en ferai ce que je voudrai. »
Il composa donc le premier acte de la Coupe du roi de Thulé sur le poème de Louis Gallet et d'Edouard Blau. Mais bientôt, il avoue : « J'ai revu mon premier acte de la Coupe à deux reprises différentes ; la première fois j'ai trouvé cela tout simplement admirable ; la seconde fois cela m'a paru définitivement infect. » Et le compositeur déchira ce nouveau manuscrit et ne concourut pas.

Georges Bizet
Il s'éloigna pendant quelque temps du théâtre, fit jouer aux Concerts Pasdeloup une symphonie qu'il intitulait Souvenirs de Rome et dont le titre modifié fut, par la suite, Roma. Le 3 juin 1869, il épousa Mlle Halévy, la fille de son maître. Mais la guerre éclatait, et Georges Bizet, violemment ému par nos désastres, s'engagea.
Cette guerre devait laisser des traces profondes dans l'âme du compositeur.

fac-similé d'un autographe de Bizet
La cristallisation s'est déjà opérée : toute la personnalité de Georges Bizet s'est condensée. Il sait où il va et ce qu'il veut. Il écrira des œuvres plus larges, plus enivrées, plus humaines. Son expression est devenue simple, vivante, dépouillée.
Après un acte, Djamileh, qui fut représenté pour la première fois le 22 mai 1872 et dont la grâce curieuse, la riche mélancolie, le coloris chatoyant furent tant admirés, Carvalho, qui venait de prendre la direction du Vaudeville et dont l'amitié ne se démentait pas, commanda à Bizet la musique de scène l'Arlésienne.
Après quoi, Georges Bizet composa l'œuvre rêvée, nationale et réaliste pour laquelle il était destiné : Carmen.
***

Madame Galli-Marié, créatrice du rôle de Carmen (photo Nadar)
Nous voici en présence, avec Carmen, d'un des chefs-d’œuvre les plus authentiques de la musique théâtrale.
Tandis que les librettistes s'efforçaient à une discrétion, dont les premiers spectateurs ne leur ont pas su gré, Bizet, par sa musique, nous restituait toute la rudesse déchirante du conte de Mérimée.
La clarté aveuglante et dure d'Espagne, la sensualité âpre, le goût du meurtre et du plaisir violent sont traduits là avec un art direct et pour ainsi dire magnétisant.
La partition a je ne sais quoi de physique, comme une palpitation artérielle, une chaleur animale. Certaines pages propagent les lourds et vulgaires parfums de là-bas, les senteurs fauves d'une peau basanée et les sueurs fumantes, le sang versé dans les halètements d'une dégradante lutte à mort, en plein soleil.

Mademoiselle Charlotte Wyns dans le rôle de Carmen
Georges Bizet, qui avait dépeint avec des nuances infinies la nostalgie pudique de Djamileh, ne craint pas de nous révéler, à vif, avec des inflexions vigoureuses et pressantes, la gitanella lascive, encanaillée, qui « s'avançait en se balançant sur les hanches comme une pouliche des haras de Cordoue ». Il n'est pas possible d'analyser ici, comme il convient cette étonnante partition de Carmen. Le duo du second acte suffirait seul à classer l'ouvrage. Il se développe avec un art magistral, inflexible. Les sonorités recueillies et reliées par le grand musicien en sont si profondes, si justes, si frémissantes qu'à de certains moments l'orchestre lance jusqu’à nous les fantômes fatidiques de Carmen et de José, qu'ils nous frôlent, que nous sentons sur nos nuques leurs souffles oppressés. Ecoutez les phrases enamourées, si simples, du paysan naïf et passionné. Quelques accords étranges, pauvres et languissants vous diront l'abdication, l'effondrement de José devant la bohémienne qui l'a fasciné par son chant sinueux, prometteur de liberté et d'aventures « là-bas, là-bas dans la montagne ».

Madame Calvé dans le rôle de Carmen (photo Nadar)
Mme Strauss-Bizet qui entretient, avec une pieuse fierté, le culte de l'auteur de Carmen, me disait récemment que ce duo, jugé trop « naturaliste » et trop long à la création, fut l'une des causes du demi-succès de l'ouvrage aux premières représentations. On poussa même le grand compositeur à l'écourter, à l'interrompre de points d'orgue propices à l'applaudissement facile. Bizet résista à ces basses objurgations. La scène nous est demeurée telle quelle, dans sa véridique et émouvante beauté.
Carmen fut créée le 3 mars 1875 sur la scène de l'Opéra-Comique. Un public nombreux mais glacial s'offensa de quelques scènes de ce drame, dont les accents de vérité surprirent des spectateurs amoureux des fadaises des opéras-comiques du temps. Pourtant, cette fois encore, Bizet avait fait « des concessions qu'il regrettait ». Dans les jeux violents de Carmen et de José, il avait jeté cette ingénue attendrissante et douçâtre : Micaëla. Malgré sa grâce romanesque, cette intruse chétive et affadie nous agace un peu, à présent. A la création, elle sauva la pièce d'un désastre. Ses apparitions rougissantes, séduisirent un auditoire prêt à se fâcher. Le reproche qu'on faisait surtout à la pièce était celui d'immoralité. Du Locle lui-même, directeur de l'Opéra-Comique, désapprouvait ces tons libres, cette vérité magnifiquement éployée. Un ministre lui ayant demandé une loge pour la première représentation, Du Locle lui répondit par une invitation personnelle pour la générale, voulant que le ministre jugeât d'abord par lui-même s'il était convenable qu'il y amenât sa famille.
Georges Bizet qu'on avait décoré le matin de la première représentation s'attira, dit-on, ce commentaire désobligeant : « On l'a décoré le matin parce que l'on savait qu'on ne pourrait plus le décorer le soir. »
On a fait à Galli-Marié un très vif grief de ne pas avoir joué Carmen dans la note naturaliste, d'en avoir fait trop une héroïne d'Opéra-Comique. Et cependant, à une représentation qu'elle donnait à Gênes, elle avait failli être tuée par Don José. Au dernier acte le ténor calcula mal son geste et la lame de sa navaja traversa la joue de Carmen. Galli-Marié s'enorgueillissait plus tard de cette blessure, dont la cicatrice ne disparut jamais.
Le sort incertain de la pièce, aux premières représentations, avait affecté profondément Bizet. Cet insuccès fut-il la cause de sa mort ? Des biographes nous ont décrit la nuit désespérée du grand musicien, après la répétition générale de Carmen. D'autres se sont inscrits en faux contre ces paroles. Et Mme Galli-Marié, la créatrice de l'ouvrage, piquée par tous ces propos, a déclaré avec fermeté au rédacteur d'un journal de province :
« L'insuccès de Carmen à la création, mais c'est une légende. Carmen n'est pas tombée au bout de quelques représentations comme beaucoup le croient. Nous l'avons jouée plus de quarante fois dans la saison, et quand ce pauvre Bizet est mort, le succès de son chef-d’œuvre semblait définitivement assis ».
Mme Bizet a bien voulu me dire elle-même qu'à cette époque le succès de Carmen ne lui semblait pas du tout « définitivement assis ». Et le grand musicien, assombri, tourmenté, mourut le 2 juillet 1875. Il souffrait d'un abcès à l'oreille. Aucun chirurgien ne se montra capable de l'opérer, et subitement, au grand désespoir de ses amis et de ses admirateurs qui commençaient à se faire nombreux, il disparut. C'était une perte irréparable pour la musique et l'art de notre pays. Elle émut jusqu'au philosophe allemand Frédéric Nietzsche qui, dans le Cas Wagner, écrivait : « J'entendis, hier, le chef-d’œuvre de Bizet. Je l'entendis jusqu'au bout avec la douceur du recueillement. Comme un ouvrage pareil vous élève ! On devient soi-même un chef-d’œuvre. » Et plus loin, se délivrant de l'influence de Wagner, il ajoutait : « Il faut « méditerraniser » la musique. »
Comme don José, Nietzsche appelait Carmen sa Carmen adorée et se lamentait sur la disparition d'un compositeur qui, s'il eût vécu, eût donné à ses œuvres les lignes pures et les ondulations heureuses des archipels latins.
Camille Saint-Saëns, lié d'amitié avec Bizet s'écria : « Ah ! qu'ils sont coupables ceux qui, par leur hostilité ou leur indifférence, nous ont privés de cinq ou six chefs-d’œuvre qui seraient maintenant la gloire de l'école française ! »

un souvenir de la 200e représentation de Carmen (30 janvier 1885)
fac-similé d'une page de la partition où sont réunies les signatures des auteurs du livret et des interprètes
***
M. Stravinsky, le compositeur violent, acide et méprisant du Sacre du Printemps a, au nom de la musique avancée, rendu un hommage particulier à l'auteur de Carmen. Considérant la musique française, il n'a pas craint d'affirmer : « II y a Bizet, Chabrier, Satie. » Cette opinion originale et qui n'a qu'une valeur de boutade, nous indique cependant suffisamment dans quel respect nos jeunes musiciens, si dédaigneux de leurs prédécesseurs, tiennent l'auteur de l'Arlésienne.
Et si l'on recherche les motifs profonds de cette ferveur, peut-être les trouverons-nous dans les façons franches, directes de son exécution, dans les lignes longues, grossies à dessein, harmonieusement balancées de sa mélodie, dans les couleurs raffinées et violentes, largement étalées de son orchestration.
Bizet, qui marque les débuts du réalisme au théâtre, est, avant tout, un musicien français, le musicien français.
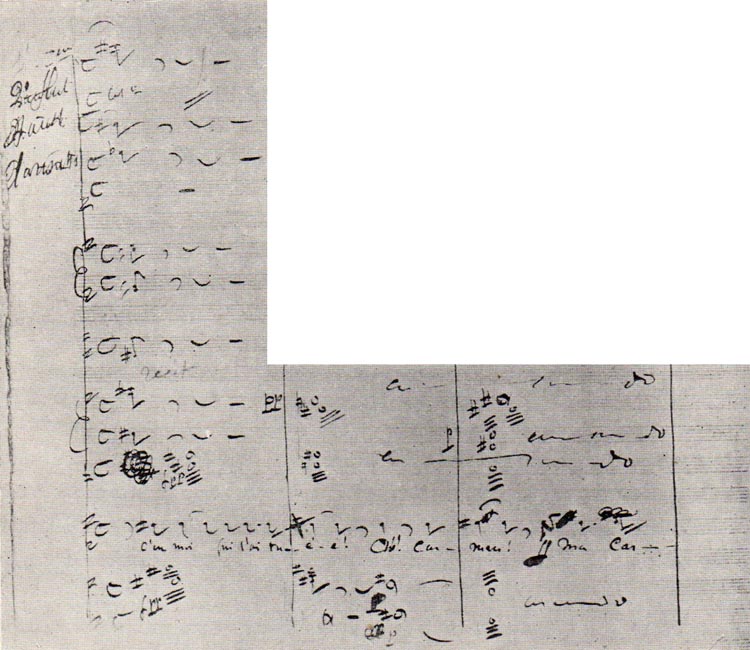
fac-similé de la dernière page de la partition de Carmen
« La musique française, a écrit Debussy, c'est le plaisir. » Et l'aîné de l'auteur de Pelléas a, en effet, chanté le plaisir, la joie merveilleuse, la beauté enivrante de vivre. Sa musique est le cri même de sa vie, le reflet de son âme. Dans ses dernières partitions, il œuvre dans une matière impérissable avec une impétuosité, une verve et une lucidité magnifiques. Les caractères de ses personnages sont posés avec une précision cursive et presque cruelle sur des décors éblouissants de netteté. Rappelez-vous ce thème court et étrange, caressant et râlant, qui nous décrit Carmen. Miroir inséparable qu'élèvent à chaque instant, les instrumentistes et où se reflètent toutes les variations des passions de la bohémienne.
Pénétré des théories modernes de Berlioz, familier des classiques, Bizet orchestre avec un sens de chaque instrument, un art de la nuance, une sûreté de main, un raffinement psychologique dans les développements d'un thème musical qui le classent au tout premier rang des maîtres de la musique.
« Je ne fais pas grand cas, disait Bizet à son professeur Marmontel, de cette popularité à laquelle on sacrifie aujourd'hui honneur, génie et fortune ».
Si elle était, en effet, sa pensée intime, et si réellement il avait conscience de son génie, peut-être ne dut-il point trop souffrir de l'indifférence de ses contemporains. Et pourtant, à présent, je me demande avec angoisse si sur son lit de mort, le grand musicien ne dut pas éprouver en déroulant sa carrière passionnée, si vite brisée, une impression de désolation et de désastre ? A quoi lui servait ce génie douloureux et puissant ? Pourquoi s'être épuisé en veilles laborieuses ? Ah ! dites, pouvait-il croire, en cet équipage de débâcle qu'on lui rendait enfin justice et que son nom s'inscrirait pour toujours dans la mémoire des hommes ?

décor pour le 2e acte de Carmen : le cabaret de Lillas Pastia
Le public ni les critiques, à la première représentation de Carmen n'avaient pu comprendre la valeur et la force du chef-d’œuvre de Georges Bizet. Parmi les articles qui lui étaient consacrés je détache ces quelques lignes d'un des plus importants critiques de l'époque.
« Où est-il l'âge d'or des Zampa, des Fra Diavolo, des Marco Tempesta, ces farouches bandits dont la carabine innocente n'a jamais brûlé de poudre, même contre les moineaux ? Aujourd'hui les brigands de l'Opéra-Comique sont des assassins pour tout de bon. Il est vrai que le sang qu'ils versent ne mérite guère de pitié. La Carmen, l'héroïne du poème de MM. Meilhac et Halévy (deux auteurs souvent mieux inspirés) n'est qu'une hideuse drôlesse qui, pour être empruntée au roman de Prosper Mérimée n'en fait pas moins mauvaise figure sur une scène habituée à plus de respect pour la morale et la pudeur. Que pensez-vous, chastes mères de famille, bons bourgeois qui comptez, sur la foi du passé, régaler vos femmes et vos filles d'une petite soirée anodine et décente, que pensez-vous, dis-je, d'une ignoble gueuse offrant, d'un regard provocant, son amour à quiconque a le don de lui plaire, — et Dieu sait si le nombre est grand de ces mortels favorisés ! — convolant d'un muletier à un dragon, d'un dragon à un toréador, et brusquement arrêtée dans l'essor de ses galanteries volcaniques par le stylet d'un amant répudié ? Le rôle infect, on peut le dire, de cette Célimène de trottoir est joué par Madame Galli-Marié avec un réalisme d'allures et de physionomie peu propre à faire pardonner à l'artiste les défaillances de son chant.
La musique, affreusement touffue, est telle qu'il la fallait attendre de M. Georges Bizet, dont la science incontestée fait bon marché de la mélodie. »
Et le critique en question terminait son article par cette phrase décourageante à l'adresse de tous les candidats pressés, — déjà ! — de prendre la direction de l'Opéra‑Comique : « Aspirer à la direction de l'Opéra-Comique dans l'état lamentable où l'a réduit une administration frappée d'idiotisme, sans répertoire, sans public, sans artistes, sauf une étoile de passage, quel est l'homme, je ne dis pas d'esprit, mais de sens, capable de prendre la main dans des conditions semblables ? » Après Carmen, l'Opéra-Comique monta l'Amour africain, trois actes tirés du Théâtre de Clara Gazul, musique de Paladilhe, qu'on joua six fois. Le Don Mucarade d'Ernest Boulanger eut un destin moins malheureux : on le donna douze fois. Le public se détachait peu à peu de l'Opéra-Comique, malgré la création récente de Carmen. Camille du Locle, gendre de Perrin et ancien secrétaire général de la salle Favart ne semblait point favorisé. Ses recettes étaient médiocres et diminuaient chaque année ainsi qu'on en pourra juger d'après le tableau suivant : en 1873 l'Opéra-Comique réalisait un chiffre global de recettes de 1.267.463 francs ; en 1874 : 1.053.238 ; en 1875 : 947.265 ; en 1876 : 912.774.
Du Locle fut contraint de quitter la direction de l'Opéra-Comique, laissant un déficit de 100.000 francs. Son beau-père Emile Perrin se vit obligé de reprendre cette direction, tout en veillant aux destinées de la Comédie-Française dont il était administrateur général.
Le 15 août 1876 Léon Carvalho était appelé à gouverner la Salle Favart. Aussitôt, les recettes remontaient : cette année 1876 produisait 931.302 frs. Au cours de la première année de son règne, Carvalho faisait débuter vingt-sept chanteurs dont six seulement restaient définitivement attachés à la troupe de l'Opéra-Comique.
Mais c'est de 1881 à 1884 que l'Opéra-Comique connaît, trouve sa plus grande ère de prospérité. Les Contes d'Hoffmann dont il sera question plus loin furent joués dans la seule année de 1881, cent fois. L'ouvrage d'Offenbach, dont les deux délicieux airs, « Elle a fui la tourterelle » et « C'est une chanson d'amour » avaient conquis tout le public, fut représenté douze fois en 1882, en tout cent trente et une fois jusqu'en 1886. Repris en 1911, les Contes d'Hoffmann ont été donnés sur la scène de d'Opéra-Comique près de 400 fois.
C'est pendant cette période que furent inaugurées les soirées populaires du lundi dont les tarifs s'échelonnaient de 0 fr. 50 à 3 francs. Le cahier des charges les imposait aux directeurs de la Salle Favart. Mais on ne pouvait faire que deux mille francs de recette, alors que les frais étaient de 4.500 francs. Toutefois, dès 1880, la recette annuelle de l'Opéra-Comique atteignait près d'un million et demi.
En 1881, notons les débuts de M. Georges Hüe, premier grand prix de Rome de 1879, avec les Pantins, deux actes qui avaient obtenu le prix Cressent. M. Georges Hüe devait faire représenter plus tard, sur la même scène Titania, l'une des œuvres théâtrales dont le côté symphonique a été le plus admiré et Dans l'ombre de la Cathédrale, sur un livret de M. Maurice Léna et Mme Henry Ferrare, d'après Blasco Ibanez.
En 1882, M. Vincent d'Indy fait jouer sa première œuvre : Attendez-moi sous l'orme, agréable pastiche dont le livret était une adaptation de Regnard. Cette pièce obtint dix-neuf représentations. Signalons encore la Galante Aventure d'Ernest Guiraud dont le libretto parut déraisonnable et la Nuit de Saint-Jean de Lacôme. Ce dernier opéra-comique, d'une verve et d'un entrain fort plaisants fut joué vingt-six fois. Repris en 1889, il fut donné encore quarante-huit fois. Le dernier ouvrage inédit de cette année fut une divertissante comédie musicale d'Amédée Dutacq : Battez Philidor ! qui fut jouée dix fois. Les recettes de 1882 se montèrent à 1.839.523 francs.
L'année 1883 ne voit éclore qu'un éphémère Mathias Corvin du compositeur hongrois de Bertha qui ne fut affiché que trois fois.

Mademoiselle Van Zandt (photo Nadar)
En 1884, Manon, de Massenet, dont nous parlerons plus longuement, est créée. Puis le délicieux Joli Gilles de Ferdinand Poise, dont Carvalho s'était refusé à mettre en scène une Carmosine reçue et déjà gravée par de confiants éditeurs. C'est le 8 novembre qu'eut lieu le fameux incident Van Zandt. On se rappelle que cette chanteuse légère, fort appréciée du public, jouait ce soir-là le rôle de Rosine dans le Barbier de Séville. Dès le premier acte, elle ne parut pas à son aise... Après quelques excentricités, les spectateurs se fâchèrent. Lucien Fugère vint devant la rampe excuser sa camarade. La représentation fut interrompue. Mlle Cécile Mezeray remplaça, en costume de ville, au pied levé la cantatrice défaillante. Mlle Van Zandt devait revenir l'année suivante à la Salle Favart. Les quatre soirées auxquelles elle prit part furent orageuses. Le public n'avait pas oublié ses incartades. Il ne les lui pardonnait pas. Carvalho fut obligé de résilier l'engagement de la créatrice de Lakmé.
Le Chevalier Jean de Victorin Joncières fut chanté par Mme Emma Calvé en 1885. Cet ouvrage devait être repris deux ans plus tard. La répétition des couturières eut lieu l'après-midi même du jour que l'Opéra-Comique fut incendié. Le Chevalier Jean ne fut jamais redonné. Pendant cette année, nous voyons encore trois actes assez faibles de Victor Massé, Une nuit de Cléopâtre. L'année de 1886 est plus fertile en créations : citons le Mari d'un jour, d'Arthur Coquart ; trois actes aristophanesques de Charles Lecocq, un Plutus, dont la destinée a été plus obscure que celle de la Fille de Madame Angot et Maître Ambros.

les ruines de l'Opéra-Comique au lendemain de l'incendie (photo Nadar)
Le Roi malgré lui, dont je parlerai plus longuement fut joué en 1887. Le libretto avait été tiré par Emile de Najac, Paul Burani et M. Jean Richepin d'un vaudeville en deux actes qui avait été représenté au Palais-Royal en 1836. La carrière de cet opéra-comique fut arrêtée au bout de quatre représentations par l'incendie qui détruisit le 25 mai 1887 la Salle Favart. Il n'est pas inutile de rappeler en détail aujourd’hui les circonstances du désastre. Le spectacle était composé du Chalet et de Mignon. L'acte d'Adolphe Adam venait de prendre fin. Il était neuf heures cinq du soir. Tandis que Mme Simonnet chantait au premier acte de Mignon : « O Vierge mon seul espoir » quelques flammèches tombèrent sur la scène. Une herse à gaz avait communiqué le feu aux fils entrelacés d'une frise. Taskin vint à l'avant-scène encourager le public à garder le calme. Quelques spectateurs quittèrent la salle, nullement effrayés. Malheureusement le rideau de fer ne fut pas abaissé. Le feu gagna bientôt les décors pendus aux cintres. Les pompiers de service, affolés, au lieu de noyer d'eau le brasier, coururent inutilement çà et là. Le concierge craignant l'explosion du gaz, éteignit toutes les lumières. Un désordre affreux se produisit. La porte de secours de la rue Marivaux était fermée à clef. Les spectateurs du rez-de-chaussée et du premier étage évacuèrent la salle assez rapidement. Mais la foule des autres étages s'engouffra dans un seul escalier. Elle négligea de prendre quatre autres escaliers. Le feu avait gagné la salle et les coulisses du théâtre. Les artistes encore maquillés et dans leurs costumes de scène purent quitter leurs loges. L'incendie qui devait être simulé au troisième acte de Mignon, éclatait brusquement, dans une réalité angoissante.
On découvrit dans les décombres soixante-seize corps calcinés. Le préfet de police publia que quatre-vingt-quatre personnes avaient trouvé la mort. Le chiffre exact des victimes est resté inconnu. Dans la salle du buffet du deuxième étage, seulement, on enleva vingt-sept cadavres. Dans le personnel du théâtre, on compta comme morts : quatre danseuses, deux choristes, quatre habilleuses, cinq ouvreuses.
Après un procès retentissant, le directeur de l'Opéra-Comique, Léon Carvalho, fut condamné à trois mois de prison, deux cents francs d'amende et cinquante mille francs de dommages et intérêts. Le pompier André se vit, de son côté, infliger un mois de prison. Carvalho fit appel du jugement. Il en résulta un acquittement général.
Treize jours avant le sinistre, un député avait interpellé assez longuement en pleine Chambre sur les dangers d'incendie à la Salle Favart. Les parlementaires prirent la chose en riant. Le ministre de l'Instruction publique ne craignit pas, dans sa réponse, de dire qu'un théâtre comme l'Opéra-Comique était fatalement voué au feu et que toutes les mesures qu'on prendrait pour l'éviter ne serviraient de rien. Le député qui suivit à la tribune l'interpellateur s'écria : « Après cet intermède plaisant, parlons de choses sérieuses ». Et une furieuse discussion politique fut engagée. On avait complètement oublié les tragiques préavis qui, quelques jours plus tard ne devaient être que trop confirmés.

les ruines de l'Opéra-Comique au lendemain de l'incendie (photo Nadar)
***
Après Carmen, l'ouvrage qui retient notre attention, est le Roi d'Ys, d'Edouard Lalo.
Edouard-Victor-Antoine Lalo est né le 27 janvier 1823 à Lille. Il descendait d'une famille espagnole qui s'était établie dans les Flandres, au XVIe siècle. Ses ancêtres, amoureux de rythmes langoureux et de splendeurs orientales, devaient revivre en lui.
Son père, officier napoléonien, avait fait la campagne de Russie en 1812 et en était revenu. Sur le champ de bataille de Lutzen, l'Empereur avait tenu à le décorer lui-même. Il destinait son fils à la carrière des armes, mais sans contrarier les dispositions pour la musique, que l'enfant manifestait déjà.
Le jeune Edouard Lalo entre au Conservatoire de Lille dans la classe de solfège de Leplus, où il obtient un premier prix en 1835. Elève de Muller on lui décerne le premier prix de violon en 1838. Dans le même temps, il prend des leçons de composition musicale avec Pierre Baumann, violoncelliste qui avait fait partie, à Vienne, de l'orchestre qui, pendant dix ans, donna les premières auditions des symphonies de Beethoven.
Après une violente discussion avec son père qui voulait l'obliger au métier des armes, Edouard Lalo, à l'âge de 16 ans, part de Lille et vient habiter Paris, qu'il ne devait plus quitter. C'est là que, dans la misère, il fait l'apprentissage de la douleur. Il a rompu avec ses parents, avec lesquels il ne devait se réconcilier que vingt ans plus tard. Seul, dans une détresse affreuse, hanté de musique, il entre dans la classe d'Habeneck au Conservatoire. Il étudie la composition avec Julien Schulhoff. Crèvecœur, à qui l'Institut venait de décerner un grand prix de Rome, lui donnait, d'autre part, quelques leçons.
Edouard Lalo ne reste que six mois au Conservatoire. L'enseignement meyerbeerien de cette école officielle contrarie ses idées. En 1845, il donne son Trio qui est peut-être la première production musicale de ce genre en France et qui marque une date dans la musique de chambre de notre pays.
Déjà, toute sa personnalité se dévoile. Son tempérament rythmique, ennemi de toutes les œuvres d'alors, s'y donne libre cours.
En 1855 il connaît Armingaud et, avec Jacquard et Mas, constitue un quatuor qui devenait célèbre. Lalo y tenait la partie d'alto. Plus tard, ils s'adjoindront des instruments à vent, et formeront la Société Classique où l'on entendit des exécutions particulièrement brillantes des maîtres du passé.
C'est alors qu'il se lie avec Delacroix. Ce grand peintre, qui aimait la musique, devait laisser une empreinte ineffaçable sur l'esprit du compositeur. Lalo habitait alors rue Duphot. Tous les vendredis y avaient lieu des auditions musicales. Pâle, amer et passionné, planait-là, comme un oiseau blafard et magnifique, le masque tourmenté du maître de la Barque de Dante.
Dans la musique d'Edouard Lalo vous retrouverez ce coloris riche et profond, cette lourde matière impérissable, ce large sens du décor et toutes ces nostalgies d'aristocrate désabusé qu'on admire sur les toiles fulgurantes du grand peintre romantique. Eugène Delacroix et Edouard Lalo entretinrent un long commerce d'amitié. C'est un malheur pour les artistes que les lettres pleines de feu qu'ils échangèrent se soient perdues et que les lithographies et les eaux-fortes que le peintre dédia au compositeur soient disparues.

Edouard Lalo (d'après la Revue Musicale)
En 1865, Lalo, qui donnait des leçons d'harmonie, s'éprend de son élève préférée Mlle Julie-Marie-Victoire Bernier de Maligny, qu'il épouse le 5 juillet. La jeune femme était d'origine bretonne. Et, toute respirante des odeurs marines du goémon et de l'algue, voici Margared et Rozenn, en un seul être que le destin envoie. Amour si perspicace et si ample que tous les mystères de l'âme armoricaine de sa compagne sont révélés au musicien et que déjà éclatent, à ses oreilles, les musiques altières du Roi d'Ys.
Ce mariage provoque de nouvelles ambitions. En 1867 a lieu un concours de musique dramatique dont l'heureux élu devait être joué sur une grande scène lyrique. Edouard Lalo compose sa première partition théâtrale : Fiesque, sur un livret que Charles Beauquier avait tiré du drame de Schiller. Naturellement, Fiesque n'obtient pas les suffrages du jury officiel. L'œuvre de Lalo est classée troisième, après deux petits ouvrages, pour jamais obscurs, le Magnifique, de Philippot, et la Coupe et les Lèvres, de Canoby.
Cette injustice flagrante émeut Perrin qui était alors directeur de l'Opéra. Il reçoit l'ouvrage, mais demande des coupures et des remaniements. Les deux auteurs se soumettent à toutes ces exigences. Mais Fiesque n'entre toujours pas en répétition. Lalo, impatienté, blessé dans son amour-propre, retire purement et simplement son œuvre. Il la porte à Vachot, directeur de la Monnaie de Bruxelles. Enfin, là, la pièce est distribuée, répétée. Mais Vachot fait faillite. Et Fiesque ne fut jamais représenté intégralement.
Lalo devait garder, toute sa vie, présent à la mémoire, cet échec. La plaie ne devait plus se fermer. Dans tous les ouvrages qu'il écrira plus tard, il reprendra comme par ressentiment, des motifs de Fiesque.
Lorsqu'on considère le morne état de la scène lyrique française en 1860, on s'aperçoit que Fiesque est une partition d'une originalité audacieuse et enchantée malgré sa mouvance classique. D'autres beautés pathétiques peuvent toucher l'auditeur. On en retiendra, pour le moins, l'admirable monologue de Fiesque et la magnifique scène du dernier acte où Verrina supplie Fiesque de renoncer au dogarat, dans une progression superbe, sur un rythme de marche funèbre. Espérons qu'il se trouvera un jour un directeur avisé et repentant pour monter, dans sa rayonnante vision originale, cet ouvrage dont s'enorgueillit la musique française.
Ce n'est que quatre ans après la guerre de 1870 (qui fit tant de deuils dans la famille de Lalo et suscita en son cœur de si profondes douleurs) que le musicien donne une œuvre nouvelle au concert. Il délaisse le théâtre dont il méprise les aménités brillantes, faciles et vides et fait jouer son Concerto pour violon, puis la Symphonie Espagnole qui le classent, définitivement, au premier rang de nos compositeurs. Mais le grand public l'ignore toujours.
C'est alors qu'Édouard Blau lui conte le sujet du Roi d'Ys, qu'il tient de M. de la Morandière. Edouard Lalo se met au travail et la partition est achevée en 1880. Carvalho en prend connaissance et la refuse. Vizentini et Escudier la refusent également. Mais Vaucorbeil, commissaire du Gouvernement, fait un rapport enthousiaste sur l'œuvre et supplie Halanzier, directeur de l'Opéra, de la monter. « Alors que l'Académie Nationale de Musique, écrit Vaucorbeil, manifeste l'intention saugrenue de créer Aïda, la France se déshonore en ne jouant pas le Roi d'Ys ! » Halanzier est insensible à ces objurgations.
Mais voici que Vaucorbeil, le fougueux admirateur de Lalo, voici que Vaucorbeil lui-même succède à Halanzier. Joie pour le musicien. Joie de courte durée. Vaucorbeil refuse le Roi d'Ys et monte Aïda.
***
« Une des légendes les plus répandues en Bretagne écrit Ernest Renan, est celle d'une prétendue ville d'Ys qui, à une époque inconnue, aurait été engloutie par la mer. On montre à divers endroits de la côte l'emplacement de cette cité fabuleuse et les pêcheurs vous en font d'étranges récits. Les jours de tempête, assurent-ils, on voit dans le creux des vagues, le sommet des flèches de ses églises ; les jours de calme, on entend monter de l'abîme le son des cloches modulant l'hymne du jour. Il me semble souvent que j'ai au fond du cœur une ville d'Ys qui sonne encore des cloches obstinées ou convoque aux offices sacrés des fidèles qui n'entendent plus. »
Ce sont ces mêmes tintements nostalgiques que Lalo dut percevoir dans les battements de son cœur lorsqu'il composa la partition du Roi d'Ys. A l'entrée de son œuvre, il équilibra une Ouverture impressionnante comme un pœcile, primitive et lourde de souvenirs comme un dolmen. Dans le majestueux portique, le musicien apparaît entouré de ses instrumentistes, pour esquisser le drame musical qu'il va développer au cours du spectacle. « Voilà ce que je vais vous raconter », s'écrie-t-il d'une voix inflexible.
C'est l'orchestre des Concerts Pasdeloup qui, le 14 novembre 1876, exécuta en première audition, l'ouverture du Roi d'Ys. Lalo devait ensuite la modifier. Le chant du violoncelle et l'allegro des cuivres subsistèrent seuls dans la version définitive.
Le 29 avril 1876, le baryton Manoury chante à la Société Nationale un air du Roi d'Ys intitulé, pour la circonstance, « Veille de Combat ». Et, en 1880, Mme Edouard Lalo, qui possédait une fort belle voix de contralto, et Mme Fuchs y interprétaient le duo de Margared et de Rozenn.

décor pour le 3e acte du Roi d'Ys
L'ouverture du Roi d'Ys est naturellement composée des motifs de la partition. Le retour de Mylio est interprété par la clarinette dans l'andante à trois-quatre.
L'allegro et l'allegro appassionato peignent le désespoir de la farouche Margared. Le chant du violoncelle à six-quatre nous dit la chaste mélancolie et la douceur rêveuse de Rozenn. Enfin, un retour magistral de l'allegro nous restitue le chant de guerre de Mylio.
Le Roi d'Ys ne put être joué que le 7 mai 1888. Il fallut un directeur novice de l'Opéra-Comique M. Paravey, pour créer l'ouvrage. C'était la première pièce qu'on montait dans un nouveau théâtre sous une nouvelle direction. On avait lancé partout des invitations. Mais on avait oublié de numéroter les places ! Près de 3.500 personnes se pressaient dans une salle surchauffée qui pouvait à peine contenir 2.000 spectateurs. Personne n'avait confiance dans la réussite de la pièce. Les invités, qui ne savaient où se placer, étaient furieux. Le succès au premier acte fut douteux. Mais, dès le second acte se déchaîna un tumulte enthousiaste, malgré la détestable mise en scène de Paravey. L'air de Rozenn fut trissé, tous les morceaux de la partition bissés. En moins d'un an, le Roi d'Ys fut joué 60 fois. (L'œuvre fut reprise en 1902 à l'Opéra-Comique, avec une nouvelle mise en scène de M. Albert Carré. Elle a atteint aujourd'hui 350 représentations.) Mais Lalo avait 65 ans. Il devait mourir le 22 avril 1892.
***
Des critiques fantasques ont prétendu que Lalo était wagnérien. La connaissance qu'il avait de l'art de Wagner ne l'a point influencé. Mylio n'est pas le frère de Tristan ni de Siegfried. Sans doute par de certains côtés, il est Tristan. Mais un Tristan de France, un ancêtre héroïque et tendre de notre Cid. Il est l'incarnation majestueuse et passionnée de la généreuse âme française. Lalo, qui, pendant de longues années s'était fait l'interprète des grands classiques, procède plutôt de Weber, parfois même de Mozart. Le leitmotiv ne se retrouve dans ses partitions que trois ou quatre fois. Son orchestration, nourrie, savante, riche, est coupée d'accords brusques comme dans les œuvres classiques. Il peint à fresque, avec fougue. Aucun développement inutile. Une écriture cursive, synthétique, mais d'une incomparable élégance. Une nerveuse et étincelante puissance. Plus de déclamation pompeuse, prétentieuse, si souvent grotesque. Un sens du goût exquis et rare. Cette musique du Roi d'Ys a je ne sais quoi de royal. Et cependant, tout le désespoir qui monte de la lande bretonne, le flux et le reflux des grandes solitudes glauques de là-bas, cet air vif, iodé, salé qui brûle les lèvres et les yeux, et enfin l'écume et les embruns et toute l'atmosphère tragique de cette Baie des Trépassés sont redites en musique avec la perception minutieuse et nuancée qu'on découvre dans les descriptions de Bretagne d'Ernest Renan.
La partition du Roi d'Ys est une magistrale leçon de musique française de théâtre. Lalo nous offre ainsi le tracé idéal de notre drame lyrique. Voici les préceptes impérieux que j'y puise et que j'offre à la méditation de nos compositeurs :
1° Agrandir la signification du sujet qu'on traite ;
2° Epuiser techniquement, mais sans complaisances brillantes, les motifs qu'on aborde ;
3° Peindre à larges touches l'atmosphère locale ;
4° Faire dominer, à l'orchestre, la psychologie des personnages, dont on dessine, d'un trait violent et sûr, les caractères ;
5° Faire jouer le drame à l'orchestre avec plus d'intensité que sur scène, de telle sorte qu'un auditeur puisse suivre, sans voir les chanteurs, chaque péripétie de l'intrigue ;
6° Un récitatif simple, humain, haletant, rapide ;
7° Toute musique doit avoir sa valeur propre, sa valeur pure en dehors de la valeur du texte, et un fragment jugé indigne de figurer au concert ne devra jamais se trouver dans une partition théâtrale.
Il n'est pas inutile d'affirmer ici ces principes, trop souvent ignorés sinon dédaignés. La formule de ce qu'on appelle railleusement la musique de théâtre ne doit pas tenir prisonnière l'inspiration de nos compositeurs.
Edouard Lalo a sauvegardé, lui, la dignité de la musique de théâtre dans un temps où tout artiste original et sincère était banni de la scène.
***
Entre Carmen et le Roi d'Ys qui forment deux limites brillantes d'une époque de la Salle Favart, plusieurs ouvrages français ont été créés qui gardent leur importance dans l'histoire lyrique. Il n'est pas possible de s'arrêter longuement sur certaines de ces partitions d'une rare qualité et auxquelles le public accorde encore sa faveur.
Avant Carmen, le 24 mai 1873, l'Opéra-Comique créait le Roi l'a dit, l'une des œuvres les plus spirituelles, les plus complètes de Léo Delibes. Bien qu'écrite selon les coupes de l'ancien répertoire, elle nous émeut par une grâce riante, une fraîcheur de sentiments qui dénotent une exquise personnalité théâtrale. Le finale du second acte en est des plus remarquables. Il peut encore passer pour un modèle. Il est rare qu'on s'assimile l'esprit classique de plus heureuse façon.
Le Roi l'a dit fut donné quarante fois en 1873 ; repris en 1885, le charmant ouvrage de Léo Delibes obtint encore douze représentations. Depuis, on ne sait pour quelle raison, il fut rayé du répertoire.
En mars et avril 1874, eurent lieu, en l'honneur de Manzoni, six auditions de Marie-Magdeleine, drame sacré de Massenet. C'est la première œuvre importante, peut-être même l'œuvre capitale du compositeur de Werther. « Marie-Magdeleine » fut mise à la scène trente-deux ans plus tard.
Le 20 janvier 1874, du Locle rachetait à son associé de Leuven, sa part de 300.000 francs et restait seul directeur de l'Opéra-Comique.
Gounod qui, selon l'expression de M. Camille Bellaigue « a donné à la musique française un cœur nouveau » voyait reprendre en 1873 également Roméo et Juliette créé au Théâtre-Lyrique en 1867. Madame Carvalho et Duchesne figuraient les jeunes amants de Vérone. Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'éclat et la valeur de Roméo et Juliette, non plus que sur Cinq-Mars créé le 5 avril 1877, à la salle Favart. M. Bellaigue en a publié des études d'une réflexion décisive.
Toutefois, dans Cinq-Mars que Gounod avait écrit en quelques semaines et qui se ressent de sa hâte improvisatrice, on retiendra la marche funèbre de l'introduction, le duo final du 1er acte, l'émouvant tableau de la forêt, si décrié à la création, si admiré aujourd'hui, et le puissant finale du dernier acte. Ces pages donnent assez de signification à l'œuvre d'un musicien qui, destiné à chanter l'âme féminine, voulut cette fois marquer de noblesse et d'austérité une partition précipitamment mise au point.
Le livret de Cinq-Mars avait été extrait du roman d'Alfred de Vigny par un ami de Charles Gounod, Poirson. Louis Gallet avait donné au scénario une forme scénique habile. Tout le succès, à la création, alla au ballet, chez Marion de Lorme. On y dansait la Carte du Tendre chère à Mlle de Scudéry, — ce qui eût surpris même La Rochefoucauld.
Le 31 octobre 1877 et le 20 décembre 1880, deux ouvrages de Ferdinand Poise, les Surprises de l'Amour et l'Amour médecin sont joués non sans succès et plaisent par leur légèreté, leur verve facile. Le 20 octobre 1884, on donne le Joli Gilles également de Poise et qui témoigne du même esprit aisé, de la même habileté scénique.
Les Contes d'Hoffmann, de Jacques Offenbach furent représentés pour la première fois le 10 février 1881, après la mort de l'auteur de la Vie parisienne. Ernest Guiraud avait orchestré cette partition, encore fort goûtée de nos jours. Les Contes d'Hoffmann sont restés au répertoire de l'Opéra-Comique. On y retrouve la façon d'écrire presque classique d'Offenbach. L'œuvre est d'un agrément indéniable. C'est surtout dans l'orchestration du compositeur de la Belle Hélène que se révélait la personnalité de ce grand musicien gai, avec ses idées cocasses et ses trouvailles. Mais l'instrumentation de Guiraud, si adroite qu'elle soit n'est d'aucun rapport avec les inspirations d'Offenbach.
Signalons un acte dont le poème était dû à Paul Arène et Alphonse Daudet, le Char. Emile Pessard en avait écrit la musique. Créé en 1878, la course de ce char fut des plus brèves. Ajoutons qu'au cours de cette même année 1878, la Salle Favart encaissa, un soir, 8.409 francs 56 centimes (ce qui constituait un maximum encore inconnu) grâce au concours de Mlle Isaac.

décor pour le 2e acte de Lakmé
Léo Delibes fit jouer le 14 avril 1883 son œuvre maîtresse : Lakmé, dont le premier acte demeure d'un charme incomparable. Cette partition qui peut sembler d'un genre ancien renferme quelques audaces harmoniques exploitées, depuis, par l'école debussyste. Par la couleur pénétrante de l'orchestre, par la fine répartition des timbres, Lakmé, malgré ses passages de virtuosité surannée, est aux yeux de quelques musiciens modernes d'un prix inestimable.
Clément-Philibert-Léo Delibes est né le 21 février 1836 à Saint-Germain-du-Val, dans la Sarthe. Admis au Conservatoire de Paris, il obtenait en 1850 une première médaille de solfège. Elève, pour le piano, de Le Couppey, pour l'harmonie, de Bazin, pour l'orgue, de Benoist et, pour la composition, d'Adolphe Adam, il ne semble pas que ses études conservatoriales aient marqué beaucoup sur son esprit. Sa première opérette, Deux sous de charbon, fut jouée en 1855 aux Folies-Nouvelles. De 1855 à 1865 Delibes fit jouer plusieurs opérettes au théâtre des Bouffes-Parisiens. En 1869, il donnait encore aux Bouffes-Parisiens l'Ecossais de Chatou et aux Variétés la Cour du Roi Pétaud. Nommé en 1865 second chef des chœurs à l'Opéra, il écrivit plusieurs arrangements de ballets et fit représenter le 25 mai 1870 sa fameuse Coppélia. En 1876, on lui créa, également à l'Opéra, Sylvia. Après Coppélia, l'Opéra-Comique lui demanda le Roi l'a dit (24 mai 1873) et après Sylvia, Jean de Nivelle (8 mars 1880) et enfin Lakmé (14 avril 1883). Il laissait après sa mort Kassya qu'Ernest Guiraud et Massenet terminèrent. La création de Kassya à l'Opéra-Comique (14 mars 1893) n'ajouta rien à la gloire de Léo Delibes.
Lakmé fut composée en moins d'un an. Le musicien avait été fort intéressé par le roman de Pierre Loti, le Mariage de Loti. II demanda à ses trois librettistes un scénario qui rappelât l’intrigue du livre. Pendant deux ans, le compositeur songea à Lakmé. Il écrivit la partition en onze mois. Après la première représentation Victorin Joncières publia un article dont je détache ces lignes judicieuses : « à égale distance des formules surannées du drame lyrique, Lakmé forme le trait d'union entre la musique du passé et celle de l'avenir ; aussi a-t-elle réussi auprès des dilettantes d'opinions divergentes. » Il n'est pas douteux qu'un grand nombre de pages de cette partition soient démodées. Mais d'autres, par leur gracieuse simplicité leur pureté mélodique, leur exotisme facile, leur élégance harmonique demeurent parmi les plus savoureuses de l'art lyrique français.

fac-similé d'un fragment autographe de la partition de Manon
En 1856, Auber avait fait représenter une Manon assez pauvre. Le public n'en avait retenu qu'une danse nègre, et une chanson créole. C'était insuffisant pour le maintien de la pièce au répertoire. Massenet fut mieux inspiré lorsqu'il donna 28 ans plus tard, le 19 janvier 1884, une nouvelle Manon. C'était un mélodrame lyrique plein d'esprit, d'émotion et admirablement fait pour plaire aux amateurs les moins difficiles. Massenet n'avait pas rompu avec le vieil opéra-comique. Il en avait conservé les couplets, les duos, trios, quatuors. Il s'était contenté de souligner par un accompagnement d'orchestre le dialogue parlé. Sa technique de compositeur s'augmentait d'un sens dramatique exceptionnel. Il introduisait dans la musique théâtrale ces fameux rythmes amoureux à 9/8 et 12/8. Il ne craignait pas de faire une place dans son orchestre au saxophone. La mélodie avait des étirements voluptueux, une sorte de grâce charnelle. Il continuait avec des pâmoisons et des secousses la manière du musicien de Faust. On a appelé avec quelque raison Massenet « la fille de Gounod ».

Léon Beyle dans Manon (photo Paul Berger)
A quoi tient donc le succès toujours accru de Manon ? N'est-ce pas plutôt au sujet où les sensibilités les plus ordinaires trouvent à s'émouvoir ? Je n'ai pas grande admiration pour le roman de l’abbé Prévost qui justifie un peu facilement les débordements inattendus d'un tempérament vulgaire. J'éprouve quelque répugnance aux douleurs puérilement romanesques de cette jeune courtisane imprudente. On peut trouver au XVIIIe siècle des romans d'une grâce plus vivante, d'un sentiment plus hardi, d'un caractère plus puissant. Je songe à l'admirable livre de Choderlos de Laclos : les Liaisons dangereuses.
Mais, il faut convenir que Massenet était particulièrement préparé à traduire les malheurs amoureux d'une fille perdue et d'un clerc peu scrupuleux. Je ne méconnais pas les qualités du compositeur de Manon. J'apprécie autant qu'il faut l'esprit, le pathétique sans gravité, l'incomparable sens de l'accent dramatique du musicien. Les auditeurs délicats écoutent avec déplaisir l'abus que Massenet a fait de ces cadences arrondies et qui font retomber avec une grâce toujours affectée les voix de ses héros. L'épais Lescaut lui-même s'exprime par ces mignardises. La partition de Manon manque, par ailleurs, d'unité. N'importe. Massenet qui présente, non sans autorité cette fausse image du XVIIIe siècle qui était alors à la mode, révèle une personnalité désormais reconnaissable dans toute la musique. Le dernier acte si prenant même aux cœurs raffinés en est un témoignage très net. Nous reviendrons d'ailleurs à Massenet lorsqu'il s'agira de Werther et surtout du Jongleur de Notre-Dame dont le mérite est plus profond.
Le 16 mars 1887, l'Opéra-Comique montait Proserpine de Camille Saint-Saëns, autre histoire de courtisane amoureuse. L'action se passe au XVIe siècle. L'auteur de Samson et Dalila ne nous offre qu'une partition d'opéra d'une formule déjà consacrée. Le manque d'imagination de Saint-Saëns s'y montre plus qu'ailleurs. Malgré les ensembles puissants et bien ajustés et le beau trio final, malgré l'orchestration magistrale, Proserpine ne semble point une œuvre importante de l'histoire française de la musique dramatique.
Nous voici arrivés au Roi malgré lui d'Emmanuel Chabrier, joué pour la première fois le 18 mai 1887 et qui par suite de l'incendie de l'Opéra-Comique n'obtînt que quatre représentations. Chabrier était alors en pleine force de son talent. On connaissait déjà de lui España et Gwendoline. La critique se montra hostile au dernier ouvrage de Chabrier. Le livret, dû à trois écrivains renommés, n'est pas des meilleurs. L'œuvre tient tout ensemble de l'opéra et de l'opéra bouffe. C'est l'un des premiers essais de parodie musicale qui aient été donnés au théâtre. On est tenté d'y trouver l'ébauche du finale de l'Heure espagnole de M. Maurice Ravel. Le musicien du Roi malgré lui s'y dévoile comme le précurseur de nos compositeurs actuels. On est surpris de ne pas revoir sur une scène lyrique actuelle le Roi malgré lui. De nombreuses pages raviraient le public contemporain. Je n'en veux pour exemples que l'air sautillant et malicieux d'Alexina au 1er acte, et, au 3e acte, l'air de Fritelli, « Je suis du pays des gondoles » qui commence sur un vague rappel de la habanera de Carmen : « L'amour est enfant de Bohême » et finit avec emportement sur les accents de la marche de Rakovsky. Cela n'empêche pas le plaisant compositeur d'écrire au dernier acte du Roi malgré lui un duo d'une rare qualité dramatique, le duo entre Minka et Nangis. Mais, là encore et dans certains airs de virtuosité le musicien n'a-t-il pas voulu s'amuser aux dépens d'un public facile à tromper ? L'instrumentation du Roi malgré lui reste d'une riche et musicale fantaisie. L'école moderniste pourrait puiser à cette source riante maintes inspirations.
Il me reste à signaler dans ces pages au cours de la période étudiée, le Piccolino d'Ernest Guiraud joué en 1876. Ce musicien ami de Bizet ne manquait pas de talent ni d'érudition. Il est moins célèbre pour son classicisme délicat que pour les encouragements qu'il ne cessa de prodiguer à quelques uns de ses élèves devenus les meilleurs musiciens de l'époque contemporaine. Piccolino, dont l'intrigue rappelle celle de Mignon fut accueilli avec moins de faveur que l'ouvrage d'Ambroise Thomas. Il obtint néanmoins cinquante représentations. N'oublions pas le Florentin de Lenepveu représenté en 1874 ; les Amoureux de Catherine (1876) d'Henri Maréchal, compositeur attitré d'Erckmann-Chatrian, et qui fit encore jouer la Taverne de Trabans (1881) ; Maître Ambros qui marque les débuts sur une scène lyrique de M. Charles-Marie Widor et enfin l'Egmont (1886) de M. Gaston Salvayre.
Ainsi dans les quinze premières années du temps qui nous occupe, la production lyrique pour le théâtre est, sinon d'une grande variété, assez riche. Elle annonce la place prépondérante que la musique française prendra.
Déjà elle est marquée par trois œuvres éclatantes et dont le monde entier subit encore l'attrait : Carmen, Manon et le Roi d'Ys.
***
Paravey ne dirigea l'Opéra-Comique que pendant quatre ans. La succession de Carvalho était lourde. Aux difficultés scéniques s'ajoutèrent bientôt les difficultés administratives et financières. Un contrôleur de l'état fut chargé, à la fin de 1890, de réviser tous les comptes et d'établir le passif de l'entreprise. Paravey fut obligé de quitter la place. Le 6 mars 1890, Léon Carvalho fut rappelé au poste qu'il avait occupé avec tant de brillante ingéniosité, d'autorité et délicatesse éprouvée.
Ne soyons pas injustes pour Paravey. Il avait monté le Roi d'Ys, le chef-d’œuvre d'Edouard Lalo que tous les directeurs, ainsi qu'on l'a vu, avaient refusé de créer. Dans la dernière année de sa direction, alors que ses affaires étaient rien moins que prospères, il avait donné la première représentation du Dante, quatre actes et six tableaux de Benjamin Godard (13 mai 1890. Principaux interprètes : Mmes Simonnet, Nardi, MM. Gilbert, Lhérie, Taskin). Œuvre languissante et qui ne pouvait retenir l'attention du public. Le 30 mai, eut lieu la création de la Basoche, opéra-comique en trois actes de M. Albert Carré qui devait, par la suite, devenir directeur de la Salle Favart. La musique était due à M. André Messager. Le succès de cette partition étincelante, écrite sur un livret fort adroitement arrangé pour la scène, ne s'est jamais démenti. Ses principaux créateurs avaient été MM. Soulacroix, Lucien Fugère, Carbonne, Mmes Landouzy et Molé-Truffier. A l'âge de 76 ans M. Lucien Fugère continue de tenir, avec un art inimitable, le rôle du duc de Longueville, dans l'ouvrage de MM. Albert Carré et André Messager. La musique de la Basoche, d'une inspiration très simple et très vive, instrumentée avec autant d'élégance que de verve demeure comme l'une des manifestations les mieux réussies de l'esprit musical français. Paravey fit jouer encore, le 3 décembre, le Benvenuto d'Eugène Diaz avec le baryton Renaud et Mme Deschamps-Jehin, le 31 décembre, un Amour vengé, en deux actes de M. Gaston de Maupeou. Le malheureux directeur du Théâtre de Nantes nommé à l'improviste, à la tête de la Salle Favart, avait eu d'excellentes intentions. L'Opéra-Comique est un théâtre fort difficile à mener. Paravey ne s'en aperçut que trop tard. Il devait y revenir, quelques années après, comme régisseur du vieux répertoire. Il était ainsi mieux à sa place.

Lucien Fugère dans la Basoche (photo Sabourin)
Après avoir monté le 14 avril 1891, les Folies amoureuses, dont la partition spirituelle était de la plume experte et facile d'Emile Pessard, Léon Carvalho voulut frapper un grand coup en jouant l'un des musiciens les plus indépendants de l'époque. Il donna le 18 juin, le Rêve, en sept tableaux d'Emile Zola et M. Alfred Bruneau. (Mmes Simonnet, Deschamps-Jehin, MM. Engel et Bouvet chantaient les principaux rôles.) C'est là une date importante de la musique moderne de théâtre. Une personnalité décidée, libre de toute contrainte traditionniste, se révèle au public. L'œuvre d'Emile Zola et M. Alfred Bruneau provoqua une manière de scandale. On ne s'émut pas seulement des audaces orchestrales et des dissonances, mais aussi de la simplicité du dialogue, de la vérité du drame. Pour la première fois, sur une scène lyrique, un compositeur et un écrivain s'exprimaient sans concessions. Emile Zola et M. Alfred Bruneau osaient être sincères. Ils ne craignaient pas de traiter lyriquement des sentiments de tous les jours. Leurs héros étaient pauvres et se déclaraient sans les redondances jadis obligatoires. Ils avaient été choisis d'ailleurs, dans les foules contemporaines. L'intérêt qu'ils excitaient n'était pas moins grand que s'il s'était agi de rois ou de personnages légendaires. On peut envisager aussi que les auteurs du Rêve, sous un masque qui paraissait grimacier et révolutionnaire, revenaient brusquement aux sujets qui avaient tenté les grands musiciens du dix-huitième siècle. Pergolèse, Cimarosa, Mozart n'avaient-ils pas pris les intrigues et les héros de la Servante maîtresse, du Mariage Secret, des Noces de Figaro, ou de la Flûte enchantée, dans les milieux mêmes de l'époque qu'ils vivaient ? Il semblait alors normal que les personnages d'une pièce lyrique fussent costumés comme les spectateurs qui les écoutaient. Cent ans après les Noces et la Flûte le public des théâtres musicaux trouvait scandaleuse l'exhibition en costumes modernes, des héros du Rêve. Par manière de protestation, l'Écho de Paris, alors à l'avant-garde de l'art français, offrit un banquet, qui eut un grand retentissement, à Emile Zola et M. Alfred Bruneau.
Nous écoutons, aujourd'hui, le Rêve avec moins de parti pris et de feu. La partition de M. Alfred Bruneau qui parut à la création si discordante, si rugissante, est d'une sensibilité délicieusement libre. M. Alfred Bruneau apporta au théâtre lyrique quelques formules neuves qui depuis sont tombées dans le domaine public. Il a fait chanter, avant M. Gustave Charpentier, des ouvriers en habits de nos jours. Avec moins de goût, mais peut-être plus de puissance que Claude Debussy, le musicien du Rêve et de l'Ouragan simplifia le chant et recula les frontières du royaume instrumental. Le prélude de cinquième tableau, le sixième tableau, le septième tableau du Rêve demeurent encore des pages incomparables. M. Alfred Bruneau dès 1891 réconciliait le théâtre lyrique, — presque toujours craintif, factice, et fade, — avec la littérature et la vérité. Il se posait, dès lors, comme le chef du naturalisme musical.
En 1892, Léon Carvalho fit jouer, le 19 janvier, Cavalleria rusticana de M. Pietro Mascagni, — sur quoi il est inutile d'insister, — et le 9 mai, Enguerrande, quatre actes, dont la musique était due à M. Auguste Chapuis et qui, malgré sa ressemblance avec les œuvres de Massenet, n'obtint que six représentations. Le 9 juin les Troyens, joués en 1863, au même théâtre, furent repris avec le concours de Mme Marie Delna dont le contralto robuste et prenant faisait alors sensation.

décor pour le 2e acte de Werther par Ronsin et Paquereau
Le Werther, en quatre actes et cinq tableaux, de Massenet fut donné pour la première fois le 19 janvier 1893 avec Mmes Delna, Laisné, MM. Ibos et Bouvet, (trois mois après, M. Mouliérat reprenait le rôle de Werther qu'il interpréta pendant longtemps.)
|
|
|
|
Thomas Salignac dans le rôle de Werther (photo Paul Berger) |
Madame Jeanne Marié de l'Isle dans le rôle de Charlotte (photo Reutlinger) |
Massenet présentait ce jour-là son plus important ouvrage. La partition, qui commence et finit sur un chœur d'enfants, est, malgré l'intrigue sombre du livret, d'une fraîcheur et d'un charme rares. Massenet s'est moins abandonné là aux procédés qui lui étaient familiers. Pour plaire au public, il est très sincère. Il n'y a plus, dans Werther, les coupures et les trous qu'on trouve dans Manon. Une musique tantôt gracieuse et spirituelle, tantôt puissante et émue, coule pendant les quatre actes d'un flot jamais aminci, jamais tari. Les airs du premier acte : « Je ne sais si je veille », « O nature pleine de grâce », toute la scène du clair de lune, les airs de Sophie et de Werther au deuxième acte, les deux airs de Charlotte et le duo du troisième acte, le duo du quatrième acte sont dans toutes les mémoires. La partition, nécessairement romantique, est la plus touchante, la mieux ajustée que l'auteur de Thaïs ait écrite.



illustrations de Tony Johannot pour Werther de Goethe
Le 24 mai, Mlle Sybil Sanderson chantait pour la première fois Phryné, opéra-comique en deux actes que Camille Saint-Saëns avait spécialement composé pour la belle actrice américaine.

Mademoiselle Sibyl Sanderson dans Phryné
Le livret qu'Augé de Lassus écrivit en vers est d'une pitoyable platitude et porte les rides d'une vieillesse qui n'a rien de vénérable, ni d'attique.
Reste la musique de Camille Saint-Saëns. Elle est lumineuse, entraînante, galante et doctissime. Le trio de l'Invocation à Vénus, du second acte, bâti à grand labeur renferme les pages les plus heureuses de la partition. Il était, d'ailleurs, excellemment interprété, à la création. On se rappelle que le premier acte de Phryné, est tout orchestré de la main élégante et déliée de M. André Messager. Camille Saint-Saëns se plaisait lui-même à reconnaître cette collaboration précieuse.
L'Attaque du Moulin fut créée le 23 novembre par MM. Vergnet, Bouvet, Clément, Belhomme, Mondaud, Mmes Delna, Georgette Leblanc. Il semblait bien, qu'ému par les reproches qui lui avaient été adressés, l'année précédente, pour le Rêve, M. Alfred Bruneau, fût revenu à la coupe conventionnelle du drame lyrique. On retrouve dans l'Attaque du Moulin les airs, duos, trios, quatuors qu'on était habitué à entendre dans les pièces anciennes. L'orchestre est encore riche et complexe, la déclamation difficile. Et il y a, dans toute la partition, je ne sais quelle senteur végétale des forêts, quelles frondaisons pressées, inextricables, quels enlacements tourmentés de tiges et de branches.
Léon Carvalho qui, sept ans auparavant, lors de l'incendie de l'Opéra-Comique, avait été si maltraité et, pour un temps, publiquement condamné, se vit rendre justice au commencement de l'année 1894. Il fut nommé chevalier de la légion d'honneur. Le 22 janvier était joué le Flibustier, trois actes dont la musique était de César Cui (principaux créateurs : MM. Fugère, Taskin, Clément, Scaramberg, Mmes Landouzy et Tarquini d'Or.) César Cui appartenait au fameux groupe russe des Cinq où se retrouvaient Moussorgski, Balakirev, Rimski-Korsakov et Borodine. Fils d'un officier français établi en Russie, lors des campagnes napoléoniennes, César Cui avait pris parti publiquement contre les musiciens italiens et allemands qui dirigeaient et encombraient les conservatoires et les théâtres slaves. Il était devenu le porte-parole ardemment écouté du groupe des Cinq. On ne pouvait mieux faire que d'accueillir en France la production la plus sérieuse de ce compositeur qui faisait figure de chef d'école. Il est juste d'ajouter que la partition du Flibustier, malgré le pittoresque des binious, est morne dans son ensemble.
Le 18 avril, le fameux Falstaff de Verdi avec MM. Victor Maurel, Soulacroix, Clément, Belhomme, Mmes Delna, Grandjean et Chevalier, le 8 mai, le Portrait de Manon, un acte, agréablement attendrissant, de Massenet, apparaissent.

Marie Delna dans la Vivandière (photo Sabourin)
Ninon de Lenclos, 4 actes et cinq tableaux d'Edmond Missa, joués, le 19 février 1895 n'obtint que neuf représentations. Le premier avril, la Vivandière de Benjamin Godard fut créée par MM. Fugère, Clément, Mmes Delna et Laisné. Le compositeur de Dante venait de mourir à 46 ans. Il n'avait pu terminer la partition entraînante et facile de la Vivandière. M. Paul Vidal dont Guernica devait être chantée pour la première fois le 7 juin par MM. Jérôme, Bouvet, Mondaud, Mmes Marie Lafargue et Elven, s'acquitta pieusement de la tâche dont il fut chargé. Il écrivit la plus grande partie de l'instrumentation de la Vivandière avec la science exacte et brillante qu'on lui connaît. Mme Emma Calvé parut le 3 octobre dans le rôle d'Anita de la Navarraise qui lui avait été spécialement destiné par Massenet. Les autres rôles étaient chantés par MM. Jérôme, Bouvet, Belhomme. La Navarraise, qui par sa coupe en deux actes rappelle Cavalleria rusticana, n'est pas l'un des meilleurs ouvrages de l'auteur de Werther.
Les trois actes de Théodore Dubois qui portaient ce titre : Xavière furent interprétés, pour la première fois, le 26 novembre. Le livret était tiré du roman de Ferdinand Fabre par Louis Gallet. L'action se passe dans les Cévennes. Mais Théodore Dubois n'avait recueilli là aucune documentation pittoresque. Sa partition, dont on ne retient qu'un duo d'une naïveté charmante, est d'un classicisme terne et désuet.
L'année 1895 se termine sur la Jacquerie, 4 actes d'Edouard Lalo et Arthur Coquard, dont la création se fit le 23 décembre. Le musicien du Roi d'Ys n'avait composé que le premier acte de cet opéra traditionnel. Son génie y laissa sa trace dans l'émouvante chanson de Jacques Bonhomme. La Jacquerie était chantée par Mmes Marie Delna, Yvonne Kerlord, MM. Jérôme et Bouvet.
L'année 1896 n'est marquée que par deux créations : le 5 mai, le Chevalier d'Harmental, cinq tableaux de M. André Messager et le 24 juin la consciencieuse Femme de Claude de M. Albert Cahen.
Le 8 février 1897 Camille Erlanger débutait au théâtre avec Kermaria, drame lyrique en trois épisodes, chanté par Mmes Guiraudon, Charlotte Wyns, MM. Bouvet, Jérôme et Mondaud. La personnalité musicale de l'auteur d'Aphrodite s'affirmait déjà par cette partition mystique et forte.
Le 17 mai, le Vaisseau fantôme de Richard Wagner fut mis à la scène française par Léon Carvalho. A Mmes Marcy, Delorn, MM. Bouvet, Jérôme, Belhomme, Carbonne avaient été distribués les principaux rôles.

Maurice Renaud dans le Vaisseau fantôme (photo Paul Berger)
Sur un livret en quatre actes tiré du roman de Pierre Loti, M. Louis Lambert avait composé le Spahi, créé le 18 octobre. M. Alexandre Luigini prenait place pour la première fois au pupitre de l'Opéra-Comique pour diriger cette partition agréable mais qui ne réussit pas auprès du public.
Trois semaines avant la mort d'Alphonse Daudet, Massenet fit jouer Sapho par Mmes Emma Calvé, Charlotte Wyns, Guiraudon, MM. Leprestre, Marc Nohel et Gresse. Le grand romancier avait pu assister à la première représentation du drame lyrique que MM. Henri Cain et Arthur Bernède avaient tiré de son chef-d’œuvre. La partition de Massenet, très en dehors, « très théâtre », avait été rapidement écrite. Certaines pages, d'une verve facile, d'une observation superficielle, évoquent, pourtant assez bien la chaleur et la clarté de notre midi.
Il nous faut encore signaler, le 14 décembre, les débuts d'un musicien d'une technique raffinée, M. Henri Büsser, qui fit jouer, le 14 décembre, une pastorale en un acte : Daphnis et Chloé.
Le 29 décembre, onze jours après la mort d'Alphonse Daudet, on apprenait le décès de Léon Carvalho. C'était une perte considérable pour l'Opéra-Comique, pour la musique française de théâtre, pour notre école de chant dramatique. Après avoir fait ses preuves au Théâtre-Lyrique, Léon Carvalho avait pris la direction de la salle Favart à deux reprises, et dans les moments les plus difficiles qu'eût traversés cette scène musicale. Il appela, place Boieldieu et place du Châtelet, les musiciens les plus importants de l'époque. Il était attiré par l'originalité et la jeunesse dont témoignaient quelques compositeurs. Il savait discerner et mettre en valeur les talents. Quand les nouveaux venus, pour lesquels il avait pris de l'estime, n'avaient pas à lui offrir une œuvre achevée, il leur commandait, par avance, des partitions. Il savait encourager et obliger au travail les musiciens de théâtre les mieux doués. Il était lui-même un travailleur infatigable. Metteur en scène lyrique, habile et studieux, il rompit avec les conventions devenues ridicules, et sut donner à ses réalisations théâtrales les mouvements de la vie et les apparences de la nature. Tous les grands chanteurs du temps furent ses pensionnaires. Il avait constitué une troupe d'une qualité, d'une homogénéité incomparables. Comme il savait découvrir les musiciens, il avait su découvrir les chanteurs, dont il avait fait débuter un nombre considérable. Personne n'indiquait mieux que lui aux interprètes, les nuances et les subtilités des rôles les plus complexes. Léon Carvalho changea la physionomie de l'Opéra-Comique. Il en fit le théâtre lyrique le plus moderne, le plus vivant, le plus riche d'Europe.
***

Albert Carré (photo Paul Berger)
La succession difficile de Léon Carvalho échut le 14 janvier 1898 à M. Albert Carré, directeur du Gymnase et du Vaudeville, et qui continua avec éclat l'œuvre de son prédécesseur. Dès le 23 mars, M. Albert Carré faisait représenter l'Ile du Rêve, idylle polynésienne en trois actes de M. Reynaldo Hahn, jeune musicien âgé de 24 ans. Elève de Massenet, M. Reynaldo Hahn avait bâti une partition déjà fort habile, d'un charme doux et monotone, d'un exotisme délicat et sans surcharge.
Le second ouvrage monté par M. Albert Carré fut Fervaal. L'action musicale, en trois actes et un prologue de M. Vincent d'Indy, avait été créée, un an auparavant, au théâtre de la Monnaie à Bruxelles. A la salle Favart, Mme Jeanne Raunay, MM. Imbart de la Tour, Léon Beyle, Carbonne chantaient les principaux rôles de Fervaal. C'est là, la première œuvre importante que M. Vincent d'Indy ait écrite pour le théâtre. A l'instar de Richard Wagner, M. Vincent d'Indy composa à la fois le livret et la musique de Fervaal. L'intrigue mythologique et symbolique se déroule dans les Cévennes, (d'où le musicien d'Istar est originaire), au moment de l'invasion sarrazine. Fervaal comme Siegfried et Parsifal, est un héros chevaleresque. Brenn, il a fait vœu druidique de chasteté. Il aime une femme dont il est aimé. Il oublie pour elle son serment de druide. Son pays succombera sous le malheur. Mais Fervaal entrevoit les temps nouveaux où la patrie ressuscitera plus fière et plus grande.

Fervaal. Décor pour le prologue (Bibliothèque de l'Opéra)
Il est évident que Fervaal a été écrit sous l'influence de Richard Wagner, dont l'ombre s'étendait alors sur toute l'Europe. On retrouve dans la partition du compositeur français, les motifs conducteurs, l'orchestre nombreux, le récitatif mordant et altier et toutes les hautes préoccupations chères au maître de Bayreuth. Pourtant, si l'on écarte l'appareil guerrier, le symbolisme orageux de Fervaal, on découvre que le musicien français a été davantage influencé par son, maître César Franck, que par le dieu Wagner. Ecoutez l'instrumentation de Fervaal. Elle est puissante et fine. Elle ne paraît pas sombre ni lourde. Elle garde de l'élégance dans la force. Elle n'est pas, sans cesse, grondeuse ni débordante. Souvent, tel instrument impose silence à ses voisins, pour faire fuser sa propre couleur, seule. Car les instruments n'attaquent pas, selon la méthode allemande, par masse. Et tout n'y est pas constamment au premier plan.
La partition de Fervaal est considérée très justement comme l'une des œuvres maîtresses de la musique française de théâtre. Par la noblesse de conception, par l'amplitude du plan, par la sévérité de méthode, elle tient l'un des premiers rangs dans le répertoire de notre musique dramatique. Les spectateurs les plus distraits, les plus naïfs, les plus opposés au génie de M. Vincent d'Indy ne peuvent pas ne pas être touchés par la fin du prologue, par le début du premier acte, par le récit d'Arfagard et le duo, — du premier acte également, — par ces puissants chants de forêt au 2e acte, par la grandeur passionnée de la conclusion du dernier acte. Si l'on veut absolument adresser un reproche à cette admirable partition, c'est sa nudité de construction, sa sécheresse de logique qu'on incriminerait. Les arêtes et les contours s'y montrent peut-être trop ostensiblement. Œuvre grave et savante d'un professeur formé aux écoles de Richard Wagner, de César Franck et qui a longuement étudié Rameau et Gluck, Beethoven et Berlioz. « Fervaal, dit M. Paul Dukas, est, je ne crains pas de l'affirmer, le seul ouvrage écrit depuis Parsifal dans lequel l'élément musical tienne une telle place et produise un tel résultat. »

Lucien Muratore dans Fervaal (photo Sabourin)
M. Vincent d'Indy fait partie de ces grands musiciens guerriers et mystiques, tout vibrants de romantisme et dont l'auteur de la Tétralogie fut le représentant génial. Sa partition de Fervaal a toute la noblesse désolée d'un paysage cévenol. Elle évoque les causses désertiques aux roches fauves, brûlées de soleil, escarpées, corrodées et tailladées, sous un rude climat. Elle fait songer à cette cathédrale velaisienne, de La Chaise-Dieu, la plus élevée de France et dont la pierre grise et rugueuse est semblable à un vénérable habit monastique.
« L'art musical, a écrit M. Vincent d'Indy dans son Cours de composition, plus peut-être que tous les autres, reste intérieur, comme la foi dont il est l'émanation ; il ne connaît pas d'autre but que la prière, l'enseignement des vérités éternelles. » L'auteur de la Légende de Saint-Christophe n'a écrit jusqu'à présent que des ouvrages de haute édification et qui réjouiront les dévots. Ceux qui sont touchés de la grandeur d'une œuvre et dédaignent les compositions de petite conséquence l'écouteront avec un grand sentiment d'admiration. Le musicien de Fervaal n'a pas fléchi de respect superstitieux, ainsi qu'on l'a dit, devant Richard Wagner. Il a son style propre, vertueux et nuancé. Il a trop de clairvoyance et de lecture dans son système pour être un musicien d'une originalité séditieuse. Mais une place, non des moindres, est réservée à sa personnalité vigoureuse et scientifique, dans l'histoire de notre littérature musicale.
***
Le 13 juin 1898, M. Albert Carré fit représenter, pour la première fois, la Vie de Bohème de l'astucieux maestro transalpin, Giacomo Puccini. MM. Maréchal, Lucien Fugère, Bouvet, Jacques Isnardon, Belhomme, Mmes Guiraudon et Tiphaine composaient la distribution de cet ouvrage, où la banalité mélodique, la boursouflure, la passion des effets grossiers apparaissent un peu moins que dans Tosca ou Madame Butterfly.

Mademoiselle Charlotte Wyns dans la Vie de Bohème (photo Reutlinger)
Le directeur de l'Opéra-Comique fut obligé de quitter le 15 octobre le théâtre des Nations (devenu Théâtre-Lyrique, puis théâtre Sarah-Bernhardt). Mais la nouvelle salle Favart qu'on édifiait depuis 1887 n'était pas encore prête. La troupe de l'Opéra-Comique se vit obligée de donner au théâtre du Château-d'Eau, du 26 octobre au 25 novembre, trente représentations. Ce n'est que le 7 décembre que fut inauguré, au cours d'une soirée de gala, le théâtre actuel de la place Boieldieu.
A la vérité la troisième salle Favart qui aurait dû être la plus moderne et la mieux agencée de nos salles de théâtres n'offre aucun des avantages qu'on pouvait en attendre. Sa façade n'est point sur les boulevards. Sa décoration, à l'intérieur et à l'extérieur, est d'une banalité prétentieuse, d'une laideur enjolivée dont les artistes s'étonnent. Alors que l'architecte Bernier pouvait s'adresser à des peintres comme Puvis de Chavannes, Claude Monet, Edouard Manet, Auguste Renoir, Eugène Carrière, Edgard Degas, à des sculpteurs comme Rodin, Dalou, Bartholomé, Camille Claudel, il fit appel aux plus indigents artistes qu'eût distingués l'Institut. A peine remarque-t-on le plafond, la Vérité, de Benjamin Constant, le Drame lyrique et le Monument à Bizet de Falguière. Les autres ornements artistiques, qui encombrent les murailles de foyers et d'escaliers inutiles n'offrent aucun intérêt. Quant aux moulures, aux mascarons, aux boudins et aux bossages placés partout dans le théâtre, ils sont d'un goût déplorable. Ce qui est plus regrettable encore, c'est que la scène est très étroite et sans aucune profondeur. Nul emplacement n'a été réservé pour les décors qu'on apporte et remporte pour chaque représentation, pour chaque répétition. D'autre part, l'acoustique excellente aux étages supérieurs est défectueuse aux baignoires et à de certains endroits de l'orchestre. La fosse de l'orchestre même n'est ni assez profonde, ni assez grande. Malgré tous ces inconvénients et ces défauts, la troisième salle Favart est de proportions plaisantes. Le public est attiré au théâtre de l'Opéra-Comique, tant par le répertoire très populaire que par le cadre neuf, réduit et où sont possibles les réalisations dramatiques d'une humanité plus intime et plus vraie que sur d'autres scènes lyriques.
Une nouvelle période la plus éclatante qu'ait encore connue la musique française de théâtre coïncide avec l'ouverture de la troisième salle Favart. Les compositeurs français, formés par des maîtres passionnés et désintéressés, instruits des grands événements musicaux de l'étranger, attirés par les manifestations incessantes des quatre ou cinq théâtres lyriques de la capitale, par les concerts, chaque jour plus nombreux, sont parvenus à leur maturité. Dans toute la force de leur talent, ils publient les œuvres les plus riches, les œuvres les plus riches, les plus originales et les plus fermes qu'on ait vues à l'Opéra-Comique. Dès le 30 décembre, le directeur de la salle Favart fait une reprise de Fidelio avec Mmes Rose Caron, Laisné, MM. Vergnet, Bouvet, G. Beyle, Carbonne et Gresse. En montant comme premier spectacle important, le chef-d’œuvre de Beethoven, M. Albert Carré voulait-il indiquer que le nouveau théâtre serait désormais consacré à la musique la plus noble et la plus pure ?
***
Le 2 mars 1899, on joue l'Angelus, un opéra en un acte de Casimir Baille, qui n'attira pas l'attention. Le 24 mars, c'est le tour de Beaucoup de bruit pour rien, quatre actes et cinq tableaux de Paul Puget, avec MM. Lucien Fugère, Clément, Léon Beyle, Isnardon, Carbonne, Mmes Mastio, Telma et Dehelly. La partition fort habilement construite, selon les formules massenétiques, manque parfois d'accent personnel mais non de force ni de flamme. Le 20 avril, Charles Lecocq, l'auteur de la Fille de Madame Angot donna un ballet en un acte le Cygne, preste et joli, un peu vulgaire.
Le conte de fées en quatre actes de Massenet, Cendrillon fut créé le 24 mai avec le concours de MM. Lucien Fugère, Dubosc, Gourdon, Mmes Bréjean-Gravière, Guiraudon, Deschamps-Jehin, Emelen, Tiphaine et Marié de l'Isle. Les spectateurs accueillirent avec un vif plaisir cette partition pleine de gentillesse spirituelle, de grâce attendrissante et d'une instrumentation délicatement distribuée. Cendrillon fut représentée trente fois dans l'année, ce qui, pour un ouvrage lyrique, indique un très grand succès. La dernière création fut Javotte, un exquis ballet en trois tableaux de M. J.-L. Croze, musique de Camille Saint-Saëns, dansé, pour la première fois, le 23 octobre. L'auteur de Samson et Dalila a écrit là l'une de ses partitions les plus brillantes, les plus heureuses. L'orchestration vive, poussée, chatoyante, reste d'un classicisme raffiné.

Gustave Charpentier
Dès le 2 février 1900, apparaît Louise, le roman musical en quatre actes et cinq tableaux de M. Gustave Charpentier. Les principaux rôles avaient été confiés à Mmes Rioton, Deschamps-Jehin, Tiphaine, Marié de l'Isle, MM. Maréchal, Lucien Fugère, Carbonne et Vieuille. L'œuvre de M. Gustave Charpentier, est tout ensemble, un drame philosophique social et symbolique, une étude de mœurs parisiennes et une pièce d'amour. L'intrigue est des plus simples : une couturière, fille d'ouvriers, s'éprend d'un poète adolescent et qui veut l'épouser ; les parents de Louise refusent leur consentement au mariage ; la jeune fille s'enfuit avec Julien ; mais, apprenant que son père est malade, Louise revient à ses parents ; chassée par son père, elle s'enfuit définitivement chez son amant. Sous son aspect réaliste, Louise est une sorte de féérie idéaliste. Un personnage de noctambule figure allégoriquement le plaisir et Paris. Au second acte, l'atmosphère de la capitale, avant 1900, sur les hauteurs de Montmartre, est remarquablement décrite en une symphonie où, fort à propos, interviennent les fameux cris de Paris. Très artificieusement, M. Gustave Charpentier a fait de cette action humble et prosaïque une synthèse de la vie montmartroise, avant l'Exposition universelle. Le symbolisme wagnérien fait, avec Louise, son entrée dans le monde contemporain.
L'auteur de la Tétralogie ne s'était inspiré que de sujets légendaires. M. Gustave Charpentier qui, ainsi que le maître bayreuthien, a écrit lui-même son livret, a pris son argument dans un milieu actuel et a tenté de lui donner un sens mystique et social. Il s’apparente, comme librettiste, à Emile Zola, Villiers de l'Isle Adam, à MM. Saint-Georges de Bouhélier et Saint-Pol Roux. Comme musicien, il est proche de Wagner, de Massenet et de M. Alfred Bruneau. La partition de Louise, dont les mélodies vibrantes, coulantes et affectées, l'accentuation très expressive, le goût théâtral de l'effet à tout prix, font penser qu'elle est de filiation vériste et qu'elle est aussi construite d'après la formule leitmotiviste. Certains passages, à l'orchestre, rappellent très nettement des pages parsifaliennes. L'instrumentation est évidemment riche et forte. Quelle qu'ait été l'indépendance de l'auteur des Impressions d'Italie, il n'a pu échapper à l'influence du grand Allemand. Pourtant, cette musique, tantôt d'un romanesque populaire, tantôt gouailleuse, tantôt d'une rhétorique ampoulée, porte bien la marque d'une personnalité. Quoi qu'en écrive M. Richard Strauss, M. Gustave Charpentier ne représente pas toute la musique française. Mais il est bien le musicien d'une époque. Ses compositions, d'un tour apparemment facile, font une impression profonde sur l'esprit de la foule. Le peuple de Paris retrouve là son image. Louise est un document important d'un moment de la vie française. Sa force de persuasion est loin d'être abolie. L'œuvre de M. Gustave Charpentier a déjà été jouée plus de six cents fois sur la scène de l'Opéra-Comique. Un quart de siècle s'est écoulé depuis son apparition. Son succès va grandissant. C'est que « cette jeune ouvrière aux yeux vifs, au teint mat, dont les cheveux noirs roulés en grosses tresses se penchaient sur une taille longue et vigoureuse », ainsi que M. Gustave Charpentier l'a lui-même dépeinte est le type même, minutieusement observé, de la jeune couturière, sortie d'une famille parisienne, pauvre et laborieuse. Le compositeur-poète en a fait une manière de figure héroïque dont on ne pourra se détacher de si tôt. La partition, remarquablement cimentée, forme un tout compact. Si l'on veut distinguer les passages saillants, on s'arrêtera avec plus de complaisance sur le duo et la scène du repas du premier acte, sur le nocturne parisien au second acte, sur le couronnement de la muse du troisième acte, sur la berceuse du dernier acte. On a dit que Louise était d'une facture tout ensemble trop banale et trop pompeuse. Laissons dire. L'œuvre de M. Gustave Charpentier, a en elle tout un côté vif et sincère qui l'imposera toujours à l'attention du public.
Pourtant, à la première représentation, les spectateurs se montrèrent offensés par cette évocation mystico-naturaliste. On protesta, on siffla, on hurla. Un artiste important, chargé d'un des principaux rôles, affirmait déjà que la pièce n'obtiendrait que trois représentations. Louise fit sensation. Dès le 26 juillet, on célébrait la cinquantième représentation, à un banquet qui eut lieu au Moulin de la Galette, en plein centre du quartier chanté par M. Gustave Charpentier. Ajoutons que, le 10 avril, Mlle Rioton, qui chantait le rôle de Louise se sentit soudain sérieusement indisposée. Elle ne put continuer la représentation. Une jeune choriste écossaise Mlle Mary Garden, qui devait fournir plus tard une des plus belles carrières lyriques de notre temps, remplaça, après le second acte, au pied levé, Mlle Rioton. M. Gustave Charpentier est aujourd'hui membre de l'Institut. Il n'a pas oublié les modestes modèles qui servirent son inspiration. Il a créé un Conservatoire de Mimi Pinson où les jeunes ouvrières peuvent recevoir une éducation musicale. Il s'est intéressé, avec une grande générosité, à toutes celles qui mènent obscurément l'existence laborieuse de Louise.

décor pour le 2e acte de Louise
***
Un nouvel ouvrage important de Camille Erlanger fut représenté la première fois le 11 avril : le Juif Polonais, en trois actes et six tableaux. Mmes Guiraudon, Gerville-Réache, MM. Victor Maurel, Clément, Vieuille, Carbonne, Huberdeau, Gresse et Rothier en étaient les interprètes. La partition, d'une élégance savante renferme quelques airs alsaciens. On se rappelle quel parti l'auteur d'Aphrodite a su tirer, à la fin du second acte, de la Valse du Lauterbach. On ne sait pourquoi cette œuvre pittoresque et dramatique a disparu de l'affiche de la salle Favart.
Après le Follet, un acte, fort ordinaire, de M. Lefèvre (de Reims), joué le premier mai, on put applaudir le 30 mai Hänsel et Gretel la féérie en trois actes et cinq tableaux de M. Humperdinck. Interprété par Mmes Delna, de Craponne, Rioton, Mastio, Dhumon, Daffety et M. Delvoye, ce conte musical fut très vivement goûté du public. On a écrit de cette partition qu'elle était d'un « Wagner pour enfants ». C'est excessif. La musique, composée sur des thèmes populaires et des rondes d'enfants très mélodique, très agréable, bien instrumentée, fait songer plutôt à la manière de Gounod.
Signalons enfin le 4 juillet, la création de Phœbé, ballet en un acte d'une poésie subtile et pénétrante de M. André Gedalge et ajoutons qu'à la fin de l'année M. Albert Carré supprima cette institution ridicule et offensante qu'on appelle la claque.
En 1901, se continue la série des œuvres importantes : le 19 avril la Fille de Tabarin, trois actes de M. Gabriel Pierné avec Mmes Mary Garden, Tiphaine, de Craponne. MM. Fugère, Léon Beyle, Jean Périer, Delvoye, Boudouresque. Elève de César Franck et de Massenet, M. Gabriel Pierné composa sur le livret de Mendès une partition d'une rare distinction et d'un ton finement moderne.
Le 29 avril M. Alfred Bruneau revient avec l'Ouragan à ses premières ambitions. Cette fois par sa sincérité violente, par son libre langage lyrique, le musicien du Rêve peut être considéré comme le chef de l'école naturaliste de la musique. Ses grandes phrases, écrasées et tordues, ses harmonies acides, opaques ou puissantes, ses rythmes robustes et abondants, ses larges ondoiements d'orchestres, précisent sa personnalité. Une élévation de pensée, un don généreux de synthèse apparaissent dans ce nouvel ouvrage d'une vérité ample et profonde. L'ouragan extérieur décrit symphoniquement par M. Bruneau, ravage l'âme des personnages et roule les sentiments comme des vagues. Le premier acte est une grande marine paisible où le soleil et le vent jouent délicieusement sur les eaux glauques. Au second acte, le drame se noue à l'orchestre avec une puissance tragique. Le troisième acte fait souffler par les instruments toute la tempête. L'œuvre qui avait été créée avec le concours de Mmes Delna, Raunay, Guiraudon, de MM. Maréchal, Dufranne, Bourbon, est l'une des plus saisissantes, des plus hautes qu'on ait données sur une scène lyrique française.
Le 5 juillet eut lieu la première représentation du Légataire universel opéra bouffe en trois actes, de Georges Pfeiffer, interprété par Mmes de Craponne, Eyreams, MM. Jean Périer, Grivot, Carbonne. C'est une œuvrette imitée de Cimarosa, avec des couplets joyeux, des duos, des quatuors, des quintettes faciles et légers. Quatre jours avant la clôture annuelle, le 10 juillet on monta encore un acte, la Sœur de Jocrisse, d'Antoine Banès qui devait devenir bibliothécaire de l'Opéra.
C'est une antique, délicieuse et édifiante histoire que celle de Grisélidis souvent, diversement racontée. Grisélidis, conte lyrique en trois actes et un prologue, de deux bons rhéteurs de théâtre, le jovial et raffiné parnassien Armand Silvestre, et M. Eugène Morand, agrémenté de la musique de Massenet, fut créé le 20 novembre 1901 avec le concours de Mmes Bréval, Thiphaine, Daffetye, de MM. Lucien Fugère, Maréchal, Dufranne, Jacquin, Huberdeau. Il fut donné sur la scène de l'Opéra-Comique 80 fois. Il a été. repris, il y a deux ans, sur la scène de l'Académie nationale de musique.
Massenet ne s'est pas attaché à faire là une partition suivie et nouée comme par exemple lorsqu'il s'est agit de la wagnérienne Esclarmonde. Sans se préoccuper de développements thématiques ni, parfois, de prosodie, il a illustré musicalement le poème d'Armand Sylvestre et M. Eugène Morand, avec des cantilènes, des chansons, un trio d'opérette, une valse, plusieurs soli de violoncelle, flûte, alto. Tous ces morceaux sont reliés ou séparés par des rafales d'orchestre. Le musicien n'a pas pris au sérieux les malheurs de Grisélidis et semble s'être gaussé de son persécuteur le diable. Belzébuth et son épouse rappellent irrésistiblement les personnages d'une des premières productions de Massenet : Sidi-Belboul, opérette jouée en 1874, aux Mirlitons. Il est juste de redire que le prologue de Grisélidis est d'une exquise qualité. Très émouvants également, le départ du marquis, mari de Grisélidis, au son des cloches de l'Angelus et le fabliau de Bertrade. Quant aux mélodies d'Alain, aux cantilènes de Grisélidis, on les a si souvent entendu ressasser qu'il est tout à fait inutile d'en reparler. Massenet a tant célébré ces belles pécheresses : Hérodiade, Thaïs, Manon, Marie-Madeleine, qu'il a paru un peu gêné lorsqu'il s'est trouvé devant le visage austère et touchant de Grisélidis. Il a prêté à « l'épouse fidèle » des accents moins persuasifs qu'à ses languides courtisanes. Autour de l'image simple et sévère il n'a tressé que des guirlandes de fleurs artificielles et poudreuses. Il n'a gardé sa ferveur et sa religion que pour l'adorable Jongleur de Notre-Dame. Massenet a beau interrompre le discours à tout instant par de coquettes mélodies qui sont là comme des anecdotes et des caresses insistantes, il a beau jeter au cours du drame, mille aménités faciles et brillantes pour provoquer l'applaudissement, ses séductions de vieux galant ne nous prennent pas, ni ses plus fluctueuses, ses plus sucrées sollicitations. On ne peut donner cette fois à l'auteur de Werther, pour plus grande preuve d'admiration, que celle de lui en marquer moins.
***

Claude Debussy sur la terrasse de Saint-Germain
Quatre mois après Grisélidis, et après un acte grandiloquent et désuet de Jules Bouval, la Chambre bleue, le 30 avril 1902 l'Opéra-Comique révélait à un public nullement préparé l'œuvre la plus importante de notre théâtre musical moderne : Pelléas et Mélisande, drame lyrique en cinq actes de M. Maurice Maeterlinck, musique de Claude Debussy. Massenet ne voulait que plaire. Claude Debussy disait également : « La musique française, c'est le plaisir. » En confrontant Grisélidis à Pelléas et Mélisande, on estimera que les deux compositeurs avaient deux façons bien différentes de séduire.

le monument de Claude Debussy par Joël et Jan Martel ; J. Burkhalter, architecte
Pelléas et Mélisande fut chanté, à la création par Mmes Mary Garden, Gerville-Réache, MM. Jean Périer, Dufranne, Vieuille. Après avoir publié des œuvres où ne passaient que rarement des lueurs de son original et charmant génie, Claude Debussy, en pleine possession de ses moyens, éprouva le désir de décrire, sans concessions, le songe exigeant qui le tourmentait. Il mit plus de douze ans à composer Pelléas et Mélisande. Tous se liguèrent contre lui et jusqu'à M. Maurice Maeterlinck qui dans une lettre publique déclara : « Dépouillé de tout contrôle sur mon œuvre, j'en suis réduit à souhaiter que sa chute soit prompte et retentissante. » Pourtant, jamais autant que dans cette partition, la triste voix mortelle n'enchanta, d'accents plus profonds et plus beaux, l'oreille humaine.
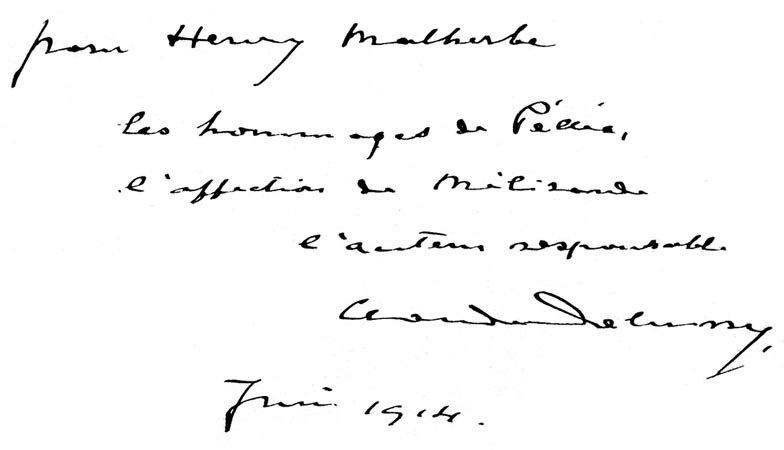
dédicace de Debussy sur l'exemplaire de Pelléas et Mélisande offert à M. Henry Malherbe
Le public de la répétition générale et de la première représentation accueillit Pelléas et Mélisande avec une grossièreté sans exemple dans l'histoire du théâtre lyrique.
Rares étaient ceux qui comprenaient et admiraient le génial ouvrage. De nombreux compositeurs (aujourd'hui chaleureux debussystes !), criaient au scandale. Des adversaires avisés avaient imaginé de faire distribuer aux spectateurs une analyse extravagante de la pièce et qui parodiait, non sans lourdeur, le drame. Malgré une plainte déposée en justice, on ne découvrit pas les auteurs de cette fourberie.
Nous ne devons pas oublier la confiance généreuse que M. Albert Carré, directeur de l'Opéra-Comique, et M. André Messager, directeur de la musique de la salle Favart, eurent en Claude Debussy. Celui-ci travailla, de longues années, à Pelléas et Mélisande ; MM. Carré et Messager, suivirent avec une sollicitude fervente toutes les étapes de la partition et encouragèrent à plein cœur les efforts de l'incomparable musicien.

fac-similé d'un autographe de Debussy
Mais ceux qui imposèrent, de façon décisive, Pelléas à l'admiration du public ce furent les jeunes artistes, les étudiants des galeries supérieures qui étouffèrent sous leurs acclamations les protestations de spectateurs ignares. Révoltés par l'injustice qui accablait le grand précurseur de la musique, ils assistaient à toutes les représentations de Pelléas avec une ténacité, un fanatisme indomptables. Ces ardeurs ne furent point vaines. Les jeunes confesseurs de la foi nouvelle ont, aujourd'hui, brisé toutes les résistances.
Claude Debussy, en portant Pelléas et Mélisande sur une scène lyrique, rompait avec toutes les traditions. D'autres ont exposé — et parfaitement — les découvertes harmoniques de ce grand musicien. Il me sera, toutefois, permis de dire qu'admirable inventeur, il supprima la distinction arbitraire des accords consonants et dissonants. Aux récitatifs pompeux et ampoulés, il substitua une déclamation exquisément humaine, serrée, pudique, vraie.
L'accompagnement ne rampe plus servilement. Il est comme une voûte de feuillage, qui ne donne aux avenues de la mélodie que l'ombre verte et la senteur enivrante. La voix humaine, aux inflexions chaudes et graves, aux ondulations molles et heureuses, a retrouvé son pathétique prestige. Elle est, enfin, sauvée de l'orage strident que provoquent les éléments déchaînés de l'orchestre. Et chaque instrument, désormais, pourra dire, avec la grâce qui lui sied, ce dont il est chargé.

décor de Jusseaume pour le 4e acte de Pelléas et Mélisande
L'orchestre lui-même est fluide, délicieusement orné, agrandi, renouvelé, d'une sonorité originale, nostalgique et précieuse. Le bruissement de la forêt, la chanson argentine de l'eau qui s'éparpille et retombe, la lumière qui tremble sur l'herbe, l'odeur des fleurs inclinées et toutes les confidences heureuses de la nature nous sont enfin révélées.
L'architecture de la partition est flottante et voilée à dessein, mais les plans en sont établis d'avance avec une minutieuse perfection. Les contours violemment cernés arrachent à la nature d'œuvre d'art qui meurt dans la prison des lignes trop précisées. Il faut que l'œuvre d'art ne soit pas indiquée avec un pédantesque orgueil, mais qu'elle garde un mystère qui aime le mystère, une douceur vivante, une attirance fraternelle qui la mette en constante relation avec les grandes harmonies inconnues du monde.
Claude Debussy a donné au langage lyrique une vie frissonnante et nuancée. Il a fait de la musique la parole la plus naturelle des hommes. Toutes les impressions qu'il reçoit de l'extérieur se traduisent, chez lui, directement, fatalement en sonorité harmonieuses.

Mademoiselle Mary Garden dans le rôle de Mélisande
L'auteur de Pelléas et Mélisande a délivré la musique théâtrale du poids des traditions emphatiques, plates et arides. L'arabesque mélodique est chez lui une sorte de graphique des mouvements de la plus délicate et plus vibrante sensibilité que nous ayons trouvée en art. La musique n'est plus là une sorte de manteau de cérémonie que l'on jette sur les mots d'un livret. Elle est l'expression la plus juste et la plus profonde des sentiments qui agitent les héros du drame.
Des doctrinaires superstitieux ont dit de la musique de Pelléas qu'elle est anarchique, hors de la syntaxe et de la tradition.
Si l'on étudie cette partition, si l'on s'en imprègne, on ne peut plus douter de sa lignée classique ni de sa mouvance historique.

Jean Périer dans le rôle de Pelléas (photo Nadar)
C'est par un élargissement magnifique des principes harmoniques que Claude Debussy a fait ses découvertes magistrales. Un ignorant ne devient pas un inventeur comme le croient certains jeunes hommes trop pressés de produire et de se produire avec éclat. Il faut connaître les lois d'un art intimement, avoir une longue formation scientifique pour se muer en novateur séditieux ou revenir à la simplicité.
Les développements lyriques de Pelléas ne sont pas que d'une technique éblouissante, mais lancés, ramenés, retournés, éployés et liés selon l'inspiration d'un artiste lucide et profond qui sait être, en même temps qu'un théoricien inégalable un psychologue aigu et saisissant. Chaque thème de Pelléas n'est plus la donnée d'un problème, mais l'âme même des personnages, souffrante, haletante, fascinante. En deux ou trois mesures, Claude Debussy plante un décor rare et troublant, restitue une atmosphère. fait éclore ou évoluer un sentiment. Synthèses admirables et longuement étudiées, et qui gardent toutefois, une fraîcheur d'esquisse, une grâce spontanée par quoi, seul, s'exprime le génie.

M. Henri Albers dans le rôle de Golaud (photo Sabourin)
Cette clarté insistante et pure de Pelléas et Mélisande propage une sérénité mystérieuse, recouvre une diffuse profondeur. Là, tout est féérie, rêves scintillants, harmonieuses et tendres hallucinations, magie. L'instrumentation précieuse et estompée a des transparences inouïes, je ne sais quelle translucidité vaporeuse. On dirait d'une eau dormante et qui reflète et agrandit toutes les expressions frissonnantes du drame.
Aucune bassesse d'accent pour appeler l'applaudissement, aucune recherche de l'effet banal. Les contours ne s'arrêtent pas avec une cruauté précise, mais jouent capricieusement, se perdent insensiblement et se retrouvent avec des grâces fantasques, comme par hasard, mais toujours à propos. L'âme humaine a enfin trouvé son langage furtif et suppliant.
Que toutes ces explications me paraissent pauvres et lentes ! Dois-je encore présenter les émouvantes beautés qu'enferme chaque scène de Pelléas et Mélisande ? Rappeler la scène sur la terrasse, le duo au bord de la fontaine, la scène de la chevelure, « la rayonnante ascension musicale » qui vous transporte des angoissants souterrains à la lumière heureuse d'un paysage marin, la pathétique montée du duo du quatrième acte, la mort sublime de Mélisande et toutes les pages de cette partition pour toujours respirante ?

Félix Vieuille dans le rôle d'Arkel
Puissance d'orage qu'a cette musique sur nos sensibilités. Désormais — je le dis sans dessein littéraire — à chaque heure de méditation se lèvent, sur mon passage, les fantômes harmonieux qu'a créés le grand enchanteur. Ils illumineraient la pensée la plus indigente.
Puissent ces quelques mots, infiniment émus, communiquer un peu le ravissement — comme d'un long amour — que j'éprouve lorsque je m'approche du concert de vos voix palpitantes et si étrangement pures. Pelléas, Golaud, Arkel, petit Yniold, Geneviève et Mélisande. Et je me tiendrai pour satisfait.

Mademoiselle Maud Bernard dans le rôle du Petit Yniold (photo Sabourin)
***
Le 12 mai 1902, un acte banal de M. Charles Hess, Madame Dugazon n'eut que quelques représentations éphémères. La Troupe Jolicœur, la comédie musicale en trois actes d'Arthur Coquard, fut créée le 30 mai. Après l'attitude scandaleuse du public, à la répétition générale de Pelléas et Mélisande, le directeur de l'Opéra-Comique décida de ne plus inviter qu'uniquement et personnellement les critiques musicaux. C'est ainsi qu'à la répétition générale de la Troupe Jolicœur on ne vit que quelques critiques. L'ouvrage de Coquard n'en obtint pas davantage de succès. Pourtant certaines pages comme la Fête foraine, la mort de Loustic sont remarquables. Arthur Coquard, wagnérien de tendances, avait écrit une partition trop véhémente peut-être, mais où les thèmes étaient développés, enlacés et repris avec une autorité, une science sonore indiscutables. Dans son ensemble, la Troupe Jolicœur est une œuvre ingénieusement conçue et exécutée. Elle est infiniment supérieure à Paillasse, le drame grossier et burlesque de Leoncavallo et auquel le public immense des illettrés se pâme. On a été fort injuste pour Arthur Coquard, qui était un musicien d'une grande probité artistique et qui put collaborer adroitement avec Edouard Lalo, lorsqu'il s'est agi de terminer, après la mort de l'auteur du Roi d'Ys, la partition de la Jacquerie.
La Carmélite, comédie musicale en quatre actes de M. Reynaldo Hahn fut montée le 16 décembre. Mmes Emma Calvé, Marié de l'Isle, Tournié, Sauvaget, MM. Muratore, Dufranne, Carbonne, Allard, Bourbon, Cazeneuve, étaient chargés des principaux rôles de cet ouvrage où étaient contés les amours de Louis XIV et de Mlle de La Vallière. Le compositeur des Chansons grises avait écrit sur ce livret de Catulle Mendès sa plus importante partition. On connaît son érudition, sa curiosité, son amour des vieux maîtres, son goût délié, ses poétiques inspirations graves ou charmantes. Dans cette musique de la Carmélite tout est disposé avec sagesse et sensibilité. La répétition du ballet de cour, au premier acte, est d'un archaïsme exquis et nous laisse imaginer très précisément ce que devaient être les fêtes données par le grand Roi. Pastiche raffiné et qui tient de la gageure. Vous trouvez, entre autres pages délicates, dans la Carmélite, un duo d'amour et un dernier acte d'un art ingénieux et pénétrant. Pourtant ce sujet, par moments sévère, ne convenait pas tout à fait au mélodieux, gracieux et nostalgique auteur des Etudes latines.
Le 20 janvier 1903, eut lieu la première représentation de Titania, drame musical en trois actes de M. Georges Hüe. Mmes Jeanne Raunay, Marguerite Carré, de Craponne, MM. Maréchal, Allard, Delvoye et la ballerine Jeanne Chasles en étaient les interprètes. Cette œuvre, encore wagnérienne de facture, d'une instrumentation étincelante, d'une riche invention mélodique n'eut pas le sort qu'elle méritait.
Une gracieuse pièce lyrique en 4 actes et 5 tableaux, Muguette d'Edmond Missa, fut créée le 17 mars par MM. Muratore, Fugère, Cazeneuve, Mmes Marie Thiéry, Passama et Pierron. On y entendait, assez habilement orchestrées, d'émouvantes mélodies des Flandres. Le 15 mai suivant, l'une des cantatrices les plus belles et les plus brillantes, Mme Sybil Sanderson, créatrice d'Esclarmonde et de Phryné, mourait brusquement, en pleine jeunesse, des suites d'une grippe. La Petite Maison, opéra-comique en trois actes de M. William Chaumet, fut représenté le 5 juin avec le concours de MM. Fugère, Clément, Delvoye, Mmes Marguerite Carré, Mastio, Tiphaine. Composé suivant la vieille formule, avec un dialogue parlé, des airs, des couplets, cet ouvrage n'eut qu'une carrière éphémère. La Tosca de Giacomo Puccini fit son apparition sur la scène de l'Opéra-Comique, le 13 octobre. Ce drame brutal, dont les épisodes d'un tragique déjà forcé sont encore gonflés et poussés par une musique à gros effets vulgaires, n'obtint pas, tout d'abord, le succès extravagant qui lui est venu aujourd'hui. Mais ses mélodies triviales et artificieuses furent bientôt exécutées par les petits orchestres de cafés et les pianos mécaniques. La foule s'en engoua. A la reprise, la Tosca, lancée par une publicité retentissante, fit des recettes, chaque jour plus importantes.
Le 23 décembre, fut donnée la Reine Fiammette conte lyrique en quatre actes et six tableaux de Xavier Leroux. L'interprétation était assurée par Mmes Mary Gaden, Passama, Tiphaine, Lucy Vauthrin, Pornot, MM. Maréchal, Jean Périer, Allard, Carbonne, Delvoye. M. Paul Vidal avait déjà écrit une musique de scène pour ce drame de Catulle Mendès lorsqu'il fut représenté à l'Odéon. Xavier Leroux, sur ce livret pittoresque et dramatique, composa une partition abondante, mélodique, tantôt langoureuse et prenante, tantôt pathétique et forte. Sans rigueur de système, avec une adresse exceptionnelle, il devait occuper une place importante dans la musique de théâtre. Le lamento de Fiammette et la scène du couvent des Assises, dans la Reine Fiammette sont les pages les plus poétiques et les plus nuancées que Xavier Leroux devait laisser.

Henri Rabaud (photo Sabourin)
La tragédie musicale en quatre actes, la Fille de Roland, de M. Henri Rabaud fut créée le 16 mars 1904, par Mme Marguerite Carré, MM. Léon Beyle, Dufranne, Vieuille. On connaît l'ingrate tragédie d'Henri de Bornier, d'une désarmante et naïve imagination. On peut se demander comment un académicien méconnaissait à tel point la Chanson de Roland, la plus altière de nos épopées. Comment ce poète classiciste a-t-il trahi ainsi l'esprit et l'accent de nos chansons de geste, leur fière simplicité, en nous en offrant un travestissement si incolore, une si piteuse contrefaçon ? Qu'ont à faire ses personnages en carton-pâte, avec les radieux héros de la fable du jongleur ? Rappelez-vous, sous la fastueuse tente de Charlemagne. cette rutilante assemblée de fauves splendides, ces chefs et ces marquis de chevalerie. Ma mémoire ne s'est jamais séparée de cette scène où Ganelon, féal avant que d'être félon, répète avec scrupule et intrépidité, devant Marsile, roi Sarrasin, les ordres de Charlemagne. Henri de Bornier s'est heureusement dispensé de traiter cette scène. M. Henri Rabaud a fait de son mieux pour amplifier l'aride et fade poème et donner quelque noblesse d'âme à ces héros amollis et languissants. Les développements fugués, le récitatif juste et nuancé, les harmonies puissantes, les thèmes mélodiques appuyés et sinueux qui cernent les figures, à la façon du plomb d'un vitrail, ont de quoi retenir l'attention. Il est vrai que l'orientaliste ensoleillé de Mârouf ne s'est pas encore dégagé d'un dogmatisme d'école. Il est prisonnier des formules et des coupes consacrées par les maîtres d'autrefois. La partition de la Fille de Roland est farcie d'exercices académiques, de pages d'anthologie, d'exemples musicaux de fugues et de contrepoints. Par cette sérieuse imitation de l'ancien, M. Henri Rabaud dévoile déjà ses ambitions de professer, ses penchants pédagogiques qui devaient faire de lui bientôt un membre de l'Institut, et un directeur de Conservatoire. Mais ce musicien néo-classique, cet érudit, cet ami indiscret des compositeurs passés est remarquablement digne de prendre la parole sur une grande scène lyrique. Les deux derniers actes de la Fille de Roland, s'ils ne brillent point par l'originalité, atteignent par leur structure et leur fermeté à une véritable grandeur.

décor pour la Fille de Roland
Les chansons de geste furent heureusement, deux mois plus tard, remarquablement comprises par un érudit et un poète véritable, M. Maurice Léna, librettiste incomparable du Jongleur de Notre-Dame, miracle en trois actes de Massenet, créé le 10 mai par MM. Lucien Fugère, Maréchal, Allard, Carbonne, Huberdeau et Billot. M. Maurice Léna, ancien professeur de rhétorique supérieure à Lyon, tout comme son camarade de l'Ecole Normale, M. Joseph Bédier, a fait des études approfondies de nos anciennes littératures. Ce savant médiéviste était doublé d'un poète. Il prit le sujet du Jongleur de Notre-Dame dans un fabliau du XIIIe siècle qu'il transporta au XIVe. Anatole France s'était déjà inspiré de ce fabliau lorsqu’il écrivit un de ses plus délicats contes de l'Etui de Nacre. M. Maurice Léna, inconnu au monde du théâtre, après avoir achevé son livret s'avisa de l'envoyer par la poste à Massenet qui était alors dans toute sa gloire. Le musicien de Manon et de Werther lut d'une traite le manuscrit et répondit à l'écrivain encore obscur qu'il serait heureux d'écrire une partition sur ce livret qui l'enchantait. Massenet mit de côté tous les ouvrages commencés et entreprit la composition du Jongleur de Notre-Dame. Il devait écrire là son chef-d’œuvre.

le Jongleur de Notre-Dame. La leçon de chant
Le poème, si pur et si frais de M. Maurice Léna, mettait en scène un jongleur misérable, recueilli par les moines de l'abbaye de Cluny. Le pauvre hère, ne sachant ni prier, ni glorifier pieusement la Vierge, a l'idée d'exécuter ses acrobaties les plus périlleuses devant la statue divine. La mère de Dieu est touchée par l'humble et étrange offrande. Elle s'anime par miracle et enlève au ciel le jongleur extasié. Sur cette fable fleurie et sacrée, Massenet a établi une partition savoureuse, dépouillée et qui nous offre le plus doux exemple de la piété. Certaines pages comme l'Alleluia du vin, l'entrée de Boniface, la légende de la Sauge, la danse et la transfiguration du jongleur Jean procurent une félicité entière. Elles peuvent plaire à Dieu autant qu'à ses fidèles. Le souvenir de Manon, de Werther, ou de Thaïs s'effacera peut-être un jour. Les suaves accents que Massenet prêta au Jongleur de Notre-Dame et au pieux cortège des moines raviront toujours les esprits et les cœurs.

Lucien Fugère dans le Jongleur de Notre-Dame (photo Paul Berger)
Le 18 janvier 1905 fut représenté, pour la première fois sur la scène de l'Opéra-Comique, Hélène, un poème lyrique en quatre tableaux de Camille Saint-Saëns qu'interprétaient Mmes Garden, Sauvaget et M. Clément. On sait quelle profonde culture classique avait l'auteur de la Jeunesse d'Hercule. Dans Hélène on retrouve le goût qu'il ne cessait de témoigner à la Grèce antique. Ses harmonies pures, les lignes précises et fines de ses dessins mélodiques, la force et la grâce de ses savants développements, remettent dans notre mémoire tout le miracle de l'Hellade.

fac-similé d'un autographe d'Alfred Bruneau
L'Enfant roi, comédie lyrique en cinq actes de M. Alfred Bruneau, fut donné le 3 mars 1905 avec le concours de Mmes Marie Thiéry, Friché, MM. Dufranne, Périer, Vieuille. Œuvre curieuse, d'un naturalisme exaspéré, puissante et mélodieuse (le finale du troisième acte qui se passe au marché aux fleurs de la Madeleine est d'une vigueur, d'une couleur rares) qui ne put triompher de l'hostilité d'un public prévenu. Le premier ouvrage d'un musicien de 22 ans, Gabriel Dupont fut, par contre, accueilli avec enthousiasme. La Cabrera, drame lyrique en deux parties joué le 5 mai par Mmes Gemma Bellincioni, Cocyte, Vauthrin, MM. Clément, Simart, Huberdeau, avait remporté le prix Sonzogno, d'une valeur de cinquante mille francs. Par cette partition fougueuse et véhémente, l'auteur d'Antar et de la Farce du Cuvier s'annonçait comme l'un de nos dramaturges lyriques les mieux doués.
Le 23 mai eut lieu la première représentation de Chérubin, comédie chantée de M. Francis de Croisset, musique de Massenet, interprétée par Mmes Mary Garden, Marguerite Carré, Aline Vallandri, Guionie, MM. Fugère, Allard, Cazeneuve, Chalmin. L'Espagne est évoquée, là, par Massenet avec un esprit désinvolte et léger, en des chants prestes, habiles, sans personnalité, un peu trop rapidement composés.
Le 6 novembre, on assiste à la première représentation de Miarka, comédie musicale en quatre actes et cinq tableaux d'Alexandre Georges. Mmes Héglon, Carré, Pierron, MM. Jean Périer, Lucazeau, Cazeneuve, Huberdeau furent les créateurs des principaux rôles. Le public a retenu de cette partition bien construite des mélodies étranges et mélancoliques déjà éditées sous le titre de Chansons de Miarka.
Il ne me reste à signaler pour l'année 1905, que la Coupe enchantée, en un acte de M. Gabriel Pierné, jouée le 26 décembre et dont on admire encore la langue vive, l'instrumentation colorée et certaines pages finement pastichées, et les Pêcheurs de Saint-Jean, scènes de la vie maritime en quatre actes de M. Charles-Marie Widor, représentés à la même date du 26 décembre, par MM. Salignac, Vieuille, Carbonne, Mmes Claire Friché et Cocyte. L'auteur de Nerto a écrit, là, une grande symphonie maritime avec chœurs. Il lui plaît parfois de donner dans l'archaïsme. Mais il a autant de goût que de culture intellectuelle. Dans les Pêcheurs de Saint-Jean, on aimera, sans doute, une forme d'art traditionnelle, un ordre parfait, la pureté et l'aisance du style et l'on s'arrêtera plus longuement à l'émouvante et large scène de la bénédiction du bateau.

Camille Erlanger (photo Paul Berger)
En 1906, l'Opéra-Comique donne le 27 mars, Aphrodite, pièce musicale en six tableaux de Camille Erlanger. Mmes Mary Garden, Hélène Demellier, Claire Friché, Mathieu-Lutz, Régina Badet, MM. Léon Beyle, Allard, David Devriès, tenaient les principaux rôles. La nouvelle partition de l'auteur du Juif polonais eut un grand retentissement et le succès d'Aphrodite fut, tout de suite, décisif. On pourra attribuer cet engouement brusque du public pour Aphrodite au sujet qui avait été tiré du libre et lumineux roman de M. Pierre Louÿs. La musique d'Erlanger y avait, sans doute une part. L'auteur de Saint-Julien l'Hospitalier venait d'achever une composition, d'une richesse harmonique, d'une technique, d'une puissance et d'un caractère fort au-dessus de ce qu'on entendait habituellement. Pour envelopper tout le drame d'une couleur locale véritable, Camille Erlanger s'est servi des vieux modes grecs. Il a évoqué, avec une grâce nostalgique et précieuse, en des sonorités troublantes, fluides, scintillantes et originales, tout une époque heureuse, voluptueuse et légère de la vie hellénique.

décor pour Aphrodite
Le 12 avril 1906, l'Opéra-Comique crée Marie-Magdeleine, drame sacré en quatre tableaux de Massenet, représenté, 33 ans auparavant au même théâtre, comme oratorio. Les principaux rôles de l'adaptation scénique étaient chantés par Mme Aïno Ackté, MM. Dufranne et Salignac. La partition de Marie-Magdeleine, quoiqu'inférieure à celle au Jongleur de Notre-Dame, renferme des passages de toute beauté comme les chœurs du début, les chœurs féminins de la fête chez Meryem, le tableau du Golgotha, le Pater du deuxième acte, la scène de la Rédemption, la scène de Madeleine entourée des saintes femmes.
M. Henry Février fait le 8 mai, ses débuts au théâtre avec le Roi aveugle, légende scandinave en deux tableaux, œuvre mystérieuse et émouvante. Après un acte gentil d'Edmond Diet, la Revanche d'Iris, représenté le 13 mai, M. Albert Carré monte, le 6 juin, le Clos, opéra-comique en quatre actes de M. Charles Silver, qui avait obtenu le premier grand prix de Rome, en 1891. Avec le Bonhomme Jadis, un acte délicieux de M. Jaques-Dalcroze, l'Opéra-Comique donne le 9 novembre, les Armaillis, légende dramatique en deux actes de M. Gustave Doret. Cette partition dont on a surtout remarqué les admirables chœurs populaires et les danses est d'une tenue, d'une émotion, d'une réflexion qui dénotent un musicien d'une rare et haute qualité. Les Armaillis avaient, comme principaux interprètes, à la création, Mlle Lamare, MM. Dufranne, David Devriès et Cazeneuve. Le 28 décembre, un troisième ouvrage de Giacomo Puccini est représenté, à la salle Favart, Madame Butterfly, que chantaient Mmes Carré, Lamare, Bériza, MM. Clément, Jean Périer, Cazeneuve, Francell. Cette tragédie japonaise en trois actes est aussi pauvre de musique, aussi inélégante d'écriture, aussi fâcheuse d'inspiration que la Tosca.
***

fac-similé d'un autographe de la scène finale d'Ariane et Barbe-Bleue
L'année 1907 est l'une des plus glorieuses de l'Opéra-Comique. Le célèbre musicologue allemand Hugo Riemann pouvait alors écrire : « Je vous dirai que, dans ce moment, l'hégémonie allemande dans la composition musicale, me semble un peu en péril d'être dépossédée par l'étranger et peut-être encore plus par les Français que par les Slaves. » Après avoir joué le 17 avril Circé poème lyrique en trois actes de MM. Paul et Louis Hillemacher, d'une correction toute classique et la Légende du Point d'Argentan, un acte assez ordinaire de Félix Fourdrain, M. Albert Carré fit représenter le 10 mai un conte lyrique en trois actes de M. Maurice Maeterlinck, musique de M. Paul Dukas, avec le concours de Mmes Georgette Leblanc, Hélène Demellier, Thévenet, Brohly, Bakkers, Berg, Régina Badet, MM. Vieuille, Azéma. Ariane et Barbe-Bleue est considéré à juste titre comme l'un des plus hauts chefs-d’œuvre de la musique dramatique. Le livret de M. Maurice Maeterlinck fut publié très peu de temps avant l'exposition de 1900. Il porte bien la marque de l'école symboliste, alors, dans tout son éclat, et dont M. Maurice Maeterlinck était l'un des plus illustres adeptes. En voici brièvement le sujet. Barbe-Bleue n'a pas, comme le dit la légende, assassiné ses femmes. Elles vivent prisonnières dans un souterrain où ne parvient jamais la lumière. Barbe-Bleue vient d'épouser une sixième femme, Ariane. Elle libère les séquestrées. Mais le peuple s'est révolté Il a pris d'assaut le château et blessé Barbe-Bleue. Mélisande, Sélysette, Ygraine, Bellangère et Alladine pansent les plaies de Barbe-Bleue et restent auprès de lui après avoir refusé la délivrance offerte par Ariane. Ariane repartira seule pour la clarté, laissant ses sœurs obstinées, dans l'obscurité, la bassesse, la misère. Il est évident que ce poème abstractif se prêtait assez mal à l'affabulation lyrique. M. Paul Dukas a su pourtant écrire sur ce scénario incolore et vaguement idéaliste, une partition d'une hauteur de pensée, d'une passion intérieure, d'une grandeur et d'une beauté qu'on ne se lasse pas d'admirer. Ariane et Barbe-Bleue constitue peut-être le plus important poème symphonique de la musique française. C'est moins une œuvre de théâtre qu'une vaste pièce d'orchestre, de musique pure.

décor de Lucien Jusseaume pour le 1er acte d'Ariane et Barbe-Bleue
On éprouve une véritable joie à feuilleter la partition d'orchestre d'Ariane et Barbe-Bleue. Aucune autre ne semble plus riche, mieux équilibrée, plus parfaite. Les instruments y sont employés, avec leur couleur exacte, interviennent avec un à-propos infaillible, sont placés avec un art souverain. Le plan, tout classique, a été conçu d'incomparable manière. Construction sonore, d'une amplitude, d'un jaillissement, et d'une pureté, dans sa diversité où s'affirme une maîtrise de très grand architecte, d'artiste profond, de compositeur génialement inspiré. Ces termes ne sont pas excessifs quand il s'agit du musicien de la Péri. Toutes les acquisitions de la musique classique, toutes les trouvailles de la musique moderne sont réunies dans Ariane et Barbe-Bleue. Les nombreux thèmes, grandioses ou émouvants, sont développés, triturés avec une science, une sûreté, une souplesse éblouissantes. Il est difficile de détacher de cet ensemble, si durement cimenté, certains morceaux plus particulièrement saisissants. Mais comment ne pas citer la scène des pierreries du premier acte, l'évocation du printemps par Ariane et tout le finale du second acte, le début du troisième acte, d'une ingéniosité, d'une magnificence, d'une audace orchestrales dont on ne connaît point d'exemples ? Le chant, d'une intensité peut-être trop continue, est toujours expressif, ferme, juste et tout ensemble original. M. Paul Dukas a certes approfondi l'œuvre de Wagner. Mais il applique la méthode leitmotiviste avec tant de nuances, de finesse et d'imagination, il la pare d'inventions poétiques si rares, il manie les timbres avec tant de subtile variété que sa personnalité peut demeurer nette et forte. M. Paul Dukas a mis dix ans pour écrire la partition d'Ariane et Barbe-Bleue qui, auprès de Pelléas et Mélisande et de Pénélope, est l'un des monuments les plus indestructibles de toute la musique française de théâtre.
***

décor pour Fortunio
A Ariane et Barbe-Bleue, succéda, le 5 juin, Fortunio, comédie musicale en cinq actes d'André Messager, qu'interprétèrent Mme Marguerite Carré, MM. Francell, Fugère, Dufranne et Jean Périer. Tout l'esprit délicat, toute la distinction aisée, toute la grâce raffinée de l'auteur de la Basoche se donnent libre cours dans cette partition dont quelques pages comme « la vieille maison grise », « la chanson de Fortunio » (déjà traitée par Offenbach), le duo de Clavaroche et de Jacqueline, l'air mélancolique de Jacqueline sont demeurés célèbres.
Il y a quelques années, Xavier Leroux m'écrivait : « La mission du compositeur ne consiste qu'à rassembler les rythmes ancestraux. Un musicien ne doit s'inspirer que des chants populaires. Il peut les interpréter avec le goût et la science qui lui sont propres ; il a le devoir de les animer, de les affermir, de les répandre. Le rôle du compositeur apparaît ainsi comme un rôle national. » Ce rôle national, Xavier Leroux a cru le tenir en prenant les motifs caractéristiques de folklore bourguignon pour principaux thèmes du Chemineau créé le 6 novembre par Mmes Friché, Cécile Thévenet, Mathieu-Lutz, MM. Dufranne, Jean Périer, Salignac, Vieuille. Un grand succès détermina l'auteur de la Reine Fiammette en faveur de cette manière d'écrire. Son génie expansif et rusé ne se plaisait plus qu'à ces chants de terroir. Le musicien les reliait, les développait et les nuançait avec autant d'ardeur que d'autorité. La prosodie a été frénétiquement accentuée tout comme dans un drame vériste, l'orchestre est entraînant, pressant, heurté, la technique alerte, abondante et robuste. La partition du Chemineau est pleine, en maints endroits, de verve, de malice et de je ne sais quelle bonhomie communicative. Cette musique fruste, directe, sans dessous, entête comme du gros vin âpre. Xavier Leroux sait tracer, à grandes lignes schématiques, les caractères. Les hautes silhouettes de ses personnages, se détachent, bien accusées et noires, sur le fond des paysages. La mélodie longue, constamment au paroxysme, creuse, dans la terre lourde des harmonies, des sillons profonds et parallèlement sinueux, comme à l'aide du soc d'une charrue. Chaque scène, chaque acte, sont découpés puis réunis avec un rare discernement. Les motifs, colorés à gros empâtements, s'éploient, fraternisent, se fragmentent et reviennent à propos et d'après un système où il y a autant d'emportement que de raison. L'ouvrage entier est campé d'aplomb, avec un dogmatisme plein de sécurité. Le musicien répète et force sans cesse les effets. Peut-être a-t-il trop de complaisance aussi pour les unissons, les cadences, les progressions harmoniques, les accords brusquement plaqués. Je n'éprouve pas un goût bien décidé pour des paysanneries lyriques comme le Chemineau. A vous parler naturellement, je préfère relire le dernier acte de la Reine Fiammette, d'une grâce si enveloppante et si pure.

Xavier Leroux (photo Paul Berger)
En 1908, nous assistions, le 26 février à la première représentation de la Habanera, drame lyrique en trois actes d'un jeune musicien de 28 ans, M. Raoul Laparra. Mlle Hélène Demellier, MM. Salignac, Seveilhac et Vieuille en étaient les interprètes principaux. Tout ensemble poète, peintre et musicien, M. Raoul Laparra avait écrit un ouvrage rude, à larges traits, à grosses touches. Nul souci, chez lui, de plaire ni d'étonner. Il s'était raconté en un langage simple, franc. Ami d'une syntaxe traditionnelle, il confessait passionnément sa foi.
L'orchestre de la Habanera ne commente plus, comme dans les ouvrages post-wagnériens, le drame, n'en livre pas au public la signification riche et profonde. Si l'on excepte les préludes assez bien construits, il ne fait office que d'accompagnement, avec une implacable uniformité. Les motifs populaires, les rythmes obstinés, recueillis en Castille, sont confiés, tels quels, aux instruments, dans toute leur rudesse native, dans leur hardiesse canaille. M. Raoul Laparra les répète identiquement et sans cesse au cours de la pièce. De leurs retours obsédants, il tire l'effet voulu. Ainsi crée-t-il le paysage fixe et âpre des hauts-plateaux ibériques, leur atmosphère morne et surchauffée. Décor sonore uni et brûlant sur lequel les personnages et leurs mordantes déclamations se détachent avec une irritante intensité. L'auteur de la Habanera se méfie des développements symphoniques. C'est à dessein qu'il plaque ses harmonies concises, sommaires, crues, comme des touches grasses et vives. Mais le récit musical vibre d'un ton si puissant, se meut d'une marche si impérieuse, qu'on est entraîné irrésistiblement. Quoique musicien de race et en possession d'un métier souple et fort, M. Raoul Laparra, est avant tout, musicien de théâtre. Il n'énonce que l'essentiel, la vérité nue des sentiments et des actions, selon l'expression de Marcel Schwob.
Voici brièvement le. sujet de la Habanera. Dans un village de Castille, jeté comme un foulard bariolé sur l'épaule d'une colline, deux frères, Ramon et Pedro, aiment la même jeune femme, Pilar. Elle est éprise du cadet Pedro. Le jour des épousailles de Pilar et de Pedro, Ramon, dans un accès d'ivresse ou de jalousie, tue son frère, cependant que, sur la place publique, Pilar, insoucieuse, danse une habanera. Personne n'est témoin du crime. Mais cet air de danse ne quittera plus la mémoire du fratricide. La habanera devient, dès lors, en quelque sorte, le personnage principal du drame. Elle étreint l'assassin de sa spirale mélodique comme d'un lasso. Traqué par la habanera, comme par un monstre vaste et aérien, Ramon, au second acte, voit apparaître le fantôme de son frère et, au dernier acte, Pilar expirer. Suffoqué d'épouvante, il s'enfuit, dément. On peut dire que les deux derniers actes se passent dans le cerveau d'une construction bizarre de Ramon. Ce poème étrange qui a je ne sais quoi de cinégraphique, dans sa précipitation et ses outrances, est farci de mots et d'expressions que M. Laparra n'a pas craint d'emprunter directement au dialecte espagnol. On accordera que la littérature, romantique et symboliste, de M. Raoul Laparra n'est pas d'un grain, ni d'un suc délectables. Mais alliée aux rythmes impétueux de la musique, cette rhétorique franco-espagnole acquiert une chaleur, une consolidation merveilleuses. D'ailleurs, toutes les articulations du drame sont liées, avec une magistrale sûreté de main.
Les trois préludes de la Habanera suffiraient à révéler la force pathétique, la qualité supérieure de l'ouvrage. Ils enflent d'un souffle d'orage chacun des actes. Citons, au premier acte, le monologue de Ramon, le chant d'amour de Pedro, les phrases mélodieuses de Pilar au second acte et au début du troisième, la confession de Ramon, au dernier acte. Bien qu'on ait voulu l'apparenter au vérisme italien, dont il n'a ni l'emphase insipide, ni la vulgarité agaçante, le drame lyrique de M. Laparra garde, par sa saisissante couleur locale, son originalité de conception, sa sincérité d'accent, une place à part dans le répertoire de notre deuxième scène lyrique. Cette Habanera n'est, d'un bout à l'autre, qu'un long cri d'angoisse, échappé à un jeune homme, oppressé de fièvre, dans une exaltation créatrice qui a je ne sais quoi de convulsif. Quoique de provenance classique, M. Raoul Laparra a négligé les brillants exercices d'école auxquels auraient pu donner lieu les motifs castillans qu'il a choisis et qu'il répète a satiété, dans leur pureté primitive, dans leur structure et leur fermeté natales. Chacun de ces motifs a une vie qui lui est propre, nettement séparée de celle de ses voisins. Le compositeur les ressasse comme les litanies, comme des formules de magie qui lui permettent d'ensorceler les auditeurs. La densité heureuse, l'équilibre étudié, la sonorité de l'orchestre demeurent incomparables. On peut regretter que le prologue de la Habanera qui n'a d'ailleurs pas été gravé dans les partitions, ait été supprimé aux représentations de la Salle Favart. Ce prologue, publié à part, a été mis à la scène, à Bruxelles. On y voit Ramon consulter une sorcière qui prédit sa destinée au fratricide. Ce tableau est la clef de l'ouvrage et le musicien peut y marquer toute sa tendance, nous livrer tout son évangile secret. Dans cette œuvre qui restera, l'on peut discerner d'autres attraits qui sollicitent notre faveur. La Habanera a mis M. Raoul Laparra au rang qu'il mérite et précisé sa rare et dominatrice personnalité.
***
Snegourotchka, de Rimki-Korsakov, succède le 26 mai, à la Habanera et le 9 décembre a lieu la première représentation d'un drame lyrique en quatre actes de M. Isidore de Lara, Sanga.
En 1909, Solange, opéra-comique en trois actes de M. Gaston Salvayre, est créé le 10 mars, par Mmes Vallandri, Lassalle, MM. Francell, Allard, Cazeneuve. Ouvrage fort adroit, d'une jolie et légère couleur instrumentale, d'une imagination facile et agréablement mélodique. Le 30 octobre, on joue Chiquito, scènes de la vie basque en quatre actes de M. Jean Nouguès et le 8 décembre, après Myrtil, un conte musical honnête et gris en deux parties de M. Ernest Garnier, nous avons la surprise heureuse de la révélation du Cœur du Moulin, poème lyrique en deux actes de M. Maurice Magre, musique de Déodat de Séverac. C'est le seul ouvrage que cet exquis et profond musicien ait donné à l'Opéra-Comique. Et c'est un court chef-d’œuvre qu'on est étonné de ne plus voir figurer sur l'affiche de la Salle Favart. La partition de chant et piano est un enchantement d'un bout à l'autre. Il y a là un sentiment de la nature, une fraîcheur d'inspiration auxquels personne ne restera insensible. Des thèmes d'une finesse et d'une douceur délicieuses jaillissent de toutes parts, comme des eaux pures. Malheureusement, l'orchestration wagnérienne alourdit, par endroits, cette limpide et naïve féérie musicale. Le Cœur du Moulin n'en est pas moins une partition, d'une grâce fluide et où se manifeste formellement le génie d'un musicien français admirablement doué. La disparition prématurée d'un artiste comme Déodat de Séverac est un deuil cruel pour toute notre littérature lyrique.
Le 7 mars 1910, M. Albert Carré monta Léone, opéra-comique en quatre actes de Samuel Rousseau. Mmes Alice Raveau, Nicot-Vauchelet, MM. Sens, Allard, Vaurs en tenaient les principaux rôles. Cette œuvre d'un compositeur classé évoquait, avec un art pénétrant et vif les paysages odorants et le peuple pittoresque de Corse. Samuel Rousseau qui était un musicien docte et laborieux a mené une existence retiré de professeur et d'érudit. Léone dont la partition est remarquablement conçue et exécutée, n'a pu avoir qu'un destin honorable et court, devant le public. Mais les artistes consulteront toujours avec fruit cette œuvre rare et parfaite et seront émus par les pages ardentes et magistrales de la mort de Milia. Samuel Rousseau a transmis à son fils, M. Marcel Samuel-Rousseau, auteur de Tarass-Boulba et du Hulla, ses dons, sa technique et sa foi.
Les musiciens de gai savoir sont rares. Claude Terrasse était le plus heureusement doué d'entre eux. Il s'était assujetti à de nombreuses complaisances pour le public et ses inspirations divertissantes semblaient intarissables. La fécondité de son imagination, la verve alerte de ses rythmes semblaient ne devoir plus s'épuiser. Après avoir publié de nombreuses opérettes riantes et spirituelles, Claude Terrasse fit représenter, sur la scène de l'Opéra-Comique, le 4 mai 1910, le Mariage de Télémaque. Deux écrivains illustres M. Maurice Donnay et Jules Lemaitre en avaient écrit le livret d'une finesse exquise. Certaines pages de la partition du Mariage de Télémaque comme la parodique Marche des Phéaciens ou le Chœur des fileuses sont encore d'un entrain et d'une grâce irrésistibles. Claude Terrasse avait un esprit vif et délié, une générosité toujours en mouvement. Il était, par de certains cotés, un humaniste. Il avait découvert les ancêtres de l'opérette en Lulli, auteur de la musique de Monsieur de Pourceaugnac, en J.-P. Rameau, auteur du chœur des grenouilles, dans Platée, en J.-S. Bach, auteur de la cantate sur l'abus du café, dans le défi de Phébus et de Pan. Ce sont là de nobles aïeux auxquels l'auteur du Mariage de Télémaque ne manquait pas d'ajouter Mozart et Beethoven. Offenbach surtout le transportait d'admiration. Il se croyait sincèrement l'héritier du musicien de la Vie Parisienne. Il n'avait pas tort.

décor pour le Mariage de Télémaque
Le 30 mai 1910, fut donnée la première représentation de On ne badine pas avec l'amour, comédie lyrique en trois actes de M. Gabriel Pierné. On ne s'attendait pas à voir le musicien de l'An mil qui a de la lecture et du monde, s'éprendre d'un livret où serait, mis en vers, le dialogue aérien d'Alfred de Musset. Le libretto ne semblait pas heureux. Mais la musique de M. Gabriel Pierné, si fine et si juste, est d'une distraction, d'une imagination et d'une science exceptionnelles. Doué d'une intelligence et d'un goût extrêmes, le compositeur de la Croisade des Enfants, par un travail opiniâtre, s'est fait un vocabulaire riche et subtil et s'est élevé à une maîtrise d'où n'est point bannie l'originalité. Je n'en veux pour preuve que le finale du premier acte d’On ne badine pas avec l'amour, où, dans la fabrication thématique serrée et la richesse harmonique complexe, on discerne tant d'adresse, de couleur précieuse, de sentiment et d'esprit. L'orchestration d'On ne badine pas avec l'amour est, comme on peut s'en douter, traitée de main de maître.
L'année théâtrale 1910 s'achève par la création de Macbeth, drame lyrique en sept tableaux de M. Edmond Fleg, musique de M. Ernest Bloch. MM. Henri Albers, Vieuille, Féodoroff, Mmes Lucienne Bréval, Lucy Vauthrin et Brohly chantaient les principaux rôles. Verdi avait déjà écrit la musique d'un Macbeth. La partition de M. Ernest Bloch est puissante et âpre et procède de Richard Wagner et de M. Paul Dukas. La fin du premier acte de Macbeth décèle un symphoniste du goût le plus sérieux, d'une dialectique vibrante et hardie.
Le 23 janvier 1911, M. Albert Carré mit en scène l'Ancêtre, drame lyrique en trois actes de Camille Saint-Saëns. L'auteur de Samson et Dalila, sur une intrigue tragique qui se passait en Corse, avait composé une musique, d'une netteté toute classique et lumineuse, d'une technique savante et sèche. Le public n'accueillit pas sans réserves cette œuvre. L'Ancêtre ayant produit les recettes les plus basses de la saison fut bientôt retiré de l'affiche.
M. Georges Clemenceau avait écrit une comédie en un acte, riche d'idées et d'une philosophie finement désabusée, le Voile du bonheur. M. Paul Ferrier s'avisa d'en tirer un scénario lyrique en deux actes. M. Charles Pons fut chargé de la musique. Il s'en acquitta au mieux des intentions des auteurs. Le Voile du bonheur fut donné, sur la scène de l'Opéra-Comique, le 26 avril 1911 et demeura, depuis, au répertoire du théâtre. A la même date, fut créée la Jota, drame lyrique en deux actes de M. Raoul Laparra. Cette œuvre formait le second volet d'un triptyque lyrique, dont la première partie était la Habanera et dont la dernière doit être la Malaguena. La Jota parut une œuvre touffue et d'un métier dramatique incertain. Le premier acte en est pittoresque et attachant. Mais le second acte qui met en scène un épisode violent de la guerre carliste, semblait sombre et ampoulé, bruyant, troublant, accablant. Les spectateurs en gardèrent une impression irritante. La Jota n'est d'aucun rapport avec l'ardente Habanera. Peut-être, lorsque la Malaguena sera achevée, la Jota prendra-t-elle sa signification véritable et sa place exacte dans le triptyque dramatique projeté par M. Raoul Laparra.

Maurice Ravel (photo Paul Berger)
Le 19 mai 1911, on vit pour la première fois, sur la scène de la Salle Favart, Thérèse, drame lyrique en deux actes de Jules Claretie, musique de Massenet et l'Heure espagnole, comédie lyrique en un acte de M. Franc-Nohain, musique de M. Maurice Ravel. La musique de Thérèse, faible, désuète, adroitement composée, ne donnait pas une expression nouvelle au visage de l'auteur du Jongleur de Notre-Dame.
Mais l'Heure espagnole était le premier ouvrage théâtral d'un artiste moderniste et qui avait déjà fait exécuter aux concerts d'admirables compositions, d'un raffinement aigu et d'une originalité tranchante, M. Maurice Ravel. L'auteur de la Rhapsodie espagnole n'avait pas renoncé, en venant au théâtre, à son ironie éveillée, à ses teintes bizarres et charmantes, à sa grâce déliée, pleine de jeunesse et de plaisir. Sur la scène même de l'Opéra-Comique, où tant de défroques lyriques de l'ancien répertoire pendaient encore pour la plus grande joie des illettrés, l'auteur de la Pavane pour une infante défunte, s'amusait, avec un esprit pinçant et vengeur, des vieilles formules de la musique dramatique. Le scénario, leste et agaçant, de M. Franc-Nohain convenait singulièrement à cette critique hardie, en action, des formules flétries et démodées des dramaturges lyriques d'autrefois. Peu d'auditeurs comprirent, d'ailleurs, dans toute sa vivacité, cette satire musicale. M. Maurice Ravel, entouré de quelques amis, s'amusait beaucoup du tour qu'il venait de jouer à nos compositeurs officiels des scènes subventionnées. Mais il n'avait pu faire autrement que d'écrire, pour l'Heure espagnole une partition délicieusement neuve, élégante et ciselée.

décor pour l'Heure espagnole d'après la maquette d'A. Bailly
***
Le 14 décembre 1911, parut une œuvre d'une hauteur de pensée, d'une valeur musicale, d'une probité artistique incomparables : Bérénice, tragédie lyrique en trois actes d'Albéric Magnard. On sait comment ce grand musicien qui était aussi un grand cœur passionné, mourut, en 1914, fusillé par les Allemands. L'émotion que j'ai éprouvée en apprenant cette fin héroïque, n'intervient d'aucune façon dans le jugement que je porte ici sur Bérénice. Comme Wagner, comme M. Vincent d'Indy qui fut le professeur de l'auteur de Guercœur, Albéric Magnard avait écrit, lui-même son livret. « Ce n'est point une nécessité, a écrit justement Racine dans la préface de sa Bérénice, qu'il y ait du sang et des morts dans une tragédie ; il suffit que l'action en soit grande, que les acteurs en soient héroïques, que les passions y soient excitées, et que tout s'y ressente de cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie. » Albéric Magnard a suivi littéralement ces grands préceptes. Il a ajouté, à l'intrigue racinienne, quelques épisodes exotiques. Mais son ouvrage demeure pur et sobre et suivi. M. Adolphe Boschot a très exactement appelé cette partition de Bérénice « une partition de musique de chambre. » L'émotion y est tout intérieure. Malgré la richesse et la puissance de l'orchestration, d'ailleurs établie selon les méthodes bayreuthiennes, malgré la beauté et la curiosité de la mélodie, Bérénice est une œuvre nettement classique. Schumann, Wagner, César Franck et M. Vincent d'Indy furent les maîtres d'Albéric Magnard. A leur lueur, l'auteur de Bérénice s'est créé un style d'une noblesse et d'une solidité indiscutables. Aucune œuvre de notre répertoire lyrique ne porte plus que Bérénice l'empreinte expressive d'une grande âme. On constate avec tristesse que cette partition si forte, si harmonieuse, si virilement pathétique et si ample a disparu de la scène de l'Opéra-Comique. Huit représentations seulement ont été données de Bérénice. Que faut-il donc pour que l'on rende enfin justice à Albéric Magnard ?

décor pour Bérénice
Le 7 février 1912, eut lieu après un procès retentissant, la première représentation de la Lépreuse, tragédie légendaire en trois actes de Henry Bataille, musique de M. Sylvio Lazzari : Mmes Delna, Marguerite Carré, Brohly, MM. Léon Beyle, Vieuille, Azéma en étaient les principaux interprètes.
La ferveur et la décision qui inspirèrent la Lépreuse l'illuminent d'une pâle clarté mystique. Sa masse sombre et ornée, son équilibre, ses arêtes et ses bases sont d'un pieux monument. Chapelle gothique, d'une ample structure, dressée sur la lande bretonne, sous le vent de l'Océan, en plein ciel tragique de Cornouailles. Vous retrouverez là cette méthode de l'architecture du quinzième siècle, les fleurons, les entrelacs, les figures, les symboles et tout l'embellissement sublime des cathédrales ogivales.
Henry Bataille et M. Sylvio Lazzari ont élevé ce sanctuaire avec la foi, la doctrine, la profonde, subtile et railleuse intelligence des maîtres des pierres vives du moyen âge. Rien n'y manque, ni les rampes aériennes, ni les roses flamboyantes, ni cette arithmétique sacrée des nombres, avec leurs multiples et leurs subdivisions, ni même la figure satanique et bestiale qui grimace, répétée aux gargouilles de l'église, et se nomme, dans la Lépreuse, la vieille Tili. Et, comme une arcade jetée d'un pilier à l'autre de la partition. la fatalité domine cet ouvrage de vaste envergure. taillé dans le basalte et le granit.
Dans la préface de la première édition de la Lépreuse, Henry Bataille n'a pas craint de confesser les emprunts textuels qu'il avait faits à la « gwerz » d'un jongleur armoricain du moyen âge.
A l'instar de Philippe de Maizières, Oresme et Raoul de Presles, qui nous ont laissé le Songe du Verger et le Songe du vieux pèlerin, Henry Bataille dont nous n'avons pas oublié le long visage médiéval, émacié, sarcastique et rêveur, nous apporta ce pur et douloureux Songe de la Lépreuse.
C'est là, peut-être, son chef-d'œuvre. Il a retrouvé les couleurs fraîches et fleuries, le dessin mince, dépouillé et primitif des enlumineurs de missels. Il ne s'est point perdu dans le dédale odorant de la forêt de Brocéliande et a échappé au sortilège de Merlin l'enchanteur. Très dévotieux et ingénu comme un jongleur de geste, Henry Bataille a fait offrande, spontanément, en toute franchise de cœur et d'âme. La Lépreuse semble un de ces mystères ineffables avec les signes, les obligations, l'industrie et le rituel de l'époque, et que les confrères de la Passion eussent pu jouer, rue Saint-Denis.

fac-similé d'un autographe de M. Sylvio Lazzari
L'intrigue, dans sa simplicité savoureuse, dans son humanité rustique et rampante, atteint, sans effet apparent, à une grandeur de symbole.
La légende des amours d'Aliette, la lépreuse, et d'Ervoanik, fils du fermier Matelinn et de Maria Kantek, la fileuse, ne s'effacera plus de la mémoire des hommes. Redisons-la, cette fois encore très rapidement, comme une oraison.
Ervoanik aime Aliette, suspecte de lèpre, et veut l'épouser. Les parents s'opposent au mariage.
Ervoanik et sa bien-aimée, les pieds nus, iront, par Plouvern et Morlaix, jusqu'au pardon de Folgoat, demander à Dieu la grâce de « manger dans la même écuelle ». Bientôt fatigués, avant que de poursuivre leur chemin, ils veulent prendre un peu de repos, dans la ferme de la vieille Tili, mère d'Aliette. Tili porte en elle le sang vicié et l'hérédité de tous ses ancêtres ladres et taquins. Elle n'est pas lépreuse confirmée et son visage ancien est indemne des stigmates des caqueux. Elle hait ses voisins et voudrait tous les frapper du mal dont elle souffre, obscurément.
Sa fille, coquette équivoque et étrangement attirante, a déjà contaminé plusieurs amants. Mais, au dernier, qu'elle éloigne de toute contagion, elle désire d'être une sorte d'épouse mystique. Quand ils seront mariés, elle avouera la vérité et ils oublieront... Tili, dont les yeux flamboient de malice, ne l'entend pas ainsi. Elle a de la complaisance et des ressources et persuade à Aliette, par un artifice dramatique, qu'Ervoanik est déjà nanti de femme et d'enfants. Le fermier stupidement envoûté par la vieille, assure la jeune fille dans ce mensonge.
Alors, Aliette, transmet son mal infect au pauvre amant. Ainsi, touchant symbole, s'éploie sur le pauvre monde, par la rancune et l'imposture, toute corruption.
Au retour du pèlerinage Ervoanik est devenu lépreux. Il lui est interdit, à grosses peines, de se mêler à la grande communication des gens sains. A la douleur de sa mère, pris en pitié par ses parents, on le sépare des hommes.
Il ira vivre, non loin d'une fontaine, à distance du village, dans une maison blanche. Aliette, repentante, le suivra dans le silence et la paix du clandy (et non dans la lande, comme on dit, par erreur, dans le texte : clandy signifie, en bas-breton : maison du malade.)
Ce bref résumé ne donne qu'une idée languissante du candide et merveilleux poème d'Henry Bataille, dont chaque sentiment, chaque mot ont été religieusement exhumés de la vie d'autrefois et brillent d'une limpidité mystérieuse et d'une grâce transparente non pareilles.
Au-dessus de ces naïfs personnages qui implorent miséricorde, M. Sylvio Lazzari a bâti une construction sonore d'une amplitude, d'une vigueur d'abstraction et de subtilité, d'une libre raison et d'une poésie qui commandent l'admiration.
Le compositeur de la Lépreuse est, à n'en pas douter, un grand musicien de la lignée wagnérienne. Le souvenir insistant de Parsifal, des Maîtres chanteurs, voire de Tristan et Yseult, apparaît dans sa partition. Mais il s'est dérobé à l'étreinte étouffante du grand Allemand. S'il a appris le métier à Bayreuth, par sa mélodie, par sa déclamation, par la clarté de son expression, par ses rythmes, courts et décidés, il impose sa personnalité.
Au bord de la tristesse immense et murmurante de la mer, sous l'orage et les embruns de l'Océan, il a élevé, seul, les fines colonnettes sculptées et qui supportent la masse énorme de l'église. Resserrant les détails, condensant les idées, il a jeté par-dessus la grêle et profonde action de l'écrivain, le manteau de pierre dentelée d'une cathédrale flamboyante. On découvre même les arcs-boutants de soutien, les béquilles extérieures, trop apparentes, — pour que ne s'affaisse point le gothique édifice.
M. Lazzari n'a pas voulu nous restituer, dans leur pureté natale, les chansons populaires des Bretagnes. Il y eût toujours manqué la basse imposante du flux et du reflux, la pédale grandiose de la mer. Mais il a longtemps vécu en Armor. Il a observé, avec une pénétrante ténacité, les hommes de là-bas, — images si fidèlement revivantes de leurs ancêtres. Il s'est imprégné de leurs chants nostalgiques et désolés. Il a prié sur leurs autels vétustes. Il mime leur passion et la décrit avec une farouche sincérité d'imitation. Ainsi, Saint-François d'Assise bêlait comme un agneau quand il disait « Bethléem », et se pourléchait les babines comme s'il y goûtait du miel lorsqu'il prononçait le nom de Jésus.
La mélodie de M. Sylvio Lazzari suit les sinuosités du rivage d'émeraude. Son récitatif est calqué sur la ligne et les accents du grave et mélancolique patois breton. Chaque scène, chaque acte ont des plans bien cernés, une construction précise et solide. Enfin, le dramaturge développe, avec une main qui jamais ne tremble, tout ce que la chanson populaire de Cornouailles a d'éléments dramatiques.
Les motifs qui nous révèlent chaque personnage, décrivent les variations sentimentales, peignent un paysage ou clament un symbole, ont jailli spontanément du cœur du musicien, avec les ombres, les nuances et la forme du folklore breton.
Dans le recueil de Bourgault-Ducoudray, précédé d'une préface, par ailleurs, du plus haut intérêt, et, qui semble, dans sa monotonie, le plus complet qui ait été publié, on ne saurait découvrir les sources de l'inspiration du compositeur. Sauf le thème de la souffrance d'Aliette, qui rappelle avec assez d'exactitude la curieuse chanson du Roy Loys, tous les autres motifs semblent originaux, voire ceux que le musicien a transformés et instrumentés selon sa propre grammaire d'art.
Ce compositeur post wagnérien n'emploiera-t-il pas, avant l'éclosion du debussysme, certaines formules, comme, à côté de poncives gammes ascendantes, la gamme par tons, formules qui appartiennent désormais à ce même debussysme ? Mais sa partition de la Lépreuse est d'allure et de mouvements nettement classiques.
M. Lazzari donne à entendre, toutefois, même lorsqu’il rend hommage à Beethoven ou Mozart, que ce n'est pas être classique que de le vouloir trop paraître. Il n'est pas l'esclave des coupes désuètes, mais seulement imprégné de l'esprit de tradition.
Quand on considère les lignes savantes, fermes, sans surcharge, de ses dessins mélodiques, on songe à la morsure des traits exécutés au burin. M. Sylvio Lazzari n'a-t-il pas longuement regardé d'Albert Dürer les symboliques gravures de la Mort, et aussi les cruels portraits et la danse macabre d'Holbein ?
Chaque personnage a sa déclamation caractéristique, une rude et tranchante façon de s'exprimer Sur le grisaille et les plaintes mornes du livret, chaque individu projette sa vive lueur.
En tête des actes de la Lépreuse, se placent, non des ouvertures, mais des préludes, qui esquissent le décor, un paysage ou un intérieur, répandent une atmosphère : au premier acte, la nuit finissante et l'aube secrète, puis éclatée, avec les chants des oiseaux, les odeurs réveillées des fleurs, trempées de rosée ; au second acte, la ténébreuse salle de ferme de Tili, pleine de rires hystériques, de menaces bizarres et d'incantations désolées ; au dernier acte, dans d'austères tonalités franckistes, la lande tragique, battue par les gémissements comme par les flots de la tempête.
On éprouvera ce qu'un grand symphoniste comme M. Sylvio Lazzari peut obtenir d'un orchestre de théâtre, devant cette instrumentation de la Lépreuse, nourrie, directe, éclatante, qui fléchit, se déchire, pour laisser s'épancher les voix, et se relève chaque fois, plus bondissante, plus véhémente et plus nombreuse.
Les amateurs de morceaux détachés retiendront, de cette partition classiquement divisible, la douce et claire chanson des lavandières, le départ carillonnant pour le pardon de Folgoat, qui clôt le premier acte et le dernier, l'extatique berceuse d'Aliette, le sarcastique et saisissant monologue de Tili, et surtout la scène du dernier acte, entre Maria et son fils, purement admirable et où l'on retrouve toute la passion de Marie et de Jésus. leur ineffable amour, l'immense et déchirante douleur de la Descente de croix. Il me reste à signaler que sur la demande de M. Sylvio Lazzari, Henry Bataille avait cru devoir changer le dénouement de sa pièce. Sur la scène de l'Œuvre, le fantôme seul d'Aliette apparaissait, devant le regard extasié d'Ervoanik, suppliant, halluciné. Sur la scène de l'Opéra-Comique, Aliette, en chair et en os, miséricordieuse et pardonnée vient chercher le pitoyable exalté.
***
Le 29 février 1912, un épisode lyrique en deux tableaux de M. Georges Loiseau, musique de M. André Fijan, les Fugitifs est joué par Mmes Espinasse, Nelly Martyl, MM. Pasquier, Delvoye. C'est un ouvrage d'un musicien expert et doué pour le théâtre. Signalons la première représentation, le 29 octobre, de la Danseuse de Pompéi, facile opéra-ballet en 5cinq actes et sept tableaux, tiré du roman de Mme Jean Bertheroy par Mme Henry Ferrare et M. Henri Cain, musique de M. Jean Nouguès. Le 18 décembre, Mmes Marthe Chenal, Espinasse, Ninon Vallin, Nelly Martyl, MM. Léon Beyle, Jean Périer, Azéma, Dupré, Vaurs chantent la Sorcière, drame musical en quatre actes et cinq tableaux de Camille Erlanger. La partition de la Sorcière peut être comparée, par la science consommée, l'inspiration originale et la ferveur, à celle d'Aphrodite. Camille Erlanger s'y montre, de nouveau, le parfait symphoniste de théâtre que nous admirions. Le prélude et le duo du second acte de la Sorcière doivent être comptés parmi les morceaux les plus beaux du compositeur du Juif Polonais. Et, sans couleur locale excessive, ni artifices inutiles, l'entrée de la sorcière Zoraya qui s'apprête à cueillir, au clair de lune, les fleurs de ses baumes étranges est une page magistrale de la musique théâtrale française.
En 1913, nous trouvons, le 20 mars, la première représentation du Carillonneur, pièce lyrique en quatre actes et six tableaux, d'après le roman de Rodenbach, par M. Jean Richepin, musique de Xavier Leroux. Les principaux interprètes en étaient Mmes Marguerite Carré, Brohly, MM. Léon Beyle, Boulogne, Vieuille, Vigneau, Vaurs.
Le Carillonneur est un ouvrage touffu où le meilleur côtoie le pire. Très mélodique, très habilement orchestrée, la partition surchargée, débordante, devait être, de l'aveu même de l'auteur, émondée et réduite. Artiste très laborieux, Xavier Leroux avait consacré six ans de sa vie à écrire le Carillonneur dont quelques fragments comme la scène du concours des carillons, au 2e acte (on songe à la scène de concours des Maîtres Chanteurs), le chœur de la fin du 2e acte, l'aveu de Godelieve, au 3e acte, sont d'un grand musicien de théâtre.

Madame Germaine Lubin dans le Pays (photo Sabourin)
Le 16 août 1913, une autre pièce lyrique, magnifique spéculation musicale et littéraire fit son apparition : le Pays, drame lyrique en quatre actes et cinq tableaux de M. Charles Le Goffic, musique de M. J. Guy Ropartz, chanté par Mme G. Lubin, MM. Salignac et Vieuille. C'est une œuvre d'une haute simplicité et d'une austère beauté. Elle n'éloigne que ceux qui aiment médiocrement la musique. Elle nous dédommage de tant de fadaises qu'on nous oblige à entendre. Ne croyez pas que le Pays déborde d'originalité. Au contraire. Le ton y est de bonne compagnie. Aucune curiosité verbale. Aucune singularité harmonique. Dédaigneux des propos alambiqués, les industrieux auteurs du Pays parlent la langue classique. Erudits et sentencieux, ils n'ont pris et suivi qu'un dessein généreusement esthétique. Mais ils avaient quelque chose à dire et n'y ont pas manqué. La grâce volontairement étrange d'un discours ne masque que l'indigence d'une idée. Elle ne lui confère pas la solidité. L'amour du néologisme abuse les modernistes. On n'étonne pas par la délicatesse recherchée et le rare du tour. Qu'importe l'usage des formules ! Une personnalité libre et ferme peut s'exprimer sans bizarrerie. Elle n'y perd rien de sa force ni de son exception. D'autres n'ont que de l'esprit. Les auteurs du Pays n'ont que de la pensée et du sentiment.
M. Charles Le Goffic a tiré le sujet du Pays de l'Irlandaise, l'une des nouvelles que renferme le recueil intitulé Passions celtes. Je rappellerai brièvement l'intrigue. Le pêcheur paimpolais Tual Manohec a fait naufrage en Islande. Il a été rejeté sur la lande boueuse et désertique de Hrafuaga. Tous ses compagnons ont péri. Seul, Tual a été sauvé par le chasseur Jorgen Egilsson. Kaethe la fille de Jorgen, soigne le marin blessé. Les jeunes gens s'aiment et se jurent fidélité. Mais le Breton regrette son pays, où il jouissait de tant d'agréments et de douceurs. Une nuit, délaissant Kaethe qui va bientôt être mère, il s'enfuit à cheval, par la rive fangeuse. Il s'enlise.
La pièce ne comporte que trois personnages, mais vigoureusement campés. La prose poétique de l'auteur de Dixmude est sévère, le réalisme serré, la concision parfaite. De son naturel déterminé ne se dégagent que mieux la passion et la philosophie. C'est proprement un conflit d'âmes. Des abstractions symboliques s'augmentent, par la musique, d'une telle puissance d'évocation qu'elles tiennent, dans le drame, des rôles plus frappants que ceux des êtres vivants. A chaque instant le compositeur trouve des motifs d'inspiration. Le texte rapide et dépouillé peut être allongé par la déclamation lyrique, magnifié par l'orchestre. Jamais il n'y eut plus heureux ajustement entre le poème et la musique. Cette prose exacte et délicatement nuancée convient infiniment mieux à un compositeur qu'un plat poème versifié et artificiellement orné.
M. Guy Ropartz est aussi profond éducateur que musicien. Sa partition pouvait ne sembler qu'une démonstration péremptoire de doctrines inflexibles. Elle est du plus grand style. Elle dénote autant de raison et d'ordre que de chaleur et d'imagination. Sans doute, le compositeur applique le système leitmotiviste wagnérien. Mais il l'adapte assez souplement à son propre tempérament. Quelques jours avant la représentation du Pays, Claude Debussy avait dit : « Si la musique souffre aujourd'hui, c'est parce qu'elle a mal interprété l'idéal wagnérien et a voulu en tirer une formule inacceptable pour notre race. Wagner n'est pas un bon professeur de français. » Après l'audition de l'ouvrage de M. Guy Ropartz, l'auteur de Pelléas et Mélisande, très délicatement voulait paraître répéter ces principes avec moins d'assurance.
On a souvent décrit la Bretagne, et tout le premier M. Guy Ropartz, qui est d'origine armoricaine. Mais jamais peut-être le doux et mystique pays de Cornouailles n'a été célébré avec des accents d'une véhémence mieux soutenue que dans le Pays. Pas un instant, le musicien n'est au-dessous de son sujet. La ferveur du créateur lyrique a été telle qu'il a monté son œuvre à un point suprême d'étendue et d'élévation. Elle s'étend jusqu'aux généralités allégoriques, alors que l'artiste ne désirait que justifier par l'imagination une impression particulière.
Au-dessus de chaque personnage de l'écrivain, le compositeur fait surgir, par ses harmonies, une sorte de vaste ombre sonore, je ne sais quel spacieux fantôme symbolique. MM. Le Goffic et Guy Ropartz sont nés sur la lande bretonne. Le Pays nous semble un beau morceau d'architecture musicale, savamment combiné. Il a dû jaillir pourtant spontanément, d'une double inspiration, sous une poussé héréditaire.
Je ne m'attarderai pas à analyser cette partition. Elle est si clairement conçue et établie que, dès une première audition, l'on peut suivre le cheminement des thèmes, observer leurs luttes émouvantes et leurs transformations, se pénétrer de leur changeante et ardente éloquence. Vous discernerez facilement la qualité des motifs lyriques, seulement à écouter deux d'entre eux qui ouvrent et ferment la partition. Le premier décrit avec intensité la brumeuse Islande, « ses aspects de non-vie, de monde fini ou pas encore créé », comme disait Pierre Loti. Le second, très naïvement populaire, figure la Bretagne hallucinante. Il croise et décroise ses lignes sur tout l'ouvrage. Il est tendu sur le drame comme un filet dans les mailles duquel le héros sera finalement pris. Les autres thèmes ne sont pas moins suggestifs ni moins beaux.
L'orchestration est traitée selon les manières de Franck et de Wagner. Un grand souffle la traverse. Elle souligne violemment les épisodes tragiques, mais suit parfois avec trop d'éclat certaines notations psychologiques. Elle demeure, malgré tout, comme l'une des plus magistrales compositions symphoniques de l'école française par l'amplitude de son plan, par son abondance, par la vertu de son idéalisme.
Ayant à parler de M. Le Goffic, Anatole France nous a rapporté cette confession de M. Quellien, alors lié d'amitié avec le poète d'Amour breton : « Nous autres Bretons, nous aimons que dans un livre il y ait de l'âme. Pour ce qui est du cœur, nous nous en passons. » Je ne connais rien de plus révélateur sur le caractère armoricain que cet aveu. Et dans le Pays aussi, qui sous sa première forme, avait été publié en volume, on ne découvre qu'âme. L'ouvrage tire de là un mérite permanent et absolu. Tout n'y est prétexte qu'à symboles. Symboles sont les personnages. Symbole, l'amour de Tual et de Kaethe. Symbole, la barque à demi construite. Symbole, l'enlisement dans la tourbière. Si noblement abstractive qu'elle semble, l'intrigue reste saisissante. Je pourrais vous énumérer toutes les allusions allégoriques de cet altier ouvrage. Mais ne voulez-vous rien deviner vous-mêmes ?
***
Le 4 juin 1913, autre création importante : Julien, poème lyrique en quatre actes et huit tableaux dont un prologue, de M. Gustave Charpentier qu'interprétaient Mme Marguerite Carré, MM. Rousselière, Boulogne, de Creus, Cazeneuve. Julien est la seconde partie d'une importante trilogie lyrique dont Louise forme la première partie et dont l'Amour au faubourg, que M. Gustave Charpentier nous promet, depuis plusieurs années, sera la dernière. Les réflexions que nous a suggérées Louise peuvent également s'appliquer à Julien. L'idéal sinon le procédé de l'auteur des Impressions d'Italie n'a point changé. Plus que jamais, il s'enferme dans sa philosophie mystico-naturaliste. Son esthétique se montre encore plus sèche et plus nue. Sa manière de mêler le réalisme le plus vif au spiritualisme le plus éthéré y apparaît comme exaspérée. On voit au second tableau de Julien un temple de la Beauté qu'un grand-prêtre à la barbe assyrienne et neigeuse dessert solennellement. Au troisième tableau, qui se passe en Hongrie, l'artiste dialogue avec la Nature, au quatrième, il s'insurge contre la Religion. L'intrigue est, malgré cette mise en scène fastueuse, tout intérieure. M. Gustave Charpentier qui est resté son propre librettiste, décrit les différentes étapes de la sensibilité d'un jeune musicien, d'abord plein de flamme et d'espoir, puis découragé, désœuvré, tombé à la misère physique et morale. Au cours de toute la partition, reviennent les motifs, déjà entendus dans Louise et la Vie du Poète. Tout le tableau de la Fête à Montmartre est extrait de la Vie du Poète. Le troisième tableau, dans la plaine de Hongrie, est entièrement nouveau. Il est, d'ailleurs, d'une simplicité émouvante et d'une force persuasive peu communes. M. Gustave Charpentier y semble toujours le fervent continuateur de Berlioz, de Wagner et de Massenet. La mélodie populaire et vibrante, l'orchestration juste et ferme de Louise se retrouvent dans Julien.
Pour terminer la saison, le directeur de l'Opéra-Comique monte, le 1er décembre Céleste, un drame lyrique en quatre actes et cinq tableaux de M. Emile Trépard, imitateur trop visible de M. Gustave Charpentier.
A la fin de l'année 1913, M. Albert Carré est appelé, comme administrateur, à la Comédie-Française. Il avait amené le théâtre de la place Boieldieu, à une célébrité que tout justifiait. De 1902 à 1909, l'Opéra-Comique n'avait jamais brillé d'un éclat plus vif. A cette époque la troupe permanente de la Salle Favart, qui comprenait des éléments remarquables, était la plus souple, la plus unie, la mieux fondue, la plus savante qu'on eût vue sur une scène lyrique de Paris. Une nouvelle école de chant dramatique y surgissait qui par une méthode noble, pure et réservée, par son style et son goût, allait s'opposer aux façons grossières des chanteurs des autres pays. D'autre part, tous les musiciens importants qui composaient des ouvrages pour le théâtre étaient assurés d'être accueillis à la Salle Favart. M. Albert Carré, pendant cette période, n'a laissé dans l'ombre aucune œuvre musicale de quelque valeur. Dans l'histoire du théâtre lyrique on n'avait pas encore assisté à un effort si patient, si ingénieux et si fécond.
***

les frères Isola
MM. Gheusi, Emile et Vincent Isola prenaient la direction de la Salle Favart, à partir du 1er janvier 1914. M. Gheusi, ancien associé de Pedro Gailhard, à la direction de l'Opéra, avait écrit plusieurs livrets d'ouvrages qui avaient été représentés sur la scène de l'Opéra-Comique : Kermaria, le Juif Polonais, Guernica. L'Opéra et la Comédie-Française avaient également affiché des pièces dont il était l'auteur. Journaliste et romancier de qualité, il s'était lié d'amitié avec Carvalho, Pedro Gailhard et M. Albert Carré. Il avait une connaissance parfaite du théâtre et de la musique. Quant à MM. Emile et Vincent Isola, ils avaient dirigé avec autant d'habileté que de bonheur le théâtre de la Gaîté, où pendant dix ans, ils avaient joué, avec le concours des artistes les plus réputés, le répertoire lyrique.
La nouvelle direction s'annonçait sous d'heureux auspices. Dès le 2 janvier 1914, elle présentait à la presse et au public, un spectacle inédit et qui avait été entièrement préparé par M. Albert Carré, avant son départ. Ce spectacle était composé de Francesca da Rimini, drame lyrique en trois tableaux du musicien transalpin Franco Leoni et de la Vie brève, drame lyrique en deux actes et quatre tableaux du compositeur espagnol Manuel de Falla. Quoique supérieure aux ouvrages du vérisme italien qui nous étaient connus, Francesca da Rimini n'offrait à notre attention rien de curieux, ni de nouveau. Par contre, la Vie brève révélait la personnalité d'un musicien magnifiquement doué, M. Manuel de Falla. Sa courte partition, encore, par endroits, hésitante et conventionnelle, nous remplissait de nostalgie et d'espace. Elle avait une telle puissance d'évocation, tant de jeunesse hardie et de vigueur fascinante qu'elle s'imposait tout de suite à l'admiration des artistes et des auditeurs. Toute l'Espagne, avec ses rythmes lancinants, pressants, les sonorités mates et froissées de ses guitares, ressurgissait, comme dans un songe brutalement coloré. M. Manuel de Falla ne devait pas en rester là. Disciple de Pedrell, de Granados et de Claude Debussy, il devait bientôt prendre la tête de tout le mouvement musical ibérique. Et nous n'oublierons jamais, qu'en pleine guerre, en mars 1918, lorsque mourut le compositeur de Pelléas et Mélisande, M. Manuel de Falla, prit la parole, dans une salle de Madrid et proclama, dans un hommage profond et pathétique, que le plus grand musicien contemporain venait de s'éteindre. Les Allemands qui se croyaient alors victorieux et occupaient l'Espagne de toute leur propagande écoutèrent le dithyrambe avec stupeur. Ils ne l'ont pas encore pardonné à l'auteur de la Vie brève.

décor pour Mârouf
Le 25 février 1914, MM. Gheusi, Emile et Vincent Isola nous conviaient à la première représentation de la Marchande d'allumettes, conte lyrique en trois actes de M. Tiarko Richepin, musicien plein de dons et de fantaisie mais qui se laissait trop souvent aller à une facilité vulgaire. Le 15 mai 1914, Mârouf, opéra-comique en cinq actes de M. Henri Rabaud, fut créé par Mmes Davelli, Tiphaine, MM. Jean Périer, Vieuille, Vigneau, de Creus. C'est une spirituelle et savoureuse turquerie, dont le sujet et l'enluminure verbale ont été empruntés par M. Lucien Népoty aux Contes des Mille et une nuits du docteur Mardrus. Le musicien sévère de la Fille de Roland a su, cette fois, alléger son style, mettre une exquise clarté dans ses harmonies et vivre de toutes les voix de l'orchestre. La partition de Mârouf, savetier du Caire renferme plusieurs motifs puisés aux sources mélodiques de l'Orient et délicatement traités. Elle n'est pas surchargée de pittoresque. Avec un tact singulier, M. Henri Rabaud est resté français de sentiment et de métier. Sa personnalité ne s'est point égarée. On dirait d'un chef militaire français qui nous convie à une riante fête arabe, organisée par ses soins et pour le plaisir de touristes européens. Je voudrais détacher certains passages de cette œuvre que M. Camille Bellaigue a très justement appelée « le dernier sourire de la musique française, avant la guerre ». Mais comment faire ? Tout est, là, d'une perfection si joliment nuancée, d'une verve et d'une facture si aimables ! Et la conclusion de la pièce, par une triomphale fugue finale, est, par l'architecture et le tour, un chœur unique dans notre musique théâtrale. Mârouf, savetier du Caire a pu séduire, tout ensemble, les artistes et le gros public. L'ouvrage de M. Henri Rabaud est celui qui, de toutes les œuvres nouvelles créées depuis dix ans, a réussi avec le plus d'éclat, à la Salle Favart.
***
La guerre éclatait le 2 août 1914 et obligeait l'Opéra-Comique à différer sa réouverture qui, normalement devait avoir lieu, le 1er septembre. De nombreux membres du personnel artistique et administratif étaient mobilisés. Je ne m'attarderai pas à décrire, ici, l'attitude généreuse de ce personnel, pendant ces temps difficiles. Qu'il me soit permis, pour le moins, de déposer une fleur du souvenir sur la tombe de Cazeneuve, mort héroïquement à l'ennemi, à l'âge de 54 ans. Cazeneuve occupait, depuis plus de dix ans, à la Salle Favart, l'emploi des ténors légers et des trials. Il avait fait plusieurs créations importantes. En même temps que chanteur, il était un subtil et divertissant acteur de composition. A la déclaration de guerre, Cazeneuve, âgé de 52 ans, s'engageait dans l'infanterie. Deux ans après, il tombait comme simple soldat, dans les tranchées, enseveli sous l'explosion d'une mine allemande.
La guerre se prolongeait. Le personnel de l'Opéra-Comique non mobilisé, réduit à l'inactivité, était plongé dans la misère. MM. Isola et M. Gheusi (qui était capitaine à l'état-major de la place de Paris), crurent faire œuvre utile en rouvrant la Salle Favart, dès le printemps de 1915. On ne donna, tout d'abord que trois spectacles par semaine. Bientôt, la troupe et l'orchestre purent être reconstitués et les représentations quotidiennes furent reprises. Quelques ouvrages
courts et circonstanciels furent même créés : le 25 décembre 1915, les Cadeaux de Noël, émouvant conte lyrique en un acte de M. Emile Fabre, musique de Xavier Leroux ; le 20 janvier 1916, le Tambour, conte en une scène de M. Saint-Georges de Bouhélier, musique de M. Alfred Bruneau, qui retrouvait là les généreux accents de l'Attaque du Moulin ; le 24 février 1916, Charmante Rosalie, spirituelle opérette en un acte de M. Pierre Veber, musique de M. Henri Hirchmann.
Deux créations d'œuvres marquantes purent être faites au cours de l'année 1916. Le 10 juin, on représenta une Madame Sans-Gêne, en quatre actes, du musicien italien Umberto Giordano. Le 19 décembre, on jouait, pour la première fois les Quatre journées, conte lyrique en quatre actes et cinq tableaux de M. Alfred Bruneau. Cette partition est l'une des plus hautement significatives du musicien de l'Ouragan. Le livret d'un symbolisme profond et nuancé déconcerta le public. Mais la musique forte et expressive de M. Alfred Bruneau fut fort admirée. Le 24 décembre 1917, M. André Messager fit jouer la partition la plus précieuse, la plus frappante qu'il eût écrite : Sœur Béatrice, légende lyrique en quatre actes sur un poème de M. Robert de Flers et G. A. de Caillavet. La personnalité si fine et si prenante d'un musicien de la plus pure tradition française s'y déployait librement. On ne saurait orchestrer avec une délicatesse de touche plus légère, avec une technique plus ingénieuse et mieux appropriée. Dans les circonstances tragiques de la guerre, la légende lyrique de M. André Messager prenait un sens particulier. Elle révélait, mieux qu'aucune œuvre d'art nouvellement produite, tout le fonds rare, subtil et humain de l'âme française. Le 25 janvier 1918, MM. Gheusi et Isola purent monter encore Ping-Sin, un drame lyrique en deux actes, académiquement conçu et écrit par Henri Maréchal et Au beau jardin de France, allégorie dramatique et musicale en un acte de M. Guillot de Saix, musique de M. Francis Casadesus, d'une inspiration fraîche, limpide et pathétique.
Le 20 octobre 1918, M. Albert Carré qui avait quitté ses fonctions d'administrateur de la Comédie-Française pour rester colonel, dans l'armée, était démobilisé. M. Emile Fabre qui remplaçait M. Albert Carré, pendant son absence, au Théâtre-Français, était nommé définitivement administrateur de la Maison de Molière. M. Albert Carré redevenait directeur de l'Opéra-Comique en association avec MM. Emile et Vincent Isola. M. P.-B. Gheusi qui dirigeait, avec la collaboration de M. Isola, la Salle Favart, depuis le 1er janvier 1914, se voyait retirer le privilège, avant son expiration. Quelques jours après survenait l'armistice puis, plus tard, la paix. M. Albert Carré dont la gestion précédente avait été si brillante, reparaissait à la tête de son théâtre préféré. Il allait appliquer, de nouveau, les méthodes qui lui avaient été favorables, pendant près de vingt ans.
***
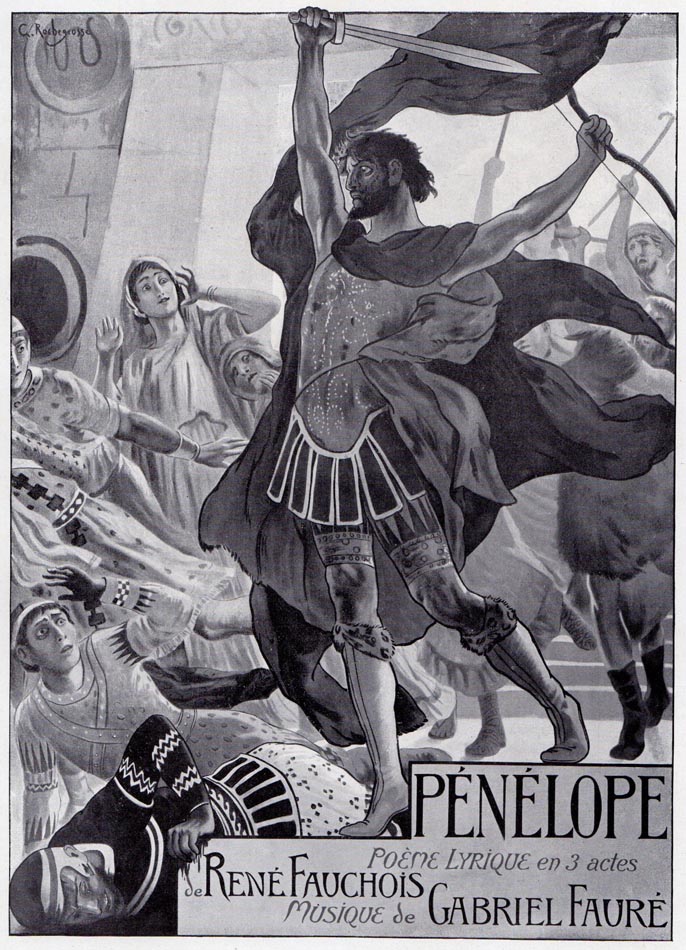
affiche pour Pénélope par Georges Rochegrosse
Après une guerre aussi longue et aussi rude, il était difficile aux directeurs subitement renommés de trouver aussitôt à jouer des ouvrages de valeur. Les compositeurs, pendant la grande crise, n'avaient pas songé, pour la plupart, à travailler pour la scène lyrique. MM. Albert Carré et Isola furent particulièrement bien inspirés en reprenant, dès le 20 janvier 1919, l'un des chefs-d’œuvre les plus purs de la musique : Pénélope, poème lyrique en trois actes de M. René Fauchois, musique de Gabriel Fauré. Pénélope avait été créée au Théâtre des Champs-Elysées, en 1914, par Mlle Lucienne Bréval et M. Lucien Muratore. Mais l'Opéra de l'avenue Montaigne avait cessé, avant même la guerre, ses représentations. Aucun directeur d'une scène lyrique n'avait encore recueilli l'œuvre magnifique de Gabriel Fauré. Le 20 janvier 1919, Pénélope fut chantée, sur la scène de l'Opéra-Comique, par Mlle Germaine Lubin, MM. Rousselière et Vieuille.
L'émouvante reprise de Pénélope que venait de faire l’Opéra-Comique nous était précieuse à plus d'un titre. Créé depuis dix ans, cet ouvrage, écrit dans une haute tension d'âme, fut jugé tout de suite à sa valeur. Critiques, historiens et professeurs en discernèrent, avec conviction et gravité, l'importance et lui fixèrent le premier rang avec une respectueuse certitude.
Sous son noble et intelligent masque classique, Pénélope cachait une force d'originalité profonde et poignante. Gabriel Fauré, insidieusement. avec une violence tout intérieure, portait, d'un seul coup, la musique de théâtre à un point que nul autre dramaturge lyrique n'avait atteint avant lui.
La justesse géométrique de son grand esprit, l'étendue de son érudition, qui voulait toujours sembler aimable, l'incitaient à une composition d'allure et de mouvements traditionnels. Pénélope est conçue, apparemment comme une pièce de musique de chambre dont elle a toutes les rigueurs délicates. Et ces traits familiers, maniés avec une sûreté et une habileté prodigieuses. s'allongent, s'élèvent, se déploient jusqu'à devenir les lignes d'une construction sublime. Soumise aux justes lois, mais libre, elle prend ainsi un caractère de beauté souveraine, encore complètement inconnue dans l'histoire musicale.
Comment, en ce sol fatigué et impur où tant de musiques, d'ambitions modernes éclatent en laideurs brutales, est née cette fleur incomparable ? De quelle source mystérieuse jaillit une mélodie si limpide et si neuve, dont la finesse, l'ondoiement et la splendeur nous ravissent et nous étonnent ? J'essaye de discerner les liens qui unissent Pénélope aux grandes œuvres du passé et ne découvre aucune parenté très affirmée. Mozart ni Beethoven n'eussent écrit cette partition qui a l'intelligence et la beauté des Olympiens. Gluck lui eût prêté une déclamation pompeuse et sans nuances, aucun raffinement sonore. L'auteur d'Orphée eût encore intercalé, dans le drame interrompu un ou deux airs grandiloquents, et Minerve nous serait apparue, glorieusement, pour conduire et dénouer la pièce. Dans Pénélope ne surgissent pas des déesses pour en imposer à l'auditoire. Mais dans la musique de Gabriel Fauré, on trouve assez de prestige et de grandiose simplicité pour que tout s'idéalise et nous transporte en des régions surnaturelles.
Ce chef-d’œuvre d'une jeunesse éternelle et dont la musique, imprégnée d'âme, possède une infaillible efficacité d'évocation mérite une patiente étude. Nos contemporains ont assez de culture pour en distinguer les perfections. Les termes de comparaison à notre disposition nous permettent de la juger et de la situer. On ne nous reprochera pas, plus tard, d'avoir ignoré cette production musicale d'une essence, d'une réflexion, d'un épanouissement uniques et qui nous remplit de plaisir et de respect.
Qu'on ne croie pas à un emballement subit, à une extase forcée et que tout ne justifie point. Revenu d'une frénésie qui m'avait tant agité et d'une imprudente sécurité qui accompagnent toujours la jeunesse, résolu de traiter le musicien à toute rigueur, depuis dix ans, je m'efforce à découvrir une tare, un truquage, une faiblesse dans Pénélope. Quelques esprits lucides et malveillants lisent et relisent la partition. Elle garde, en toutes circonstances son pouvoir suprême, sa grâce perpétuellement fleurie, son olympienne sagesse. C'est toujours le génie et la probité qu'on interroge.
Chaque audition nous fait découvrir quelque beauté insoupçonnée et de nouveaux motifs de nous fortifier dans notre admiration. Les plus timorés peuvent, désormais, faire l'aveu de leur saisissement et de leur gratitude, devant cet art éblouissant et qui a, dans sa finesse achevée, je ne sais quoi de sacré.
J'ai observé Gabriel Fauré à Annecy, dans un décor rêvé pour un musicien touché par la grâce comme l'auteur du Quatuor en sol mineur. On a souvent décrit les heureuses proportions de ce lac d'Annecy. Ses vapeurs bleues adoucissent les brusques contours et les pointes aiguës des montagnes neigeuses. Les couleurs, sans cesse variées, d'un ciel capricieux jouent sur la surface des eaux moirées et changeantes.
Que Gabriel Fauré nous était cher, dans ce paysage choisi et si bien fait pour le révéler ! Ces fléchissements nonchalants à l'horizon, cette tendre clarté brumeuse, ces jardins, ces arbres aux feuillages retombants nous cachaient les plus hauts sommets du continent, cependant si proches. L'été finissant vidait ses corbeilles dans un coin du décor. Les serpentements du rivage et des monts fuyaient et se répondaient comme le chant et l'accompagnement d'une mélodie fauréenne.
Je n'écoute plus une page de l'auteur du Parfum impérissable sans songer à ces amples perspectives, à cette lumière riante de midi.

Mademoiselle Lucienne Bréval, créatrice du rôle de Pénélope (photo Boyer)
Pénélope ne dure que quelques heures : d'un soir azuré à une matinée rougissante de la mer Ionienne. Nous y sommes touchés par la lumière, par la voix de la grâce antique telle qu'on nous la représente. Du mythe ancien, M. René Fauchois n'a pris qu'une situation très simplement émouvante. Aux personnages légendaires, Gabriel Fauré n'a pas craint de prêter la langue savante et nuancée de la musique moderne et des sentiments que l'on sent quand même d'aujourd’hui. Le monde antique des monstres et des dieux n'a pas envahi le poème. La musique seule nous en restitue, en ses rythmes ineffables, le mystère grandiose, le pathétique lointain et ardent.
On connaît assez l'intrigue de Pénélope empruntée par M. René Fauchois aux derniers chants de l'Odyssée. Qu'on me permette de la rappeler brièvement, afin de désigner les épisodes qui ont servi à l'élaboration de la pièce lyrique.
Ulysse est revenu, dans Ithaque, sous l'aspect d'un vieillard indigent et arqué de fatigue. D'injurieux prétendants occupent son palais et se sont emparés des richesses royales. Chacun d'entre eux a la secrète ambition d'épouser la vertueuse Pénélope. Après avoir attendu, durant dix longues années, le retour du vainqueur de Troie, la reine douloureuse va être contrainte de prendre un parti.
Pénélope n'a pas reconnu Ulysse en ce mendiant timide. Seule, sa nourrice l'identifie. Il se révèle à ses pâtres et au vieux berger Eumée, mais leur recommande de garder le secret et de servir sa vengeance. L'ingénieux roi conseille à Pénélope de choisir pour époux celui des prétendants qui parviendrait à tendre le grand arc d'Ulysse. Aucun n'y arrive. Aux risées de l'assemblée, le souverain déguisé en vagabond dépose la besace et le bâton à terre et tente à son tour l'épreuve. Il bande l'arme redoutable et aidé de ses serviteurs, massacre les princes voleurs. Ulysse et Pénélope régneront de nouveau sur le royaume pacifié d'Ithaque.
M. René Fauchois nous a conté la légende homérique sans pédanterie ni hardiesse. Il a laissé au musicien le soin d'évoquer comme il souhaitait les héros de la fable antique. Il a bien fait. Par le génie du compositeur chaque mot rayonne, chaque vers dégage une éblouissante clarté.
On a dit, non sans perspicacité, que cette partition de Pénélope était racinienne. N'est-il pas piquant de voir que M. Fauchois, qui s'était déclaré autrefois, publiquement l'ennemi irréductible de l'auteur de Phèdre a justement fourni le prétexte d'un ouvrage qui rappelle si bien la manière du grand dramaturge classique ?
Les captivantes mélodies de Gabriel Fauré semblent avoir, dans leurs plus expansifs tourments, le sourire nerveux et secret des figures de Léonard de Vinci. On a cru longtemps, malgré Caligula et Prométhée que l'auteur du Soir n'était qu'un musicien d'intimité et que sa verve, sa tendresse, ses nostalgies fuyantes perdraient de leur charme à la lumière crue des rampes. Bien au contraire, ses rythmes de grâce et d'amour suivent tous les désirs de l'esprit. Au théâtre, ils trouvent une atmosphère singulièrement propice à leur diffusion et leur primauté.
Onze ans ont passé depuis la création de Pénélope. C'est beaucoup pour une œuvre lyrique. Les grandes scènes pastorales et guerrières du poème chanté ont pris leurs amples proportions véritables. Pénélope est désormais classée comme un chef-d’œuvre national. Comme l'Odyssée, d'où elle est issue, elle paraît une grande œuvre collective. Voilà l'image resplendissante de l'âme française, le faisceau de ses doctrines artistiques, la synthèse de ses plus nobles aspirations.

décor de Roussel pour le premier acte de Pénélope
A ce sujet archaïque, Gabriel Fauré, par une divination singulière a conféré une force héroïque et une fine variété modernes. Son fabuleux Ulysse peut aussi bien être un soldat d'hier et qui rentre en son foyer, envahi par les prétendants... Un point d'humanité, un fait général sont scellés ici. Le conte est fait avec des harmonies si spécieuses et si dépouillées qu'il semblera toujours d'actualité.
Bien qu'il ait remis en honneur le mode hypolydien le musicien de Pénélope a rejeté tout pittoresque extérieur, tout mesquin souci de documentation. On peut affirmer que sa couleur locale n'est que psychologique. Il ne pousse pas les sentiments à l'excès et spiritualise, pour ainsi dire, jusqu'aux passions les plus fortes. Il sait faire de la beauté et de la grâce sans emphase ni orgueil. Sous des apparences vivantes et simples, il allie, en ses fières et libres constructions, la pureté classique à la plus féconde audace novatrice. Les habitudes de bon ton et de discrétion ne l'abandonnent jamais. Humaniste inventif et éclairé, autant par malice que par goût, il pousse toujours plus loin les théories, après en avoir épuisé toutes les finesses.
En ses raffinements harmoniques, il se laisse aller comme à des étourdissements rapides et très doux afin de détourner, d'interrompre ou de contrarier le plaisir que nous en attendons. A l'exemple d'Ulysse, son héros de prédilection, il a la grâce, la ruse et la force.
Les fameux enchaînements fauréens, ses intarissables modulations sont d'une prestesse imprévue, d'une particularité et d'une imagination stupéfiantes. Ce grand musicien fantasque ne suit pas résolument un chemin tonal. Il penche toujours légèrement à droite ou à gauche, s'engage sur des sentiers à peine tracés, disparaît dans un buisson pour revenir sur la grand’ route dans le moment qu'on l'y attend le moins. Il n'est jamais aussi complexe que lorsqu'il veut paraître simple. Son délire poétique, son ivresse délicieuse procurent aux plus blasés mille possibilités d'émotion et de joie.
Son style, aussi large que savoureux, porte l'empreinte profonde de sa personnalité absorbante. Mais Gabriel Fauré ne chante que selon notre cœur. Il a un sens si impérieux et si subtil de la phrase française et de ses valeurs que ceux qui ignorent notre langue resteront toujours un peu étrangers à cet art extrême, venu des profondeurs et qui réveille tant de choses évanouies en notre âme.
Pénélope repose sur deux fondements essentiels : deux thèmes très courts, l'un douloureux — celui de Pénélope — l'autre héroïque — celui d'Ulysse. Par des développements d'une ingéniosité inouïe, nullement menés selon la méthode wagnérienne, mais strictement adaptés aux situations du drame et à ses nécessités psychologiques, l'admirable compositeur tire toute la substance musicale d'une des œuvres les plus hautes et les plus riches qu'on ait entendues — œuvre proprement unique dans toute la littérature sonore.
Semblables aux flammes ailées qui tendent toujours vers le haut, ces motifs sont agités d'un mouvement incessant et divers. Ils se heurtent, s'enlacent, se repoussent et se confondent pour former par le jeu de leurs combinaisons, les éléments les plus inédits, les plus pénétrants, les plus étendus d'une partition exquise et merveilleuse. Il y a là un trésor inépuisable d'idées mélodiques, aussi bien dans le chant des personnages que dans le ramage des instruments. L'orchestre est un orchestre ordinaire de concert qui, dans une succession de beautés toujours plus grandes et plus neuves, a des accents sinueux aussi profonds que la voix humaine. Cette dernière elle-même ne se perd jamais dans l'orage instrumental et demeure toujours perceptible. Fixe unité, équilibre précieux que rien ne peut briser.
Les teintes orchestrales sont à peine indiquées et transparentes, dans la profusion des tracés contrapuntiques. Le docteur Magnus et Jules Soury n'affirmaient-ils pas que les primitifs héros d'Homère ne pouvaient distinguer les couleurs ? Je crois lire, dans ce parti pris contrapuntique, que Gabriel Fauré a davantage voulu nous donner l'illusion de la sculpture que de la peinture. Ces frises musicales de Pénélope m'enchantent. Oserai-je dire qu'elles procurent, dans leurs richesses, l'idée transposée de ce que pouvaient être ces nombreuses statues d'ivoire, d'argent et d'or, dues à Phidias et Praxitèle et qu'on n'a jamais retrouvées ?
Entre toutes ces pages d'une brûlante ferveur, circulent des souffles d'air hellénique, les brises odorantes de la mer porteuse de vaisseaux. La douleur vertueuse de Pénélope (selon l'expression de Boileau), la colère héroïque d'Ulysse s'épanchent avec de véridiques et irrésistibles accents, parmi les mélodies insaisissables comme de fuyantes nymphes. Ces rythmes convergents si nobles et si purs s'assemblent aux finales de chaque acte, dont les dernières mesures éclatantes et robustes nous pénètrent du sentiment magnifique de la beauté antique. Et lorsque l'ingénieux et magistral récit lyrique s'achève dans la tonalité sereine d'ut majeur qui a la blancheur du marbre, le musicien jette sur toute la fable ses suprêmes sonorités triomphales comme un manteau de lumière.

Gabriel Fauré (photo Sabourin)
Pénélope occupera plus tard les songes des humains pleins de bienveillance et de sagesse. A moi-même, elle a procuré des rêveries délicates, d'heureuses hallucinations au bord des rivages ioniens, si puissamment évoqués. Dans l'air doux et blond de l'Hellade me sont encore apparus, grâce à ces sonorités magiques, les majestueux monuments, les statues divines, et j'ai admiré de nouveau, l'audace farouche des guerriers antiques et la beauté sérieuse et ingénue de leurs femmes.
Il est des temps où le fait d'avoir du génie se paie si chèrement qu'on voudrait pouvoir y renoncer. Mais la réputation affichée il faut la soutenir. Il me semble que le grand musicien de Pénélope n'y cédait qu'à regret. Cependant, nous ne voulons pas attendre plus longtemps pour le mettre à la place qui lui est due. Puissent ces lignes rapides et ferventes révéler quelque chose de notre vénération et de notre reconnaissance et faire entendre que ces sublimes efforts n'auront pas été vains.
Je m'étais en commençant, proposé d'écrire une analyse minutieuse de Pénélope. Mais les trouvailles harmoniques, les idées, les sentiments, les formes y sont si abondants, qu'un fort volume n'en contiendrait pas toute l'énumération. En relisant cette partition, d'une si inflexible unité, jaillie tout armée d'un cerveau olympien, j'ai compris l'inutilité de ma tâche.
***
Après une reprise éphémère le 19 juin 1919 de la Fille de Madame Angot, l'opérette en trois actes de Charles Lecocq qui parut déplacée, sur la scène de l'Opéra-Comique, eut lieu la première représentation de Gismonda, drame lyrique en trois actes et quatre tableaux de M. Henry Février, ouvrage d'inspiration vériste, très théâtral, et écrit pour plaire au grand public.
Le 12 janvier 1920, MM. Carré et Isola montèrent la Rôtisserie de la Reine Pédauque, comédie lyrique en quatre actes et cinq tableaux, d'après Anatole France, par M. Georges Docquois, musique de M. Charles Levadé. Cette œuvre, attendue depuis vingt ans, n'a pas déçu les espoirs qu'on fondait sur elle. On y découvre maintes pages comme le début du second acte, le troisième acte, la mort de Jérôme Coignard, d'une exquise fraîcheur, d'une verve preste et d'un sentiment très prenant. A sa technique remarquable M. Charles Levadé joint une richesse mélodique très réelle et très attachante.

décor pour Masques et Bergamasques
Le public de la Salle Favart était habitué à de longs spectacles. Malgré la beauté de Pénélope, le chef-d’œuvre de M. Gabriel Fauré sembla trop court pour tenir toute une soirée. Le 4 mars 1920, on ajouta à Pénélope, Masques et Bergamasques, poème dansé en un acte de M. René Fauchois, musique de Gabriel Fauré. C'est une spirituelle et nostalgique comédie verlainienne composée de plusieurs morceaux déjà publiés par l'éminent compositeur. On y réentend les deux mélodies célèbres : le Clair de lune et le Plus doux chemin et la Pavane. La brève ouverture de Masques et Bergamasques est, seule, inédite. Mais elle est d'une facture, d'un charme et d'une élégance incomparables. A la fois moderne et très classique, elle remplit l'âme de rêve et de bonheur. Preste et légère d'apparence, elle est d'une émotion si profonde et si pure que plusieurs critiques ont rapproché, cette fois et très justement le nom de Gabriel Fauré de celui de Mozart.

décor pour le deuxième acte du Sauteriot
Le Sauteriot, drame lyrique en trois actes et quatre tableaux de MM. Henri-Pierre Roché et Martial Périer, musique de M. Sylvio Lazzari fut joué, pour la première fois, le 8 avril 1920, par Mmes Yvonne Brothier, Alice Raveau, MM. Lapelletrie, Azéma, Cazette. L'auteur de la Lépreuse apportait un nouvel ouvrage sévère et puissant, d'une admirable tenue mélodique et instrumentale. Le livret était écrit dans une langue poétique raffinée mais ne parut pas d'un métier théâtral — peut-être volontairement, — assez poussé. M. Sylvio Lazzari y trouva pourtant prétexte à une composition musicale d'un ordre et d'une richesse indiscutables. Le musicien de la Lépreuse s'est imposé, avec le Sauteriot, comme le continuateur le plus attirant, le plus franc, du système wagnérien. A cet égard, le premier acte et de dernier du Sauteriot sont de la main d'un maître de la symphonie.
Lorenzaccio, drame lyrique en quatre actes et onze tableaux de M. Ernest Moret, d'une technique non moins habile que celle de M. Sylvio Lazzari, fut créé le 19 mai 1920, par MM. Vanni-Marcoux, Lapelletrie, Vieuille, Cazette et Mme Hilda-Roosevelt. La partition de Lorenzaccio était dédiée à Massenet, dont M. Ernest Moret avait été le disciple et l'ami. Œuvre de grande réflexion, méthodique, luxueuse et damasquinée comme une arme princière du XVIe siècle. M. Ernest Moret avait scrupuleusement respecté le texte d'Alfred de Musset. L'auteur des Nuits avait, pour ainsi dire, transmis sa passion au musicien. Toutes les images poétiques de Musset trouvaient là une traduction sonore puissante, bien équilibrée, profondément étudiée.
Sur un délicieux livret de M. Maurice Donnay, M. Alfred Bruneau composa le Roi Candaule, comédie lyrique en cinq actes, chantée, le 1er décembre 1920, par Mlle Marthe Chenal, MM. Jean Périer, Panzéra. Le grand musicien du Rêve s'y essayait à un genre plus léger, mais encore nouveau pour lui. Il y réussissait non sans éclat.
La première représentation de Forfaiture, drame lyrique en cinq épisodes, d'après un film célèbre, de Camille Erlanger, donnée le 11 février 1921, marque une date fâcheuse pour la mémoire du compositeur d'Aphrodite. Forfaiture n'eut que deux représentations. Camille Erlanger avait laissé, inachevée, cette partition. Un musicien belge se chargea de la terminer et de l'orchestrer. L'entreprise fut loin d'être heureuse.
Le 28 juin 1921, M. Jean Huré, musicien d'une haute probité, faisait représenter Au bois sacré, ballet en un acte et le 11 octobre de la même année M. Marc Delmas qui venait d'obtenir le premier grand prix de Rome donnait Camille, opéra-comique en un acte.
Dans l'ombre de la Cathédrale, drame lyrique en trois actes de M. Maurice Léna, Mme Henry Ferrare, d'après B. Ibanez, musique de M. Georges Hüe, créé le 7 décembre 1921 par Mme Davelli, MM. Charles Friant et Vieuille, célèbre l'Espagne mystique et ténébreuse. M. Maurice Léna et Mme Henry Ferrare ont trouvé à traiter, dans le roman de M. Blasco Ibanez, le plus curieux sujet lyrique dont puissent s'amuser les esprits d'aujourd’hui : le conflit du socialisme et du catholicisme. C'est le brûlant dessein que les auteurs ont pris et suivi. Le poète du Jongleur de Notre-Dame a écrit le livret de Dans l'Ombre de la Cathédrale, sans naturalisme doctrinaire, mais avec une noble pudeur, une grâce précieuse, une impartialité émouvante. Il n'a pas craint de citer, au cours du drame, certains principes du socialisme, dans leur texte officiel. Chrétien fervent, il a su d'autre part, glorifier la religion dans laquelle il est né. On ne peut avoir plus de tact ni de mesure. La partition dont M. Georges Hüe a orné le poème est la plus riche, la plus nerveuse, la plus rapide qu'il eut encore conçue pour le théâtre. Un aquafortiste comme Goya, s'il avait été musicien, nous eût donné de telles compositions saisissantes et raffinées. Qu'on relise seulement, au premier acte, les pages du cortège des mendiants. M. Georges Hüe décrit, à l'orchestre, les gueux hispaniques, avec une subtilité mordante, un pittoresque étudié, une éloquence abrégée qu'un musicien peut rarement réunir. Le second acte de Dans l'Ombre de la Cathédrale est pathétique, sobre et humain. Et le troisième acte témoigne d'une grandeur véritable. Les politiciens fiévreux et les amateurs de musique trouvèrent également de quoi contenter leur curiosité aux représentations de Dans l'Ombre de la Cathédrale.
Un musicien américain, M. Blair Fairchild, déjà connu pour d'exquises mélodies et de remarquables pièces de concert faisait ses débuts sur la scène de l'Opéra-Comique, le 7 décembre 1921, avec Dame Libellule, ballet-pantomime en un acte, dont le livret était de M. Georges Lemierre. Une personnalité fine et prenante se révélait dans ce court ouvrage, écrit sous les ombrages debussystes. La partition de Dame Libellule aussi spirituelle qu'expressive, aussi leste que subtile s'apparente à un délicat chef-d’œuvre de Claude Debussy, Jeux. M. Blair Fairchild y faisait preuve, déjà, d'une maîtrise incontestable, d'une sensibilité vive et précieusement nuancée.
Les Noces Corinthiennes, tragédie lyrique en trois actes et un prologue de M. Anatole France, musique de M. Henri Büsser, furent jouées le 10 mai 1922 par Mmes Yvonne Gall, Lyse Charny, MM. Trantoul, Vieuille, Azéma. Le poème, publié en 1876, par Anatole France, n'était pas destiné à la scène. Toutefois. M. Bergeret autorisa les représentations qui en furent faites, à l'Odéon, avec une musique de scène de M. Henri Büsser, et enfin l'adaptation lyrique qu'en donna la Salle Favart.
L'intrigue des Noces Corinthiennes est connue. Goethe la développa en sa célèbre ballade : les Fiancés de Corinthe. Elle servit à Catulle Mendès et Ephraïm Mikaël pour élaborer un puissant et pénétrant livret en trois actes, intitulé Briséis, dont Emmanuel Chabrier, mort trop tôt et en pleine maîtrise, ne put achever que le premier acte.
Lorsque Anatole France écrit, on l'entend, pour ainsi dire chanter. Dans leur pureté, leur nudité lumineuse, les vers des Noces Corinthiennes avaient, semblait-il, assez de musique. Chaque expression, choisie avec un goût infaillible et d'une concision parfaitement cadencée, brillait comme une fleur toujours fraîche et claire, avec un sens juste et plein que le zèle, même très pieux, d'un musicien ne pouvait qu'alourdir et ternir.
Tout le miracle grec, aimé de Renan, était enfermé dans ce poème comme en un flacon de cristal. Ainsi que Pallas Chryséléphantine nous révèle l'Acropole, les Noces Corinthiennes racontent toute l'Hellade, Apollon à la lyre d'or y paraissait dans toute sa gloire. Quel mortel audacieux pouvait risquer de se mêler au chant divin, de le transformer, l'exagérer, l'accroître ? Le sort de Marsyas n'a pas fait reculer l'intrépide compositeur de Colomba. Il s'est lancé dans la périlleuse entreprise. Il n'a pas été dévoré.
Les personnages des Noces Corinthiennes, suspendus entre le monde réel et le monde idéal, ne sont que des symboles très nettement apparents. Les idées y étreignent les sentiments et l'on comprend que les sentiments n'y sont qu'en guise d'idées. On entend, dans les seuls vers d'Anatole France, tous les rossignols mélodieux de Sophocle, parmi les oliviers au feuillage azuré. Que pouvait-on ajouter au fabuleux ramage ?
M. Henri Büsser n'est pas de ces musiciens passionnés qui manient leur art avec un violent parti pris. Humaniste de la musique, bel esprit, heureux de son discernement, il est toujours occupé du soin de nous plaire. On ne peut que lui savoir bon gré d'avoir élevé, autour du poème d'Anatole France, une construction sonore aussi juste en ses proportions et qui découpe l'azur profond de lignes si harmonieuses.
Par la réflexion et l'étude, M. Henri Büsser s'est fait des goûts délicats. Son langage est châtié, poli. Le talent surabonde dans sa partition érudite, sensée, pas trop curieuse. Qu'il s'exprime bien ! Quels séduisants propos ! On ne peut souhaiter plus d'élégance mondaine.
Toutes les formules consacrées par les maîtres sont connues de l'éclectique musicien des Noces Corinthiennes. Admirons son purisme et son dilettantisme. Des successions d'accords de quarte, de sixte et des successions de quintes, des enchaînements d'accords de septième renversés nous font croire qu'il apprécie le raffinement et la licence de la musique moderne.
Il veut s'imposer à force d'agréments et d'excitations. Sa muse, ou si vous préférez sa musique, qu'effleure le plaisir est toujours équipée en conquête, parée de voiles aux coloris légers et pomponnée de rubans. Si le charme pittoresque de la forme ne recouvre pas toujours la facilité de la pensée, il faut convenir que, par toutes les grâces dont il orne les douleurs, par sa coquetterie de lettré, sa science d'imitation pleine de respect et d'art, M. Henri Büsser était merveilleusement préparé pour pénétrer les textes d'Anatole France et de s'en inspirer.
L'orchestration, d'une savante curiosité, d'une densité exquise et brillante, est supérieurement traitée. Délicatement ouvragée, elle entoure l'œuvre comme d'une frise de figurines qui courent et jouent sur le rebord du drame. Chaque thème peut déployer ses claires sinuosités, que l'on suit ainsi que les allées d'un jardin bien tracé. D'un équilibre soutenu, sans forcer le ton, cette instrumentation tourne autour des trois actes en belle procession. Elle est légère et diaphane comme le ciel bleu de l'Attique. Voici la brise odorante et fraîche de la mer, le murmure des sources et le frissonnement du feuillage des hauts platanes parés de roses grimpantes. Il n'y manque que cette négligence spirituelle que l'on découvre chez les plus grands poètes grecs, — et même chez Anatole France, — et leur bonhomie, leur simplicité rustique. Homère ne nous dit-il pas qu'Achille chantait, tout en faisant cuire un gigot de mouton dans sa marmite ?
***
Le 6 novembre 1922, fut donnée la première représentation de les Uns et les Autres, comédie lyrique en un acte sur un texte de Paul Verlaine, musique de M. Max d'Ollone. Le compositeur du Retour semblait y avoir convoqué, une nuit, à sa table de travail, les ombres illustres de musiciens défunts comme Gluck, Rameau, Couperin, Meyerbeer, Gounod, Wagner, Massenet, Debussy et même le plus grand de nos artistes français, Gabriel Fauré. Ils répondirent à l'appel de leur laborieux confrère. Chacun murmura son avis. Est-ce à dire que la partition des Uns des Autres n'est qu'un pot-pourri ? Loin de là. Ces exhortations des maîtres de M. Max d'Ollone se sont merveilleusement fondues dans une orchestration, en sourdine, d'un charme fluide et prenant. L'auteur des Amants de Rimini est un savant assembleur de rythmes câlins et frôlés. Son instrumentation légère, d'une précieuse technique, bruit comme l'eau argentine d'une source, s'épand comme la fine odeur des arbres.
Le même jour, un véritable opéra bouffe italien en un acte de Puccini fut représenté : Gianni Schicchi. Si l'on compare cet ouvrage aux célèbres partitions gaies de la Péninsule, on trouvera qu'il est d'une qualité assez médiocre. Mais l'auteur de la Vie de Bohème a le don indiscutable du théâtre, de la rapidité scénique. Dans Gianni Schicchi, tout en s'attardant encore à de fades romances, il a renoncé à son habituelle redondance. Il paraît avoir retrouvé, dans ses hérédités, l'allégresse bondissante, la riante folie des rythmes anciens de l'Italie.
Quand la cloche sonnera, drame lyrique en un acte, était la troisième et plus importante œuvre, créée le 6 novembre 1922. Mme Balguerie, MM. Lapelletrie et Lafont en étaient les interprètes.
L'exécution de Quand la cloche sonnera ne dure pas moins d'une heure et demie. Mais, à aucun instant, l'intérêt musical ne faiblit. Chaque moment est un moment d'intelligence, d'art et de pensée.
M. Alfred Bachelet semble avoir été fortement pris par la Salomé et l'Elektra de M. Richard Strauss. Mais par sa façon de traiter les thèmes principaux, voire les dessins secondaires, par sa spontanéité savoureuse, la dureté de son expression, notre compatriote se sépare nettement du maître allemand. Son œuvre, d'une abondance et d'une richesse inépuisables, garde une puissance, une plénitude, une clarté, vraiment françaises. Sa personnalité demeure farouche, tranchante, jamais en défaut.
L'auteur de Scemo n'enchevêtre pas inutilement les thèmes, qu'il présente avec une franchise, une audace déconcertantes. Chacun de ces thèmes reste lumineux, d'un tracé souple, ferme, facilement poursuivi. Pas une mesure qui ne soit à sa place. Les pierres colorées et innombrables de la mosaïque ont été posées avec une certitude infaillible.
Chose étrange, le compositeur s'est si bien imprégné des mélodies slaves qu'il semble avoir écrit sa musique sur un texte russe. Sa déclamation peut paraître singulière. Elle est justifiée. Ses ondulations, ses bonds d'octaves, rappellent le parler chantant, traînant des Russes qui s'essayent à la conversation française. Aucun doute n'est plus permis. M. Bachelet a vécu dans la société des Slaves parisianisés. Et il a prêté leur accent pittoresque à ses personnages.
Le prélude qui pouvait être la synthèse du drame est moins un prélude, dans son raccourci, qu'une introduction. Cette introduction rapide permet à M. Bachelet de nous conter l'arrivée de Yacha chez Akimitch, ses entretiens avec le vieux gardien et sa fille, la naissance de l'amour des deux jeunes gens, durant les veillées familiales. Le compositeur expose, dans leur ordre, les motifs des personnages, motif claudicant, très rude, très franc, d'une grande honnêteté pour Akimitch, motif chromatique inquiet, un peu incertain, pour l'hésitant Yacha, motif gracieux et prenant pour Manoutchka. La cloche, restée seule, au beffroi, et qui règle tout le drame et force le destin des personnages, est caractérisée, avec une précieuse discrétion, par une simple note : un mi naturel qui tinte tout le long de la pièce.
Au lever du rideau, Yacha murmure une chanson d'une exquise couleur locale. Quand, plus tard, il parlera des sonnailles, M. Bachelet trouvera une façon très personnelle d'interpréter, par l'orchestre, le prolongement des ondes sonores, les échos mélodieusement répandus des cloches. Il ne se servira pas tout simplement, comme tant d'autres, de courts accents des cors, à son ouvert. Mais par un artifice d'instrumentation d'une séduisante subtilité, par des recherches d'un raffinement singulier, il propagera au loin les branles répercutés du bronze résonnant. Toute la scène où Manoutchka conte le départ des cloches est d'une grâce expressive de la plus adorable musicalité.
Quand elle nous dit qu'elle pose sa tête sur leur airain, leur « raconte des histoires », on entend les cloches répondre à la jeune fille avec des vibrations incertaines et tremblantes. C'est la voix même de Manoutchka qui, frappant le bronze, produit ces bruissements confus, ces bourdonnements mourants, et, si j'ose dire, ce ronron du métal.
Relisons, ensuite, la longue et saisissante légende de la Petite fille de Novgorod. Par un souci de psychologue et de poète, M. Bachelet interrompt ainsi l'action et s'abandonne au rêve. Mais ce qu'on a pris pour une interminable digression n'est qu'un moyen plus sûr de dépeindre les physionomies nonchalantes des personnages, de créer leur atmosphère véritable, de faire prévoir leurs douleurs, plus tard, subies avec résignation.
Aussi bien, on peut dire qu'il est, en quelque sorte, sacrilège de prétendre découvrir dans cette partition, d'une consolidation inaccoutumée, des « longueurs ». Chaque scène est d'une si juste tenue musicale, d'un prix si inestimable, que détachée de l'œuvre mère, elle comblerait de joie, au concert, les auditeurs les plus difficiles.
Enfin, dans le grand duo d'amour, voici, lié à des motifs nouveaux, qui seront développés à leur tour, le thème d'amour dans son plus rayonnant épanouissement.
Dès le retour d'Akimitch, le drame est lancé. Dans une poussée empoignante, après le carillon du couvent qui tinte dans une tonalité opposée à celle de l'orchestre et propage tant de poésie pénétrante, après les invocations frémissantes à la Vierge, ponctuées par les tremolos de l'orchestre comme par des râles (sol bémol, fa, si bémol), le musicien nous conduit avec une autorité âpre et tendue, au terme violent de son drame.
Sans doute dans cette forêt de rythmes et de timbres, aux essences curieuses et grisantes, on trouvera le ton quelque peu forcé, l'exaltation des personnages grossie et continue. Qui nous rendra l'humanité si profonde, si attirante, si inspirée de Scemo ?
Tous ces thèmes sont très partagés, dans un renouvellement continuel des sonorités. L'orchestration somptueuse, fouillée, grouillante, demeure toujours d'une écriture horizontale, avec des traits extrêmement modulants et qui, dans les fréquents mouvements, très rapides, créent de grosses difficultés d'exécution.
***

décor pour le Festin de l'Araignée par Maxime Dethomas

les personnages du Festin de l'Araignée
MM. Carré et Isola effectuèrent le 5 décembre 1922, la reprise du Festin de l'Araignée, ballet pantomime en un acte de M. Gilbert de Voisins, musique de M. Albert Roussel.

Albert Roussel
M. Albert Roussel est l'un de nos musiciens les plus libres, les plus hardis, les plus étrangers aux formules consacrées ou à la mode. Si l'on suit la courbe lumineuse de sa carrière on voit qu'elle s'élève, hors de toute servitude, avec une force, une amplitude, un calme imperturbables. Par sa sobre et dure puissance, son originalité serrée, ses cadences vives et sa couleur, le Festin de l'Araignée, composé en deux mois et sur commande, semble le chef-d’œuvre de M. Albert Roussel. Le ballet pantomime de MM. Gilbert de Voisins et Albert Roussel avait été créé au mois d'avril, en 1913, au théâtre des Arts, alors dirigé par M. Jacques Rouché. Personne ne put se méprendre sur la valeur de cet ouvrage qui demeure encore la plus belle révélation de l’actuel directeur de l'Opéra. M. Albert Roussel est, en quelque sorte, un grand paysagiste de la musique. Il contemple un site avec une telle acuité de regard qu'il en découvre les plus subtils secrets, les plans les plus profonds. Il ne s'attarde pas aux puériles harmonies imitatives. Toutes les sensations, toutes les idées qu'il éprouve, il les transpose en un langage musical, ferme et âpre. Ecoutez l'exquise et frémissante pastorale du prélude du Festin de l'Araignée. Il y a là une libre raison, une inspiration lucide et hardie qui classent le musicien. Les autres pages de sa partition ne sont pas moins captivantes. Contrepoints curieux et savants, scherzos bondissants, rythmes heurtés ou gais, dessins riches et délicats, instrumentation personnelle, chatoyante et vigoureuse sont les plus ordinaires découvertes que l'on y puisse faire.

fac-similé d'un autographe d'Albert Roussel
Ceux qui s'émeuvent aux paysages marins et que tourmente la nostalgie d'un vaste horizon se satisferont de Polyphème, drame lyrique en quatre actes et cinq tableaux du capitaine de vaisseau Jean Cras, créé le 3 janvier 1922 par MM. Vanni-Marcoux, Bussy, Mmes Balguerie, Roussel et Frédérique Soulé. La mer plaintive, électrique et soupirante, ses changeants rivages, ses fantasmagories, tout le jeu des nuages et des vagues sont chantés, dans Polyphème, avec un art des sonorités scrupuleux, persuasif et choisi. L'impression navale, à cette audition, est si oppressante que l'orchestre, avec sa grande voix océanique, ses harmonies d'abîme, son clapotis rapide et léger entoure la scène comme d'une mer.
La pastorale dialoguée d'Albert Samain ne témoigne malheureusement pas d'une grande adresse scénique. Il faut ajouter, à la justification du poète du Chariot d'or, que Polyphème est un ouvrage très vivement exécuté. De son vivant, l'auteur ne l'avait ni publié, ni présenté à un théâtre.
Lulli, Bianchi, Naumann, Haendel, Haydn et M. Raymond Bonheur avaient déjà mis en musique les tragiques amours du cyclope légendaire. Ces prédécesseurs fameux n'ont pas arrêté M. Jean Cras. D'autre part, trouvant, dans le poème de Samain, deux scènes visiblement imitées de M. Maurice Maeterlinck et que Claude Debussy traita dans Pelléas et Mélisande, il n'a pas craint de les développer musicalement, à son tour. M. Jean Cras est un rêveur et un érudit. Sa personnalité s'est affirmée au cours de profondes méditations et de nombreuses lectures. Avant que de s'exprimer, lui-même, il a parcouru les contrées musicales les plus anciennes et les plus neuves. Il en a rapporté plusieurs curiosités dont il a orné le bâtiment théâtral qu'il a lancé.

Jean Cras
Mais mieux que ses devanciers, le musicien de Polyphème connaît le grand drame secret de la mer, dont il a noté musicalement tout le langage profond et mouvant. Ses thèmes assez longs, à la manière d'Henri Duparc qui fut son maître, exposés avec une sereine franchise, se développent largement, sans heurts ni confusion. Ils se déroulent avec des serpentements de rivage et évoquent, par leurs grandes lignes ployées, les vastes horizons des immensités marines. L'étude musicale de la partition de Polyphème révèle une richesse d'idées intarissable. Chaque personnage est dépeint par dix, douze, quinze motifs que le compositeur a minutieusement agencés, pendant les escales, comme s'il réglait tous les éléments de la complexe machinerie d'un vaisseau moderne. Il a sondé l'espace et la profondeur et, guidé par les astres, connaissant les voies idéales, il a écrit sa composition musicale, comme s'il traçait sa route sur une carte marine. Malgré l'imperfection d'un dernier acte trop long, Polyphème a mis en pleine clarté un musicien véritablement doué, un observateur lyrique charmant et profond.
***
Imaginez, agrandies au cadre de l'Opéra-Comique, quatre grisailles persanes, rehaussées de couleurs aquarellées et dont les précieux et riants personnages, par un coup d'enchantement, se détachent du fond immobile et se mettent à chanter, à danser, à vivre. Tel est le Hulla, conte lyrique oriental en quatre actes de M. André Rivoire, musique de M. Marcel Samuel-Rousseau, créé le 9 mars 1923, par Mlle Yvonne Brothier, MM. Charles Friant, Lafont, Audoin, Azéma, Hérent. MM. André Rivoire et Marcel Samuel-Rousseau qui ont atteint la perfection dans l'habileté et le talent, ont su parer leurs héros des grâces qui en imposent le plus. Ils ont embelli l'aventure amoureuse du Hulla de toutes les circonstances qui peuvent le mieux divertir le public. Rien n'a été oublié de ce qui devait rendre agréable leur ouvrage et je ne doute pas qu'il le soit. Un grand succès a récompensé les efforts et les soins que les auteurs ont pris de ne nous dire que des choses obligeantes. Le sujet du Hulla a été emprunté au recueil des contes orientaux, les Mille et un jours, moins célèbre mais non moins admirable que celui des Mille et une nuits.
Pour garder leur fluidité, leur flexible musicalité aux vers aériens de M. André Rivoire, M. Marcel Samuel-Rousseau s'est tenu à une discrétion où l'on découvrira autant d'habileté que de déférence. La partition du Hulla qu'on prétend académique, tout comme le poème qui l'inspira, ne paraît évidemment pas neuve. Mais les détails en sont délicieux, certains endroits touchés avec un art éblouissant, une véritable maîtrise. Le trait cursif et appuyé se détache sur un fond éclatant de clarté, ainsi qu'un dessin habile qu'on voit sur les faïences iraniennes d'un bleu turquoise intense. Le compositeur n'a pas voulu surcharger d'ornements nombreux et complexes la pâte tendre de son livret. Erudit professeur d'harmonie au Conservatoire. M. Marcel Samuel-Rousseau n'aime pas de paraître pédant. Son tact ne le trompe jamais. Il a toujours vécu dans le monde de la musique et auprès de son père, l'auteur de Léone, dont j'ai parlé plus haut. Il est devenu ainsi, sur l'art du théâtre lyrique d'une extrême expérience. Il n'ignore rien des recettes à employer en toute circonstance dramatique. Je suis sûr qu'il connaît à fond toutes les partitions destinées à la scène. Le compositeur de Tarass-Boulba était merveilleusement préparé pour entreprendre la musique du Hulla, musique si agréablement française par la tendresse et l'esprit et qui a plu et plaira toujours au théâtre. L'instrumentation est légère et transparente. Par de savants et savoureux accouplements de timbres, les sonorités fluides s'élèvent avec ses sinuosités de parfums qu'on brûle dans des cassolettes d'or. Dès le début de la première scène du Hulla, quand on écoute le joli chant du ténor, en sol mineur, soutenu par le gracieux dessin d'un chœur féminin, on est renseigné sur la personnalité du musicien. Pas de surcharge. Pas de grossissement à surprises. Mais une brièveté élégante et claire. Un art singulier, déjà révélé dans Tarass-Boulba, d'écrire les ensembles, de dépeindre le grouillement de la foule, de dessiner, par des sonorités pittoresques et saisissantes, les caractères des personnages apparus. On a dit que le Hulla s'apparentait étroitement au Mârouf, de M. Henri Rabaud. Un seul thème, celui des messagers, au troisième acte du Hulla peut ressembler, d'assez loin, à la musique de Mârouf. Le conte lyrique de MM. André Rivoire et Marcel Samuel-Rousseau ravira par sa finesse, sa fraîcheur, son ingéniosité. Rien n'a été négligé pour rendre plus général et plus vif le plaisir que les auteurs du Hulla se proposaient de donner au public d'un théâtre lyrique.
***
MM. Reynaldo Hahn et René Fauchois ont voulu défendre, à leur façon, la réforme de l'enseignement classique, préconisée par M. Léon Bérard, en nous présentant le 18 juin 1923, une Nausicaa, opéra en deux actes, directement inspiré du sixième chant de l'Odyssée. Le récit de M. Fauchois, fait avec beaucoup de grâce, est même orné de plusieurs citations heureuses. Il ne touche qu'avec légèreté aux choses vastes et difficiles d'Homère. Il est resté pieusement fidèle à l'épopée ionienne. Sans le souci des arguments pointilleux de l'école moderne, M. Reynaldo Hahn qui est né avec beaucoup de goût pour la musique a écrit, pour Nausicaa, une partition toute de facilité, de brillant et de charme. Il n'emploie qu'un langage harmonique juste et simple et qui a fait ses preuves, qui n'est pas à la mode d'un moment. Sa grâce langoureuse et son esprit mélancolique y paraissent en toute liberté. Il possède une connaissance précise de tout ce que les musiciens prospères et érudits ont de plus agréable dans leur système. Sa musique idyllique d'une engageante clarté, nous prendra toujours dans son réseau léger. La partition de Nausicaa, mélodieuse et aisée, est très écrite pour les voix et la prosodie déclamatoire est d'une rigoureuse justesse. Comment en pouvait-il être autrement avec M. Reynaldo Hahn qui prétend aux lauriers du chanteur ? L'orchestration discrète, tendre et où l'emploi des flûtes et des harpes n'est point abusif (comme dans les compositions à sujets antiques) a été bien étudiée. Un piano a été ajouté aux instruments de l'orchestre. Ses sonorités tintantes y ont été fondues avec un goût et une adresse toujours en éveil. Il me semble, toutefois, qu'en de certains passages, la musique de M. Reynaldo Hahn illuminerait davantage un texte voluptueux d'Anacréon que la vénérable épopée d'Homère. Mlle Davelli et M. Henri Albers ont créé les deux principaux rôles de Nausicaa.
Pepita Jimenez, comédie lyrique en deux actes et trois tableaux d'Isaac Albéniz était jouée, après Nausicaa, par Mmes Marguerite Carré, Estève, MM. Bussy, Azéma, Dupré, Bourdin, Goavec. Ce court ouvrage juvénile date de la première période de la production albenizienne, avant 1905 et avant la géniale Iberia. Il avait été créé au Liceo de Barcelone, le 5 janvier 1896, puis représenté à Prague et à Bruxelles. Ne cherchez pas dans cet orchestre vibrant de Pepita Jimenez des soucis de logique ni de psychologie. L'atmosphère, seule, est incomparable. La musique d'Albéniz, nous inonde de l'azur ardent d'Andalousie et nous fait respirer tous les parfums âcres ou doux des jardins ibériques. Elle tend un fond de paysage espagnol si vrai, si intense que les personnages ne sont plus que des ombres capricieuses et falotes. Cette musique est vivante, comme d'une animalité agile et hardie. Elle a, pour ainsi dire, le luisant d'une toison, les frissons d'une bête de sang La frénésie rythmique du compositeur suffit à notre plaisir. La partition de Pepita Jimenez, presque entièrement faite de scherzos bien construits n'est qu'une sorte de nocturne scénique, exaltant et curieux. Le génie d'Albéniz n'est pas inférieur au génie de Frédéric Chopin.
Quelques pages pittoresques et animées sont d'une couleur surprenante. Le compositeur est évidemment moins heureusement inventif dans les scènes de tendresse. Mais son inspiration passionnément populaire. surabondante nous ravit. Durant toute la pièce, ces fantaisies du musicien ne cessent pas, non plus que notre indulgence pour elles. Peu de passages témoignent d'une inexpérience technique qui semble voulue. Dès Pepita Jimenez, Albéniz paraît avoir travaillé la fugue et le contrepoint, sous la direction des maîtres français dont il était l'ami. Pourtant, toute cette féérie rythmique a dû être commencée avec distraction et continuée de même. Toute l'âme de la race espagnole tressaille dans ces dolentes ou furieuses inventions d'Isaac Albéniz.
Le 5 novembre 1923, furent jouées Sainte-Odile, drame lyrique en trois actes de M. Marcel Bertrand et la Griffe, drame lyrique en deux actes de Félix Fourdrain qui n'apportèrent rien de neuf à l'histoire de la musique de théâtre.
La Plus forte, un solide et claironnant drame lyrique en quatre actes de M. Jean Richepin et Paul de Choudens, musique de Xavier Leroux, fut créé le 11 janvier 1924 par Mme Charny, MM. Henri Albers, Charles Friant, Baugé. Cet ouvrage enchantera ceux qui se passionnent pour le théâtre bien fait, populaire, plein de gros effets et d'artifices irrésistibles. On le goûtera comme l'une de ces lourdes soupes villageoises, apprêtées selon les vieilles recettes rurales. Le sujet de la Plus forte, dans ses données plus libres que délicates, semble, au premier abord, d'une orageuse hardiesse. On dirait d'un drame de bêtes, au fond des forêts, à la saison du désir. Dans un déploiement violent des instincts et des forces animales, un mâle et son petit se disputent la même femelle. Elle meurt. Les mâles réconciliés, retournent à leur tanière. Telle est rapidement esquissée cette tragédie champêtre dont on peut écrire qu'elle est la Phèdre auvergnate.
Xavier Leroux qui était un professeur émérite, construisait ses édifices sonores avec des soins infinis, selon un plan remarquablement conçu et exécuté. Il choisissait trop vivement ses matériaux. Il les prenait assez souvent au hasard. De là quelques pages qui nous semblent, aujourd'hui, vulgaires, mais qui n'en révèle pas moins un large souffle, une plébéienne invention mélodique. La partition de la Plus forte est d'un équilibre, d'une distribution, d'une combinaison qui font au technicien la meilleure impression. Le musicien a utilisé un grand nombre d'airs populaires d'Auvergne, qu'il a présentés et harmonisés avec la plus fraîche et plus fine poésie. Xavier Leroux est mort prématurément. Il n'a laissé que la partition chant et piano et l'orchestration du premier acte. M. Henri Büsser a continué la tâche interrompue avec un raffinement, dans l'art et la piété, qui étonne l'imagination. On ne saurait plus familièrement pasticher l'instrumentation fougueuse et claire de Xavier Leroux. L'auteur du Chemineau a été enlevé trop tôt à notre affection. Il devait nous donner toute une suite de ces fresques musicales rustiques, à grosses touches, à larges et puissants traits. Sa personnalité en eut été agrandie et mieux éclairée.
***
MM. Albert Carré et Isola en jouant la Brebis égarée, le 10 décembre 1923, n'ont pas seulement diverti des spectateurs polis et dévots. Dans l'affaiblissement général du théâtre lyrique, ils ont donné un joli exemple de courage et de générosité. Ils ont présenté avec magnificence l'œuvre d'un poète véritable et d'un compositeur très jeune et très indépendant. On était excédé d'entendre les musiques discrètes et emphatiques d'un répertoire fatigué. La plupart des ouvrages nouveaux ne nous proposaient que des copies prudentes et intéressées des partitions anciennes. Voici, avec la Brebis égarée un souffle inattendu. Voici un peu et encore trop peu de renouveau, de franchise et de clarté.

Darius Milhaud
Les personnages de la Brebis égarée nous font des confidences entières, sans aucune dissimulation. Ils affectent une candeur qui n'est peut-être pas moins artificielle que l'outrance et la bravoure des vieux héros du théâtre musical. Le public a paru d'ailleurs assez rebuté du naturalisme poétique, lyrique et chrétien de MM. Francis Jammes et Darius Milhaud. Il n'a pu se résoudre à souffrir un si violent changement dans ses habitudes que tant d'autres flattent. Les auteurs de la Brebis égarée trouveront, sans doute, dans l'avenir, des auditeurs plus persuadés de leurs mérites. Rappelez-vous les premières représentations du Rêve, de Louise, de Pelléas et Mélisande.
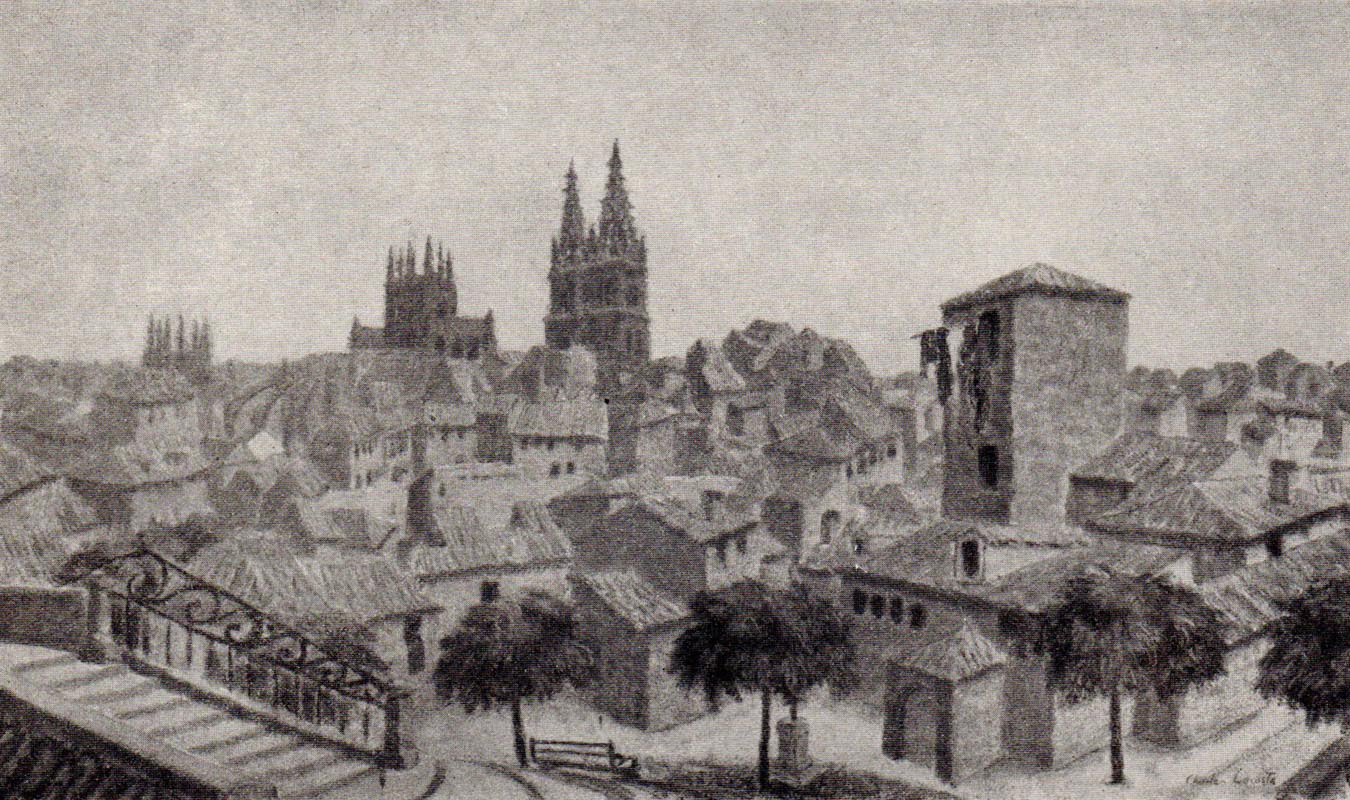
décor pour le 2e acte de la Brebis égarée par M. Lacoste
M. Darius Milhaud passe, dans le monde de la musique, pour un bruiteur, un moderniste séditieux. Dans la Brebis égarée, le jeune compositeur est aussi sage qu'il a paru impétueux. A la fin de la partition, il a pris le soin de faire imprimer : « Paris, 1910. — L'Enclos, 1914. » Il a donc écrit cet ouvrage entre dix-huit et vingt-deux ans. Son livre de chevet devait être, à cette époque, la partition de Pelléas et Mélisande. Il ne manquait, d'ailleurs, d'aucune étude, pour bien composer. Son œuvre, si debussyste par la forme et le fond, est d'un agrément mélodique, d'un raffinement harmonique, indiscutables. Chaque tableau de la Brebis égarée est mis en place, poussé, médité. avec une science délicate, sinon avec une personnalité tranchante. Chaque acte, chaque scène sont traités d'après une idée directrice, avec des combinaisons thématiques, des habiletés d'écriture, des libertés harmoniques fort ingénieuses. L'orchestre de M. Darius Milhaud, pour la Brebis égarée est l'orchestre déjà connu de César Franck, d'Alberic Magnard, de Claude Debussy. Mais le musicien préfère, aux traînantes sonorités du quatuor, le chant nasillard et franc des bois. Il abuse des plaintes des cors. La voix humaine n'est que, rarement, à découvert. Cette partition qu'on écoute avec plus de curiosité que de plaisir et plus d'énervement que de sensibilité, révèle, sous une nonchalance feinte, un métier d'une fermeté irréfutable. Je connais peu de musiciens capables d'ériger une construction aussi équilibrée, aussi calculée que celle de la Brebis égarée. Depuis longtemps, nous n'avions entendu, sur la scène de l'Opéra-Comique, une œuvre inédite aussi piquante, aussi stimulante. Mmes Balguerie, Ferrat, MM. Salignac et Baugé tenaient les principaux rôles de la Brebis égarée.
***

Mlle Sonia Pavloff dans le Petit Elfe Ferme-l'Œil
Le Petit Elfe Ferme-l’Œil, ballet féérique en un acte d'après Andersen, musique de M. Florent Schmitt, fut dansé, le 9 février 1924, par Mlles Sonia Pavloff, Frédérique Soulé, Mona Païva, Rosne, Collin.
C'est bien le plus piquant divertissement dont puissent s'amuser les esprits des spectateurs d'aujourd'hui. Le ballet de M. Florent Schmitt, d'une naïveté subtile et de la plus vive fantaisie, ne nous donne pas seulement un plein contentement. Il marque aussi une date dans l'histoire de la Salle Favart. Après Claude Debussy, après MM. Alfred Bruneau, Paul Dukas, Gabriel Fauré, Maurice Ravel, Albert Roussel, un grand musicien moderne, M. Florent Schmitt, se glisse furtivement, — il est légèrement en retard... — sur le théâtre suranné. Il a pris un masque grimaçant d'enfant pour déguiser sa personnalité orageuse.
M. Florent Schmitt nous invite, une fois de plus, à feuilleter le génial recueil des Contes d'Andersen. Le récit porte, dans le volume, ce titre : le Vieux Ferme-l'Œil. Le musicien en a tourné les pages avec autant de distraction que de vivacité. Il a interverti l'ordre des sept petites histoires débitées une à une par le gnome Ferme-l'Œil, chaque soir de la semaine. L'auteur du Psaume XLVII les a désignées sous des titre nouveaux, plaisants, et auxquels le grand danois n'avait pas songé. Andersen les avait intitulés très simplement : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche.

Florent Schmitt par L. Ferrier Jourdain
Avec autant de bonne foi que d'intelligence, M. Florent Schmitt a adapté pour la scène lyrique cette naïveté séduisante. Il s'est vu obliger de supprimer quelques passages, difficiles au théâtre. Il y a fait entrer quelques choses d'un autre conte d'Andersen : l'Intrépide soldat de plomb, et par une recherche aussi exacte qu'ingénieuse, a créé d'habiles transitions d'un état de rêve à un autre. Il faut beaucoup de sensibilité et d'amour pour pénétrer dans les âmes enfantines et se retrouver dans leur gentille incohérence.
Qu'il est touchant de voir l'austère et ténébreux musicien d'Antoine et Cléopâtre se pencher pieusement sur le récit naïf et s'efforcer à cette sérénité, à cette fluidité ! Par la noblesse hardie de sa musique. il a enveloppé de grands symboles les idées et les sentiments de ses minuscules héros. C'est délicieux et inattendu. Il a donné à sa voix rude et forte des inflexions caressantes et baroques. Oubliant parfois sa verve impétueuse. il s'est permis de la grâce. Après Schumann, Moussorgski et Debussy, il s'est attendri jusqu'à recueillir les souffrances étranges des premières sensations puériles. Il a célébré le poème de la vie des enfants et a discerné les forces obscures qui la mènent. Il ne s'est occupé qu'à nous divertir. Pourtant, il s'est élevé jusqu'à la pure raison et à la sagesse d'Andersen.
La partition du Petit Elfe Ferme-l'Œil semble un énorme jouet très compliqué et fabriqué à grand labeur. Les plans ont été tracés et cernés avec une décision farouchement juvénile. C'est une construction hâtive, un peu barbare, pour pantins primitifs, ingénument et grossièrement taillés en plein bois. L'orchestre colorie les thèmes à larges taches vives, comme ferait un petit garçon féroce et turbulent. Çà et là, la mélodie, d'une claire et élégante mélancolie et d'une innocence pas trop contournée, suit une courbe gracieusement allégée et ne dégage plus que l'humble parfum d'une fleur des champs.

décor pour le Petit Elfe Ferme-l'Œil par André Hellé
Il suffit d'écouter quelques mesures du prélude de Petit Elfe Ferme-l'Œil pour situer, d'emblée, le compositeur parmi nos grand musiciens. Ce prélude débute par un thème nostalgique, diffus et bien personnel à M. Florent Schmitt (la nuit, la fatigue, le sommeil fiévreux, l'invitation aux voyages lointains), auquel est relié un trépidant et plaisant motif de ronde populaire aux rythmes fortement marqués et qui caractérise l'Elfe Ferme-l'Œil. Ce dernier thème du vieux gnome, tantôt murmuré, tantôt repris triomphalement à l'harmonie, dominera sur toute la partition. Transformé avec autant de dextérité que d'audace, il servira tour à tour aux souris, au cavalier noir, aux lettres et aux Chinois. Nous saurons ainsi que Ferme-l'Œil est l'organisateur et le principal acteur de tous ces divertissements illusoires. Les autres thèmes sortent peu à peu de l'ombre, comme les premiers symptômes des songes qui agiteront les sept nuits du petit Hjalmar. L'auteur de la Tragédie de Salomé, par la saveur inédite de ses harmonies, par la finesse de ses modulations, par la fermeté de sa technique, nous donne là une magistrale leçon de musique française moderne. On pourra admirer encore la mélodie noble et douloureuse de la cigogne lasse, le dessin linéaire et spirituellement emmêlé des lettres boiteuses et des lettres bien moulées, la berceuse de la nourrice, d'une profonde musicalité, la danse précieuse de la princesse de Chine.

décor pour le Petit Elfe Ferme-l'Œil par André Hellé
***
Je crois bien que l'Appel de la Mer, drame lyrique en un acte de M. Henri Rabaud, créé le 10 avril 1924, par Mmes Balguerie, Sibille, Baye et M. Guénot, est l'une des meilleures œuvres de l'auteur de la Procession nocturne.
Dans aucune autre sa nature n'éclate avec plus d'avantage. Par la franche et fière structure, par la curiosité et la noblesse de l'inspiration, par un don exceptionnel de séduire et de persuader, par un sens étendu de la technique scénique, cette composition a entraîné, tout ensemble, le consentement des artistes et du grand public. M. Henri Rabaud a écrit lui-même son livret. Il a traduit et adapté la pièce originale de J.-M. Synge, intitulée Riders to the sea (c'est-à-dire A cheval vers la mer) écrite en anglais d'Irlande et jouée en 1903. L'auteur de Mârouf a mis à la scène, non plus un amour plaisant, mais l'austère horreur d'un sombre drame maternel. Sa musique entoure l'ouvrage comme d'une verte crinière circulaire, d'écumes rageuses, de vagues mugissantes. Par la justesse et l'unité de ses rapports, elle conduit inflexiblement au but que le dramaturge s'est proposé. Pas une longueur, pas un arrêt dans cette partition qui n'a que l'étendue stricte exigée par l'action scénique. Un ordre merveilleux y est établi. Ecrite fort savamment, d'une manière aussi prenante qu'adroite, traitée sans aucune bassesse, avec ces fugues irrésistibles, ces scherzos prestigieux, familiers à l'auteur de Mârouf, elle progresse jusqu'à la fin d'une marche libre et forte. L'écriture de M. Henri Rabaud qui fait songer à celle d'un Saint-Saëns, converti à la jeune musique, dans sa discipline nette et châtiée, s'enrichit cette fois de quelques apports de l'école moderniste. C'est un plaisir véritable de lettré que de suivre, dans l'Appel de la Mer, les évolutions souples et hardies des motifs qui glissent par deux, par trois comme d'étincelants poissons dans une eau transparente. Sans puiser directement au folklore gaélique, M. Henri Rabaud a su donner à sa mélopée et ses rythmes les contours caractéristiques, le coloris et le mouvement du chant populaire d'Irlande. L'orchestre de l'Appel de la mer est un orchestre ordinaire de concert sans instruments insolites, (sans même un contrebasson). Le chant peut planer, libre, au-dessus des harmonies ajourées et solides, ainsi qu'une guipure d'Irlande. Avec une pieuse fidélité, une saisissante faculté imitative, M. Henri Rabaud décrit, par de persuasives harmonies le galop tragique d'un cavalier qui court vers la mer et la mort, le tournoiement du rouet familial. le choc argentin des aiguilles à tricoter, les hurlements du vent d'ouest, les vagues qui déferlent sur la côte rocheuse. Harmonies moins recherchées que réfléchies et qui trouvent leur emploi dans un leitmotivisme aussi dogmatique qu'ingénieusement psychologique. Certaines sonorités fuyantes et légères dessinent des arabesques, comme celles des mouettes et des cormorans, en plein vol, « au sommet de la falaise qui s'émiette. »
***
Le 9 juin 1924, on entendait, pour la première fois, Fra Angelico, tableau musical en un acte de M. Paul Hillemacher. Sur un scénario rapide et fragile, l'auteur de Circé avait écrit une partition du plus élégant mysticisme. Déclamation, chœurs, instrumentation, tout y était d'une pure et savante tradition. Voilà un modèle achevé, plein d'art et d'étude, pour cantates de Prix de Rome.
L'Opéra-Comique a représenté également le 9 juin 1924, la Forêt bleue, la ravissante féérie musicale de M. Louis Aubert. Des œuvres de cette espèce occuperont toujours l'attention du public. Tous ceux qui recherchent au théâtre un peu de bonheur et de rêverie, éprouveront, à l'audition de la Forêt bleue, un attrait puissant. C'est un spectacle gracieux, allégeant et rare à nos mœurs rudes et notre monde ténébreux. Pendant une heure de félicité entière nous sont rendus les petits personnages qui ont enchanté notre enfance. Ils ressuscitent dans une atmosphère de poésie si pénétrante et si délicate, avec des couleurs si tendres et si plaisantes que les spectateurs les plus mornes se laisseront toucher. La Salle Favart a joué, l'ouvrage qui, depuis de longues années, était le mieux tourné pour séduire les imaginations actuelles.
Ecrite en 1904, publiée en 1907, la Forêt bleue n'avait pu être donnée qu'à Genève et à Boston. Les directeurs parisiens connaissaient cette partition, pleine de fantaisie et de raison. Ses qualités supérieures, musicales et scéniques, ne pouvaient être contestées. Les concerts Pasdeloup, les concerts de Paris en avaient exécuté d'importants fragments, devant des auditoires surpris et charmés. MM. Louis Aubert et Jacques Chenevière avaient relu les Contes de ma mère l'Oye dans un moment favorable. Le livre leur était tombé des mains. Au cours d'une rêverie longue et délicate les héros ingénus de Charles Perrault s'échappèrent. en tumulte, des pages harmonieuses et pures où ils étaient prisonniers. Ils s'ennuyaient peut-être dans leurs contes respectifs. Comme des petits génies espiègles, la Belle au bois dormant, le Prince charmant, le Petit Chaperon rouge et le Petit Poucet s'enfuirent des chapitres qui leur étaient consacrés et embrouillèrent les feuillets jaunis du volume. Ils firent connaissance et se contèrent leurs exploits. Ils nouèrent leurs rondes alertes autour de nos auteurs. Ils ne voulaient plus se séparer. Le Petit Poucet, en particulier, s'était passionnément attaché à la fillette parée du chaperon rouge. Et tout cela se passait dans un songe, où l'air était bleuâtre et odorant, parmi les grands arbres d'une forêt mystérieuse.
C'est ce songe jovial et frais que M. Louis Aubert et Jacques Chenevière, nous ont conservé dans toute sa grâce profonde et malicieuse. Par un industrieux effort d'art, ils l'ont vêtu des plus jolies apparences du théâtre et de la musique. Les petits fantômes fameux ont gardé leur allégresse et presque toute leur candeur. Ils sont toujours merveilleusement braves et beaux. Mais les magiciens modernes ne les ont qu'à demi éveillés. Même à des mémoires infidèles, ils paraissent dépourvus de leur dignité classique. Ils n'en plairont que davantage, sans doute, aux mauvais élèves qui forment la majeure partie du public moderne.

décor pour le 1er acte de la Forêt bleue
Toutes les fées aimantes et flottantes de nos vieux contes ont uni leurs voix immatérielles dans la musique de M. Louis Aubert qui n'est surpris par aucune disgrâce. Autant par l'assistance de ses lectures que par sa propre valeur, l'auteur des Poèmes arabes, en écrivant pour le théâtre, a pénétré la plénitude de la musique dramatique, dans toute son étendue. Rien de trop recherché, de trop ancien, ni de trop moderne dans sa composition. Simplement, un équilibre, une disposition savante, un feu d'inspiration bien tempéré. C'est par des accents vifs et sincères, par la force, l'adresse, par une ingénieuse et sage économie, par la vraie éloquence lyrique que M. Louis Aubert est arrivé au délicieux. Il a résisté à toutes les fausses opinions. La partition de la Forêt bleue, née au temps de la royauté de Pelléas, porte évidemment l'empreinte debussyste. Mais elle a tiré un agrément si naturel de ce commerce, elle a tant de suite et de solidité, une gaieté si particulière et tant de souplesse dans le procédé qu'elle a trouvé le moyen d'être personnelle. Les thèmes, d'une poésie significative, du Petit Poucet, du Chaperon rouge, de la Princesse, du Prince charmant, de l'Ogre, de la Forêt, du Château de la Belle au Bois dormant, s'élèvent, voltigent, tournoient, frémissent, s'entrelacent et se dispersent, selon l'art le plus pénétrant, la psychologie la plus attentive. Le conte est construit, lyriquement, par un architecte et un ornemaniste de grand savoir. Et la musique retrace, avec des teintes de fine mélancolie, mais non sans relief, les caractères et les aventures. Le seul défaut — si c'est un défaut — de ces pages lyriques est d'être trop caressantes, d'une suavité trop insistante, d'une joliesse trop étudiée. Les deux premiers actes, avec leurs effusions de sentiment, leur verve, leur fraîcheur, leur pittoresque sensible, sont d'un agrément et d'une réussite incomparables. On ne saurait mieux faire en matière de musique de théâtre. Ne consultons que notre raison pour nous engager dans cette opinion. La musique est un milieu de grande contradiction. Ceux qui appartiennent à des partis opposés ne jugent d'une œuvre que par saillie d'humeur ou par passion.
Je ne suis pas surpris de voir nos compositeurs d'avant-garde témoigner de l'hostilité à l'auteur de la Forêt bleue. C'est une fleur d'or de l'esprit musical, éclose à l'ombre de Claude Debussy et de Gabriel Fauré. Nos modernistes, quoi qu'ils affirment, ont définitivement rompu avec ces deux génies, dont ils détestent les fidèles. Pourtant, ils n'ont qu'à relire les huit mesures de la danse de l'ogre, au second acte de la Forêt bleue. Ils y découvriront, étalés sans orgueil depuis vingt ans, les stridences burlesques, les dissonances baroques et plaisantes, les vulgarités de timbre, les couleurs crues avec lesquelles nos adolescents veulent nous étonner. D'ailleurs ces « audaces » sont là merveilleusement en situation. M. Louis Aubert n'en tire aucune supériorité. La déclamation judicieuse, mélodieuse, suggestive, est d'un excellent observateur. Quant à l'instrumentation, on n'en pouvait écrire, il y a dix ans, de plus habile ni de mieux combinée. Transposition directe de la nature, elle est scrupuleusement descriptive, imitative, évocatrice.
Henry MALHERBE.