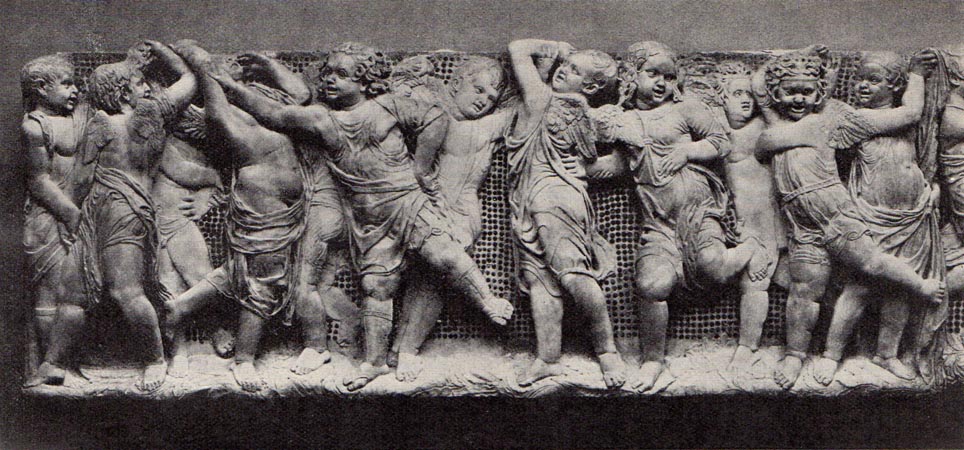
Cinquante ans de musique française (1874 - 1925)
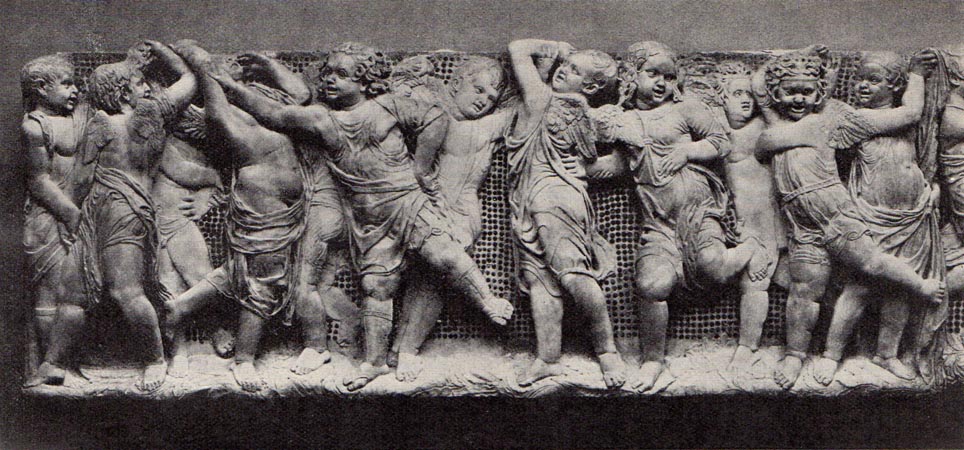
bas-relief de Donatello
LA MÉLODIE
par Charles KŒCHLIN
Ce n'est pas sans raison que nous évitons ici le terme de lied. Plusieurs, il est vrai, ont préféré l'emploi de ce mot, maint critique musical notamment ; et le traité de composition de M. d'Indy parle souvent de la « forme-lied ». Néanmoins, la mélodie française pour piano et chant (1) reste bien différente du lied allemand. Non seulement dans la structure (car, peu à peu, elle s'est affranchie des répétitions en couplets), mais dans l'esprit même, qui très vite a cessé d'être celui de la chanson populaire, pour au contraire s'affirmer comme une des manifestations les plus « aristocratiques » de la musique. On peut concevoir que des lieder de Schumann, de Schubert ou de Brahms soient chantés et compris par le peuple ; mais le peuple est très éloigné (dans sa culture actuelle) des mélodies de Claude Debussy, de M. Henri Duparc, de G. Fauré. Elles sont d'une autre essence que les chansons : lyriques, individuelles, et surtout évocatrices des poésies.
(1) Elle existe souvent aussi pour chant et orchestre.
Le caractère évocateur des mélodies françaises résulte d'une tendance plus générale de presque toute notre musique. Depuis fort longtemps, elle se plut à décrire (cf. le Réveil des oiseaux, la Bataille de Marignan, etc., de Clément Janequin ; les pièces de clavecin de Couperin, de Daquin, de Rameau, etc.). Avec les temps modernes, c'est une « évocation » plus profonde, dont les premiers signes (croyons-nous) se trouvent chez Berlioz. L'influence du romantisme et celle de la Révolution française avaient ouvert la voie à l'art le plus nettement individualiste, celui par lequel le poète lyrique exprime ses propres sentiments — ou du moins ceux qu'il imagine avoir ressentis. Et l'on retrouve chez nos « mélodistes » modernes l'expansion de ce sentiment de la nature qui fleurit aux temps du romantisme, issu de Bernardin de Saint-Pierre et de Chateaubriand.
Peu à peu l'on voit disparaître la chanson populaire à refrains : elle fait place à des « développements », comme seraient ceux d'une symphonie en raccourci ; ils montrent une richesse d'écriture, des trouvailles d'expression, de justes et nécessaires subtilités d'harmonie dont la petite romance sentimentale sur des « vers à mettre en musique » n'offre jamais d'exemples. — Or, précisément dans la mesure où cet art de la mélodie française s'est affranchi de la tradition surannée (romance à couplets), la beauté de cette mélodie est devenue plus complète, plus forte et plus profonde : il est facile de s'en rendre compte par l'évolution de Gabriel Fauré.
Une des caractéristiques de cette libération, c'est l'influence des grands poètes sur nos musiciens. Il faut d'abord combattre et réfuter certain lieu commun cher aux littérateurs comme à toute une partie du public. Le temps n'est plus où « ce qui ne vaut pas la peine d'être dit, on le chante »... Cependant, de prétendus connaisseurs veulent encore que la musique se puisse accommoder de textes insignifiants ; bien mieux : « les beaux vers ne doivent pas être mis en musique ». On se figure aussi, dans certains milieux, que les compositeurs sont des incultes, choisissant d'instinct les poésies médiocres. Erreur profonde : sauf de rares exceptions, les meilleurs musiciens ont toujours préféré les meilleurs poètes, et cela pour le plus grand bien de leurs œuvres.
Mais on nous présente cette collaboration comme inutile, nuisible... « Les mots ont déjà leur musique, et cela suffit » disent volontiers les poètes (2). N'y aurait-il point confusion de termes ? La musique naturelle des syllabes et des rythmes : élément que ne détruit en aucune façon l'autre musique, celle du compositeur, lorsqu'elle est justement sentie et justement prosodiée. Au contraire, l'art des sons vient commenter magnifiquement celui des mots : il découvre des profondeurs ignorées ; une beauté virtuelle apparaît, que l'on ne soupçonnait pas. Qu'il souligne impitoyablement les chevilles ou toute faiblesse de pensée, cela se peut bien ; mais tant pis ! On ne saisit guère d'ailleurs, pourquoi les poésies devraient n'être interprétées que par la déclamation monotone, emphatique, ampoulée, du tragédien illustre. On ne voit pas non plus que dans le Parfum impérissable ou dans Lydia, G. Fauré ait trahi Leconte de Lisle ; on ajouterait même que l'admirable musique de ces mélodies nous éclaire le poète sous son vrai jour : un grand sensible, contrairement à l'absurde réputation d' « impassibilité parnassienne ». — En revanche, les vers médiocres n'ont produit que des œuvres de second ou de troisième ordre. Il semblerait que cela fût évident a priori : mais on est dans l'obligation de le spécifier nettement, en face de l'opinion contraire qui réunit les suffrages de tous les incompétents : je veux dire certains poètes auxquels la beauté musicale est étrangère, et le profanum vulgus qui, ne comprenant ni musique, ni poésie, en parle avec l'outrecuidante sûreté de l'ignorance.
(2) La légende veut que Victor Hugo ait interdit, un jour, de « déposer de la musique » sur telle de ses œuvres. Espérons que la légende est mensongère...
Et d'ailleurs, la cause est entendue en dépit de toute théorie préalable ; il ne faut, pour cela, que songer aux très belles mélodies de M. Duparc, de G. Fauré, de Claude Debussy. Est-il besoin d'ajouter que, contrairement à l'erreur trop répandue, ils surent admirablement choisir leurs auteurs ? (3)
(3) Baudelaire, Leconte de Lisle, Verlaine, Villiers de l'Isle-Adam, A. Samain, Van Lerberghe, M. Pierre Louÿs, etc. Sans oublier Villon ni Charles d'Orléans.
Quant aux œuvres ainsi réalisées, il est difficile en quelques mots d'en dire la profondeur et la subtilité. Ces évocations qui sont à la fois des paysages et des sentiments, atteignent l'intérieur de la conscience où se rejoignent la sensation visuelle et l'émotion du cœur (par exemple Au cimetière, ou Arpège, de G. Fauré). Summum de perfection, où l'harmonieuse unité des dessins et des rythmes permet cependant la variété d'une expression qui détaille, au besoin, la « musique du mot » : précieuses trouvailles venant s'enchâsser dans l'ensemble comme les gemmes d'une couronne. Et loin que la mélodie française reste purement descriptive, elle devient (lorsqu'il le faut) aussi profonde que n'importe quel lied étranger, mais avec des qualités musicales si nettement de chez nous ! Richesse d'invention, mesure parfaite dans le langage de la sensibilité : marques de la plus haute civilisation artistique. Raffinement qui est de la simplicité ; discrétion concise de la forme traduisant le sentiment le plus vif : art parfait, dont l'aboutissement est la sérénité grecque de la Chanson d'Eve ou du Jardin clos de G. Fauré.
Longue évolution, à laquelle participèrent tant de musiciens français ! Presque tous ont écrit des mélodies. Plus ou moins bonnes : car en pareille matière, s'il est extrêmement difficile et très rare de composer un chef-d'œuvre, on improvise aisément une banalité quelconque suivant la formule ; et les épigones sont légion ! Nombre de médiocres ne laissent, dans ce domaine, que des œuvres de « nième ordre ». Il faut, à cet art délicat, certaine inspiration subtile et profonde ; une force créatrice singulière ; des dons imaginatifs sans cesse renouvelés : une absolue maîtrise de la forme, une incomparable souplesse de ligne et de pensée harmonique. De grosses machines, avec le fracas des orchestres ou l'âpreté éblouissante de la polytonie sont, peut-être bien, plus aisées à écrire — et somme toute exigent moins de génie. O ironie ! L'on a vu des symphonistes de valeur échouer dans ce genre méprisé des idolâtres wagnériens, alors que Debussy composa le Prélude à l'après-midi d'un Faune, et G. Fauré, son admirable Prométhée. « Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème » ; le temps, et les dimensions, et les sonorités ne font rien à l'affaire. Admirons donc, respectons profondément et chérissons toujours la modestie de ces très grands artistes qui, sachant écrire — et se borner — enfermèrent leur cœur dans ces coffrets magiques d'où l'essence concentrée de leur passion profonde, ainsi que le Parfum impérissable, s'épanche à jamais pour le plus grand bonheur des âmes aimantes.
Les caractères généraux d'individualisme, de lyrisme intérieur, d'évocation directe et profonde, de raffinement harmonique et prosodique, de sensibilité traduite avec l'équilibre classique d'une époque de parfaite civilisation musicale, tout ce qu'ainsi nous reconnaissons d'avance aux mélodies françaises les meilleures, est-il besoin d'ajouter que nous n'entendons pas réserver ces avantages exclusivement à cet art national ? En ces domaines, une classification n'est jamais absolue. Des étrangers ont connu telle sensibilité condensée et directe : Moussorgski notamment. D'autres ont évoqué des visions par des trouvailles de génie : Schubert, dans le Roi des Aulnes. Et d'ailleurs, dans le même temps que des précurseurs (M. Duparc ou G. Fauré) inauguraient une forme nouvelle, bien des Français restaient encore inspirés de Schumann ou n'écrivaient même que de petites romances, trop souvent insignifiantes. On conçoit donc que notre délimitation n'ait rien de la rigueur scientifique. — On saisit également qu'il nous sera nécessaire d'abréger un peu, lorsque nous rencontrerons des musiciens moins caractéristiques. Peut-être aurons-nous le tort d'oublier quelques confrères de réelle valeur. Peut-être sommes-nous coupable d'ignorer certains compositeurs de grand talent ou même de génie, que des circonstances défavorables privent d'une juste notoriété. C'est, hélas, le fait de toute étude historique de ce genre, surtout en présence d'une telle abondance de matière. On n'a la prétention ici ni de tout savoir, ni de tout dire de ce qu'il faudrait, trop heureux déjà si l'on n'omet aucun point essentiel.
Le plan de cette étude sera conforme à la chronologie, à quelques « décalages » près, l'œuvre de certains précurseurs s'étendant parfois sur une longue période et pouvant être tenue pour contemporaine aussi bien qu'ancienne : notamment celle de G. Fauré, dont les premières mélodies remontent à 1865, alors que les dernières — l'Horizon chimérique — datent de 1921 : évolution qui dura presque soixante années.
La mélodie française proprement dite, sorte de poème symphonique avec paroles (les Proses lyriques de Claude Debussy, ou la Bonne Chanson de G. Fauré) n'est pas la seule forme, toutefois, qu'il faille considérer. Elle peut se trouver plus développée (la Damoiselle élue, de Debussy ; la Fin de l'homme, de M. Ch. Kœchlin), ou beaucoup plus courte (quatrains de M. H. Merckel, de M. R. Désormière). Elle n'offre pas un caractère populaire avec Verlaine et Samain : elle reprend ce caractère, parfois, avec M. Jean Cocteau, avec M. Radiguet, collaborateurs de jeunes musiciens. On ne doit pas oublier non plus les très intéressantes transcriptions de l'ancien folklore, écrites par Bourgault-Ducoudray, par M. d'Indy, M. Paul Ladmirault, etc. Enfin, il existe des œuvres chorales qui sont, à tout prendre, du domaine de la mélodie, ainsi que le furent les chansons à quatre ou cinq voix des maîtres de la Renaissance (4).
(4) On excusera l'auteur de ces lignes de ne parler qu'incidemment, et sans insister, de sa propre production. Encore qu'en l'espèce il s'agisse d'une centaine, presque, de mélodies, il ne nous appartient naturellement pas d'en juger les mérites, ni même l'influence. Quant à leur évolution harmonique, c'est, à peu de chose près, celle de la musique française entre 1890 et 1920. Ajoutons qu'il est difficile, pour un artiste, de dire « ce qu'il a voulu faire ». Le sachant mieux que ses confrères, il en parle toutefois moins aisément... On admettra donc qu'aucune page de la présente étude ne soit expressément consacrée à nos propres mélodies, mais qu'à l'occasion nous soyons amené à citer telle ou telle, les rattachant à certaine évolution de sentiment, à l'emploi de nouveaux moyens harmoniques : citations à titre simplement objectif, et toutes réserves faites sur le plus ou moins de valeur des œuvres.
Je ne sais si l'on trouverait en notre XVIIIe siècle français l'origine musicale du Lamento de M. H. Duparc, de la Barcarolle de G. Fauré ou des Fêtes galantes de Claude Debussy. Je ne le pense pas... Cependant, comme d'ailleurs pour toute notre musique moderne, il ne serait pas absurde de remonter à l'influence des Encyclopédistes, et — bien avant celle des poètes romantiques du XIXe siècle — à J.-J. Rousseau. Dans le même temps que l'on se mit à comprendre Shakespeare, l'état d'esprit des Encyclopédistes et de ceux qui prônaient le « retour à la nature » fut une des causes du mouvement romantique, individualiste et lyrique, qui guida l'artiste moderne en de nouveaux chemins.
Musicalement, l'individualisme que montre l'abandon de la romance populaire pour le poème symphonique avec paroles, c'est Berlioz, le premier, qui l'osa. Usant de moyens que dans une époque de décadence harmonique et contrapunctique son génie dut inventer, — moyens dont (un peu injustement) l'on a contesté parfois les qualités musicales, et qui d'ailleurs n'ont pas la subtilité, la perfection charmante des œuvres les plus récentes de G. Fauré — Berlioz écrivit des « mélodies » foncièrement nouvelles. En dépit de certaines faiblesses, on y voit la marque du génie. Assurément, il eut une influence plus grande par ses trouvailles d'orchestre, par sa conception descriptive, évocatrice (cf. la Scène aux champs de la Symphonie fantastique). Il n'en reste pas moins que sa vivacité de sentiment, sa fidélité scrupuleuse au texte, son audacieuse liberté à l'égard des formes en usage, tracèrent les voies que suivirent les modernes français. On connaît trop mal, de nos jours, son recueil de mélodies : inégal, à coup sûr, (avec parfois des naïvetés, et bien des pages qui datent), mais plein de vie et de trouvailles. La tradition populaire des couplets, Berlioz le plus souvent ne saurait s'en accommoder, à cause de la diversité des strophes poétiques. A moins que le caractère spécial du morceau ne l'exige (cf. Chanson du Roi de Thulé), il est trop intelligent pour ne pas la briser ou l'élargir à son gré ; l'indépendance avant tout : spiritus flat ubi vult. — Les anciennes chansons ne montraient pas tel besoin de vérité ; la même musique, dans les couplets successifs, s'adapte tant bien que mal à des idées assez différentes — parfois même contradictoires. De nos jours ces adaptations boiteuses ont disparu ; mais Berlioz semble le premier qui, délibérément, s'y soit refusé. Même dans la Captive, il varie déjà l'accompagnement par les rythmes, les nuances et les timbres. D'autres mélodies vont plus loin encore. Voyez, par exemple, le Lamento du Pêcheur (5). Des harmonies absolument neuves, accords mineurs de tonalités diverses, sous le même dessin de broderie chromatique (do-do dièse-do, ou do-ré bémol-do). Une admirable justesse d'expression : le musicien suit pas à pas le poète. Une forme mélodique et rythmique qui n'use que par instants d'une sorte de refrain (« Ah, sans amour, s'en aller sur la mer ») pour se montrer extrêmement diverse, infiniment libre dans ses aspects successifs, et ces changements ne détruisent pas l'unité de l'ensemble. Conception à la fois lyrique et dramatique, tout à fait nouvelle à l'époque où fut écrite cette mélodie. L'origine en est évidemment dans le respect du texte poétique, d'où naît un commentaire musical qui volontairement oublie la romance à couplets et méprise la mode. Mais il est voisin de certaines œuvres modernes ; et la description du paysage état d'âme, si fréquente à la fin du XIXe siècle, on peut dire que Berlioz l'inaugura dans ce Lamento d'ailleurs ignoré de presque tous nos musiciens... On citerait aisément d'autres mélodies de l'auteur des Troyens ; mais aucune, si je ne me trompe, n'apparaît plus caractéristique que son Lamento.
(5) Sur la célèbre poésie de Th. Gauthier. Dans le recueil de Berlioz, son titre est : Sur la Lagune.
Si l'on feuillette un album de chant de nos grands-parents (de 1830-1860), aucun Français n'y montrera l'équivalent de cet art nouveau. Quelques œuvres de Schubert (heureusement !) et des romances de Loïsa Puget ou de P. Henrion alternent avec des cavatines italiennes et des airs de Mozart. Y eut-il, à cette époque, d'autres précurseurs restés inconnus ? Peut-être, bien que cela ne soit guère probable. Une note charmante d'orientalisme fut apportée par Félicien David, mais spécialement dans Lalla Roukh et dans le Désert car ses « Hirondelles » sont assez romance. Il faut descendre le cours des années jusqu'aux mélodies de Gounod pour rencontrer une musique plus voisine de celle qu'écrivirent, par la suite, M. Duparc et G. Fauré.
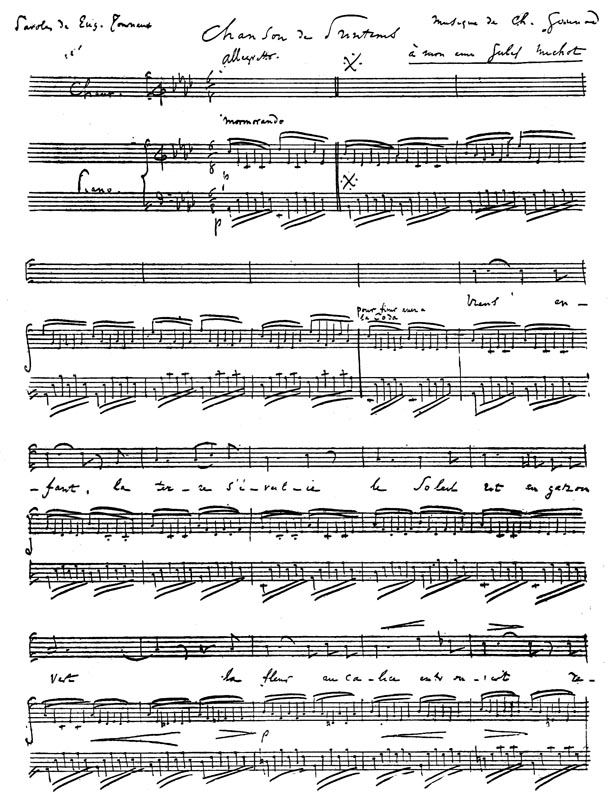
fac-simile d'un autographe de Charles Gounod (communiqué par Madame la baronne de Lassus, née Gounod)
Nous sommes, à présent, assez loin des temps où Gounod fut tour à tour encensé et vilipendé, pour qu'il semble possible d'apprécier à sa valeur réelle l'aïeul charmant de notre Ecole française. Que de nombreux épigones aient provisoirement discrédité sa musique, que les orgues de Barbarie nous aient exaspérés avec « l'air de Siebel », que d'inégales exécutions de Faust (6) aient nui à sa mémoire et qu'enfin les tempêtes wagnériennes aient submergé pour un moment le charme intime et profond de Gounod, il n'importe. De jeunes musiciens d'aujourd'hui lui rendent un culte fervent (7). Ceux d'hier — les meilleurs, du moins (8) — n'avaient pas cessé de l'aimer. Ce n'est pas seulement qu'il ait inspiré tant de modernes par sa mélodie si personnelle : mais reportez-vous à l'époque de Meyerbeer et vous mesurerez tout ce qu'apporta Gounod dans le monde. Une force de séduction que Berlioz n'atteignit qu'exceptionnellement, une technique sûre, acquise d'après J.-S. Bach (9), une façon nouvelle de concevoir le récitatif (si mélodique, si heureusement rehaussé d'harmonies typiques et de modulations expressives) ; enfin, par dessus tout, cette bonté aimante qui, si naturellement, s'épanchait avec une aisance presque mozartienne, — en vérité, ne sont-ce pas les dons d'un grand musicien ? On veut bien s'en apercevoir de nos jours. Et le plus curieux, c'est qu'un Emile Vuillermoz s'y trouve d'accord avec un Jean Wiéner, avec un Georges Auric. Apparemment, ce « soleil musical » luit pour tout le monde !
(6) Et surtout l'admission de Roméo et Juliette à l'Opéra, avec son intempestif et déplorable ballet.
(7) A l'un des Concerts Wiéner du printemps 1923, l'on entend un Quatuor à cordes de Gounod.
(8) Par exemple G. Fauré, M. Ravel, et même Claude Debussy malgré les quelques réserves qu'il ait pu faire.
(9) Que la sœur de Mendelssohn, à Rome, lui avait révélée. Cette technique lui valut d'ailleurs d'être traité par les critiques meyerbeeriens, de scholastique sans mélodie !
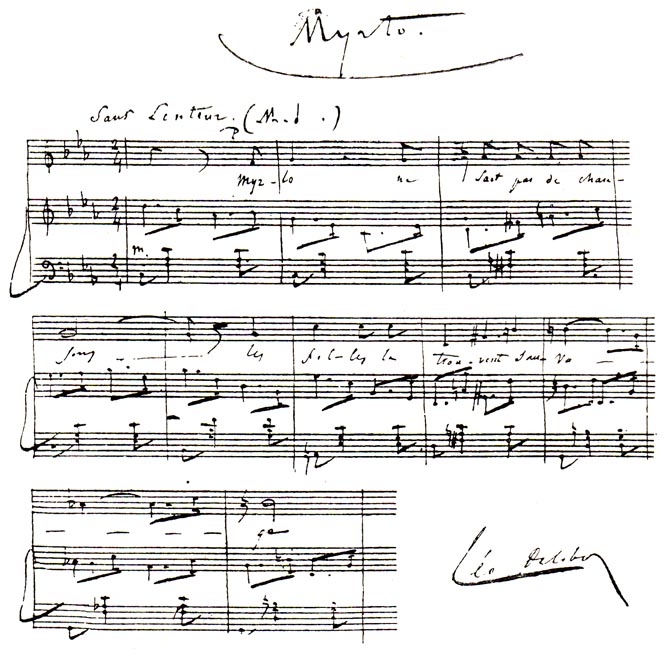
fac-simile d'un autographe de Léo Delibes (Bibliothèque du Conservatoire)
Or, si nous en venons au sujet plus limité qui
nous occupe (qu'on nous excuse ici d'avoir généralisé afin de remettre les
choses au point) l'influence de Gounod en tant que compositeur de « mélodies »
fut prépondérante. Lui aussi, à l'occasion, ne laissa point de rompre la
tradition du couplet. Et lorsqu'il la conserve, — assez souvent d'ailleurs — je
ne sais quelle heureuse fortune veut qu'il réussisse quand même de charmantes
romances. Sa musique est de celles (bien rares) qui supportent la répétition. On
objectera sans doute que la seconde strophe du Vallon n'est pas aussi
complètement que la première dans le caractère de la poésie ; mais, grâce à sa
beauté intrinsèque, on a du plaisir à cette redite. La Chanson de printemps
s'accommode à merveille de la forme à couplets, et surtout cette Venise,
pur chef-d'œuvre, où l'on pressent Henri Duparc et Gabriel Fauré ! A vrai dire,
ces « recueils de mélodies » sont assez mélangés... On y trouve un peu de tout,
l'éditeur ayant fait flèche de bois douteux, des airs d'opéras oubliés, une
mélodie posthume (Repentir), et d'autres qui ne sont guère meilleures ;
mais également, les authentiques premières œuvres, si captivantes, qu'il écrivit
à Rome dans le feu de son inspiration juvénile. Comme il advint plus tard de
Fauré et de Claude
Debussy avec Verlaine, ou de M. H. Duparc avec Baudelaire, Gounod fut
l'interprète rêvé qu'on pouvait souhaiter à Lamartine (10). — Aujourd'hui, si
l'orientalisme de Medjé nous semble un peu conventionnel (charmant
d'ailleurs, ainsi que celui des Adieux de l'hôtesse arabe, de Bizet), la
couleur de Venise, à la date où cette œuvre fut écrite, réalise un
miracle précurseur, et parmi toutes, elle durera comme durent les choses
parfaites, les inventions du génie. — Enfin, la forme libre de Berlioz, Gounod
en offre plus d'un exemple lorsque sa fantaisie ne veut pas s'astreindre à la
régularité des couplets. Voyez, à ce sujet, Boire à l'ombre (d'E.
Augier), sorte de récitatif mélodique d'une extrême variété de contour et
d'accompagnement : elle devance son époque comme les finals de Mozart,
solidement construits mais d'une allure si libre, devançaient la leur.
(10) Cf. le Soir, Solitude, Chant d'Automne, le Vallon.

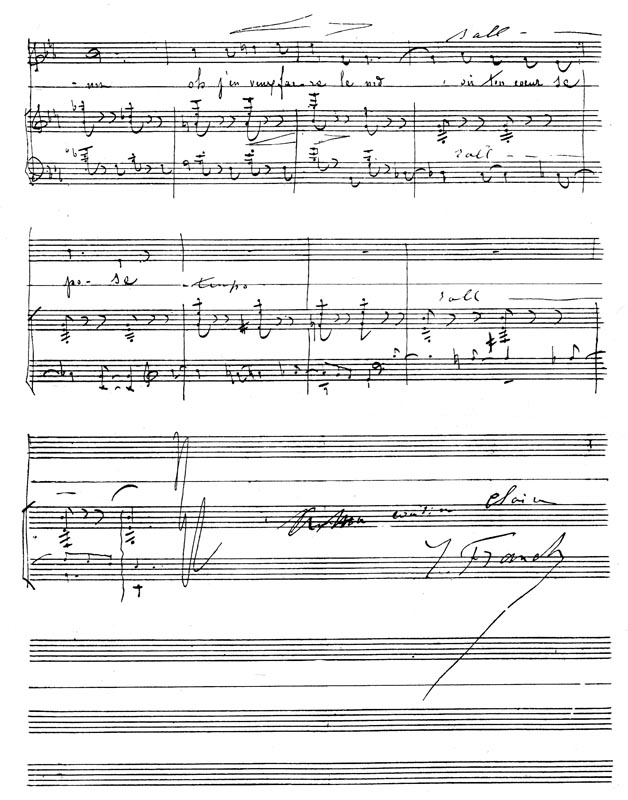
fac-simile d'un autographe de César Franck
Les jeunes musiciens d'alors (Bizet, Saint-Saëns, Ed. Lalo, etc.) bénéficiaient à la fois de cette liberté de forme et des conceptions descriptives de Berlioz ; mais l'influence de Gounod — sensibilité de douceur et de charme — fut si forte qu'elle tourna parfois à la formule chez les disciples privés d'une personnalité triomphante. Ce renouveau de la musique française fut alors plus fécond dans le domaine de la musique de chambre et de la symphonie. Notre Ecole acquérait de nouvelles forces par la technique retrouvée de J.-S. Bach et par la connaissance des grands romantiques allemands ; mais, de 1860 à 1875 (— si l'on excepte quelques précurseurs : A. de Castillon, M. Duparc, G. Fauré —) ce n'est pas dans le genre de la « mélodie » que la musique française innova. Le Lamento de Berlioz, la Venise de Gounod apportèrent au monde plus de nouveauté que tous les recueils de Bizet, de Reyer et de Saint-Saëns (11). Epoque de transition entre la romance banale (qui triomphait au temps de Berlioz et de Gounod), entre le poème descriptif vulgarisé (12) — et la mélodie profondément sensible, évocatrice à la manière de certaines pages de M. H. Duparc. Il ne faut pas médire de ce temps où bien des recherches s'élaborèrent. Il ne faut pas s'étonner que la plupart des musiciens n'aient eu que du talent — talent honnêtement développé par un métier sérieux — et qu'ils n'aient pas su deviner de grands poètes : Leconte de Lisle, Baudelaire, Verlaine. Ce rôle fut celui des Duparc, des Fauré, des Debussy. Il y fallait sans doute quelque génie. Peut-être aussi l'ambiance de la société ne favorisait-elle point cette orientation nouvelle : l'influence de Victor Hugo était prépondérante. Bizet, Saint-Saëns, et jusqu'à Fauré dans ses premières œuvres, s'inspiraient du poète des Contemplations. Mais si Victor Hugo n'aimait pas la musique, on peut dire que celle-ci le lui rendait bien, dénonçant le factice des antithèses et l'inquiétante fantaisie des images. Les meilleures mélodies de Saint-Saëns ne furent pas toujours écrites sur des poésies de Victor Hugo, en dépit de l'aisance avec laquelle l'auteur de Samson et Dalila tournait les difficultés... D'ailleurs la Cloche, Rêverie, eurent leur célébrité ; également, le Pas d'armes du Roi Jean, dont la couleur moyenâgeuse est en sensible progrès sur le Page, écuyer, capitaine d'Ed. Membrée. Aujourd'hui, les jeunes ne sont-ils pas injustes envers ces œuvres qui leur semblent fort vieillies ? Quoiqu'il en soit, les Mélodies Persanes (sur des poésies d'Armand Renaud) offrent à la fois une personnalité plus nette et une beauté plus indiscutable. — Quant à Bizet, malgré les Adieux de l'hôtesse arabe et la charmante Berceuse, ses mélodies restent évidemment très au-dessous de l'Arlésienne et de Carmen. Bien écrites, et d'un réel charme ; mais il y manque cette netteté de frappe, ces trouvailles étonnantes d'harmonies, de rythmes et de modulations qu'à chaque instant l'on admire en ces deux chefs-d'œuvre. — Nous ne mentionnons que pour mémoire le recueil de Reyer, la plupart des pièces qui le composent ne sont d'ailleurs que des airs du Sélam, d'Erostrate ou de Maître Wolfram ; et les quelques mélodies proprement dites sont très inférieures aux belles pages de Sigurd et de Salammbô. — Benjamin Godard eut de grands succès avec la Chanson de Florian, le Cimetière (de la Symphonie légendaire), et la Berceuse de Jocelyn, sans qu'on puisse dire toutefois que ces œuvres agréables soient dignes du Tasse ou de tel entr'acte de Jocelyn. Infiniment plus caractéristiques, les Chansons écossaises de M. Paladilhe, dont la saveur de folklore mérite de n'être point oubliée, — Myrto, de Léo Delibes — et surtout l'Esclave, et Marine, d'Edouard Lalo. Avec ce maître on est loin du « style romance » et des médiocres imitations de Gounod dont semblaient alors se contenter la plupart des compositeurs de mélodies. En ce genre aimable et facile. on ne distinguera pas aisément les œuvres de Bizet de celles qu'écrivirent Guiraud, Léo Delibes, ou M. Paladilhe. Lalo, bien au contraire, y traduit sa propre nature : c'est l'écriture soignée et personnelle, la noblesse d'accents, la tendresse discrète dont témoigne le Roi d'Ys (13).
(11) On peut excepter de cette critique les Mélodies Persanes de Saint-Saëns, qui font entendre une note nouvelle.
(12) Par exemple, ce Page, Ecuyer, Capitaine qui connut tant de succès, et que tout le monde ignore aujourd'hui... Quant à la romance banale, elle est de tous les temps et de tous les pays, répondant aux besoins de la médiocrité.
(13) On notera le développement tout à fait libre de Marine : encore à cette époque, la chose était rare.
Quant à Massenet, on sait de quelle empreinte particulière il marqua la plupart de ses compositions, à ce point qu'en langage musical, ces deux mots : « du Massenet » possèdent une signification très nette. On ne dira point cependant que tous ses recueils soient d'égale valeur. Mais, surtout dans ses premières mélodies, on trouve des pages fort séduisantes et qui sont au nombre des meilleures qu'écrivit l'auteur de Manon. Il y a (comme on dit en astronomie) des « conjonctions » au ciel de l'art. Celle de Massenet et d'Armand Silvestre fut voulue par les Dieux. Sans doute, on rappellera que Fauré comme Alexis de Castillon, collaborateurs d'Armand Silvestre, montrèrent plus d'envergure et de profondeur que Massenet en ses jolis albums : Poème d'avril, Poème d'amour, Poème d'octobre, Poème du Souvenir. Mais le sort même des artistes que réunirent ces Poèmes, tous deux doués d'une incroyable aisance, n'offre-t-il pas quelque chose d'analogue ? (14) Au début, un charme païen s'imposant à l'attention, — puis le succès, et avec lui, le besoin de plaire, de recueillir tous les suffrages ; dès lors, l'inévitable hâte, avec une sorte de condescendance au goût du public. Heures brèves que celles de ces débuts si brillants, heures auxquelles on songe avec un peu de mélancolie. Aujourd'hui, il semble qu'une vague furieuse déferle, soulevée par les cataclysmes sonores du Sacre du Printemps. Elle passera ; que restera-t-il après ses remous ? Probablement, un jour à venir, voudra-t-on bien reconnaître le charme sincère et juvénile de Si tu veux, mignonne, du Chant provençal, de la Sérénade du passant, et même des Enfants, et surtout de Nuit d'Espagne... Ce charme, que pour notre part nous croyons très réel, on le mesure aussi bien en le comparant à celui, beaucoup plus faible, de toutes les imitations qu'il engendra. On sait l'influence exercée par Massenet sur certains de ses élèves, comme sur d'autres musiciens dont il ne fut pas le maître. Habiles compositeurs, prix de Rome pour la plupart, experts et corrects, ils n'auront pas dégagé une personnalité aussi nette que leur modèle. D'ailleurs la plupart n'ont écrit des mélodies que par surcroît à leurs œuvres théâtrales, ces mélodies n'étant point une nécessité de leur art, comme elles le sont par exemple chez M. Duparc.
(14) Mettons à part, bien entendu, le côté humoristique de l'œuvre d'Armand Silvestre.
Qu'on nous excuse, ici, de « déblayer » quelque peu... Il pourra sembler étrange que nous consacrions des pages à l'étude détaillée des mélodies de Claude Debussy, de Fauré, de M. Duparc, et qu'au contraire il nous suffise de ne citer, en ce moment, que des noms (ou peu s'en faut). Mais aussi bien, il ne doit point s'agir d'égalité de traitement. Si d'une part tels de nos grands musiciens créèrent des œuvres qui les représentent profondément, d'un autre côté, innombrables sont les compositeurs ayant improvisé en quelques heures de loisir, d'aimables bluettes dont le besoin ne se faisait pas sentir et dont on ne peut même estimer qu'elles traduisent la personnalité de l'artiste. Dans cette foule, il existe des « indésirables » : amateurs adroits, ou maladroits professionnels, également insignifiants, et qu'il nous semble inutile de même nommer ; — on en connaît aussi de beaucoup plus sérieux, ayant laissé par ailleurs des œuvres théâtrales ou symphoniques assez importantes. Les mélodies, chez eux, ne sont que l'accessoire ; il est bien naturel que nous n'étudiions point cet accessoire par le détail. Musique écrite souvent sur de médiocres poésies, sans grande conviction, sans caractère personnel, et perpétuant assez bien la tradition d'effacement relatif des mélodies de Bizet, de Reyer, de Th. Dubois, etc. Ce qui ne signifie point qu'à l'occasion l'on n'y rencontre de fort agréables pages... (15) Parmi ces successeurs de Massenet, les uns déjà d'autrefois, d'autre beaucoup plus récents, nous citerons les frères P. et L. Hillemacher, G. Marty, M. Paul Vidal, Xavier Leroux, M. G. Pierné (16), M. E. Moret, M. Ch. Levadé et enfin M. Reynaldo Hahn, dont les œuvres (Chansons grises, Etudes latines, etc.) sont les plus connues, sans doute, parmi toutes celles de ce groupe. Elles obtinrent, à leur apparition, de tels succès chez les « gens du monde » que certains enthousiastes les tenaient pour supérieures aux mélodies de Massenet, d'où on les sentait issues. Cela nous semble fort contestable ; et si le soin de M. Hahn en matière de prosodie est plus scrupuleux encore que celui de Massenet, si les recueils du maître sont inégaux, ce qu'ils contiennent de meilleur nous paraît à la fois plus personnel et plus significatif. — Enfin, à cause d'une sorte d'expansion un peu théâtrale et qui va parfois jusqu'à certaine emphase naïve, on pourrait croire qu'il y ait quelque massenétisme dans les mélodies (trop oubliées aujourd'hui) d'Augusta Holmès. Coïncidence plutôt, et d'ailleurs ressemblances superficielles, non réelles (17). Cette ardente musicienne n'était pas quelconque. De hautes visées (d'autant plus hautes qu'elle était envoûtée par Wagner, grande prêtresse de la religion nouvelle qui se fondait alors avec la Revue wagnérienne), des dons mélodiques indéniables, une passion sincère, — mais une technique inégale, l'impossibilité de s'exprimer avec la force et la profondeur désirables : bref, le contraire d'un art grec. Toutefois, ce qu'elle écrivit n'était pas inexistant. Les erreurs, les manques de goût s'étalent si franchement qu'on est presque désarmé. Entre l'enthousiasme de Villiers de l'Isle-Adam et le dédain des modernes, il y a de la marge ; l'opinion de Claude Debussy ne lui était point si défavorable, et Debussy savait ce qu'il disait...
(15) Cf. Séparation, des frères Hillemacher ; la Rieuse, de M. Pierné, les Vieilles de chez nous, de M. Levadé, etc.
(16) On reviendra plus loin sur certaines œuvres humoristiques de M. Pierné, où réellement ce musicien donna quelque chose de lui-même.
(17) Encore que l'air d'Hérode : Vision fugitive serait assez Holmès.

fac-simile d'un autographe d'Alexis de Castillon (Bibliothèque du Conservatoire)
Cette hantise de l'ampleur, ce besoin d'élargir l'inspiration (même en des mélodies), cette ambition de puissance qu'avait Augusta Holmès (18), naturellement César Franck les ressentit, ainsi que ses élèves. L'influence combinée de Franck et de Wagner s'exerça principalement de 1880 à 1900. Si, dans le domaine symphonique, on put entendre des œuvres ennuyeuses à la Société Nationale, il faut être juste : l'ampleur (atteinte ou non) favorisait une tendance utile à ce moment au développement de la musique française. Il y eut du sublime raté, ce qui est fâcheux ; mais il y eut aussi beaucoup d'enthousiasme, d'ardeur sincère, et de courage, toutes choses nécessaires à l'élaboration d'œuvres que le goût du public ne protégeait nullement. — D'autre part, l'orientation des musiciens vers la légende, vers la nostalgie tristanesque ou la piété franckiste, vers l'infini des vastes sommets, — si trop souvent elle les conduisit à des œuvres mort-nées, d'un déplorable pessimisme, en revanche elle les guida vers les chemins nouveaux ; ils apprirent à aimer des poètes que la génération précédente ne connaissait guère (19) : nous voulons parler, notamment, de Baudelaire, dont l'influence fut considérable sur la musique des mélodistes français, avant que ne s'exerçât celle de Verlaine, de M. Henri de Régnier, de M. Maeterlinck. Enfin, César Franck et certains de ses élèves (Alexis de Castillon, M. H. Duparc), comme de son côté G. Fauré, conçurent pour la mélodie un art tout différent de la romance d'autrefois, également très loin du ton familier de la chanson ou de la plainte intime du lied. Haute noblesse d'Alexis de Castillon, nostalgie profonde de M. H. Duparc, pur mysticisme de César Franck : c'étaient des aspects nouveaux, dont la beauté n'est pas niable. Mais, comme on voit toujours des excès chez les disciples, les successeurs de ces musiciens en vinrent à dédaigner trop souvent l'art familier, à ne viser qu'au sublime ou bien à se noyer dans les flots noirs d'un océan de pessimisme. Il fallut alors des réactions nouvelles : celles de Chabrier, de Debussy, de M. Ravel, et des « jeunes » d'aujourd'hui, pour montrer avec évidence la légitimité d'un art qui n'est pas constamment sublime. Mais tout d'abord, les tendances wagnériennes et franckistes eurent d'assez bons effets (20) dans le genre qui nous occupe : la mélodie pour piano et chant. Il est à noter d'ailleurs que les plus parfaits de nos musiciens modernes — j'ai nommé Claude Debussy et G. Fauré — ne furent pas exempts de ces influences (encore que le premier recueil de G. Fauré soit antérieur à l'idolâtrie wagnérienne). Mais ils les assimilèrent de la façon la plus heureuse, sans rien perdre de leur personnalité, sans cesser de rester toujours de chez nous. Ils n'y prirent qu'un encouragement à la libre, lyrique et large expression (cf. Poèmes de Baudelaire et Proses lyriques, de Claude Debussy ; Larmes, Nocturne, Automne, etc., de G. Fauré).
(18) Sans réussite, d'ailleurs ; et il convient de rappeler que M. H. Duparc y parvenait aisément dans la Vie antérieure, comme G. Fauré dans son Chant d'automne. Mais les œuvres de M. Duparc, écrites de 1870 à 1875, ne furent éditées et connues qu'après 1890 ; de même, il fallut un long stage à Fauré avant de parvenir à quelque notoriété, au temps où tous les éditeurs (sauf un, plus malin) refusaient de s'intéresser à ses mélodies admirables. C'est pourquoi nous réservons pour plus loin l'étude de ces grands musiciens.
(19) A l'exception, bien entendu, de M. Duparc et de Fauré, qui dès longtemps avaient « découvert » Baudelaire.
(20) Dût-on crier au paradoxe, nous ajouterons que l'effet du wagnérisme et du franckisme fut moins louable dans l'art symphonique. La mélodie étant forcément limitée par les paroles, les disciples ambitieux ne risquaient point d'y céder à l'envie d'écrire de trop vastes développements. Et souvent la personnalité de tel musicien de valeur se trouve mieux traduite en des mélodies qu'en une symphonie entière : témoin Ernest Chausson.

fac-simile d'un autographe de Charles Bordes (propriété de la maison Rouart et Lerolle)
Pour César Franck lui-même, si l'essentiel de son œuvre se trouve dans la symphonie, l'oratorio et la musique de chambre, certaines de ses mélodies témoignent d'une inspiration et d'une technique incomparables. La Procession forme un tout : développement symphonique en raccourci, d'une réalisation très nouvelle, sans préjudice de l'unité et de la logique musicale. Elle est profondément franckiste au meilleur sens du mot, dans une expression à la fois panthéiste et chrétienne dont les ans n'ont pas altéré la beauté. Le Nocturne est une admirable rêverie sous la voûte étoilée, où la bonté naturelle du « père Franck » se donne libre carrière. Je sais bien que de nos jours on trouve élégant de railler cette bonté... Evidemment, à cause d'elle le musicien fut limité dans ses inspirations. Voyez le passage célèbre des Béatitudes : « poursuivons la richesse avec ardeur ». Banal et sec, il sonne faux, c'est entendu. Mais si d'autres artistes, par la suite, ont su traduire la violence des mauvais instincts humains, à ceux-ci la splendeur du Nocturne de Franck demeurera toujours étrangère. Elle leur passe à cent pieds par dessus la tête, et nous avons le droit de préférer ce genre de beauté, en face de tels « dynamismes » actuels et féroces.
Parmi les plus anciens élèves de Franck, après M. Henri Duparc (dont nous étudierons plus loin, par le détail, l'œuvre incomparable), il convient de ne pas oublier Alexis de Castillon, mort trop jeune pour avoir donné toute sa mesure : jadis incompris pour son modernisme, aujourd'hui dédaigné, démodé... Au demeurant, un noble musicien dont certaines pages sont d'une réelle et touchante beauté. Il écrivit, sur des vers d'Armand Silvestre, Six mélodies, presque ignorées et pourtant bien au-dessus de ce qu'on faisait alors (à l'exception des œuvres de M. Duparc et de G. Fauré) ; le Semeur, le Bûcher, la Mer, sont des poèmes puissants dont l'ampleur permit l'interprétation orchestrale (21) récemment entendue aux Concerts Colonne. Renouveau, Sonnet mélancolique, les Vendanges (avec, par instants, des accents schumanniens) donnent à l'inspiration d'Armand Silvestre sa grandeur véritable, ou si l'on veut, l'augmentent de tout ce qu'y ajouta l'âme hautement mélancolique d'Alexis de Castillon.
Charles Bordes aussi mourut jeune et n'est pas estimé à sa valeur. On connaît son admirable dévouement à la cause des Chanteurs de Saint-Gervais et de la musique du XVIe siècle ; mais l'on ignore ses propres compositions ; et lui-même, si peu arriviste, ne s'occupa guère de les lancer... L'un des premiers il découvrit Paul Verlaine (cf. le Soleil du matin, Dansons la gigue, etc.). Il y a dans son inspiration une naïveté charmante, que certains tiennent pour gaucherie de primitif, mais que l'absence de formules et la parfaite sincérité font attachante et vivante, — alors que tant de mélodies faciles et banales ornent les pianos de toutes les « jeunes filles en fleur »...
(21) Cette orchestration fut réalisée, il y a quelques années, par le signataire de ces lignes.
G. Lekeu appartient à l'Ecole belge, bien qu'ayant vécu en France. Signalons pourtant ses Trois poèmes, fort caractéristiques de la manière et du sentiment si personnels de ce musicien profond, mort à la fleur de l'âge, et qu'un génie précoce animait lorsqu'à vingt et un ans il écrivit son très bel Adagio pour instruments à cordes.

fac-simile d'un autographe de Guillaume Lekeu (propriété de la maison Rouart et Lerolle)
De M. d'Indy, il n'existe que peu de mélodies. Mais leur forme est intéressante par la liberté et l'allure symphonique. Clair de lune (d'après une des Orientales de V. Hugo), œuvre de jeunesse, pour chant et orchestre, largement conçue, mériterait d'être exécutée à nouveau dans les grands concerts. On connaît mieux le Lied maritime, souvent chanté, et dont M. d'Indy lui-même écrivit les paroles. L'amour terrestre y est dépeint (comme fit maintes fois l'auteur de Fervaal) avec l'instabilité inquiète d'un sentiment qui torture dans la volupté : cette conception ne saurait surprendre chez celui qui composa la Légende de Saint-Christophe. M. Pierre de Bréville, M. Guy Ropartz ont écrit de nombreuses œuvres vocales. De celui-ci, nous citerons plus particulièrement la Mer (sur un charmant thème populaire breton) ; l'Intermezzo (suite cyclique de quatre poèmes lyriques d'après H. Heine) ; et la série de mélodies à la mémoire de Charles Guérin. Du musicien d'Eros vainqueur, des paraphrases de chansons françaises : le Furet, Nous n'irons plus au bois, etc. ; les Petites litanies de Jésus, Bernadette, où se traduit une foi sincère... Que manque-t-il à ces deux compositeurs pour atteindre la profonde beauté fauréenne, ou pour s'égaler parfois à l'ampleur confiante, naïve et forte, de César Franck ? Peu de chose, peut-être ; mais ce peu, en matière d'art, on ne saurait le négliger. Sans doute M. de Bréville s'est-il exprimé avec plus de véhémence et de façon plus complète dans sa Sonate pour piano et violon, ainsi que d'autre part M. Guy Ropartz dans sa Sonate pour piano et violoncelle.
Ernest Chausson, bien que mort jeune encore, laissa deux importants recueils de mélodies : certaines sont parmi les meilleures de ses œuvres. La profonde douleur qui s'exhale de Nanny, notamment, se trouve exprimée avec un rare bonheur. Le Nocturne (sur une poésie de M. Maurice Bouchor) est d'une fraîcheur de sentiment, d'une pureté lumineuse tout à fait séduisantes, sans qu'à nul instant le joli en soit mièvre ou banal. Les Serres chaudes (Chausson fut un des premiers musiciens à connaître les poèmes de M. Maeterlinck) montrent une passion véhémente et point factice. Les Heures, le Temps des lilas, sont de belles traductions de la profonde mélancolie, du pessimisme naturel d'Ernest Chausson ; — le Cantique à l'épouse, la Chanson bien douce, la Forêt du rêve et de l'enchantement doivent rester dans toutes les mémoires : bien que trop rarement chantées, ces pièces ne sont pas inférieures à la Chanson perpétuelle, qui jouit d'une certaine célébrité. — Dans l'œuvre de ce musicien, plus d'une page, plus d'un morceau se ressent de l'influence wagnérienne et de l'enseignement franckiste, mais il est permis de tenir ses mélodies (avec telles parties de sa musique de chambre) pour l'expression la plus complète, la plus originale, d'une personnalité fort attachante. L'on regrette infiniment qu'une mort prématurée l'ait privé de donner sa pleine mesure ; et quoiqu'il en soit, la plupart de ses mélodies sont en bon rang parmi toutes celles de l'Ecole française moderne.
M. Henri Duparc, comme l'on sait, n'a composé qu'une dizaine de mélodies, plus un poème symphonique : Lénore, — la maladie l'ayant privé de la joie de traduire les idées musicales qui naissaient en lui. Que d'obstacles, hélas, à la production musicale de l'humanité ! Les uns ressentent vivement, mais leurs dons proprement musicaux, et parfois aussi leur technique ne leur permettent pas de s'exprimer avec l'entière beauté qu'on aurait voulue. D'autres n'ont qu'une extrême facilité d'assimilation, sans idées personnelles, sans même qu'on puisse dire qu'ils vivent en dehors du souvenir des maîtres. Tel est handicapé par les soucis matériels, et n'a point la santé qu'il faudrait pour travailler, le soir, après la fatigante besogne du gagne-pain familial. Tel donne de merveilleuses promesses, et meurt à vingt ans ! Pour M. Duparc, il n'exista sans doute à son époque aucun musicien mieux doué, aucun artiste plus ému ; et, par une fatalité déplorable, il n'a pu léguer à ses admirateurs qu'un mince recueil de mélodies : mais d'un prix si haut, avec de si profondes beautés qu'elles le sacrent, dès lors, l'un de nos premiers compositeurs et l'un des plus grands, malgré les courtes dimensions de ses œuvres.
Un artiste de génie est toujours un précurseur. Il ne marche ni avec la mode, ni même parfois avec le goût de son époque. Il la devance, escorté d'une petite élite... En un temps où la clarté pure de l'Arlésienne et de Carmen n'était que grisaille obscure (22) aux oreilles incultes des auditeurs du Vaudeville et de l'Opéra-Comique, alors que le Concerto de Castillon était sifflé à l'égal du prélude de Lohengrin, M. Henri Duparc (23) s'avisa de la splendeur nostalgique de Baudelaire ; il écrivit d'admirables mélodies sur l'Invitation au voyage et la Vie antérieure. La simplicité des harmonies ne nous donnera point le change. Tout était nouveau dans ces œuvres, sentiments et modulations. Dès lors, nul n'a le droit de s'étonner qu'elles soient restées incomprises de presque tout le monde, — éditées seulement vers 1892 et ne devenant célèbres que plusieurs années après. L'avènement, dans la musique, de la sensibilité baudelairienne : chose capitale. Songez aux poètes préférés des musiciens, de 1870 à 1880; c'étaient d'une part Théophile Gautier et Victor Hugo, dont les vers ne sont pas toujours favorables à l'expression musicale ; — de l'autre, Armand Silvestre, à l'égard duquel l'opinion contemporaine est probablement injuste et qui fut pour Massenet, de Castillon, M. Duparc et G. Fauré, un précieux animateur, — mais que l'on ne saurait égaler, de loin, à Leconte de Lisle, à Baudelaire, à Verlaine. Il faut d'ailleurs un certain délai avant que la musique ne découvre les moyens d'interpréter des poésies nouvelles en toute leur beauté. L'art de la mélodie tel que nos modernes l'ont conçu, exige et suggère mille trouvailles — plus hardies parfois que celles découvertes à la même époque dans le domaine de la « musique pure ». Il semble que l'imagination créatrice des compositeurs y soit particulièrement favorisée, et qu'ensuite ils retrouvent, pour leurs œuvres symphoniques, des idées, des harmonies, des modulations à quoi ils furent incités par la tâche ardue, mais si captivante, de mettre en musique les belles poésies (24).
(22) Le premier acte de Carmen est terne (sic), écrivait un critique au lendemain de la première.
(23) Et dans le même temps, Fauré (Cf. 1er recueil de mélodies).
(24) Il passe comme des souvenirs de la Bonne chanson dans le Nocturne en Ré b. et dans le Final de la Seconde Sonate de Violon ; la Forêt de Septembre et la Chanson d'Eve ne furent pas sans laisser de traces dans le Second Quintette, etc.

fac-simile d'un autographe de Vincent d'Indy (propriété de la maison Rouart et Lerolle)
Le langage musical des mélodies de M. Duparc, de certaines qu'écrivit G. Fauré vers la même époque (Automne, les Berceaux, Chant d'automne), et de quelques passages d'Alexis de Castillon (« nous semons nos espoirs »...) montre une évolution harmonique parallèle à celle de César Franck, dans l'emploi des accords de septième et de leurs résolutions exceptionnelles (25). On y trouve des modulations imprévues, comme celles de la Sérénade florentine de M. Duparc dont le mi b initial annoncerait le ton de si b, et qui cependant est nettement en fa dès la première phrase du chant. Sauf Bourgault-Ducoudray, personne sans doute ne dut comprendre cette façon désinvolte de passer de l'hypophrygien au majeur classique ! On goûte en ces œuvres une largeur de pensée singulière — peut-être due à l'influence de Wagner, et fort nouvelle, car les mélodies de Bizet, de Léo Delibes, de M. Paladilhe, de Massenet, dérivent directement de celles de Gounod. Mais ces détails de technique n'ont qu'une importance relative, elles ne donnent aucune idée de ce que sont les œuvres. Comment, par des mots, y parvenir ? Le critique a le droit pourtant. il a le devoir de s'efforcer à son tour de traduire les sentiments qu'exprime la musique. Si maladroits que soient ces mots, et si étroitement précis, ils restent cependant des auxiliaires que l'on doit employer ; et le résultat n'est pas forcément une vaine rhétorique.
(25) Notons d'ailleurs que les mélodies de M. Duparc et de Fauré auxquelles nous faisons allusion, sont antérieures aux principales œuvres de César Franck.
L'Invitation au Voyage et la Vie antérieure resplendissent de cette étrange lumière baudelairienne, éloignée et vive tout à la fois, — irréelle : mirage. reflet d'une vision apparue sur de lointains horizons de rêve, — avec quelque chose de mystique, de majestueux, et de quasi religieux dans sa hantise de l'au-delà. Evocation de paysages qui sont en nous-mêmes, ou suggestion d'un passé qu'on devinerait par intermittences à la manière du héros de La plus belle histoire du monde. Il faut que cette impression soit bien forte et qu'il se dégage de cette musique une perpétuelle beauté, pour qu'à nos jours de complication harmonique et d'indépendance tonale, ces mélodies aux accords familiers nous émeuvent à chaque audition nouvelle comme si nous les entendions pour la première fois (26).
(26) On retrouve aussi cette nostalgie de la lumière dans le Chant d'automne de G. Fauré, également écrit sur une poésie de Baudelaire, — d'ailleurs d'allure plus dramatique, et moins mystérieusement lointain.
Auprès de ces deux chefs-d'œuvre de M. Duparc, certaines de ses autres mélodies apparaissent, je ne dis pas prosaïques, mais plus voisines de la vie réelle, d'une atmosphère normale, d'une moins étrange séduction, et cependant fort belles : ce sont, par exemple, la Vague et la Cloche, et le Manoir de Rosemonde ; elles montrent un Duparc vigoureux, rythmé, faisant présager ce qu'il eût écrit dans ce genre de passion dramatique, si la vie le lui avait permis. — Le Testament et le Lamento inaugurent des accords sombres, chers aux franckistes et dont ceux-ci abusèrent quelque peu dans la suite. Mais chez M. Duparc, étant des trouvailles personnelles, ils gardent leur accent. Ces mélodies offrent un caractère très saisissant, dans leur profonde et lugubre mélancolie, exempte d'amertume. La Chanson triste n'est pas aussi lointaine, pas aussi baudelairienne qu'on aurait pu l'imaginer, d'après la touchante poésie de Jean Lahor (« Dans ton cœur dort un clair de lune... je me noierai dans sa clarté »). Elle n'est que tendrement et passionnément émue ; on l'accueillerait avec joie chez un compositeur de second ordre, mais évidemment elle ne suffirait pas à consacrer la renommée du grand musicien qu'est M. Duparc. Soupir nous semble la plus fidèle traduction de la douce et saine intimité de Sully Prudhomme.

fac-simile d'un autographe d'Ernest Chausson (propriété de la maison Rouart et Lerolle)
Quatre mélodies encore, et c'est tout. Mais d'une incomparable beauté. (Peut-être même Extase et Elégie surpassent-elles la Vie antérieure).
La Sérénade florentine : étrange rencontre ; on la dirait écrite, pensée par Gabriel Fauré. De telles analogies sont fort rares, et d'autant plus que le style de Fauré semble inimitable (du moins avec une beauté égale à la sienne). Une commune influence du charme italien, une semblable façon de le concevoir musicalement, furent sans doute les causes de cette analogie. En définitive la Sérénade florentine, avec ses subtiles modulations, est du « bon Fauré », — comme on dirait aussi de la Venise de Gounod, et sans que cela puisse en rien diminuer le musicien de la Bonne Chanson.
Phidylé, l'une des plus connues du recueil, marque l'avènement de Leconte de Lisle dans la musique (27). Emplie d'un large panthéisme au souffle tranquille, puissante, harmonieusement païenne, — sereine comme un beau paysage virgilien aux bois d'yeuses parsemant les collines.
(27) Lydia, de M. Fauré, lui est un peu antérieure.
Il est d'ailleurs étrange que les œuvres de Leconte de Lisle, par la suite, n'aient pas inspiré un grand nombre de musiciens.
Extase est encore du Baudelaire, quoique de Jean Lahor (28), — et du « Tristan » aussi. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait une plus belle inspiration dans le duo de Tristan et Yseult, même à l'appel de Brangaine, que cette invitation d'Extase au nirvâna de la mort. Et que l'on n'objecte point que c'est de l'art morbide « à cause qu'il conclut au néant ». Dire le néant avec cette beauté, c'est précisément une admirable lutte, la plus efficace, contre ce néant même. Et c'est donc le nier. Quand la musique atteint à nous dissoudre dans un accord comme s'il anéantissait toute chose extérieure, c'est du très grand art, et ne s'en démoralisent que ceux-là seuls dont l'être intime ne saurait comprendre la vraie beauté. Celle-ci est toujours réconfortante.
(28) Jean Lahor subit à coup sûr l'influence de Baudelaire ; ses poésies sont toutes pleines d'une nostalgie qui va jusqu'à se vouloir noyer dans l'oubli total — le Nirvâna hindou.
Enfin, l'Elégie : peut-être, avec l'Extase, le summum de ce recueil. Il nous faut insister, car on ne chante pour ainsi dire jamais cette œuvre admirable. Evidemment, ce n'est point un succès assuré pour l'interprète, dans un salon mondain... L'émotion d'Elégie est d'ordre intérieur et tangible à la fois. Abstraite, si l'on veut : un cœur qui bat sourdement, un deuil si profond qu'on n'en parle pas, puisqu'il nous possède, étant notre vie même ; et puis, surgissant de cette douleur, comme un attendrissement de toute la nature.. De la matière musicale semble s'exhaler un charme immense et très doux. Et la douceur de cette sensibilité anime le développement d'une vie intense. Quelques lignes, — et cela est ample, grand, universel... car l'ampleur n'est pas de faire beaucoup de bruit, ni de répéter cinquante fois un thème majestueusement, prud'hommesquement solennel, — mais de composer une ligne de chant qui s'élève, plane et retombe, comme le pur dessin d'une colline parfaite, — ayant soutenu ce chant de sa propre beauté harmonique, celle-là exactement qui convient à cette mélodie.

fac-simile d'un autographe d'Henri Duparc (propriété de la maison Rouart et Lerolle)
C'est le cas de l'Elégie ; réalisée par une écriture d'ailleurs fort raffinée quant aux accords et quant aux dessins de l'accompagnement, c'est pourtant l'absolue simplicité, parce que tout y est à sa place et que la ligne a quelque chose de définitif. On ne songe pas à penser aux hardiesses harmoniques (deux neuvièmes de suite, dès le début) : c'est si justement ce qu'il fallait, qu'on ne saurait imaginer un autre moyen pour commenter la douleur qui s'exhale de cette poésie.
Ecrites vers 1875, on ne connut les mélodies de M. Duparc qu'après 1890. Mais elles étaient si fort en avance sur leur époque, que même en 1895 le style en parut nouveau (29). C'est pourquoi nous placerions en regard, comme d'un temps analogue, l'œuvre d'Emmanuel Chabrier, en réalité légèrement postérieur à celui de M. Henri Duparc. Le recueil de Chabrier n'est pas considérable non plus, par le nombre des mélodies : encore contient-il un chœur (Ode à la Musique), certain arrangement d'España (d'ailleurs contestable, avec des paroles faites après coup), et des fragments du Roi malgré lui. A côté de ces suppléments, cinq mélodies proprement dites : Chanson pour Jeanne, Credo d'amour, Lied, l'Ile heureuse, Toutes les fleurs. Puis, humoristiques et descriptives : Ballade des gros dindons, Pastorale des cochons roses, Villanelle des petits canards, — et les Cigales, qu'on peut réunir à ce groupe animalier.
(29) Ainsi des chants populaires si simples et si larges de l'Espagne, par exemple (cf. Cancionero espanol de F. Pedrell).

fac-simile d'un autographe d'Henri Duparc (propriété de la maison Rouart et Lerolle)
On redirait ici ce qu'on a dit souvent au sujet de Chabrier : il est un mystère de naïveté fine et de grosse truculence. Paradoxe que cette union ; paradoxe aussi, d'employer des accords réputés « vulgaires » mais de s'y prendre avec une si parfaite bonne grâce qu'on ne saurait y trouver qu'un charme de plus (voyez, par exemple, les sixtes et quartes de la Bourrée fantasque). Ses mélodies, sans doute, ne sont pas le plus caractéristique de son œuvre (30) ; mais elles possèdent ses qualités précieuses ; notamment cette vive spontanéité (31), et cet attendrissement un peu sensuel, exempt de toute prétention : à la nature même du musicien. En d'autres pages, on trouverait une évolution harmonique plus accentuée (cf. Briséis). Toutefois ce recueil de mélodies ne manque ni de raffinement ni de nouveauté. Et cela reste si profondément personnel ! Enfin, la Ballade des gros dindons, la Pastorale des cochons roses et la Villanelle des petits canards créaient un comique, je crois bien, inconnu jusque là. Il est intimement mélangé de poésie — d'une agreste et charmante poésie de verger normand ; il est essentiellement musical, avec des harmonies savoureuses et justes ; il est aussi loin de l'opérette que de la mascarade. Cela seul suffirait à faire vivre le nom de Chabrier ; mais rappelons encore une fois (puisqu'on a prétendu (32) que ce grand musicien avait fait fausse route au théâtre), rappelons que s'il avait le génie du comique, il n'avait pas que ce génie. Pensez, seulement, à l'Epithalame de Gwendoline, à l'air de Henri de Valois, du Roi malgré lui, — et relisez l'admirable Ode à la Musique... Chabrier, en des temps de pessimisme et de noirs accords, avait créé de la lumière... Il avait désenguignonné le royaume de la Déesse adorable parce qu'il avait eu la franchise de l'adorer humblement, et, sincèrement, de sourire. Mais déjà, depuis assez longtemps, un compositeur encore peu connu vers 1890 et dont on se bornait à concéder qu'il avait écrit « quelques jolies mélodies », Gabriel Fauré, serait apparu comme un précurseur de Chabrier dans les jardins enchantés, si le monde des mélomanes lui avait rendu justice. Car songez que Lydia, la Sérénade Toscane, sont contemporaines des mélodies de M. Duparc, (peut-être même les croirions-nous antérieures). Songez que la très belle Sonate pour piano et violon fut écrite plusieurs années avant celle de César Franck !
(30) Nous rappellerons plus loin la charmante et belle Ode à la Musique.
(31) Chabrier écrivait sans hâte, et ses mélodies ne sont aucunement des improvisations. Mais il avait des idées si nettes, si saillantes, il trouvait si bien (en y mettant le temps) les moyens de les mettre en valeur, que toutes ces pièces donnent une impression de parfaite spontanéité.
(32) Cf. la conférence de M. d'Indy, lors des « concerts historiques » à l'Opéra, conduits par M. Rhené-Bâton avec l'Association des Nouveaux Concerts Pasdeloup.

fac-simile d'un autographe d'Emmanuel Chabrier (Bibliothèque du Conservatoire)
Lente, longue évolution. Elle commence au premier recueil de mélodies, pour aboutir à l'Horizon chimérique... Je ne pense pas qu'il existe de plus bel exemple d'une ascension continue vers la beauté. Chose incroyable : le jeune, le timide, le maladroit élève (disons-le sans crainte) qui débuta par le Papillon et la fleur, est devenu le maître glorieux à qui nous devons la Bonne chanson et le Jardin clos !
G. Fauré n'eût-il écrit que ses mélodies, cela suffisait pour qu'il fût désigné (comme l'écrivait Gaston Carraud) « le plus grand musicien actuellement vivant, dans le monde ». Nul peut-être ne fut choisi par les Dieux avec autant de certitude, pour traduire en musique, pour faire vivre dans son art l'âme des poètes. Il apparaît comme un devin aux secrets magiques. C'est une pénétration instinctive et voulue à la fois — parfaite et totale, à ce point qu'il en arrive à dégager jusqu'aux défauts des poésies médiocres. Celles-ci (heureusement rares dans ses recueils) ne lui inspirèrent que des mélodies de second ordre (En prière, Notre amour, Rêve d'amour). En revanche, lorsque les poèmes ont une réelle beauté, cette beauté se complète, s'amplifie, ou plutôt se révèle exactement elle-même, apparue dans son essence profonde, une fois parée de la musique fauréenne. Chose étrange, car cela ne cesse pas d'être « du Fauré », et dans le même temps chaque œuvre à son tour dévoile l'âme de Verlaine, de Samain, de Van Lerberghe, avec un fidèle respect dont on admire le tact, mais aussi avec un besoin de vérité qui scrute l'être intime et met le cœur à nu... Tout a été dit (33) sur la grâce audacieuse, sur la nonchalance révolutionnaire de ses réalisations harmoniques : modulations paradoxales si l'on s'en tient à la logique ordinaire, mais excellentes et nécessaires au sens musical. Un langage nouveau, sans de réels néologismes d'agrégations de notes : nouveau par le sentiment, par les enchaînements d'accords, par l'écriture des parties, les mille résolutions exceptionnelles, l'emploi subtil des septièmes, des préparations par échanges, des seconds renversements, et de ces accords de seconde ou de « triton », dont la basse monte... Il y a sans cesse des accrocs aux règles strictes, à ce qu'on pourrait appeler la scholastique grossière des traités d'harmonie, et néanmoins le style garde une pureté que Bach et Mozart n'ont pas dépassée, je dirais même presque pas atteinte. Mais cette perfection, qui est de la profondeur, atteint si profondément en effet dans le sanctuaire intime de chaque poésie, qu'elle y découvre des choses insoupçonnées et qu'elle avère certains poètes, parfois, plus grands qu'on ne le croyait : un Verlaine d'une aristocratique distinction, un Horace à la tendre philosophie, un Leconte de Lisle ardemment passionné, un Armand Silvestre (cf. le Secret) d'une exquise pudeur. Croyez le bien, c'est le musicien qui a raison, et l'opinion publique a tort.
(33) Notamment par M. E. Vuillermoz : cf. Musiques d'aujourd'hui ; le numéro d'octobre 1922 de la Revue Musicale, etc.
On comprend qu'ainsi révélatrices du cœur humain, ces mélodies, œuvres brèves, soient beaucoup plus grandes qu'on ne l'imagine parfois. Elles nous donnent un exemple réconfortant et salutaire. Chabrier déjà, et M. Henri Duparc nous l'avaient proposé : point n'est besoin d'entasser Pélion sur Ossa ; la route du Parnasse n'est pas d'escalader des sommets ardus. Sonorités, dimensions, rythmes exceptionnels : à quoi bon ? force et beauté résident dans les rapports harmonieux. Aujourd'hui, en notre temps de béotisme belliqueux où le public, avide de coups de théâtre et de percussions violemment assénées, est féru de « dynamisme pur » (il appelle cela de la vie, comme tel amateur du cinématographe le place au-dessus de l'art), aujourd'hui surtout l'œuvre de G. Fauré est le plus lumineux des phares qui puissent guider les jeunes générations.
Il faut connaître le musicien, il faut avoir connu l'homme, pour apprécier les vertus singulières de cet art : l'absence de « battage », la simplicité, la modestie même, l'ardente conviction, la bonté, l'amour qu'il y a dans cette musique. Savoir que c'est pour la Muse seule, pour la beauté pure, pour un rêve de mieux et d'au-delà, — non face au public ni aux confrères qu'on voudrait dépasser, — mais dans l'indifférence des critiques, dans l'indifférence de l'avenir à succès, que cet œuvre fut élaboré. Ne penser qu'à l'œuvre, ne pas craindre des moyens simples et modestes, être soi-même : c'est ainsi que le goût, peu à peu, s'épure ; non par pédantisme, érudition, snobisme ni méfiance, mais par l'instinct de ce qui est beau — simple et raffiné — : civilisé, dans le meilleur sens du mot.
Alors, quand nos cadets comprendront tout cela, quand ils auront mis à sa place, si haute, la beauté du charme, quand ils auront reconnu sa puissance et l'extrême difficulté d'ailleurs d'y parvenir à leur tour, quand ils auront admis l'indestructibilité qui en reste le privilège (parce que ce charme, venant du cœur, est de la vie humaine infiniment plus qu'une agitation mécanique et turbulente) — alors, on pourra décidément avoir confiance en l'avenir. Peut-être n'en sommes-nous pas si éloignés. Mais, comme dit l'autre, n'anticipons pas, et revenons à G. Fauré.

fac-simile d'un autographe de Gabriel Fauré (Bibliothèque du Conservatoire)
Presque soixante années depuis les premières mélodies (1865) jusqu'à l'Horizon chimérique... Mais aussi, quelle évolution depuis les Ruines d'une Abbaye, par la Sérénade Toscane, vers Lydia, Après un rêve, et le Chant d'automne qui sont déjà du beau Fauré, vers Nell, les Berceaux, Clair de lune, — puis l'extraordinaire Bonne Chanson, — Soir, Arpège, les Cinq mélodies « de Venise », — puis le Parfum impérissable, la Forêt de septembre, puis enfin la sérénité plus dépouillée de la Chanson d'Eve, du Jardin clos, des Mirages, de l'Horizon chimérique, et cette écriture vraiment inimitable, ainsi que certaines modulations des Chorals de Bach devant lesquelles on reste éternellement ébahi ! Certes, il y aurait lieu d'étudier par le détail chacune de ces pièces, car nulle (ou presque) n'est sans intérêt, même lorsque l'idée et le sentiment (à cause de la poésie) ne sont pas de la plus pure beauté. Toutefois, nous devons abréger quelque peu... On voudrait surtout que les commentaires relatifs aux plus parfaites de ces œuvres, ne fussent pas trop inférieurs à ce qu'il faudrait ; mais c'est là, sans doute, un souhait bien ambitieux : car elles échappent à l'analyse et défient toute « description littéraire ».
1er Recueil. Certaines de ces mélodies sont les œuvres d'un jeune homme, presque d'un enfant. On ne s'étonnera pas de l'inexpérience prosodique dont témoignent le Papillon et la Fleur, ou les Matelots, ni du manque de personnalité de la phrase vocale. La réalisation harmonique est d'un « bon élève », sans plus : les tonalités sont nettement abordées. Mais l'expression n'a rien encore de G. Fauré. Plus un musicien est riche, « en puissance », d'expression profonde, plus il semble long parfois à dévoiler cette expression, à découvrir les chemins par où, de son cœur, elle doit s'élancer. Mai, et Dans les ruines d'une abbaye nous paraissent d'une meilleure venue. L'influence de Gounod s'y montre dans la ligne du chant comme dans les modulations expressives, — naturelles, claires, et déjà quelque peu subtiles. Beaucoup de naïveté, mais qui n'est point niaise : c'est avec cette naïveté-là qu'on arrive aux sommets. — Seule a plus d'ampleur ; l'écriture en est tout autre : celle d'un jeune organiste qui a travaillé le contrepoint.
Toujours la forme à couplets : le musicien ne s'en débarrassera que progressivement. Là, elle fait un peu longueur ; aussi bien, il faut qu'une mélodie soit de premier ordre (ex. Venise, de Gounod ; Lydia, Barcarolle, de G. Fauré) pour que l'ennui ne résulte point de cette forme. Mais avec la Sérénade Toscane (34) nous entrons dans un monde nouveau : la grâce proprement fauréenne de ce charme italien de rêve, dont Arpège et Clair de Lune donnèrent une réalisation définitive. L'atmosphère de cette Sérénade Toscane est déjà celle de Masques et Bergamasques... (35) Deux couplets, mais une coda différente : premier indice du nouvel organisme qui naîtra. Car la mélodie, autrefois simple répétition de strophes, va devenir un tout — diversement ordonné suivant les cas, mais comme un être vivant doué d'un centre nerveux, — alors qu'auparavant elle procédait par juxtaposition de zoophytes élémentaires (les couplets). Maintenant au contraire, avec l'unité parfaite et sans la monotonie des redites, chaque mélodie se développera, marchant vers son but, atteignant son sommet (ex. Dans la Nymphée). — Mêmes symptômes de prochaine libération, dans la Chanson du pêcheur (sur le texte du Lamento de Berlioz). Après deux premiers couplets, un élargissement imprévu (et tellement « Fauré » !) traduit cette phrase : « Sur moi la nuit immense plane comme un linceul... » — Lydia : première rencontre de Fauré avec l' « antique ». Un chef-d'œuvre vraiment, de grâce et de pureté, — une statuette du Musée des Thermes. Latine, alors qu'Inscription sur le sable (36) est grecque ; on trouve dans Lydia, non de la mièvrerie, mais une sensibilité qui se livre davantage, si touchante d'ailleurs et si tendrement humaine ! « Oublions l'éternelle tombe... laisse tes baisers de colombe chanter sur ta lèvre en fleur... » Douce persuasion épicurienne, dont le fond, triste, reste voilé du charme de la vie... Des triolets s'incurvent, volute ionique ; et l'expression plus vive de la dernière phrase vocale se tempère d'une coda (du piano seul) merveilleusement « dépouillée » et sereine, en sa ligne d'une absolue simplicité (celle que l'on retrouve, plus tard, à certains thèmes de Prométhée et de Pénélope) (37). — Chant d'automne : ici la forme se fait plus libre encore. La reprise de la première strophe est soutenue d'un accompagnement tout autre ; elle conclut de façon différente; puis voici venir un nouveau développement, d'une large et dramatique conception : se calmant, il amène l'imprévue conclusion, émouvante au possible (« J'aime de vos longs yeux la lumière verdâtre », etc...). Par l'écriture des parties, le rythme des basses, le caractère déjà concertant du style, c'est un véritable morceau symphonique, sans préjudice à l'égard de la beauté purement vocale. Ouvre trop peu connue, rarement chantée, et qui resplendit de cette singulière lumière baudelairienne, comme l'Invitation au voyage ou la Vie antérieure. L'ampleur que (sans l'atteindre parfois) rechercha l'école franckiste, est celle de la solidité des basses de cette très belle mélodie.
(34) Ces mélodies, le recueil les présente-t-il dans l' ordre chronologique ? C'est douteux ; car on en rencontre, après la Sérénade Toscane, et même après Lydia, d'assez quelconques.
(35) Qu'y a-t-il de plus nettement fauréen que telle phrase de la Sérénade Toscane !
(36) Du Jardin clos.
(37) Il y aurait toute une « leçon de composition musicale » à dégager de Lydia. Nous ajouterons seulement deux mots : mystère des moyens et de leur adaptation parfaite, pourquoi les échanges de notes que l'on remarque au début de cette mélodie sont-ils charmants ici, et chose banale en telle réalisation de « Chant donné » de concours d'harmonie ?
Les pièces suivantes déconcertent un peu, surtout venant après ces pures et fortes inspirations. Si l'Absent témoigne d'un sens expérimenté du contrepoint et de la musique symphonique (38), si l'Aubade, charmante de fraîcheur, de jeunesse et de clarté, annonce déjà Aurore (39), en revanche le Rêve d'amour nous semble peut-être ce qu'il y a de moins fauréen dans tout son œuvre ; Sylvie lui est très supérieure comme détails de réalisation (certains font penser à Nell), mais elle demeure d'une expression assez ordinaire (Fauré fut toujours mal à l'aise, il ne put jamais être lui-même, avec les poésies banales et superficielles). Tristesse, qui jusqu'à ces derniers temps jouissait d'une assez grande faveur dans les « matinées d'élèves », n'est pas du meilleur Fauré non plus, et surtout languit, avec ses quatre couplets. — L'Hymne (de Baudelaire) ne réalise pas une concordance absolue entre les tendances habituelles du musicien et l'enthousiasme qu'ici les paroles lui imposèrent. Cet enthousiasme d'un amour dithyrambique ne sera véritablement réussi que par la musique de l'incomparable, de l'unique Bonne chanson. — La Rançon (c'est le Fauré un peu austère de Solitude) semble assez « primitive », on y trouve presque des banalités harmoniques : elles étonnent, et détonent, en ce recueil. Ici-bas, avec son « triton » caractéristique, est assurément supérieur aux précédentes : mais (comme l'Hymne) d'un certain romantisme, l'idée expressive dépasse les moyens, tandis que le Chant d'automne gardait une superbe allure classique.— Cette allure classique est également celle d'Après un rêve, dont la forme se montre d'une solidité merveilleuse, et si souple : se modelant sur la pensée, conservant néanmoins l'unité du rythme et du dessin d'accompagnement ! C'est une des plus belles et d'ailleurs l'une des plus connues des mélodies de ce premier recueil. — Au bord de l'eau (Sully Prudhomme) témoigne d'une subtilité harmonique nouvelle, avec ses enchaînements chromatiques et ses septièmes successives — assez franckistes, mais antérieurs aux plus belles compositions de César Franck. — Barcarolle... Venise : la Venise populaire et nocturne, l'infini lointain de la lagune et sa berceuse mélancolie. Prescience de grand artiste, car (si je ne me trompe), Fauré ne connut la ville des Doges que bien plus tard, lorsqu'il écrivit les cinq mélodies « de Venise » Mandoline, En sourdine, etc.) Barcarolle est une des plus belles pages du recueil, et qu'entendent toujours avec la même émotion ceux qui ont gardé la hantise de la reine délicieuse de l'Adriatique.
(38) Toutefois, cette mélodie semble antérieure au Chant d'automne.
(39) Du second recueil des mélodies.
On dirait qu'entre la fin du premier recueil et le début du second, des années nombreuses s'écoulèrent. Ici, l'écriture est plus souple, plus pleine, plus dense, plus diverse. Des modulations comme on en trouve à la fin de Nell sont choses tout à fait nouvelles dans l'œuvre de Fauré, et l'on n'en connaissait pas chez les autres musiciens. Comparées à Nell, les meilleures du premier recueil (Sérénade Toscane, Lydia, Chant d'automne, Après un rêve, Barcarolle), si belles qu'elles soient, paraissent encore très naïves avec leurs accords à l'état fondamental et leurs « résolutions directes, usuelles ». On n'y rencontre pas encore ces septièmes inopinées, ces tritons irrégulièrement résolus, ces seconds renversements à résolutions exceptionnelles, ces retours à la tonalité, souples et précis comme les bonds d'un chat qui retombe sur ses pattes avec grâce, et ces mouvements des basses, subtils, si justes d'expression, qui nous ravissent et nous émerveillent dans « Je me poserai sur ton cœur... »
Second recueil. Nell pourtant n'est que l'op. 18. Chef-d'œuvre achevé : on y goûte la saveur particulière de cette écriture par notes de passage (principalement aux basses) combinées aux arpèges ; elles réalisent des harmonies raffinées, audacieusement et clairement modulantes ainsi que celles de J.-S. Bach. Il y a des points de repère dans la production de G. Fauré : comme des jalons pour l'avenir, très en avance parfois sur son temps, voire même sur ses autres mélodies de la même époque. Tels étaient la Sérénade Toscane, Après un rêve, Lydia surtout, et le Chant d'Automne. Ainsi, dès le début du second recueil, Nell annonce le style de l'Horizon chimérique. A la faveur des poésies les plus belles qu'il rencontre, le musicien, si impressionnable à cette beauté, devance sa propre inspiration et devine son propre avenir. Ce fut évidemment une découverte émotionnante pour Fauré, que celle de Leconte de Lisle (40) : révélation subite, d'où naquirent Nell et les Roses d'Ispahan ; l'artiste créateur fut porté au-dessus de soi, — ou plutôt, la poésie aimée l'obligea de formuler l'essence de lui-même qui correspondait à cette poésie. Miracles isolés, d'ailleurs; et dans le même temps (ou peu s'en faut) vous verrez l'incomparable Nell voisinant avec les mélodies, évidemment moins belles, du Poème d'un jour ; — d'ailleurs charmantes ou dramatiques et qui suffiraient à classer un autre musicien en très bon rang. Mais on ne peut se tenir de préférer Nell, et de beaucoup. — Automne (le texte d'Armand Silvestre n'est pas sans accent), montre une fort belle inspiration, dont la grave et large mélancolie s'oppose harmonieusement à la lumière juvénile de Nell, exaltée comme un beau ciel de Juillet. — Entre deux, le Voyageur nous fait connaître un Fauré tragique, presque violent (cf. aussi le n° 2 du Poème d'un jour, et plus loin la Fleur jetée, assez peu connue). Expansion nécessaire, ne fût-ce que pour l'avoir contraint à des rythmes vigoureux préparant ceux de ses Quatuors. La partie médiane du Voyageur est d'une ample beauté, et par des moyens très simples (modulations inattendues) elle réalise une saisissante impression de lointain. — L'op. 23 se compose de deux mélodies, les plus connues peut-être et les plus souvent chantées : les Berceaux, le Secret. Elles révèlent des sentiments profonds qu'à la simple lecture des poésies l'on n'aurait peut-être pas soupçonnés. — Admirez l'unité rythmique et plastique de ces Berceaux, mais aussi la fidélité avec quoi la ligne vocale s'attache à l'expression particulière de chaque phrase : élégante et parfaite solution d'un problème difficile où tant de musiciens échouent, s'appliquant à « la musique du mot » sans être capables de vues d'ensemble. En ce temps assez lointain Fauré possédait déjà la maîtrise du style... Le sentiment concentré, profond, du Secret disparaît en général, défiguré par des interprétations à la fois trop rapides et trop dramatiques ; elles font un sort à chaque mesure, pour l'égoïste plaisir d'une agréable nuance : l'âme fauréenne exige un goût, un tact, une largeur tout autres. — Passons plus rapidement sur Notre amour, cher aux salons qui continueront d'ignorer le Nocturne, les Présents, les Larmes, dont nous parlerons tout à l'heure. Cela semble bien une « poésie à mettre en musique », avec son aimable sentimentalité et ses divisions symétriques : « Notre amour est chose légère — charmante — sacrée — infinie — éternelle ». Mais cette forme et cette pensée ont plutôt desservi le musicien ; et la gradation de légère à charmante ne laisse pas d'être un peu factice. — Toujours d'Armand Silvestre, l'op. 27 n° 1 : Chanson d'amour, qui n'est pas non plus du meilleur Fauré. Mais le n° 2, la Fée aux chansons, reste charmante en sa gaîté juvénile et lumineuse.
(40) Surtout après certains textes médiocres du premier recueil (Rêve d'amour, de Victor Hugo ; Sylvie, de Paul de Choudens).
Aurore (op. 39, n° 1) nous semble bien supérieure à Chanson d'amour. L'écriture s'y montre aussi séduisante que hardie, par l'heureux emploi des renversements subtils et des modulations lointaines. — Le Pays des Rêves est une exquise barcarolle de féerie, avec ses accords « du troisième degré » et ses « sensibles bémolisées ». — Les Roses d'Ispahan, comme Nell, les Berceaux, Nocturne, et Clair de Lune, se placent au premier rang dans ce recueil de mélodies. Prenez-y garde : il faut un sens musical très fin, un goût très subtil pour en saisir la beauté parfaite et pour distinguer cette beauté de la joliesse un peu banale où d'autres musiciens évoluent. Rien de moins banal pourtant, malgré ses accords usuels et connus, que les Roses d'Ispahan, mélange intime de langueur orientale et de nonchalance fauréenne (41). Rythme, harmonies, ligne du chant, sont ici des choses définitives qu'on s'imaginerait créées par la naissance même de la poésie de Leconte de Lisle. — On en dirait autant de ce merveilleux Clair de Lune, première rencontre de Fauré avec Verlaine, pièce unique et l'on peut dire géniale, qui vivra toujours parmi les hommes s'ils gardent le sens de la poésie, de la musique et de la nuit. « Au calme clair de lune, triste et beau » : admirable simplicité de Verlaine qu'enveloppe à son tour la simplicité du chant fauréen, avec la volute caressante de son contrepoint. Infinie profondeur des dernières mesures, dans la clarté lunaire...
Deux poèmes de Villiers de l'Isle-Adam (Nocturne, et les Présents) inspirèrent au maître la plus tendre musique et la plus profonde : d'une émotion contenue d'abord et qui s'enfle sans romantisme inutile, en gardant une si parfaite justesse d'accents : c'est la réserve hautaine, mais si aimante, du poète de l'Hymne à Vénus. Œuvres peu connues du public et dont la compréhension semble le privilège des initiés : elles y gagnent de n'être pas « vulgarisées » dans les matinées d'élèves. — On ne citera que pour mémoire une composition de second ordre, En prière, où le musicien fut certainement gêné par le texte. Enfin, ce recueil conclut aujourd'hui par la Barcarolle autrefois parue dans le premier ; nous avons dit plus haut notre admiration pour cette page si merveilleusement vénitienne.
(41) D'ailleurs, cette nonchalance dissimule une énergie infiniment plus grande qu'on ne croyait, au temps où Fauré se voyait qualifié d' « aimable compositeur de jolies mélodies ». Voyez, simplement, Pénélope et Prométhée.
Au début du troisième volume, des pièces qui d'abord faisaient partie du second : Larmes (la poésie en est extraite de la Mer, de M. Richepin), fort belle œuvre ; du Fauré dramatique, sombre, presque d'une âpre amertume, et par conséquent rarement chantée. — Au cimetière, pour lequel semble avoir été créé le mot d'Amiel : « un paysage est un état d'âme ». Etonnante synthèse que cette vision du cimetière de campagne sur la falaise lumineuse, rustique, paisible, à jamais loin de toute vie agitée. Eternel sommeil sous le soleil calme. Des tonalités grégoriennes se dégage mystérieusement l'humilité austère des croix de bois, dans cette émotion contenue et précise dont Fauré garda le secret. Puis, évoquée en trois lignes, c'est l'affreuse tempête où sombrent les barques dans les flots glauques roulant pêle-mêle des cadavres nus... Puis de nouveau la paix, l'infinie tendresse qui semble bercer l'æternam requiem de ceux qui reposent, pieusement ensevelis.
Spleen, de Verlaine (« Il pleure dans mon cœur »), l'une des meilleures interprétations de ce poème si souvent traité par les musiciens. — D'une prison, dont l'expression sobre, d'un dramatique concentré, devrait être une leçon pour tant de compositeurs qui mettent inopinément « du théâtre » en l'art de la mélodie intime. — La Rose (de Leconte de Lisle), merveille de grâce païenne racontant la naissance de Vénus et la naissance de la Rose. — Deux pièces extraites de la délicieuse musique de scène écrite pour le Shylock de M. Haraucourt : Chanson, et Madrigal ; la première, au rythme de barcarolle, infiniment séduisante ; la seconde rappelant, par des moyens modernes, les musiques écrites à la fin du XVIe siècle, et si proche des scènes familières de Carpaccio !

fac-simile d'un autographe de Claude Debussy (Bibliothèque du Conservatoire)
Puis, les cinq mélodies composées à Venise, pendant quelques semaines de loisir heureux : Mandoline, En Sourdine, Green, A Clymène, C'est l'extase... Ici le raffinement fauréen se joue parmi les modulations les plus fugitives — qui cependant (mystère profond) n'altèrent pas le sens tonal. On ne sait que préférer de toutes ces œuvres si parfaites, si précises en leur apparence ondoyante et vague. — Le Parfum impérissable est un des sommets du troisième recueil. Poésie qui brûle de l'amour le plus tendrement reconnaissant : que vous semble de la réputation de froideur faite à Leconte de Lisle ? Mais le musicien est là, qui dévoile le cœur du poète. Et cette essence, cette âme odorante de la rose qui goutte à goutte emplit la fiole de son impérissable parfum, n'est-ce point sa musique même, dont les effluves s'épanchent sur le monde, éternellement ? « Mon cœur est embaumé d'une odeur immortelle » ! Nous touchons ici le fond même de l'inspiration fauréenne, nous sommes à la source de sérénité de ses dernières œuvres, toutes pleines de tendresse envers la vie dans l'adorable Andante du second quintette, dans le Jardin clos, dans l'Horizon chimérique.
Et voici que le musicien se tourne également vers la fantaisie légendaire d'Albert Samain : Arpège aux lointains vaporeux ; Soir qui déborde de pitié et d'amour. L'admirable effusion de Soir est trop connue pour qu'il nous faille insister : mais disons qu'Arpège, d'un sentiment et surtout d'une facture très différents, ne nous semble pas inégal. Ineffable poésie de nuits de rêve, de jardins — en quelque irréelle Italie — baignés de clarté lunaire, avec des vols de lucioles dans l'air, comme des sylphes ailés, — nonchalante, et tendre, et divine grâce de la beauté féminine (« Sylva, Sylvie et Sylvanire, belles au regard bleu-changeant »), il y a tout cela dans cette musique d'Arpège, mais deux mesures vous en diront davantage.
Puis (op. 87) Fauré revient une dernière fois à son ancien collaborateur Armand Silvestre (le Plus doux chemin ; le Ramier) : il faudrait, pour goûter ces petites pièces, les placer dans le second recueil, à côté d'Aurore ou du Secret : au milieu du troisième, après le Parfum impérissable, Arpège et Soir, elles se ressentent trop nettement de la moins belle qualité des poésies qui les firent naître. Mais Dans la forêt de septembre est une des plus hautes inspirations de Fauré. L'une des plus touchantes aussi, car il semble qu'on devine quelque chose de personnel en ce retour sur soi-même à l'heure où, vaillant encore, l'homme sent la vieillesse qui le guette. Cela est émouvant comme une confession. La vigueur large s'y tempère de sensibilité attendrie, et à l'approche de « l'hiver », déjà la sérénité s'annonce de la Chanson d'Eve ou du Jardin clos. — Accompagnement, et la Fleur qui va sur l'eau closent dignement ce très beau recueil : celle-là étrangement agitée, magique et mystérieuse, celle-ci, barcarolle de rêve où semble revivre tout l'art des Nocturnes pour piano de G. Fauré.
Entre temps, la Bonne chanson, qui dans l'œuvre fauréen occupe une place absolument à part. Il y a des moments de la vie où l'on vit plus intense, où l'acuité des sentiments paraît doublée, où la force d'inventer se fait joyeuse, où toute l'activité créatrice de la nature semble descendue en nous. Ce temps des fiançailles de Verlaine où le poète naguère « maudit », exhale sa joie candide comme dans la jeunesse d'un paradis terrestre, (— joie non exempte parfois de craintes, de souvenirs douloureux, mais plus puissante que tous les obstacles et qui réconforte ainsi que la certitude d'un avenir de bonheur) (42), Fauré l'a traduite comme s'il l'avait vécue lui-même, — avec parfois quelque chose de plus mûr, de moins juvénile que la joie, redevenue enfantine, de Verlaine (43). Mais il y a dans son œuvre une telle expansion d'amour (J'ai presque peur, en vérité), une telle claire confiance en la vie (Puisque l'aube grandit), un bonheur si beau (l'Hiver a cessé), une densité de sentiment, d'où une si irrésistible force vive de musique que cette Bonne chanson reste jeune comme au premier jour et qu'à chaque nouvelle audition, l'on y découvre de nouvelles raisons d'admirer. A l'analyse des accords et des enchaînements harmoniques de ce recueil, on se rend compte de l'infinie diversité du langage musical, même limité aux accords usuels. Il n'est point de page ici, point de ligne d'où ne surgisse quelque trouvaille imprévue, où ne s'épanouisse une fleur jusque là inconnue : aussi la somme de création que représentent ces neufs mélodies est-elle supérieure à celle de mainte combinaison bitonale ou polytonale... D'ailleurs, comme nous l'avons déjà remarqué, les découvertes suggérées au musicien par la traduction des poèmes — à cause qu'ils l'ont si vivement inspiré — sont des points de départ dont on retrouve les repères en d'autres œuvres, dites de musique pure. Quant à prétendre (comme le feraient certains théoriciens) que la « musique pure » soit plus belle que la « mélodie » écrite sur des paroles, c'est complète illusion. Si la chose n'était pas évidente a priori, l'exemple de la Bonne chanson suffirait à la prouver.
(42) On sait qu'il ne se réalisera point pour Verlaine, et de cet instant unique, la Bonne chanson seule est restée.
(43) Ainsi, N'est-ce-pas ? n'a peut-être point le caractère de tendre naïveté que montre la poésie : et Fauré n'a songé à traduire ni le Soleil du matin, ni Un jour de Juin...
Mais, après cette expansion presque romantique (je dis presque : car la Bonne chanson est véritablement classique, mais d'un classique vivant et passionné), après les remous de la Fleur qui va sur l'eau, d'Accompagnement, de la Forêt de septembre, après la puissance magnifique de Prométhée (arènes de Béziers, 1900), l'art fauréen gagne peu à peu la sérénité d'un beau crépuscule ; il s'exprime avec la simplicité dépouillée d'un bas-relief grec. Influence de l'âge ; mesurant le chemin parcouru, et pur désormais de toute scorie, l'esprit acquiert une vision d'ensemble. Délaissant toute agitation (en son besoin de calme, et peut-être à cause de certaine lassitude physique), soutenu par la plus accomplie maîtrise d'écriture. guidé par une pensée toujours aussi ferme, poussé par une sensibilité qui ne faiblit pas, il atteint les plus beaux sommets classiques. Ajoutez-y des hasards heureux dans l'existence : telle, la « commande » de ce Prométhée qui marque une date dans la carrière de G. Fauré comme dans l'histoire de la musique française.
Les derniers recueils montrent cette inimitable subtilité, si simple et si neuve, où chaque note a sa place, traduisant une sérénité toute emplie d'émotion : émotion, au fond, très vive, et dans l'apparence, très contenue. Jamais l'art musical de ce siècle n'a ressuscité avec autant de perfection l'idéale beauté grecque.
La Chanson d'Eve et le Jardin clos sont écrits sur des poèmes de Van Lerberghe. Un Eden de rêve ; l'aube de la vie sur le jeune monde du paradis ; lumière, pureté... Dès le début de cette Chanson d'Eve (« c'est le premier matin... »), un style hardiment dépouillé : une seule ligne, sobre, calme, sur quoi se place, soutenu d'accords parfaits, un large récit du chant. « Un jardin bleu s'épanouit... » : sorte de chaos dans la lumière (un chaos classique, si l'on peut dire !) qui s'organise peu à peu et de la vague tonalité initiale, se précise à notre sens musical par la répétition des mesures. Sereine joie des premiers âges, jours d'avant le mal et la douleur, — mais vus par un de ceux qui ont vécu, avec une sensibilité très vive, la vie humaine. Sérénité acquise après les remous, les agitations, les angoisses ; sérénité aussi de qui reçut le bonheur de créer de la musique, de pouvoir s'exprimer en beauté (44). — La jeunesse que traduit et possède cette œuvre d'un sexagénaire (45) n'est pas un phénomène unique, je dirais même qu'elle n'a rien de paradoxal. Le Falstaff de Verdi surprit tout le monde par sa gaîté, par l'entrain de ses rythmes, en un moment où ces qualités n'étaient point fréquentes chez de jeunes musiciens. Dans les derniers recueils de Fauré (46) c'est une jeunesse intérieure qui resplendit : les œuvres semblent illuminées au dedans d'elles-mêmes. On dirait une image de sa vie passée, rendue plus profonde et plus vive de tout ce qu'y ajoutèrent les années qui menaient à la vieillesse. Sans doute, c'est une chose naturelle et salutaire (comme disait Arkel : « pour oublier un moment les menaces de la mort ») de se tourner vers la lumière d'autrefois, de célébrer encore ce qui fut cher dans notre existence, de ranimer par le souvenir les torches ardentes, d'en amplifier l'éclat dans la conscience profonde acquise par l'âge. C'est en ce sens qu'il est véritablement naturel et nullement paradoxal de voir cette jeunesse ressusciter. Et c'est par le moyen de notre analyse psychologique qu'à défaut d'une audition, l'on peut se représenter l'étrange ardeur, si belle, qui se dégage des œuvres récentes de Gabriel Fauré. Certes, elle n'est pas dans l'agitation violente : mais un artiste a parfaitement le droit de ne pas s'inspirer de la « vie moderne » et surtout des caractères extérieurs de brutalité de cette vie moderne. La Muse de Fauré ignora les bars, les bals, et même les jazz... Elle se tourna vers cette harmonie grecque, raffinement suprême de la civilisation la mieux équilibrée, — comme vers ce qu'il y a, chez les humains, de vivant, de sensible, d'aimant... Et le ferme espoir d'avoir exprimé de la beauté donnait à l'artiste créateur une confiance au profond de lui-même, qui se traduisit en l'admirable sérénité que l'on sait.
(44) Ainsi également, la joie de Mozart n'est pas seulement issue de son caractère, encore moins de sa vie même, mais de la confiance que lui apportaient ses dons merveilleux.
(45) M. Fauré naquit en 1845, et la Chanson d'Eve fut éditée en 1906-07.
(46) Comme aussi dans le Final de la Seconde sonate de violon, et dans le Scherzo du Second quintette.

fac-simile d'un autographe de Claude Debussy (Bibliothèque du Conservatoire)
Il y eut, chez Fauré, la conjonction nécessaire avec Van Lerberghe, comme avec Verlaine aux temps de la Bonne chanson. Le panthéisme de cette Chanson d'Eve (comme Dieu rayonne aujourd'hui ! comme il exulte parmi ces roses et ces fruits ; comme il murmure en cette fontaine !) ne surprendra point chez le poète qui fut l'auteur de Pan. Fauré, peut-être inconsciemment, y semble ajouter quelque chose de vécu. « O mort, poussière d'étoiles... », cette admirable mélodie n'est-elle pas le songe d'un vieillard devant une très belle nuit d'été, — rêvant que son âme s'ira dissoudre dans la grande âme du monde ?
Actuellement, le public n'a fait à la Chanson d'Eve ni au Jardin clos la place que ces œuvres méritent. Au concert, il les entend trop rarement, et la lecture en est délicate. On se convaincra quelque jour de leur haute beauté, intérieure et charmante : quelque chose de très pur et de très émouvant, avec, émanant de la matière sonore, une volupté parfaite qui ne rabaisse en rien leur mysticisme panthéiste. Mais, plus nous tenterions de préciser les sentiments, de prendre l'instantané des reflux de pensée qui animent ces œuvres, et mieux nous saisirions combien notre cliché serait incomplet. La jeunesse sereine, disions-nous de Prima verba et de Paradis ? Elle ne suffit pas à caractériser Crépuscule ni O mort, poussière d'étoiles, d'où se déduit un sens philosophique : « la souffrance est liée à la sérénité même ». Dans le Jardin clos, « Je me poserai sur ton cœur » évoque la tendresse de l'âme et l'infini des flots, — ou bien, si vous préférez, l'infini du cœur et la tendresse de la mer ensoleillée ; Inscription sur le sable, c'est à la fois la mort et le souvenir éternel, en des lignes si harmonieusement, si parfaitement païennes que le néant qui s'en exhale, non seulement n'a point d'amertume, mais semble animé d'un bonheur mystérieux.
Le style des Mirages et de l'Horizon chimérique est de même nature que celui du Jardin clos et de la Chanson d'Eve. Le charme, la perfection de l'écriture sont tels, un si grand réconfort de musicalité s'en dégage, que l'aspect douloureux de certaines parties s'en trouve voilé, adouci, et comme tamisé d'une auréole lumineuse. C'est le contraire de l'art heurté, à gros effet, qui mate les foules; et l'hellénisme, une élite seule en pénètre aujourd'hui la beauté. Cet hellénisme demeura le secret de Fauré, particulièrement dans Diane, Séléné (de l'Horizon chimérique) et dans la subtile et magique Danseuse, des Mirages. Exemple admirable, presque décourageant d'ailleurs, tant est lointaine, inaccessible à nous tous, la possibilité de réaliser à notre tour un pareil idéal. — Mais ce n'est pas ainsi qu'il faut considérer les choses. On a le droit de se rappeler les débuts de Gabriel Fauré. Sans doute, cet artiste incomparable réunit des dons très rares ; d'abord, la fortune de s'émouvoir exceptionnellement à la beauté ambiante, de la découvrir en quelque sorte, et d'ignorer la laideur ; ensuite, le pouvoir d'assimiler, et de traduire musicalement cette émotion première. Mais aucune carrière ne devrait mieux nous encourager que la sienne, par la mesure du chemin parcouru. Un artiste ne sait jamais (ni les autres) jusqu'où il parviendra, et le propre du génie est de s'ignorer le plus souvent, malgré l'intime confiance dans l'avenir, cette confiance que l'on possède lorsqu'on a beaucoup à dire...
Peut-être jugera-t-on démesurée cette étude approfondie (incomplète, cependant) des mélodies de Fauré, et surtout en regard de certaines appréciations rapides au sujet d'autres musiciens. Mais comment éviter cette disproportion ? Comment traiter de la même façon Clair de lune et telle romance banale ? Il va de soi que nous pouvons nous tromper... Si la romance banale de M. X... dissimule des profondeurs insoupçonnées, et (quelle hypothèse blasphématoire !) si Clair de lune jouit d'une réputation usurpée, l'avenir se chargera de rectifier nos jugements. Mais jusqu'à preuve du contraire, il semble bien qu'on puisse dire, de façon absolue, que ces mélodies de Fauré sont de la plus incontestable beauté. Nous ne pouvions faire autrement que de lui réserver ici la place d'honneur.
A Claude Debussy également, dont en pareille matière l'œuvre est de premier ordre, moins considérable certes, car Debussy mourut assez jeune, mais d'une beauté presque sans déchet, et certainement supérieure à celle de ses pièces de piano.
Si, tout jeune, Fauré subit l'influence de Gounod (d'ailleurs excellente), celle de Massenet marque de son empreinte les premières mélodies de « Claude-Achille » Debussy (c'est ainsi qu'alors il signait ses compositions). Elle se voit aussi dans sa cantate du concours de Rome : l'Enfant prodigue. On la remarque d'ailleurs, à cette époque, sur la plupart des élèves du Conservatoire, disciples ou non de l'auteur de Marie-Magdeleine (47). — Cette influence fut sans doute moins heureuse que celle de Gounod (48) ; chez Debussy toutefois, même dans les moins caractéristiques de ses œuvres de jeunesse, on rencontre çà et là des tournures de phrases, des enchaînements, des façons particulières de sentir à quoi l'on ne peut se tromper. Et Gounod avait deviné le génie en cette cantate de l'Enfant prodigue, si « massenétique » qu'elle fût par endroits (49).
(47) Debussy travaillait à la classe de Guiraud.
(48) Il faut reconnaître que l'on fit aussi du bien mauvais Gounod.
(49) C'est une anecdote qu'on a déjà contée. L'Institut venait d'accorder le prix à Claude-Achille Debussy, grâce à l'intervention de Gounod. Celui-ci, sortant de la séance, rencontre l'heureux lauréat, l'embrasse, et lui dit : « Toi, mon petit, tu as du génie. »
Probablement contemporaines des Arabesques et de la Petite suite, deux premières romances sans grand intérêt : Fleur des blés, Beau soir. La ligne est mélodique, les idées sont agréables, — rien de plus. Mais avec les Angelus, quelque chose de personnel, déjà, dans ses évocations de cloches. Il aima toujours leur voix multiple, il la fit parler mainte fois. Et certes, il réussit mieux par la suite qu'en ce premier essai ; mais celui-ci n'est pas négligeable ; il fut sûrement incompris de ses camarades de classe. Naïve mélodie, mais qui déjà sortait de l'ordinaire.
Puis, trois autres, où s'affirme celui qui devait un jour écrire Pelléas et Mélisande ; l'âme de Verlaine, dès lors, se révélait au musicien des Ariettes et des Fêtes galantes.
La Mer est plus belle, accords parfaits de tonalités changeantes, annonce du thème futur de Mélisande et terminaison dans le vague, en suspens sur un accord de septième de dominante, ce qui dut enchanter Bourgault-Ducoudray, mais lui seul peut-être. — Le son du cor s'afflige : déjà le style des Ariettes oubliées, si expressif... Des enchaînements harmoniques d'une grande simplicité : accords parfaits, avec seulement des appogiatures ou des notes de passage sur les temps forts. Mais l'idée musicale et la façon d'écrire sont nouvelles, et cette mélancolie pressentie par un tout jeune débutant affirme mieux que des promesses. — L'Echelonnement des haies montre le Debussy gai, printanier, lumineux, que nous retrouvons à la fin des Jardins sous la pluie, comme au sortir des Souterrains de Pelléas (50). Réalisation et sentiments bien à lui, avec l'emploi de ces accords de quinte et quarte (sans résolution sur la tierce), qui depuis furent d'un usage courant. Et cette joie sous le clair soleil d'avril, cette joie jeune, pure d'arrière-pensées, est d'autant plus précieuse qu'elle se montre plus rare chez Debussy.
(50) Voir également les Danses de l'Enfant prodigue, et le début de la quatrième Prose lyrique.

fac-simile d'un autographe de Claude Debussy (Bibliothèque du Conservatoire)
Les Ariettes oubliées : de nouvelles « découvertes » dans l'écriture harmonique, une admiration toujours croissante des poésies de Verlaine ont permis dès lors au musicien de s'affirmer comme l'un des plus profonds interprètes du pauvre Lélian. Il est savoureux de lire aujourd'hui, au dos des couvertures de l'édition originale, les titres et les premières mesures de certaines mélodies, « célèbres » (au dire de l'éditeur), dues à M. Vidal, à P. Puget, à M. G. Dubreuilh. On imagine que les maisons Hamelle ou Girod devaient n'avoir qu'une mince confiance dans l'avenir de « Claude-Achille ». Le cas est assez fréquent lorsqu'il s'agit d'un futur grand musicien, n'insistons pas (51).
(51) Rappelons néanmoins que longtemps, la plupart des éditeurs refusèrent les œuvres de César Franck et celles de Fauré. Pendant longtemps ces deux grands musiciens durent céder leurs compositions à des prix dérisoires.
C'est l'extase, la première de ces Ariettes, est une fort belle page, intensément expressive ; l'artiste y semble maître, déjà, de son vocabulaire à « résolutions exceptionnelles de neuvièmes ». — Il pleure dans mon cœur se fait plus langoureux ; sans gradation d'ailleurs et peut-être inutilement coupée par des arrêts du dessin initial, elle languit un peu. Malgré le charme de la phrase chantée il ne saurait y avoir de comparaison possible avec la version de Fauré. — L'Ombre des arbres, plus dramatique encore que C'est l'extase, avec ses modulations lointaines, livre sans retenue son émotion, d'une franche envolée qui n'a pas vieilli d'une note. — Les chevaux de bois : d'un humorisme très réussi, avec ses déplacements parallèles d'accords parfaits sur le thème des cloches de Parsifal et la furtive poésie qui se mêle aux soirs de réjouissances populaires. — Green débute par quelques mesures d'une fraîcheur ingénue et charmante. Cela tourne ensuite au « Massenet » (Rêve des chers instants qui la délasseront...). D'ailleurs, erreur assez rare chez Debussy, le sentiment général n'est pas celui que Verlaine pensait avoir mis dans cette poésie, au fond d'une grande tristesse. Mais Spleen, la dernière du recueil, est vraiment admirable. « Le ciel était trop bleu, trop tiède ; la mer trop verte... ». Seul peut-être Debussy était capable d'exprimer avec cette intensité de désespoir et d'amour, des regrets infinis. Mandoline est également de l'ancien Debussy. Chose assez curieuse, cette œuvre annonce des musiques beaucoup plus récentes, si l'on considère la vivacité de ses rythmes, ses accords en quintes, et la réalisation « dépouillée » de la dernière page. D'autres mesures, en revanche, offrent des harmonies naïves (et d'ailleurs charmantes) que Debussy par la suite, cessa d'écrire. Le tout, malgré ses divers aspects, reste homogène ; les faiseurs d'analyses seront déroutés par cette variété de forme : mais elle est, musicalement, logique, et celle qu'il fallait à l'idée.
Les cinq Poèmes de Baudelaire, autrefois gravés par souscription (aucun éditeur n'en voulait), puis restés longtemps introuvables après l'épuisement du premier tirage (52), n'étaient connus alors que d'un petit nombre de fervents debussystes. Ils montrent une expansion naïve et généreuse, d'un romantisme par moments presque wagnérien : œuvre de transition, mais qu'on regretterait beaucoup de ne point trouver chez ce grand musicien. Plusieurs de ces Poèmes sont d'ailleurs fort beaux. — Le Balcon débute par une phrase à la Holmès ; pourtant, l'ensemble est d'une indiscutable personnalité. Il s'en exhale une puissante attraction sur qui veut bien ne pas résister, de parti-pris, à ces mélodies pleines d'appogiatures si expressives. On y respire les effluves d'un pessimisme tristanesque (parfaitement en accord avec la poésie de Baudelaire, car elle demande un commentaire avant tout lyrique). Pessimisme d'ailleurs plein d'élan et de jeunesse. — sans amertume, comme on peut être pessimiste à l'âge où tant de réserves de vie sont là, pour guérir des « idées noires ». (Au contraire, c'est quand la plus sombre mélancolie, la plus dure angoisse nous oppressent, c'est alors que n'ayant point la force de peindre une douleur désespérée nous éprouvons l'impérieux besoin de musiques vivantes, gaies, ou tout au moins humoristiques). — Harmonie du soir annonce des accords de Pelléas : « Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir ». Il y avait un écueil redoutable : « valse mélancolique et langoureux vertige »... cela risquait d'être presque vulgaire, ou si veule ! Debussy paraît avoir évité Charybde et Scylla. — Le Jet d'eau, probablement la plus connue de ces mélodies, n'est sans doute pas la meilleure. Après un début d'une sensibilité très debussyste, avec sa double pédale de secondes qui se posent doucement comme des mains sur un front fiévreux, l'idée s'éparpille un peu, sans ligne bien caractéristique. — La Mort des amants reste, je crois nettement au-dessous de la poésie de Baudelaire au sensualisme profond jusqu'à la luxure ; mais Recueillement est admirable, depuis la douleur contenue (quoiqu'un peu à la Tristan) de la première page, jusqu'à la Coda raffinée et simple : « Entends la douce nuit qui marche... » Certaines des Ariettes (les n°s 1, 3, 6) évoquent de semblables nostalgies, et l'alliance avec le poète se réalise de la façon la plus heureuse.
(52) Jusqu'à ce que, beaucoup plus tard, la maison Durand s'avisât de les publier à son tour.

Claude Debussy (d'après le tableau de Jacques-Emile Blanche)
Les Fêtes galantes (de Verlaine) sont publiées en deux recueils, de trois pièces chacun. Mais les Ingénues et le Faune sont probablement assez postérieurs aux autres. — En sourdine rappelle par instants le second des poèmes de Baudelaire, d'une musicalité charmante, mais sans atteindre d'ailleurs à la beauté profonde de Fauré sur le même texte. — Fantoches, c'est un Debussy humoristique qu'on regrette de ne pas rencontrer plus souvent, car il avait le sens d'un comique très fin auquel intimement et subrepticement se mélangeait une poésie charmante. Mélange très humain et spécialement français, qu'avec d'autres moyens on remarque aussi chez E. Chabrier, M. Erik Satie et plus récemment M. G. Auric ou M. H. Sauguet. Fantoches est vraiment une « pièce unique » dans l'œuvre vocal de Claude Debussy, — et parfaite. — Clair de Lune : très belle évocation, surtout au début et vers la fin. Plus directement expressive que celle de Fauré, je veux dire d'une expression moins objective, et comme individuelle. Non plus émouvante certes, mais avec un « sens de l'infini » plus romantique, surtout aux dernières mesures. L'infini de Fauré est hellénique, architectural ; celui de Debussy, c'est la forêt et la nature. Les deux interprétations sont légitimes, il est difficile de savoir laquelle on préfère.
Dans le second recueil des Fêtes galantes, les Ingénues, jolie et mystérieuse, plus contenue que les précédentes, (on dirait un peu moins riche en trouvailles ? mais cela tient peut-être à son caractère général). D'une étrange tristesse, voluptueusement troublée par ces « nuques blanches » et par ces « hauts talons » évoquant un siècle d'élégance ingénieuse, savamment raffinée. — Le Faune, très particulière avec ses lointaines harmonies sur pédale. Cela côtoie la bitonalité, malgré la tonique de basse, scandée comme par un tambourin persistant. Nouvel aspect de l'évolution debussyste, assez postérieur à Pelléas et aux Nocturnes. — Colloque sentimental, l'une des plus belles plaintes de Debussy, à la fois expansive et retenue ; pourtant aussi vivante, aussi profondément dramatique que les meilleures des Ariettes oubliées. Que tout cela est ému ! et comment, dans cette musique, n'a-t-on pu voir que les stigmates d'une nature morbide, d'un artiste compliqué ! Injustice et mystère des routines incompréhensives...
Les Proses lyriques sont évidemment antérieures au second cahier des Fêtes galantes, peut-être même au premier. Elles semblent, par endroits, un « premier état » de Pelléas. « De rêve » : c'est l'atmosphère légendaire du Songe de la Forêt de M. Henri de Régnier ; il s'y trouve également des souvenirs de Verlaine, des hommages aux préraphaélites anglais et au mysticisme de la Rose-Croix de J. Péladan. Mais qu'importent ces influences, si la musique est réellement — ce qu'elle est — du Debussy ? On sait qu'il écrivit lui-même le texte de ces quatre Proses et que ce texte fut souvent déprécié par les critiques. N'a-t-on pas été injuste ? Ces proses d'un musicien, si elles n'ont pas la perfection des Chansons de Bilitis de M. Pierre Louÿs ; si, outre la marque de mainte influence, on y peut regretter des images ou des assonances truquées : (« les grands iris violets violèrent méchamment tes yeux » —) en revanche elles seules, à ce moment de sa vie, créaient l'atmosphère voulue par le compositeur, lui suggérant la musique qu'il rêvait d'écrire (53). D'ailleurs certains passages en sont d'une poésie charmante, abstraction faite de leur alliance parfaite avec la musique debussyste (« la nuit à pas de velours vient endormir le beau ciel fatigué... et c'est dimanche dans les avenues d'étoiles »). Quoi qu'il en soit de sa valeur littéraire (54) (et pour nous, elle ne paraît pas douteuse), le recueil des Proses lyriques est l'un des mieux venus dans tout l'œuvre pour chant et piano, de Claude Debussy. — Le début de la première (De rêve...) est digne du prélude de Pelléas. Même décor de mystère, sous les vieux arbres d'automne ; nostalgie des siècles passés, siècles d'élan et de foi ; évocations, en quelques mesures, de cortèges héroïques entrevus dans les hautes futaies d'une forêt légendaire..., puis, tout retombe dans l'ombre du souvenir : « mon âme, c'est du rêve ancien qui t'étreint... ». De grève : comme une étude pour la Mer et certaines pages de Pelléas et Mélisande : en raccourci, une journée de la grève marine ; l'air frais, les flots vert-tendre, un « grain », puis, dans le soir, les cloches lointaines, sur les vagues apaisées. Suite d'aquarelles, « faites avec rien », comme on dit ; d'une habileté incomparable et, ce qui vaut mieux encore, d'un pittoresque aussi poétique que sensible. — De fleurs : on est ici dans une des Serres chaudes de M. Maeterlinck ; vitres de maléfice, « serre de douleur » où l'on étouffe, « soleil, tueur d'illusions »... Au début, des accords mineurs presque franckistes ; puis, après une période un peu flottante (« les grands iris violets », etc.) l'expression se fait dramatique, atteignant une réelle puissance. Ce tableau musical si caractéristique inspira l'obsédant entrelacis de feuilles vertes qui revêtait la couverture de la première édition, et qu'on regrette de ne plus trouver dans les tirages récents. — De soirs : par un après-midi de dimanche, c'est la joie de l'Echelonnement des haies, cette joie debussyste enfantine, naïve, exempte de toute vulgarité comme de toute arrière pensée, fraîche ainsi qu'une ancienne chanson populaire dans un mode grégorien. Puis, le soir descend... Une indicible poésie s'exhale à l'évocation de la nuit, — ample, solennelle, tendre et raffinée à la fois, Pour terminer, quelques mesures où le vieil Arkel semble chanter : « Prenez pitié des Villes »...
(53) Peut-être — ce n'est qu'une hypothèse ! — peut-être certains passages en furent-ils écrits après, et d'après la musique. La chose arrive parfois lorsqu'un compositeur est aussi l'auteur des paroles.
(54) Premier essai, je crois — et probant ! — de musique écrite sur de la prose. Depuis, l'on a eu les livrets de M. Bruneau, les Chansons de Bilitis de Claude Debussy, les Histoires naturelles de M. Ravel, l'Enfant prodigue de M. Darius Milhaud... Plus anciennement, et postérieurs de peu aux Proses lyriques, les Bienfaits de la Lune (de Baudelaire) avaient été mis en musique par M. E. Le Grand, dont nous reparlerons plus loin.
Succédant aux Proses lyriques, les trois Chansons de Bilitis montrent une phase nouvelle ; contemporaines, ou peu s'en faut, des Nocturnes (55). Par leur précision choisie et concise, ce sont de vraies médailles antiques. Comme G. Fauré, après des élans romantiques, après des expansions « développées », Debussy en vient à un style plus resserré, plus nettement classique. Et la source de son inspiration est différente. Les Proses lyriques se maintenaient dans une atmosphère de rêve et de légende ; ici, l'idée même étant celle de la lumière grecque, la forme tout naturellement exigeait un certain atticisme. On le discerne dès la première chanson de Bilitis, sorte de transposition musicale de ces Pastorales de l'Anthologie dont s'était souvenu M. Pierre Louÿs. La Chevelure (n° 2) est, si l'on veut, moins nouvelle : souvenir des blonds cheveux de Mélisande. Le Tombeau des naïades a le secret des évocations directes, immédiates, ainsi que certaines mesures de Pelléas et le début du Cimetière de G. Fauré : sans qu'il soit possible ni même permis d'analyser pourquoi cela est si parfait — et si simple. « Art impressionniste », prononce-t-on dédaigneusement (quand on ne le comprend pas). Nous nous sommes expliqué souvent sur la question, et ce n'est point le cas de la traiter ici par le détail. Chez Debussy, sauf de rares exceptions, « impressionniste » ne doit jamais signifier « écrit par taches, sans ligne nette ». Impression ? soit ; mais tout d'abord, sentiment ; — et, dans la forme, unité parfaite. Ce Tombeau des naïades en offre un exemple frappant. Le dessin se poursuit avec la meilleure et la plus claire logique, les harmonies se déduisent naturellement les unes des autres : cela est à la fois d'une plastique très précise et d'une évocation irrésistible (56).
(55) Composées en 1898, et postérieures à la partition de Pelléas et Mélisande, bien que celle-ci n'ait été jouée qu'en 1902.
(56) On doit insister sur les qualités de forme qu'offrent les œuvres dites « impressionnistes » ou « expressionnistes ») de Claude Debussy et de G. Fauré, parce que certaines critiques semblent établir une scission — purement factice — entre l'art objectif et le subjectif : celui-ci flottant au gré d'une sensibilité amorphe, celui-là possédant exclusivement l'équilibre musical, surtout s'il est de la « musique pure » qui ne vise à rien exprimer du tout. Nous ne saurions trop mettre en garde le lecteur contre ce qu'il y a d'arbitraire et d'injuste dans ces manières de voir. Il y a des musiques objectives qui sont fort mal construites ; et les œuvres « subjectives » de G. Fauré sont des modèles d'architecture, tout en traduisant la plus vive sensibilité.
On regrette infiniment que Debussy ait cru se devoir borner à trois seules Chansons de Bilitis, alors que tant d'autres du même livre s'offraient à lui, alors surtout qu'il était un des rares musiciens capables d'en comprendre et d'en formuler l'essence païenne (57). Mais, dans les dernières années de sa vie, il se tourna vers un art plus exclusivement français. Chauvinisme a priori ? Non ; plutôt amour naturel et profond des qualités que, jugeant nécessaires à l'art, il retrouvait dans la pure tradition de notre pays. Lisez Monsieur Croche, antidilettante : vous y trouverez des appréciations sur la Tétralogie qui pourront choquer plus d'un fervent des grands concerts ; mais en cela Debussy se montra précurseur de nos jeunes musiciens (58). Ils ont subi l'influence de la forme debussyste et de la forme fauréenne (art concis, sans redites), comme ils furent à l'excès rassasiés de Beethoven et de Wagner. Il y a donc ici tradition nationale, et non par esprit de haine ou d'étroit protectionnisme à l'égard de l'étranger, mais parce que nous sentons dans l'art français la présence de certaines qualités éternellement bienfaisantes. Elles existaient chez les Grecs et chez les Latins. Le contraire de ces qualités, c'est l'expression inutilement lourde, exagérément soulignée pour l'usage de ces primaires incultes à qui l'on doit répéter cent fois les choses.
(57) L'Aphrodite de C. Erlanger reste si loin, en vérité, de l'inspiration de M. Pierre Louÿs !
(58) Et s'ils semblent parfois tourner le dos à certains disciples de Claude Debussy, il n'importe. Ce sont des branches divergeant d'une même souche.

fac-simile d'un autographe de Georges Hüe (Rouart et Lerolle)
Cette tradition nationale, Debussy l'a particulièrement respectée dans les œuvres qu'il écrivit après les Chansons de Bilitis. Ce sont :
D'abord, Trois chansons de France. 1° le Rondel bien connu, de Charles d'Orléans, le Temps a laissé son manteau. On y voit la lumière de l'Echelonnement des haies et de la quatrième prose lyrique, dans l'atmosphère musicale de la Renaissance. Non pas froide, érudite reconstitution, mais plutôt résurrection sous une forme si naturelle, à la fois de jadis et d'aujourd'hui. Exemple frappant de ce qu'annonçait Bourgault-Ducoudray : les modes grecs, fort anciens, seront une source de musique nouvelle. De nos jours la preuve en est faite car les compositeurs écrivent en ce style, sans souci d'archaïsme, mais par instinct, par une préférence naturelle pour ces enchaînements d'accords. (D'ailleurs avec la plus grande liberté : ne se privant jamais, s'il leur plaît, de revenir provisoirement au majeur et au mineur « classiques ») L'ingénuité raffinée de Charles d'Orléans, la douceur de sa civilisation « renaissante » se retrouvent dans le commentaire musical si juste, si heureusement inventé. — La Grotte, atmosphère artificielle de serre luxueuse, avec quelque chose de la beauté périssable et stérile, si mélancolique, de Narcisse. Sonorité somptueuse, voluptueuse, presque défaillante par endroits ; et cela est d'une distinction extrême, que certains debussystes admirent sans réserve. — « Pour ce que Plaisance est morte... », rondel de Ch. d'Orléans : encore l'épanouissement naturel du grégorien français aux souffles de l'inspiration moderne. Un jeune rameau de l'arbre médiéval. Ses lignes pures, quelque peu dépouillées, révèlent un goût raffiné, ainsi que la seconde des Ballades de Villon. En même temps a disparu le romantisme des Poèmes de Baudelaire ou des Ariettes oubliées. Style classique, presque objectif malgré la présence réelle et constante (mais intérieure) de la sensibilité debussyste ; sérénité quasi religieuse...
Trois ballades de François Villon. La première (« de Villon à sa mye ») est des plus émouvantes ; sous la forme si discrète l'expression se devine, semble même plus forte et malgré tout conserve le pathétique de nos temps modernes (nullement incompatibles, d'ailleurs, avec l'inspiration personnelle de Villon). Je ne pense pas qu'il se rencontre jamais plus parfaite similitude entre deux génies. « Charme félon, la mort d'un povre cueur... » Une grande pitié pour les tristes choses humaines, en cet art debussyste. Angoisses de Golaud, méditations d'Arkel, trouble détresse, intense regret de Villon : qu'en dites-vous, qui ne tenez Debussy que pour un habile impressionniste ? La seconde (Ballade que fait Villon à la requeste de sa mère pour prier Nostre Dame) reconstitue, du moyen-âge, la simplicité raffinée... Usage des vieux modes, comme rajeunis par des « notes de passage » ; accords parfaits parallèles, ou bien écriture plus dénudée, à deux seules parties : ces éléments concourent à l'unité parfaite, ils se fondent harmonieusement en un tout, avec le refrain si recueilli, qui sent la cire des cierges et l'encens : En ceste foy je vueil vivre et mourir. Pièce unique dans l'histoire de la mélodie française, on la rapprocherait seulement (malgré la différence de l'écriture) de certains passages du Cimetière, de G. Fauré. — Enfin, la Ballade des femmes de Paris, au début un peu rapide, égayée d'allusions humoristiques à des thèmes napolitains, semble moins parfaitement réaliser l'idéal de la poésie et le désir du musicien. Il se peut d'ailleurs que la grande difficulté d'élocution, et qu'à l'orchestre la sorte de confusion résultant des accords rapides, empêchent de goûter à sa valeur cette spirituelle Ballade. Mais, si alerte, est-elle cependant assez en dehors ? Est-ce bien là le bon bec de Paris, autant que la première ballade est « la même tristesse » de Villon ?
Les dernières œuvres vocales de Claude Debussy restent fidèles à sa chère tradition française. Le Promenoir des deux amants (poèmes de Tristan Lhermitte) publié en 1910, se compose de trois pièces dont la première (« Auprès de cette grotte sombre ») fit partie tout d'abord des Chansons de France, ainsi qu'on l'a vu tout à l'heure. La seconde (« Crois mon conseil, chère Climène ») pourrait se trouver dans les Fêtes galantes ; elle n'est pas sans rappeler des passages de Clair de lune, avec un sentiment toutefois moins inquiet, et sans la nocturne conclusion dans le mystère. Ici, point d'infini, point d'angoisse secrète, mais une tendresse présente, dont l'expression se fait mesurée, et dont la mesure même ne saurait nous priver d'une belle ampleur. Quant à la troisième de ces mélodies, — ainsi qu'aux derniers accords de la précédente — il s'y trouve quelque chose, par moments, de confortable et de « facile » ; on songe à certaines parties de la Sonate pour flûte, alto et harpe. En face de cette écriture impeccable où rien ne semble avoir hésité, on est cependant saisi d'une vague inquiétude, cela n'est-il pas trop peu primitif ? Il faut s'entendre ici ; et l'on ne prétend pas qu'un artiste ait le devoir d'être maladroit ! Mais il n'est pas moins vrai que tout créateur entreprend une lutte, chaque fois qu'il crée... Tel, Debussy lui-même — avant d'en être sorti victorieux — fut un primitif dans le combat qu'il dut livrer avec la matière musicale, pour écrire Pelléas et Mélisande. Fauré aussi, lorsqu'il créa la Forêt de septembre, mais non plus dans le Ramier, ni dans le Plus doux chemin. Nuances si l'on veut, ces nuances ne sont pas négligeables.
Le recueil suivant (1913) des Trois poèmes de Mallarmé présente un aspect tout autre. Par la nature même de ces poèmes, où l'on sait combien chaque mot à d'importance, Debussy se trouva conduit à faire, comme on dit, la « musique du mot ». Il y parvint d'ailleurs avec une incomparable maestria. Sans rompre la ligne, ou tout au moins sans qu'on éprouve jamais une impression de marqueterie. Ses recherches sont d'une précision rare et d'une subtilité fort réussie. Voyez, notamment, à la dernière page de Soupir : « sur l'eau morte où la fauve agonie des feuilles erre au vent... ». Dans Placet futile, dont la préciosité voulue n'est pas au détriment de l'expression, le commentaire du mot se fait plus minutieux encore. Un motif persistant rétablit l'unité de l'ensemble, non sans des harmonies raffinées, parfois fort inattendues... On sait l'ancienne et grande admiration qu'éprouvait Debussy pour le poète de l'Après-midi d'un Faune. II avait été reçu chez Mallarmé ; l'œuvre et l'homme lui étaient familiers. On ne s'étonnera donc point de trouver, en ces trois pièces, une compréhension si juste, si subtile et si profonde... L'Eventail est étrangement mallarméen. Très descriptif, il ne réalise pas seulement la traduction musicale des paroles ; mais la musique a le caractère même de la poétique. Une sorte de mystère dans la ligne vocale et dans les harmonies : on a la certitude que le secret ne s'en livre pas aisément à chacun, — et que néanmoins avec une attention ingénieuse et soutenue, on pourra s'en rendre maître sans trop de mal. Premier aspect, sibyllin, d'un langage précis et clair à qui l'a su déchiffrer (59). Admettez, si vous voulez, que j'exagère un peu quant à l'obscurité première de cette musique ; et cependant, sa réserve comme aussi certaine étrangeté harmonique, n'est-ce point là du pur Mallarmé ?
(59) On pourrait pousser plus loin la comparaison. Les accords employés ici par Debussy, apparaissent séparément assez simples, et c'est leur relation que le profane saisira plus difficilement : de même, pour la syntaxe de Mallarmé.
De tous les recueils de Chants de Claude Debussy, les moins connus sont le Promenoir des deux amants, (sauf la Grotte) et ses Trois poèmes. Ils sont bien loin d'avoir une renommée digne de leur valeur. — Pendant la guerre, on eût dit le contraire du Noël des petits enfants qui n'ont plus de maison. Aussi bien, sur un tel sujet, c'était la carte forcée de l'attendrissement, et le succès inévitable. Ce morceau d'ailleurs est fort bien venu ; il ne manque de caractère, ni de conviction, ni de musique. Cependant les triomphes qu'il remporta furent hors de proportion — est-il besoin de le dire ? — avec sa beauté propre. On le joue moins souvent aujourd'hui ; mais, comme tout le monde a dû l'entendre au moins une ou deux fois, il n'est pas utile que nous en parlions davantage.
De l'œuvre vocal tout entier de Claude Debussy se dégage une conclusion très nette : c'est (malgré la personnalité toujours reconnaissable de ce maître si caractéristique) l'extrême variété de ces divers recueils, et l'absence des formules. Des critiques ou même des compositeurs, qui ne comprenaient point Pelléas et Mélisande, parlèrent à ce propos d'un art systématique, comme fabriqué avec un petit nombre de recettes infaillibles. Rien de plus injuste (et sur le seul chapitre des neuvièmes dont certains lui reprochent quelque abus, il est facile à l'analyse de voir que l'écriture de ces accords est très différente suivant les cas). Chez Debussy, il y avait presque toujours renouvellement et création. Qu'en telles de ses mélodies, ainsi qu'également dans quelques préludes de piano, on puisse regretter certain fléchissement de l'inspiration, c'est possible. Mais, pour le reste, quelles richesses, quelles trouvailles, et quelle incessante évolution !
On s'en aperçoit, lorsqu'on en vient à comparer ces œuvres à la plupart de celles que d'autres écrivirent dans le même temps.

fac-simile d'un autographe de Florent Schmitt
Pendant « l'époque debussyste » (c'est-à-dire d'environ 1890-95 à 1914) l'École française s'est montrée extrêmement féconde ; nombre de compositeurs cultivèrent avec succès le genre qui nous occupe. Les uns, contemporains de Claude Debussy, voire même légèrement antérieurs ; d'autres que dans une certaine mesure on peut estimer ses disciples — voire presque, parfois, des imitateurs ; — certains au contraire, fidèles à une tradition d'écriture peu novatrice ; — puis, des élèves de M. d'Indy plus ou moins strictement attachés aux principes de la Schola Cantorum ; — enfin, des indépendants, des solitaires qu'il est difficile de grouper. Nous nous trouvons ainsi en présence d'une vaste production, dont beaucoup d'éléments sont dignes d'intérêt (60). Sans nous illusionner sur la valeur de notre classification (car c'est toujours chose assez factice), nous présenterons donc cet ensemble si divers, en ayant recours aux groupements indiqués plus haut.
(60) Néanmoins — à part quelques-unes — les mélodies dont il s'agit n'ont pas la beauté de premier ordre ni l'originalité foncière que l'on rencontre chez Debussy, Chabrier, Fauré, M. Duparc. Donc, le plus souvent, nous n'entrerons point dans les mêmes détails qu'au sujet de ces maîtres. D'ailleurs, à l'égard des œuvres les plus récentes, celles de jeunes compositeurs, on n'a pas encore eu le temps de les bien connaître (et puis, il est des personnalités que l'on ne saisit pas tout de suite). En conséquence, nous devrons nous borner à de simples citations, destinées à seulement attirer l'attention du public sur ces noms, et sans que nous ayons la prétention, pour la plupart de pouvoir émettre aucun jugement à leur sujet.
I. Contemporains ou aînés de Claude Debussy. Du même temps, d'ailleurs, que des musiciens de l'école franckiste (Chausson, M. de Bréville, M. Guy Ropartz), voici plusieurs compositeurs notoires dont il sied de ne pas omettre les œuvres... Erlanger d'abord, avec ses Chansons russes, plus naïves d'écriture que ses drames lyriques et moins ambitieuses, mais non sans un certain charme dont ses œuvres scéniques furent plus avares. — A l'époque déjà lointaine de la Vie du poète, M. Charpentier fit exécuter certaines mélodies avec accompagnement d'orchestre (aux Concerts Colonne) ; elles ont paru ne point manquer d'une couleur assez vive (Dame souris trotte...)
Egalement, de M. Charpentier, un recueil où se trouvent traduits plusieurs poèmes de Verlaine. — De M. G. Hüe l'on citera notamment des Croquis d'Orient (d'après la Shéhérazade de M. T. Klingsor), dont le plus connu, l'Ane blanc, fut son cheval de bataille dans les salons mélomanes : esquisse amusante, sans prétention et somme toute fort bien réussie. — De M. A. Dutacq, deux beaux duos (Larmes, et Arpège, poésies d'A. Samain) que l'on peut rattacher à l'école franckiste ; trop rarement chantés, ils méritent qu'on ne les oublie point ; — Sur des textes de Catulle Mendès, M. A. Bruneau écrivit deux recueils caractéristiques, les Chansons à danser et les Lieds de France. L'ampleur propre à ce compositeur essentiellement dramatique s'y décèle en d'émouvantes pages, par exemple la Sarabande, et les Mauvaises fenêtres, non sans d'ailleurs qu'il y ait, en d'autres de ces pièces, les qualités de charme que possède aussi le Rêve ; et l'Heureux vagabond, chanté par M. Engel, nous laissa le souvenir de larges horizons, de belles impressions de plein air. En comparaison, les Chants de la vie, plus récents, semblent d'une inspiration bien inégale. — M. Paul Lacombe, presque contemporain de Saint-Saëns et l'un des rares survivants de cette ancienne génération, n'a point cessé de composer malgré son grand âge et c'est pourquoi nous préférons le placer à cette époque relativement récente, d'où datent les meilleures de ses mélodies. — M. René Lenormand, dont on sait la belle vitalité (et la noble sympathie à l'égard de tout ce qui s'écrit de nouveau), est l'auteur de nombreux lieder (61). Tels sont pleins d'une ardente, romantique et passionnée conviction, d'autres fort délicats, d'une intime et tendre sensibilité qui n'est point du tout banale. Et, comme son fils (M. H.-R. Lenormand, l'auteur dramatique bien connu), il se montre particulièrement hanté par les pays lointains d'Orient, d'Asie, d'Océanie : on ne s'étonnera pas de trouver ses exquises Mélodies exotiques les plus réussies, peut-être, de toutes celles qu'il a produites. — M. Alexandre Georges connut la célébrité avec ses Chansons de Miarka, à tel point qu'elles servirent de substratum à un ouvrage scénique, qui fut donné à l'Opéra-Comique. Certaines ont un indiscutable accent ; il en est aussi qui ne manquent pas de charme. — M. M. Emmanuel mérite à coup sûr d'être connu comme un savant historien de la musique : mais ce n'est pas le tout, ce n'est même pas le principal de son œuvre : voyez en lui un compositeur à la fois sérieux et hardi (nous y reviendrons au chapitre de la chanson populaire) ; son écriture habile, qui sait allier le respect de la tradition au besoin d'innover (62), ne masque jamais du vide. Comme son maître Bourgault-Ducoudray (63), c'est un fervent des modes grecs, qu'il sait employer de la façon la plus heureuse. On connaît trop mal ces mélodies du moins arriviste des compositeurs. Signalons au public l'émotion du triptyque In memoriam (écrit pour voix, piano, violon et violoncelle) ; la grâce des Odelettes (réduction, d'après l'orchestre, pour piano, voix et flûte) ; une suite de douze mélodies (« Musiques », poèmes de P. de Nay) apparentées les unes aux autres par des rappels, des variations, etc., et un certain nombre de pièces encore inédites.
(61) Ici le terme de lieder peut s'employer, à cause de la nature même de ces œuvres.
(62) Notons à ce sujet, les Sonatines dont la première date de 1887, et contient des passages d'une audacieuse bitonalité.
(63) Les plus belles harmonies de Bourgault-Ducoudray se trouvent incontestablement dans ses transcriptions de chants populaires (de la Bretagne, de la Grèce, de l'Ecosse). Toutefois il écrivit plusieurs mélodies, parmi lesquelles on citerait l'Hippopotame (sur le texte de Th. Gautier), d'une large et forte inspiration.

fac-simile d'un autographe de Maurice Ravel (propriété de la maison Durand)
II. Les Debussystes. Toutes réserves faites sur l'absolu de notre classification, il est manifeste pourtant que certains compositeurs subirent l'influence de Claude Debussy, — ou bien, qu'ils vécurent dans la même ambiance artistique et littéraire. De ce nombre, d'abord, M. Florent Schmitt et M. E. Le Grand. Cela remonte aux derniers temps du professorat de Massenet ; M. Schmitt mettait en musique diverses poésies de Verlaine (O triste était mon âme, etc.) et de M. C. Mauclair (les roses de l'autre année sont mortes) qui sont parmi les meilleures de ses mélodies. On connaît mieux les Barques, Musique sur l'eau, Tristesse au jardin ; en dépit d'une expression musicale qui n'est pas toujours, peut-être, en harmonie parfaite avec les paroles, un tempérament vigoureux y déchaîne de puissantes effusions d'orchestre ; elles submergent un peu la voix, mais sont animées de la même vie que le Quintette. — M. E. Le Grand, depuis de longues années, abandonna la composition musicale après de remarquables débuts, exceptionnellement pleins de promesses. Les élèves de Massenet, ses camarades, n'ont pas oublié l'étincelante Sirène d'or, ni surtout les Bienfaits de la lune, où le hardi musicien commentait la prose de Baudelaire avec des accents si justes et si pénétrants. Bientôt après (fut-ce devant la griserie que nous apporta l'Ecole Russe, ou bien en face des Nocturnes et de Pelléas ?) cet artiste hors ligne, dont l'inspiration était aussi riche de chants que d'harmonies et de rythmes, se décourageant de jamais pouvoir atteindre la beauté qu'il poursuivait, décida de ne plus écrire ! A-t-il tenu parole ? Le démon intérieur ne fut-il pas plus fort ? On le saura peut-être un jour ; en attendant, nous lui devions cet hommage de vive et fidèle admiration.
D'ailleurs, bien que M. Schmitt et M. Le Grand fussent de très fervents debussystes, leurs personnalités restaient à part, et les ressemblances avec les Poèmes de Baudelaire ou les Ariettes oubliées, assez superficielles. Elles sont plus profondes chez M. Raymond Bonheur (à qui le maître dédia le Prélude à l'après-midi d'un Faune). Mais on peut dire que ses œuvres, extrêmement distinguées et si finement musicales, sont moins imitées que simplement contemporaines. Les similitudes ici nous paraissent dues à des sensibilités voisines, à de pareilles sympathies littéraires et artistiques. L'un des premiers, M. Raymond Bonheur découvrit M. Francis Jammes dont il traduisit fort heureusement plusieurs poèmes. Signalons aussi la belle Elégie, assez parente à la fois de Pelléas et de la Damoiselle élue.
Pour M. Ravel, l'opinion publique est enfin éclairée. Nul critique musical ne se risquerait (comme le firent naguère certains importants personnages) à prétendre qu'il ait imité Debussy, en raison de quelques analogies de formes et d'accords. Ses premières mélodies, d'ailleurs, ne pouvaient donner le change à de bons musiciens. D'Anne qui me jecta de la neige, et d'Anne jouant de l'espinette, utilisent les anciens modes d'une toute autre façon qu'à la même époque ne le faisait Debussy. On n'y trouve point la sorte de confession presque naïve et si tendrement émue des Poèmes de Baudelaire ou des Ariettes, mais une précision de lignes, une volonté nette dans la structure, une lumière cristalline de glace et de givre. Cela suffisait à juger que ce musicien était bien lui-même, et non pas un reflet de Claude Debussy. Mais l'incompréhension est le propre de l'homme ! — Sainte, loin de rappeler l'auteur de Pelléas, ne ferait songer qu'à certaines harmonies de M. Erik Satie (ex. Sarabandes, et Sonneries de la Rose-Croix), de même que la phrase initiale de la Belle et la Bête (de Ma mère l'Oye) rappelle évidemment la seconde Gymnopédie. — Avec Shéhérazade (trois poèmes de M. T. Klingsor) M. Ravel donne sa pleine mesure. Et son expansion juvénile est d'autant plus précieuse qu'elle semble « sortie malgré lui », plus forte que la retenue et la pudeur d'un musicien qui ne s'abandonne pas volontiers. « L'abandon » (si l'on peut dire) de Shéhérazade n'oublie jamais de garder la plus excellente tenue de style. Quelle lumière dans Asie et dans la Flûte enchantée ! Quelle élégance si mélodiquement expressive dans l'Indifférent ! L'ivresse première du Voyage d'Urien (de M. A. Gide) semble remplir Asie ; on y rencontre de ces trouvailles essentiellement musicales (la pédale de Ré, vers la fin) dont ne s'avisent que les heureux marqués au front par la déesse. — Même éclat méditerranéen dans les Chansons grecques. Il ne s'agit ici que de transcriptions, les thèmes étant populaires ; mais elles réalisent l'unité absolue avec des chants dont elles dégagent et multiplient la beauté. — Dans les Histoires naturelles, M. Ravel se montre bien le musicien de l'Heure espagnole ! mais avec, à l'occasion, des impressions de nature, voire de poésie nocturne (ex. le Grillon) tout à fait précieuses. Et son humour ne cesse jamais (quoiqu'on l'ait prétendu) d'être de la musique. — Peu de « mélodies séparées » : les Grands vents venus d'outre-mer, un Ravel plus inattendu, quelque peu tragique et mystérieux, non sans accent d'ailleurs ; Sur l'herbe, où sa conception précise du dialogue, ses nuances finement comiques, sa vision d'un dix-huitième siècle mondain, se donnent librement carrière. — Enfin, trois poésies de Mallarmé. Il n'est pas fréquent de voir les compositeurs se risquer à « l'auteur difficile » de l'admirable Sonnet sur la tombe d'Edgar Poë. Nous avons parlé des belles traductions de Claude Debussy. L'écueil est dans la difficulté, parfois, de deviner les paroles : on le retrouvera plus loin, avec les Chansons bas de M. Darius Milhaud. Pour le Soupir (n° 1 du recueil de M. Ravel), on suit aisément la pensée du poète et celle du musicien, aboutissant à l'émouvante envolée « vers l'azur attiédi d'octobre pâle et pur, qui mire aux grands bassins sa langueur infinie ». Mais le Placet futile est d'une compréhension moins aisée. C'est un frère cadet de Sur l'herbe ; il évoque, en de multiples et rapides intentions, le siècle des petits abbés et des belles dames. La prosodie, chose rare chez M. Ravel, est parfois discutable (64) ; des effets de détail sont fort bien réussis ; mais l'ensemble reste coupé, et d'une mièvrerie qui, voulue évidemment, n'en demeure pas moins bien chatoyante. — Surgi de la croupe et du bond nous paraît, et de beaucoup, la meilleure de ces trois pièces. Etrange comme les vers eux-mêmes, son mystère n'est pas près d'être dévoilé. Impression saisissante où, malgré le charme persistant de l'écriture, planent de sinistres menaces...
(64) Voyez, par exemple, la première phrase : « Princesse ! à jalouser le destin d'une Hébé... j'use mes feux ». Dans la mélodie de M. Ravel, Princesse se trouve lié avec ce qui suit : à jalouser ; d'où, impossibilité de comprendre la phrase.
On ne peut celer que les contemporains de M. Ravel, ceux du moins qu'on serait tenté de classer dans l'école debussyste, n'atteignent ni la précision raffinée des Histoires naturelles, ni l'émotion profonde des Ballades de Villon. Chez certains d'entre eux — comme M. Roger-Ducasse (65) par exemple — la Mélodie pour chant et piano est l'accessoire, la musique de chambre ou d'orchestre formant l'essentiel de leur œuvre. — De M. Louis Aubert, on connaît et l'on a plus d'une fois entendu les Rimes tendres, les Crépuscules d'automne, les Poèmes arabes. De celles-là à ceux-ci, une évolution incontestable dans le langage musical de cet habile compositeur. — Non moins habile, M. Inghelbrecht, de qui le Jardin de l'Infante s'inspire d'un Samain indécis et frêle, mais non sans charme. — Charme sincère également, exempt de toute prétention, celui de M. Jacques Pillois (ex. l'Anémone et la Rose). — Le regretté A. Caplet fut un prix de Rome tôt converti à la religion debussyste, et dont on connaissait la ferveur (66). Son style se rattacherait plutôt à celui des œuvres les plus récentes de Claude Debussy, — avec une déclamation extrêmement soignée et une remarquable souplesse d'écriture pianistique... (67) Citons notamment ses trois Fables de La Fontaine, d'une fantaisie subtile et précise, et d'une raison très intelligente. — Enfin, à cause de sa naturelle tendance au charme, nous rattacherions à ce groupe M. Jean Huré, dont malheureusement plusieurs recueils sont encore inédits (Mélodies, 1893-1900 ; Sonnets de Ronsard, 1913 ; Motets, 1895-1923, etc.). Son Hymne à la nuit (extrait des Chansons de Bilitis de M. Pierre Louÿs) nous semble une des meilleures caractéristiques de cet artiste trop rarement chanté, dont la séduction naturelle est soutenue d'un art raffiné et sûr.
(65) Deux Rondels.
(66) Il réalisa diverses orchestrations de pièces de piano de Claude Debussy, et fut l'un des meilleurs chefs d'orchestre ayant interprété les œuvres du maître.
(67) Plusieurs de ces mélodies sont d'ailleurs écrites pour chant et orchestre.
Dans ce même ensemble « debussyste », il serait assez logique de placer M. L. Rohozinski, — élève successivement de M. Victor puis de M. Vincent d'Indy — mais dont les caractères musicaux ressemblent davantage à ceux de Claude Debussy ou de M. Ravel. Et ses sympathies littéraires s'apparentent également à celles qu'affirma l'auteur du Balcon et des Ariettes oubliées. Fidélité à l'égard de « nostalgies anciennes » qui paraissent un peu dédaignées aujourd'hui ; mais les Hiboux et la Cloche fêlée (68) ne le font point regretter.
(68) De la suite de Quatre mélodies de M. Rohozinski.
Enfin on devrait également s'aviser que par sa Délie, M. Roland Manuel (élève de M. Ravel) est en quelque sorte un continuateur du Claude Debussy des Chansons de France : nous en parlerons plus loin, au chapitre des « jeunes ».

fac-simile d'un autographe de D. E. Inghelbrecht
III. Musiciens plus traditionnels, prix de Rome pour la plupart. Il est assez compréhensible que certains prix de Rome aient gardé un style peu révolutionnaire : soit qu'ils aient obtenu le prix en raison de leur « sagesse » naturelle, soit que la pratique de la cantate et des envois de Rome aient influé sur leur avenir. Mais précisément, à cause de cette docilité, de cette facilité correcte, et pour tout dire, de cette tendance à la formule, il est assez rare que leurs mélodies offrent davantage qu'un intérêt secondaire. Peut-être d'ailleurs n'y prêtent-ils pas d'importance, réservant au théâtre le principal de leur effort : ce théâtre vers quoi, dès le début de leur carrière, les porte déjà l'épreuve habituelle du concours de Rome.
M. Henri Rabaud, avant qu'il ne fût directeur du Conservatoire, s'était affirmé comme symphoniste et comme musicien de théâtre, par le grand succès de Mârouf et de la Procession nocturne. Pour mémoire seulement, nous rappellerons qu'il écrivit quelques mélodies ; elles ne comptent pas au nombre de ses œuvres les plus marquantes. La meilleure semble une vive et gaie Chanson (« que je t'aime, joli berger ») restée d'ailleurs sans lendemain. — M. Henri Büsser est l'auteur d'un assez grand nombre de pièces vocales, parmi lesquelles certaines sont caractéristiques de son heureuse nature ; elles mériteraient d'être mieux connues : Retour de Vêpres, notamment, et surtout Ames obscures (sur les charmantes paroles d'Anatole France) ainsi que : Maman chante avec nous, recueil de chansons où les sentiments enfantins sont gaîment exprimés, le plus souvent d'une façon très réussie. — M. Max d'Ollone, sous l'influence constante de Massenet, ne doit point cependant être traité d'épigone ; car il est allé plus loin ; c'est du Massenet, moins théâtral, mais intensifié quant à l'harmonie. D'ailleurs l'action du maître s'exerça naturellement, en raison de certaines analogies dans la manière de sentir et de s'exprimer. En l'abondante production de M. d'Ollone, où tout n'est pas d'égale valeur, on rencontre bien des pages émues, pleines de musique et de tendresse (ex. Adieu, Oublier, Nuit d'été, etc.) L'ingénuité et l'aisance du Chant d'amour se trouvent aussi dans les Premières communiantes. Ici-bas, tous les lilas meurent (de Sully Prudhomme) est commenté avec un pessimisme mystique auquel n'avait point songé Gabriel Fauré. Mais les plus remarquables, sans doute, de ses mélodies (outre le recueil In memoriam d'après Tennyson) sont celles dont il écrivit lui-même les paroles, ainsi qu'il le fit pour ses drames lyriques : Jean, le Retour, l'Etrangère. On y sent une pareille émotion philosophique et religieuse : Nuit de printemps, cri d'angoisse d'un être qui ne peut plus croire ; Soir d'hiver, première inquiétude de l'enfant en face de la douleur humaine et du grand problème de l'Injustice...
Citons encore :
M. Raoul Laparra, M. Léon Moreau, Fernand Halphen, M. R. Hahn (Chansons grises, Etudes latines, Au pays musulman, etc.), M. Jean Cras (Elégies, Offrandes lyriques), M. Lucien Haudebert (Dans la maison), Lili Boulanger (69) (Clairières dans le ciel, sur des poésies de M. Francis Jammes, dont certaines traductions sont fort touchantes : Au pied de mon lit, Si tout ceci n'est qu'un pauvre rêve, Je garde une médaille d'elle, Demain fera un an...)
(69) Ce recueil est loin, d'ailleurs, de donner une idée complète de ce qu'est l'œuvre de Lili Boulanger : il faut se reporter également à son très bel Agnus Dei, à ses trois grands Psaumes ; il faudrait aussi connaître cette Princesse Maleine qui fut sa dernière composition.
Mais c'est ici que nous apercevons clairement les défauts de notre classification ; car les œuvres de M. Jean Cras (élève de M. Duparc) ne sont pas sans rapport avec celles des disciples de M. d'Indy ; et le recueil de Lili Boulanger pourrait aussi bien être placé en regard de certaines mélodies de la famille debussyste.

fac-simile d'un autographe d'André Caplet (propriété de la maison Durand)
IV. Elèves — ou transfuges — de la Schola Cantorum. Parmi les musiciens qui travaillèrent avec M. Vincent d'Indy, le déchet semble assez considérable (70). Aujourd'hui l'opinion peut être fixée à ce sujet, par bien des sonates ennuyeuses, par mainte œuvre où le métier est trop rudimentaire et la construction peu solide.
(70) Notez aussi qu'il existe au Conservatoire un grand nombre de prix de fugue, ou même de Rome, qui n'ont quasiment rien produit d'intéressant : tout n'est pas non plus pour le mieux sur la rive droite de la Seine.
Mais, si la cause est à peu près entendue à l'heure actuelle, on constate cependant qu'un nombre restreint de compositeurs (dont l'éducation s'est faite en partie double : à la Schola, et ailleurs) ont écrit, à côté d'œuvres intéressantes dans le domaine de la musique de chambre ou de la symphonie (71), des mélodies pour chant et piano qui ne sont aucunement négligeables. On peut objecter bien des choses à l'enseignement de la Schola cantorum ; mais il faut croire que dans certains cas, mélangé en proportion raisonnable à celui du Conservatoire, la sorte d'austérité sérieuse qui le caractérise n'a point abouti (comme trop souvent chez les purs « scholistes ») à de l'ennui pur.
(71) Parfois même de premier ordre, comme celles de M. Albert Roussel.
C'est le propre des disciples, en général, d'acquérir les défauts des maîtres, non leurs qualités ; mais il n'en est pas toujours ainsi — heureusement ! — et quelquefois l'influence de M. d'Indy s'est exercée de la meilleure manière.
M. Paul Ladmirault, d'abord élève de Fauré, puis ayant fréquenté plus ou moins la Schola cantorum, s'est distingué dans ses harmonisations de chants populaires (sur quoi nous reviendrons plus loin). Ses mélodies proprement dites témoignent de l'excellente musicalité qu'on s'accorde unanimement à lui reconnaître (ex. l'Aubépine). — Mieux que ses œuvres vocales (d'ailleurs peu nombreuses), les suites pour piano, de Déodat de Séverac (le Chant de la Terre, En Languedoc) donnent une idée complète de ce musicien aux idées fraîches et charmantes, parfois vigoureuses et rythmées. On connaît surtout Ma poupée chérie, et la Chanson du petit cheval ; rappelons aussi la Chanson de la nuit durable, et ce poème de plus vaste envergure, dont le compositeur écrivit lui-même les paroles : A l'aube, dans la montagne. — Cette inspiration dont la nature est le thème éternel, nous la retrouvons dans les pièces lyriques de M. J. Canteloube : l'Arada (la Terre) suite de six mélodies sur des sonnets en langue d'oc ; le Triptyque (sur les poèmes de M. Roger Frêne) récemment exécuté aux Concerts Colonne ; les Chants d'Auvergne, etc. — Egalement loin des tristes villes, le Poème féérique et sylvestre de M. E. Royer : ce sont des impressions d'une journée en forêt, traduites par un langage à la fois naïf et subtil, sans mièvrerie... Les trois Chants lyriques du même musicien tentent, avec nos ressources occidentales, des équivalents du langage oriental, et nous avons d'autant plus d'inclination à trouver la chose licite, qu'elle fut notre but également dans les mélodies extraites de la Shéhérazade de M. Tristan Klingsor, ainsi que dans la suite orchestrale : les Heures Persanes. — M. Albert Groz est l'auteur d'un assez grand nombre de pièces vocales dont la plus connue, croyons-nous, est le Cantique des créatures, de Saint-François d'Assise (pour baryton et orchestre). Une évolution se remarque, depuis ses premières œuvres (les Heures d'été, 1904) jusqu'aux Chansons créoles (1919), et les mélodies sur des poèmes de M. Henri de Régnier : Epigramme, Lied (1922). Il se fait une sorte de clarification de l'idée, et l'écriture devient plus classique, plus fauréenne...
Enfin, M. A. Roussel écrivit toute une série de mélodies — la plupart sur des vers de M. H. de Régnier, — d'une haute tenue de sentiment, et parfois d'un pathétique douloureux dont il est difficile de ne pas ressentir l'émotion. A côté de pièces spirituelles et charmantes, telles que l'Ode à un jeune gentilhomme et le Bachelier de Salamanque (qui sont à peu près, dans son œuvre de mélodiste, ce que représente le Festin de l'Araignée par rapport aux Evocations), — le Départ, les Adieux, sont du profond Roussel — avec une certaine austérité qui, n'étant qu'une forme de sa naturelle réserve, rend l'expression plus forte et plus belle encore, le tout d'ailleurs d'un langage et d'une pensée absolument à lui. Ce recueil de mélodies est de ceux qui dureront, parce qu'il est fait d'une substance d'impérissable sensibilité.
V. Des Isolés. On aurait pu ranger M. Roussel, tout aussi bien, dans ce groupe. On était en droit, d'autre part, de présenter Albéric Magnard au milieu des élèves de M. d'Indy.
Les quatre poèmes pour baryton, de Magnard, semblent d'abord un peu touffus avec leur écriture « concertante » : mais on les découvre si sincères, si humains en leur naïve confession d'autobiographie ! Le texte est de Magnard lui-même ; il se rapporte à des événements personnels. La musique y montre ce mélange de vigueur et de tendresse que tout le monde n'a pas compris chez un artiste dont l'émotion pourtant apparaît si forte à qui veut bien aller au-delà des notes elles-mêmes. Un style dont les moyens sont très connus ; mais telle est la puissance du cœur vivant que des pages comme les premières ou les dernières du quatrième poème peuvent supporter la comparaison avec les plus beaux lieder de Schumann ou de Schubert. La conception, évidemment, n'est point celle de G. Fauré ni de Claude Debussy, car la formation musicale de Magnard procède directement des « classiques » germains. Mais l'essence de sa musique est autre que l'allemande, ainsi qu'on le voit par l'étude approfondie de ses symphonies ou de ses sonates. Elle est née de la terre française...

fac-simile d'un autographe de L. Rohozinski
Dans quelle partie de notre Ecole moderne ranger Gabriel Dupont ? On ne sait pas au juste... il ne fut précisément ni debussyste ni fauréen ; mais, n'ignorant rien de ces maîtres, il se rattache également (par l'élan de son inspiration mélodique et de ses rythmes) à M. Bruneau, voire à M. Charpentier. A part les Heures dolentes (suite symphonique), le principal de son œuvre est au théâtre (Antar, la Farce du cuvier, etc.). Il laisse un recueil de mélodies, Poèmes d'automne, où l'on appréciera sa généreuse et sincère spontanéité. — Camarade et contemporain de G. Dupont, mort plus jeune encore (à vingt ans, alors qu'il était au Conservatoire), Ch. M. Michel donnait les plus belles espérances par les dons musicaux et en quelque sorte moraux de ses œuvres : franchise d'accent, hardiesse (à cette époque) des modulations subites ; honnêteté, droiture, forte santé de son art... Il existe de lui deux recueils de mélodies (72) dont quelques-unes sont absolument dignes de survivre.
(72) Et deux Chansons écossaises de Leconte de Lisle, chez A. Leduc. Les recueils de mélodies ont été publiés par les soins de M. Max d'Ollone et du signataire de ces lignes ; ils sont en dépôt à la maison Durdilly et Cie.
En dehors du Conservatoire et de la Schola Cantorum, presque entièrement autodidacte, M. Paul Dupin a fourni une carrière musicale déjà longue. Les mélodies n'en sont pas la partie essentielle : cette puissante nature se plaît aux vastes développements. Toutefois, dans le recueil paru chez E. Demetz, on rencontre des pièces fort expressives, justement représentatives de cette nature si particulière, mélange de douceur résignée et de révolte fougueuse, — de tendres plaintes et d'invincibles espoirs. (ex. notamment : Pauvre fou qui songe, Au crépuscule, le Convoi, etc.). Dans sa suite de pièces de piano sur le Jean-Christophe de M. Romain Rolland, il se trouve, en conclusion, un lied pour chant, d'une grande beauté, et qui semble avec son allure classique, écrit par Jean-Christophe lui-même.
M. François Berthet, par contre, est surtout un compositeur de mélodies (bien qu'il ait écrit deux quatuors à cordes, des chœurs, et des suites pour le piano). Mais les circonstances de la vie et le caractère des musiciens causent des notoriétés différentes. Celle de M. Berthet ne correspond point à la valeur de son œuvre, tant s'en faut. Cette nature intime et profonde (d'une sensibilité à la fois contenue et débordante — comme du sang qui sortirait d'une plaie qu'on s'efforce de maintenir fermée) n'est pas du tout une nature d'arriviste : on lui reprocherait même — chose rare — de l'être trop peu. Si nous voulions faire un choix parmi cet ensemble de vingt pièces dont presque toutes seraient à citer, nous remarquerions : l'Ame d'une flûte, Aux collines, Spleen, Tant que mes yeux, Ce qui dure... Notez aussi l'humour si détaillé de la Sérénade (poésie de Mellin de Saint-Gelais), et la couleur curieusement orientale de la Chanson de flûte, sur la charmante poésie de M. Tristan Klingsor.
C'est ainsi qu'il existe, dans le monde de la musique, un certain nombre d'artistes qu'on est excusable de ne pas connaître, en raison de la discrétion qu'ils mettent à se faire jouer et de leur noble mépris de la réclame. Nul doute que nous-mêmes n'en ignorions de fort intéressants, tant il est difficile pour telle musique et pour telle nature d'obtenir des exécutions au concert. — On croit généralement que, de nos jours, les choses se sont modifiées à tel point que tout le monde peut arriver à faire entendre des mélodies ou des sonates. Je n'en suis pas sûr. On le croit, parce qu'on voit quelques jeunes parvenir à la renommée, « comme dans un fauteuil »... Mais disons qu'ils ont tout fait pour cela, habiles metteurs en scène, sachant se grouper, se faire valoir, entretenir des relations avec les critiques ; écrivant, d'ailleurs, de la musique « dans le mouvement », c'est-à-dire d'un langage polytonal, et d'une sensibilité particulière. Des rythmes violents ; au besoin, des danses, et des souvenirs de jazz. Couleurs vives, contours à l'emporte-pièce. C'est absolument leur droit ; et même, ils peuvent de la sorte réaliser des œuvres de valeur. Ils l'ont fait Mais supposez qu'un autre musicien (il en a le droit, lui aussi) déteste cette sorte d'art, et se montre d'une autre époque (passée, ou à venir, qui sait ?) Supposez que ses chants n'aient point les qualités destinées à faire briller les interprètes, ou bien à gagner d'emblée, par une percussion violente, le suffrage des auditeurs incultes qui forment la majorité... Croyez m'en : S'il est inconnu, personne ne le chantera, à moins d'une exécution fortuite qu'un de ses aînés aura pu favoriser de son influence. (73) Le chemin de la gloire ou seulement de la notoriété sera donc presque inaccessible à cet artiste intime et solitaire, surtout s'il lui répugne d'aller voir des protecteurs et s'il a quelque fière paresse, bien excusable, à cet égard. — Nous n'avons pas cru devoir omettre ces considérations générales : elles fixent la physionomie du présent, elles expliquent aussi pourquoi des œuvres de valeur ne sont connues que d'un petit nombre d'initiés et pourquoi elles ne figurent pas aux devantures des marchands de musique, alors qu'en revanche vous en verrez d'autres, dont nous ne parlons point ici. En matière d'arrivisme, on l'a vu par l'exemple d'Alexis de Castillon, c'est une lourde faute que de mourir trop jeune. Tel fut le cas du très regretté Paul Martineau (74), élève de M. Jean Huré. Il était exceptionnellement doué. Ses Chants hébraïques (écrits en 1914, d'après des mélodies juives populaires) montrent des voies harmoniques et une simplification d'idées, réellement nouvelles à cette époque. Si plus tard les Six voulurent un art vigoureux, c'est premièrement chez Paul Martineau qu'on le trouverait (75). On y trouve également un langage bitonal. Il s'affirme ainsi l'un des précurseurs de cette phalange plus connue que lui. En outre, il garde une émotion, un sérieux, une profondeur, un mysticisme que certains jeunes semblent provisoirement reléguer second plan. Paul Martineau était Breton, avec sans cesse la mer et ses vastes horizons devant les yeux ; sa façon d'être populaire (cf. Sonatine) n'a rien de commun avec celle des disciples de M. Jean Cocteau qui préfèrent à l'esprit des antiques chansons celui, plus contemporain, des foires de Montmartre ou de Neuilly. — Il existe aussi de Paul Martineau une étrange Chanson de fou, dont les rythmes haletants, le tournoiement halluciné s'arrêtent un instant pour laisser s'épanouir une large mélopée, d'allure grégorienne, à l'infinie tristesse, — angoisse d'aliéné qui reprend un peu de raison, tout juste ce qu'il faut pour la conscience de ce qu'il souffre.
(73) D'ailleurs, la notoriété même ne suffit pas. Il existe nombre de mélodies de Fauré (!) qu'on ne chante quasiment jamais (cf. Larmes, Nocturne, les Présents, etc.)
(74) Mort en 1914, à vingt-quatre ans.
(75) On le trouvait déjà, d'ailleurs, en cherchant bien, chez plus d'un musicien de l'école française contemporaine. Il y avait Pénélope et Prométhée. Et, à cette époque, M. Roussel avait presque terminé Padmâvati.
C'est également là de la « musique à l'emporte-pièce » avant celle de MM. Milhaud, Honegger et Poulenc. D'ailleurs la sorte d'inspiration en est différente — très différente — de celle du Bœuf sur le toit ou des Mariés de la Tour Eiffel. Quoiqu'il en soit, cette Chanson de fou est bien près de s'affirmer géniale. Il faut sauver de l'oubli d'aussi authentiques beautés ; les morts sont handicapés par le fait que les vivants se remuent : il n'ont pour porte-parole que de rares amis ; ils ne peuvent guère compter que sur le hasard, le hasard par lequel une page musicale, à la devanture d'une boutique d'occasions, ou sur les quais, se révèle aux yeux de l'amateur enthousiaste qui la fera connaître. Retenons le nom et l'œuvre de Paul Martineau.

fac-simile d'un autographe de Roland Manuel
Chansons et Mélodies populaires
L'orientation de la Mélodie française vers le poème symphonique avec paroles, vers un développement plus ou moins libre (et, dans tous les cas, affranchi du refrain), vers un « tout organique » comme peut l'être un « mouvement » de sonate, — nous la trouvons chez Claude Debussy, Fauré, M. Ravel, M. Roussel, etc. Pourtant il existe des lieder français, et des chansons modernes. Parfois la forme de la poésie, tout nécessairement, y mène (ex., de M. d'Ollone « Et s'il revenait un jour », sur le texte de M. Maeterlinck). Parfois aussi la nature de l'artiste le conduit vers une sorte de lied d'allure assez germanique : ainsi les mélodies de Massenet, celles de M. Lenormand, de M. Dupin, etc. Parfois encore les répétitions du Rondel peuvent revêtir une forme populaire. Debussy l'esquiva dans ses Chansons de France, ainsi que M. Roger Ducasse ; on trouvera plutôt cette interprétation un peu familière dans les Rondels de Th. de Banville mis en musique par M. Ch. Kœchlin, ou dans Si tu le veux (du même auteur), écrit à l'origine sur la Chanson de Bertrade de Grisélidis. Egalement d'essence populaire, les Vaux-de-Vire de M. A. Gedalge, sur les authentiques poésies d'Olivier Basselin ; on y goûte la naïveté de pensée et d'harmonie (76) qui convient à ces inspirations d'un caractère à la fois bon enfant et malicieux. — Dans le même ordre d'idées, les Chansons de bonne humeur de M. T. Klingsor (dont il écrivit les paroles et la musique) s'inspirent avec esprit des anciens rythmes et du ton goguenard de nos vieilles chansons. M. G. Pierné, avec Petit bonhomme, les Petits chats blancs, etc., a montré l'une des faces de son talent multiple, — peut-être la plus naturellement révélatrice de sa réelle physionomie.
(76) D'ailleurs, d'une impeccable écriture, est-il besoin de le dire ?
Il serait donc très possible que nous eussions des compositeurs de chansons « populaires », si ces chansons devaient être réellement comprises du peuple. Mais il faut bien constater que le style des anciens airs — auquel se rattache évidemment celui de MM. Gedalge, Klingsor, Pierné, etc. — n'est point celui qui semble en faveur auprès des masses, actuellement. Il serait nécessaire de guider tout d'abord ces masses vers de la vraie musique (sublime ou familière, peu importe) ; mais c'est de l'avenir imprévisible et le présent ne semble pas favoriser le genre de compositions populaires qui seraient en même temps de la musique...
Quant au passé de notre folklore, il motiva des reconstitutions tout à fait intéressantes, et qu'il nous paraît logique d'étudier dans cette partie consacrée aux œuvres de piano et chant. Des compositeurs modernes se sont donné la peine de transcrire ces airs anciens, les soutenant d'harmonies en accord avec les modes mêmes qu'ils emploient. Certaines personnes ont crié au scandale, sous prétexte que ces vénérables monodies ne devaient pas être accompagnées : on ne saisit guère pourquoi, si l'accompagnement et la mélodie forment un tout homogène. D'ailleurs, des œuvres telles que les Chansons grecques de M. Ravel, les Chants hébraïques de Paul Martineau ou les Sept chansons espagnoles de M. de Falla, sont véritablement de premier ordre. L'antique beauté des thèmes populaires s'y trouve admirablement en valeur avec ces réalisations de nos contemporains. — Mais déjà, et depuis longtemps, nous avions des modèles en l'admirable recueil de Chants de la Basse-Bretagne transcrits par Bourgault-Ducoudray. Vous y rencontrez des pages du plus noble caractère (l'Angelus, Mona, le Clerc de Tremelo), voisinant avec des chansons presque humoristiques ; des hymnes de joie et des cris de douleur, toute l'âme bretonne. Le propre de ces « traductions en langage polyphonique » est le retour aux vieux modes bretons, qui sont également ceux de l'art grégorien et de la musique grecque d'autrefois. Bourgault-Ducoudray (aidé par les savants travaux de Gevaert) devina les précieuses et multiples ressources de ces modes, lorsqu'ils sont harmonisés. Après lui, l'élan ne s'arrêta point. Nous avons dit plus d'une fois, au cours de cette étude, l'influence de l'antique langage, et son emploi naturel — expression même de la pensée musicale — chez Fauré (77), Claude Debussy, M. Ravel, etc.
(77) Il convient de rappeler, au sujet de Fauré, que le plain-chant et ses ressources lui furent enseignés à l'Ecole Niedermeyer.
Dans le domaine du Folklore même, l'effort de Bourgault-Ducoudray ne resta pas sans lendemain. En Bretagne particulièrement, M. M. Duhamel, M. Ladmirault (Chants de Bretagne et de Vendée ; deux vieux cantiques bretons), M. Jean Huré (Sept chansons bretonnes), M. J.-Guy Ropartz, M. Paul Le Flem, peuvent être considérés comme formant un groupe dans l'ensemble des musiciens français : — l'Ecole celtique — qui revendique sa nationalité particulière.
De son côté, M. Maurice Emmanuel, avec le même respect des anciennes gammes, avec également les richesses d'une écriture contrapunctique à la fois simple et hardie — celle entre toutes qui convenait — transcrivit des Chansons bourguignonnes extrêmement savoureuses. Ed. Moullé, dans ses Chansons normandes, fit preuve d'une imagination sans cesse en éveil et d'un goût très sûr. M. Vincent d'Indy a publié un très intéressant recueil de Chansons du Vivarais, dont certaines sont tout à fait belles. M. Canteloube s'est tourné vers le folklore de l'Auvergne et du Quercy ; M. E. Vuillermoz vers celui du Canada. M. Ravel, non moins heureusement que ses chansons grecques harmonisa quelques chants hébraïques, et M. Darius Milhaud, dans ses Poèmes juifs, utilisa d'anciennes mélodies dont fut bercée son enfance.
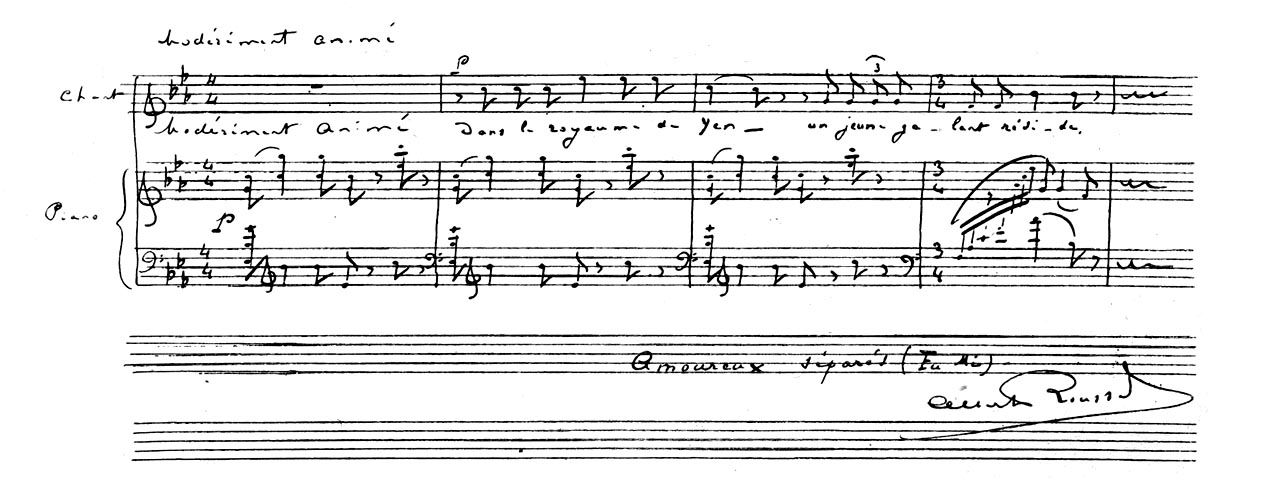
fac-simile d'un autographe d'Albert Roussel
Mélodies avec orchestre. — Chœurs, etc.
Le genre mélodie ou poème lyrique n'est pas exactement limité. Si d'une part il confine au chant populaire, au lied, de l'autre il s'étend jusqu'au poème de vaste dimension, pour lequel un accompagnement d'orchestre devient nécessaire. Plus d'un exemple s'en rencontre dans l'Ecole moderne.
Déjà, de simples « mélodies » appellent l'orchestre. Les poèmes d'Alexis de Castillon sont d'une ampleur qui n'est point déplacée en une grande salle de concerts. Egalement, nous citerons des œuvres telles que Phidylé, l'Invitation au voyage, la Vie antérieure, de M. Duparc ; Juin, Nox, Midi, le Nénuphar, l'Astre rouge, le Sommeil de Canope (78), du signataire de ces lignes, pour lesquelles l'orchestre est tout indiqué. — Debussy instrumenta le Jet d'eau, et G. Fauré, Clair de lune... Il arrive souvent, de nos jours, que de jeunes compositeurs transcrivent ainsi des mélodies écrites d'abord pour piano et chant : chose délicate à réaliser, mais non impossible. Un préjugé assez répandu voudrait interdire ces arrangements ; on soutient parfois que la musique intime ne supporte pas l'orchestre. Est-ce bien vrai ? Et n'en faut-il pas accuser, plutôt, de maladroites, de trop lourdes orchestrations, ou bien encore des exécutions trop sèches et trop appuyées ? En définitive, certains drames lyriques (Pelléas et Mélisande, Boris Godounov, et même Faust) contiennent des passages très voilés, d'une expression intérieure et discrète... Une salle de concerts (à moins qu'elle ne soit immense) n'exclut pas l'intimité ; et la sonorité des cordes, dans un pp, est aussi douce, — davantage même (et plus lointaine) que celle du piano. Nous concevrions très bien une version pour chant et orchestre, de l'Extase de M. Duparc, du Recueillement de Claude Debussy, et de notre Rêve familier (79). ... On accordera que chez Fauré, la délicatesse des parties pianistiques (en ses dernières œuvres) ne saurait trouver d'équivalent instrumental (ex. Je me poserai sur ton cœur, ou la première mélodie de l'Horizon chimérique). Et cependant, cette objection même est discutable, puisque orchestrée, la musique de scène du Pelléas et Mélisande de Fauré n'a point perdu son caractère fauréen, ni son mystère intime.
(78) Il existe aussi une autre version (orchestrale) de ce Sommeil de Canope d'Albert Samain ; elle est de M. G. Samazeuilh.
(79) Sur la poésie de Verlaine (cf. Ch. Kœchlin, 3e recueil de mélodies).
D'ailleurs, il faut bien l'avouer, nos compositeurs actuels ne tiennent aucun compte de ce qu'a pensé tel ou tel critique à ce sujet. Les œuvres pour chant et orchestre sont très nombreuses, et les grands concerts ne nous en présentent qu'un petit nombre. Nous avons cité M. Duparc et Claude Debussy : ajoutons M. Ravel, avec Shéhérazade et le Noël des Jouets ; A. Caplet (Hymne à la naissance du matin) ; M. Royer (trois chants lyriques) ; M. J. Canteloube (Triptyque) ; M. G. Soudry (trois poèmes — Concerts Colonne, 1922-23) ; M. Benoît-Méchin (trois poèmes de M. Jules Romain), etc., etc. Toutes ces œuvres prouvent « par le fait » la légitimité d'une orchestration.
Quant à celles d'un plus vaste développement, les théoriciens même ne posent plus la question. Il est évident qu'alors, l'orchestre est nécessaire. Depuis assez longtemps, l'on a pu trouver dans la musique française moderne des exemples de telles réalisations. N'insistons pas sur la Fiancée du timbalier, de Saint-Saëns, essai sans grande valeur, l'un des moins réussis en ce genre (nous lui préférons de beaucoup le Pas d'armes du Roi Jean). Mais la Damoiselle élue, de Claude Debussy (avec ses chœurs de voix de femmes), sur un poème du peintre « préraphaélite anglais » D.-G. Rosetti, est une des plus charmantes manifestations de cet art difficile. Elle se place, non tout à fait au début de sa carrière mais au temps où, pensionnaire de la Villa Médicis et marchant déjà vers l'avenir, le musicien des Proses lyriques commençait à prendre conscience d'une sensibilité si différente de celle que montrent la plupart des élèves du Conservatoire. — Le Second poème lyrique sur le livre de Job, de M. Rabaud, est peu connu — trop peu — : une seule exécution en fut donnée, voici près de vingt ans, aux Concerts Colonne. Œuvre singulière, absolument à part dans la production de M. Rabaud dont on sait l'habituelle sagesse, la sûreté, l'équilibre, la tranquillité. Ici au contraire, tout plein de l'indignation de Job devant les injustices de la vie, profondément angoissé par l'éternel problème de la douleur et du mal, c'est dans un fougueux sentiment de révolte que le musicien s'exprime.
D'inattendues dissonances, de hardies rencontres de notes, un trouble véhément, un orchestre et des rythmes inspirés de M. R. Strauss... Peut-être bien cette étrange exception restera-t-elle comme la plus saillante des pensées de M. Rabaud ; il en faut souhaiter de nouvelles auditions. — La Fin de l'homme (Ch. Kœchlin) est, comme sentiment (sinon comme réalisation musicale), assez voisine du Second poème sur le livre de Job. C'est toujours l'invective blasphématoire et passionnée de Leconte de Lisle (celle même dont s'anime l'admirable Kaïn), que lance à Jéhovah, dans une ironie amère, le vieil Adam près de mourir « Seigneur, je me repens du crime d'être né ».
Le Socrate de M. Erik Satie, d'ailleurs beaucoup plus récent, est d'une tout autre sorte. La réalisation orchestrale, discrète, n'utilise qu'un nombre restreint d'instruments ; et l'œuvre entière reste imprégnée d'atticisme, avec un sens grec de la mesure qu'on ne s'étonnera pas de trouver chez M. Satie, pour peu qu'on apprécie les qualités de ce musicien parfois méconnu. Les gens sérieux l'ayant catalogué : « humoriste du genre loufoque » n'admirent point qu'il pût s'attaquer à décrire la mort de Socrate. Mais ce n'est pas au moyen de classifications toutes faites qu'on devinera l'énigme qu'est l'artiste si curieusement divers auquel on doit les Gymnopédies et le Prélude à la porte héroïque du ciel, en même temps que les Danses du piège de Méduse, Parade, et les Trois petites pièces montées. Pour Socrate, rien n'est plus sérieux, et de la troisième partie notamment (la Mort de Socrate) une impression saisissante se dégage.
Le Job de M. Rabaud, la Damoiselle élue de Cl. Debussy, le Socrate de M. Erik Satie sont écrits sur de la prose. A priori, rien n'empêche que les musiciens n'y aient recours ; et la preuve a posteriori résulte de leurs œuvres. On conçoit ainsi que des fragments de livres puissent être traduits en musique. M. Darius Milhaud a choisi, dans la Porte étroite de M. A. Gide, les passages qui lui convenaient le mieux pour dépeindre l'idéal et la détresse d'Alissa Ce n'est plus, évidemment, de la mélodie proprement dite ; mais cela s'y rattache, et d'un autre côté, au théâtre.
De nos jours, le petit orchestre est en grande faveur. Par raison d'économie, sans doute ; mais aussi par une naturelle préférence de nos jeunes musiciens pour les sonorités plus précises, un peu crues parfois, qui en résultent. La Jeune Tarentine (Ch. Kœchlin), les Poèmes hindous de M. Delage, les Trois poèmes de Mallarmé de M. Ravel, le Bestiaire de M. Poulenc, et Ses poèmes de M. Max Jacob, le Catalogue de fleurs de M. Darius Milhaud, seront probablement suivis d'autres œuvres de même genre ; et ce ne sera point seulement une affaire de mode. On distingue fort bien, dans les Poèmes hindous de M. Delage, que ces sonorités nécessaires à l'œuvre ne pouvaient s'obtenir que par le mélange de ces éléments simples. Il convient de rappeler, d'ailleurs, que l'exemple fut donné, dès avant 1914, par M. Stravinsky (Poèmes de la lyrique japonaise) et par M. Arnold Schoenberg (Pierrot lunaire) (80).
(80) L'orchestration de la Jeune Tarentine est d'ailleurs plus ancienne, mais inédite. Il convient de rappeler aussi que Fauré avait écrit un arrangement de la Bonne chanson, pour piano et quatuor à cordes ; et l'on connaît celui, analogue, de la Chanson perpétuelle d'Ernest Chausson.

fac-simile d'un autographe d'Henri Rabaud
A la mélodie pour chant et piano se rattachent également les œuvres qui sont de petits poèmes symphoniques avec paroles, écrits pour des chœurs. Car on ne saurait les classer ni dans l'oratorio, ni dans le genre « suite symphonique avec chœurs » (81).
(81) En ces dernières années, plusieurs musiciens semblèrent d'avis que ces chœurs devaient être soutenus, jadis, par des instruments — du moins dans la généralité des cas. Mais peu importe ici. L'essentiel demeure que, de la tradition (vraie ou supposée) des chœurs a capella du XVIe siècle est issue de nos jours une tradition nouvelle, dont on peut espérer beaucoup.
Et d'abord, qu'est devenue la musique chorale a capella, par laquelle, aux XVe et XVIe siècles, les compositeurs traduisaient les œuvres des poètes ? Après un long sommeil et qui semblait de mort, ce genre est véritablement ressuscité. — Il était logique que Charles Bordes, fondateur des chanteurs de Saint-Gervais, s'y consacrât ; rappelons à ce sujet son charmant Madrigal à la musique (d'après Shakespeare, traduction de M. Maurice Bouchor). On connaît et l'on a souvent applaudi les Trois chansons de Claude Debussy (Dieu ! qu'il la fait bon regarder ; Quand j'ai oüy le tabourin sonner ; Yver, vous n'estes qu'un vilain), écrites avec un art subtil et dans une connaissance approfondie des ressources vocales si variées que présentent ces moyens... Moyens très simples en apparence ; en réalité, capables de beaucoup de raffinement et d'imprévu. On s'en rend compte également chez M. Ravel. Imprévu et raffinement sont portés à l'extrême dans ses trois chœurs a capella (82), Nicolette ; Trois beaux oiseaux du paradis ; N'allez pas au bois d'Ormonde. A relire ces pièces (inspirées de l'ancien folklore et malgré cela, si nettement du Ravel), on en mesure l'habileté précise et l'extrême ingéniosité vocale. Ces qualités sont celles dont aussi A. Caplet témoigna dans ses Inscriptions champêtres (poésie de Rémy de Gourmont), chœur de voix de femmes, avec soli. Les sonorités claires ou sombres, les alternances de lumière et d'ombre, les impressions d'espace et de lointain y sont réalisées par une écriture qui est presque celle de l'orchestre, tout en restant dans les moyens pratiques de la voix.
(82) Dont il écrivit lui-même les paroles, non sans un réel talent.
Le Paysage de M. Le Flem, chœur sans paroles, aux étranges intonations chromatiques, élargit le domaine de cet art à des modulations subtiles, ainsi que le faisaient déjà M. Ravel et A. Caplet. —L'Hiver, de M. Paul Locard, rappelle agréablement les maîtres de la Renaissance ; et nous retrouvons le souvenir de ces maîtres dans les Quatre ballades françaises de M. Paul Fort, mises en musique de façon charmante par M. Raymond Bonheur. Citons encore le Renouveau (poème de Ch. d'Orléans), qui précède la série de nos Rondels de Th. de Banville ; Deux chansons de M. R. de Castéra ; la Chanson à boire, de M. Francis Poulenc, écrite pour les étudiants d'une Université de « l'Amérique sèche » (!), trois Chansons à quatre voix (pour soli), œuvre très récente de M. Darius Milhaud et les Quatuors vocaux de Mme J. Herscher-Clément. Des canons, en grand nombre, furent composés par M. Paul Dupin : les uns en souvenir de son voyage en Egypte (les Grandes orgues du Nil, notamment, impression très frappante, avec son chromatisme mystérieux et majestueux) ; d'autres plus familiers, d'un style assez libre en ce qui concerne les rencontres de notes entre les parties vocales ; mais à l'audition, ces rencontres n'ont rien de désagréable. — Egalement, M. Gedalge vient de terminer toute une série de canons, que chantent les enfants de l'Ecole primaire de Chessy, initiés à la musique par son habile méthode et par son admirable dévouement.
On peut également concevoir que la traduction musicale d'une poésie se trouve confiée à deux, trois ou quatre voix, successives ou simultanées. En général, le sens même des paroles suggère ces sortes d'arrangements au musicien. C'est ainsi que dans les Clairs de lune (de M. Ch. Kœchlin, sur un poème de Leconte de Lisle) à des alternances de lumière et d'ombre, de vie et de mort, correspondent deux voix de timbres différents : ténor, et contralto. La Tarentelle de Fauré exigeait, pour la continuité de son rythme rebondissant, deux voix qui se répondissent en d'agiles et rapides vocalises. C'est une œuvre de jeunesse, qui n'a presque point de rapport avec l'Horizon chimérique ! Mais vive, spirituelle et charmante...
Les six duos de Franck (l'Ange gardien ; Aux petits enfants ; la Vierge à la crèche ; la Chanson du Vannier ; les Danses de Lormont ; Soleil) pouvaient aussi bien être pensés pour une seule voix (à part les Danses de Lormont). Ils sont d'ailleurs tout emplis de ce mysticisme ingénu du « père Franck », qui n'est pas à la mode d'aujourd'hui, et que d'aucuns affectent de railler. Tant pis pour la mode, et tant pis pour la raillerie : on souhaiterait à ces froids critiques d'avoir écrit la Vierge à la crèche, ou la Chanson du Vannier. — Larmes, la poésie d'Albert Samain mise en musique par M. Dutacq, fut conçue par Fauré sous la forme d'un duo, dont l'inspiration n'est certes pas inférieure à celle des mélodies du second recueil qui lui sont, croyons-nous, contemporaines. On connaît mal cette belle œuvre ; elle n'est presque jamais chantée : il ne faudrait point qu'on l'oubliât.
En revanche, le célèbre Madrigal (« Inhumaines qui sans merci... » poésie d'Armand Silvestre) jouit d'une réputation très méritée. Voici longtemps déjà que G. Fauré l'écrivit ; il n'a pas vieilli d'une note. On le chante parfois en chœur ; mais, selon toute apparence, quatre soli sont préférables ; c'est pourquoi nous le rangeons ici parmi les quatuors vocaux avec accompagnement. En ce genre de musique trop peu cultivé par nos musiciens modernes, on évoquera naturellement les suites de chansons de Johannes Brahms, d'allure viennoise et populaire, d'ailleurs fort caractéristiques. Mais le Madrigal de Fauré, en regard, semble d'une délicatesse, d'une limpidité, d'un charme pur essentiellement aristocrates, au meilleur sens du mot. — Plus proches des quatuors de Brahms se montrent ceux de M. Florent Schmitt.
Mais, en réalité, toute œuvre chorale qui n'appartient à l'oratorio, ni au drame, ni à la symphonie véritable, fait logiquement partie de notre étude. étant — à la manière des « mélodies » pour chant et piano — l'interprétation lyrique d'une poésie. Il nous est d'autant plus nécessaire de ne point omettre ce genre de musique, que les concerts l'encouragent de moins en moins. Surtout à Paris, on sait l'extrême difficulté de s'y faire jouer en pareille occasion, car les grandes sociétés de Concerts ne consentent à payer des choristes que pour des œuvres consacrées (Béatitudes, Damnation de Faust, Neuvième symphonie de Beethoven).
Avec ou sans orchestre, nos compositeurs modernes ont écrit de nombreux chœurs pour voix de femmes. Beaucoup ne sont que d'agréables petits morceaux. destinés aux cours d'ensemble des professeurs de chant ; et l'on n'attend point que nous en citions une liste complète. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, du très beau Chant funèbre d'Ernest Chausson, on a le devoir d'en rappeler l'existence. Vraiment, le répertoire des grands concerts est par trop limité. Je sais bien que d'impérieuses raisons d'économie dictent les programmes : les musiciens d'orchestre peuvent les invoquer, car leurs profits ne sont que très modestes. On souhaiterait que ces Associations fussent mieux soutenues, soit par les pouvoirs publics, soit — comme en Amérique — par de généreux Mécènes. En attendant, peut-être ne leur en coûterait-il pas beaucoup, lorsqu'ils nous donnent les Béatitudes ou la Neuvième symphonie, d'y adjoindre certains chœurs modernes qui sont vraiment de premier ordre, — comme par exemple ce Chant funèbre où la mélancolie naturelle d'Ernest Chausson se donne librement carrière. Une telle œuvre, malgré sa durée assez restreinte, nous présente de ce noble musicien une image plus vraie et plus belle à la fois que sa Symphonie, beaucoup moins personnelle, et — à notre humble avis — infiniment moins intéressante.

fac-simile d'un autographe de Paul Ladmirault
On chante parfois, dans les cours d'ensemble,
la Mer, de M. Vincent d'Indy : malgré ses qualités de couleur et de
sentiment, il ne serait peut-être pas aussi urgent de la donner aux Concerts ;
mais les délicieux, les admirables chœurs du Caligula de Fauré, pourquoi
ne figurent-ils jamais aux programmes du Châtelet ou de la salle Gaveau ? Déjà
le troisième nocturne (Sirènes) de Claude Debussy ne reçoit que bien
rarement les honneurs d'une exécution orchestrale, quoiqu'un petit nombre de
choristes suffise. (Rappelons aussi, pour mémoire, que la Damoiselle élue
est accompagnée par un ensemble de voix de femmes). — On sait que Saint-Saëns
écrivit une nouvelle version de ses Mélodies persanes : elle constitue
ainsi une suite symphonique avec chœurs, sous ce titre : Nuit persane. —
La Nuit, du même compositeur, ne paraît sur l'affiche qu'à de très longs
intervalles. — Et que dirons-nous de l'Ode à la musique, d'Emmanuel
Chabrier ? Elle n'est guère jouée que dans les concerts « à côté », lorsqu'un
chef d'orchestre ayant pu rassembler les fonds nécessaires, décide de nous la
faire entendre. Pourtant c'est un des plus authentiques chefs-d'œuvre de
l'incomparable musicien... On voit que tout n'est pas pour le mieux dans le
Royaume de la « Déesse adorable » !
Si l'on veut entendre des chœurs pour voix de femmes, il ne faut compter (sauf
exception) que sur les matinées des professeurs de chant. L'intérêt,
direz-vous, en est inégal ? Pourtant, vous seriez bien injuste d'en médire, car,
et d'abord, les choristes y sont parfois excellentes, voire meilleures que bien
des professionnelles ; ensuite, elles se trouvent interpréter, à l'occasion, de
très belles œuvres, — comme ce Chant funèbre de Chausson, Caligula
de G. Fauré, l'Ode à la musique, etc. Nos souvenirs personnels d'avoir
entendu ou conduit nombre de chœurs modernes en telle de ces séances, nous
mènent à citer ici : Pastourelle, et Chanson, de M. Henri Rabaud,
(on regrette qu'il n'ait pas écrit d'autres pièces du même genre, celles-ci sont
charmantes) ; A la fontaine de Bandusie (sur le texte d'Horace), de M.
Reynaldo Hahn ; A la rivière, de M. Büsser ; Conte de fées, de
Ch.-M. Michel ; le Ruisseau, de Fauré ; l'Anneau de Sakountala, de
M. P. de Bréville ; les Petits Elfes, de M. G. Pierre ; Visions
antiques, A l'aube, la Grande ourse, de M. F. Berthet.
Joignons-y, de l'auteur de ces lignes : la Vérandah (double chœur pour
voix de femmes), la Lampe du ciel, et Trois poèmes extraits du
Livre de la Jungle, de R. Kipling (sur la traduction de M. Louis Fabulet et
de R. d'Humières). — Enfin, comme œuvre plus récente (a capella,
d'ailleurs), les très habiles Inscriptions champêtres, de Caplet, dont
nous avons parlé plus haut.
Les Chœurs mixtes isolés sont en moins grand nombre ; en général, l'utilisation de ces chœurs conduit les musiciens à développer symphoniquement. Nous ne parlerons point d'œuvres telles que le Déluge, ou la Lyre et la Harpe, de Saint-Saëns, qui sont véritablement d'un autre domaine que celui du simple poème lyrique. Mais l'Hymne Védique, de Chausson (sur la poésie de Leconte de Lisle) est à la fois de la musique religieuse, symphonique, et lyriquement traductrice d'un texte littéraire. Encore une belle œuvre : on regrette de l'entendre si rarement. La vieille prière bouddhique, de Lili Boulanger, est du même genre mystique et descriptif tout ensemble. — Il existe plusieurs chœurs de Bourgault-Ducoudray ; le plus connu est celui qui, dans un puissant élan d'enthousiasme, salue les Gaulois : « Nos pères ». On déplore d'avoir à constater qu'encore aujourd'hui, certaines des œuvres chorales de ce remarquable musicien sont restées inédites ! — De G. Fauré, l'exquise Pavane (que l'on peut entendre, heureusement dans Masques et Bergamasques à l'Opéra-Comique), — et les Djinns, œuvre de jeunesse qu'il faut lire par curiosité, pour se bien rendre compte de l'ampleur de toute l'évolution fauréenne, depuis ces temps lointains jusqu'à celui de la Pavane. Car il n'existe peut-être pas au monde, deux choses plus différentes ! Il est vrai que les Djinns sont inspirés de Victor Hugo, et les œuvres de ce poète ne permirent jamais à Fauré d'être soi-même. Citons aussi notre arrangement pour chœur mixte, du Midi de Leconte de Lisle ; cette « mélodie », d'abord écrite pour ténor ou soprano solo, exige à l'orchestre un vaste déploiement de sonorités que seule la puissance d'un ensemble choral pouvait équilibrer. On nous signale également un Hymne pour chœur mixte, Als catalans (aux Catalans) de M. J. Canteloube, et le Cantique de Pâques (chœur et soli) de M. Honegger. Mais, somme toute, des œuvres de ce genre sont assez rarement tentées par les musiciens contemporains. Soit que leur inspiration reste plus intime (les Debussystes) ou plus familières (les Six), soit encore qu'ils se rendent compte, jusqu'à l'évidence, que jamais les grands concerts ne monteront des compositions de cette espèce, ils n'en écrivent point : ou bien alors, les chœurs s'enchâssent dans de vastes ensembles (ex. le final des Evocations, de M. Roussel). Tout cela est fort dommage ; mais le remède est difficile à trouver, tant que le public se détournera des œuvres nouvelles, ne persistant à inonder les portiques du Châtelet que pour celles de Wagner, de Beethoven... et de Rimski-Korsakov (83).
(83) Il s'agit de la triomphante, sempiternelle et d'ailleurs interminable Shéhérazade, que successivement nous donnent toutes les Associations de concerts.
Les Jeunes.
Comme par le passé, les nouvelles générations de musiciens consacrent l'accessoire ou le meilleur de leurs efforts, à des mélodies de valeur diverse. Les unes sont de simples cartes de visite déposées au palais de la Musique par des mondains, élégants dilettantes, — au fond paresseux et indifférents : toujours les mêmes esprits légers à qui Fauré ne semblait qu'un musicien charmant — voire un peu superficiel, parce qu'eux-mêmes l'étaient. Il y a les amateurs riches, snobs, qui firent du post-Debussy. qui font du pseudo-Ravel, qui feront du simili-Honegger, ou de la polytonie à l'instar de M. Darius Milhaud. Il y a les sincères maladroits, enthousiastes et primaires, chez qui les mêmes admirations se révèlent en des mélodies naïvement inspirées de leurs modèles, dont ils restent fort loin. Il y a les corrects et plus ou moins habiles élèves, qui n'écrivent que suivant la formule : experts à doser juste ce qu'il faut de dissonances et de modernité aux concours de composition : écrivant à la manière de Fauré ou de Claude Debussy, mais point encore à celle de M. Honegger ni de M. Albert Roussel... Les paroles leur sont d'ordre secondaire ; parfois certains élèves ne redoutent pas des poésies qu'on aurait cru définitivement traduites par Debussy ou par Fauré : peut-être ignorent-ils ces traductions ; et ne vit-on pas, il y a quelque vingt ans, certain disciple de Fauré écrire « lui aussi » une mélodie sur le Soir de Samain ? Toutes ces œuvres sont d'un intérêt discutable : il n'y a pas lieu d'insister. — Et d'autre part l'on dira ce qu'on voudra sur l'esthétique (84) de certains nouveaux venus qui déjà firent beaucoup parler d'eux ; on objectera bien des choses, dont certaines sont justes. Cependant, on ne pourra nier que leur musique, en général, est vivante, et que dans le seul domaine de la mélodie, plusieurs méritent d'être étudiés. Ce sont les textes par eux choisis, qui montreront le mieux les tendances actuelles de cette partie de l'Ecole française. Sans doute il ne faut pas s'illusionner, ni s'inquiéter outre mesure. Que des jeunes tournent le dos à Samain, voire à Verlaine, à Leconte de Lisle, ce sont des sautes de la mode assez regrettables, mais fréquentes, surtout chez qui s'enthousiasme, avec un grain de snobisme et pas mal de conviction, pour tel poète contemporain. Mais ils ne représentent pas l'entière jeunesse musicale et peut-être, un avenir prochain se tournera-t-il vers des pensées tout autres. Néanmoins, leur tendance ne doit pas être négligée. Indépendamment du vocabulaire musical nouveau (lequel s'appliquerait aussi bien à l'expression de Verlaine qu'à celle de M. Jean Cocteau), il faut tenir compte de ce qu'ils préfèrent, et tenter d'expliquer leur état d'esprit.
(84) Leurs natures sont diverses ont-ils néanmoins des tendances et même des principes communs ? La question est fort discutée ; grammatici certant... Ce n'est pas ici le lieu de l'étudier in-extenso.

fac-simile d'un autographe de Paul Dupin
Le cataclysme de 1914 apporta dans la société, tout ensemble de la violence, de l'égoïsme, une impitoyable sécheresse, la crainte de la douleur physique et morale, — et l'amour du mouvement matériel : besoin de s'étourdir, de faire table rase (provisoirement, du moins) des douces rêveries ou des utopies généreuses. — C'est là une ambiance dont l'effet s'aperçoit même sur des musiciens dont la nature intime n'est pas en harmonie avec ce manque de sensibilité. Voyez, par exemple, l'évolution de M. Darius Milhaud. La Brebis égarée (qui date de 1912) ne craint pas d'exprimer la plus noire tristesse : c'est la sorte d'ascétisme d'un très jeune homme, celle à quoi l'on se plaît en des temps heureux... Puis, il laisse son cœur s'épancher avec une sorte de ferveur romantique, d'ailleurs pleine de charme et qui parfois atteint une réelle beauté — dans une fraîcheur de sentiment tout embaumée des parfums de la campagne provençale, au printemps (85). Les quatre poèmes de M. Claudel (1915‑1917), plus sombres et plus farouches, d'une âpreté chrétienne et quasiment biblique, s'apparentent à la Brebis égarée. Mais bientôt, on dirait qu'il en a marre « de rester ainsi dans le noir » ; il lui faut « tuer le cafard », il a besoin d'une expression plus en dehors, plus vivante... Cesser de penser au néant, quitte à célébrer les joies populaires des foires et des bals publics ! Ce sont alors les Trois poèmes de M. J. Cocteau — cirque, boulevard extérieur, foire de Bordeaux ; — les Chansons bas de Mallarmé, concises et nettement frappées (les paroles d'ailleurs restent parfois difficiles à comprendre) ; les Soirées de Pétrograd. Mais il est dit que cette nouvelle génération a résolu de prendre les choses comme elles sont, avec la sorte d'exultation populaire que favorise M. Jean Cocteau (dont l'influence sur le groupe des Six est considérable).
(85) Cf. Quatre poèmes de Léo Latil (1914), et particulièrement le Rossignol. Précédemment, M. Milhaud avait mis en musique sept proses de M. Claudel, extraites de la Connaissance de l'Est : d'ailleurs moins « au point » ; œuvre de jeunesse où se voit une grande facilité musicale mais dont l'expression ne nous semble pas valoir celle des Poèmes de Léo Latil.

fac-simile d'un autographe d'André Gedalge
D'une façon générale, nous assistons à une réhabilitation de l'art familier, fût-il même un peu vulgaire. On semble n'avoir pas la force de s'abandonner à la nostalgie, ni de prendre en pitié la douleur humaine ; car, songez-y : la violence même de certains à-coups, celle des rythmes brutaux et des percussions explosives n'est à tout prendre, parfois, que le contraire de la vraie force. Et il y a bien quelque faiblesse à cet art qui se divertit, ainsi que des enfants battant l'eau dans les petites vagues de la grève : faiblesse de n'oser point s'en aller au large, nager en eau profonde, vers les grandes lames de l'Océan. — Mais en revanche, la sincérité est louable, de ne point chercher le sublime quand même, si l'on n'y est porté naturellement ; et la crainte du pessimisme est parfois salutaire ; elle aide à reprendre goût aux choses de la vie. On s'explique ainsi que ces jeunes (provisoirement, du moins) semblent fuir l'Ecclésiaste, parce qu'au fond, peut-être, ils en sont trop imprégnés, et que la véritable joie sereine — celle d'un Gabriel Fauré — n'habite point dans leur musique. D'ailleurs rien n'est fixe dans l'art : surtout dans l'art moderne ; et ce que nous pouvons signaler ici n'est peut-être, déjà, que du passé. Car nous vivons en un temps de rapides transformations des langages et des sentiments musicaux (86).
(86) Il est d'ailleurs impossible de définir en quelques lignes la nature multiple de M. Darius Milhaud. On ne doit point passer sous silence une des meilleures œuvres, l'Enfant prodigue (d'après le texte même de M. André Gide). Là, vous trouverez le langage de la douleur, de la pitié, de l'angoisse : absolu contraste avec le Bœuf sur le toit. L'Enfant prodigue est, en somme, du « théâtre de concert », car les scènes de M. A. Gide sont presque toutes des dialogues, et l'on ne trouverait pas impossible de les représenter avec décors et costumes ; mais le musicien préférera la liberté d'imagination, et l'expression plus concentrée que donnent des personnages non visibles. L'Enfant prodigue fut écrit au Brésil, en 1917-18. Les œuvres vocales les plus récentes de M. Milhaud sont des Quatuors vocaux (que nous avons signalés plus haut) et une Symphonie pour hautbois, violoncelle et quatuor vocal. On l'y voit revenir à ces « impressions pastorales » qui lui sont particulièrement heureuses, et c'est une « joie nouvelle » qu'il semble exprimer.
Comme M. Darius Milhaud, M. G. Auric reste fidèle à M. Chalupt, à M. J. Cocteau, à M. Radiguet. Il se tourna d'abord vers un humorisme dont l'esprit n'excluait jamais la musique (ex. le Gloxinia, le Pouf, le Tilbury, sur des poésies de M. René Chalupt). La tournure railleuse de M. Auric est chez lui si naturelle qu'on ne sait jamais si, dans le même temps, il ne juge pas une même phrase à la fois charmante et ridicule... Plus fantaisistes, plus directement influencés de M. Erik Satie, les poèmes de M. Jean Cocteau. La dernière expression de ce jeune musicien semble une sorte de retour vers l'enfance, comme d'images d'Epinal peintes à l'aquarelle, avec le raffinement malgré tout, de qui ne se laisse prendre qu'à demi : mélange curieux, paradoxal, d'humour conscient et d'instinctive candeur. C'est l'Alphabet de M. Radiguet.
Dans ce même ordre d'idées, peinture horticole ou champêtre qui ne s'efforce pas d'analyser l'âme humaine, le Catalogue de fleurs, de M. Darius Milhaud, où seul l'éclat des roses vifs et des bleus foncés semble intéresser le musicien (en passant, un retour vers l'humorisme avec la conclusion insinuante : « les prix vous seront envoyés par correspondance ».)

fac-simile d'un autographe de Charles Kœchlin (propriété de la maison Rouart et Lerolle)
On entendit naguère au Théâtre des Champs-Elysées, les Cocardes de M. Poulenc (87), toujours sur des poésies de M. Jean Cocteau. On ne doit point les prendre à la blague, nous avertit l'auteur, mais comme une objective peinture des tristesses foraines. Nous les devinons issues de Parade, de M. Erik Satie ainsi que les Epigraphes de M. Duret, d'une charmante couleur païenne, furent probablement écrites sous l'influence bienfaisante de Socrate. En réalité M. Erik Satie est le seul compositeur d'âge mûr avec lequel ces jeunes se trouvent en parfaite sympathie musicale. Des étrangers, M. Schoenberg, M. Stravinsky, contribuèrent dans une large mesure à leur « émancipation harmonique ». Partis du Debussysme (et sans Pelléas, la liberté de leur musique ne serait pas celle que l'on voit), élèves de J.-S. Bach, pourrait-on dire, par l'intermédiaire de M. A. Gedalge ou de M. Ch. Kœchlin, n'ignorant ni M. d'Indy, ni Magnard (lequel eut son influence sur M. Darius Milhaud), ni Albert Roussel, — moins éloignés de M. Ravel, peut-être, qu'on ne le dit et qu'ils ne le croient (88), c'est pourtant à M. Erik Satie qu'ils rendent l'hommage le plus direct et le plus convaincu. Cela tient à ce que M. Satie fut sans cesse en avant, comme un franc-tireur jaloux de sa liberté, sorte de chasseur indépendant qui prendrait davantage de plaisir à regarder autour de soi, à flâner en rêvant... Rêverie active d'ailleurs, car de temps à autre son instinct dépistait le gibier de l'avenir, en des taillis où nul ne s'avisait de l'y deviner. Il existe quelques mélodies de M. Satie, — un très petit nombre — mais elles sont bien caractéristiques de son mélange d'humorisme et de poésie pastorale : mélange intime d'ailleurs et qui déconcerte les gens sérieux, ainsi qu'ils le sont également par son regard à la fois acéré et naïf. La Statue de bronze n'est autre que la grenouille du jeu de tonneau. « Une pâture de pistoles la traversent sans lui profiter, et s'en vont sonner dans les cabinets de son piédestal numéroté... Et le soir, les insectes couchent dans sa bouche ». Les dernières mesures sont d'une poésie charmante. Illogique, après l'humour presque opérette des premières pages ? (89) Mais non, si l'on admet de rapprocher ainsi, comme dans la vie réelle, le divertissement prosaïque et la rêverie étoilée (« Chaque chose, disait Socrate, est issue de son contraire »). Daphénéo : blague d'atelier et fraîche pastorale ; une malicieuse petite-fille en écrivit les paroles. Le Chapelier, d'une farce plus grosse et qui d'ailleurs ne rate pas son effet : on ne lui reprocherait que d'utiliser volontairement à contre sens le délicieux duo de Mireille, que trop de philistins ignorent ou méconnaissent (90). Des Quatre petites mélodies, la première est tout à fait sérieuse en son allure désolée (M. Satie l'a dédiée à la mémoire de Claude Debussy) ; les autres restent dans le domaine de l'humour, de cet humour particulier à l'auteur des Embryons desséchés, et qu'il n'est pas aisé de définir en quelques mots.
(87) On a cité plus haut son Bestiaire (d'après G. Apollinaire), œuvre bien connue aujourd'hui. Son dernier recueil est une suite de mélodies sur des poésies de Ronsard, et sans doute ce qu'il écrivit de meilleur en pareille matière.
(88) Surgi de la croupe et du bond est déjà nettement bitonal, par endroits. En retour, M. Ravel n'a-t-il pas subi de récentes influences en sa sonate pour violon et violoncelle ?
(89) Je dis bien : presque, car cette musique — on ne sait comment — trouve le moyen de toujours rester distinguée...
(90) Alors, ils se moquent de Gounod, et triomphent lourdement ; cela était tout à fait contraire à l'intention de M. Satie.

fac-simile d'un autographe de Mme Herscher Clément
D'autres personnalités d'ailleurs s'affirment, avec des tendances tout à fait différentes. En face de nos humoristes européens, se dresse la personnalité mystique et tendre de Sir Rabindranath Tagore, auquel les jeunes musiciens veulent bien accorder aussi leur sympathie. Le célèbre poète hindou fut interprété par M. Darius Milhaud, par M. Louis Courret, par M. Jean Cras, par Madame Jeanne Herscher-Clément, etc. De Madame Herscher-Clément, les Images d'Asie (sur les proses si colorées, si vécues, de Mme la baronne Frachon) nous ramènent très musicalement vers la poésie de l'exotisme : la beauté des soirs et celle des pagodes est éternelle, il ne s'agit pour nous que de savoir encore la traduire et la comprendre. — Dans ses Poèmes arabes (accompagnés par deux flûtes seules) une toute jeune débutante, Mlle Renée Philippart, nous montre déjà mieux que des promesses. Et l'orientalisme, décidément, n'a pas cessé d'être cher à nos musiciens. Nous avons cité plus haut les trois Poèmes lyriques de M. E. Royer ; voici maintenant Farizade au sourire de rose, sept poèmes de Perse (91), de M. Roland-Manuel. Ils offrent cette caractéristique d'être de très courte durée : une page au maximum ; mais pourquoi pas, si la couleur est vive et juste ? Parmi les autres mélodies de M. Roland-Manuel, nous retiendrons particulièrement la suite des trois pièces sur la Délie du poète Maurice Scène, comme l'œuvre vocale la plus achevée, jusqu'à présent, qu'il ait écrite. La sagesse de ne pas craindre telle ou telle influence le mène peu à peu vers sa propre personnalité (92). Voyez la seconde de ces mélodies : on dirait qu'elle continue l'œuvre de Claude Debussy, et sans doute n'est-elle pas inférieure au Faune, des Fêtes galantes... Mais elle ne répète point ce qu'a chanté le maître, et le disciple ici parle par lui-même.
(91) Ecrits en 1914, on notera ceci de particulier, que chaque titre est chanté. Et cela s'arrange très bien ainsi...
(92) Cela semblera paradoxal, peut-être; mais c'est un fait bien connu. Au contraire, si l'on veut fuir une influence, il arrive qu'on y tombe tout droit, comme le bicycliste inhabile sur le caillou qu'il voulait éviter.
Outre ses Poèmes Hindous, M. Maurice Delage avait écrit dès avant 1914, deux mélodies au style extrêmement raffiné, tel qu'on pouvait l'attendre d'un élève de M. Ravel ; pourtant ce n'est pas exactement du Ravel, non plus que du Roland-Manuel.
P. Menu (mort pendant la guerre d'une maladie contractée aux armées), était un musicien admirablement doué, dont on a pu récemment applaudir aux Concerts Colonne la Fantaisie dans l'ambiance espagnole. Il laisse des pièces vocales — inédites — dont ceux qui les connaissent disent le plus grand bien. — M. Georges Migot, dont on sait le goût pour l'art japonais (ex. le Paravent de laque aux Cinq images) a mis en musique de très brefs poèmes : Sept petites images du Japon, encore plus concis que les quatrains de M. Francis Jammes de M. R. Désormière, et les mélodies japonaises de M. H. Merckel. (« Comme la rivière » compte en tout treize mesures). De M. Migot également, trois chants sur des vers de Tristan Derème et quatre mélodies sur des rythmes poétiques de Gustave Kahn.
Mlle Marcelle de Manziarly, jeune musicienne remarquablement douée, ne craint pas l'expression douloureuse en les Six chants dont elle écrivit elle-même les paroles : ce n'est pas nous qui la blâmerons de s'adonner à l'art de caractère subjectif... Madame Marguerite Béclard d'Harcourt, outre ses belles transcriptions de vieux chants péruviens (recueillis sur les lieux, d'après la tradition orale) a composé plusieurs mélodies, dont surtout les dernières — Poèmes chinois — montrent une inspiration charmante, soutenue d'un style très sûr.
Les Heures d'été de M. J. de la Presle, Trois chansons (Ch. Vildrac) et la Verdure dorée (Tristan Derême) de M. J. Ibert, les Poèmes japonais de M. Claude Delvincourt, témoignent que nos jeunes prix de Rome ne réservent pas tous leurs soins au théâtre. On les en félicite. Que par ailleurs M. Delvincourt ait publié une importante sonate de violon, et M. J. Ibert deux pièces pour quatuor d'instruments à vent, ces incursions dans le domaine de la musique pure auront pour avantage d'affermir leur style : et cet avantage se retrouvera lorsqu'ils aborderont des œuvres scéniques.
Qu'adviendra-t-il de ceux qui ne font à peine qu'entrer dans la carrière ? Plusieurs sont actuellement sous l'influence du groupe des Six, ainsi que de M. Jean Cocteau et de M. Radiguet. Elle est évidente chez M. Cliquet-Pleyel, qui d'ailleurs (en 1913-14) fut une sorte de précurseur, aux temps où son inspiration juvénile ne se pouvait traduire que par des allegro, sans jamais s'attarder aux andante. Cette influence s'aperçoit également chez MM. H. Sauguet, Maxime Jacob, R. Désormière. Mais il est trop tôt pour savoir ce que deviendront ces très jeunes musiciens ; l'on peut affirmer seulement que leurs premiers essais contiennent beaucoup de promesses ; et l'on doit retenir leurs noms. L'écriture vocale de M. Sauguet, celle de M. Jacob restent un peu indécises ; jusqu'ici, leurs pièces de piano ou d'orchestre nous semblent mieux venues : sans doute parce que, libérés des littérateurs, ils se sont montrés davantage eux-mêmes. Cette nouvelle génération, sans rien abandonner des « conquêtes polytonales », saura-t-elle se souvenir de la beauté du style consonnant ? Il est permis de l'espérer.
Dans la musique, les plus fortes influences, et les plus durables, ne sont pas nécessairement celles des dynamistes. La progéniture de Gounod est plus abondante et plus belle que celle de Meyerbeer : qui l'eût cru, au temps du triomphe des Huguenots et de l'Africaine ? La Tétralogie, Parsifal même, encore si aimés du public, cessent d'inspirer nos musiciens ; le charme pur de Mozart, celui de Fauré ne feront sans doute qu'accroître leur action. Des signes certains nous annoncent que plusieurs jeunes Français font à nouveau la découverte d'un art de subtilité tranquille, de sérénité supérieure, d'hellénisme (93). On en peut augurer grand bien.
(93) En vue de représentations théâtrales à Monte-Carlo, M. Francis Poulenc écrivit récemment des récitatifs pour la Colombe de Gounod ; M. G. Auric, pour Philémon et Baucis, M. Erik Satie pour le Médecin malgré lui, M. Darius Milhaud pour l'Education manquée de Chabrier. Ces hommages vous sembleront tardifs ? Sans doute, car maint prédécesseur des Six n'a point ignoré Gounod. Mais il faut que les enfants se rendent compte des choses : et les parents savent bien que leur autorité, leur expérience, leur persuasion ne suffisent point. Il en va de même des jeunes artistes à l'égard de leurs aînés. Tout fiers d'avoir « découvert l'Amérique », ils annoncent triomphalement à leurs devanciers : « Mais savez vous bien que Gounod est un grand musicien ? » Eh oui, nous le savions, — et nous l'avions dit. Mais il vaut mieux que les nouveaux venus se soient convaincus par eux-mêmes car c'est la seule conviction durable et profonde.
J'ignore si, à d'autres époques de l'histoire musicale, on a pu constater une aussi grande activité, effervescence pareille à celle d'une ruche populeuse, affairée et prospère. Cela paraîtra d'autant plus remarquable que la musique est moins que jamais un gagne-pain « sérieux », entendez productif et sûr. Pourtant, depuis cinquante années — ou davantage — les musiciens français travaillent sans relâche, sans espoir de succès immédiats, parfois même sans pouvoir escompter que des éditeurs les aideront avant la venue de la problématique célébrité. Mais telle est la confiance de ces artistes, tel leur amour de la musique, que les uns et les autres, ceux qui ont du génie comme les ratés et les impuissants ou les demi-talents, tous persévèrent, aucun ne perd courage.
Le plus triste, c'est que bien des œuvres restent en carton, et le hasard « providentiel » qui les en ferait sortir n'arrivera peut-être jamais. Nous avons dit plus haut toutes les réserves qu'il nous faut faire sur l'insuffisance de notre étude ; elle est forcément incomplète. Mais, telle que vous l'aurez lue, elle vous aura montré cependant l'abondance et la qualité de cette « surproduction » musicale... On souhaite enfin que ces travaux sur l'histoire de notre musique ne restent pas inutiles, et que s'adressant à d'autres qu'à de froids érudits, ils en arrivent à persuader le public (94) que nous sommes, depuis soixante ans environ, à l'une des plus belles périodes de notre art. Période classique, écrirons-nous même sans crainte. Car vraiment, la plupart des mélodies de Fauré et de Claude Debussy (pour ne citer que ces deux maîtres) témoignent des meilleures qualités classiques. En France, comme à l'étranger sans doute, les compositeurs actuels se heurtent à certain dédain de la musique moderne — et particulièrement des « mélodies ». On veut bien accorder que cette musique est parfois « charmante », mais à cause de ce charme on se la figure superficielle : comme si l'austérité désagréable était en l'espèce, une vertu nécessaire ! Et puis l'on a pris une telle accoutumance des vastes sonorités, des longs développements (que ne motive pas toujours la discutable beauté des thèmes ou des harmonies), on a l'habitude si invétérée d'un art qui souligne tout, comme pour des primaires (bien des auditeurs, en effet, le sont !) que certain public croirait au-dessous de lui de s'extasier devant telle mélodie. — Pourtant, une élite s'est formée chez nous, qui sait enfin comprendre la splendeur de cet art. Il y eut récemment à la Société Nationale de musique un éclatant triomphe de la Bonne chanson de G. Fauré. Le sens de cette manifestation n'est pas douteux. Elle montre qu'on sait se trouver là en présence d'une expression haute et profonde.
(94) Le public des Grands concerts en aurait particulièrement besoin. Sait-on qu'à chaque programme contenant une œuvre moderne de quelque importance, les recettes baissent immédiatement ? Le fait est indéniable, et bien connu des chefs d'orchestre... Nous le signalons avec amertume.
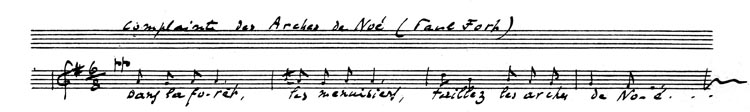
fac-simile d'un autographe de M. Gabriel Pierné
Mais à l'étranger, cette beauté est souvent méconnue, ou même inconnue. Il faut avoir écrit des œuvres de poids, — des symphonies ! Faute de quoi l'on n'est classé que comme un amuseur. Il faut avoir combiné intellectuellement des éléments (disparates peu importe !) suivant la formule de la symphonie dite classique. « La musique moderne, c'est de la sensation » — « C'est du dessert » — du surplus, de l'accessoire, un agrément... inutile. Eh bien, non ! Rien de plus faux. Nous ne cesserons de le dire et de le répéter. Le public, certes, ne s'en rendra compte qu'à l'audition. Mais, s'il est difficile de commenter des œuvres musicales, s'il est même impossible de prouver leur beauté, on peut insister comme ce professeur de mathématiques qui donnait, à son élève princier (d'intelligence un peu paresseuse) « sa parole d'honneur que le théorème était vrai » ; on peut former l'espoir d'entourer d'une atmosphère bienveillante ces œuvres que d'inlassables énergies créèrent, dans le plus complet et le plus admirable dévouement. — C'est à quoi nous voulûmes tendre.
Charles KŒCHLIN.