
Cinquante ans de musique française (1874 - 1925)
LES CHEFS D'ORCHESTRE
Voici, parmi les valeureux chefs d'orchestre de ces cinquante dernières années, ceux de la génération la plus ancienne qui, comme leurs prédécesseurs immédiats, ont réuni tous les signes de l'apostolat et mérité le titre de précurseurs. Ainsi se dessine la physionomie d'un Habeneck mort en 1849, et situé, par conséquent, en dehors du cadre de la présente étude. Son nom ne saurait cependant y être oublié, car Habeneck constitue réellement le point de départ de toute l'activité du concert symphonique en France. A dater de son intervention, plus de ces brusques solutions de continuité qui se produisaient avant lui. En 1725, Philidor avait institué les Concerts spirituels afin de compenser l'absence des représentations théâtrales pendant le Carême. Après soixante-six années d'exercice, ces concerts cessèrent en 1791 pour une période de quatorze ans. De même le concert de la Loge olympique, patronné par Marie-Antoinette (ancien Concert des Amateurs) disparaissait en 1789 après que le comte d'Origny eût vainement tenté de remplacer son fondateur, Gossec.
Un essai de résurrection des Concerts spirituels avait eu lieu en 1805 sous l'égide de l'administration du théâtre italien. Le succès de cette tentative ne se dessina que vers 1818 quand Habeneck fut chargé par l'administration de l'académie royale de musique de diriger, salle Louvois, des auditions symphoniques. A partir de 1821, celles-ci se prolongèrent dans la salle Le Peletier.
Le digne successeur des Philidor, des Caperan, des Berton et des Gossec, François-Antoine Habeneck était né à Mézières le 1er juin 1781. Son père, originaire de Mannheim, engagé dans la musique d'un régiment français, avait été son premier professeur pour le solfège et le violon.
Lorsque parut, le 15 février 1828, l'arrêté du vicomte de La Rochefoucauld autorisant les anciens et nouveaux élèves du Conservatoire à donner six séances publiques annuelles, il appartint au génie d'Habeneck de former l'embryon de l'admirable société dont les destinées devaient être si éclatantes par la suite. La première assemblée générale s'ouvrit le 24 avril 1828. Mais le concert inaugural avait eu lieu dès avant cette date — le 8 mars — dans la salle actuelle de la rue du Conservatoire, construite par l'architecte Delannois en vertu d'un décret du 3 mars 1806. Ainsi s'ouvrait avec Habeneck toute l'ère moderne, celle que nous n'avons pas nous-mêmes encore close. La Symphonie héroïque de Beethoven, le duo de Sémiramis et un air de Rossini, un solo de cor composé et exécuté par Meifred, le Concerto de violon de Rode joué par Sauzay, enfin plusieurs morceaux de Cherubini composaient le programme. Mutatis mutandis, c'est-à-dire en dehors des changements imposés, depuis lors, par trois évolutions successives, et parfois tapageuses, un esprit identique ne plane-t-il pas encore aujourd'hui dans les salles de concerts symphoniques ? La chute innombrable des ans n'a pas détourné jusqu'ici le lit torrentueux des choses, tel qu'il fut jadis creusé par la main puissante d'Habeneck.
En jetant les bases du statut collectif qui régit jusqu'à ce jour les associations instrumentales, le véritable fondateur de la presque centenaire Société des Concerts s'est acquis un autre titre de gloire, et celui-ci ne sera certes pas le moins imprescriptible.
Dans le domaine de la vulgarisation musicale Habeneck se manifesta comme l'un des plus actifs importateurs d'art allemand en France. Par là porte t-il sans doute une part considérable de responsabilité dans l'envahissement dont fut témoin la seconde moitié du « stupide ». Mais, en son temps, l'action d'Habeneck avait été féconde et hardie. L'avenir a prouvé l'excellence de son goût. Mais il lui fallut engager des luttes épiques contre l'opposition tenace du public et même des musiciens d'orchestre. Pour obtenir gain de cause auprès de ceux-ci, le chef dut user souvent de diplomatie. C'est ainsi, par exemple, qu'il substitua l'allegretto de la symphonie en la à l'andante de la symphonie en ré. A peu près vers la même période, Girard, alors chef d'orchestre à l'Odéon Lyrique, s'attira pendant une répétition de la Symphonie pastorale les clameurs furieuses des instrumentistes : pour eux, ce n'était point « de la musique » ! L'audace de certains actes est toute relative à l'époque où ils se manifestent.
Fatigué, malade, Habeneck avait maintes fois, en 1843 et 1844, cédé le commandement à son second, Tilmant. Il se retira le 10 avril 1848, presque vingt ans jour pour jour après le premier concert de la société nouvelle. A l'unanimité, Narcisse Girard passa premier chef et vice-président, la présidence étant dévolue à Auber, directeur du Conservatoire. Girard, né à Mantes le 27 janvier 1797, était élève de Baillot et de Reicha. Chef d'orchestre à l'Opéra-Comique, puis à l'Opéra, il manifestait un autoritarisme qui, un moment, avait failli entraîner les préférences des musiciens vers Battu, le second chef. Il prit possession de son poste le 14 janvier 1849 en conduisant la Neuvième Symphonie de Beethoven. Il le conserva jusqu'en 1860. Le 16 janvier de cette année, pendant une représentation des Huguenots qu'il dirigeait à l'Opéra pour les débuts de Mlle Brunet, il fut pris d'une syncope et expira dans la nuit. Avant de mourir, il avait désigné Deldevez pour sa succession à l'Académie de musique. Mais Dietsch obtint la place. Ce dernier signala son règne de trois ans et demi par de retentissants démêlés avec Gounod et Wagner au sujet de la Reine de Saba et du Tannhäuser. Cependant, l'intérim de la Société des Concerts avait été assuré, de janvier à mai, par Tilmant, second chef, qui fut définitivement élu, le 5 mai, premier chef et vice-président par 98 voix, c'est-à-dire à la presque unanimité des suffrages. Deldevez, jouant de malheur, n'enlevait ici que la seconde place.
Comme Habeneck et Girard, comme plus tard Colonne, Lamoureux et Luigini, Tilmant — brillant élève de Rodolphe Kreutzer — était un violoniste distingué. C'est à ce titre que les Italiens l'absorbèrent d'abord. Il remplaça Girard au double pupitre de la Société des Concerts et de l'Opéra-Comique. Indépendamment de cela, son rôle apparaît très profitable à la musique. Né en 1799, il avait dirigé, dès 1834, les concerts du Gymnase Musical où furent exécutées les œuvres symphoniques de Berlioz. Avec son père, le violoncelliste Alexandre Tilmant, il organisa aussi des séances de musique de chambre qui connurent longtemps le succès. C'était un excellent musicien et l'un des bons chefs d'orchestre de son temps. Son règne à la Société des Concerts ne dura pourtant que quatre années pendant lesquelles il dirigea quarante et une séances. Affecté par un certain dénigrement, il démissionna.
Mouvementée fut l'élection suivante, qui suscita de notoires compétiteurs. Il ne fallut pas moins de cinq tours de scrutin. Au premier, Georges Hainl obtint 45 voix, le malchanceux Deldevez 32, Berlioz 10, Alard 7, Dancla 2, Millot 1. Au dernier tour Hainl et Deldevez restèrent seuls en présence. Hainl fut élu de justesse par 53 voix contre 49 à son concurrent. Il était né à Issoire en 1807. Fils d'un cordonnier quelque peu ménétrier qui lui avait enseigné le rudiment musical, il entra comme violoncelliste à l'orchestre de Lyon devant même que d'obtenir un premier prix dans la classe de Norblin au Conservatoire de Paris. Revenu au Grand Théâtre de Lyon comme chef d'orchestre, il recueillit par la suite — en 1860 — la succession de Dietsch à l'Opéra, dirigea les créations de l'Africaine, de Coppélia et la première représentation de Faust dans ce théâtre — le chef-d'œuvre de Gounod ayant été, ainsi qu'on sait, révélé au Théâtre-Lyrique, le 19 mars 1859. Il prit la baguette au Conservatoire le 10 janvier 1864 pour la conserver jusqu'au 26 mai 1872, date de sa retraite. Son rival Deldevez obtint alors une revanche éclatante par 94 voix sur 104.
Ce choix tardif reçut l'approbation générale. On émit même à ce moment l'opinion que cette désignation eût été plus opportune neuf années auparavant aux lieu et place de celle de Georges Hainl. Celui-ci, plus doué pour le théâtre, se trouvait mieux à son aise au pupitre de l'Opéra qu'à celui du Conservatoire. Deldevez avait, au contraire, reçu de Habeneck la tradition des exécutions symphoniques. Et c'est ainsi qu'à presque un demi-siècle de distance, les cinquante dernières années de musique française, à l'orée desquelles émerge le visage romantique de Deldevez, se trouvent directement commandées, et en quelque sorte conditionnées par le véritable fondateur de la Société des Concerts. Deldevez, l'un des plus marquants parmi tous les successeurs d'Habeneck à cause de son intelligente activité, n'atteignit pourtant jamais à l'ample maîtrise de son illustre modèle ; sa main, notamment, manquait de souplesse et de légèreté. Avec Pasdeloup, il n'en fut pas moins le pivot autour duquel évolua toute une génération de musiciens ; et c'est celle-ci qui devint précisément tutrice des représentants de notre musique contemporaine.
Parisien de Paris, où il naquit le 31 mai 1817, il apprit presque seul à jouer bientôt d'un violon minuscule, cadeau de jour de l'an. Le professeur Sudre le vit manier cet instrument et le prépara pour le Conservatoire où il entra en 1825 — donc âgé de 8 ans — dans la classe de solfège de Larivierre, reprise peu après par Leborne. Protégé du hautboïste Vogt, il devint l'élève de Habeneck pour le violon, de Reicha et Halévy pour le contrepoint, de Berton pour la composition. Il avait réalisé une belle rafle de récompenses officielles lorsqu'en 1838 il échoua définitivement au concours de Rome après cinq tentatives infructueuses : échec d'ailleurs relatif puisqu'il obtenait un second Grand Prix. Deldevez résolut pourtant de porter ce jugement en appel — devant la cour suprême du grand public — et organisa un concert afin de faire entendre sa cantate, Loyse de Montfort. En dépit de cette louable obstination, ses compositions ultérieures, parmi lesquelles plusieurs ballets et quelques ouvrages symphoniques, n'ont guère laissé de traces.
Ses fonctions d'interprète devaient être plus brillantes. A 16 ans, le 1er décembre 1833, il entrait comme second violon à l'Opéra. Ses appointements y étaient de 800 francs par an ; ils ne s'élevèrent à 1.000 francs qu'en 1837 lorsqu'il passa dans les premiers violons pour atteindre enfin à 1.500 francs en 1847 au moment où il devint troisième chef d'orchestre. Dans ces nouvelles fonctions, il trouva peu d'occasions de paraître, car Girard et Battu lui disputaient victorieusement l'honneur de conduire. Il émigra dès lors à l'Opéra-Comique où il partagea l'emploi de premier chef avec Tilmant. Mais il trouva de l'encombrement aussi de ce côté, et accepta de rentrer à l'Opéra comme second chef aux appointements annuels de 4.000 francs. Le destin semblait vouloir condamner Deldevez à l'inaction : mécontent d'être tenu trop à l'écart, il démissionne derechef le 1er juin 1870. Voilà donc déjà un exemple des difficultés que peut éprouver un chef de valeur à s'affirmer dans cette carrière très pauvre en débouchés. Cependant Deldevez était second chef aux Concerts du Conservatoire depuis 1860. Il n'y avait du reste dirigé que deux fois en tout : les 6 et 20 décembre 1863 et, aux Concerts spirituels, le 29 mars 1868. Dans ses lettres sur les chefs d'orchestre compositeurs, Charles Gounod écrivait de lui : « Il a vécu et grandi au contact des grands maîtres, sous la tradition de l'illustre Habeneck. Il a été un témoin ; il est un héritier du patrimoine de science, d'expérience, de transmission des doctrines qui l'ont formé lui-même. »
Une troisième fois, Deldevez revint à l'Opéra, mais en qualité de premier chef, succédant, là aussi, à Georges Hainl. Ce poste, il l'occupa jusqu'en 1877 pour le laisser à Lamoureux, tandis qu'il maintint son hégémonie depuis 1872 jusqu'en 1885 sur la Société des Concerts. Durant ces treize dernières années, il interpréta, entre autres œuvres, Roméo et Juliette de Berlioz, la Salutation angélique de Gounod, des fragments de l'Arlésienne de Bizet, des Scènes dramatiques de Massenet, exécutées précédemment aux Concerts du Châtelet, Ève du même musicien, le finale du deuxième acte de Sigurd, l'ouverture du Roi d'Ys de Lalo, celle de Sapho de Gounod, la Lyre et la Harpe de Saint-Saëns, les Béatitudes de César Franck, l'ouverture de Geneviève, opéra de Schumann, dont la création avait eu lieu en 1850 à Leipzig sous la direction de l'auteur (trois uniques représentations).
Sous son très honorable règne, Planté, Fissot, Delaborde, Saint-Saëns, Diémer, Sarasate, Marsick, Garcin, Ysaye, A. Tolbecque, Jacquart, Taffanel, Guilmant figurèrent parmi les principaux solistes. Dès 1877, Charles Lamoureux devait le remplacer à l'Opéra. Deldevez souffrait depuis longtemps déjà de cruels rhumatismes. Après l'incendie de la rue Le Peletier, il avait dû garder le lit pendant plus de six mois. Mais il avait eu la joie de participer à l'inauguration du Palais Garnier, le 5 janvier 1875. Ce n'est pourtant qu'en 1885 qu'il se retira de la Société des Concerts. Sa vie, qui se prolongea jusqu'en 1897, fut ensuite une longue souffrance.
Dans l'ordre didactique, Deldevez fut, au Conservatoire, professeur de la classe d'orchestre et il a laissé plusieurs ouvrages de littérature musicale dont l'un intitulé la Société des Concerts, est encore souvent consulté.
Son successeur à la Société, Jules Garcin, originaire de Bourges, était âgé de 55 ans lors de son élection le 2 juin 1885. Il avait suivi les cours de Pastou, de Clavel et d'Alard pour le violon, de Bazin pour l'harmonie, d'Adolphe Adam et d'Ambroise Thomas pour la composition. Durant trente années, il fut successivement premier violon, violon solo, troisième chef et premier chef à l'Académie Nationale de musique. Titulaire d'une classe de violon au Conservatoire en 1890, après la retraite de Massart, il assuma durant sept années la direction de la Société des Concerts et fit connaître notamment à ses abonnés la Symphonie en ut mineur et le Déluge de Saint-Saëns, la Messe en si mineur de Bach, la troisième partie du Faust de Schumann, le prélude de Tristan et Iseult, la Rhapsodie norvégienne et la Symphonie espagnole de Lalo, Caligula de Gabriel Fauré, l'épithalame de Gwendoline de Chabrier. Jules Garcin avait, pendant son brillant proconsulat, cédé plusieurs fois la baguette à son second, Jules Danbé. En 1892, il abandonna son poste pour raison de santé, mais conserva toutefois jusqu'au bout sa classe de violon. Il mourut le 10 octobre 1896, peu avant Deldevez, qui s'était retiré depuis douze ans.
Lorsqu'ils disparurent l'un et l'autre, il y avait une dizaine d'années déjà que Jules Pasdeloup s'était éteint à Fontainebleau. Plus loin de nous dans le temps, combien la personnalité de celui-ci est demeurée plus présente à notre imagination ! Il n'est pas exagéré de dire que Pasdeloup a dominé son époque. Il l'a dominée parce qu'il était ce que l'on convient d'appeler un caractère, et que son individualité franchement affirmée tranchait presque violemment sur le fond un peu neutre formé par les hommes d'alors. S'il se fût contenté d'être, comme la plupart de ses collègues, un prince débonnaire, il eût certes évité de multiples et désagréables déboires. Mais il voulut et il sut être, à ses risques et périls, un dictateur exalté, et, à sa manière, un révolutionnaire. Véritable missionnaire de l'art, il surpassa de beaucoup les destinées ordinaires de ses semblables et il laissa une œuvre qui lui survécut et lui survit encore d'une façon inattendue.
Il passa, lui aussi, par la filière officielle. Né à Paris le 15 septembre 1819, il entrait au Conservatoire en 1829, remportait un premier prix de solfège en 1832 et un premier prix de piano en 1834. Ses maîtres avaient été Zimmermann, Bazin et Carafa. Sorti de l'école, il y revint peu après pour y occuper des postes secondaires : répétiteur de solfège le 27 mars 1841, puis de clavier de 1849 à 1850, il obtint enfin la classe d'ensemble vocal en 1855. Jusqu'en 1848, il donna surtout des concerts de piano. A ce moment, des événements particuliers suspendirent le cours de ses travaux : avatar imprévu dans l'existence d'un Pasdeloup, il avait été nommé gouverneur du château de Saint-Cloud. L'année 1851 marque le début de son activité d'organisateur. C'est alors qu'il forme avec des élèves du Conservatoire la Société des jeunes artistes dont les manifestations, assez modestes au demeurant, avaient lieu dans une très petite salle de la rue de La Tour d'Auvergne, puis à la salle Herz. Il y joua les classiques, mais aussi des œuvres nouvelles de Gounod, Saint-Saëns, Lefébure-Wély, etc... Ce modeste groupement lui offrit bientôt les cadres d'un orchestre de plus large envergure. D'autre part, l'empressement du public devint tel qu'il fallut songer à trouver un plus vaste local. C'est alors qu'il osa tenter, au Cirque d'Hiver, des auditions classiques populaires. Les moins confortables places on se les disputait au prix de 75 centimes.
Avant cette tentative, d'ailleurs couronnée de succès, Charles Gounod, abandonnant la direction de l'Orphéon, groupement fondé par Wilhelm et qui réunissait tous les élèves du cours normal de la Ville de Paris, avait laissé la charge des sections de la rive droite à Pasdeloup, tandis que Bazin devait s'occuper de celles de la rive gauche.
La première séance des Concerts Populaires remonte au 27 octobre 1861. La Symphonie Pastorale et le Concerto de Mendelssohn, joué par Alard, composaient le fond du programme. 4.000 auditeurs se pressaient sur les gradins surpeuplés ! Le cachet alloué aux membres de l'orchestre, lui aussi d'une modestie toute démocratique, était de 15 francs pour chaque concert et ses trois répétitions. Celles-ci se déroulaient, souvent dans une atmosphère de tempête, le mardi et le jeudi rue du Conservatoire et le samedi au Cirque d'Hiver. Lancien, second violon à l'Opéra, était violon-solo.
Pasdeloup, malgré sa formation scolaire, nourrissait une admiration fervente pour Berlioz et pour Wagner. Pendant son court passage au Théâtre-Lyrique (1868-69), d'ailleurs assez désastreux au point de vue pécuniaire, n'avait-il pas monté Rienzi ? Au maître allemand, le programmes des Concerts populaires furent toujours très largement ouverts. Les « premières auditions » wagnériennes se suivaient sans répit malgré les protestations et l'effroi des musiciens de l'orchestre. Imitant la défiance de leurs devanciers des phalanges d'Habeneck et de Girard à l'égard des symphonies de Beethoven, les instrumentistes de Pasdeloup trouvaient que « les portées noircies par Wagner étaient terriblement surchargées de signes de toutes sortes ». Des réflexions de ce genre nous ont été rapportées par l'un d'eux, siégeant jadis devant le second pupitre de violon, aujourd'hui compositeur illustre et membre de l'Institut. Quant à l'auditoire, il réagissait violemment. Exécuter un ouvrage de Wagner au milieu du concert était chose généralement impossible. Dominant les vociférations, Pasdeloup, avec un calme olympien, haranguait les perturbateurs et annonçait que le morceau serait exécuté seulement à la fin. Ainsi les mécontents avaient-ils la faculté de ne point subir contre leur gré les furieux « outrages » de la « musique de l'avenir ». On profitait d'ailleurs parfois de l'autorisation avec tant d'unanime empressement que personne, ou presque, ne demeurait dans la salle pour l'audition de ces morceaux intempestifs. De nos jours, nous voyons encore de semblables interventions ; M. Pierné ne s'y dérobe pas à l'occasion. Inutile d'ajouter que le tapage ne s'exerce plus pour les mêmes causes, car les habitués du Châtelet sont aujourd'hui fervents du culte de Bayreuth. Le temps a dès longtemps accompli son œuvre salutaire. Mais l'éducation wagnérienne des mélomanes du Cirque d'Hiver était tout entière à accomplir ; Pasdeloup s'en chargeait crânement. Novateur, il le fut du reste non seulement par la besogne de vulgarisation qu'il entreprit en faveur des créations de la musique allemande, mais aussi par l'éclectisme de ses vues. Les jeunes compositeurs français de l'époque lui doivent une singulière reconnaissance. Bref, il offrit un rare exemple de clairvoyante opiniâtreté. La nature de Pasdeloup, impulsive, généreuse, ne se laissa jamais dompter. Son aspect bourru, ses emportements restent encore légendaires. Les compositeurs eurent souvent « des mots » avec lui. Tous lui vouaient cependant, à quelque titre, de la reconnaissance. Saint-Saëns, Massenet, Guiraud, Bourgault-Ducoudray, Lenepveu voyaient, grâce à lui, leurs productions mises en pleine lumière. Bizet et Lalo lui durent une notable partie de leur notoriété naissante.
Après avoir affirmé toute son existence des sentiments essentiellement altruistes, après avoir mis la musique à la portée de chacun et rallié les masses à l'amour des belles œuvres, Pasdeloup termina ses jours dans une gêne cruelle. Le sort a de ces injustices envers les hommes qui témoignèrent de désintéressement et d'intégrité. Edouard Colonne et le déjà célèbre baryton Faure avaient eu pourtant la pensée d'organiser un festival d'adieux lorsque Pasdeloup prit sa retraite. Cette séance eut lieu le 30 mai 1884 ; le jeune orchestre du Châtelet s'était, pour la circonstance, réuni à son aîné du Cirque d'Hiver. Gounod, Reyer, Léo Delibes, Guiraud, de Joncières, Jules Cohen vinrent en personne diriger leurs œuvres. Alard, Ch. Dancla, Ad. Hermann, Lancien, Marsick, Sivori, accompagnés par seize harpistes, par Guilmant à l'orgue et par l'orchestre sous la direction de Pasdeloup, jouèrent la Méditation de Gounod. La recette s'éleva à quelque 100.000 francs. Elle améliora certes grandement la situation pitoyable du vieux chef sans la rendre heureuse néanmoins. Le vétéran des luttes orchestrales, à qui pesait l'inaction, voulut reprendre ses concerts quelque temps après. Mais les associations concurrentes, fondées selon l'esprit vulgarisateur de celle du Cirque d'Hiver, avaient déjà groupé autour de leur jeune pavillon une bonne partie des dilettanti. Pasdeloup, abandonné de ses meilleurs musiciens et de sa clientèle, sentit péniblement l'amertume de l'oubli. Il s'éteignit le 13 août 1887, à 68 ans, laissant le noble enseignement d'un fructueux effort. Les imitateurs de Pasdeloup se comptèrent en effet par légion. Après Paris, grandes et moyennes villes comme Bordeaux, Toulouse, Nantes, Marseille, Londres, Turin, Bruxelles et autres possédèrent bientôt leurs concerts populaires. Ainsi se trouva propagée la haute musique dont Pasdeloup avait sans doute été le premier véritable champion. Sa valeur personnelle en tant que chef d'orchestre n'eut peut-être pas toutefois un rayonnement inaccoutumé. Nombre de ses musiciens subirent plutôt son réel ascendant comme artiste que comme praticien de l'orchestre ; et, parmi ses fidèles, beaucoup l'estimèrent pour ses qualités annexes : hardiesse, ténacité, goût du risque et largeur de vues. Sous ce rapport, sa personnalité, d'ailleurs infiniment attachante, présentait certaines particularités avec celle de son contemporain Deldevez.
Pasdeloup, vieilli et en quelque sorte démonétisé, pâtit d'une destinée commune. La foule se détourne aisément des plus radieux couchants pour concentrer sa curiosité sur l'espoir des renouveaux. Au firmament musical, deux astres de première grandeur venaient de s'élever soudainement au-dessus de l'horizon : Colonne et Lamoureux.
Avant de résumer la carrière de ces chefs illustres qui ramassaient le flambeau des mains défaillantes de Pasdeloup, il convient de préciser que ce dernier avait lui aussi éclipsé, au temps de sa naissante gloire, quelques soleils de l'ère précédente, la Restauration. Entre la Société des Concerts de Habeneck et les Concerts populaires du Cirque d'Hiver s'intercale une série d'entreprises dont la postérité n'a guère gardé le souvenir, mais qui ont, historiquement du moins, creusé leur visible sillon. Ne mentionnons que pour mémoire l'essai des Concerts Historiques de Fétis, dans la salle du Conservatoire, la salle Ventadour ou la salle Herz. A son tour, Manéra, élève de Habeneck, fonda l'Union Musicale à la salle Sainte-Cécile de la Chaussée d'Antin, appelée le Casino Paganini ; Félicien David et Berlioz y dirigèrent des concerts. Seghers, violoniste élève de Baillot, et l'un des fondateurs de la Société des Concerts, créa la Société Sainte-Cécile où furent révélées les deux premières symphonies désormais à peu près ignorées de Gounod, l'Ode à Sainte-Cécile (1852) et la Première Symphonie en mi bémol de Saint-Saëns. Bien auparavant, M. Masson de Puysneuf avait confié à Philippe Musard (1792-1859), la direction des concerts donnés à l'hôtel Lafitte en hiver et aux Champs-Elysées, en plein air, durant l'été. Vingt ans plus tard, les concerts Besselièvre fonctionnèrent chaque soir dans le square où, après 1871, opéra l'ancien chef de musique militaire Chessonnois. Les concerts Besselièvre et les concerts Musard n'affectaient point un caractère sévère. Le tempérament même du « Roi des quadrilles » s'y fût opposé. Compositeur de musique de danse, celui-ci sut obtenir une vogue singulière. Ses prodigieux succès de Londres, aux bals masqués de l'Opéra-Comique et de l'Opéra, au Jardin turc, lui valurent une auréole très particulière. Il recherchait surtout les effets originaux et comiquement agressifs. Les cancans naguère entendus dans les bals de barrière, où il avait débuté en jouant du cor et du violon, avaient empli ses oreilles de rythmes et de bruits étranges. L'excentricité musicale lui plaisait furieusement. Déchaîner le vacarme, étonner ses clients ébahis par quelque tonitruante trouvaille, assourdir par un effroyable tintamarre, tel était le goût de Musard le père. Ses quadrilles, longtemps célèbres, s'intitulaient par exemple le Tourbillon ou la Foudre. Malgré sa curieuse physionomie, et en dépit même de l'élégance fréquente de son écriture, ce lointain précurseur du jazz-band ne pouvait cependant passer pour véritable représentant de la musique française. Métra non plus (1830‑1889) quoique très doué ! Après avoir obtenu un premier prix d'harmonie au Conservatoire, puis abandonné la classe de composition d'Ambroise Thomas — encore un méfait de l'auteur de Mignon ! — Jules-Louis-Olivier Métra se sentit violemment attiré, lui aussi, par le bal et par le music-hall (Robert Mabille, Château des fleurs, Elysée-Montmartre, Frascati, Folies-Bergère, bals du théâtre de la Monnaie de Bruxelles, et, jusqu'à sa mort, ceux de l'Opéra de Paris). Orban (1825-1889), corniste virtuose et chef d'orchestre à Frascati, suivit à peu près une voie identique.

Olivier Métra (photo Pierre Petit)
Tout différent apparaît dans les brumes du passé, le lillois Valentino (1785-1856). Second chef à l'Opéra en 1820, puis premier avec Habeneck après le départ de Kreutzer, Henri-Justin-Joseph Valentino s'était spontanément retiré de l'Académie de musique lorsque le docteur Véron, nommé directeur, avait prétendu diminuer les traitements du personnel instrumental. Il y a donc cent ans, un chef d'orchestre prenait ouvertement le parti de ses musiciens contre une trop chiche administration. Nous avons revu depuis lors, et dans le même théâtre, certaines interventions d'un chef en faveur de ses subordonnés. Mais il avait, ce dernier, derrière lui la puissance du syndicat et cela se passait seulement après l'armistice de 1918 ! A cet égard, Valentino devrait être déjà rangé parmi les précurseurs et laisser ici, par conséquent, sa trace. Mais tout son mérite n'est pas là. Appelé après ce fâcheux incident à l'Opéra-Comique, il lui appartenait de fonder en 1837, salle Saint-Honoré, baptisée par la suite salle Valentino, les premiers concerts populaires de musique de chambre qui aient existé en France. C'est cette initiative qui caractérise son rôle et classe en bon rang son auteur. Ces concerts étaient organisés sur le modèle de ceux qu'Habeneck avait conçus dix ans auparavant. Mais leur cadre offrait plus d'ampleur. Les séances étaient d'ailleurs préparées avec un grand soin et Joseph Habeneck, frère de l'illustre musicien, en dirigeait les études.
Le principe des auditions ne manquait pas d'ingéniosité. Les lundis, mercredis et vendredis étaient consacrés à la musique classique, les autres jours, sous la direction de Fessy, à la musique légère. Ainsi Valentino établissait-il non seulement un trait d'union entre la Société des Concerts et les futurs concerts Pasdeloup, préparant de la sorte le passage de la première formule à la seconde, plus utilitaire et plus féconde, mais il osait tenter cette entreprise assez téméraire de la quotidienneté musicale, si aléatoire et si complexe qu'elle ne s'est que bien rarement renouvelée, et que, de nos jours, on n'en trouverait qu'un unique exemple : celui des courageux Concerts Touche. Et encore ceux-ci viennent-ils de succomber à leur tour.
L'essai de Valentino était d'ailleurs prématuré. Il advint que le genre frivole l'emporta bientôt tout à fait sur la musique sérieuse. Après Valentino, Fessy se proposa d'attirer le public récalcitrant avec une symphonie de Félicien David. Peine perdue ! La salle, cessant par degrés d'appartenir à l'art noble, reçut alors, selon le goût du temps, une affectation plus futile encore ; la danse en chassa pour toujours la musique. Notre époque n'a-t-elle pas connu semblable épidémie, mais sans doute plus maligne à cause du caractère étrange d'un microbe virulent, exotique et barbare ? Entraînée vers les bas-fonds par sa sœur Terpsichore, Euterpe s'était encanaillée.
Valentino, désespéré, cessa la lutte en 1841, c'est-à-dire juste dix ans avant la première création de Pasdeloup : celle de la Société des jeunes artistes du Conservatoire (1851) et vingt ans avant la fondation des Concerts populaires de musique classique (1861). Dix ans encore plus tard environ, Colonne et Lamoureux allaient sonner la charge. Le Concert National et l'Harmonie sacrée datent, en effet, l'un et l'autre de 1873. Pendant un demi-siècle, à partir du vieil Habeneck, les bornes de la route nationale de la musique furent donc disposées par espaces décennaux. Sur un rythme symétrique s'était préparé lentement, mais sûrement, l'avènement glorieux des cinquante dernières années. Réguliers et de même métal, tels apparaissent en définitive les divers anneaux de la chaîne dont le fondateur de la Société des Concerts avait jadis si solidement forgé l'amorce.
Le combat salutaire, Pasdeloup l'avait livré dangereusement tout seul, en franc-tireur, et sans autres armes que les siennes propres. Colonne, lui, bénéficia d'abord d'un puissant et généreux appui. Afin de divulguer les œuvres orchestrales des jeunes compositeurs, l'éditeur Georges Hartmann avec Duquesnel venaient de grouper fort opportunément des instrumentistes de choix. Ayant créé le Concert National dans ce louable but, Hartmann n'aurait pourtant enregistré qu'un piteux échec, et son nom serait dès maintenant plus effacé, s'il n'avait eu l'inspiration divinatoire de s'adjoindre le bouillant, mais encore assez obscur Colonne. La séance inaugurale s'ouvrit au théâtre de l'Odéon, le 2 mars 1873. Cinq autres la suivirent. Le siège fut transféré le 9 novembre au Châtelet. Au cours de ce cycle, Marie-Magdeleine de Massenet et Rédemption de César Franck bénéficièrent d'une première audition. Mais le prix des places était des plus modiques et, partant, la recette assez maigre. Malgré une subvention de 6.000 francs de Mme Erard, il fallut renoncer à poursuivre une trop onéreuse expérience. C'est alors que Colonne, profitant des conjonctures avec une singulière habileté, parvint à transformer, d'un coup de baguette magique, l'utopique statut du Concert National et à jeter les bases d'une union collective. L'Association artistique vit ainsi le jour en 1874, sous la présidence d'honneur d'Ambroise Thomas. Sa première manifestation publique se déroula le 6 novembre dans la salle du Châtelet où elle a vaillamment fêté, l'an dernier, son heureux cinquantenaire.
A cet instant décisif de son existence, Colonne avait trente-six ans, puisque né à Bordeaux le 23 juillet 1838. Son père et son grand-père, d'origine italienne, étaient eux-mêmes musiciens. Il grandit donc dans un milieu favorable à l'épanouissement de sa précocité et de ses dons. Dès l'âge de huit ans, il avait commencé de se préparer à ses futures destinées en jouant du flageolet et de l'accordéon. Ses premières leçons de violon, il les prit avec Baudoin. En 1855, c'est-à-dire à dix-sept ans, il quitta sa ville natale pour entrer au Conservatoire de Paris où il réunit un estimable et patient palmarès : Harmonie, premier accessit en 1857, premier prix en 1858 ; violon, deuxième accessit en 1857, premier en 1860, deuxième prix en 1862, premier en 1863. Il avait été dans la classe de Girard, puis de Sauzay pour le violon, d'Elwart pour l'harmonie, d'Ambroise Thomas pour la fugue. De 1863 à 1867, lui échut le poste de premier violon à l'Opéra et chez Pasdeloup. Il appartint au quatuor Lamoureux en qualité de second violon et dirigea en 1871 les concerts du Grand-Hôtel. Pour les représentations des Erynnies de Leconte de Lisle, Colonne eut la chance de révéler l'importante musique de scène due à Massenet. C'est vers cette époque qu'Hartmann remarqua ses capacités.
En marge de l'Association artistique des concerts du Châtelet, couramment désignée par la suite sous le titre de Concerts Colonne, de nombreuses besognes absorbèrent son activité. Pendant plusieurs années il dirige les concerts d'orgue de Guilmant au Trocadéro ; il reçoit la mission d'organiser, également dans la salle du Trocadéro, les concerts officiels de l'Exposition de 1878. Le 1er janvier 1892, Bertrand, prenant possession du fauteuil directorial de l'Opéra, le choisit comme collaborateur pour la surveillance des études musicales et la conduite de l'orchestre. En juillet 1893, Taffanel succède à Colonne qui a monté, pendant son séjour à l'Académie nationale de musique, Salammbô, Samson et Dalila, la Walkyrie. Vers la même époque, Colonne passa plusieurs saisons au théâtre du Cercle à Aix-les-Bains.
En 1897, il organisa au Nouveau-Théâtre des séances afin de donner chaque jeudi en matinée,
des symphonies, quatuors, quintettes, concertos, cantates des maîtres anciens et modernes. Pour expliquer cette addition aux séances dominicales, M. Charles Malherbe annaliste de l'Association artistique, formulait l'opinion suivante : « La plus célèbre société instrumentale
de l'Allemagne, le Gewandhaus ne craint pas de produire, à côté d'une symphonie de Beethoven, un Lied de Schubert ou de Mendelssohn, une mélodie de Schumann ou de Brahms, avec l'accompagnement d'un simple piano. Cette indication était bonne à recueillir, car nos juges les plus sévères ne pourront s'indigner de voir quelquefois appliquer à Paris le principe qui se pratique couramment à Leipzig ».
Nous ne concevons pas très bien, sous une plume pareillement autorisée et probablement inspirée, la nécessité de ce rapprochement entre la France et l'Allemagne. Et ces lignes, elles-mêmes « bonnes à recueillir », nous ne les évoquons que pour montrer combien, jusqu'à la fin du siècle dernier, l'exemple d'ailleurs alléchant de la musique allemande hantait les cerveaux français. Dans ces circonstances, comme dans les précédentes, Colonne eut l'incontestable mérite d'agir avec éclectisme et clairvoyance. En 1894 déjà, soit vingt années seulement après la fondation de l'Association, on évaluait à 957 le nombre des œuvres entendues au Châtelet. Dans ce total, si la musique allemande est fortement représentée, les compositeurs nationaux figurent aussi dans une proportion très honorable. Colonne a d'abord donné intégralement les grands ouvrages de Berlioz. Saint-Saëns, Massenet, Benjamin Godard, Théodore Dubois, Widor, entre autres, lui sont redevables d'une partie de leur célébrité. Il joue Lalo et commence de révéler certaines pages de Gabriel Fauré. Les silhouettes de tout jeunes compositeurs d'alors, Gustave Charpentier, Gabriel Pierné, Xavier Leroux, se profilent à l'horizon des concerts du dimanche.
Malgré ses tendances en somme plutôt audacieuses, l'Association artistique prospérait d'année en année. Mais les débuts avaient été rudes. Le première mise de fonds ne s'était pas, disait-on, élevée à plus de 225 francs (?). Les charges pesaient gravement sur les bilans. Cependant l'orchestre « associé » allait bientôt compter 107 membres ; et, avec les chœurs, les exécutants comprirent souvent jusqu'à 250 unités. Vers 1907, alors que sa vitalité commençait à décliner, Colonne, blanchi sous le harnois, avait appelé spontanément auprès de lui un musicien émérite, M. Gabriel Pierné, qui devait ensuite prendre sa succession.
En diverses circonstances, Colonne éprouva les bienfaits de la sollicitude empressée des éditeurs. L'un, Hartmann, lui avait permis de se mettre solidement en selle. Un autre décida de son expédition en Russie. C'est en effet Mackar qui l'unit à Tchaïkovski afin d'établir, à travers toute l'étendue du continent, un courant musical entre la Seine et la Néva — on dirait aujourd'hui des « échanges artistiques ». Au début de 1891, pendant que Tchaïkovski exposait plusieurs de ses œuvres au Châtelet, Colonne dirigeait à Saint-Pétersbourg trois festivals de musique française avec le concours vocal de Gabrielle Krauss et de Bouhy. Au mois de novembre suivant, il retourna dans la capitale russe, accompagné cette fois de Berthe Auguez de Montalant. Ces voyages au pays slave, alors en pleine effervescence musicale, eurent de lointains retentissements. Ils classèrent définitivement Edouard Colonne comme chef d'orchestre européen.
Tels furent les principaux exploits d'une persévérante, riche, droite et sage carrière.

Edouard Colonne (photo Nadar)
Au physique, Colonne était de taille moyenne avec un tantinet d'embonpoint. L'œil incisif, et de fière prestance, il offrait d'ordinaire un aspect ouvert, affable et calme. Par là même, il contrastait avec Charles Lamoureux dont le regard était froid et l'abord plutôt sévère. Ce n'était d'ailleurs pas la seule différence que ces deux lions présentassent entre eux. Hughes Imbert a tracé une savoureuse esquisse de leurs tempéraments artistiques, de leurs manières de sentir et d'exprimer : « Si Lamoureux soigne davantage les nuances et les finesses de l'orchestre, s'il fait répéter plus individuellement les diverses familles d'instruments, s'il arrive aussi à une exécution méticuleuse, très soignée, qui met peut-être en un relief trop prononcé certaines parties de l'œuvre, mais qui amène quelquefois un peu de dureté et de sécheresse, Colonne remplace la fermeté et la précision par le fondu et l'enveloppement que n'obtient pas toujours son émule dans les compositions lyriques. Il prend surtout sa revanche dans l'exécution des meilleures pages d'Hector Berlioz, auxquelles il donne une grande élévation par la fougue shakespearienne et le brio étincelant qu'il inculque à ses artistes. L'orchestre Lamoureux ne prend jamais le mors aux dents ; celui de Colonne s'emballe à fond de train ».
A noter, de la part de Colonne une ingénieuse inspiration : le premier, il donna dans ses programmes des commentaires analytiques sur les morceaux à exécuter. Cette innovation favorisa l'éveil de l'intelligence musicale du public.
Incessamment sur la brèche, chercheur infatigable, tenace dans ses résolutions, ses amitiés et ses admirations, prudent et passionné, mais toujours ardent pour la défense et l'illustration de la Beauté, ainsi apparut en son temps cet artiste qui avait créé autour de lui une atmosphère toute imprégnée de musique. Jusque dans son foyer, la sainte cause n'abandonnait pas ses droits. Nous n'avons pas perdu la mémoire des réceptions familiales qu'il organisait, à l'issue des Concerts du dimanche, dans le cadre à la fois intime et recherché de son appartement de la rue Le Peletier. Entourées de virtuoses et de compositeurs dont beaucoup étaient ou devinrent célèbres, Mme Edouard Colonne et sa fille Mathilde y détaillaient les lieder des maîtres. Même après sa retraite partielle et volontaire, jusqu'en 1909, on rencontrait encore, dans sa soixante-douzième année, l'alerte et beau vieillard du côté des quais de l'Institut, dont il affectionnait particulièrement les parages.
L'Association artistique, conçue et créée par lui, gigantesquement développée grâce à sa finesse et à sa vigilance, à sa douce et ferme obstination, se trouvait au moment de sa mort, survenue le 28 mars 1910, dans une situation morale et matérielle qui ne permettait plus aucune inquiétude. Il y avait marqué sa place d'une si profonde empreinte qu'aujourd'hui encore, parmi cet après-guerre ingrat et oublieux, dans cette autre ère, pourrions-nous dire, la Société artistique s'appelle toujours pour quiconque et tout court « les Concerts Colonne ». Longue vie lui soit accordée et longue durée au souvenir de son fondateur !
Le cas est presque entièrement semblable pour l'association concurrente et du reste pareillement prospère : celle des Concerts Lamoureux. Ayant mentionné plus haut quelques-unes des divergences qui existaient entre les deux musiciens, on peut établir aussi un parallèle entre les deux hommes et leurs caractères. Nous avons connu un Lamoureux court sur jambes, chauve, vif quoique replet : « un boulet de canon sur un obus », selon la pittoresque expression de Caliban. Emile Bergerat, qui s'abritait sous ce pseudonyme, lui consacrait d'autre part les lignes suivantes, à la veille de la mémorable et unique représentation de Lohengrin : « La première fois en ce monde que Charles Lamoureux m'ait apparu, ce fut à un repas de noces chez Gillet, à la Porte-Maillot. Et, tout de suite, je compris que j'allais aimer cet homme-là. Il s'avançait en effet d'un pas de grand-prêtre vers la mariée, tenant de la droite un verre de vin rouge, et dans la gauche un verre de vin blanc. Après un joli discours, il procéda au mélange symbolique. C'était une allégorie, mystique et facétieuse, des joies pures de l'hyménée. Cette cérémonie si auguste dans sa simplicité, et qu'aucun culte ne renierait, était entièrement de son invention. Elle signait son humoriste. Tout le cortège l'imita et il en résulta une allégresse générale. »
Ce côté jovial n'était toutefois que l'une des faces de son visage ; il y en avait une autre, plus redoutée de ses collaborateurs. Lamoureux, au moins en surface, n'était pas exempt d'une certaine sécheresse, d'une sorte de rigidité qui lui prêtaient un air bourru et rendaient parfois son abord plutôt rébarbatif. C'était pourtant le meilleur, le plus obligeant des hommes et le plus dévoué des amis. Sa sensibilité réelle ne trouait que rarement la rudesse de l'écorce. Il put donner en outre par moments l'impression d'être un peu en proie au délire de la persécution. Il avait, dans sa jeunesse, tellement cultivé sainte blague qu'il craignait probablement de devenir à son tour victime de bons ou de mauvais plaisants. Son autorité, Lamoureux la faisait, dans le service, peser avec lourdeur sur les épaules de ses subordonnés ; mais, rendons lui cette justice, il prétendait aussi en cingler le front de ses supérieurs hiérarchiques. Ses emportements l'empêchaient de suivre la voie, largement tracée, qui s'ouvrait devant lui. Démission sur démission, l'irascible Bordelais bifurquait sur des chemins inattendus ; c'est tout juste s'il ne s'est pas enfin, dans un accès de méchante humeur, jeté à la porte de sa propre Maison. Mais sa carrière ne souffrit pas trop de ces algarades parce qu'il portait en lui une foi lumineuse. Celle-ci le guida toujours impérieusement vers les radieux sommets.
On peut soutenir sans paradoxe qu'il fut souvent soutenu dans son ascension par son irritabilité même et par sa subséquente volonté de couvrir une faute ou de réparer un échec. Ce fut le cas pour la création de l'Harmonie sacrée, après sa discorde avec le Comité de la Société des Concerts. Nous reviendrons plus loin, sur les détails de cette aventure.
Un autre puissant levier de sa réussite : sa fortune personnelle provenant de son mariage avec Mlle Pierre, fille d'un inventif docteur en médecine, dont le nom s'est transmis jusqu'à nous sur les flacons d'un dentifrice. Si singulier que cela puisse paraître, Lamoureux donna dans sa vie mainte preuve d'industrieuses facultés. Ainsi, après le décès de son beau-père, sut-il défendre très efficacement les intérêts en jeu. Il déploya une énergie peu commune pour exploiter la découverte de cette eau merveilleuse qui devait asseoir l'aisance familiale. Il apporta la même ténacité à rechercher le succès de ce commerce qu'à poursuivre, sur le terrain artistique, les buts les plus désintéressés. Voilà donc la preuve de l'intelligence multiple et très ouverte de Lamoureux. Et le piquant de l'affaire, c'est que les produits du négoce servirent en fin de compte à étayer la prospérité de la symphonie.
Né à Bordeaux le 28 septembre 1834, Charles Lamoureux s'est éteint, à Paris, aux ultimes jours du XIXe siècle, le 21 décembre 1899. Contemporain de Colonne, dont il était de quatre ans l'aîné, son compagnon d'armes, puis son rival, il s'est constamment signalé par une combativité non moins intense que celle de son concitoyen. Il avait, avant lui, appris le violon au Conservatoire, dans la classe de Girard, d'où il sortit en 1854 avec un premier prix. Tolbecque, Leborne et Chauvet avaient été ses maîtres pour l'harmonie, la fugue et la composition. Tout en travaillant avec ceux-ci, il était entré à l'orchestre du Gymnase. Bientôt après, il pénétrait dans celui de l'Opéra et fondait le quatuor Lamoureux. C'est là qu'il eut Edouard Colonne pour complice, avec Adam et Rignault comme partenaires. Le 22 décembre 1863, la Société des Concerts le reçut dans son sein et elle le titularisa second chef en 1872. L'année suivante, il organisait la Société de l'Harmonie sacrée, point de départ de l'Association des Concerts Lamoureux. Car une brouille avait soudain surgi entre Lamoureux et la Société des Concerts. En voici les motifs : le 27 mars 1873, Lamoureux proposa que « chaque année, en dehors de son local et de ses concerts habituels, la société, dans un but artistique et patriotique (?) donne une ou plusieurs auditions des oratorios de Bach et de Haendel en s'adjoignant le personnel nécessaire à l'exécution de ces chefs-d'œuvre ». Le Comité, à sa réunion du 1er juillet, repoussa par 6 voix contre 2 la motion Lamoureux. Celui-ci, froissé, démissionna. Puis, se piquant au jeu, il poursuivit seul son idée et donna, en effet, des œuvres de Bach, Haendel et Mendelssohn avec un déploiement inusité de forces chorales et orchestrales accompagnées par l'orgue. Cela ne s'était jamais réalisé à Paris. La première séance eut lieu le 19 décembre 1873 dans la salle du Cirque des Champs-Elysées, avec le Messie de Haendel. La musique, dans notre capitale se réfugie volontiers sur la piste des clowns ! Un public enthousiaste accourut en masse, donnant raison à Lamoureux dans son différend avec la Société des Concerts. Les méthodes et le goût allemands étaient, on le voit, toujours présents à l'esprit de nos dirigeants. Par la suite, Lamoureux monta toutefois Gallia, de Gounod, et Ève, de Massenet.
Poursuivant sa course avec célérité, Lamoureux organise en 1875, à Rouen, les concerts du jubilé de Boieldieu, apparaît un instant, en 1876, au pupitre chef de l'Opéra-Comique, qu'il abandonne presque aussitôt avec éclat, fonce sur l'Opéra pour remplacer Deldevez comme premier chef (1877-1879). Il devait n'y revenir que dans les derniers mois de la direction Ritt et Gailhard en 1891. Entre-temps, il avait fondé le Théâtre-Lyrique de l'Eden où Lohengrin eut une seule et houleuse représentation le 3 mai 1887. Cet ouvrage wagnérien devait n'être joué à l'Opéra que le 3 septembre 1891, pendant le second séjour de Lamoureux dans ce théâtre. Charles Lamoureux déploya d'ailleurs un zèle inlassable en faveur du maître de Bayreuth, dont il s'affirma l'un des protagonistes les plus ardents et l'un des défenseurs les plus tenaces. Et cela aussi bien au théâtre du Château-d'Eau, qui abrita, en 1881, la naissance des Nouveaux Concerts — alias Concerts Lamoureux — qu'à l'Eden en 1885 et, en octobre 1887, au Cirque d'Eté. Voué en quelque sorte à l'école germanique, presque exclusivement attaché à la production des Bach, Haendel, Beethoven, Schumann et Mendelssohn, wagnérien impénitent, combatif et tyrannique, Charles Lamoureux sut cependant réserver un accueil assez diligent à quelques-uns des musiciens français de son époque, notamment aux Lalo, Saint-Saëns, Massenet, Vincent d'Indy, dont il exécuta la belle symphonie sur un thème montagnard, le 20 mars 1887.
Avant de recourir, précisément en cette année 1887, à l'assistance de d'Indy pour le travail des chœurs, Charles Lamoureux avait eu l'ingénieuse idée de s'adjoindre Emmanuel Chabrier. Cet intime ami de la maison fut aussi l'un de ses fournisseurs les plus marquants. A peine installée, en 1883, l'association lance España comme un cri de défi. Retentissante et mémorable, cette exécution consacra le compositeur et affermit l'interprète. En 1897, celle du premier acte de Briséis fut l'une des dernières manifestations de Lamoureux. Chabrier était mort depuis trois ans de cette terrible maladie de langueur qui devait l'emporter avant qu'il eût accompli son œuvre. Lamoureux ayant en définitive parachevé la sienne, et ne voyant sans doute plus la nécessité d'engager de nouveaux combats, Lamoureux, énigmatique, se dessaisit soudain de son sceptre au profit de son héritier légal, son gendre Camille Chevillard.
Avec Chevillard, on entre dans un nouveau stade de la vie orchestrale. Sous ce rapport, Lamoureux et Colonne avaient mêmement franchi une étape de plus que Pasdeloup. Fougueux animateur de l'époque héroïque, capable de violenter un public musicalement primaire et marchant au besoin carrément contre lui, Pasdeloup, Habeneck des faubourgs, fut, parmi les chefs d'orchestre de métier, le dernier amoureux des longues chevelures. Je veux dire qu'à la manière ancienne, et quoique pianiste, il usait encore d'un archet de violon pour guider et entraîner ses troupes. Par précaution, il en accrochait plusieurs à la droite de son pupitre. Vestiges d'un passé qui allait bientôt disparaître à jamais. Par contre, Colonne et Lamoureux, bien qu'ils fussent l'un et l'autre violonistes. adoptèrent le bâton sans retour. Lamoureux s'irritait même à ce sujet, trouvant, selon les jours, ses baguettes trop épaisses ou trop minces, trop légères ou trop lourdes.
Ces questions d'attributs prennent souvent plus d'importance réelle qu'elles n'en ont en apparence. Nous leur assignerions volontiers une valeur symbolique. Dans l'ordre de la chronologie musicale, la transformation définitive de l'archet souple et soyeux en petit bout de bois chauve et rigide, tenant du gourdin et de l'insigne de la plus haute dignité militaire, évoque immanquablement pour nous les différences sensibles qui séparent un Colonne de son ancêtre, comme la barbiche à l'impériale distingua naguère les hommes de l'époque de Pasdeloup, comme la mode des cheveux longs et des cheveux courts correspondit plus tard à la psychologie féminine d'aujourd'hui comparée à celle d'antan.
Encore un Lamoureux ne saurait-il être situé parmi les prédécesseurs immédiats de la pléiade des chefs d'orchestre modernes. Avant d'en venir aux personnalités représentatives de cette catégorie intermédiaire, au milieu desquelles figure un Chevillard par exemple, il faudrait mentionner nombre d'individualités sans doute plus estompées, mais estimables, qui furent un peu comme les satellites des Colonne et des Lamoureux.
Bien qu'il fût entré à la Société des Concerts dès 1857, Ernest-Eugène Altès en était le contemporain. Né à Paris le 28 mars 1830, il mourut à Saint-Dyé-sur-Loire le 2 juillet 1899, peu avant Lamoureux. Son rôle, un peu effacé peut-être, avait été celui d'un excellent musicien et d'un adroit conducteur de répétitions. Il occupa deux postes à la Société des Concerts : sous-chef en 1870 et second chef de 1877 à 1881. A l'orchestre de l'Opéra où il était entré en 1846, il passa deuxième chef en 1877 et se maintint comme premier de 1880 à 1887, soit en tout quarante et une années de bons et loyaux services chez le même patron ! Au Conservatoire, il avait été successivement élève de Habeneck pour le violon et de Bazin pour l'harmonie. Il obtint un premier prix de violon. Mais quand il revint plus tard à l'Ecole Nationale de musique, ce fut pour enseigner... la flûte !
Paul Taffanel, son successeur dans cette fonction, forma, avec Colonne et Lamoureux, le triumvirat des chefs d'orchestre bordelais. Né le 16 septembre 1844 dans la capitale de la Guyenne, il était donc le benjamin de ce prestigieux trio. Dans l'histoire de la musique, il a rempli un double apostolat : comme chef d'orchestre et comme instrumentiste. C'est d'ailleurs en qualité de flûtiste que Taffanel s'imposa d'abord dans les divers endroits où il devait se mettre en évidence par la suite. Elève de Dorus et de Reber, au Conservatoire, il avait remporté en 1860, 1862 et 1865 les premiers prix de flûte, d'harmonie et de fugue. Sa présence à l'orchestre de l'Opéra date de 1861 et sa titularisation comme second flûtiste de 1864. En 1867, il forçait en outre les portes de la Société des Concerts, pour y devenir soliste en 1869. L'instrumentiste gagnait rapidement des galons, mais personne ne prenait garde à ses autres capacités. Modestement installé parmi ses camarades, il attendit en effet vingt-six années à l'Opéra et vingt-cinq à la Société avant de pouvoir troquer son pupitre d'exécutant contre celui de chef. Au Palais Garnier, c'est en remplacement du violoniste Lancien qu'il fut appelé au troisième poste. La fosse anonyme, il la domina pour la première fois le 25 janvier 1890 lors d'une représentation de Faust. Mais les étapes allaient se précipiter désormais. Trois ans plus tard (1893), Colonne lui cédait la première place. Ce court intervalle avait enfin suffi pour établir sa consécration, car Garcin lui avait abandonné déjà la sienne, à la Société des Concerts, le 27 novembre 1892. Peu auparavant, son élection avait été acquise à une appréciable majorité contre Danbé, concurrent cependant redoutable. Durant les onze années qu'il commanda la célèbre phalange, Taffanel lui imprime un vif élan. Il opère le rajeunissement des cadres avec Berthelier, Nadaud, Carembat, Hayot, Loeb, François Rabaud, Hennebains, Bas, Allard, Hasselmans. Taffanel infuse comme un sang plus jeune à la Compagnie. Dans l'élaboration de ses programmes, il accuse un sens assez aigu de l'actualité, et même un certain penchant à satisfaire les goûts les moins rétrogrades de sa clientèle. L'un de ses premiers soins, il le consacre, en janvier 1893, à l'Ode à la musique de Chabrier, d'ailleurs fraîchement accueillie ; le 28 janvier 1894, il ose s'attaquer aux airs de ballet du Prince Igor de Borodine ; en avril de la même année, il offre à ses abonnés des fragments des Béatitudes de César Franck (exécutées pour la première fois à Dijon en 1891 pour les fêtes de Saint-Bernard). En mars 1896 vient opportunément le tour de la Symphonie avec piano, sur un thème montagnard, de Vincent d'Indy. Toutefois, l'ordinaire de ces séances ne se distingue certes pas par des tendances révolutionnaires. Sa supériorité consiste surtout dans son autorité personnelle, par la vertu de laquelle il transforme les méthodes de travail et améliore le rendement. Plus promptement qu'aucun autre de ses collègues, et avec un minimum de préparation, il obtient le résultat voulu. On raconte que parfois, les répétitions de Pasdeloup étaient si pénibles et si longues que les musiciens, retenus à l'heure du déjeuner, avaient coutume d'apporter des provisions de bouche — pain, chocolat, saucisson — qu'ils absorbaient entre deux reprises ou pendant les tacet. Taffanel réussissait par contre à réduire au strict minimum l'effort demandé à ses troupes : critérium du prestige, de la science et de l'habileté du capitaine. Il eut d'ailleurs, en la personne de Samuel Rousseau un coadjuteur précieux. Samuel Rousseau, compositeur estimé et maître de chapelle à Sainte-Clotilde, était, à la Société, chargé des chœurs.

Paul Taffanel (photo Pierre Petit)
Jusqu'en 1901, Taffanel, chef distingué, consciencieux, de sang-froid — éminent en somme — sut conserver, faubourg Poissonnière, le respect unanime de ses subordonnés et la faveur non moins totale de ses auditoires. A l'Académie nationale de musique, il garda les prérogatives de son rang jusqu'en 1906 ; il y avait notamment monté, à la satisfaction générale aussi, Thaïs, Othello, Tannhäuser, Messidor, les Maîtres chanteurs.
Ajoutons que Taffanel appartint en 1872 à la Société classique de musique de chambre et fonda, en 1879, la Société de musique de chambre pour instruments à vent. Au Conservatoire, il fut titulaire d'une classe de flûte et de la classe d'orchestre. Dans la première, il devait former l'un de ses plus brillants successeurs à la Société des Concerts et à l'Opéra, M. Philippe Gaubert. Peu après sa retraite, et au milieu de la déférence sympathique de tous, Paul Taffanel mourut le 8 novembre 1908.
Vers 1894, c'est-à-dire en plein règne de Taffanel, trois chefs se partageaient le pupitre de l'Opéra. La besogne se trouvait répartie entre eux de la manière suivante :
Ouvrages nouveaux ou de Wagner : Taffanel, doublé par Mangin.
Ouvrages du répertoire : Madier de Montjau, doublé par Taffanel.
Ballets : Madier de Montjau, doublé par Mangin.
Ouvrages précédant les ballets : Mangin, doublé par Madier de Montjau.
Madier de Montjau, né à Paris en 1841, avait été l'élève de Jacques Dupuis et Etienne Soubre au Conservatoire de Liège, de Léonard, Massart et Delibes en France. Après quatre ans passés à l'Opéra comme second violon, il y devint chef en 1880. Jusqu'alors, il avait exercé la conduite d'orchestre à la Nouvelle-Orléans et à Anvers ; à Paris, son talent s'était déployé au théâtre de la Renaissance et à l'opéra populaire de la Gaîté.
Le troisième chef de cette période à l'Opéra, Eugène-Edmond Bocquet, dit Mangin, ne à Paris le 7 décembre 1837 et mort en 1907, ne joua jamais un rôle de premier plan. Mais il attacha son nom à une estimable entreprise. Elève de Marmontel, de Bazin et d'Ambroise Thomas, il eut au Conservatoire un deuxième prix de piano (1853), un premier prix d'harmonie et d'accompagnement (1858). Il était professeur des Ecoles de la Ville en 1860, chef de chant au Théâtre-Lyrique en 1862 et chef d'orchestre en 1864. Chef de chant à l'Opéra en 1887, il y arrivait chef d'orchestre en 1893 pour l'emploi indiqué ci-dessus. C'est dans l'intervalle qu'il avait accompli le meilleur de sa tâche, non à Paris mais à Lyon. De 1871 à 1873, pendant son séjour au Grand-Théâtre de cette ville en qualité de premier chef d'orchestre, il fonde le Conservatoire (1872) et dirige cette école jusqu'en 1881. Il crée ensuite les Concerts populaires de Lyon (1873-1880) et les Concerts du Conservatoire (1874). A la base de la florissante activité musicale par laquelle cette riche cité s'est dès longtemps signalée, se trouve indéniablement l'impulsion d'Édouard Mangin qui fut d'ailleurs nommé, après son départ de Lyon, en 1882, professeur de solfège au Conservatoire de Paris. La nomination de Taffanel à la Société des Concerts en 1892 avait provoqué la démission de son concurrent malheureux Jules Danbé, second chef depuis l'élévation de Garcin à l'échelon supérieur. Danbé espérait suivre la même normale progression que son ancien. Déçu, il se retira. Mais ce geste ne marqua pas la fin d'une carrière qui avait été jusque-là très heureusement remplie.
Jules Danbé, né à Caen le 16 novembre 1840 fut, au Conservatoire, le disciple de Girard et de Savard. Dans la classe du premier, il remporta en 1859 un premier accessit de violon, la plus haute récompense qu'il put s'adjuger. Danbé n'était pas ce qu'il est convenu d'appeler « l'homme des concours ». Mais il montra peu après qu'il était homme d'action, ce qui vaut mieux. Il se forma d'abord dans les orchestres théâtraux du Vaudeville, du Théâtre-Lyrique, de l'Opéra-Comique, de l'Opéra et dans les orchestres symphoniques des Concerts Pasdeloup et de la Société des Concerts. Comme chef, il avait débuté sous la direction de Musard. En 1871, avec un petit noyau instrumental de qualité, il fonde les Concerts du Grand-Hôtel. Jusqu'en 1874, il donne des séances dans la salle Herz et, en 1875, dans la salle Ventadour. Ces auditions, bientôt en vogue, attirèrent sur Danbé l'attention générale. Aussi, en 1876, Vizentini, directeur du Théâtre-Lyrique, l'appelle-t-il auprès de lui. Danbé monte alors Dimitri, les Erynnies, Paul et Virginie L'année suivante, c'est la direction de l'orchestre de l'Opéra-Comique qui lui échoit et il la conserve jusqu'au 1er avril 1898 : près de vingt-deux années pendant lesquelles Danbé s'occupe de quatre-vingt-douze ouvrages nouveaux. On constate en outre une véritable rénovation de l'orchestre. Henri Vaillard, deuxième chef (1876) et Giannini, troisième chef (1895) sont ses lieutenants. Son départ de l'Opéra-Comique fournit l'occasion d'une touchante manifestation de sympathie à son égard. En 1899, il émigre au Théâtre Lyrique de la Renaissance et dirige incidemment aux Casinos de Néris-les-Bains et de Vichy. Il est mort en 1906.

Jules Danbé (photo Nadar)
Jules Danbé incarna brillamment le type du chef d'orchestre de théâtre. Charles Lamoureux, Colonne, Taffanel, et, avant eux, Deldevez, avaient régné sur des scène lyriques. Mais ils s'étaient néanmoins spécialisés dans le concert, auquel ils durent surtout leur réputation. La postérité n'a au contraire accordé qu'une modeste notoriété à un certain nombre de chefs qui se vouèrent à l'art lyrique. En remontant un peu plus loin dans l'histoire du théâtre, nous trouvons notamment, pour préciser ce cas, le parisien Pierre-Joseph-Alphonse Varney (1er décembre 1811-7 février 1879) auteur du célèbre Chant des Girondins, composé pour un drame d'Alexandre Dumas père, le Chevalier de Maison Rouge, et du reste assez plate démarcation de l'un des cinquante chants français de Rouget de l'Isle. Varney, père et professeur de l'auteur des Mousquetaires au Couvent, Louis Varney, avait conduit au Théâtre de Gand en 1835, puis au Théâtre Historique, au Théâtre-Lyrique et aux Bouffes-Parisiens, avant d'en être le directeur (1862). En 1868, il se trouve au Grand Théâtre de Bordeaux et à la Société Sainte-Cécile. Il se retira en 1878.
Deux ans auparavant était mort le violoniste Deloffre, né à Paris en 1827, qui fut chef d'orchestre au Théâtre-Lyrique, sous Carvalho, et après Tilmant à l'Opéra-Comique où il eut l'honneur de diriger la première représentation de Carmen. En 1876 l'Opéra-Comique possédait également le Marseillais Titus-Charles Constantin, rompu à toutes les difficultés du métier théâtral. Né le 7 janvier 1835 et mort à Pau en octobre 1891, son maître avait été Ambroise Thomas. Violoniste comme beaucoup de ses semblables, il régit la musique à l'Athénée, au Casino, à la Renaissance, au Châtelet, où il fut appelé par Litolff, aux Fantaisies-Parisiennes et enfin à l'Opéra-Comique. Son concitoyen Jules Cohen, né à Marseille le 2 novembre 1830 et mort à Paris le 13 janvier 1901, chef des chœurs à l'Opéra jusqu'au 30 septembre 1874, exerça des fonctions peut-être moins brillantes, mais il apporta dans l'usage de ses prérogatives une maestria qui lui valut une situation morale enviée. Elève de Zimmermann, Marmontel, Benoist et Halévy, il revint en 1870 au Conservatoire comme professeur adjoint, puis jusqu'en 1892, comme professeur titulaire de la classe d'ensemble vocal.
Mais voici un musicien, également chef de chant à l'Opéra, dont le souvenir s'est moins estompé dans le halo poussiéreux de la scène. Peut-être doit-il en partie cette survivance à l'honnête labeur qu'il fournit parallèlement en tant que producteur. Son élection à la Société des Concerts devait surtout le distinguer de ses confrères.
Georges Marty était né à Paris le 16 mai 1860. De très bonne heure, il manifesta des aptitudes musicales et, à douze ans, entra au Conservatoire. Disciple de Gillette et de Croharé pour le solfège, de Théodore Dubois pour l'harmonie, de César Franck pour l'orgue, de Bazin et de Massenet pour la fugue, le contrepoint et la composition, il obtint la première médaille de solfège en 1875, le premier prix d'harmonie en 1878, une mention honorable au concours de Rome en 1879 et un second Grand-Prix en 1881. En 1882, sa cantate Edith lui valut le premier Grand-Prix. En 1890, ayant terminé son séjour à la villa Médicis. et voyagé en Sicile, en Tunisie et en Allemagne, il est désigné comme chef des chœurs du Théâtre-Lyrique (Verdhurt), à l'Eden-Théâtre de la rue Boudreau. Il participe à la représentation de Samson et Dalila (1891) et monte la Jolie fille de Perth de Bizet. On lui confie les ensembles vocaux de Néron de Lalo, à l'Hippodrome (1891) et d'Israël en Egypte de Haendel, donné par la Société des grandes auditions musicales. Le 1er février 1892, il est nommé professeur d'une classe d'ensemble vocal au Conservatoire. Plus tard, il prend la succession de Samuel Rousseau dans la classe féminine d'harmonie. En 1893, il passe chef de chant à l'Opéra, en remplacement de Jules Cohen. Il participe ainsi aux représentations de Gwendoline, de Djelma, d'Othello, de Tannhäuser, de Messidor, des Maître chanteurs. Lorsque Pedro Gailhard créa les Concerts de l'Opéra, il en confia la direction à Paul Vidal et à Georges Marty. Là furent jouées des œuvres de Vincent d'Indy, Ch.-M. Widor, Erlanger, Xavier Leroux, Le Borne, Gabriel Pierné, Bachelet, Hirchmann, Bourgault-Ducoudray, Massenet, Saint-Saëns, Paul Dukas, Joncières, André Wormser. En 1900 il devint, sur l'offre pressante d'Albert Carré, chef d'orchestre à l'Opéra-Comique. Enfin, le 12 juin 1901, les membres de la Société des Concerts furent appelés à désigner le successeur de Paul Taffanel, démissionnaire. Eugène d'Harcourt, Gabriel Marie, André Messager, Désiré Thibault, Samuel Rousseau et Georges Marty figuraient sur la liste de candidatures. La lutte fut circonscrite entre ces deux derniers. Samuel Rousseau obtint 37 voix ; Marty triompha brillamment avec 54 voix. Ce devait être le couronnement d'une carrière assidue et régulière.
En 1906, Marty remplaçait Danbé comme directeur des concerts classiques du Casino de Vichy. Par une coïncidence curieuse, il mourut deux ans plus tard (1908) d'une maladie de foie. au mois de septembre, alors qu'il terminait la saison musicale de Vichy. Il était alors dans toute la force de l'âge et dans l'épanouissement de son talent. Au cours de cet été, rien n'avait laissé prévoir à aucun de nous ce brusque dénouement. Lorsqu'il disparut, à 48 ans, Georges Marty était alerte, solide, vigoureux, trapu et plein de projets pour l'avenir. Il n'avait sans doute point montré de génie, mais il laissait le souvenir d'un chef de bonne classe, minutieux jusqu'au fignolage et scrupuleux au plus haut point. Son fils unique fut tué au début de la guerre.
C'est en 1892 que Camille Chevillard enjambait pour la première fois l'estrade des Concerts Lamoureux. Cette même année se signale par un autre événement : l'apparition de M. Eugène d'Harcourt, né à Paris en 1860, et de ses Concerts éclectiques populaires. Malgré ce titre prometteur, ce ne fut, pendant une durée totale de moins de quatre années, qu'une assez pâle réédition de la formule symphonique courante. Grâce à sa culture, plutôt rare dans ce milieu, d'Harcourt aurait peut-être pu se laisser tenter par l'attrait de plus larges horizons, n'avait en effet mené conjointement de fortes études de lettres, de droit et de musique. Pour cette dernière, il suivit, au Conservatoire de Paris, l'enseignement de Savard, Massenet, Durand, et, au Conservatoire de Berlin, celui de F. Schultz et de Woldemar Bargiel. De retour en France en 1890, il s'empressa de construire une salle — la salle d'Harcourt, rue de Rochechouart. Il ne rêvait, lui aussi, que de donner d'intégrales auditions des partitions de Beethoven, Weber, Schumann, Wagner. Toute son ambition était donc de suivre la mode du moment. La séance inaugurale comporta la première exécution, à Paris, de la Valse impériale de Strauss. Maint compositeur français trouva pourtant chez d'Harcourt un enviable abri : Gounod, Massenet, Ambroise Thomas, Saint-Saëns, Paladilhe, de Boisdeffre, Victorien Joncières, Eugène Gigout, Fernand Le Borne. Marsick, Hayot, Laforge, Loeb formaient un quatuor de haute classe. Les solistes s'appelaient Houfflack, R. Schidenhelm, Lucien Wurmser, Guilmant, Mme Roger-Miclos, Salmon, Delafosse, Pugno.
D'abord très modestes, les concerts étaient, dans la pensée du fondateur, exclusivement réservés à la classe populaire ; ils s'écartèrent rapidement de leur objectif, et c'est en partie à cette cause qu'il faut probablement attribuer la brièveté de leur existence. Compositeur et écrivain, d'Harcourt sut aisément trouver une agréable utilisation de ses loisirs. Il publia en 1895 Quelques remarques sur l'exécution de Tannhäuser, en 1898 Un aperçu analytique des symphonies de Beethoven, traduisit en français Geneviève de Schumann et le Freischütz de Weber ; puis, subventionné par l'Etat, il rapporta de ses voyages d'études la Musique actuelle en Italie, la Musique actuelle en Allemagne et en Autriche-Hongrie.
La longue liste des musiciens qui illustrèrent à la fin du siècle dernier la profession de chef d'orchestre doit-elle s'arrêter ici ? Sans doute suffit-il de signaler les plus marquants, ceux dont les travaux échappèrent à la banalité d'un labeur anonyme. Combien d'autres, artisans laborieux, penchés sur leur pupitre provincial ou bien noyés dans l'ombre des théâtres parisiens consacrèrent leur digne et utile industrie à cette tâche méticuleuse des répétitions et de la mise au point ! Musiciens quelque peu sacrifiés, ceux-ci, dont les talents plus ou moins étendus s'employèrent à battre scrupuleusement la mesure ! Consciencieux, clairvoyants et indispensables préparateurs, ou bien surveillants idoines quoique d'un rang inférieur ! Leur dévouement quotidien à la musique d'autrui ne vaudrait-elle pas mieux qu'un dédaigneux oubli de la postérité ? Mais comment songer à citer tous les diacres de ce culte alors que la liste de ses pontifes se charge elle-même à l'excès ? Déjà s'enflent et roulent les vagues pressées des jeunes générations. Il faut quitter le passé pour entrer plain-pied dans le présent. Là, ce ne sont plus visages assombris par le recul ou bien ridés par les insultes du Temps ingrat, mais des physionomies vivantes, aux traits précis et que n'a point ternies l'embu des brumeux et mélancoliques lointains.
Au point de jonction se trouvent diverses saillantes individualités. Un Gabriel Marie serait du nombre. Né à Paris le 8 janvier 1852, il a demandé sa formation musicale au Conservatoire où il eut en 1865 une première médaille de solfège et un premier prix d'harmonie et d'accompagnement en 1873. Colonne lui céda la direction des Concerts d'orgue de Guilmant au Trocadéro. Il émergea d'abord comme pianiste, rentra dans le rang comme timbalier chez Lamoureux avant d'y devenir chef des chœurs. Chargé de diriger en 1887 les concerts de l'Exposition du Havre, il fut pendant sept saisons chef d'orchestre de la Société Nationale de Musique. Il collabora successivement au Théâtre-Lyrique de l'Eden (1890), au Grand Théâtre de l'Eden (1893), aux Concerts de la Société Sainte-Cécile de Bordeaux (1894), à l'Association Artistique de Marseille et au Casino de Vichy. Mais si le nom de Gabriel Marie demeure lié au cycle présent de la musique française, c'est surtout en raison de ses multiples interventions dans le concert moderne. L'âge d'un artiste compte peu tant que persiste sa vitalité. De là vient que certains hommes préparent, d'une époque à une autre, la transition souvent imperceptible, mais inéluctable. Ce fut, à n'en point douter la fonction d'un Camille Chevillard.
Il se peut que, dans ses dernières années, le gendre de Charles Lamoureux ait subi un certain alourdissement de sa vivacité native. Il n'en a pas moins représenté, pendant un quart de siècle l'un des facteurs les plus vigoureux du mouvement musical parisien. C'est pourquoi sa brusque disparition ne fut pas de celles que l'on voit, en d'éphémères lendemains, susciter de conventionnels regrets. Chevillard avait de son vivant creusé sa place très profondément ; et, lui mort, le souvenir de sa silhouette massive familièrement comparée à celle du sanglier, de son geste un peu trapu mais ferme, continue jusqu'à maintenant encore d'évoquer un très riche et glorieux passé.
Les Concerts Colonne, dans le vaste Châtelet disposent d'un public mouvant et divers. Chevillard, à l'Association Lamoureux, avait constitué une clientèle plus spéciale, assez apparentée à celle des habitués de la rue du Conservatoire.

Camille Chevillard (photo Berger)
Son père, le célèbre violoncelliste Alexandre Chevillard, avait révélé à Paris les derniers Quatuors de Beethoven. Camille Chevillard, élevé dans la vénération des maîtres allemands, possédait quand même assez de liberté pour ne pas bouder systématiquement à la production nationale contemporaine, dont il fut d'ailleurs un représentant distingué. Il jouait, au fur et à mesure de leur apparition, la Symphonie en ut majeur de Paul Dukas, Edith au col de Cygne de Georges Hüe, l'Après-midi d'un faune de Debussy ; il introduisit dans son cercle les Russes : Rimski-Korsakov avec Antar, Balakirev avec Russia. N'importe ! Vis-à-vis de ses fidèles, il demeurait le traducteur inspiré de Liszt, de Beethoven, de Schumann, de Wagner. Il répondait avec une évidente satisfaction à l'attente des pèlerins venus chaque dimanche communier dans cette religion. D'emblée, Chevillard avait reçu la consécration de chef d'orchestre wagnérien. Dès sa première année de présidence effective de l'Association Lamoureux, en 1900, la Presse recueillait à ce propos l'écho d'un enthousiasme qui ne dédaignait pas l'hyperbole. Le 16 février, Chevillard, qui ne s'était jusqu'alors imposé qu'avec une certaine lenteur aux côtés de Lamoureux, donna au Château-d'Eau la Symphonie Héroïque et Siegfried Idyll qu'accompagnait une « extraordinaire » exécution du Prélude de Tristan et de la mort d'Iseult. « Jamais, écrivait un critique en veine de dithyrambe, jamais aucun orchestre n'a pu rendre, jamais aucun orchestre n'exprimera avec une perfection plus ardente, avec une poésie plus intense, avec une plus lucide exaltation, ces deux pages sublimes de Wagner. Pas un détail de ces conceptions si complexes ne nous a échappé ; pas une mesure qui n'ait pris sa valeur, son sens, sa portée ; pas une note qui n'ait jeté sa plainte ou son cri de joie. Et par un miracle de volonté, les deux morceaux n'en ont pas moins conservé, d'un bout à l'autre, une tenue, une cohésion, un élan merveilleux. Je ne crois pas que Wagner ait jamais eu la joie d'entendre exécuter la mort d'Iseult avec une passion si vive, si sincère, avec une joie si caressante, si surhumaine, avec un tel rayonnement d'ivresse. »
Cet éloge, pour emphatique qu'il soit, se fût certes appliqué encore mieux au Chevillard qui, après plusieurs lustres, avait à tous égards acquis sa pleine maturité. La seule remarque qui s'impose, c'est que, précisément, pendant ces quelque vingt années, Chevillard ne sut pas, ou bien ne voulut pas imposer à son cénacle un sensible élargissement de ce champ d'action. Successeur de son beau-père, Charles Lamoureux, il ne fut pas seulement cela, mais aussi, dans le domaine du wagnérisme, son opiniâtre continuateur. A l'Opéra où, depuis l'avènement de M. Jacques Rouché en 1913, il portait glorieusement la responsabilité des études musicales, Camille Chevillard allait donner libre cours à cette constante inclination ; mais il ne s'adapta que malaisément aux exigences impérieuses du théâtre. Les critiques véhémentes qui s'abattirent sur lui en 1923 l'affectèrent énormément. Mais il dut, malgré tout, retirer une satisfaction intime et profonde en réalisant un aussi doux rêve. Les représentations wagnériennes et leur préparation soutinrent sa brûlante flamme jusqu'au bord de sa tombe. Quelques semaines plus tard, le 30 mai 1923, il s'éteignait dans sa villa familiale de Chatou, qu'il affectionnait. Il n'était âgé que de 63 ans, étant né le 14 octobre 1859 à Paris.
Ainsi se termina, et peut-être sous la pesante amertume d'un soir désenchanté, l'existence de cet homme prestigieux et fier — vie toute de droiture, sans concessions comme sans détours. Chevillard a servi la musique avec passion, de toute son âme à la fois virile et tendre. Car une immense et rayonnante bonté se dissimulait sous ses brusques dehors. Sa délicate sensibilité prenait souvent des formes exquises. Mais une incroyable et incurable pudeur jugulait tous ses actes publics et dérobait à tout venant les trésors infinis de son cœur. Enjoué, Chevillard l'était aussi, malgré sa mine rébarbative et renfrognée ; gai jusqu'à la jovialité, lorsqu'il ne craignait pas de se montrer sous son véritable jour ; confiant comme un enfant quand il se sentait bien à l'aise au milieu d'amis chers ; s'abandonnant avec une sorte d'ivresse dans la douceur d'une chaude intimité ; avec cela d'une étonnante fidélité : voilà quel était le véritable Chevillard, pourvu qu'il laissât seulement dompter sa terrible timidité.
Sa carrière, toute droite elle aussi, tient en peu de mots. Chef de chant chez Lamoureux, en 1887 ; chef d'orchestre adjoint en 1892 ; élu à l'unanimité en 1899 au poste de Lamoureux dont il avait entretemps épousé la fille unique. il dirigea pour la première fois à ce titre le dernier jour du siècle dernier, le 31 décembre 1899 ; enfin professeur d'une classe d'ensemble instrumental au Conservatoire en 1907, et, en 1913, nous l'avons déjà dit, directeur des études musicales à l'Opéra. Découvert et mis lui-même en lumière par Lamoureux, Chevillard, avant de disparaître, eut le mérite de sortir des limbes un musicien non seulement capable de le remplacer, mais aussi d'entretenir, voire de raviver la flamme allumée plus d'un demi-siècle auparavant par le fondateur de l'Harmonie sacrée. De 1911 à 1914, François Ausseil, né le 14 février 1869 à Perpignan, lauréat du Conservatoire en 1900, avait été second chef de l'Association. Mais le dauphin prédestiné n'était autre que M. Paul Paray. Après la disparition de celui qu'il nommait, à juste titre, sa providence, c'est lui qui fut élu chef d'orchestre et président des concerts Lamoureux.
Les nombres ont leur rythme et souvent leurs caprices. Lamoureux avait, nous l'avons indiqué, quatre ans de plus que Colonne. Le successeur et héritier naturel du premier, Chevillard, était également de quatre ans l'aîné de Gabriel Pierné, héritier spirituel du second. Mais en dépit de son droit d'aînesse, Lamoureux ne s'était installé définitivement dans ses meubles que huit ans après Colonne, son cadet. Or, par une sorte de compensation, Gabriel Pierné, héritier élevé au premier poste de la société rivale qu'en 1910, c'est-à-dire une dizaine d'années environ après son émule, Camille Chevillard. Sur le terrain musical, Chevillard et Pierné ne sauraient être considérés comme des contemporains, malgré les dates assez proches de leur naissance. Ils furent toutefois, de 1910 à 1922, si l'on peut ainsi dire sans craindre de risquer un facile jeu de mots, les deux colonnes sur quoi reposa, durant cette époque, l'édifice de la symphonie française. Pendant la guerre, aux temps de l'union sacrée — de « l'harmonie sacrée » — ils conjuguèrent leurs efforts, unirent en un seul les deux orchestres Lamoureux et Colonne, où la mobilisation avait creusé de nombreux vides, et se maintinrent vaillamment côte-à-côte sur leurs positions de combat.
Cette collaboration circonstancielle et momentanée ne parvint pas à combler la distance qui les séparait : tempérament, caractère, inclinations, méthodes, aspect même, presque tout, sauf leur commune musicalité, les opposait l'un à l'autre. Durant que leurs règnes coïncidèrent, ils s'avancèrent sur deux routes très distinctes, si ce n'est en divergence absolue. On a vu Chevillard volontiers à la remorque de son public sur un terrain relativement restreint, ne cherchant point à contrarier ses sentiments, wagnériens ou beethovéniens, qu'il avait lui-même contribué à développer. Gabriel Pierné, sans pouvoir être taxé d'irrespect pour ces dieux majestueux, tâche cependant à acclimater sur les berges de la Seine des idoles plus neuves. Dukas, Debussy, Ravel reçoivent au Châtelet la plus large hospitalité. Des expériences parfois plus hasardeuses sont tentées. C'est à l'auditoire de suivre ici des directives et non de les imposer. Ondoyant et divers, celui-ci ne répond pas constamment à ces invites. Alors Pierné tient tête avec crânerie. Au bout de ces conflits, il n'y a pas toujours la victoire. Il n'y a même pas, quelquefois, la justification de la bataille livrée. Car, si Stravinsky, d'abord sujet de scandale, se trouve plus tard adopté, certaines « premières auditions » ne suscitèrent qu'un vain tumulte. Au moins y a-t-il lutte et même esprit de sacrifice. Chez Gabriel Pierné la clarté du cerveau surpasse la vigueur du bras ; et son action sur les masses du Châtelet, il la doit encore plus à sa vive intelligence, incessamment en éveil, qu'à la fascination de sa baguette. Il affirma toujours une conception hardie selon laquelle le but du concert moderne, et la haute mission de chef d'orchestre ne consistent pas à profiter quiètement de la vitesse acquise, mais au contraire à prospecter sans cesse, et à créer du mouvement. Pour cela, il faut une sorte d'abnégation et risquer par surcroît la discorde dans son propre camp. En musique, les trois quarts du public sont arriérés, opiniâtres ou routiniers. La majorité du reste est moutonnier. La nouveauté n'attire pas lorsqu'elle ne repousse. Les comités directeurs de nos grandes associations symphoniques, chargés des intérêts moraux et matériels de la collectivité, sont bien obligés, bon gré mal gré, de tenir compte de cet important facteur. Aussi, lorsqu'on félicite M. Gabriel Pierné de la noble originalité qui le différencie de la plupart de ses confrères, serait-il injuste de ne pas associer à cet hommage le comité dont il préside les débats, puis l'Assemblée Générale des musiciens associés qui entérine enfin les actes de leur gestion. M. Gabriel Pierné ne se signale, ni dans ses goûts, ni dans son œuvre personnelle, par des tendances d'un modernisme très prononcé. Pourtant, loin de s'enfermer sur le tard de sa vie dans une tour d'ivoire, il sut rester jusqu'ici en contact permanent avec le dehors. La production de son époque, il la suit d'un œil perçant à travers les différents stades de l'évolution normale et d'ailleurs inéluctable. De là vient sans doute cette persistante impression de jeunesse que dégage encore sa personne populaire à un moment de son existence où un certain essoufflement pourrait résulter d'une carrière déjà longue et bien remplie.
Celle-ci commençait en 1890. Succédant à César Franck, le jeune Pierné prenait alors place, jusqu'en 1898, à la tribune du grand orgue de Sainte-Clotilde ; il avait 27 ans. Messin, avec peut-être un mélange d'hérédité méridionale par sa mère, montpelliéraine, il était né le 16 août 1863. Sa précocité musicale ne devait rencontrer aucun obstacle de la part de son père, professeur au Conservatoire de Metz. Sa première œuvre, Sérénade (1874) fut celle d'un bambin de 11 ans. En 1871, il était entré au Conservatoire de Paris où il obtenait la 1re médaille de solfège en 1874, le 1er prix de piano en 1879, le 1er prix de contrepoint et fugue en 1881 et le 1er prix d'orgue en 1882. Cette année-là, il enlevait aussi, à 19 ans, c'est-à-dire avec une hâte exceptionnelle, et avec un extraordinaire brio, son 1er grand-prix de Rome avec la cantate Edith d'Edouard Guinand. Cette récompense était partagée par Georges Marty, lequel était nommé en premier, Gabriel Pierné n'intervenant qu'en seconde ligne. Il y eut donc en cette année 1882 deux premiers grands prix. Raison : l'année précédente l'Institut n'avait décerné que des seconds grands prix (à MM. Bruneau et Vidal) et une mention honorable (à Edouard Missa).
Ce concours de Rome avait été marqué par un incident minime, mais dont les conséquences eussent pu devenir fâcheuses pour le postulant.
Les logistes étaient, à cette époque, hébergés dans l'ancien Conservatoire du faubourg Poissonnière, sous clef naturellement, et avec défense absolue de communiquer avec le monde extérieur. Or, un jour, de jeunes élèves de l'Ecole, amis de Pierné, vinrent en bande sous la fenêtre du prisonnier pour adoucir sa claustration en lui jetant des oranges. L'infraction vint aux oreilles du secrétaire général du Conservatoire, le terrible père Rety, geôlier des logistes, lequel fulmina et ouvrit incontinent une enquête. Des indications sur la cantate n'étaient-elles pas incluses dans les fruits délictueux ? L'hypothèse, un instant soulevée par l'esprit inquiet du pointilleux M. Rety fut tôt abandonnée et la sérénité du travail de l'élève Pierné ne fut pas autrement troublée par la suite. Mais l'austère secrétaire général ne manqua pas de faire passer un mauvais quart d'heure aux indisciplinés, parmi lesquels figurait, penaude, sa propre nièce.
Sept années avant d'être appelé à diriger les concerts du Châtelet, soit en 1903, M. Gabriel Pierné avait été nommé chef-adjoint d'Edouard Colonne. C'est par conséquent depuis vingt-trois ans qu'il a tour à tour collaboré, puis présidé aux destinées de l'Association, n'interrompant ses fonctions à Paris que pour aller à maintes reprises diriger des concerts à l'étranger, en Suède notamment, et en Angleterre où il eut l'occasion de conduire, à la Philharmonic Society, sa Croisade des Enfants. Directeur des ensembles musicaux de la Ville de Paris, membre du conseil supérieur du Conservatoire, il présida la commission chargée de l'enseignement musical dans les Etablissements primaires et secondaires de l'Etat. Enfin, au mois de janvier 1925, l'Institut, en l'invitant à occuper le fauteuil académique de Théodore Dubois, a accueilli, en même temps qu'un compositeur émérite, un musicien qui a singulièrement milité en faveur de tous ses confrères, et même ceux des générations postérieures à la sienne.
En 1910, devant même qu'il eût remplacé Colonne, Gabriel Pierné était déjà notoire. C'est le moment où l'on commençait de chuchoter le nom, prédestiné semble-t-il, d'un néophyte ardemment anxieux d'exercer à son tour le sacerdoce symphonique. Cet impatient, c'était M. Rhené-Baton. D'origine bretonne, il était né en Normandie, à Courseulles-sur-Mer, le 5 septembre 1879. Au Conservatoire, il séjourna deux ans dans les classes supérieures de piano. En dehors de l'école officielle, il poursuivit son éducation musicale avec André Gédalge et André-Bloch. Duparc fut son maître vénéré. En 1907, M. Rhené-Baton devient chef des chœurs à l'Opéra-Comique. Les Concerts de Musique Contemporaine, organisés sous les auspices de l'éditeur Jacques Durand vont lui fournir bientôt l'occasion de se produire publiquement salle Gaveau à la tête d'un orchestre, début qui, à son heure, prend les proportions d'un événement artistique assez retentissant. La curiosité des milieux musicaux se fixe d'emblée sur ce jeune chef au geste enflammé. D'aucuns considèrent ce coup d'essai comme un coup de maître. Aussi lorsque M. Jacques Durand décida de donner par la suite une audition de Au Jardin de Marguerite de M. Roger Ducasse, c'est encore à M. Rhené-Baton qu'en sera confiée la présentation. Il déploie dès lors son action, mais d'abord en province où son expérience se complètera vite : à Angers, avant l'avènement de M. Gay (Concerts populaires) et à Bordeaux (Société Sainte-Cécile). En 1914, il entre chez Lamoureux comme chef-adjoint. Il parvient à s'établir enfin dans ses meubles en 1918. Quand M. Sandberg, malgré ses lourdes occupations dans le cinéma résolut de ressusciter les Concerts Pasdeloup, défunts depuis trente-quatre ans (1884), c'est M. Rhené-Baton qui prit au Cirque d'Hiver, comme jadis, le commandement de la célèbre phalange durablement réincarnée. Ce groupement a tenu contre vents et marées. A plusieurs reprises, les conditions matérielles de son existence ont pu pourtant paraître compromises. On l'a vu, d'une année à l'autre, errer à la recherche d'un abri toujours aléatoire : du Cirque d'Hiver à l'Opéra, de l'Opéra au théâtre des Champs-Elysées, des Champs-Elysées à l'inconfortable Trocadéro. Grave crise de logement symphonique qui sévit chez nous en permanence et ne favorise pas la toujours délicate croissance des institutions concertantes. Les destinées des nouveaux Concerts Pasdeloup sont momentanément fixées au théâtre assez peu propice de la rue Mogador. La faveur publique d'ordinaire inconstante a suivi ces obstinés dans leurs déambulations à travers la capitale inhospitalière ; elle s'est même affirmée à partir de son retour dans les quartiers du centre. Mais, après avoir été ballottée sur des flots incléments, l'actuelle association Pasdeloup n'a pas encore trouvé un havre de toute sécurité : déplorables conditions pour obtenir cette cohésion qui ne s'acquiert, et à la longue, que dans le calme et dans la certitude d'un enviable avenir. Il faut, nul ne l'ignore, le désintéressement passionné et durable de chacun des multiples éléments qui concourent à la formation d'un grand orchestre symphonique moderne pour obtenir l'homogénéité nécessaire et surtout l'indispensable souplesse. De sorte que la synthèse poursuivie par M. Rhené-Baton avec une constance, une ardeur et une foi exemplaires, ne s'est peut-être pas réalisée jusqu'ici avec toute la fermeté désirable. Question de temps sans doute, et de confiance en soi. A la persuasion de M. Rhené-Baton, appelé d'ailleurs fréquemment au dehors, vient s'ajouter, quant à présent, celle de M. Albert Wolff qui, vraisemblablement, contribuera beaucoup pour sa part à l'amélioration du rendement.

Rhené-Baton
Dans ce paragraphe-ci, le moment n'est pas encore venu de brosser en traits rapides le portrait de M. Albert Wolff. En établissant celui de M. Rhené-Baton, gardons-nous de nous laisser entraîner par la tentation d'une charge trop aisée. De stature imposante, son buste puissant commente avec une grâce sans doute un peu massive les mélodies ou les rythmes échappés de l'orchestre. Cette mimique, la plupart des illustres kapellmeister des grandes écoles allemandes et italiennes ne cherchèrent d'ailleurs pas à la tempérer. Toutefois, chez nous, une trop romantique gesticulation ne satisfait pas tout un chacun. Constitue-t-elle un défaut ? Cela dépend. En tous cas, ce travers serait de ceux dont on peut se corriger très aisément. M. Rhené-Baton, jeune encore, est loin d'avoir stéréotypé ses réactions physiques. La preuve, c'est que, présentement, il évolue sensiblement à cet égard. Au demeurant, sa rapide fortune en maintes villes étrangères connaisseuses doit rendre infiniment circonspectes toutes ces observations d'ordre du reste essentiellement secondaire. Ce qui importe plutôt, c'est de savoir, abstraction faite des signes extérieurs, à quel degré l'autorité foncière d'un chef s'impose à ses subordonnés. Or, des causes également accessoires paraissent avoir souvent conditionné l'empire de M. Rhené-Baton tant sur ses collaborateurs que sur le public. La cordiale entente avec un comité comme la sympathique estime d'un auditoire ne tiennent pas uniquement à des considérations artistiques, mais fréquemment aussi à des impondérables. Elles subissent les influences contradictoires d'un milieu extrêmement sensible et instable ; elles sont surtout fonction de la longueur de l'onde magnétique qui se dégage spontanément de l'artiste. Tout cela, nous le formulons fortuitement à propos de M. Rhené-Baton, mais non pas exclusivement pour lui. Car ces réflexions s'appliquent à chaque acteur, et tout chef d'orchestre symphonique en est un, qu'il le veuille ou non.
Pour ce qui concerne personnellement le président actuels des Concerts Pasdeloup, nous ajouterons qu'il a pâti, même auprès de son entourage immédiat, des obstacles accumulés sur sa route depuis la constitution de la nouvelle société, indépendante désormais à l'instar des associations Colonne et Lamoureux. Quand il n'y a pas, dit-on, d'avoine au râtelier, les chevaux se battent et lèvent le sabot entre leurs gardiens. Ces difficultés morales et matérielles, il est bien rare qu'une grande association musicale naissante ou renaissante puisse les éviter ; elles ne doivent pas nous étonner. Le talent et la gloire de M. Rhené-Baton seront, espérons-le, de les surmonter toutes et d'avoir enfin construit, sur un sol aussi friable, un majestueux édifice.
Ce n'est pas son seul mérite. Si sa laborieuse réussite en tant que fondateur et pionnier lui confère, au bout de sept années d'exercice, des titres imprescriptibles et semblables à ceux d'un Colonne et d'un Lamoureux auxquels il est équitable de le comparer, M. Rhené-Baton a démontré au surplus qu'une entreprise symphonique, même lancée dans des conditions hasardeuses pouvait gagner sa cause sans s'inféoder aux partis réactionnaires de la musique, et en gardant, tout au contraire, un contact permanent avec la production contemporaine et principalement avec la française.
Ce qu'à ce sujet nous avons relaté pour l'éloge de M. Gabriel Pierné s'applique presque totalement à M. Rhené-Baton. Il ne défend d'ailleurs pas uniquement notre musique moderne dans l'atmosphère relativement amie des salles parisiennes. Il a souvent porté la bonne parole à l'étranger. Son rôle de propagandiste ne se réduit pas à quelques apparitions occasionnelles. Il le poursuit avec une intrépide insistance. En 1910, il dirige déjà un concert à Munich ; ce fut probablement le seul ou l'un des seuls festivals de musique française donnés depuis longtemps en Allemagne par un Français. En 1912 et 1913, il visite Londres, Buenos Aires, Montevideo, Rio de Janeiro avec la compagnie des Ballets Russes de M. de Diaghilev. La déclaration de guerre le surprend en Hollande avec l'orchestre Lamoureux engagé pour une série de concerts. En 1916, il sera chargé d'une mission artistique dans les Pays-Bas. Puis il deviendra directeur de la musique de l'Opéra de La Haye, et aura le bonheur d'être choisi pour conduire la représentation de Pénélope à Anvers. Ses séjours se succèdent alors en Hollande, dans les pays scandinaves et baltes. Au commencement de cette saison, il se trouvait derechef à Riga. Même après la restauration des Concerts Pasdeloup, il a donc poursuivi depuis l'origine de son existence militante un double apostolat : dans son propre pays et à l'extérieur. Agé de 47 ans, nul ne peut prévoir son avenir. Mais, pour lui rendre la plus stricte justice, que d'aucuns pourraient lui marchander, sachons reconnaître qu'il a moissonné dès à présent une quantité plus qu'honorable de lauriers.
André Caplet, plus âgé que lui d'un an fut un moment son collaborateur. Tandis que Rhené-Baton fut quelque peu le disciple de Duparc, Caplet évolua longtemps dans le sillage de Debussy. Dès sa sortie de la Villa Médicis, Caplet subissait l'influence de l'auteur de Pelléas et Mélisande. C'est lui qui, en 1921, eut l'insigne faveur de monter au Châtelet le Martyre de Saint-Sébastien. Il professait à l'égard de son maître une piété fervente qu'il prétendait dans certaines circonstances ériger en monopole ; et son ombrageux scrupule engendrait parfois des déterminations excessives et allant en définitive à l'encontre de leur dessein même. C'est ainsi qu'en juin 1922, il crut devoir refuser avec éclat de diriger à l'Opéra la reprise du Martyre, la présentation scénique étant à ses yeux indigne du chef-d'œuvre.
Originaire du Havre, il naquit le 23 novembre 1878 et attendit jusqu'à l'âge de 19 ans pour faire son entrée au Conservatoire. Mais il allait mettre les bouchées doubles. En 1899, il remportait déjà un 1er prix d'harmonie et un 1er accessit de contrepoint et fugue, en 1900 un 2e prix d'accompagnement et enfin le Premier Grand Prix de Rome en 1901. Encore élève, il avait été nommé directeur de la musique à l'Odéon et s'était adjugé le prix du Quintette pour piano et instruments à vent de la Société des compositeurs. L'année de la création du Martyre de Saint-Sébastien, il cinglait vers l'Amérique du Nord. Il eut jusqu'en 1914 la direction des études musicales à l'Opéra de Boston. De retour à Paris, au printemps de cette année-là, il recevait de flatteuses propositions de M. Rouché, installé depuis peu au Palais Garnier. Mais son tragique destin devait le détourner de ces pacifiques occupations. Mobilisé dans l'infanterie, il fut d'abord blessé, puis reçut cette atteinte de gaz qui allait compromettre irrémédiablement sa santé et ouvrir si prématurément sa tombe.
Peu de temps auparavant, il avait eu la satisfaction de conduire pieusement son Miroir de Jésus aux Concerts Colonne. Vers la fin de la guerre, le général Pershing l'avait fait désigner comme directeur de l'école des chefs de musique américains. Caplet, apte à toutes les besognes musicales, s'acquitta de cette tâche avec maîtrise. Mais, à partir de ce moment, tous les efforts qu'il dut fournir se ressentirent de la précarité de sa résistance physique. Il gravit pourtant encore un demi échelon quand il devint en 1922 coadjuteur de M. Rhené-Baton chez Pasdeloup, poste que son caractère inquiet ne lui permit pas de conserver en dépit des succès qu'il y remporta. Ses vastes capacités, sa probité artistique, son honnêteté d'homme intransigeant et incorruptible, ses convictions ardentes et généreuses quoique tourmentées et quelque peu despotiques lui gagnèrent bientôt une renommée du meilleur aloi. La réputation très justifiée qui s'attachait à ses talents et à sa probité s'était en somme formée selon une progression assez régulière.
Par contre, le nom de son compatriote normand Paul Paray, brusquement dévoilé sur les murs de l'arène, brilla tout aussitôt d'un éclat impromptu. Le successeur de Camille Chevillard à l'association Lamoureux n'est-il pas en effet nouvellement venu à cette profession de chef d'orchestre dans laquelle il a su s'illustrer d'une façon si soudaine et si décisive ? Lorsque se produisit la déclaration de guerre, M. Paul Paray ne comptait encore que parmi les aspirants du personnel musical et non parmi les militants. Né au Tréport le 24 mai 1886, et par conséquent de huit ans le cadet de Caplet, c'est en 1905 seulement qu'il se présenta au Conservatoire et fut jugé « Dignus intrare ». Fils d'un brave hôtelier tréportais, fort doué pour la musique et qui tenait volontiers l'orgue à l'église du lieu, Paul Paray reçut l'enseignement officiel de Xavier Leroux et de Caussade, obtenant avec l'un le 1er d'harmonie en 1908, avec l'autre un 2e prix de contrepoint en 1910.
Mais il dut une bonne partie de sa culture musicale à l'éminent organiste Dallier, qui avait naguère encouragé sa famille à lui laisser suivre sa voie.
L'année qui suivit son dernier concours, le jeune Paul Paray s'adjugeait les plus hautes récompenses, c'est-à-dire le Premier Grand Prix de Rome. Il accomplit sans austérité son séjour à la Villa Médicis, puis, aux abords de l'été 1914, vint passer un congé en France. Mais ce n'est pas le chemin de la douce Italie qu'il reprit. Un exil d'un tout autre genre allait lui être imposé bientôt. Fait prisonnier presque au début de la guerre, il ne fut rapatrié qu'en 1918 avec une santé fort ébranlée. Dès l'année suivante, en 1919, sa véritable carrière, celle de chef d'orchestre, va se dessiner d'une manière assez miraculeuse. Paray répugne à entreprendre des choses à l'aveuglette, ce qui lui fait honneur. Talonné par des amis, il finit cependant par accepter à contre-cœur la direction de quelques musiciens dans un petit casino des Pyrénées. Il fallait bien vivre et même se refaire après tant d'atroces privations ! Car Paray — autre noble trait de son caractère — n'avait voulu accepter de ses geôliers d'Outre-Rhin aucune grâce, voire aucun traitement privilégié. Par un hasard extraordinaire, l'un des collaborateurs de Camille Chevillard se trouvait parmi les musiciens dudit casino alors que l'association Lamoureux, insatisfaite des essais qu'elle avait tentés pour se donner un chef-adjoint, désespérait de dénicher l'oiseau rare. On signale incontinent le débutant au président. Il n'avait en vérité jamais conduit et sa tâche estivale n'était pas des plus malaisées. Mais, de suite, le chef d'orchestre de race se découvrait en lui aux jeux surpris de ses sujets. Musicalité, mémoire, élégance, précision, décision, instinct de commandement, toutes ces qualités, il en développa tout aussitôt le germe. Peu après son retour à Paris, on voulut convaincre Paray de la nécessité d'une rencontre avec Chevillard. Peine perdue tout d'abord ! De guerre lasse, il se laissa finalement fléchir et écrivit à peu près en ces termes, avec respect, au président illustre des Concerts Lamoureux, surchargé par ses nouvelles et pénibles fonctions de l'Opéra : « Maître, on me pousse à vous demander audience, je ne sais dans quel étrange but. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour vous et serais heureux de vous approcher quelques instants. Nous parlerons de musique et de Schumann, que nous aimons tous d'eux d'une égale ferveur. Puis, la conversation pourra se poursuivre sur le beau sport du tennis que nous pratiquons l'un et l'autre... » Paray vit Chevillard et il se plurent immédiatement. A l'issue de l'entretien, je crois que Chevillard confia à la fille de Lamoureux, sa femme et digne associée : « J'espère que tu seras contente : je pense avoir enfin trouvé un collaborateur, et peut-être aussi un successeur ». Toute l'histoire de Paray tient, jusqu'ici, dans ces mystérieuses coïncidences.

Paul Paray (photo Martin)
Paray dirigea pour la première fois, rue de la Boétie, le 29 février 1920. On sait que son coup d'essai fut un coup de maître. Son exceptionnelle autorité s'imposa d'une façon fulgurante. A partir de ce moment, Paul Paray alterna au pupitre avec Chevillard. La situation prépondérante qu'il occupa dès lors virtuellement, son élection en 1923, comme successeur de son maître, bienfaiteur et ami, la consolida définitivement.
Parvenu à la troisième année de sa présidence, M. Paul Paray en est encore à cette période idyllique et prometteuse dans laquelle un chef a pleins pouvoirs pour travailler à la réalisation de grandes choses que l'on attend de lui. Il n'est pas douteux que celui-ci soit apparu de prime abord comme éminemment digne de l'héritage des Lamoureux et des Chevillard. Il a, désormais, le prestige nécessaire et il a su, au surplus, se pénétrer adroitement de l'esprit particulier qui présida toujours à l'effort de la célèbre association. Peut-être même a-t-il trop jalousement recueilli ses traditions. Avec prudence il semble, en effet, s'être surtout attaché jusqu'ici à maintenir les portes de l'auguste Maison soigneusement fermées sur la quiète et douillette atmosphère du passé.
En face des divergences d'opinion qui se manifestent à cet égard, n'est-ce pas le moment de nous demander, d'une manière générale, quelle doit être la politique de nos grandes associations symphoniques ? le privilège d'engager des batailles hasardeuses pour le triomphe éventuel des idées, des systèmes, des doctrines et des œuvres de demain, ces grandes associations peuvent-elles l'abandonner presque exclusivement à des groupements fortuits, souvent éphémères, ne disposant en tous cas ni de leurs ressources, ni de leur prestige, ni de leur stabilité ? Sied-il qu'elles abdiquent cette auguste prérogative aux mains de recruteurs isolés, néophytes parfois plus ardents qu'instruits, plus généreux qu'expérimentés, plus exaltés que perspicaces, ou plus sectaires que lucides, plus personnels qu'altruistes, plus tapageurs qu'éclatants et, par conséquent, plus redoutables qu'opportuns dans l'une quelconque de ces multiples hypothèses ?
Nos grandes institutions agiront avec sagesse en ne risquant pas des aventures trop téméraires, qui détourneraient leurs fidèles et compromettraient par là-même leur équilibre financier, déjà mal assuré. Mais, sans se livrer à des expériences acrobatiques, elles ne se déroberont pas aux suggestions de l'actualité musicale, française ou étrangère. Victorieuses des tournois de jadis, si elles s'assoupissaient sur le lit de leurs lauriers d'antan, d'ailleurs parfois chèrement acquis, mais, il semble, quelque peu fanés, les éléments sportifs de leur clientèle rechercheraient des stades plus vibrants. Les dilettantes, enclins par nature à la curiosité, iraient quérir autre part le piment que réclame leur palais de gourmets, et la soif des générations montantes s'étancherait vraisemblablement à des sources plus fraîches et moins industrialisées.
Au reste, toute routine porte en soi un microbe mortel. Les maisons durablement prospères sont celles qui sèment constamment en vue des récoltes futures. Faute de prendre cette élémentaire précaution, et de renouveler leurs étalages au gré des évolutions inéluctables accomplies par la convoitise des chalands, les firmes les mieux établies périssent sous l'amas de leurs stocks démonétisés.
Et puis, ne faut-il pas s'inquiéter aussi de l'instruction méthodique, rationnelle et progressive des masses ? Or cette éducation là, telle que nous la définissons en trois mots, les grandes institutions sont presque seules à pouvoir l'entreprendre et la poursuivre avec le maximum de sécurité et de rendement, avec le minimum d'inconvénients et d'aléas. Les programmes analytiques, imaginés par un Edouard Colonne, rendirent à ce propos de signalés services. La création, plus récente, d'un organe explicatif, comme le Guide du Concert, puis à son exemple, la Semaine musicale, fut le fruit d'une heureuse et judicieuse inspiration. Le public n'y trouve pas seul son profit, mais aussi le critique chargé censément de l'éclairer. Ces publications évitent bien des malentendus. Car, sans le secours de certains renseignements sur la genèse et l'esprit d'une production, son plan général, son but, sur l'essence, les tendances, la conduite et la progression des idées, sur l'esthétique de l'artiste considéré, ses antécédents, son passé, son tempérament, son style, ses ressources, l'auditoire et ses pâtres s'engagent ordinairement à contre-sens ; et, lorsqu'ils vont les uns et les autres jusqu'à conclure, leurs déductions s'orientent au rebours de la raison.
Contre de si fâcheuses méprises, il sied de garantir l'opinion et de lui fournir des armes. Tous les moyens seront donc bons pour entourer les œuvres de toutes les explications désirables et les placer sous une lumière crue. Si l'on parvenait à répandre, verbalement et par toutes sortes d'écrits, d'utiles commentaires à foison, les grandes associations comme les théâtres lyriques eux-mêmes n'éprouveraient sans doute pas autant de déboires quand ils essayent de renouveler leur répertoire.
Nous estimons en résumé que les dirigeants de nos principales institutions musicales ont une triple mission : conservateurs tout désignés des choses du passé musical, ils se doivent assurément, et tout d'abord, à l'impeccable exécution des chefs-d'œuvre classés ainsi qu'à l'incessant rappel des belles pages oubliées. Leur tâche ne s'arrête pourtant pas là. Les foules ne pouvant guère être touchées largement, régulièrement et efficacement que par eux, ils ne sauraient, sans faillir gravement, renoncer à leurs fonctions quasi officielles d'éducateurs. Enfin, comme ils exercent une sorte de monopole de fait, il faut bien qu'au jour le jour, ils suivent attentivement les travaux des compositeurs actuels ; sans quoi le destin des musiciens de notre temps se dénouerait implacable, ment dans le néant des limbes. En effet, par suite de l'énorme augmentation du prix des concerts d'orchestre, les sociétés de prospection et d'exploration musicales comme la vieille Société nationale et sa cadette la Société musicale indépendante (S. M. I.) n'ont plus, au moins momentanément, la possibilité de divulguer les œuvres qui exigent un large déploiement de personnel concertant. Jadis, celles-ci se partageaient la besogne avec les grandes associations symphoniques. Par force majeure, elles se confinent maintenant sur un terrain beaucoup plus exigu. Nécessité n'a pas de loi ! Mais qui recueillera cette lourde et glorieuse partie de leur succession si les instrumentistes associés se dérobent à leur tour ?
Les grandes associations doivent avoir, pour la musique, un rôle à peu près identique à celui de l'administration des musées pour les arts plastiques. Mais ce n'est pas du Louvre ou de telles collections rétrospectives qu'elles s'inspireront toutes à l'envi. Leurs modèles, elles les trouveront dans ces pinacothèques éclectiques où voisinent des spécimens judicieusement assemblés de l'art ancien, moderne et contemporain. A cause de leur puissant ascendant, il importe seulement qu'elles n'outrepassent point les limites de la sagesse et du bon ton. Nulle crainte à ce sujet : leurs présidents chefs d'orchestre ne manquent ni de jugement ni de pondération. Du reste, le système électoral qui porte ceux-ci désormais au pouvoir serait déjà suffisant pour exclure, de leur part, d'outrancières fantaisies. A cet égard, la règle est excellente puisque l'action de ces arbitres doit pouvoir éventuellement servir de contrepoids à tout ce qui serait susceptible d'offenser le goût et de menacer notre civilisation artistique.
Quant aux troupes de couverture, aux patrouilles et aux flancs-gardes, indispensable protection du gros des forces musicales de la nation, et sans cesse alertées, ces généraux d'armée en laisseront le commandement à des volontaires individuellement persuadés de la beauté, de la nécessité de leur probable sacrifice, et, au besoin à des risque-tout dont la menace d'aucun péril ne saurait intimider l'aventureuse et hardie progression.
Parmi ces éclaireurs se trouve un Félix Delgrange, né à Paris le 6 juin 1885, élève de Pessart pour l'harmonie, lauréat du conservatoire pour le solfège (1re médaille) en 1900 et en 1906, pour le violoncelle (2e prix). A un moment psychologique de l'histoire musicale, Delgrange prodigua des efforts convaincus. tenaces et très noblement désintéressés pour acclimater dans nos pépinières les greffes les plus rebelles. Luttant par le verbe et par la plume, bataillant à coups de manifestes incendiaires, il sut communiquer sa flamme à quelques escouades d'interprètes dévoués qu'il résolut un jour de mener en personne au combat. Ses campagnes devaient aboutir notamment aux toutes premières victoires d'une demi-douzaine de jeunes fauves qui provoquaient alors solidairement de mémorables émeutes. Dans ces bagarres, il y eut pour Delgrange maints mauvais coups à recevoir et fort peu de profits matériels à glaner. Mais, au cours de ces expéditions, le groupe dit « des six » et d'autres musiciens avaient trouvé un utile tremplin.
C'est vers la fin de la guerre, au foyer franco-belge, que Delgrange appliqua ses desseins. Un peu plus tard, Delgrange émigra salle Huyghens, mal éclairée, mal chauffée, bref, inconfortable au possible. Les murs en étaient couverts d'expositions de tableaux quelconques, souvent cubistes. Le public, assez assidu malgré tout, s'égrenait sur des chaises de fer où voisinaient princesses et « montparnos ». Le snobisme n'attendait même pas l'armistice pour renaître. Dans ce cadre extraordinaire, Delgrange parvint à disposer de solistes éprouvés, et d'une sorte d'orchestre di camera au milieu duquel Darius Milhaud tint une partie d'alto. Les bénéficiaires de ces concerts furent d'abord, en outre de D. Milhaud, Erik Satie, Georges Auric, Durey et Mlle Tailleferre, puis Francis Poulenc et Arthur Honegger. De ce dernier, on joua le 19 octobre 1918 une Sonate pour piano et violon, et le 3 avril 1919 sa Berceuse. Roland-Manuel, alors à ses débuts, apparut avec son Hommage à La Fontaine, Hommage funèbre, Clarisse ou l'hommage indiscret exécutés au piano par Ricardo Viñes. Parmi les compositeurs étrangers, voici que surgissent coup sur coup Pizzetti, Respighi, Malipiero, Prokofiev ; de Falla et Scriabine, encore peu connus chez nous, s'ajoutent à cette première liste. Enfin, au cours de trois saisons salle Gaveau, Félix Delgrange donna nombre d'œuvres marquantes en première audition. De Stravinski, il révéla l'Histoire du soldat, Rag Time, trois pièces pour quatuor à cordes, la sonate pour clarinette solo, les Berceuses du Chat et les Pribaoutki chantées par M. Pierre Bertin, l'actuel pensionnaire de la Comédie-Française, excellent musicien ainsi qu'on sait. Darius Milhaud accélère le rythme de ses créations et donne chez Delgrange ses 2e et 4e quatuors, Printemps et Pastorale pour divers instruments et, pour grand orchestre avec chœurs, ses Choéphores ; Auric présente Chandelles romaines et Kœchlin son chant funèbre à la mémoire des jeunes femmes pour chœurs et orchestre (1920), la nuit de Walpurgis classique. Cette nomenclature indique avec quelle fougue et quelle persistance Delgrange appliqua le plan réfléchi et chevaleresque qu'il s'était tracé ; elle caractérise aussi la nature d'une intervention singulière et digne de remarque.
D'autres que ce violoncelliste, mué maintenant en impresario, valent d'être cités à cause d'exploits du même genre, sinon semblables. Que justice soit rendue à tous ceux qui servirent, en marge des concerts classés, la cause de la musique : à Francis Casadesus, fondateur et président de l'orchestre de Paris et à Georges de Lausnay, son collaborateur attitré ; à Paul Oberdorffer, créateur des concerts symphoniques portant son nom ; à Pierre Montpellier, chef d'orchestre autant que pianiste ; à Robert Siohan et à Loicq qui tenta de ressusciter en 1923, salle Gaveau, les fameux Concerts Rouge ; à E.-C. Grassi, élève de Vincent d'Indy, de Bourgault-Ducoudray, et grand connaisseur en folklore siamois ; enfin au pianiste Lucien Wurmser. Celui-ci fut tour à tour fondateur et directeur des Concerts Classiques de Troyes en 1908, vice-président et chef d'orchestre de l'association des Concerts Hasselmans (1913-1914), fondateur et directeur de l'orchestre philharmonique de Paris. Il s'est fait l'ardent défenseur de la musique française en Europe et même sur le nouveau continent puisque, en juillet 1920, il accomplit, comme chef d'orchestre du Théâtre national de l'Odéon, une tournée en Amérique du Sud avec la troupe de ce théâtre. En 1920-1921, il dirigea les représentations de la Chauve-Souris à Femina et, en août suivant, celles du théâtre Eugénia-Vittoria à Saint-Sébastien. Au mois de septembre de la même année, il conduisait 40 représentations au Pavillon-Théâtre et à l'Apollo-Théâtre de Londres. En 1922, Lucien Wurmser fonda l'association des grandes auditions avec orchestre et chœurs. Cette vaste tentative dans le non moins vaste hippodrome Gaumont, n'eut, en raison de son ampleur même, qu'une très courte durée.
N'ayons garde d'oublier ici des chefs d'orchestre étrangers comme Serge Koussevitzky, qui, retenus chez nous, au moins momentanément, par des liens quelconques, ouvrirent de larges avenues bien aérées dans notre vieille cité musicale. Il n'est pas de talent qui soit ici plus populaire aujourd'hui que celui de cet exceptionnel animateur, entraîneur irrésistible, si compréhensible par surcroît à la jeune production française, si accueillant pour elle, si proche enfin de nos compositeurs modernes en dépit de sa lointaine nationalité. Soit comme directeur des représentations de Boris Godounov à l'Opéra soit, dans le même cadre, comme conducteur de ses propres concerts symphoniques, Serge Koussevitzky a marqué profondément sa trace sur notre sol.
Mais, pour renouer la filière de ces pionniers isolés, il faut remonter un peu en arrière. Quelques-uns, comme Pierre Monteux, ont pu recevoir la récompense de leurs efforts. Après avoir conquis ses premiers grades comme alto-solo des Concerts Colonne (1890) et de l'orchestre de l'Opéra-Comique, il met en évidence sa fine et sûre musicalité au milieu du célèbre quatuor Geloso (1894-1911). Chez Colonne, il devient second chef et chef des chœurs, fonde les Concerts Berlioz et dirige, de 1908 à 1914, l'orchestre du Casino de Dieppe. Aux approches de la guerre s'organisent les Concerts Monteux, qui font aussitôt sensation et fonctionnent avec éclat. Aussi exceptionnel qu'il soit, leur succès ne suffit pourtant pas à en assurer la réussite matérielle. Tâche ingrate et périlleuse entre toutes — ne l'avons-nous pas déjà dit et répété ? — que celle d'apprivoiser la foule. Car Monteux ne songe pas à flatter les tendances de la multitude ; il s'essaye plutôt à éclairer son goût et à détruire ses préjugés. Formé au Conservatoire, disciple de Garcin et de Berthelier, dans la classe duquel il obtint un 1er prix de violon, de Lavignac (harmonie) de Lenepveu (contrepoint et fugue), sa formation scolaire ne troubla point sa naturelle inclination vers un art évolué. Dès qu'il se sera saisi de la baguette, il s'efforcera de la mettre au service des principaux représentant de la musique contemporaine, depuis les aïeux immédiats, Berlioz, Franck, Chausson, Lalo, Saint-Saëns jusqu'à leurs petits-fils, Paul Dukas, Roussel, Schmitt, Ravel, Roger-Ducasse, etc... Quoique n'ayant ni le caractère ni les allures d'un fier-à-bras, Pierre Monteux ne craignit pas de s'exposer en reprenant, au concert, le Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky peu de temps après le vacarme déchaîné par l'apparition de cet ouvrage sur la scène. La défense des compositeurs modernes et notamment des musiciens français, Pierre Monteux eut le rare mérite de ne pas l'avoir prise seulement en France, à grands risques d'ailleurs, mais de s'être aussi employé très activement en sa faveur auprès des étrangers. A Paris, avec les Ballets Russes, on l'avait déjà vu diriger au Châtelet Daphnis et Chloé de Ravel et Petrouchka de Stravinsky, au théâtre des Champs-Élysées, Jeux de Debussy et le Sacre du Printemps, à l'Opéra le Rossignol. Ses tournées furent non moins appréciables. M. de Diaghilev et sa compagnie lui fournirent l'occasion de poursuivre au dehors sa tactique favorite. D'autre part, à peine revenu des tranchées du front franco-allemand, il compléta de 1917 à 1919 ses états de services militaires par une brillante campagne au Metropolitan Opera de New York où il remplit, à la satisfaction générale, les fonctions de 1er chef d'orchestre pour les ouvrages français. En 1920, il est placé à la tête du Boston Symphony-Orchestra. Il en conserve la direction jusqu'en 1924 pour céder celle-ci à Serge Koussewitzky. Son laborieux ministère s'employa dans la patrie de Franklin au mieux de nos intérêts nationaux. Parmi des éléments de toutes nationalités et souvent hostiles, incessamment en butte à toutes sortes d'intrigues, Pierre Monteux qui possède des qualités de manœuvrier, a su durant un séjour à Boston s'imposer à la fois comme musicien, comme chef et comme homme.
Pour un artiste relativement avancé, suffisamment personnel et assez intransigeant sur les principes directeurs de sa carrière, ce seul fait d'avoir su, d'avoir pu se maintenir au-delà du terme annuel, d'ordinaire fixé pour cette mission essentiellement temporaire et révocable, prouve avec quelle fermeté Pierre Monteux s'était imposé sur le nouveau continent. Aussi semble-t-il d'autant plus fâcheux que, condamné depuis plusieurs années — depuis son retour — à une irritante inaction, on n'utilise, ni à l'intérieur, ni au dehors, ses insignes capacités.
A l'époque des Concerts Berlioz, Pierre Séchiari fut un instant son émule. Mais, jusqu'ici, les circonstances n'ont pourtant pas permis à ce dernier d'atteindre à une égale réputation. De deux ans plus jeune que Monteux, violoniste comme lui, Pierre Séchiari est né à Paris le 29 septembre 1877. Au Conservatoire, il passe par les classes d'Alkan, d'Adrien Bérou, de Maudrin et se trouve dans celle de Berthelier en même temps que Monteux. La fraternelle rivalité qui faillit opposer fortuitement les deux condisciples remonte à cette année 1896 où ils obtinrent ensemble un 1er prix de violon après s'être l'un et l'autre escrimés sur le 29e concerto de Viotti. L'année même de son prix Séchiari fonda un quatuor sous son nom. Les séances de cet ensemble instrumental se poursuivirent pendant huit ans et feront place en 1904 aux auditions du Double quintette de Paris. Premier violon solo des Concerts Lamoureux de 1896 à 1906, il scelle à cette dernière date l'association des Concerts Séchiari qui tiendra successivement ses assises à la salle Gaveau et au théâtre Marigny. Chancelante à ses débuts, couronnée d'un succès matériel parfois médiocre, cette entreprise subsistera finalement jusqu'à la guerre, en 1914. Pendant ses huit années d'existence, l'association des Concerts Séchiari aura donné 90 séances et présenté plus de 100 ouvrages en première audition. Depuis 1910, et également jusqu'en 1914, M. Pierre Séchiari dirigea aussi les Concerts Populaires de Lille. A l'étranger, il conduisit par la suite l'orchestre des Concerts Populaires de Bruxelles, les Concerts d'abonnement de Genève, l'orchestre symphonique de Dortmund, l'orchestre du Kurhaus de Wiesbaden. Directeur de la musique au Casino de Vichy en 1921, Pierre Séchiari fut aussi jusqu'en 1926 chef d'orchestre des Concerts Classiques de Marseille.
Parmi la génération suivante se rencontrent quelques jeunes hommes, dont la carrière est à peine entamée : ce sont les pianistes Armand Ferté (Paris, 22 octobre 1881), Georges d'Humières, dit de Lausnay (Paris, 15 mars 1882), Henri Morain (Grenoble, 6 août 1883), Paul-Gaston Lévy (Paris, 10 mai 1890) et le benjamin de cette fournée, Wladimir Golschmann (Paris, 16 décembre 1893).
Elève de Xavier Leroux, de Duparc et de Diémer, dans la classe duquel il remporte, avant 17 ans, un premier prix de piano en 1897, Armand Ferté a occupé deux postes qui le mirent en vue : ma propre mobilisation lui permit d'exercer, pendant et après la guerre, les fonctions de directeur de la musique et chef d'orchestre au théâtre national de l'Odéon. Successeur de Pierre Monteux, il est en outre 1er chef d'orchestre au Casino de Dieppe. Nous aurons à parler surtout de lui dans le chapitre des pianistes.
Logé à la même enseigne, Georges de Lausnay peut cependant revendiquer, en tant que chef d'orchestre, un très appréciable titre de gloire : celui d'avoir été avec Francis Casadesus le fondateur de cet Orchestre de Paris qui, la saison dernière encore, constituait, en marge des grandes associations symphoniques, un studieux et utile groupement.
Le grenoblois Henri Morin a fait tout jeune un long séjour aux Etats-Unis où son père était chef d'orchestre. Il a travaillé ensuite à Berlin avec le violoncelliste Antony Hekking. Après ces prémices internationales il devient un instant l'élève de Vincent d'Indy, puis va se perfectionner à l'école de Leipzig où il obtient un diplôme. Admis par faveur à assister aux répétitions d'orchestre d'Arthur Nikisch, il eut, en tous cas, toute latitude de se pénétrer au Gewandhaus de cet exemple magistral. Il termine enfin ses études de contrepoint et fugue avec Hugo Riemann. En 1910 et 1911, il assiste Otto Lohse à l'Opéra de Cologne en qualité de chef-adjoint. Contrairement à la plupart de ses confrères français, ce n'est qu'après avoir fait ses premières armes à l'étranger, qu'il prend position sur le sol natal. Il devient alors directeur de l'association Nantaise des Grands Concerts. Il collabore à la fondation dans cette ville de la Schola Cantorum. De 1911 à 1919 il dirigera plus de 40 concerts, échantillonnant ses programmes selon une formule qui, tout en portant la marque distinctive de sa formation classico-allemande, ne le montre nullement hostile aux œuvres françaises ou latines ainsi qu'aux ouvrages contemporains. Il joue notamment les Béatitudes, Rédemption, Rébecca, la Damnation de Faust, Hippolyte et Aricie, l'Orfeo de Monteverdi, Roméo et Juliette de Berlioz, la Symphonie fantastique, le Camp de Wallenstein, l'Après-midi d'un Faune, la Péri, la Pavane de Ravel, le Palais hanté de Florent Schmitt, des pages de Rimski-Korsakov, de Borodine, de Moussorgski, et aussi les symphonies de Beethoven, le Christ au Mont des Oliviers, Mozart, Haydn, Schumann, Brahms, des fragments de la Tétralogie, de Parsifal, etc... En 1913 et 1914, il donne des concerts d'orchestre à Paris. En février 1920, commence à la salle Gaveau une série de manifestations qu'il interrompt pour aller diriger, en Italie, les Ballets Russes. M. Henri Morin fut aussi l'un des chefs du Grand Théâtre de Lyon. Il a accompli ces dernières années d'importantes tournées à l'étranger. C'est lui qui dirigea, en 1920, la première représentation de Chemineau à Chicago. Ses voyages de 1921 et de 1923 en Roumanie eurent un certain retentissement et suscitèrent quelques polémiques. Doué d'une forte volonté, soucieux de s'imposer, discuté par les uns, loué par les autres, il nous semblerait prématuré de lui assigner dès maintenant une place déterminée dans la galerie de nos jeunes chefs d'orchestre.
Tout au contraire de M. Morin, c'est une éducation purement française qu'a reçue M. Paul-Gaston Lévy avec Lavignac, Xavier Leroux, Caussade, Maurice Emmanuel, Widor et d'Indy. Au Conservatoire, il eut un 1er prix d'harmonie décerné à l'unanimité en 1916 et le prix Nicodémi. Fort peu de temps après sa sortie des classes, il a dirigé des festivals consacrés à Chabrier, Chausson et Magnard. Il eut l'occasion de conduire l'orchestre Lamoureux en 1920. Il a enfin constitué l'association des Concerts Paul Lévy qui donna en novembre et décembre 1921 et janvier 1922, au théâtre des Arts, une série d'auditions sous le titre d' « Exposition de musique classique et moderne » — appellation justifiée par ce fait qu'à côté de pages contemporaines voisinaient des œuvres françaises du XVIIIe siècle.

Wladimir Golschmann
M. Wladimir Golschmann, d'origine russe, est français de nationalité. Il a poursuivi le cycle de ses larges études avec Paul Braud pour le piano, Berthelier pour le violon, Caussade et Albert Bertelin pour l'harmonie et le contrepoint. Depuis 1909, il a été violoniste des orchestres Séchiari, des concerts Rouge et Touche et de la Société des Concerts. De 1919 date la fondation des Concerts Golschmann qui ont donné, cette année-là, 10 séances à la salle des Agriculteurs et 7 en 1920 à la salle Gaveau. Il a dirigé au théâtre des Champs-Elysées des représentations de la Loïe Fuller, des séances de danse de Mme Anna Pavlova, et, en 1920, la saison des Ballets russes avec la troupe desquels il se rendit ensuite aux Etats-Unis. M. Golschmann est, nous l'avons dit, sinon un débutant, du moins l'un de nos capellmeister les moins âgés, et l'un de ceux à qui l'avenir pourrait à l'occasion sourire. Au pupitre, il porte beau et agit avec décision. Mince, souple et élégant, il a grand air. L'audace musicale ne lui manque pas; il joue volontiers Schoenberg, Tansman, les « Six » (qui ne sont plus que cinq) et tous compositeurs de cette catégorie. Il bataille même d'aventure autrement qu'avec la baguette ; on garde le souvenir de certaine séance des Concerts Pasdeloup où une œuvre ultra-moderne motiva de sa part une défense mouvementée, conjointement avec une belliqueuse démonstration du moins bouillant Florent Schmitt.
***
Si, après cette incursion dans le domaine des initiatives individuelles et des efforts isolés, nous reprenons, au point où nous l'avons laissée, l'histoire des associations officielles, nous trouvons en M. Philippe Gaubert un musicien qui, à l'exemple de son illustre maître et prédécesseur Paul Taffanel, doit figurer dans plusieurs chapitres de cette étude. La carrière de Gaubert offre d'ailleurs, dans sa progression et ses aspects divers, une curieuse symétrie avec celle de Taffanel. Le professeur et l'élève ont occupé les mêmes postes ; et ils se sont fait l'un et l'autre, à un quart de siècle de distance, une célébrité égale comme virtuoses de la flûte, professeurs, et comme chefs d'orchestre.
Philippe Gaubert est né le 14 juillet 1879 à Cahors. Très jeune il força les portes du Conservatoire de Paris. Après avoir été l'élève préféré de Taffanel, il reçut l'enseignement de Xavier Leroux, Caussade et Lenepveu. Muni d'un 1er prix de flûte en 1894, il remporta par la suite un 1er prix de contrepoint et de fugue et obtint en 1905 le second Grand Prix de Rome pour sa cantate Maïa. Ses débuts d'exécutant d'orchestre s'étaient produits dès 1897, date à partir de laquelle il siégea dans la fosse de l'Opéra. Sept ans plus tard, en 1904, avant son concours de Rome par conséquent, il recevait son premier bâton de commandement à la Société des Concerts où, après épreuve, il était bombardé second chef. En 1909, il succédait au Casino de Vichy à Georges Marty, son « premier ». Ces étapes successives et fort rapides, au cours desquelles l'autorité de Philippe Gaubert s'aiguisait, le conduisirent à l'Opéra. En 1913, il entrait, avec MM. Büsser et Gabriel Grovlez, dans le peloton conduit par Camille Chevillard. Les fonctions de 1er chef qu'il occupe actuellement lui furent dévolues en 1920. Depuis cette époque, Philippe Gaubert a pris dans le Palais Garnier une place que l'on peut dire prépondérante. Il y a monté les Troyens, la Péri, Daphnis et Chloé, l'Heure espagnole, Padmavati, la Fille de Roland. En 1924, sa tournée en Suisse a été l'occasion d'une importante démonstration de musique française. Ce n'était pas comme 1er chef à l'Opéra que Philippe Gaubert franchissait la frontière, mais avec la Société des Concerts, à la tête de laquelle il se trouvait depuis 1919. Cette même année, le décès d'Hennebains lui permettait d'entrer, à 40 ans, comme professeur de flûte au Conservatoire. Ses disciples sont légion et quelques-uns d'entre eux arrivent aux portes de la célébrité. Philippe Gaubert était donc dès lors l'un de nos musiciens les plus en vue, et aussi l'un des plus officiels, puisqu'il cumulait déjà les fonctions de professeur au Conservatoire National, de premier chef président de la Société des Concerts et de premier chef à l'Opéra, collaborateur musical le plus immédiat de M. Rouché, le poste de directeur de la musique ayant été supprimé depuis la disparition de Camille Chevillard.

Philippe Gaubert (photo Sabourin)
A la Société, Gaubert servit très utilement la cause de la production moderne française. Tout en maintenant jalousement les traditions classiques de la vieille Association, il a su réserver et imposer dans ses programmes une place équitable aux grands musiciens contemporains : Fauré, Debussy, Dukas, Florent Schmitt, Maurice Ravel et à maint autre. Il n'a même pas craint d'introduire dans la vénérable enceinte de l'ancien Conservatoire des représentants de la jeune école révolutionnaire russe, et pourrait-on dire, actuellement encore des fauves, comme Serge Prokofiev. M. Philippe Gaubert a maintenant pour adjoint M. André Tracol, qui dirigea, pour la première fois, le concert du 22 janvier 1922 ou des quatre 2. Ce poste de second chef est un enviable tremplin où l'on essaye volontiers les « présomptifs ». Il fut souvent occupé par ceux qui devaient plus tard régner souverainement sur la compagnie. Tel fut le cas de Philippe Gaubert qui s'était installé depuis quinze ans lorsque, en 1919, André Messager lui abandonna le sceptre.
André Messager précéda immédiatement Philippe Gaubert sur le trône d'Habeneck. Il peut donc sembler paradoxal de ne le faire intervenir ici qu'en second lieu. Mais il est parfois nécessaire d'intervertir l'ordre chronologique et de paraître marcher à reculons afin de restituer à chaque personnalité ses traits caractéristiques et de la situer dans son ambiance propre. M. André Messager, homme toujours d'actualité depuis près d'un demi-siècle, a joué et joue encore un rôle assez rare dans l'histoire de l'art. Ce n'est pas sa qualité de chef d'orchestre qui lui ouvrit l'accès des situations officielles et elle n'attira pas non plus l'attention sur son œuvre de compositeur. Messager n'apparaît pas comme un manieur de baguette venu à la musique. C'est un musicien né, complet, que de nobles et multiples capacités ont élevé sans heurt au rang des chefs d'orchestre de première grandeur.
André Messager naquit à Montluçon le 30 décembre 1853. Il fit ses études musicales à l'école Niedermeyer et fut, notamment, élève de Laussel (piano), Lauret (orgue), Gigout (contrepoint) et l'un des seuls disciples de Saint-Saëns avec Gabriel Fauré. Dès l'enfance, des liens d'amitié tendre le lièrent à ce dernier. Et aucun nuage ne put s'étendre entre eux au cours de leurs longues carrières. Issu de cette institution de musique religieuse, le futur maître de l'opérette et, peut-on dire, le continuateur des créateurs de l'Opéra-Comique français, occupa diverses fonctions dans les lieux du culte. L'école Niedermeyer a exercé une très forte influence sur la formation d'une catégorie d'interprètes. M. André Messager, dans une allocution prononcée au Conservatoire, en présence de Fauré lors du jubilé de l'éminent organiste Eugène Gigout, a donné de cet établissement la pittoresque description suivante :
« Il y a une cinquantaine d'années, lorsque l'on pénétrait dans cette bizarre petite rue dénommée passage de l'Élysée-des-Beaux-Arts, l'oreille était frappée par un bruit sourd et continu ressemblant à celui d'un moulin à foulons ou d'une forge lointaine. On ne pouvait se rendre compte de ce bruit singulier qu'en entrant dans une maison portant sur une plaque cette inscription : Ecole de Musique religieuse, et en arrivant dans une salle assez vaste où une vingtaine de pianos rangés à se toucher le long des murs étaient actionnés du matin au soir par quarante ou cinquante jeunes gens qui les jouaient à tour de rôle. C'était la salle d'études de l'établissement et, au milieu de ce fracas incessant, nous devions faire nos devoirs d'harmonie, de fugue et même de composition. Je dois dire qu'on s'habituait assez vite à cette cacophonie et qu'on s'isolait presque mieux que dans le silence ».
Après avoir studieusement et intelligemment travaillé dans ce « recueillement », André Messager devint organiste du chœur à Saint-Sulpice en 1874, puis organiste à Saint-Paul et enfin maître de chapelle à Sainte-Marie des Batignolles. Entre temps, il s'était essayé comme chef d'orchestre à Bruxelles. D'autre part, en 1876, il s'était classé comme compositeur en obtenant, avec une symphonie — exécutée en 1878 chez Colonne — le prix de la Société des compositeurs français. A la fin du siècle dernier, de 1898 à 1903, il se trouve associé à la période la plus glorieuse de la première direction Albert Carré à l'Opéra-Comique. Après avoir bu à la source des plus sédatives traditions, portant d'autre part en lui la ferveur du wagnérisme, le grand, l'immense, l'insigne honneur d'André Messager sera d'avoir prévu, facilité et comme accompagné l'avènement d'une nouvelle ère musicale dont l'aube rayonnante se leva sur l'Ile-de-France en 1900. Alors directeur de la musique à l'Opéra-Comique, il monte Louise, exploit des plus méritoires pour l'époque. Peu après, il découvre Pelléas et Mélisande, patronne le chef-d'œuvre, l'entoure de piété et d'amour et, malgré l'énormité et le péril de cette tâche singulière, le révèle au public. Ce haut fait, seul, suffirait à auréoler une carrière artistique. C'est que l'esprit de Messager, perpétuellement en éveil, possède une étonnante lucidité et une clairvoyance sans pareille. Il approche juvénilement de ses soixante-seize ans et son oreille conserve une finesse miraculeuse. Son regard perçant découvre immédiatement les moindres détails d'une production nouvelle, aussi hardie qu'elle soit. Compositeur spécialisé de longue date dans la musique légère, il saisit d'emblée ce qui, sous les formes les plus diverses, est à peine perceptible pour quiconque. En réalité, Messager n'a jamais su ce qu'était vieillir, et peut-être reste-t-il le plus jeune de tous nos critiques : il le prouve encore chaque jour et par la parole, et par la plume et par le geste. Du haut de sa tribune du Figaro, il commande en quelque sorte tous les défilés de la stratégie musicale moderne. Dans tous les genres, en tous temps, en tous lieux, sa consultation prend valeur d'oracle. Il a d'ailleurs tout vu, tout entendu, tout retenu. Sa mémoire est peut-être la plus fertile en souvenirs ; et sa conversation est en même temps un charme et un enseignement. Messager connaît maints pays étranger, et il a pénétré leurs secrets. Après avoir — de 1901 à 1907 — présidé aux destinées du fameux théâtre du Covent-Garden à Londres, André Messager, associé à M. Broussan, hérite en 1906 le fauteuil directorial de Pedro Gailhard à l'Opéra de Paris. Nouveau paradoxe dans l'existence de Messager : sa co-direction, accomplie d'ailleurs dans des conditions matérielles difficiles et souvent défectueuses, ne sera témoin, sur la scène de notre premier théâtre lyrique, d'aucune création mémorable — sauf celle de Scemo d'Alfred Bachelet. Par contre, de magnifiques exécutions wagnériennes, à l'occasion desquelles le directeur prend lui-même la baguette, attestent et son autorité et sa profonde connaissance de l'œuvre du titan germanique, laquelle se situe pourtant aux antipodes de la sienne propre. C'était, au demeurant, une grosse entreprise que de présenter Parsifal sur nos boulevards. André Messager termina son règne de la sorte, et par une victoire personnelle. La « première » eut lieu le 31 décembre 1913. Les représentations commençaient à 7 h. 1/4 du soir et se terminaient après minuit. Evocation de Bayreuth et période enfiévrée de l'avant-guerre !
Presque en même temps que le gouvernement lui confiait la direction de notre Académie Nationale de musique, André Messager avait pris — en 1908 — celle de la Société des Concerts. Nous avons vu que sa candidature avait été posée le 12 juin 1901 et que Georges Marty l'emporta. Le début de la saison 1908-1909 à la Société fut marqué par une séance au bénéfice de la veuve de ce chef prématurément disparu. Saint-Saëns y joua le concerto en ut mineur de Mozart. André Messager, qui venait d'être élu, dirigeait le concert. Et le 22 novembre, la rentrée de la Société s'effectua sous sa présidence. Celle-ci s'échelonna sur onze années. Pendant la guerre, les matinées nationales, données avec le concours de la Société, reconstituée tant bien que mal, furent les premières manifestations qui signalèrent la reprise de l'activité musicale à Paris. La fusion des orchestres Colonne et Lamoureux ne se réalisa que par la suite. MM. Messager, Rabaud et Büsser dirigeaient tour à tour ces matinées nationales, dont le siège était à la Sorbonne. En mars 1917, André Messager, fit, avec la Société, une tournée à Genève, Lausanne, Neuchâtel, Berne, Zurich et Bâle. Il interpréta, outre les symphonies de Beethoven, des œuvres de Berlioz, César Franck, Lalo, Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Vincent d'Indy, Debussy, Paul Dukas. Quelle plus belle propagande française pouvait-on imaginer ? L'accueil fut partout enthousiaste. Et de cet enthousiasme, cinq ans après l'événement, nous recueillions nous-mêmes encore là-bas des échos à peine atténués. En Suisse alémanique, à Zurich, ce fut, prétend-on, du délire. Un journal local parla de « triomphe tel que la ville de Zurich n'en avait jamais vu ». Témoignage d'autant plus significatif que, la veille du concert de M. Messager, M. Felix Weingartner, signataire du manifeste des intellectuels et formidable propagandiste du camp adverse, avait dirigé la symphonie en ut mineur de Beethoven.
Au mois de septembre suivant, encouragée par cette victoire obtenue dans des circonstances particulièrement difficiles, la Société des Concerts entreprit aux Etats-Unis une autre tournée qui porta de même ses fruits. C'est au retour de cette brillante campagne que M. Messager abdiqua en faveur de son second, M. Philippe Gaubert, qui l'avait accompagné. Quelques mois plus tard, Gaubert reçut l'investiture de l'Assemblée Générale. De 1919 à 1921, André Messager reprit, aux côtés d'Albert Carré, son ami et son collaborateur pour la Basoche, la direction de la musique, salle Favart. Depuis lors, il n'a guère conduit qu'occasionnellement des représentations de ses œuvres, et, en 1926, la reprise de Pelléas et Mélisande avec la plupart des créateurs de l'œuvre, Mary Garden, Dufranne et Félix Vieuille, en tête.
M. Messager a joué un rôle si important dans nos deux théâtres lyriques nationaux et au pupitre de la Société que sa considérable renommée de compositeur ne saurait reléguer dans la pénombre son activité de chef d'orchestre. Certaines gloires de la musique ont, au contraire, une célébrité spéciale qui tendrait à faire oublier qu'ils manièrent eux aussi le bâton magique avec dextérité. Pouvons-nous mentionner dans cette catégorie Mme Armande de Polignac sans être taxé d'ironie ? La première jupe qui passe dans cette galerie sévère, toute peuplée de portraits en plastron blanc et habit noir, apporte une note pittoresque que nous nous ferions scrupule de supprimer. Mme Armande de Polignac, dirigeant au Châtelet ou à la Monnaie de Bruxelles l'exécution de son ballet les Mille et une Nuits, créé par la Loïe Fuller, offrait alors le premier exemple notable d'une femme compositeur‑chef d'orchestre.
M. Vincent d'Indy, né à Paris le 27 mars 1851, a, lui, ses soixante-quinze ans sonnés, et il les porte, comme M. Messager, avec une magnifique et presque miraculeuse fraîcheur. Descendant d'une famille noble du Vivarais, élève, dès le plus jeune âge de Diémer, de Marmontel et de Lavignac, il lia bientôt d'amitié avec Duparc, qui eut, par la suite, une grande influence sur sa formation artistique. Pendant la guerre de 1870-71, il s'engagea dans la garde mobile et écrivit l'histoire du 105e bataillon. La paix revenue, il poursuit ses études avec César Franck, qui lui enseigne le contrepoint, la fugue et la composition. Franck étant, en 1873, nommé professeur d'orgue au Conservatoire, il pénètre derrière son maître dans l'école officielle. Il la quitte d'ailleurs presque aussitôt, en 1875, après avoir remporté seulement un 1er accessit d'orgue. Muni de ce maigre diplôme, il exerce ses talents d'organiste à Saint-Leu (près Paris). Il fut ensuite timbalier, puis chef des chœurs chez Colonne, le tout durant cinq ans. Mais pendant ce modeste stage, il se rendit en Allemagne, séjourna deux mois auprès de Liszt à Weimar et assista, en 1876, aux premières représentations de l'Anneau des Nibelung à Bayreuth. Néanmoins, sa première œuvre d'importance : Attendez-moi sous l'orme (Opéra-Comique, 1882), fut un ouvrage plutôt léger. Mais nous n'avons pas à envisager, dans ce chapitre, la production musicale de Vincent d'Indy. Sur le terrain des concerts, il reprend contact avec l'orchestre chez Lamoureux, en 1887, comme chef des chœurs et participe, en cette qualité, aux préparatifs de l'unique et fameuse représentation de Lohengrin à l'Eden. On sait quelle part M. Vincent d'Indy a prise, aux côtés de Charles Bordes et de Guilmant, à la création de la Schola Cantorum, sur laquelle il continua toute sa vie d'exercer sa souveraineté. Au cours de sa noble existence, Vincent d'Indy a conduit un grand nombre de concerts tant en France qu'à l'étranger, notamment en Belgique, et en Hollande. A Barcelone, en 1895, il trace une « histoire de la musique » en cinq programmes. Il a été aussi en tournée de propagande aux Etats-Unis où il a défendu avec mérite et succès des œuvres françaises. Par un curieux retour des choses, le directeur de la schismatique Schola se vit confier en 1912 la classe d'orchestre du Conservatoire. Depuis lors, nous avons accoutumé de le voir assez fréquemment diriger, soit rue Saint-Jacques, soit en d'autres lieux, des grandes auditions symphoniques avec cette autorité à la fois majestueuse et massive qui le caractérise au pupitre. Mais, en réalité, cet éminent musicien, cet artiste si grand et si pur n'a jamais exercé la direction d'orchestre que d'une manière accessoire et épisodique.

Vincent d'Indy par Borgex (Bibliothèque de l'Opéra)
Il en est à peu près de même pour M. Henri Rabaud l'actuel directeur du Conservatoire national. Très fine lame au demeurant, M. Rabaud « conduit » avec une aisance, une élégance, une sûreté et surtout une correction, que beaucoup de chefs de métier lui pourraient envier. Il a, lui aussi, pris heureusement contact avec le public américain et dirigé, pendant toute une saison, l'orchestre de la Boston symphony. C'était vers 1917, presque à la veille de son élévation à la section musicale de l'Institut (fauteuil de M. Ch.-M. Widor, lequel succédait à feu Roujon comme secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts). M. Rabaud eut diverses occasion de monter depuis lors au pupitre. Chez Colonne, il a remplacé M. Pierné, tandis que celui-ci se trouvait en tournée, par exemple en novembre 1920. Une seule fois, il occupa régulièrement un poste régulier : à l'Opéra, de 1908 à 1914. A l'Opéra-Comique, les habitués l'accueillirent avec joie lorsqu'il y dirigea son œuvre appréciée, Mârouf.
Somme toute, rapide et bien remplie apparaît la carrière militante de ce compositeur dès aujourd'hui comblé d'honneurs. Sa généalogie semble offrir comme une prédestination. Son père était le violoncelliste Rabaud, professeur au Conservatoire, son grand-père le flûtiste Dorus, dont la sœur, Mme Dorus-Gras, avait créé le rôle d'Alice dans Robert le Diable. Henri Rabaud, né le 10 novembre 1873, ayant terminé ses études au Conservatoire avec Massenet et Gedalge, obtenu en 1894 le 1er Grand Prix de Rome, est revenu vingt-cinq ans plus tard, en 1920, dans cet établissement d'Etat comme directeur, ce qui est une manière de record.
M. Alfred Bachelet, de neuf ans plus âgé (il est né à Paris le 26 février 1864) est présentement à la tête du Conservatoire de Nancy. Il dirige les concerts symphoniques de cette ville. Naguère, il fut attaché à l'Opéra comme chef de chant, puis comme chef d'orchestre. Il a souvent pris la baguette au gré des événements. Mais cette forme de son activité serait plutôt secondaire — ce qui ne l'empêche pas d'obtenir, lorsqu'il dirige, de très appréciables résultats, surtout ces dernières années. Il dirigea à l'Opéra-Comique des représentations de ses œuvres, Quand la cloche sonnera et Scemo passé salle Favart en 1926.
M. Guy Ropartz, breton de Guingamp, où il est né le 15 juin 1864, est donc contemporain de Bachelet qu'il a d'ailleurs précédé à la direction du Conservatoire et des Concerts Symphoniques de Nancy. Il occupe maintenant des fonctions analogues à Strasbourg.
M. Reynaldo Hahn, né à Caracas (Venezuela) le 3 août 1875, vint à Paris à l'âge de 3 ans. Il a adopté la nationalité française. Au Conservatoire, où il eut pour maîtres Théodore Dubois, Lavignac, Massenet, il obtient une troisième médaille de piano préparatoire en 1868, une troisième médaille de solfège en 1890, un 1er accessit d'harmonie en 1892. Il est directeur de la musique aux Casinos de Cannes et de Deauville. M. Reynaldo Hahn a été également chef d'orchestre de l'Opéra où il a conduit notamment en représentation des œuvres de Mozart.
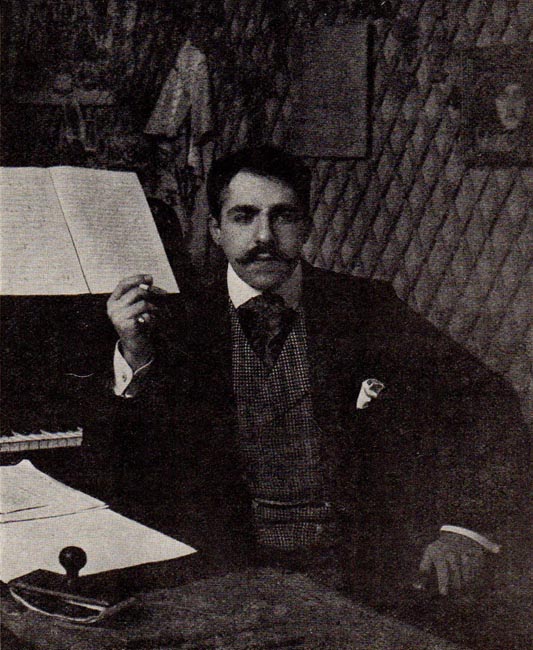
Reynaldo Hahn (photo H. Manuel)
Son collègue M. Gabriel Grovlez a conservé dans le deuxième théâtre lyrique une situation importante. Il est entré à l'Opéra en 1915. Il avait été précédemment chef d'orchestre du Théâtre des Arts. Il dirige régulièrement les grands ouvrages du répertoire. Il a été mis à plusieurs reprises en congé pour aller diriger à l'étranger. En octobre 1921, il fut chef d'orchestre de l'Opéra de Chicago, pendant la saison de Mary Garden. Il a effectué plusieurs tournées dans les principales villes des Etats-Unis, et aussi au Portugal où il eut l'honneur de présenter Pelléas et Mélisande, dans des conditions d'exécution difficiles. M. Gabriel Grovlez est né à Lille, le 4 avril 1879 et a obtenu au Conservatoire, dans la classe Diémer, le 1er prix de piano en 1899.
M. Gustave Charpentier, l'éminent auteur de Louise est certes l'aîné, par l'âge et la notoriété, de MM. Grovlez, Reynaldo Hahn et Ropartz. Il n'a jamais occupé de poste officiel de chef d'orchestre, où son indépendance bien connue de tempérament se fût désagréablement contenue. Mais on ne saurait pourtant l'oublier ici, car il fut l'un des pionniers les plus ardents et les plus actifs de l'éducation symphonique populaire. Né à Dieuze, dans l'Est, le 25 juin 1860, M. Gustave Charpentier vint après la guerre de 1870, à Tourcoing où il était comptable dans une filature. Simultanément il étudiait la musique avec Stappen, pour le violon, Bailly pour la clarinette et Maget pour le solfège. Déjà il organisait une société symphonique et une société de sérénades ! En 1879 il entra au Conservatoire de Lille et en 1881 vint achever ses études à Paris. Il fut élève de Massart (violon), Pessard (harmonie), Massenet (composition). C'est en 1887 que sa cantate Didon obtint le 1er Grand Prix de Rome. De son séjour à la villa Médicis datent les Impressions d'Italie et la Vie du poète, envois destinés à la célébrité et dont l'exécution eut lieu au Conservatoire le 18 mai 1892. Le 24 juillet 1898, M. Gustave Charpentier donnait sa grande fresque symphonique les Fêtes du couronnement de la Muse qui, depuis lors, a servi de commentaire sonore à la plupart des grandes manifestations populaires ; et presque chaque fois M. Gustave Charpentier monte au pupitre et prend le commandement de ces masses chorales et orchestrales dont le maniement lui est familier.
Son frère M. Victor Charpentier, né à Dieuze le 23 juillet 1867, ancien violoncelliste de l'orchestre de l'Opéra, a suivi un peu, sous ce rapport, la même voie. Depuis de nombreuses années, il dirige des concerts symphoniques populaires dont le siège fut maintes fois transféré, au Trocadéro notamment.
A cette lignée appartient M. Albert Doyen, le courageux et infatigable animateur des Fêtes du peuple, dont les séances, religieusement suivies par un public innombrable sont consacrées au culte de la grande musique et fréquemment à la diffusion des œuvres modernes. M. Albert Doyen est à la fois un dompteur de foules et un éducateur.
Placés, de par leurs fonctions, à la tête de ces phalanges bruyantes chargées de verser l'héroïsme au cœur des multitudes, les chefs de musique militaire peuvent, selon le discernement qu'ils apportent dans le choix de leurs programmes, faire du kiosque de jardin public où ils opèrent dominicalement ou bien une vulgaire boîte à flons-flons ou un « temple de l'art » en miniature. Il ne saurait être question d'entreprendre l'énumération de ces « braves militaires » qui n'ont pas tous le mérite, les talents ni la notoriété d'un Flot, actuellement chef au 32e de ligne. Deux d'entre eux néanmoins ont un nom qui, dès à présent, est entré vivant dans la postérité. en raison peut-être de fonctions officielles qui furent le couronnement de leur carrière. Ce sont MM. Gabriel Parès et Guillaume Balay.
M. Parès, né à Paris le 28 novembre 1860, a remporté un 1er prix de cornet à pistons en 1879 au Conservatoire de Paris, et un 2e accessit d'harmonie en 1882. Il débuta comme chef de musique au 74e d'infanterie, devint chef de musique d'infanterie et chef de musique des équipages de la flotte à Toulon en 1883. Enfin en 1893, il fut promu à la haute dignité de chef de musique de la Garde Républicaine. M. Guillaume Balay lui succéda en 1911.
M. Balay, est né à Crozon, (Finistère), le 30 avril 1871. Le 3 octobre 1885, il s'engageait au 15e d'infanterie à Brest. Il était en 1892 commissionné au 5e d'infanterie sous les ordres de M. J. Vidal qui le confiait à son frère Paul Vidal pour ses études d'harmonie. En 1894, il était reçu sous-chef de musique avec le n°1. Cette même année, après huit mois passés au Conservatoire de Paris, dans la classe de M. Mellet, il obtenait le 1er prix de cornet à pistons, décerné à l'unanimité. Sous-chef de musique au 115e, il fut en 1898 reçu chef de musique, encore avec le n°1. En 1900, il était nommé chef de musique au 154e d'infanterie, et en 1904, au 72e d'infanterie dont la musique obtint un prix d'honneur au concours des musiques militaires de Caen (juillet 1908).
Enfin, lorsque fut ouvert un concours pour l'emploi de chef de musique de la Garde Républicaine, M. Guillaume Balay, par une vieille habitude, obtint le n°1. Il fut nommé le 1er juillet 1921 à ce poste qu'il occupe encore avec honneur.
***
Il peut sembler étrange de faire figurer au nombre des « chefs d'orchestre » des musiciens spécialisés dans la direction chorale. Mais qu'ils commandent à des instrumentistes ou à des chanteurs, c'est par leur habileté de chefs, de propulseurs de musique que ces musiciens nous intéressent. Parmi eux il convient de citer M. Radiguer, directeur fondateur de l'ensemble choral qui porte son nom, M. Marc de Ranse, directeur du chœur mixte de Paris, M. Jules Meunier, maître de chapelle de Sainte-Clotilde et directeur de la Cantoria, M. Saint-Réquier, ancien chef des chanteurs de Saint-Gervais, auquel a succédé M. Paul Le Flem. Cette notable société a été successivement sous les ordres de Charles Bordes, son fondateur en 1892, de M. Saint-Réquier en 1909 et de M. Paul Le Flem depuis 1925. Ce dernier avait été nommé sous-directeur en 1922. M. Paul Le Flem, breton, est né en 1881, à Lézardrieux dans le Trégorrois. Licencié en philosophie, il a fait, après un stage au Conservatoire, ses études à la Schola Cantorum avec MM. Vincent d'Indy et Albert Roussel. Sous son impulsion, les chanteurs de Saint-Gervais effectuent des campagnes qui étendent leur renommée jusque dans les plus lointaines et les plus indifférentes provinces françaises. A Paris même, leurs séances suscitent une vogue grandissante et légitime. Car la haute tenue de leurs exécutions classiques et modernes leur permet actuellement d'affronter la comparaison avec les chorales étrangères les plus appréciées. Il convient d'ajouter que M. Paul Le Flem, en 1924, pendant un trop court passage à l'Opéra-Comique, a apporté à la direction des chœurs de ce théâtre, ses qualités de méthode et d'autorité grâce auxquelles il sait obtenir un excellent rendement de ses assujettis.
***
Parmi les compositeurs qui furent étroitement associés à la direction musicale des théâtres lyriques, M. Paul Vidal ferait volontiers dès à présent figure de patriarche. Son aspect à la fois bourru et patelin, sa bonhommie protectrice et toujours obligeante, sa conversation fertile en pittoresques souvenirs, tout concourt à former autour de son front l'auréole du sage. Il distribue les trésors de son expérience à ses petits-enfants. Coquetterie en quelque sorte professionnelle de l'homme qui reste principalement un éducateur et qui a, depuis des années, mis le meilleur de lui-même dans l'enseignement qu'il prodigue sans réserves. Car, en réalité, Paul Vidal pourrait être tout au plus le père de la plupart des compositeurs « jeunes » d'aujourd'hui. Il naquit en effet le 16 juin 1863, deux mois seulement, jour pour jour, avant Gabriel Pierné. Toulousain, il prit garnison à 15 ans dans la caserne parisienne de la Cité Bergère, où moins d'un an plus tard, il commença de prendre ses galons. Le 1er Prix d'harmonie fut enlevé d'assaut. En 1880 et 1881, il s'adjuge les 2e et 1er Prix de contrepoint et fugue et le second Grand Prix de Rome. En 1883, le Premier Grand Prix lui ouvre le chemin de la villa Médicis. Une fois muni de ses licences, Paul Vidal va se partager entre l'Opéra où il officie, et le Conservatoire où il prône. A l'Académie nationale de musique, il est sous-chef des chœurs en 1889, chef de chant en 1892, second chef d'orchestre en 1895. Au Conservatoire, où Marmontel, Durand et Massenet avaient été ses maîtres, il professe à son tour le solfège (1884), l'accompagnement au piano (1896) la composition et la fugue (1909). Il est maintenant titulaire de l'une des deux chaires de composition, l'autre étant dévolue à M. Ch.-M. Widor. Paul Vidal fut également le collaborateur de ce dernier au Conservatoire américain de Fontainebleau (1921) pour la composition. En 1906, Paul Vidal avait été nommé 1er chef d'orchestre à l'Opéra. Il succédait à Taffanel dans ce poste qu'il conserva jusqu'en 1913, c'est-à-dire jusqu'au moment où la direction Messager-Broussan fit place à la direction Rouché. A cette même époque, MM. Gheusi et Isola remplaçaient, à l'Opéra-Comique, M. Albert Carré, promu administrateur général de la Comédie-Française. Au milieu de ces permutations, Paul Vidal passa d'un théâtre lyrique subventionné à l'autre. Il prit, salle Favart, la baguette du commandement suprême et conserva la direction de la musique jusqu'en 1918. Depuis lors, quoique chargé de diverses missions de confiance, notamment à l'Opéra-Comique, il s'est presque exclusivement consacré à ses élèves. Ajoutons, pour fixer d'un dernier trait la silhouette sympathique de ce musicien si profondément attaché à l'enseignement officiel, que M. Paul Vidal occupa pendant trois ans les fonctions de président de l'Association des anciens élèves du Conservatoire. Il présida aussi durant une année la Société des Auteurs, compositeurs et éditeurs de musique de la rue Chaptal.

Henri Büsser par Borgex (Bibliothèque de l'Opéra)
Toulousain comme Paul Vidal et de neuf ans à peine son cadet, puisqu'il est né le 16 janvier 1872, M. Henri Büsser, par un phénomène inverse, doit à son visage glabre et reposé cette apparence jeune que confirme encore l'expression poupine et la géométrie quelque peu japonaise de sa physionomie. Il acquit ses premières connaissances musicales à Toulouse même, avec son grand-père maternel, ancien directeur du théâtre du Capitole. Il n'a point connu son propre père, Fritz Büsser, organiste à la cathédrale et compositeur apprécié. Après avoir travaillé quelque temps à la maîtrise de sa ville natale, Henri Büsser se dirigea d'abord vers l'école Niedermeyer pour entrer enfin au Conservatoire. Il étudia l'orgue et la composition avec Guiraud, César Franck et Widor. Il reçut également les conseils de Gounod. En 1893 — dix ans après son compatriote Vidal, sur les talons duquel il marcha avec régularité — il obtient le Grand Prix de Rome pour sa cantate Amadis de Gaule. A son retour de la villa Médicis, il devint organiste de l'église de Saint-Cloud où Gounod avait une propriété, et il conserva vingt ans cette suzeraineté. De 1902 à 1905, on le trouve à l'Opéra-Comique. Il collabore quelques mois à l'éphémère Opéra populaire. En 1912, il dirige à Bordeaux les concerts Sainte-Cécile. En 1918, il entreprend en Argentine avec la compagnie Mocchi une tournée au cours de laquelle il conduit des concerts symphoniques. Professeur de la classe d'ensemble vocal au Conservatoire, il a présentement le titre pompeux de maître de musique de l'Institut. C'est à lui qu'échoit chaque année l'honneur souvent ingrat de présenter, sous la coupole, les cantates des Grands Prix et, au Conservatoire, les « envois » des pensionnaires de la villa Médicis. Mais, actuellement, M. Henri Büsser nous apparaît surtout comme le doyen des chefs de l'Opéra. Depuis 18 ans dans cette maison, il en connaît les détours, les embûches et les issues. Aucune besogne ne le prend au dépourvu. Aussi a-t-on pu dire légitimement de lui que c'était un malin. Affecté d'une myopie qui achève de donner à son visage une expression très particulière, et couche parfois ses épaules sur son pupitre, il a pris le parti à la fois le plus brave et le plus prudent : celui de diriger de mémoire presque tout le répertoire de l'Opéra. Il intervient souvent lors de l'exécution des grands ballets. Certains jours, un duel passionnant s'engage alors entre la danseuse et le chef d'orchestre. Büsser ne s'y montre jamais déconcerté. A soutenir ces brillantes passes d'armes, il s'est acquis auprès des abonnes et des habitués la même popularité qu'auprès de tout ce peuple d'Opéra, sonore et bondissant qu'il régente depuis si longtemps. Depuis 1926, M. Büsser a succédé à M. Rühlmann comme directeur général de la musique aux Casinos d'Aix-les-Bains.
La plupart des chefs les plus réputés de la fin de l'autre siècle avaient marqué leur place à la fois au concert et dans les principaux théâtres lyriques. Il en fut notamment ainsi pour Colonne, Lamoureux, Marty, Danbé. Bien rares seraient les exemples d'une spécialisation absolue dans l'un ou l'autre de ces domaines. Il est toutefois certain que ses affinités profondes, ses goûts, son caractère, son physique même, doivent entraîner tout chef d'orchestre plutôt de ce côté-ci ou de celui-là. Tel affirme indiscutablement le tempérament et les capacités de « l'homme de théâtre » ; il n'ajoutera souvent rien à sa gloire en montant au pupitre pour des manifestations de musique pure. Et inversement. Témoin un Camille Chevillard, qui trouva sans doute, à l'Opéra, dans l'accomplissement d'ailleurs tardif de ses doubles fonctions — direction de la musique et conduite de l'orchestre — maints sujets de trouble, de contrariété, et peut-être maints déboires. Entre le concert et la scène, il y a souvent un fossé que d'aucuns ne franchissent pas sans risques graves. L'incompatibilité n'est pas nécessaire, on l'a vu ; mais elle est fréquente. Cela n'empêche que nombre des chefs du théâtre contemporain ont joué des deux cordes à la fois, et quelques-uns avec succès.
Dans la lignée moderne, Alexandre Luigini, presque contemporain, semble pourtant lointain. Né à Lyon le 9 mars 1850 — trois ans seulement avant Messager — et mort dès le 29 juillet 1906, il a cependant laissé jusqu'ici son empreinte à l'avant-scène de l'Opéra-Comique. Il n'en avait pas moins attaché par ailleurs son nom à la création des Concerts Bellecour et de l'Ecole, en 1880, à Lyon, où il professait alors l'harmonie. Depuis 1877, il dirigeait dans sa ville natale l'orchestre du Grand-Théâtre. Vingt ans plus tard exactement, en 1897, il accédait enfin au pupitre du second théâtre lyrique subventionné et devenait aussi tôt l'un des collaborateurs les plus précieux de la première et brillante direction Albert Carré, c'est-à-dire dans cette période qui vit l'apparition de Louise et de Pelléas et Mélisande. En mars 1906, quatre mois avant sa mort, Luigini présidait à la création d'Aphrodite de Camille Erlanger. Tel fut le terme d'une existence probe, laborieuse, utile et simple à la fois et toute entière consacrée honnêtement à l'art. Luigini servit longtemps d'exemple. Il eut même des disciples. Parmi ceux-ci, on note de bons musiciens comme M. Ernest Picheran qui resta pendant 17 ans premier chef d'orchestre à l'Opéra-Comique et qui est à présent directeur de la chorale du théâtre national de l'Opéra.

Alexandre Luigini
La disparition de Luigini creusait un vide visible à l'Opéra-Comique. Pour le combler, on fit appel à un musicien du même type, Franz Rühlmann. Né à Bruxelles en 1868, Rühlmann est d'origine belge, mais français de nationalité. Cela mérite d'être spécifié, le fait ayant été très souvent contesté. La preuve en est que Rühlmann, mobilisé malgré son âge, porta l'uniforme français pendant toute la durée de la guerre. A Bruxelles, il avait été l'élève de Joseph Dupont, célèbre chef d'orchestre belge. Tout enfant, il chantait dans les chœurs à la Monnaie. A 7 ans, il était hautboïste dans ce théâtre. Quant à la direction d'orchestre, il la pratiqua à Rouen pour la première fois. Il débuta dans cette bonne ville, au Théâtre des Arts, en 1892. Trois ans plus tard, de retour en Belgique, il passait au Grand Théâtre de Liège, puis à celui d'Anvers, dont le directeur était alors M. Giraud, père de la future Mme Marguerite Carré. En 1898, il revint au théâtre de la Monnaie, non plus comme enfant de chœur, mais comme chef d'orchestre. En 1905, il entrait à l'Opéra-Comique comme 1er chef. Et la saison suivante, à la mort de Luigini, il obtint le poste si envié de directeur de la musique. Cette haute fonction, il la conserva jusqu'en 1914, date à laquelle l'échiquier musical se trouva soudain profondément modifié par suite des changements survenus dans la direction des théâtres d'Etat — Albert Carré à la Comédie-Française, P.-B. Gheusi et les frères Isola à l'Opéra-Comique, Jacques Rouché à l'Opéra. M. Rouché, dès sa nomination, appela M. Rühlmann, transfuge de la salle Favart. Mais la guerre survint presque aussitôt ; et ce ne fut qu'en 1916 que Rühlmann, quoique toujours mobilisé, remonta d'une façon régulière au pupitre. En 1920, époque d'une profonde agitation dans le syndicat des musiciens (chambre syndicale des artistes musiciens de Paris et de la région parisienne) il défendit assez ouvertement la cause des protestataires, tout en s'efforçant de trouver un terrain de conciliation. De quel œil l'administration vit-elle cette intervention ? Toujours est-il que Rühlmann repartit dès lors pour Bruxelles, prenant à la fois la direction musicale de la Monnaie et celle des Concerts Populaires. Il revient à Paris comme 1er chef à l'Opéra-Comique en 1922-23, et reprend sa place en 1924 à l'Opéra. En janvier 1923, l'association des Concerts Colonne l'élut pour suppléer en cas de besoin M. Gabriel Pierné. Le 20 janvier Rühlmann dirigea pour la première fois au Châtelet. Il n'y fit jusqu'ici que de bien rares apparitions. Contractuellement, la situation de Rühlmann chez Colonne n'est d'ailleurs pas celle d'un adjoint régulier — comme Paul Paray le fut, naguère, auprès de Chevillard et, maintenant encore, Albert Wolff chez Pasdeloup. Ceux-ci sont admis à conduire chaque année un certain nombre de fois. La position de Rühlmann vis-à-vis de M. Pierné serait plutôt du même genre que celle du second chef de la Société des Concerts par rapport à M. Philippe Gaubert. Quoiqu'il en soit, à moins de surprises toujours possibles, nous ne croyons pas que l'avenir favorise désormais M. Rühlmann de ce côté-là.
Directeur de la musique aux théâtres des Casinos d'Aix-les- Bains depuis 1911, puis directeur artistique, il avait antérieurement paru dans ces établissements en qualité de second chef. Durant la saison d'été, il eut le mérite d'y monter, avec les soins les plus dignes d'éloges, divers grands ouvrages du répertoire comme les Maîtres chanteurs, Siegfried, les Troyens et de représenter des œuvres peu ou mal connues, comme le Sauteriot de Sylvio Lazzari. Aux Concerts Populaires de Bruxelles, il s'est efforcé de répandre notamment des pages de Dukas, Debussy, Fauré, Ravel, Gedalge et de beaucoup d'autres compositeurs français contemporains. A l'Opéra-Comique, il se dévoua avec un zèle méritoire à l'Heure Espagnole, Ariane et Barbe-Bleue, la Habanera, On ne badine pas avec l'amour, la Lépreuse, l'Ancêtre, Mârouf.
Tout cela représente un effort nombreux, varié, soutenu et honore ce rude travailleur, que nous voyons présentement encore, après trente-quatre années d'exercice, toujours sur la brèche, vaillamment.

Franz Rühlmann (photo Sabourin)
Louis Hasselmans, qui fut pendant un temps le collaborateur le plus direct de Rühlmann à l'Opéra-Comique, n'a pas, comme son aîné, débuté dans les chœurs, mais dans l'orchestre. Né à Paris le 25 juillet 1878, fils du célèbre harpiste et appartenant à une famille de musiciens, il avait eu le 1er Prix de violoncelle au Conservatoire de Paris en 1893. Embrigadé tout d'abord dans les rangs de l'association Lamoureux et aussi dans l'orchestre du Théâtre du Cercle d'Aix-les-Bains. Louis Hasselmans devait précisément se multiplier par la suite au concert et à la scène tout à la fois. Avec Lucien Capet, il fonda le quatuor qui, sous le nom de ce dernier, prit rapidement à Paris une place prépondérante. En 1909, il créa, avec le concours de M. A. Dandelot, les Concerts Hasselmans, phalange de quelque 80 exécutants, à la tête desquels il produisit une immédiate et forte impression. Cette même année, M. Albert Carré lui confia l'emploi de 1er chef à l'Opéra-Comique, poste qu'il conserva jusqu'en 1911. Alors, entrant dans la voie des grandes tournées qu'il poursuivra sans relâche — en province d'abord, puis en Angleterre, en Belgique, en Italie, en Espagne, en Suisse et en Allemagne — il va former et diriger au Canada une troupe d'Opéra composée d'artistes français et connue sous le titre de Montreal opera company. Ses campagnes à l'étranger ne l'empêchent pas de revenir tenir honorablement sa place, chaque saison, soit à l'Opéra-Comique, soit en divers centres lyriques ou musicaux français. En mai 1913, peu après l'inauguration du théâtre des Champs-Elysées (direction Gabriel Astruc) Louis Hasselmans éprouva l'immense satisfaction de présider aux représentations de Pénélope, lors de la création à Paris du chef-d'œuvre de Fauré. Au cours de cette même année, il donne encore 24 séances à l'association des Concerts classiques de Marseille. En mai 1917, on retrouve Hasselmans à Barcelone pour des concerts de musique française. En octobre, il visite la Suisse avec la Société des instruments anciens. Puis, de novembre à mars, il organise aux Etats-Unis une série de concerts — à New York, Philadelphie, Boston, Baltimore, Cincinnati, etc... A Charlotte (North Carolina) un imposant orchestre militaire, formé de soldats américains, se range sous son commandement (26-27 avril 1918) ainsi qu'à Bordeaux (les 14 et 16 juillet). A la fin d'octobre, Hasselmans est engagé par M. Campanini à l'Opéra de Chicago. Depuis, il devient chef d'orchestre au Metropolitan Opera de New York et dirige les saisons lyriques estivales de Ravinia-Parck. C'est donc à une carrière américaine que semble voué présentement cet excellent et ferme protagoniste de l'art français. Hasselmans put en effet accomplir souvent en pays étranger une très utile besogne. Grâce à son énergique activité, notre art national parvint à cohabiter avec les répertoires allemands et italiens, là-même où ces répertoires, il y a quelques années encore, régnaient souverainement et quasi-despotiquement. Un ouvrage comme la Habanera de Raoul Laparra lui doit de s'être implanté au Metropolitan Opera. D'autres pièces plus anciennes se sont aussi de la sorte imposées malgré les habitudes d'un public discipliné à d'autres écoles. En Amérique, Hasselmans eut l'occasion de rencontrer son chef de file, Albert Wolff, directeur de la musique à l'Opéra-Comique, alors lui-même en exercice sur le Nouveau-Continent. Avant Hasselmans, Wolff avait eu mission de défendre, pendant trois hivers, la musique française au Metropolitan et il put ainsi faciliter l'accès de ce magnifique théâtre international à son confrère. Hasselmans revint un moment, vers la fin de 1920, dans la Maison de sa jeunesse. Il n'est pas déraisonnable de supposer que nous l'y reverrons quelque jour, malgré son attachement sincère aux pays d'Outre-Atlantique. En tous cas, il ne serait pas juste qu'après avoir courageusement et utilement bataillé au dehors pour notre cause. il ne retrouvât pas, s'il le désirait, la confortable chaire qu'il sacrifia spontanément dans cette intention.
A propos d'Hasselmans, nous venons de citer incidemment le nom d'Albert Wolff, auquel il doit beaucoup. Les débuts de Wolff, assez différents de ceux de son camarade rappelleraient plutôt ceux de l'un de ses prédécesseurs presque immédiats, Franz Rühlmann. Saint-Saëns et Gabriel Fauré avaient tenu le grand orgue de la Madeleine. Wolff fut... enfant de chœur dans cette église, ainsi qu'à la Trinité. Né à Paris le 19 janvier 1884, il entra toutefois en 1898 —à 14 ans par conséquent — dans les classes du Conservatoire. Il y demeure 8 années, suivant tour à tour, sans craindre l'espièglerie, l'enseignement de Xavier Leroux, Paul Vidal et André Gedalge. Il en sortit avec un 1er Prix d'harmonie et un 1er Prix d'accompagnement au piano. Cela se passait en 1906. A partir de cette époque, il continua ses études de contrepoint, de fugue et de composition avec Xavier Leroux. Mais il était déjà marié — à 22 ans — et père de famille, donc dans l'obligation de se livrer à des travaux pratiques. Il cumula, de 1907 à 1911, les fonctions d'accompagnateur des classes de chant et de violoncelle au Conservatoire et d'organiste à Saint-Thomas d'Aquin. Au cours des saisons 1906-1907 et 1907-1908, il tint le piano au Concert Rouge, alors dirigé par MM. René Doire et Rabani. Wolff eut plusieurs fois l'occasion de conduire cet orchestre en miniature auquel appartenaient du reste d'excellents musiciens comme Elcus et Louis Fleury. En 1907, son maitre Leroux lui confie une classe de solfège au Conservatoire « Musica », tout récemment fondé. Ses élèves étaient peu nombreux et presque tous étrangers. En 1908, Pierre Lafitte et Georges Pioch, directeur et rédacteur en chef de la revue Musica organisent avec la participation de Comœdia le fameux « concours de ténors » dont Franz, 3e lauréat, devait être la révélation. Wolff eut la chance d'exercer ce jour-là ses talents d'accompagnateur — besogne délicate d'ailleurs puisque cet inénarrable tournoi vocal, comme tous autres du même genre, eût été dérisoire sans le secours d'un pianiste débrouillard et acrobate, autant que musicien. C'est en cette favorable conjoncture qu'Albert Carré, membre du jury, remarqua Albert Wolff. Quelques jours plus tard, il écrivait à Georges Pioch une lettre à peu près ainsi conçue : « Pouvez-vous avoir l'amabilité de me dire comment s'appelle le garçon qui accompagnait au concours ténors. Et, s'il est libre, veuillez le prier de venir me voir ».
En face des hommes, des œuvres et des choses, M. Albert Carré, mu par cette sorte d'instinct qui distingue les véritables capitaines, eut d'ailleurs souvent, dans sa longue et magnifique carrière, des intuitions de ce genre. Bref, le modeste Albert Wolff se trouve tout aussitôt enrôlé dans l'escouade des chefs de chant de l'Opéra-Comique. Il a le pied à l'étrier. Le concours Musica-Comœdia dévoila donc ensemble, quoique par des voies différentes, deux de nos futures gloires : Franz et Albert Wolff. Ce jour-là, l'ami Pioch avait rendu un double service à la musique.
Le 9 mai 1909 eut lieu le premier essai de Wolff comme chef d'orchestre : ce fut à Strasbourg, au cours d'un gala français, dans un acte de Manon et dans un autre de Roméo et Juliette. Bientôt, selon les conseils judicieux de son directeur, et sur sa précieuse promesse de le nommer, dans un délai très court, chef d'orchestre à l'Opéra-Comique, Wolff commence avec un rare entrain l'apprentissage du métier. Il recherche toutes les occasions possibles de diriger, trouve à s'engager pour des représentations en province et des petits concerts des genres les plus variés. Il commande quelquefois à 7 ou 8 musiciens, tout au plus. N'importe ! Le bras et le cerveau se forment ! Pendant ses randonnées, il aborde indifféremment l'opéra, l'opéra-comique et l'opérette — excellente école pour acquérir toute la souplesse désirable. Certain jour, il se transporte hâtivement à plus de 100 kilomètres ; au programme : la Mascotte ; Cachet 12 francs, voyage payé. D'autres fois, il est appelé au « cercle international » de Vichy, à Reims, à Chalon-sur-Saône, à Mâcon. Mais, le plus fréquemment, son rayon d'action ne dépasse guère la région de... Saint-Denis ! A battre ainsi les sentiers théâtraux de la banlieue, l'expérience vient. Arrive enfin l'échéance tant attendue où Albert Carré va tenir son engagement. Au commencement de 1911, Wolff aborde le pupitre de l'Opéra-Comique pour conduire la Jota de Raoul Laparra. Un mois après, M. Carré lui permet de participer à la tournée de l'Opéra-Comique en Argentine. Dès lors l'élan est pris ; rien ne le ralentira désormais. A dater de septembre 1911, au retour de Buenos Aires, la situation de ce jeune musicien de 27 ans ne cessera de grandir à l'Opéra-Comique, où il devient le chef d'orchestre attitré du répertoire.
La guerre elle-même, en l'absorbant par des occupations plus graves, ne fournit qu'un nouvel exemple de cette continuelle ascension, puisque, après avoir combattu sur le sol boueux des Eparges, il passe comme pilote, dans le personnel volant de l'aviation, et part pour le Maroc. Les hostilités finies, il continue de défendre pacifiquement la cause nationale chez nos amis américains. Trois saisons passées au Metropolitain Opera de New York, avec l'affectueuse confiance du directeur M. Gatti-Cazazza, lui permettent de conquérir là-bas une situation morale que peu de chefs d'orchestre français avaient pu jusqu'alors obtenir. Il lutte efficacement ainsi contre le préjugé américain, naguère enraciné par les capellmeister et les maestros, de la médiocrité française en matière de conduite orchestrale. Wolff contribue pour une bonne part à remonter un courant qui nous était singulièrement défavorable et il prépare de la sorte les assises d'une évolution dont sauront profiter, après lui, un Pierre Monteux, à Boston, et un Hasselmans à New York même. On joua, du reste, en cette capitale artistique des Etats-Unis, et avec succès, son Oiseau Bleu, illustration musicale du chef-d'œuvre de Maeterlinck. que Paris n'a pas encore eu la curiosité de connaître.
Ses rapides incursions en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Argentine commencent à lui établir une réputation quasi-mondiale. Mis de la sorte en évidence, il recueille en 1921, salle Favart, et, malgré la jeunesse relative de ses 37 ans, la succession d'André Messager à la direction de la musique. En moins de 13 années, y comprise la durée de la guerre, il est passé avec régularité des emplois subalternes au premier échelon de la hiérarchie de ce théâtre. Son précoce prestige s'établit promptement sur le corps musical et sur la troupe entière. Et durant cette florissante période, ses succès personnels contribuent puissamment à l'éclat de notre seconde scène lyrique. Sans parler de la tenue des représentations courantes, il eut le mérite de participer à de brillantes reprises comme celles de Pelléas et Mélisande, de Pénélope, d'Ariane et Barbe-Bleue, — les trois « glorieuses » — et à de sensationnelles créations parmi lesquelles se détachent celles de Quand la cloche sonnera d'Alfred Bachelet et la Forêt Bleue de Louis Aubert. D'autres batailles, comme celle qu'il livra pour la Brebis égarée, furent sans doute moins heureuses. Mais qui ne tente jamais quelque opération risquée, n'est point digne des prérogatives du commandement.
A la fin de l'exercice 1923-1924, après avoir dirigé le répertoire et les premières représentations de la Forêt Bleue, en faveur de laquelle, il avait longtemps auparavant plaidé, il abandonna son poste de l'Opéra-Comique. Sa démission était d'ailleurs prévue depuis quelques mois par suite de diverses circonstances. A cette époque, il était question de renouveler dans le superbe cadre du théâtre des Champs-Elysées, mais sous de tout autres auspices et avec le concours de M. Jacques Hébertot, l'ancienne entreprise lyrique de l'avenue Montaigne. Celle-ci, avant la guerre, n'avait eu qu'une existence éphémère, quoique somptueuse, et une fin malheureuse. Malgré de multiples préparatifs en vue d'une souhaitable résurrection, ce projet téméraire ne parvint même pas à maturité : échec de nature commerciale qui ne surprit en vérité presque personne.
Au cours de la saison suivante (1924-1925) Wolff subit une fâcheuse éclipse. On pouvait légitimement supposer qu'elle serait de courte durée. Mais en quel point de l'horizon devait reparaître cette comète ? A l'étranger ? D'alléchantes propositions l'y attiraient. Ou bien Wolff attendrait-il le moment favorable pour reprendre le départ à Paris même ? Cette seconde éventualité l'emporta, mais d'une manière imprévue. Au milieu de 1925, l'occasion se présenta sous la forme d'une collaboration offerte à Albert Wolff par M. Rhené-Baton. Désireux de se décharger partiellement de la lourde tâche qu'il avait assumée seul jusqu'alors à la tête des Concerts Pasdeloup, et poussé par le goût des voyages, Rhené-Baton, bien loin de rechercher le concours d'une honnête médiocrité qu'il aurait laissée prospérer discrètement dans l'ombre de sa propre gloire, tendit au contraire à son valeureux confrère une loyale et secourable main. Geste de solidarité clairvoyante trop rare de la part des gens en place, et qui est bien le fait d'un homme aux larges vues comme Rhené-Baton. La place qu'il prépara auprès de lui, chez Pasdeloup, à Albert Wolff, celui-ci l'a remplie avec éclat. On peut même dire que, dans ce domaine, il a dépassé les espérances de ses plus fermes soutiens. On l'avait bien vu, une année auparavant, diriger dans ce même théâtre, quelques concerts dont il était, avec M. Tiarko Richepin, le promoteur. Wolff appartenait alors encore à l'Opéra-Comique comme directeur de la musique. Aussi MM. Carré et Isola avaient-ils un instant songé à retenir chez eux leur principal collaborateur et à organiser, salle Favart, les séances symphoniques projetées. Première friction : l'accord ne se réalisa pas, et Wolff émigra pour ces concerts au théâtre de la rue Mogador, que dirigeaient à cette époque M. Jacques Richepin et Mme Cora Laparcerie. Les concerts Tiarko Richepin-Albert Wolff ne pouvaient avoir qu'une existence précaire. D'ailleurs Wolff ne s'était pas encore manifesté dans ce rôle ; son talent n'y était pas totalement adapté, et l'empressement relatif d'une clientèle à créer de toutes pièces ne devait pas parvenir à compenser les risques financiers d'une affaire aussi hasardeuse. Wolff n'en avait pas moins eu le temps de mesurer ses forces, de conquérir une certaine expérience et d'ajuster son métier à ces nouvelles besognes. Par la judicieuse composition de ses programmes, il avait enfin prouvé le zèle intelligent qu'il était susceptible de dépenser au service de la meilleure musique moderne, et en particulier de la musique française.
A l'association Pasdeloup, il ne semble pas comprendre différemment ses fonctions. Par là, il rejoint directement les traditions de hardiesse du créateur de ces concerts. Ces derniers temps, la maîtrise d'Albert Wolff s'est affirmée. Son autorité a considérablement grandi. Son art souple et nuancé a pris une énorme envergure. A la sympathie qu'il exerçait s'est jointe une sorte d'amical respect. Le plus souvent, il s'astreint à diriger de suite par cœur les partitions les plus complexes et les plus scabreuses. Est-ce une élégance qu'il arbore ou une discipline qu'il s'impose ? L'une et l'autre assurément. Toujours est-il que cet exploit fut remarqué, notamment à l'Opéra-Comique, lors de la reprise de Pelléas et Mélisande, dont l'interprétation, sous l'impulsion de Wolff, prit à la fois une sobriété d'expression et un relief extraordinaires. Wolff venait en effet de rentrer salle Favart. Les héritiers de la direction Carré-Isola, MM. Louis Masson et Georges Ricou, appartiennent l'un et l'autre à la génération montante d'Albert Wolff. Le second était déjà le plus intime collaborateur de M. Carré et comme son fils d'adoption lorsque Wolff, à son tour, conquit l'affection du grand Patron et prit, de même, une place enviée dans sa confiance. Bien que Wolff ne fût pas tout d'abord prévu dans les cadres de la nouvelle combinaison directoriale, la pénurie des véritables chefs incita cependant MM. Masson et Ricou à utiliser la valeur et le prestige de l'ex-directeur de la musique. D'aucuns se sont étonnés que Wolff acceptât de revenir comme simple premier chef, aux côtés sinon sous la férule de l'un de ses anciens subordonnés, dans une maison où il avait naguère exercé le commandement majeur. Ses amis lui conseillèrent cette politique de conciliation. Certains talents ont une telle force d'expansion, un tel rayonnement qu'en aucune circonstance il ne sauraient se trouver déclassés ; dédaigneux de l'étiquette, ils rejoignent d'eux-mêmes le rang qui leur revient naturellement. Actuellement, aux environs de la quarantaine, avec un brillant et multiple passé, Albert Wolff cumule donc les fonctions de co-directeur des Concerts Pasdeloup et de premier chef à l'Opéra-Comique. Sa carrière, dans l'un et l'autre poste, ne semble pas avoir encore atteint à son apogée. Le 2 juin 1926, il parut dans l'immense cirque de l'Albert-Hall de Londres, à la tête de l'Association Pasdeloup et sut aussitôt s'imposer à l'attention des Anglais, comme naguère à celle des américains.
Ancien collaborateur de Wolff à l'Opéra-Comique et élevé maintenant par MM. Masson et Ricou à la direction des études musicales, M. Maurice Frigara passa par le Conservatoire de Paris, où il fut élève de Dancla, de Massart et de Benjamin Godard. Né à Lille le 2 juillet 1874, ce Corse d'origine obtenait dès 1895 le grade de chef d'orchestre au théâtre de sa ville natale et une chaire au Conservatoire du Chef-lieu du Nord. En 1898, il passe de Lille à Anvers, puis au Caire. Durant cinq ans, il préside, à Nantes, aux représentations du théâtre Graslin. On le retrouve ensuite à Marseille et à Lyon, où il monte, au cours de quatre années, l'Or du Rhin, la Walkyrie, Siegfried, les Maîtres chanteurs, Gwendoline. En 1910, il signe un engagement de trois ans pour conduire, au Covent-Garden de Londres, le répertoire Français (Louise, Carmen, la Habanera). Ses collègues sont alors Campanini et Hans Richter pour les ouvrages italiens et allemands. Vers la fin de la guerre, après sa démobilisation survenue en 1917, il devient le coadjuteur de la direction Louis Masson au Trianon-Lyrique. Il prodigue surtout ses soins au répertoire ancien : les Voitures versées, le Tableau parlant, l'Épreuve villageoise, le Mariage secret, Richard Cœur de Lion, la Servante maîtresse, Rose et Colas, la Fête du village voisin, Jean de Paris, le Déserteur, le Maréchal-ferrant, Picaros et Diego, Jeannot et Colin, Maison à vendre. Son entrée à l'Opéra-Comique date de 1921. Appelé salle Favart par MM. Carré et Isola, il sut y préparer assidument son avenir et, le moment venu, profiter des faveurs du sort. Lors de sa nomination à l'Opéra-Comique, en 1926, M. Louis Masson, dont il avait été jadis le précieux auxiliaire sur les boulevards extérieurs, devait amicalement répondre à ses vastes aspirations.
Dans la situation si ardemment convoitée qu'il occupe aujourd'hui, le directeur des études musicales peut mesurer avec satisfaction le chemin parcouru depuis son profitable stage au Trianon. Probablement se rappelle-t-il aussi, non sans fierté, comment il fit autrefois connaissance avec l'orchestre du second lyrique : c'était en qualité de simple violoniste et dans le temps, d'ailleurs déjà lointain, où l'association Lamoureux utilisait son attentif archet. A part cette incursion dans le domaine symphonique, M. Maurice Frigara se consacra jusqu'ici tout entier au théâtre. C'est un homme de sûr métier, et rompu à toutes les exigences de sa profession. Travailleur infatigable et contrôleur vigilant, il fut toujours considéré comme un interprète consciencieux, précis, méticuleux, voire parfois un peu sec, de la pensée des compositeurs. Il a conduit tout le répertoire et monté des œuvres comme la Griffe et Sainte-Odile. Jusqu'à présent, il s'est plutôt imposé dans la minutieuse mise au point des ouvrages connus. En 1925, une brillante reprise de la Lépreuse mit particulièrement en évidence ses nombreuses et incontestables qualités.
Un autre bon et utile serviteur de la musique à l'Opéra-Comique fut M. A. Catherine, proche voisin de M. Frigara et quelque peu son aîné. Celui-ci était violoniste, celui-là pianiste. Né à Paris le 16 novembre 1868, Alphonse Catherine suivit au Conservatoire l'enseignement de Marmontel et Diémer pour le piano, de Théodore Dubois pour l'harmonie et de Massenet pour la composition. Très jeune, en 1892, le premier titre officiel que reçut ce musicien fut celui d'accompagnateur chargé de cours pour la classe d'Opéra au Conservatoire. Pendant treize ans, il exerça parallèlement les fonctions de chef de chant à l'Opéra, toutes besognes qui devaient puissamment contribuer à sa formation théâtrale. La carrière de chef d'orchestre, à laquelle il se destinait, s'ouvrit en 1898. Depuis Royan, où il se trouva fortuitement à l'excellente école de Luigini, nous n'en retracerons pas les menues étapes qui, par des voies normales, conduisirent Alphonse Catherine à une honorable notoriété. Le 25 février 1905, il conduisit enfin pour la première fois à l'Opéra, Tannhäuser. Mais il ne devait être titularisé dans cette fonction que quelques années plus tard En 1912 et 1913, il dirige les concerts de l'association Lamoureux au Kursaal de Scheveningue et prend, également en 1913, la baguette au Concertgebouw d'Amsterdam en l'absence de Mengelberg. Détail à noter : c'est Catherine qui conduisit à l'Opéra pour la dernière fois avant la guerre. Cette ultime et émouvante soirée — 31 juillet 1914 — était consacrée à Faust.
Les hostilités ne devaient d'ailleurs pas laisser Catherine inactif. Engagé volontaire en 1915, il peina sur le front principal et trouva des loisirs pour organiser, avec d'illustres camarades, le Théâtre aux armées dans le secteur du général Gouraud. Envoyé en Orient. il contracta le paludisme, à la suite de quoi on le raya des cadres.
Envoyé en mission officielle après la guerre aux Etats-Unis, il eut l'occasion de conduire en janvier 1919, à Philadelphie, un concert composé exclusivement d'œuvres françaises. De retour en France, son entrée à l'Opéra-Comique eut lieu en 1919. Il y dirigea ou monta notamment les Noces de Figaro, qui le mirent aussitôt en valeur, Gismonda, la Rôtisserie de la reine Pédauque, le Sauteriot, le Roi Candaule, Dans l'ombre de la cathédrale, la Habanera, Fra Angelico, la Plus forte, Gianni Schicchi, le Festin de l'araignée.
Alphonse Catherine a quitté la salle Favart en 1924. Albert Wolff comptait l'associer à son sort dans l'entreprise lyrique projetée au théâtre de M. Jacques Hébertot. L'échec de ce dessein ruina les espérances de Catherine. Des cinq années passées à l'Opéra-Comique subsiste le souvenir de ce qu'il est permis d'appeler un « caractère » Celui-ci, jusque dans ses manifestations les plus intransigeantes, se recommandait par une sincérité qui n'était pas sans prix. Depuis deux ans, M. Catherine n'a pas repris d'activité militante. Il a toutefois conduit certaines représentations lyriques de gala au théâtre des Champs-Elysées (l'Apôtre de Wailly).
C'est dans cette salle de l'avenue Montaigne que commença de s'établir la réputation de D. E. Inghelbrecht. Ce petit homme mince, souple, nerveux, malicieux, sur le visage duquel erre volontiers un ironique sourire, possède un atavisme singulier. Son grand-père était belge, son père français et sa mère anglaise. Lui-même naquit à Paris le 19 septembre 1880. Si plusieurs races se rencontrent en lui, loin de se fondre ou de s'amalgamer, elles se combattent sans merci. D'une intempérante sincérité, il se défend mal contre les impulsions de sa spontanéité. Il apparaît non moins tenace et volontaire, mais plutôt par saccades. Foncièrement artiste, ses élans fougueux peuvent le desservir. Mais, après un bond périlleux, fût-ce dans l'inconnu, il reprend l'équilibre avec agilité. Le sang-froid, vertu britannique, lui ferait peut-être quelquefois défaut, de même que la pondération réfléchie de nos cousins des plaines de l'Escaut. Son tempérament épineux et autoritaire entrave souvent la générosité pudique, mais certaine, de son cœur. Profondément désintéressé, surtout lorsqu'il s'agit de bonne musique, chevaleresque au besoin, intrépide lutteur dès que l'arène s'entr'ouvre devant lui, cultivé et curieux de tout ce qui touche à l'art, son esprit de finesse se heurte à des forces mystérieuses capables de l'entraîner au rebours de la voie qu'il s'est lui-même tracée. Pour un observateur non prévenu, son caractère demeure énigmatique, ambigu et plein d'étrangeté. Il fut toutefois un apprenti musicien pareil à beaucoup d'autres et s'assit un moment sur les bancs de l'école officielle. Il entra du reste rapidement en difficultés avec le secrétaire général du Conservatoire; sur quoi l'honorable fonctionnaire n'hésita pas à prédire que cet élève indiscipliné ne serait jamais qu'un « fruit sec ». Pour réduire à néant ce pronostic, il conviendrait d'examiner l'activité dédoublée d'Inghelbrecht, en tant que compositeur et comme chef d'orchestre. Les deux personnages sont inséparables en lui. Nous n'avons pourtant pas à aborder ici le chapitre de ses nombreuses et intéressantes productions.
A l'exemple de M. Frigara, qui prit directement sa succession salle Favart, il avait d'abord été violoniste d'orchestre. Presque en même temps, de 1903 à 1908, il dirigeait lui-même ses premières œuvres à la Société Nationale. Pendant la saison 1908-1909, Robert d'Humières, directeur du Théâtre des Arts, l'appela pour les premières représentations de la Tragédie de Salomé de Florent Schmitt. En 1913 survint la création du théâtre lyrique des Champs-Elysées par Gabriel Astruc. La direction de la musique fut confiée à Inghelbrecht qui monte et dirige successivement Iberia et les Nocturnes de Debussy, Benvenuto Cellini de Berlioz, le Freischütz de Weber, la Péri de Paul Dukas. La 1re représentation en français de Boris Godounov, qui marqua la clôture de la direction Astruc, fut également dirigée par lui. Le 2 avril 1913, au cours de ce mémorable concert inaugural de musique française où Saint-Saëns, Debussy, Fauré, d'Indy et Paul Dukas prirent tour à tour la baguette afin de présenter leurs œuvres, Inghelbrecht donna pour sa part le scherzo de Lalo et l'Ode à la musique de Chabrier. Après la fermeture du théâtre des Champs-Elysées, Inghelbrecht se consacre à une association chorale parisienne (fondée en 1912) et dont la première manifestation publique eut lieu en janvier 1914. La guerre en interrompit le développement. En 1919, nous retrouvons Inghelbrecht à la tête des concerts Ignace Pleyel, institués par un groupe de jeunes musiciens d'orchestre pour exécuter, dans la salle de la rue Rochechouart, des œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles. En 1920, il se met à parcourir l'Europe avec la compagnie des Ballets Suédois de Rolf de Maré, à laquelle il reste attaché jusqu'en 1923. Avec cette troupe errante, il revient plusieurs fois au théâtre des Champs-Elysées. Debussyste fervent et fidèlement attaché à l'école moderne, il y dirige Jeux, la Boîte à joujoux, le Tombeau de Couperin, Skating Ring, la Nuit de Saint-Jean et sa propre composition El Greco. Au mois de septembre 1924, en remplacement d'Albert Wolff démissionnaire, Inghelbrecht fut nommé directeur de la musique à l'Opéra-Comique. Il y demeure jusqu'au 15 octobre 1925, date à laquelle les destinées de ce théâtre changent de maîtres. Au cours de cette année, il s'adonne, sans grande joie sans doute, aux pièces du répertoire comme Manon, Carmen, Lakmé, les Noces de Figaro. Il compte à son actif les reprises de Pénélope, de Pelléas et Mélisande et celle de Tristan et Yseult. Cette dernière passa pour très brillante et l'entrée à l'Opéra-Comique du chef-d'œuvre wagnérien se fit, malgré certaines insuffisances numériques du personnel instrumental, avec un incontestable éclat. Il ne nous plaît pas de créer des catégories ni de paraître grouper à part des chefs d'orchestre que l'on pourrait qualifier de second ou de troisième ordre. Disons plus simplement qu'à côté des vedettes et des célébrités, certains « conducteurs » n'ont pu occuper, par suite des circonstances, une place de premier plan, quel que fût leur mérite. Cela ne signifie nullement qu'ils aient manqué de valeur. Le regretté et pittoresque Toulmouche par exemple, était un musicien et avait du talent. M. Archainbaud, chef des chœurs, chef d'orchestre, directeur de théâtre en province, M. Fernand Masson, consciencieux propagandiste de musique française à l'étranger, ont chacun marqué leur place pendant leur passage à l'Opéra-Comique. Voici d'autre part M. Louis Masson, qui, après avoir longtemps tenu la baguette au Trianon-Lyrique, dont il était le directeur, a renoncé à ce rôle depuis qu'il a été nommé à l'Opéra-Comique. Ses nouvelles fonctions qui ont mis en lumière la personnalité du nouveau directeur du second théâtre lyrique, ont du même coup relégué dans l'ombre le souvenir de Louis Masson, chef d'orchestre. Il convient donc de noter pour mémoire les principales étapes de cette carrière. Fils d'un professeur de chant au Conservatoire de Paris, M. Louis Masson était lui-même issu de cette école, où Lavignac, André Gedalge, Paul Vidal, Gabriel Fauré l'avaient tour à tour chapitré. Il fut accompagnateur et répétiteur dans cet établissement. Chef de chant à Reims, il fut appelé par Maton à remplir les fonctions de chef d'orchestre adjoint au Casino de Trouville. En 1912, lorsque s'ouvrit le théâtre lyrique du Casino de Deauville, sous les auspices de M. Cornuché, la direction musicale et artistique en fut confiée à M. Louis Masson. Celui-ci, à la mort de Lagrange, fut accepté par le Conseil Municipal de Paris comme directeur du Trianon-Lyrique. Il remit en honneur toute une série d'œuvres classiques et un choix d'opéras-comiques de la seconde moitié du XVIIIe siècle, montant lui-même au pupitre dans la plupart de ces occasions. Ajoutons que si M. Louis Masson, depuis sa nouvelle fortune, a quitté la baguette, il a conservé, du moins jusqu'à présent, la direction ou au moins in partibus de son théâtre du boulevard Rochechouart qu'il mène de front avec celle de l'Opéra-Comique. Il a été ou il est encore aidé dans ces deux établissements par des collaborateurs immédiats qui n'ont pas encore peut-être personnellement atteint à une vaste notoriété mais qui ont à diverses occasions affirmé un mérite auquel il sied ici de rendre hommage. Tels M. Jacob qui a fonctionné successivement à la Gaîté-Lyrique, à Mogador et au Trianon-Lyrique, et M. Georges Lauweryns, qui, venu du Grand-Opéra de Monte-Carlo, est entré à l'Opéra-Comique au mois d'octobre dernier. A la Gaîté-Lyrique les fonctions de premier chef d'orchestre furent occupées par M. Edouard Flament, né à Douai le 27 août 1880 et qui obtint au Conservatoire un 2e prix de basson en 1898, un second prix de fugue en 1906 et au Concours de Rome une mention honorable, en 1908. M. Jacquet, autre chef d'orchestre du théâtre de la Ville de Paris, a été également directeur musical de l'importante société de la Sirène. M. Bergalonne, né à Mâcon le 4 juillet 1869, élève de Dancla et de Durand au Conservatoire, a conduit fréquemment à la Gaîté-Lyrique, au Trianon et en province. Il appartient aux générations que l'on peut qualifier de mûries. Tout autre est le cas de MM. Cloëz et Cohen, les deux jeunes chefs de l'Opéra-Comique qui ont déjà fait leurs preuves certes mais qui, surtout, représentent l'avenir. On en pourrait dire autant de M. Renaud qui, toutefois, s'est moins fréquemment affirmé en public que ses camarades.

Georges Lauweryns
Et parmi ceux qui méritent d'être signalés au public, citons M. J.-G. Szyfer, né en 1887, étudiant à la Sorbonne de 1906 à 1909, élève du Conservatoire de 1909 à 1913, où il remporta le 1er prix d'harmonie et de contrepoint, fonda en 1913 au théâtre Femina des concerts symphoniques quotidiens (1re tentative de ce genre à Paris). Directeur musical de la salle Marivaux en 1919, M. Szyfer est depuis 1924 chef d'orchestre des représentations cinématographiques à l'Opéra, où il crée, avec l'auteur M. Rabaud, le Miracle des loups (1924), Salammbô (1925), la Croisière noire (1926). Cette dernière œuvre fut également dirigée par M. Szyfer au théâtre de la Monnaie à Bruxelles et aux théâtres de Rome et de Madrid.
L'avenir s'ouvre également devant un chef comme M. Henry Defosse, né à Nogent-sur-Seine (Aube) le 28 mars 1883. Mais celui-ci a déjà un passé bien rempli et plus qu'honorable. Parti de l'école Niedermeyer et du Conservatoire où il fut élève de Fauré pour la composition, il a été accompagnateur des classes de chant et de déclamation du Conservatoire et chargé de cours pour les répétitions des rôles. Ce fut pour lui une bonne école qui le préparait excellemment aux fonctions de chef de chant qu'il allait occuper ultérieurement au théâtre des Champs-Elysées, puis à l'Opéra de Chicago. Il devint tout de suite chef d'orchestre des Ballets Russes de Serge de Diaghilev. Il conduisit à Londres (tous les soirs pendant 8 mois) à Manchester, au Costanzi de Rome, au Théâtre Réal de Madrid, à Lisbonne, à Lyon, à Monte-Carlo, en Amérique du Sud. Petrouchka de Stravinsky, Shéhérazade de Rimski-Korsakov, le Tricorne de Falla, le Prince Igor de Borodine, Astuce Féminine de Cimarosa, Pulcinella furent donnés sous sa direction. Enfin Henry Defosse entra à l'Opéra. Il y occupait le poste de confiance mais effacé de chef de chant lorsqu'il fut brusquement mis en valeur en dirigeant au pied levé le Martyre de Saint-Sébastien, en remplacement d'André Caplet. Deux ans plus tard, il rééditait cet exploit pour Boris Godounov. Le chef d'orchestre défaillant s'appelait cette fois Koussevitzky et le protagoniste qu'il s'agissait de « dompter » n'était autre que le redoutable Chaliapine. M. Henry Defosse s'acquitta avec crânerie et succès de cette mission, et ayant ainsi deux fois de suite sauvé la mise à la direction de l'Opéra, fixa définitivement sur lui l'attention du monde lyrique. Celui-ci attend désormais la continuation logique de cette carrière si prometteuse de chef d'orchestre. Nous ne saurions clore ici cet aperçu à la fois trop vaste et trop hâtif sans insister tant soit peu à nouveau sur la tâche si utile et si méritoire de ces musiciens qui, loin des satisfactions et de la réclame de la capitale, servent scrupuleusement la cause musicale en province. Il est impossible de tenter une énumération qui resterait incomplète. Certains noms, parmi les plus notoires ou tout au moins les plus respectables d'entre eux, doivent cependant retenir l'attention. Il y a de véritables militants comme M. Jean Gay. Né à Lyon en 1865, élève de Vincent d'Indy, il fonde en 1892 et dirige jusqu'en 1902 les Concerts Populaires du Havre. En 1910 il est sous-chef au Grand Théâtre de Lyon, directeur de la musique et sous-chef au Casino d'Enghien. Mais son principal titre de gloire, c'est le labeur tenace et intelligent qu'il fournit à la tête des Concerts Populaires d'Angers dont il est depuis 1912 l'animateur constamment dévoué au service de la musique, singulièrement de la production moderne. Parmi les musiciens qui offrent de tels exemples, on peut citer aussi, à un tout autre pôle de génération artistique, le jeune Prix de Rome Louis Fourestier, organisateur de concerts dans la Sarre et qui se fit le propagandiste le plus actif de la musique française dans ces régions.
Il y a aussi des vulgarisateurs d'un autre genre qui tentent d'amener par des voies plus aimables le public aux délassements musicaux. Tel Louis Ganne, compositeur quasi célèbre d'opérette. Les concerts Ganne à Monte-Carlo ne connurent-ils pas une vogue considérable ? Louis Ganne, né à Buxières-la-Grue (Allier), 1er Prix d'harmonie au Conservatoire en 1881, 1er accessit d'orgue en 1882, fut aussi chef d'orchestre au Nouveau-Théâtre en 1892, puis à Royan et dirigea les bals de l'Opéra. Il est mort à Paris le 13 juillet 1923.
Parallèlement aux Concerts Ganne, des manifestations symphoniques d'un grand intérêt se sont régulièrement déroulées à Monte-Carlo depuis de nombreuses années. Les Concerts du Casino étaient placés sous la direction de M. Léon Jehin, 1er chef d'orchestre de l'Opéra de la principauté. M. Jehin, né à Spa en 1853, étudia au Conservatoire de Liège la fugue, le contrepoint et, avec Léonard et Vieuxtemps, le violon. Chef d'orchestre à la Monnaie de Bruxelles de 1882 à 1898, il s'est fixé dès longtemps à Monte-Carlo où il dirige toutes les saisons lyriques. Chaque été cependant il se rendait à Aix-les-Bains où il avait la haute main sur le personnel musical du Théâtre du Grand-Cercle. Sur cette scène il eut l'honneur de monter, pour la première fois en France, Tristan et Yseult avec Litvinne, Van Dyck et Albers. A partir de 1911, Léon Jehin ne retourna plus à Aix. Sa femme, Mme Blanche DeschampsJehin a accompli une remarquable carrière de cantatrice.
Tandis que Jehin régnait sur les destinées du théâtre du Cercle d'Aix, l'orchestre de l'autre Casino, celui de la Villa des Fleurs était habilement stimulé par un autre chef de valeur, Philippe Flon, qui conduisit également à Nice et à Lyon. Ne confondons pas Philippe Flon, mort il y a quelques années avec son homonyme Paul Flon, chef d'orchestre de l'Opéra Municipal du Havre et du Casino de Trouville.
Avons-nous nommé tout le monde ? Ou plutôt, à côté des brillantes personnalités, avons-nous rendu à tous les modestes, mais utiles efforts, l'hommage que nous aurions voulu ? Il serait audacieux de le prétendre. D'aussi longues énumérations, qui risquent déjà de devenir fastidieuses ne sauraient tout englober. Nous espérons seulement avoir montré par ce coup d'œil d'ensemble jeté sur l'activité de nos chefs d'orchestre, l'harmonieuse progression historique de cette course au flambeau, dont le point de départ est, pour nous un Habeneck et qui ne doit jamais plus finir. En opposant les unes aux autres certaines de nos baguettes, en analysant brièvement les traits principaux de méthode qui les différencient, nous avons conscience de n'avoir nullement diminué leur valeur particulière aux yeux du public, mais d'avoir seulement essayé de situer les différentes silhouettes de ces maîtres dans leur diversité. La personnalité de chacun d'eux se détache mieux ainsi, semble-t-il de l'ensemble ; et, ce qui est l'essentiel de notre dessin, par le jeu même de ces oppositions et de ces rapprochements, la continuité de notre Ecole de chefs d'orchestre s'affirme, pensons-nous, suffisamment. Là, comme ailleurs, l'art français est « un ».