

LE RÊVE DU MENSONGE ET DE L'INCONSTANCE
aquatinte de Goya, supprimée dans l'édition définitive des Caprices. Détail. (Académie San Fernando, Madrid.)
EDITIONS ALBIN MICHEL
HENRY MALHERBE
CARMEN
Après les études qu'il a publiées sur Richard Wagner et sur Franz Schubert, Henry Malherbe nous offre aujourd'hui un ouvrage capital sur Georges Bizet. Critique musical du Temps pendant de longues années, secrétaire général puis directeur de l'Opéra-Comique, il a connu de près nombre de contemporains, d'interprètes et de familiers de Bizet. Il a été, en outre, lié d'amitié avec la femme et le fils du compositeur de Carmen.
Les causes du brusque décès du musicien de Carmen n'ont pas encore été élucidées. Bizet a-t-il succombé à la maladie ? Ou, brisé par l'amer abandon d'une femme et désespéré par la conjuration des critiques qui avaient condamné Carmen, s'est-il suicidé ? Henry Malherbe a fixé les particularités du drame qui s'est joué dans l'ombre. Il en a serré de près chaque point, sans vouloir prendre parti.
Dans cette disparition soudaine d'un grand musicien, à l'âge de trente-six ans, d'aucuns ont été jusqu'à découvrir les effets du pouvoir d'envoûtement de la gitane fataliste, évoquée avec tant d'intensité par Bizet. Mérimée qui, à une période de sa vie, fut un adepte du magisme, appelait Carmen « la jolie sorcière ». Dans la nouvelle mériméenne, comme dans la partition de Bizet, la magie tient son rôle troublant et pressant. De là, peut-être, la force mystérieuse dont Carmen s'est augmentée sur la scène lyrique.
Si, dans Carmen, le fin fond incantatoire du conte de Mérimée et de la musique de Bizet est abordé et traité comme il convient et si la figure de Georges Bizet y est remise dans son vrai jour et illuminée de nouveaux rayons, c'est le côté musical qui s'y trouve pourtant développé avec toute la largeur qui s'imposait. Trop de musicographes ont été tentés d'amoindrir l'importance de Bizet dans l'évolution des forces lyriques. On a continué d'en juger avec légèreté, même après que Nietzsche eut essayé de démontrer la supériorité de Georges Bizet sur Richard Wagner. Igor Stravinsky, qui accorde au compositeur de Carmen le premier rang dans la musique française, n'a pu venger Bizet des injustes dédains de ses commentateurs superficiels.
C'est dans Carmen que le génie de Georges Bizet s'est entièrement accompli et a jeté tout son feu. Henry Malherbe a donc passé assez rapidement sur les autres partitions du maître parisien. Avec Carmen, qui s'applique étroitement à la réalité des passions humaines, Bizet aura été le grand artisan de l'affranchissement et du renouvellement de la musique dramatique. Ce sont ses secrets de composition qu'Henry Malherbe s'est attaché à éclairer dans l'analyse très poussée qu'il a tracée de Carmen.
Du bout de sa plume prompte et acérée, Frédéric Nietzsche n'a fait qu'indiquer, avec brièveté et précision, la valeur, l'efficacité et la beauté irrésistible et légère du chef-d'œuvre de Bizet. L'étude décisive d'Henry Malherbe, qui est allé au fond de l'art du musicien de Carmen, forme la perspective et le prolongement du commentaire divinateur du grand philosophe de Roecken. A côté du Cas Wagner et des Gloses marginales sur Carmen de Nietzsche, il faut désormais placer Carmen.
Un volume in-8° grand-écu de 320 pages avec 8 hors-texte.
Du même auteur :
LA FLAMME AU POING (Prix Goncourt, 1917) (Albin Michel). Un vol. in-16.
LA PASSION DE LA MALIBRAN (Albin Michel). Un vol. in-16.
RICHARD WAGNER, RÉVOLUTIONNAIRE (Albin Michel). Un vol. in-8°.
AUX ÉTATS-UNIS, PRINTEMPS DU MONDE (Albin Michel). Un vol. in-16 avec 2 hors-texte.
FRANZ SCHUBERT, SON AMOUR, SES AMITIÉS (Albin Michel). Un vol. in-8° avec 8 hors-texte.
LE JUGEMENT DERNIER (La Sirène).
HISTOIRE DE LA MUSIQUE RUSSE (Delagrave),
CINQUANTE ANS DE MUSIQUE FRANÇAISE (Librairie de France).
EDOUARD LALO (Le Ménestrel).
A paraître prochainement :
LES ÉTOILES OBSCURES, roman.
APPARITIONS, contes.
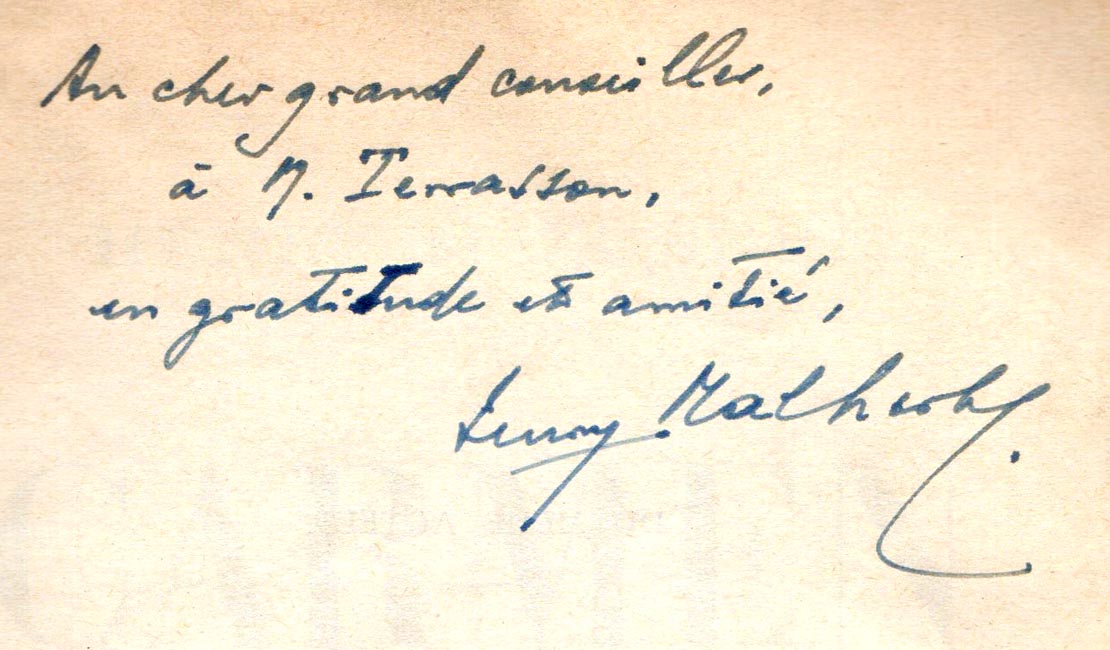
dédicace par l'auteur d'un exemplaire de son livre
HENRY MALHERBE
CARMEN
ÉDITIONS ALBIN MICHEL
22, rue Huyghens
PARIS
1951
Aux artistes du Choral et du Corps de Ballet de l'Opéra-Comique dont j'ai, depuis de longues années, éprouvé la valeur, l'ardeur au travail et le dévouement à la musique.
TABLE DES MATIÈRES
Avant-propos
PREMIÈRE PARTIE
LA VIE ET L'ŒUVRE DE GEORGES BIZET
I. — La Jeunesse de Bizet
II. — Bizet en Italie
III. — « les Pêcheurs de perles »
IV. — « la Jolie fille de Perth »
V. — Rencontre avec Céleste Mogador
VI. — Mariage de Bizet
VII. — Geneviève Bizet
VIII. — Transformation progressive
IX. — Suites d'une guerre
X. — « Djamileh »
XI. — « Jeux d'enfants »
XII. — « l'Arlésienne »
XIII. — Parenté entre « l'Arlésienne » et « Carmen »
DEUXIÈME PARTIE
LE MYSTÈRE DE LA MORT DE GEORGES BIZET
XIV. — Le faux échec de « Carmen »
XV. — Georges Bizet s'est-il suicidé ?
XVI. — Les « Carnets » de Ludovic Halévy
XVII. — Les obsèques de Bizet
TROISIÈME PARTIE
PROSPER MÉRIMÉE ET « CARMEN »
XVIII. — Voyages en Espagne
XIX. — La magie de « Carmen »
XX. — Le récit de Mérimée
XXI. — Un écrivain érudit et secret
QUATRIÈME PARTIE
LE LIVRET DE « CARMEN »
XXII. — Les personnages introduits par Meilhac et Halévy
XXIII. — Le scénario de « Carmen »
XXIV. — La musique légère en 1875
XXV. — Bizet a collaboré au livret
XXVI. — Les emprunts au conte de Mérimée
CINQUIÈME PARTIE
LA PREMIÈRE REPRÉSENTATION DE « CARMEN »
XXVII. — Incidents autour de « Carmen »
XXVIII. — La soirée du 3 mars 1875
XXIX. — Vincent d'Indy à la première représentation de « Carmen »
XXX. — Frédéric Nietzsche et Georges Bizet
SIXIÈME PARTIE
LA PARTITION
XXXI. — « Carmen » et la musique espagnole
XXXII. — Le prélude
XXXIII. — Le premier acte
XXXIV. — Le deuxième acte
XXXV. — Le troisième acte
XXXVI. — Le quatrième acte
FINALE
APPENDICE
« CARMEN » AU THÉATRE-LYRIQUE
« Carmen » et la mise en scène du drame lyrique
Un ballet inspiré de « Carmen »
AVANT-PROPOS
A l'une de ses cimaises, le musée du Louvre expose le grand tableau, les Wagnéristes, achevé par Fantin-Latour en 1885. Peinture d'un rendu délicat et sévère, un peu à la manière de Rembrandt et dans ses tonalités sourdes et sombres. On songe aux Syndics des drapiers et à la Leçon d'anatomie. On y voit, portraiturés et groupés autour d'Emmanuel Chabrier, qui s'est assis devant un piano de concert : Adolphe Jullien, Armand Boisseau, Camille Benoît, Antoine Lascoux, Vincent d'Indy, Edmond Maître et Amédée Pigeon. Sur le pupitre, une partition est ouverte que Chabrier semble détailler et commenter. Les figures des experts en musique qui l'entourent sont empreintes d'émotion et de gravité.
Quelle est donc l'œuvre rare que ces musiciens, ces critiques et ces mélomanes écoutent, dans cette atmosphère de pieux recueillement ? Tout de suite, on pense que les « wagnéristes » sont réunis pour s'enchanter d'une épopée wagnérienne encore peu connue à Paris.
Eh bien ! approchez-vous du panneau ; regardez de près le rectangle blanc de la musique reproduite par l'artiste. La partition fascinante autour de laquelle Fantin-Latour a assemblé les fanatiques du culte wagnérien est celle de Carmen. L'artiste minutieux a pris le soin de peindre de son pinceau réaliste le titre du chef-d'œuvre de Georges Bizet.
Fantin-Latour, qui a illustré la Tétralogie avec des lithographies tendrement caressées, était, lui-même, fervent admirateur de Richard Wagner. Avant d'adopter le titre de la partition qu'il convenait de placer au centre de son tableau, j'imagine qu'il a dû longtemps discuter avec les modèles qu'il s'était choisis.
Wagner était mort depuis deux ans. Batailler encore pour conquérir à son art de nouveaux suffrages était désormais sans objet. Sa musique plongeait dans un mystique ravissement des auditoires de plus en plus étendus.
Sur quel chef-d'œuvre incompris et neuf le peintre et ses « wagnéristes » devaient-ils attirer l'attention ?
En 1883, après une interruption qui avait duré un peu plus de sept ans, Carmen, heureusement lancée sur les scènes lyriques de l'étranger, était enfin revenue à l'Opéra-Comique. Malgré les éloges d'une partie de la presse et bien que le chef-d'œuvre eût été poussé, en moins de trois ans, jusqu'à sa deux centième représentation, nombre de musiciens et de critiques musicaux n'avaient pas l'impression juste et entière de la valeur d'art de Carmen. Ils n'en démêlaient ni les sentiments inspirateurs, ni les recherches ingénieuses. Obsédés par leurs idées fausses, ils continuaient de considérer étourdiment Georges Bizet comme un disciple à peine émancipé de Richard Wagner, alors que, de leur vivant, les deux grands musiciens étaient restés étrangers l'un à l'autre.
Mieux que tous, les « wagnéristes » qui figuraient sur le tableau de Fantin-Latour savaient que Bizet ne s'apparentait par aucun côté à Wagner. Pourtant, ils avaient décidé, d'un commun accord, de négliger la cause wagnérienne, déjà triomphante, pour en appeler du jugement mal fondé qui avait condamné Carmen. Entre tant de partitions qui s'offraient, ils avaient arrêté leur choix sur la plus dépréciée, la plus attaquée, en 1875 : sur celle de Bizet. Ils révélaient publiquement leur admiration pour le maître français. Ils marquaient leur volonté de faire toute réparation à la mémoire du musicien original et fort de Carmen, mort sous les coups d'une cabale formée par des esprits rétrogrades.
***
Pendant les années que j'ai passées à l'Opéra-Comique, j'ai eu de fréquents entretiens avec ceux qui avaient connu Bizet. Ils voulaient paraître informés des causes de sa mort prématurée. Pour la plupart, ils soutenaient que le musicien de Carmen s'était suicidé. Comme j'opposais à leurs assertions la thèse de la maladie, — thèse admise par tous les biographes de Georges Bizet et confirmée par Geneviève Bizet elle-même, — ils répondaient que, dans les jours qui suivirent le décès du regretté musicien, la nouvelle de son suicide était tenue pour vraie dans les milieux d'art et même par certains de ses amis. Dans les loges et les couloirs de l'Opéra‑Comique, on épiloguait d'abondance sur les faits qui s'étaient produits avant la mort de Bizet et avaient pu pousser le compositeur au suicide.
Dans cette étude biographique brève, mais que je veux complète, je me crois obligé de tenir compte des propos qui ont circulé sur ce suicide. Je les rapporte tels qu'ils m'ont été communiqués au cours des douze années pendant lesquelles j'ai été attaché à la direction de l'Opéra-Comique. Plus loin, on comprendra pour quels motifs je me défends de prendre parti.
Galli-Marié, créatrice du rôle de Carmen, s'était éprise, disait-on, de Bizet. Ils se querellaient souvent. Après une dispute violente, ils s'étaient séparés. C'est à la suite de cette rupture que le musicien serait tombé gravement malade et aurait, peu après, mis fin à ses jours. A sa mort, ses nombreux amis tinrent rigueur à l'irascible cantatrice. Elle pouvait difficilement reparaître sur une scène parisienne. Ni Emile Perrin, ni Léon Carvalho qui avaient succédé à Camille du Locle ne lui firent contracter un nouvel engagement pour l'Opéra-Comique. Elle se résigna à ne chanter qu'en province et à l'étranger. Quand, après sept années d'attente, Carvalho accepta de remonter Carmen, le 21 avril 1883, il n'osa pas faire appel à celle qui avait créé de façon inimitable le rôle de la gitanilla. L'interdit qui pesait sur Galli-Marié ne fut levé que quelques mois plus tard. Le 27 octobre 1883, — plus de huit ans après la mort de Bizet, — elle fut affichée de nouveau, à l'Opéra-Comique, dans le rôle de Carmen qu'elle avait fait sien. Et cela, sur le désir exprimé par Mme Georges Bizet.
Geneviève Bizet était-elle, de son côté, pure de tout reproche, dans les cruelles épreuves qui avaient accablé Georges Bizet ? Elle ne cherchait pas à cacher ses sentiments de vive affection pour le pianiste Delaborde. Bizet n'ignorait pas ce penchant. On prétendait même qu'à son lit de mort, il n'avait fait appeler Delaborde que pour lui accorder généreusement son pardon et lui demander de veiller sur Mme Georges Bizet. Elle avait, en effet, soigné son mari, pendant sa dernière maladie, avec un dévouement digne d'admiration.
Il me faut ajouter ici qu'après la mort du musicien de Carmen, Geneviève Bizet s'était engagée à épouser, en secondes noces, le pianiste Henri Delaborde. Au dernier moment, elle revint sur sa promesse. C'est Ludovic Halévy qui fut chargé d'expliquer à Delaborde pour quelles raisons Mme Georges Bizet se refusait à une nouvelle union. Ce projet de mariage qui n'aboutit point ne suffit pas pour qu'on accepte pour véritable la clémence cornélienne prêtée à Georges Bizet sur le point d'expirer.
D'autre part, les articles offensants des critiques, publiés dans les journaux, après la première de Carmen, ont influé profondément non seulement sur le moral, mais aussi sur l'état de santé de Bizet. Si les mêmes critiques ont fait volte-face au lendemain de la mort de Bizet et couvert de louanges celui qu'ils avaient voulu discréditer trois mois plus tôt, c'est parce qu'ils avaient appris quelle suite funeste leurs chroniques avaient eues sur l'esprit et les nerfs du grand musicien. Quinze ans après la création de Carmen, le Syndicat de la Presse donnait une représentation de gala dont l'importante recette fut entièrement consacrée à un monument à Georges Bizet. Les professionnels du journalisme désavouaient ainsi avec éclat les critiques qui avaient jugé, avec une légèreté impardonnable, du chef-d'œuvre, lors de sa première audition publique.
Si, comme les éditeurs de Carmen et plusieurs contemporains de Bizet, on croit que le compositeur s'est suicidé, pourquoi ne pas admettre tout simplement que, se voyant perdu, il ait voulu abréger ses intolérables souffrances ? Je sais que, dans le monde du théâtre, on a tendance à grossir et à déformer les événements qui s'y produisent. N'a-t-on pas brodé à l'avenant sur les tristes incidents qui ont précédé la mort de Bizet ?
Par la qualité sérieuse de sa pensée, par son érudition animée et par son esprit d'ordre et de clarté, M. Daniel Halévy mérite d'être classé au premier rang des essayistes contemporains. Fils de Ludovic Halévy et cousin issu de germain de Geneviève Bizet, il possède les quarante petits volumes où son père, d'une écriture fine et penchée, a consigné les faits marquants de son existence. Existence intimement liée à celle de Bizet, dans les dernières années du compositeur.
M. Daniel Halévy s'est plié de bonne grâce à mon désir de faire la lumière sur les causes de la mort de Bizet. Il m'a affirmé que, jamais, dans sa famille, où le souvenir de Bizet était, chaque jour, rappelé, l'on n'avait soufflé mot du prétendu suicide du musicien de Carmen. Il a bien voulu me mettre entre les mains les Carnets de Ludovic Halévy. Aux pages 188 et 189 du XXXVIe tome de ces mémoires, d'un vif intérêt, j'ai lu et relu le récit de la mort subite de Georges Bizet. J'en ai reproduit l'essentiel dans la deuxième partie de mon étude.
Je signale seulement qu'à la page 189 trois lignes ont été si énergiquement rayées qu'il est impossible de déchiffrer, sous les ratures, le texte primitif. A en juger d'après ce que j'ai pu voir, dans ses Carnets, Ludovic Halévy, qui n'était pas obligé de s'en taire, n'a pas noté les bruits qu'on faisait courir sur le suicide de son cousin Georges Bizet. La question agitée, au moment de la disparition du jeune maître, dans l'anxiété et la consternation générales, n'est pas près d'être résolue.
***
En composant sa partition, avec le tourment douloureux et harcelant de pénétrer jusqu'aux sources secrètes de la passion de don José, Georges Bizet semble lui-même avoir fléchi sous le souffle dévastateur et maléfique de Carmen. Jamais encore, il n'avait été aussi longtemps absorbé par l'un de ses ouvrages. Durant deux années, avec une sorte de frénésie lucide, il avait cherché des sortilèges sonores pour évoquer l'obsédante et dangereuse sorcière d'Andalousie.
Il s'y était appliqué avec des efforts si intensément prolongés que la vision avait passé du monde des ténèbres dans celui des apparences humaines. Il sentait la présence respirante de la gitane toute proche. Il avait poursuivi et traqué le fantôme de la bohémienne. A ses appels mélodieux, le fantôme s'était levé avec les feux de la vie.
Sur les visages des femmes de caprice ou de violence qui réveillaient ses derniers désirs, le musicien croyait voir se poser le masque de Carmen. La petite devineresse des bords du Guadalquivir exerçait son pouvoir tyrannique et maudit sur l'âme et jusque sur la chair de Georges Bizet. Quand il exprimait, avec tant de sincérité pressante, les tortures de don José, il criait les souffrances qu'il endurait lui-même. Souffrances qui devaient provoquer sa mort soudaine. En faisant souvent sonner, dans Carmen, l'annonce du destin, il savait, peut-être, qu'il s'agissait de son propre destin.
***
Aucun théâtre lyrique au monde ne peut se dispenser d'afficher, chaque saison, le chef-d'œuvre de Georges Bizet. A la date où j'écris, Carmen est en route, à l'Opéra-Comique seulement, pour atteindre sa 2.700e représentation. Comme critique musical ou comme secrétaire général et directeur de l'Opéra-Comique, je l'ai moi-même entendue plus de trois cents fois. Toujours avec un plaisir nouveau, avec une émotion nouvelle et en discernant, à chaque audition, un détail piquant et rare qui m'avait auparavant échappé.
Cette musique a été divulguée par tous les moyens de transmission connus : orgues mécaniques, boîtes à musique, disques, films, radio. Elle a perpétuellement de quoi toucher, séduire, enchanter. La bohémienne fataliste chante et danse sur tous les tréteaux et, pour ainsi dire, à chaque coin de rue. Petite héroïne obligée des loisirs musicaux de chacun, elle est si familière à nos esprits qu'on ne songe plus aux côtés inquiétants de sa nature étrange.
Quel est le secret de cette puissance d'attraction sur tant d'auditeurs venus de tous bords et issus de générations successives ? Générations habituellement partagées jusqu'au divorce sur les questions d'un art qui change avec les modes et les mœurs.
Cette partition a le mouvement de la vie même. Elle a une action à la fois psychique et physique. Elle frappe tout ensemble l'âme et les centres nerveux. Elle est musique et danse, sentiment et sensation, rêve et réalité. Une énergie en jaillit qui se communique irrésistiblement aux auditeurs de toutes catégories, aux érudits comme aux ignorants, aux artistes comme aux simples gens. Musique qui retentit directement sur tous ceux qui l'entendent et qui sont eux-mêmes des résonateurs. Les ondes qui s'en dégagent sont, si je peux dire, en corrélation étroite avec les ondes émises par un auditoire, quel qu'il soit.
D'intuition et de génie ou après un travail fiévreux et opiniâtre, Georges Bizet a découvert, pour son drame, les néologismes harmoniques et les courbes mélodiques qui provoquent à coup sûr le choc émotif. Leur mise en place a été ménagée, de science théâtrale certaine, entre des locutions de tout repos et plus ou moins gracieuses et égayées.
A la création, on trouvait généralement que Carmen était d'une facture trop irrégulière, d'une inspiration trop neuve pour répondre aux dispositions de la critique et du public de l'époque.
Aujourd'hui qu'à l'encontre des opinions exprimées après la première représentation, le chef-d'œuvre a conquis une faveur immense, une faveur universelle, on s'accorde à dire que cette réussite totale, vertigineuse est due au fait que la musique en est spécifiquement populaire, qu'elle a été écrite pour le peuple. Hé non ! Les œuvres faites pour le peuple sont justement celles que le peuple refuse, à échéance plus ou moins différée. Cela donne à penser que ce sont les chants imprévus, spontanément épanchés du cœur et composés sans souci de lucre ni de succès immédiat, qui sont finalement adoptés par le plus grand nombre de groupements humains.
La partition de Carmen est d'une originalité puissante, voire agressive. A présent, elle reste aussi unique de son espèce qu'à la date où elle fut révélée aux spectateurs de l'Opéra-Comique.
A y regarder de près, Carmen est encore l'œuvre la plus déroutante, la plus audacieuse de tout le répertoire lyrique. La musique en a été tant ressassée et défigurée qu'on ne prête plus assez d'attention à ses richesses intimes, à ses particularités multiples et enchantées. Valeurs nonpareilles, éparpillées et si bien voilées et masquées par le musicien lui-même qu'on finit par ne plus les apercevoir.
Les beautés caractéristiques et subtiles d'un chef-d'œuvre lyrique, classé ou non, peuvent être méconnues aussi bien lorsque le chef-d'œuvre en question est très rarement joué que quand il l'est trop souvent. C'est parce qu'on entend Carmen à toute heure et en tous lieux, depuis de longues années, que, pour des esprits sans curiosité ni culture, la partition a perdu de sa tranchante singularité et de ses propriétés inventives, — par quoi elle devrait d'abord s'imposer à notre admiration.
Pour les musiciens indépendants et résolument d'avant-garde, il est réconfortant de penser que Faust et Carmen, dont le succès inépuisable se prolonge et se perpétue, furent, à leur aurore, les œuvres les plus calomniées du répertoire. Au gré de leurs nombreux censeurs, Gounod et Bizet avaient scellé leurs deux chefs-d'œuvre d'une empreinte trop personnelle. Ils avaient mis trop d'innovations dans leur musique théâtrale. Innovations si bien incorporées dans la langue des compositeurs dramatiques suivants qu'elles semblent maintenant toutes simples et naturelles.
Plus que dans Faust, il y a dans Carmen, à travers des pages de gaîté légère, une force juvénile et saine, une sincérité prenante, un pathétique naïf et profond, un coloris intense, un feu de passion vraie. Georges Bizet a, en quelque sorte, humanisé la musique théâtrale. Il l'a plongée dans notre réalité quotidienne. Les véristes, venus à sa suite et qui se réclament de lui, n'ont pas eu, dans leurs improvisations fades ou brutales, ses scrupules de conscience ni ses raffinements de forme et d'idées.
Quoi qu'il en soit, Carmen est la haute source, la première station de la musique dramatique moderne. C'est à partir de Carmen que la langue mélodique et harmonique des compositeurs de la scène s'est enrichie d'expressions et de dosages sonores que notre théâtre lyrique ignorait auparavant. Conquêtes essentielles, désormais assurées et dont profiteront ceux qui succéderont à Bizet. A tous les artistes qui s'aventurent sur la scène musicale, Carmen aura ouvert de larges horizons d'une séduction magnétique.
On imagine difficilement les obstacles de toute nature que Georges Bizet eut à surmonter pour édifier, comme il l'avait projeté, son chef-d'œuvre suprême, destiné à l'Opéra-Comique. La salle Favart avait alors, avec la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques, un traité qui lui interdisait de représenter d'autres ouvrages que les opéras-comiques coulés dans les moules traditionnels, avec dialogues parlés et musique par tranches. Coûte que coûte, il fallait que Bizet s'accommodât de vaines formules qui donnaient, dès cette date et de façon visible, des signes d'épuisement.
Que de calculs pour échapper aux conventions respectées des musiciens à la mode et de tous les habitués de la salle Favart ! Que de courage pour faire passer sa pensée personnelle dans la partition; pour rendre l'expression plus pénétrante avec des accents vrais et tirés du cœur ; pour s'écarter du langage empommadé, poncif, réglementaire et dont les tournures étaient obligatoirement empruntées à un fonds lyrique commun ; pour, enfin, faire preuve d'imagination, d'initiative, d'originalité !
Bien des études ont été faites de Carmen. A mon sens, on n'y a pas suffisamment insisté sur les bonheurs d'expression du grand musicien; sur ses découvertes en dessous ; sur ses recherches des nuances justes pour traduire les sentiments ; sur les changements, lourds de conséquences, qu'il a réussi à amener dans la nouvelle organisation des formes sonores.
En s'attelant à sa besogne de bon ouvrier de la musique, en s'acharnant à mieux faire, Georges Bizet ne se doutait pas lui-même qu'il serait tenu, un jour, pour l'un des plus intrépides libérateurs de l'art des sonorités, pour le créateur du drame moderne chanté, pour le fondateur du réalisme dans le domaine du théâtre lyrique.
Jamais il ne s'est posé en réformateur. Durant sa brève existence, il n'a pas songé à faire étalage de théories ambitieuses ni à lancer des manifestes séditieux et enflammés. Doué à miracle, il avait néanmoins appris son métier avec obstination, avec ferveur, et en avait pénétré tous les secrets. Il ne s'appliqua d'abord qu'à des ouvrages agréables. En essayant d'extraire de son art tout ce qu'il pouvait contenir de neuf et de vibrant, il parvint à élargir les principes reçus de ceux qui l'avaient précédé. Ainsi, il trouva sa propre voie. Seules, ses trois dernières partitions renferment des éléments qui n'appartiennent qu'à lui et portent ostensiblement sa marque.
Encore ne voulait-il pas heurter le public de son temps. Jusque dans ses productions de la fin, il enveloppe, estompe tout ce qu'il introduit de personnel dans le langage des sonorités. Il s'efforce à unir ses inventions avec les procédés en circulation et en honneur dans l'ancien théâtre lyrique. Les musiciens qui l'entourent et qui ont démêlé le vrai de sa nature ne s'y trompent pas. D'autres, et parmi eux mon vieil ami regretté Adolphe Jullien, critique musical du Journal des Débats, se prennent aux artifices et s'arrêtent à la façade de Carmen.
Dans les pages qui vont suivre, je tâcherai de faire la part exacte des choses. Déjà dans Djamileh, Jeux d'enfants et l'Arlésienne, on observe combien Georges Bizet peine, sous les contraintes de la musique régnante, pour sauver son originalité et se hisser aux altitudes et aux belles libertés. Avec Carmen, il fait éclater le vieux cadre de l'opéra-comique, crève le ciel de toile peinte du théâtre lyrique et s'élève dans le plein air purifié, vivifiant et lumineux. Sa dernière partition brille d'une flamme inextinguible. Comme brillent au firmament les étoiles, avec leurs éternels miroitements.
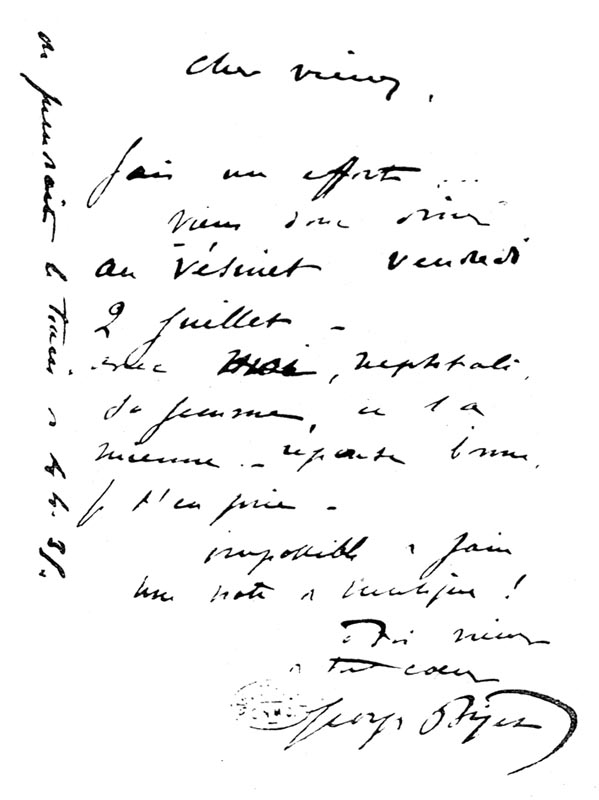
lettre autographe de Georges Bizet
PREMIERE PARTIE
LA VIE ET L'ŒUVRE DE GEORGES BIZET
I
La musique occupe le fond de la vie de Bizet, dont Carmen est la flamme extrême. Il est nécessaire d'évoquer ici l'existence du compositeur, à ses principales stations, et d'en éclairer les points saillants. Je le ferai avec la simplicité que Bizet aimait par-dessus tout. Je n'y ajouterai que quelques détails biographiques qui ne figurent dans aucune étude consacrée au musicien de Carmen. Détails que je tiens de la femme et du fils de Georges Bizet.
Georges Bizet est né le 25 octobre 1838, à Paris, 26, rue de la Tour-d'Auvergne, sur la pente commençante du divertissant quartier montmartrois. De là, peut-être, son caractère enjoué, cette vivacité d'esprit, cette jovialité frondeuse qu'on respire avec l'air dans ce coin pittoresque de la capitale. Son père, Adolphe Bizet, était professeur de chant. Son oncle, François Delsarte, également professeur de chant, jouissait d'un grand renom. Sa mère était une pianiste de mérite et sa tante maternelle, Mme Delsarte, une virtuose du piano, fort estimée en son temps. A la mairie du IXe arrondissement, l'enfant fut, dit-on, déclaré sous les prénoms d'Alexandre-César-Léopold. Prénoms pompeux sous lesquels il fut inscrit au Conservatoire. Ses parents, ses amis et tous ceux de son entourage l'appelaient Georges. Lui-même signa ses partitions Georges Bizet.
Les registres de l'état civil ayant été détruits sous la Commune, on n'a pu retrouver l'acte de naissance qui portait les prénoms d'Alexandre-César-Léopold. En revanche, l'acte de baptême, dressé sous le numéro 37, en l'église Notre-Dame-de-Lorette, a subsisté. On y lit ces lignes : « Le 16 mars 1840, a été baptisé Georges, né le 25 octobre 1838, fils d'Adolphe-Armand Bizet, professeur de chant, et de Aimée-Léopoldine-Joséphine Delzar. » (Le prêtre a déformé le nom de Delsarte.)
Dans cette atmosphère familiale, saturée de musique, Georges Bizet devait être vite initié à l'art des sonorités. Dès l'âge de quatre ans, il connaissait les premières notions de solfège que lui avait enseignées sa mère. A huit ans, il jouait correctement du piano et avait appris en partie l'harmonie. Son père le présentait, un an après, à Meifreid, membre du Comité des études du Conservatoire. Le grave personnage fut surpris par la science dont témoignait déjà l'enfant. Victor Wilder nous a raconté leur entrevue :
— Que sait-il faire ? demanda Meifreid.
— Placez-vous devant le clavier, dit le père de Bizet, frappez les accords que vous voudrez et il vous les nommera sans faire une erreur.
Le dos tourné à l'instrument, l'enfant nomma, en effet, sans hésiter, tous les accords que Meifreid lui faisait entendre et qu'il choisissait à dessein dans les tonalités les plus inusitées.
Malgré la recommandation de Meifreid, le petit Georges Bizet ne put être admis au Conservatoire. Aucune place d'élève n'était vacante, cette année-là, dans les classes de solfège et de piano. L'enfant prodige suivit, en qualité d'auditeur, les cours de piano de Marmontel. Ce n'est qu'à l'âge de douze ans qu'il fut régulièrement inscrit sur les registres de l'établissement du faubourg Poissonnière.
Six mois plus tard, Bizet remportait la première médaille de solfège et, à l'âge de quatorze ans, le premier prix de piano, dans la classe de Marmontel. Zimmermann, qui avait longtemps brillé dans l'enseignement du contrepoint et de la fugue et avait abandonné cette branche de l'écriture musicale, voulut absolument enseigner la matière en question au jeune Bizet. A dix-sept ans, notre étudiant obtenait le premier prix de contrepoint et fugue et, dans la classe de Benoît, le premier prix d'orgue. Elève de Fromental Halévy, pour la composition, il fut présenté au concours de Rome. Il n'avait pas encore atteint dix-huit ans, quand il conquit le second Grand Prix de Rome. Cette année-là, le premier Grand Prix ne fut pas décerné. Bizet l'avait mérité, de l'avis de tous les jurés. Il avait été trouvé trop jeune pour être envoyé en Italie. Il dut attendre l'année d'après pour recevoir le premier Grand Prix, avec la cantate Clovis et Clotilde.
Dans l'intervalle, Bizet avait participé à un concours d'opérettes, organisé par Jacques Offenbach, alors directeur du théâtre des Bouffes-Parisiens. Le livret imposé était le Docteur Miracle de Léon Battu et Ludovic Halévy. Les deux premiers prix ex-æquo furent attribués à Georges Bizet et à son condisciple dans la classe de Fromental Halévy, Charles Lecocq. On joua alternativement les deux ouvrages sur la scène des Bouffes-Parisiens.
Lecocq allait se consacrer définitivement à la musique légère. Il sut en recueillir tous les avantages. Bizet faillit être entraîné du même côté. Son humeur joyeuse, sa facilité l'y poussaient.
Six mois après sa venue à Rome — il n'avait pas encore tout à fait vingt ans — il écrivait : « Je suis décidément fait pour la musique bouffe et je m'y livre complètement. » Il ne refoula ce penchant qu'à regret, tout en y cédant plus d'une fois, au cours de son existence.
On peut remarquer que ce sont justement les musiciens qui n'affectaient pas un maintien sévère, ceux qui s'abandonnaient sans contrainte au plaisir, à la raillerie, à la gaîté, ceux qui se défiaient de l'emphase et de la solennité — un Mozart, un Bizet, un Moussorgski, un Chabrier, un Debussy — oui, ce sont ceux-là qui ont conféré à leur art ses accents les plus neufs, les plus humains et les plus profonds.
II
Parti de Paris le 21 décembre 1857, Georges Bizet ne parvint que le 27 janvier 1858 à Rome. Il devait y accomplir le stage de deux années, imposé aux lauréats du premier Grand Prix pour la composition musicale.
Carafa, frère cadet du prince Carafa de Colobrano et arrière-petit-neveu du pape Paul IV, ancien chef d'escadrons des hussards de Murat, devenu compositeur et professeur au Conservatoire de Paris, tint absolument à donner au jeune voyageur une lettre de recommandation pour le compositeur Mercadante, alors en grand renom. Bizet décacheta la lettre et la lut, avant de la remettre. Elle était ainsi conçue : « Mon vieil ami, je te recommande vivement le porteur de la présente, M. Bizet, lauréat du Conservatoire. C'est un jeune homme sympathique et bon garçon, mais, soit dit entre nous, en fait de talent, c'est un âne. » Je donne ici la version communiquée par le sculpteur Maxime Real del Sarte, cousin de Georges Bizet.
Dans son livre, Georges Bizet et son œuvre, Charles Pigot a publié un autre texte de cette « lettre de recommandation ». Bien entendu, Bizet ne fit pas parvenir la missive à Mercadante. « J'ai pris le parti, écrivait-il, de ne jamais remettre de lettre de recommandation cachetée. Celle que le père Carafa m'avait donnée me sert de leçon. J'ai eu assez bon nez en la décachetant sans la porter. » A son retour à Rome, Carafa demanda à Bizet pourquoi il ne s'était pas servi de « la lettre de recommandation ». Bizet répliqua astucieusement : « Monsieur Carafa, quand on a la chance d'avoir un autographe d'un homme comme vous, on le garde. » Dans une lettre qu'il envoyait de Rome le 19 janvier 1860, Bizet ne ménageait pas le musicien napolitain, ami et grand protégé de Rossini. « Vieux crétin, va ! disait-il. Je te promets, ô père Carafa, d'écrire un jour ta biographie et de donner cette lettre à la fin du volume en guise d'autographe ! Ce sera édifiant ! » Carafa, devenu membre de l'Institut, où il remplaça Lesueur, est mort en 1872.
Bizet éprouva d'amères désillusions à son arrivée à Rome — tout comme Berlioz et Debussy. Pourtant, à l'encontre de ces deux grands musiciens, il fut vite conquis à l'Italie. Si l'on y jouait de façon ridicule de la musique plus ou moins honorable (*), les peintures, les sculptures, les jardins et les paysages provoquaient son admiration.
(*) Dix-neuf ans plus tôt, Stendhal, enthousiaste de l'Italie, écrivait pourtant dans la Chartreuse de Parme : « ... Fabrice pleura à chaudes larmes pendant plus d'une demi-heure. Par bonheur, une symphonie de Mozart, horriblement écorchée, comme c'est l'usage en Italie, vint à son secours et l'aida à sécher ses larmes » (p. 467-468 de l'édition originale).
Très liant, il noua de nombreuses amitiés dans la Ville éternelle et, grâce à sa virtuosité de pianiste, s'attacha jusqu'à l'austère Schnetz, directeur de la villa Médicis. Tant et si bien qu'au lieu de passer la troisième année de son stage en Allemagne, comme le voulait le règlement, il demanda à rester en Italie. L'autorisation lui en fut accordée. Mais, à la fin d'août 1861, il regagna à grand-hâte Paris, Il venait d'apprendre que sa mère était gravement malade. Elle mourut peu de temps après le retour de son fils unique.
Les années qu'il passa en Italie furent peut-être les meilleures de son existence besogneuse, laborieuse, fiévreuse, — de son existence trop rapidement consumée. Malgré ses voyages dans la péninsule, malgré son assiduité dans les salons romains où il était sans cesse invité pour faire admirer son talent de pianiste (« Tu as raison de me recommander de n'être pas paresseux, écrivait-il à sa mère, je vais presque tous les soirs dans le monde »), il travaillait à plusieurs partitions. Pour décrocher le Prix Rodrigues, qui était de mille cinq cents francs, il composa un Te Deum. « Tantôt je le trouve bon, disait-il, tantôt je le trouve détestable, ce qu'il y a de certain, c'est que je ne suis pas taillé pour la musique religieuse. » Il comptait sur les mille cinq cents francs pour faire le voyage de Naples. Le Prix Rodrigues échut à son camarade de la villa Médicis, Barthe.
Bizet se consola de l'échec qu'il prévoyait. Après avoir songé à une Parisina, dont Donizetti avait déjà fait la musique, il s'attaqua à un opéra-bouffe en deux actes, Don Procopio, qu'il jugeait davantage dans ses cordes. Dans une lettre à son professeur Marmontel, en date du 11 janvier 1859, il révélait ses projets : « Je travaille beaucoup, je termine un opéra bouffe italien ; je ne suis pas très mécontent... Sur des paroles italiennes, il faut faire italien ; je n'ai pas cherché à me dérober à cette influence... J'enverrai pour la deuxième année la Esmeralda de Victor Hugo, et pour la troisième une Symphonie. Je n'élude point les difficultés, je veux mesurer mes forces pendant que le public n'a rien à y voir (*). »
(*) Les musiciens, pensionnaires de la villa Médicis, sont tenus d'envoyer chaque année à la Section musicale de l'Académie des Beaux-Arts une partition sur laquelle un membre de l'Institut doit rédiger un rapport. Ces « envois de Rome » sont exécutés dans une matinée spéciale, au retour à Paris des lauréats des premiers Grands prix.
Retrouvé, en 1895, dans les papiers d'Auber, Don Procopio ne fut joué pour la première fois que le 6 mars 1906, sur le théâtre de Monte-Carlo. Le manuscrit en avait été retouché et complété, avec des soins diligents et pieux, par Charles Malherbe. « L'opera-buffa in due atti » n'offre qu'un intérêt de document. L'influence italienne, avouée par Bizet, s'y manifeste avec excès. J'ajoute que la Sérénade de Smith, au deuxième acte de la Jolie fille de Perth, a été extraite de la partition de Don Procopio.
La Esmeralda, dont Mlle Bertin avait fait auparavant un opéra, ne fut pas mise en musique par Bizet. Le jeune compositeur se proposa d'écrire tour à tour Carmen sœculare, d'après Horace et dont Philidor avait fait jouer une adaptation à Londres, en 1769, un opéra-comique sur l'Amour Peintre de Molière et, huit ans avant les Maîtres Chanteurs de Nuremberg, un Tonnelier de Nuremberg, d'après Ernest Hoffmann et où se trouve un concours de chant comme dans Tannhäuser et les Maîtres Chanteurs. Il se rabattit sur les Lusiades de Camoens (et non la Lusiade comme l'ont écrit certains de ses biographes attitrés) dont il tira une « symphonie descriptive avec chœurs », intitulée Vasco de Gama. Ce fut son second « envoi de Rome ». Comme dernier « envoi de Rome », il adressa à l'Institut une Suite d'orchestre en deux mouvements : Scherzo et Andante-marche funèbre. Huit ans plus tard, le Scherzo fut incorporé dans la symphonie Roma et le thème de l'Andante-marche funèbre fut repris pour l'entrée de Leïla, au troisième acte des Pêcheurs de perles.
Le 4 août 1859, il partit pour Naples avec quatre de ses camarades de la villa Médicis. Le jour même de son arrivée, il tombait malade. « Je ne t'ai pas parlé de ma maladie, écrit-il le 17 août à sa mère, mais j'ai eu à la gorge une ulcération très douloureuse, quoique sans gravité. J'ai été malade pendant huit jours. Au mois de mai prochain, j'aurai peut-être encore quelque gonflement d'amygdales et ce sera tout, car cette maladie, chez moi, tient à la croissance. » Avant de quitter Naples, le 24 octobre 1859, il annonce qu'il avait été de nouveau obligé de s'aliter, pendant une douzaine de jours, à cause d' « une grippe, mal de gorge, douleur, etc... » Toute sa vie, il souffrit d'angine, rhinite et pharyngite. C'est par une angine, nous a-t-on dit, que débuta le mal qui devait l'emporter, seize ans plus tard.
Avant de quitter l'Italie et de regagner définitivement Paris, il s'interrogeait sur les bénéfices artistiques qu'il avait tirés de son séjour prolongé à la villa Médicis : « Aurai-je fait en ces trois années assez de progrès pour prendre dans l'art musical la place que je voudrais tenir ? C'est ce que je n'ose espérer... » Les renseignements successifs et précis qui nous sont fournis par sa correspondance nous permettent de noter que l'essentiel lui manquait encore en qualité originale.
S'il s'est pénétré des beautés plastiques du passé, un peu partout étalées sous le ciel italien, s'il a fait une collecte de souvenirs qui ont enrichi son goût et sa mémoire, il n'a pas trouvé là le cadre heureux pour le développement de sa personnalité. Dans les ouvrages qu'il a écrits pendant cette période, sa nature de talent est loin d'être définie. Ce sont de brillants exercices d'école rédigés avec une pédanterie enivrée d'elle-même. Dans cette première période de production, Bizet restait fidèle aux procédés à la mode et aux recettes qui réussissaient le mieux auprès du public régnant.
A la villa Médicis, les formules académiques étaient et sont probablement encore érigées en article de foi. Bizet était trop jeune pour ne pas se plier aux règles en vigueur. Il se laissait pénétrer par les conventions, par les modèles qu'adoptaient tous ceux qui l'entouraient. D'être sorti du milieu parisien durant près de trois ans, lui aura, du moins, servi à devenir plus habile de métier, à avoir le goût mieux informé sur les arts voisins du sien.
Il y a déjà, en lui, une force secrète, un pouvoir mystérieux qui ne sont perceptibles qu'à quelques personnages rencontrés sur sa route. C'est ainsi qu'Edmond About, dont la finesse de tact et la curiosité en éveil ne se trompent pas et savent chercher et trouver le mérite, lui déclare, quatre mois après son entrée à la villa Médicis : « Si vous ne prenez pas une des plus belles places du monde musical, vous démentirez évidemment toutes les chances et toutes les prévisions. »
Pour qui sait voir et prévoir, cet étudiant en musique remuant, volubile qu'est Georges Bizet à vingt ans, ce Georges Bizet qui prodigue, sans discernement, son enthousiasme, porte déjà la trace brûlante du sort qui lui est réservé.
III
Rentré précipitamment à Paris, au mois de septembre 1861, Georges Bizet a l'immense chagrin de perdre sa mère. Tous les plans qu'il avait formés sont anéantis. Son père a pris de l'âge et, accablé par la douleur, ne peut plus donner de leçons de solfège ni de chant. Les économies ont fondu. Comment subsister ?
Le jeune musicien se jette, tête baissée, dans le travail. Il fait appel à ses maîtres, à ses amis pour trouver à s'employer. Il accepte toutes les besognes, auprès des éditeurs, recrute des élèves pour la composition, pour l'harmonie, pour le solfège, voire pour le chant.
Grâce à son oncle Delsarte, qui avait été le professeur de chant de Mme Miolan-Carvalho, Georges Bizet est introduit auprès de Léon Carvalho, directeur du Théâtre-Lyrique. Il en devient le lecteur. Il déchiffre les partitions inédites et en réduit l'orchestre, à vue, avec tant de prestesse et de talent que Carvalho finit par s'intéresser de près aux œuvres, à la vie et à l'avenir d'un débutant aussi doué pour son art. Dans cette période de lutte pour le pain de chaque jour, aucune place n'est laissée à la méditation ni à la rêverie. La facilité et l'imitation suppléent à la pensée originale qui se dérobe.
Bizet ne veut et ne peut être qu'un bon praticien, rompu au métier. « Je n'ai jamais connu la misère, écrira-t-il plus tard, mais je sais ce que c'est que la gêne et je sais combien cela frappe sur l'intelligence. »
Pour s'assurer de quoi vivre, il fait des transcriptions à tour de bras. Aux éditions Heugel, il publie le Pianiste chanteur qui ne comprend pas moins de cent cinquante morceaux, divisés en six séries. Au milieu de toutes ces occupations, il garde encore le souci de sa carrière à courir. Il fait recevoir à l'Opéra-Comique la Guzla de l'Emir, pièce lyrique en un acte, sur un livret de Michel Carré et Jules Barbier. Au Cercle des Mirlitons, on exécute, d'abord avec succès, le Scherzo de sa Suite d'orchestre, puis, en nouvelle audition, aux Concerts Pasdeloup, le 11 janvier 1863, le même Scherzo qui provoque, sans aucune raison, un véritable scandale. Enfin, Carvalho, qui vient de se voir allouer par le comte Walewski, ministre des Beaux-Arts, une subvention de cent mille francs, confie à Georges Bizet le livret d'un opéra en trois actes de Michel Carré et Cormon, les Pêcheurs de perles.
Bizet se met aussitôt à la composition de l'important ouvrage et renonce à voir créer la Guzla de l'Emir, déjà entrée en répétitions. Il retire son manuscrit de l'Opéra-Comique. Manuscrit qu'il détruira plus tard. La Guzla de l'Emir ne fut représentée à l'Athénée que dix ans après et sur une autre musique due à Théodore Dubois.
Les Pêcheurs de perles sont donnés, en première représentation, au Théâtre-Lyrique, le 29 septembre 1863. Georges Bizet n'a pas encore tout à fait atteint l'âge de vingt-cinq ans. Le soir de la première, la jeunesse l'acclame. La critique est plus réservée sinon franchement mauvaise. Elle reproche au musicien d'imiter Verdi, Félicien David et lui fait grief — ce qui est un comble — d'appartenir à l'école wagnérienne. Seul, Hector Berlioz lui consacre, dans les Débats, un feuilleton favorable et d'une singulière clairvoyance. Plus tard, Bizet lui-même jugera sévèrement la partition et ne reconnaîtra quelque valeur qu'à certains passages des Pêcheurs : au premier acte, l'Andante du duo de Nadir et de Zurga et la Romance de Nadir ; au deuxième acte, le Chœur chanté dans la coulisse et la Cavatine de Leïla ; au troisième acte, l'Air de Zurga. Les Pêcheurs de perles n'ont été représentés que dix-huit fois sur le Théâtre-Lyrique.
L'ouvrage ne fut repris que vingt-trois ans plus tard sur la scène du casino d'Aix-les-Bains. Les directeurs des théâtres lyriques italiens, sensibles au « mélodisme » verdien de la partition, jouèrent ensuite sur toutes les scènes de la péninsule les Pêcheurs de perles. L'opéra de Bizet fut ramené en France, en 1919, et remonté, d'abord au Trianon Lyrique, puis, en 1928, à l'Opéra-Comique. Il fait partie, depuis, du répertoire de la salle Favart, où malgré son genre tombé en désuétude, sa forme arriérée et sa vilaine mise en scène, il triomphe auprès du public de la place Boieldieu, comme auprès de celui de la province.
Bizet eût été lui-même surpris, humilié, irrité par cette réussite d'un ouvrage en partie désavoué. Son confident, Edmond Galabert, nous dit « qu'à part deux ou trois morceaux qu'il chantait en s'accompagnant au piano, lorsque les amis qui venaient chez lui, à cette époque, le priaient de leur en faire entendre quelque chose, il en parlait comme d'une œuvre sans valeur. Le jour où il apprit que j'avais acheté la partition, il se montra fort contrarié et s'écria :
— Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu ? Je vous l'aurais donnée. D'ailleurs, vous n'aviez pas besoin d'avoir ça. »
IV
Avec la même esthétique et, de plus en plus, hanté par la musique de Verdi, Bizet écrit un opéra en cinq actes, Ivan le terrible. Le livret d'Arthur Leroy et Trianon avait été retenu par Gounod. Le musicien de Faust avait écrit pour l'ouvrage l'air du petit berger qu'on peut entendre dans Mireille, à l'acte de la Crau. Gounod, peu inspiré par le sujet, repasse le poème à son cadet. En quelques mois, Bizet achève la partition qui est lue devant Carvalho et reçue pour être montée sur le Théâtre-Lyrique, au début de l'année 1866. Il écrit, au mois de décembre, à Galabert : « Ivan est encore retardé ! Le Théâtre-Lyrique n'a pas le sou ! »
Il retire Ivan du Théâtre-Lyrique pour le porter à l'Opéra, où il n'est pas non plus représenté, malgré les promesses faites par Perrin.
Bizet finit par se désintéresser complètement du sort d'Ivan le terrible, dont le manuscrit a été légué par Mme Straus-Bizet à la bibliothèque du Conservatoire. Découvert là par les éditeurs Choudens et Schott, il va être enfin publié et représenté prochainement. Il n'y manque que l'orchestration des cent vingt-quatre dernières mesures. Henri Büsser s'est chargé de compléter la partition et d'en modifier certains passages trop démodés.
Dès 1865, Bizet a une première prise de conscience. Il veut s'éloigner du genre fade, creux ou emphatique qui sévit alors et commence sa symphonie, Souvenirs de Rome, qui sera intitulée plus tard : Roma. Mécontent de tous les travaux auxquels il s'est astreint depuis quatre ans, il se propose d'écrire une œuvre de musique pure, à l'instar de Mozart, de Beethoven, de Mendelssohn, de Schumann.
Depuis son retour de Rome, le malheureux grand compositeur a été obligé de satisfaire aux exigences des hommes du négoce musical, en écrivant non seulement les trois ouvrages dramatiques que j'ai signalés plus haut, mais aussi en faisant près de deux cents transcriptions de partitions plus ou moins recommandables, des mélodies « au galop », « d'ignobles valses », « des solos de piston », et jusqu'à une opérette, Sol-si-ré-pif-pan, et, au premier acte d'une autre opérette, Malbrough s'en va-t-en guerre.
Quand aura-t-il la possibilité d'écrire de la musique sans se préoccuper du bas niveau du goût public ni du gain à en recueillir ?
L'occasion lui en est encore une fois refusée, quand Carvalho lui apporte le scénario de la Jolie Fille de Perth, tiré par Saint-Georges et Adenis du roman de Walter Scott. Bizet signe un traité par lequel il s'engage à livrer la partition au directeur du Théâtre-Lyrique six mois après. Il se fie à sa facilité d'inspiration, à sa puissance de travail et croit qu'il va pouvoir mener de front tout ce qu'il a entrepris. Il est forcé d'interrompre l'orchestration de sa Symphonie qui ne sera exécutée, en première audition, que deux ans plus tard.
Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il accepte de mettre en musique le poème désespérément plat de Saint-Georges et Adenis. Quand il reçoit, en juillet 1866, le premier acte (la partition entière sera livrée le 29 décembre de la même année !) il ne peut s'empêcher d'écrire à son ami Galabert : « Je commence la Jolie Fille. La pièce sera jolie, je l'espère, mais quels vers !... » Le mois suivant, il y revient, dans une autre lettre, adressée au même correspondant : « Ma Fille de Perth ressemble peu au roman. C'est une pièce à effet, mais les types sont trop peu accentués. Je réparerai, j'espère, cette faute. Il y a des vers... Tenez au hasard... » Et Bizet cite quelques répliques insipides des deux héros du livret, pour finir par ce quatrain extrait du même ouvrage qu'il raille doucement :
Quelle est encore cette aventure ?
Nous n'en sortirons pas, vraiment !
Je n'y comprends rien ! Mais je jure
Que l'ami Smith est innocent !
« L'ami Smith est délicieux. Enfin, il faut travailler là-dessus. Je ne me sers pas des paroles pour composer ; je ne trouverais pas une note ! »
On peut glaner bien d'autres vers, d'espèce encore plus pitoyable, — ceux-ci, par exemple, dans le même premier acte :
... Chacun fête à sa guise
Le carnaval... et, par ce temps de bise,
On doit surtout bien boire et bien manger.
et :
Rentrons chez nous pour ne pas nous commettre
Avec des malfaiteurs ; ce serait compromettre
Notre valeur et notre dignité.
Comment l'infortuné musicien a-t-il pu « trouver des notes » sur de pareilles paroles ? La tâche lui en était d'autant plus ardue que le délai qui lui était imparti pour composer la musique était très court. Au mois de décembre 1866, peu de temps avant de porter à Carvalho sa partition achevée, il confia à Galabert : « Si vous saviez mon existence depuis un mois ! Je travaille quinze et seize heures par jour, plus quelquefois, car j'ai des leçons, des épreuves à corriger ; il faut vivre. Maintenant, je suis tranquille. J'ai quatre ou cinq nuits à passer, mais j'aurai fini. »
Le miracle est que Bizet bousculé, talonné, ait pu expédier en quelques mois un opéra en quatre actes qui, après tout, se tient debout et dépasse de beaucoup, en qualité, les ouvrages ordinaires qu'on sert au public, à cette date. On y relève même telles pages d'une variété rythmique et d'une invention harmonique dignes du génie du musicien de Carmen ; au premier acte : une partie du Prélude, le Final du Chœur des forgerons; au deuxième acte : la Danse bohémienne, l'Air de l'ivresse ; au troisième acte : le Menuet.
On est surpris de trouver, au premier acte de la Jolie Fille de Perth, une scène d'une frappante analogie avec une scène du deuxième acte des Maîtres Chanteurs de Nuremberg, scène où Hans Sachs interrompt à coups de marteau la Sérénade que Beckmesser chante sous la fenêtre d'Eva. Ni Bizet ni ses librettistes ne pouvaient avoir pris connaissance de l'œuvre de Richard Wagner. Ainsi que nous l'avons vu, Bizet avait commencé sa partition au mois de juillet 1866, alors que Wagner n'avait terminé les Maîtres Chanteurs que le 20 octobre 1867. La première représentation de la Jolie Fille de Perth eut lieu au Théâtre-Lyrique le 26 décembre 1867, tandis que les Maîtres Chanteurs ne furent créés à Munich que le 21 juin 1868. On ne saurait donc accuser Bizet d'avoir imité Wagner, là comme ailleurs. On est tenté de le croire en cette circonstance, à cause de la similitude des situations traitées par les deux maîtres. Il est vrai que les musiques, écrites par l'un et par l'autre pour la scène en question, diffèrent du tout au tout.
Après le travail épuisant qu'il vient de fournir, les critiques mordantes dont Bizet est l'objet, dans la presse, le lendemain de la première de la Jolie Fille de Perth, doivent paraître au musicien cruelles et imméritées. Il ne s'en formalise pas ouvertement. Dans le fond, il ne peut donner tort à ceux qui l'ont malmené. Il sait bien qu'il n'a usé, dans la majeure partie de sa composition, que de ses acquisitions d'école. Il s'est astreint à une tactique habile et hâtive pour conquérir la faveur populaire, au lieu de s'affranchir de règles étroites, de rechercher l'expression vraie, le trait profond, au lieu d'être le promoteur qui respire déjà en lui.
Johannès Weber, l'un de mes prédécesseurs les plus lucides et les mieux informés au feuilleton musical du Temps, n'a pas manqué de montrer, après la création de la Jolie Fille, que Bizet s'était encore fourvoyé dans son dernier ouvrage, malgré les mérites qu'on est forcé d'y reconnaître. Dans une lettre, reproduite dans la plupart des biographies du musicien, Georges Bizet s'accuse et s'excuse avec franchise. Il dissimule généreusement ses souffrances de carrière et les difficultés de la tâche précipitée dont il s'était chargé, pour répondre à l'important critique : « Non, monsieur, pas plus que vous je ne crois aux faux dieux, et je vous le prouverai. J'ai fait, cette fois encore, des concessions que je regrette, je l'avoue. J'aurais bien des choses à dire pour ma défense... devinez-les ! L'école des flonflons, des roulades, du mensonge est morte, bien morte ! Enterrons-la sans larmes, sans regret, sans émotion et... en avant ! »
Avec Jeux d'enfants, l'Arlésienne et Carmen, Bizet « prouvera » effectivement qu'il n'est pas le desservant des chapelles consacrés aux vielles idoles, qu'il a rompu avec les vaines traditions de la musique en vogue, qu'il sait combattre pour sa vérité, qu'il a, en lui, une puissance créatrice dégagée des conventions et des influences.
Dans cette Jolie Fille de Perth tant décriée, et dont l'industrie molle mais avisée n'est que trop voyante, on n'a pas remarqué que s'annonce déjà cette manière directe et osée que Bizet adoptera, amplifiera et fera rayonner dans les œuvres qui suivront. Il ne s'attarde plus ni aux préparations scholastiques ni aux développements, quand il décrit une situation ou rend un sentiment. Pour exprimer une émotion, il lui suffit de jeter une tache sonore forte, ramassée, saisissante. Déjà perce quelque chose de sa variété rythmique, de son indépendance tonale, de son invention harmonique. Bizet croit naïvement que quelques critiques perspicaces distingueront ces côtés renouvelés de sa facture. Aucun n'y regarde de près.
Peu de jours avant la première de la Jolie Fille, il écrit à Galabert : « Je suis très content de moi. C'est bon, j'en suis sûr, car c'est en avant. » Et, après la répétition générale : « La partition de la Jolie Fille est une bonne chose. Je vous le dis, parce que vous me connaissez. L'orchestre donne à tout cela une couleur, un relief que je n'osais espérer, je l'avoue !... Je tiens ma voie. Maintenant, en marche ! Il faut monter, monter, monter toujours ! »
A la sortie du théâtre, il est persuadé de sa réussite. « Mon ouvrage a obtenu un vrai et sérieux succès. Je n'espérais pas un accueil aussi enthousiaste et, à la fois, aussi sévère. On m'a tenu la dragée haute, on m'a pris au sérieux et j'ai eu la vive joie d'émouvoir, d'empoigner une salle qui n'était pas positivement bienveillante. J'avais fait un coup d'Etat : j'avais défendu au chef de claque d'applaudir. Je sais donc à quoi m'en tenir. »
Malgré le grand succès qui l'accueille le soir de la première, la Jolie Fille de Perth n'est jouée que vingt et une fois. Bizet n'en montre aucune amertume. Il continue son ascension, sans fléchir d'aucun côté.
V
RENCONTRE AVEC CÉLESTE MOGADOR
Bizet avait composé la dernière partie de la Jolie Fille de Perth au Vésinet, où il possédait une petite propriété. Dans ses Mémoires, Céleste Mogador, — la danseuse turbulente du bal Mabille, devenue comtesse Lionel de Chabrillan, puis romancière, comédienne et auteur dramatique, — prétend que le père de Georges Bizet avait acheté le terrain de cette propriété un franc le mètre carré. Au dire de la Mogador, Adolphe Bizet et son fils habitaient là, chacun, dans une bicoque d'une seule chambre, bâtie en pleins champs. La cascadeuse de Mabille nous décrit, à sa façon, le logis des Bizet et le genre de camaraderie qui s'établit entre elle et le musicien.
Selon Céleste, dans la pièce où logeait Georges Bizet, le lit était caché derrière une cloison. L'espace était si restreint que le musicien y avait difficilement placé trois chaises, une table, un buffet-armoire et un piano. Le père et le fils faisaient eux-mêmes le ménage et la cuisine. « Dans ces niches, écrit Céleste Mogador, ils avaient l'air, l'un et l'autre, d'être les toutous de garde de leur propriété. »
L'ancienne danseuse du bal Mabille invita donc le compositeur à venir travailler au piano dans sa villa toute proche. Bizet accepta. « ... Le son porte mieux que chez moi où il est étouffé par le plafond trop bas et les murs étroits », disait le musicien. Elle était même admise à visiter le musicien dans sa « niche ». C'est ainsi qu'il lui fit entendre une œuvre inédite. Audition à laquelle assistaient aussi deux amis du compositeur venus de Paris.
Ce soir-là, Céleste Mogador, prise d'enthousiasme, se serrait contre le musicien qui la reconduisait jusqu'à son chalet. Bizet crut à des avances et se proposa aussitôt à la galante voisine. Elle se refusa parce qu'il avait un trop grand nombre de maîtresses dont « la favorite était la femme de son meilleur ami... » « Mon admiration, dit-elle à Bizet, est absolument platonique. Quant à mon cœur, il n'a jamais rêvé d'habiter dans un cœur qui ressemble à une maison meublée où l'on vous loge à la nuit. »
Peut-être Bizet, qui était superstitieux, se figurait-il que sa voisine du Vésinet lui portait bonheur. N'était-elle pas née Elisabeth-Céleste Vénard ? Ils restèrent liés d'amitié jusqu'à une nuit où Bizet, rentrant tard de Paris, s'avisa de frapper avec sa canne aux volets de Céleste. Réveillée en sursaut, la mère de la comtesse de Chabrillan traita grossièrement le musicien. De retour à Paris, ils cessèrent de se voir.
A l'encontre de ce qu'a publié Céleste Mogador sur la « niche » du Vésinet, où Bizet se réfugiait l'été, Edmond Galabert, élève et ami du musicien, a écrit : « C'était un grand jardin clos, sur la route des Cultures, par une grille en fer avec, à chaque extrémité, une chartreuse. Sur le devant, des massifs, des pelouses ; au delà, un potager... Dans la chartreuse que l'on avait à droite... il y avait la chambre du père, la salle à manger et la cuisine ; dans celle de gauche, la chambre du fils et son cabinet où se trouvait le buste de Halévy. »
Au Vésinet, Georges Bizet avait souvent, pour invités à sa table, Saint-Saëns, Gounod, Reyer, Ernest Guiraud, Massenet, Lécuyer, Galabert, d'autres amis, des librettistes, des élèves. Comment aurait-il pu recevoir ses hôtes dans la cabane décrite par Céleste Mogador et servir à son monde des repas dont il eût été lui-même « le cuisinier » ?
Je suis tenté de croire que cet épisode de la vie de la Mogador est inventé pour corser les Mémoires où la courtisane a laissé courir son imagination, à l'exemple de son conseiller et grand ami, Alexandre Dumas père.
Céleste Mogador était, de quatorze ans, l'aînée de Georges Bizet. Dans sa maison du Vésinet, Bizet passait jours et nuits à terminer la Jolie Fille de Perth, composée en six mois. Et cela, tout en écrivant des arrangements, des orchestrations, des mélodies et en donnant des leçons. A cette époque, il disposait de trop peu de temps pour filer les intrigues que lui prête la Mogador. Bizet, qui racontait dans ses lettres tout ce qui lui arrivait, n'a pas fait allusion à l'ancienne danseuse du bal Mabille.
D'une lettre inédite, aimablement communiquée par M. Albert Willemetz, je détache ces quelques lignes qui peuvent servir à nous former l'idée exacte de la situation de Bizet, en 1867. Lettre adressée par le musicien à un correspondant belge auquel il se confie, au courant de la plume, avec sa spontanéité habituelle.
« Mon nom, écrit Bizet, est fort connu ici, à Paris, du monde artiste, littéraire, officiel, de tous ceux, enfin, qui s'intéressent à l'art. Mais le sort de mes pauvres Pêcheurs n'a pas été assez brillant pour étendre ma réputation au delà de l'enceinte fortifiée de M. Thiers. Prix de Rome à dix-neuf ans, j'ai pu faire jouer trois actes à mon retour ! Le succès musical a été réel. Ma partition a réussi, mais la pièce !...
Carvalho m'a immédiatement commandé un Ivan IV, en cinq actes, qui n'a pu, pour une foule de raisons, être représenté. Je viens de terminer ma Jolie Fille de Perth, en quatre actes, qui va entrer en répétitions, après le Roméo de Gounod. J'espère allonger la courroie et ne passer qu'au mois de novembre.
... Je joue très bien du piano... et j'en vis mal. Car, rien au monde ne pourrait me décider à me faire entendre en public. Je trouve ce métier d'exécutant odieux ! Encore une répugnance ridicule qui me coûte une quinzaine de mille francs par an. Je me fais entendre quelquefois chez la princesse Mathilde et dans quelques maisons où les artistes sont des amis et non des employés.
... Si vous venez à Paris un de ces jours, n'oubliez pas que vous avez un ami à visiter, 32, rue Fontaine Saint-Georges. Si vous venez admirer notre Exposition, ne me lâchez pas ; je vous emmènerai dans un petit réduit que je possède aux environs de Paris ; et nous pourrons, en compagnie de quelques-uns de mes amis, Gounod, Reyer, etc., flâner ensemble quelques heures. »
VI
Dans la vie de Georges Bizet, l'année de la création de la Jolie Fille de Perth est une année décisive. La lumière s'est peu à peu faite dans l'âme du musicien. Des puissances s'y sont éveillées qu'il ne soupçonnait pas. Il a saisi, un à un, les principes de l'art qui répondra à ses convictions, ses espoirs et ses rêves. Il a découvert la musique profonde qui chantait en lui et qu'il n'entendait pas auparavant. A son ordre, tout ce qui était caché vient se ranger dans son esprit.
Pour se préparer à l'œuvre qui va naître, il veut régler et fixer son existence jusqu'alors vainement dispersée. En octobre 1867, — le lendemain de la répétition générale de la Jolie Fille de Perth, — il écrit : « Plus de soirées ! Plus de cascades ! Plus de maîtresses ! Tout cela est fini, absolument fini ! Je vous parle sérieusement. J'ai rencontré une adorable fille que j'adore ! Dans deux ans, elle sera ma femme ! »
Il s'agit de Geneviève Halévy, la seconde fille de son professeur. Le mariage se fera dans le délai qu'il indique à son ami. De sérieux obstacles s'y opposent au début. Fromental Halévy, qui était attaché à son meilleur élève, — qu'il protégeait de toute son autorité, — était mort depuis 1862. Mme Fromental Halévy ne voyait pas avec faveur l'union qui allait se nouer entre sa fille et le musicien déluré, impétueux et dissipé.
Bizet avait eu des aventures dont on parlait entre amis. D'une liaison avec une jeune femme, il avait eu un fils. Je m'excuse d'entrer dans ce détail intime. Quelque quarante ans plus tard, ce fils illégitime était devenu mon ami. Non seulement il m'avait autorisé à révéler publiquement sa filiation, mais il m'a demandé de l'indiquer dans une étude biographique que je devais écrire sur Georges Bizet. Il conservait avec piété le souvenir de son père. Il me montrait, non sans fierté, les objets qui avaient appartenu au musicien de Carmen. Il y avait, chez lui, un petit musée consacré à la mémoire de Georges Bizet.
J'ajoute que j'étais également lié d'amitié avec le second fils de Bizet, légitime celui-là. Jacques Bizet, ami d'enfance de Marcel Proust, ressemblait trait pour trait à Georges Bizet, tel qu'il nous apparaît sur les photographies que nous avons de lui ou dans les descriptions qui nous ont été laissées par les intimes de la famille. Même visage, orné d'une barbe pareille mais brune, alors que la barbe paternelle était châtain clair et à reflets roux. Même regard doux et perdu sous le binocle. Même cordialité. Même pétulance. Les deux fils sont aujourd'hui morts. A l'un et à l'autre, je garde, par delà la tombe, mon affection.
On comprend, dès lors, les hésitations de Mme Halévy. Bizet faisait allusion à ces incidents, quand il écrivait à Galabert, en octobre 1867 : « Pardonnez-moi le retard que j'ai apporté à la correction de ces quelques contre-sujets, mais je viens d'être atteint profondément. On a brisé les espérances que j'avais formées... » ; en novembre de la même année : « Je suis toujours fort triste. Le coup qui m'a frappé détruit des espérances qui m'étaient chères. Peut-être tout n'est-il pas perdu, mais... » ; en février 1868 : « Excusez-moi ! J'ai été souffrant, inquiet, accablé d'ennuis, de travail, de soucis, etc. » ; et, plus loin : « Je traverse une crise ; je suis très démoralisé pour mille causes que je vous dirai prochainement. »
C'est, sans doute, pour calmer les appréhensions de Mme Halévy et s'attirer ses bonnes grâces, qu'il accepta de terminer Noé, un opéra biblique en quatre tableaux, que le musicien de la Juive avait laissé inachevé. Il y travailla du mois de juillet 1868 jusqu'au mois de novembre 1869. L'ouvrage devait être joué sur le Théâtre-Lyrique, par traité. Après la guerre de 1870, il n'en fut plus question. Noé ne fut représenté que dix ans après la mort de Bizet, à l'Opéra de Carlsruhe, sous la direction de Félix Mottl.
Le mariage de Bizet et de Mlle Halévy fut enfin célébré le 3 juin 1869. Le couple s'installa 22, rue de Douai, à Paris. Aucune fortune. Peu de travaux rémunérateurs. Trois mois après la cérémonie nuptiale, Bizet déclarait au sujet d'un ami qu'il désirait rencontrer : « Dès que j'aurai des chaises, je lui écrirai de venir nous voir. » Pour faire vivre sa famille, il ne reculait devant aucune corvée.
Mme Georges Bizet s'était tendrement attachée à son mari. Quand il expira, exactement six ans après son mariage, elle confia à Charles Gounod : « Des six années de bonheur que le mariage m'a données, il n'est pas une heure, il n'est pas une minute par laquelle je ne serais heureuse de passer encore. »
VII
J'ai connu Geneviève Bizet âgée de plus de soixante ans. C'était une femme petite, très maigre, la figure constamment secouée par un tic nerveux et brillante d'intelligence.
Quinze ans après la mort du musicien de Carmen, Mme Georges Bizet était, dans sa maturité, l'une des femmes les plus enviées, les plus adulées de Paris. L'éclat sombre de ses grands yeux, le teint doré, la taille fine et pliante, elle rappelait, par plus d'un trait, la bohémienne chantée par Bizet. Au regard de ceux qui l'approchaient, elle faisait revivre Carmen par je ne sais quels artifices, ou bien par le sortilège qui continuait de se dégager de l'héroïne de Mérimée. Dans l'été de sa vie, elle apparaissait comme une Carmen « comme il faut », une Carmen d'un salon à la mode. Ainsi que la gitane de Grenade, elle savait ensorceler son monde.
En 1888, Marcel Proust terminait ses études au lycée Condorcet où il avait Jacques Bizet pour condisciple. Il fut pris au charme de Mme Straus-Bizet. Elle avait le double de l'âge du rhétoricien. Il n'en fut pas gêné pour lui faire des déclarations d'amour. Il ne fut naturellement pas payé de retour. Dépité de voir qu'il n'était pas pris au sérieux, il lui écrivit un jour : « ... Je crois que vous n'aimez qu'un certain genre de vie, qui met moins en relief votre intelligence que votre esprit, moins votre esprit que votre tact, moins votre tact que vos toilettes. »
Mme Straus-Bizet lut la missive en souriant. Elle avait, en effet, beaucoup d'esprit. Ses répliques, salées, mordantes, jetées de verve, amusaient fort la galerie de ses amis et de ses invités. Marcel Proust se les rappela quand il a écrit A la recherche du temps perdu. Au personnage de la duchesse de Guermantes, il prêta les réparties étincelantes de Mme Straus-Bizet.
Devenue Mme Emile Straus, la veuve de Georges Bizet vivait en parfait accord avec son second mari, avocat de talent, et auquel une fortune personnelle permettait de ne pas plaider. Emile Straus s'occupait surtout à défendre ses intérêts et à recevoir ses invités avec cordialité. D'une mise sobre et très simple, il s'effaçait volontiers devant sa femme.
Ils habitaient un hôtel particulier, 104, rue de Miromesnil. Dans la salle à manger de l'entresol avait lieu, chaque dimanche, un déjeuner auquel assistaient, tour à tour, des personnages en renom, membres de l'Institut, ministres en fonctions, musiciens, écrivains, directeurs de journaux, etc. Dans ma jeunesse, j'ai pu y voir, grâce à Paul Hervieu qui m'y avait amené, Saint-Saëns, Massenet, Gabriel Fauré, Raymond Poincaré, Aristide Briand, Adrien Hébrard, directeur du Temps, Fernand Calmette, directeur du Figaro, Anatole France, Henri Bergson, Marcel Proust — encore ignoré — Paul Valéry et d'autres, non moins célèbres, à leurs dates. Aucune femme à ces réunions, sauf la maîtresse de maison qui présidait et, armée d'un face-à-main, donnait la parole aux convives marquants.
Elle aimait se tenir dans une pièce, au premier étage, où elle avait réuni tous les souvenirs de Bizet. C'est là qu'elle me mit sous les yeux le manuscrit de Carmen. Elle défendait, avec une vigilance de chaque instant, la mémoire et les œuvres de son premier mari. Jusqu'à la fin, elle continua de se faire appeler Mme Straus-Bizet. Quand elle mourut, les droits d'auteur de Carmen allèrent à son second mari, Emile Straus, qui les légua à son neveu Sibila. Aujourd'hui, ces droits sont perçus au bénéfice de l'Institut ophtalmologique Rothschild.
VIII
A la suite du demi-succès de la Jolie Fille de Perth, Bizet s'éloigne pendant un certain temps du théâtre.
Avant la création de la Jolie Fille de Perth, un concours avait été ouvert pour une cantate, à l'occasion de l'Exposition de 1867. Tous les envois devaient être anonymes. Sous le nom de Gaston de Betzi et en déguisant son écriture, Bizet prit part à la compétition, en même temps que ses amis Guiraud, Saint-Saëns et Massenet. Le prix échut à la cantate de Saint-Saëns. Le lendemain, Bizet, qui croyait que sa participation au concours avait été tenue secrète, écrivait à Saint-Saëns : « Mille compliments, cher vieux ; je regrette de n'avoir pas concouru, car j'aurais eu l'honneur d'être battu par toi. »
Un autre concours pour le choix de partitions destinées à l'Opéra, l'Opéra-Comique et au Théâtre-Lyrique, est annoncé dans les mêmes circonstances. Bizet se décide à disputer le prix pour l'ouvrage qui devait être joué à l'Opéra. C'est Emile Perrin, directeur de l'Académie impériale de musique, qui l'a obligé à affronter l'épreuve. Le livret imposé est la Coupe du Roi de Thulé, d'Edouard Blau et Louis Gallet, — livret également choisi au concours.
Après s'y être longuement préparé, Bizet trace le premier acte et la plus grande partie du second. Il en discute avec Ernest Guiraud qui, de son côté, s'est fait inscrire sur la liste des concurrents. En outre, son élève et ami Galabert traite le même sujet pour s'entraîner à la composition musicale, et, au jour le jour, adresse, par la poste, à Bizet, les feuillets de son texte.
Dans ses leçons et corrections, par lettres, Bizet donne à son disciple des conseils d'écriture et de psychologie musicales souvent admirables. Il met en pleine lumière sa propre méthode de travail et la nature, le comportement de son inspiration. Je m'en expliquerai plus loin, quand il s'agira de caractériser l'art du compositeur de Carmen. Art qui nous paraît de premier feu, de premier jet et qui, dans la réalité, a été médité, creusé et retourné en tous sens.
Au sujet de la Coupe du Roi de Thulé, Bizet écrit à Galabert, en octobre 1868 : « J'ai fait les deux premiers actes et je suis extrêmement content. C'est de beaucoup supérieur à tout ce que j'ai fait jusqu'à ce jour. » Il y revient en janvier 1869 : « J'ai terminé les deux premiers actes de la Coupe. Je suis très content. »
Brusquement, il se désintéresse de sa partition et détruit ce qu'il a eu tant de peine à formuler. Il se refuse à figurer parmi les concurrents. Pourquoi cette décision soudaine ? Il en donne diverses raisons : il n'a aucune confiance dans le jury qui siège autour de Perrin, ni en Perrin lui-même ; il a une commande pour l'Opéra, une seconde pour l'Opéra-Comique, voire une troisième pour le Théâtre-Italien et craint, s'il n'a pas le prix, que cela n'influe sur l'opinion qu'on se fera de ses œuvres prochaines, etc.
La vérité est autre. « J'ai revu mon premier acte de la Coupe, à deux reprises différentes, avoue-t-il à Guiraud. La première fois j'ai trouvé cela tout simplement admirable, la seconde fois cela m'a paru définitivement infect. »
Bizet voit enfin clair en lui-même, en son art, en son génie. Il se confesse à Galabert, en 1868. « Il se fait en moi un changement extraordinaire, écrit-il. Je change de peau, autant comme artiste que comme homme ; je m'épure, je deviens meilleur : je le sens ! Allons, je trouverai quelque chose dans mon individu, en cherchant bien. » Puis, deux mois plus tard : « Il se fait en moi un changement tellement radical au point de vue musical que je ne puis risquer ma nouvelle manière sans m'y être préparé plusieurs mois à l'avance. » Après avoir erré, le musicien de Carmen se met en route pour aller à la rencontre de sa trop brève destinée.
Pendant deux ans, sous l'influence de Mendelssohn, il n'a pas cessé de remanier sa symphonie, Souvenirs de Rome, qui sera éditée sous le titre de Roma. Elle n'est exécutée que le 28 février 1869, aux Concerts populaires du cirque Napoléon. C'est Pasdeloup — chef d'orchestre intrépide, ami infatigable auquel sera dédiée, six ans plus tard, la partition de Carmen — qui dirige cette première audition.
Le lendemain ni les jours qui suivent, aucun article de critique sur l'œuvre nouvelle ne paraît dans les journaux. Nous ne connaissons l'impression produite sur le public que par l'auteur lui-même. « Ma symphonie, écrit-il, a très bien marché. — Premier morceau : une salve d'applaudissements, quelques chuts, seconde salve, un sifflet, troisième salve. Andante : une salve. Final : beaucoup d'effet, applaudissements à trois reprises, chuts, trois ou quatre coups de sifflet. En somme, succès. »
Bizet ne dit qu'une moitié des choses. Sur la demande de Pasdeloup, il a été forcé de supprimer le Scherzo qui avait suscité des protestations, quand il fut joué pour la première fois. Des abonnés avaient écrit à Pasdeloup qu'ils ne renouvelleraient pas leurs abonnements si les Concerts populaires persistaient à afficher les ouvrages de débutants ou de musiciens modernes. Pasdeloup ne tint pas compte des remontrances et continua son effort en faveur des compositeurs nouveaux.
Tout en étant préoccupé par le Final de ses Souvenirs de Rome, auquel il n'arrive pas à donner la forme souhaitée, Bizet compose deux pièces pour piano, à l'intention de son ami, le virtuose Henri Delaborde. On peut observer dans ces pages quelque chose de l'écriture qui sera désormais celle du musicien. En juillet 1868, il écrit à Galabert : « ... je viens de terminer de Grandes variations chromatiques pour piano... C'est traité très audacieusement, vous verrez. Puis un Nocturne auquel j'attache de l'importance. »
***
La guerre de 1870 s'annonçait. Depuis plusieurs mois, les théâtres traversaient une crise grave. Le Théâtre-Lyrique, passé en de nouvelles mains, avait été dans l'obligation de fermer ses portes. Camille Saint-Saëns disait à son ami Bizet :
— Puisqu'on ne veut pas de nous au théâtre, réfugions-nous au concert !
— Tu en parles à ton aise, répondait Georges Bizet, je ne suis pas fait pour la symphonie ; il me faut le théâtre, je ne suis rien sans lui.
Saint-Saëns lui rendra justice plus tard, en déclarant : « Il se trompait évidemment ; un musicien de cette valeur est partout à sa place. »
Bizet est de nouveau tenté par le théâtre. D'accord avec Perrin, il renonce à mettre en musique un livret de Leroy et Sauvage qui avait, auparavant, séduit le directeur de l'Opéra. Il se tourne vers d'autres auteurs et s'en ouvre à Galabert : « Changement de front ! Nouvelle direction de l'Opéra-Comique qui m'a demandé un ouvrage par lettre ! Nous cherchons une grande pièce : trois ou quatre actes... Bref, on veut me faire faire une grande machine avant l'Opéra. Je veux bien, je serai charmé de lâcher le concours (la Coupe du Roi de Thulé) et d'essayer de changer le genre de l'Opéra-Comique. »
Il s'enflamme pour Calendal de Paul Ferrier et en recopie de sa main le livret, avec une encre différente pour chaque rôle. Le poème ne convient pas à Du Locle, directeur de l'Opéra-Comique. Bizet se le tient pour dit. Au mois de juin, il part pour Barbizon où il va rester quatre mois. Il emporte Grisélidis, de Victorien Sardou, et Clarisse Harlowe, de Philippe Gille, d'après Richardson.
IX
La guerre de 1870 éclate. Georges Bizet ne peut s'empêcher d'écrire à Galabert : « Voilà la tranquillité, l'ordre, la paix (promis par Napoléon III) ! Aujourd'hui, il s'agit de sauver le pays, mais après ?... Et notre pauvre philosophie, et nos rêves de paix universelle, de fraternité cosmopolite, d'association humaine ! Au lieu de tout cela, des larmes, du sang, des monceaux de chair, des crimes sans nombre, sans fin ! Je ne puis vous dire, mon cher ami, dans quelle tristesse me plongent toutes ces horreurs. Je suis français, je m'en souviens, mais je ne puis tout à fait oublier que je suis un homme. Cette guerre coûtera à l'humanité cinq cent mille existences. Quant à la France, elle y laissera tout ! »
Bien qu'en qualité de lauréat du Prix de Rome il soit dispensé du service militaire, il délaisse la musique pour entrer dans la Garde Nationale. Il prend sa part des fatigues et des souffrances subies. Pendant le siège, il est enfermé avec les siens dans Paris. Il n'en sort que pour partir pour Bordeaux, où il s'initie au folklore espagnol. Déjà, la musique de Carmen se dessine à son esprit.
La guerre laissera des traces ineffaçables dans l'âme du musicien. En se remettant à sa table de travail, Georges Bizet envisage autrement les œuvres qu'il mettra au jour. Il ne se satisfait plus que de l'expression musicale dépouillée, inédite, étrangère à celles des autres compositeurs et à celle dont il s'est, lui-même, auparavant servi, Il sait ce qu'il veut et où il va.
Dans une de ses dernières lettres à Galabert, au mois de février 1871, Georges Bizet dépeint sa tristesse : « ... nous nous retrouvons debout, vivants, ou à peu près, sur les ruines de cette pauvre France, si coupable, mais aussi bien malheureuse. Ce que coûtent les Napoléons, nous ne vivrons peut-être pas assez pour le savoir ! » Puis, il fait part à son ami de ses travaux : « Je voudrais, cet été, terminer Clarisse Harlowe et Grisélidis. Grisélidis est très avancée. Sardou veut changer le dernier acte. Dès qu'il sera rentré à Paris, je vais le prier d'en finir afin que j'en puisse faire autant. Quant à Clarisse, c'est à peine commencé. »
Bizet ne fera représenter ni Grisélidis ni Clarisse Harlowe. Encore deux partitions sacrifiées aux scrupules de sa conscience devenue très exigeante. Peu importe ! D'autres partitions vont naître, plus proches du génie qui le tourmente, de l'idéal qu'il s'est formé. Des partitions qui seront les vraies filles de son sang.
La guerre de 1870 — comme les guerres qui ont, hélas ! suivi — a fait une coupure profonde entre deux périodes d'histoire. Coupure qui se laisse voir tant dans l'état de société que dans l'art. On revenait des prétentions, des frivolités, des mollesses et des oppressions du second Empire. La défaite avait soumis la nation à de redoutables épreuves et traînait encore après elle des deuils et des misères. Les illusions tombaient une à une. La France venait d'être dépouillée d'une bonne partie de ses richesses et de sa puissance.
Une supériorité, du moins, nous restait : celle de la pensée française, celle de l'art français. Aussitôt, s'accuse la réaction contre les vieilles formes lyriques faciles ou faussement héroïques de l'Empire déchu. Un rêve ardent de renaissance et de progrès exalte les imaginations et stimule les énergies.
Les musiciens ne sont pas les derniers à s'associer à cet enthousiasme des artistes et des intellectuels. Dès le 25 février 1871 est fondée la Société nationale de Musique, qui prend pour devise : Ars Gallica. Sous la présidence de Camille Saint-Saëns, se groupent là, dans un bouillonnement juvénile, les musiciens les plus marquants du temps et de la période qui va suivre : César Franck, Gabriel Fauré, Edouard Lalo, Ambroise Thomas, Massenet, Ernest Guiraud, Vincent d'Indy, Chabrier, Duparc, Widor, Chausson, Bourgault-Ducoudray, Alexis de Castillon et d'autres. Georges Bizet est naturellement parmi eux, avec eux. Une impulsion galvanisante et féconde part de cette union de toutes les forces vives de la musique enfin retrouvée.
Au cours des années qui venaient de s'écouler, les musiciens étouffaient dans une sorte de cercle rituel que les augures des journaux, des théâtres et des concerts interdisaient de franchir. Berlioz et Gounod, qui avaient essayé de renouveler l'art des sonorités, dans son grand courant, subsistaient, pour ainsi dire, à l'ombre. Apprêtées selon les vieilles formules, les partitions à la mode étaient pavées d'imitations et de réminiscences. Leurs auteurs ne faisaient appel qu'aux combinaisons d'école, aux ficelles du métier pour s'assurer des succès rapides et fructueux. Art du dehors qui n'était plus qu'une démonstration des procédés académiques dont on usait et abusait.
Animés par une noble idée d'émulation, les membres de la Société nationale de Musique marquent leur dissidence en rompant avec des doctrines déjà à leur déclin. Dans un esprit d'émancipation, qui leur a été soufflé par Richard Wagner, ils sont occupés de grands desseins. Mais ils ne se laissent pas attirer dans la sphère wagnérienne. Ils se donnent du dégagement, de l'air. Ils veulent « renationaliser » la musique.
Grâce à leurs efforts et à leurs recherches, la musique française, qui, dans un passé reculé, avait sa figure resplendissante et déterminée, sera désormais de nouveau caractérisée. Elle deviendra le point de mire de toute la littérature sonore qui va naître. Elle prendra le premier rang dans l'histoire du développement des formes symphoniques.
Pasdeloup, Edouard Colonne, aux Concerts, et Camille Du Locle, à l'Opéra-Comique, apportent aux membres de la Société nationale une aide à la fois morale et positive. Ils essayent de conquérir leurs auditoires aux talents d'une vraie valeur qui se produisent. Nommé, avec Leuven, à la direction de la salle Favart, après en avoir été le secrétaire général, Du Locle connaît à fond les rouages et les possibilités de l'établissement qu'il doit conduire et gérer. Artiste et lettré, il penche du côté des réformateurs de la scène et de la langue musicales. Comme Léon Carvalho, comme Emile Perrin, il s'adresse de prédilection à Georges Bizet qui distance ses rivaux par le talent et par l'ardeur de son activité.
X
Pour commencer, et afin de ne pas heurter de front le public arriéré de l'Opéra-Comique, Du Locle ne montera qu'une pièce lyrique en un acte. Sans une action astucieusement intriguée, sans coups de théâtre, sans les artifices obligés. Avec l'assentiment de Du Locle, de Leuven et de Bizet, Louis Gallet rédige le livret de Djamileh, vaguement inspiré de Namouna d'Alfred de Musset. « Les directeurs de l'Opéra-Comique, déclare Bizet en septembre 1871, ne voulant pas risquer de grandes pièces cette année, m'ont demandé d'écrire la partition d'une Namouna assez intéressante. La chose était pressée, et l'on m'a mis l'épée dans les reins... »
Bizet ne s'inquiète pas du sort de Grisélidis qui ne répond plus à ses aspirations et ne pense qu'à Djamileh. Sur le poème de Gallet, il compose une musique d'une juste couleur poétique, avec le souci de poser, par ses assemblages sonores, les caractères des trois personnages de la comédie et de dépeindre leurs sentiments. Dans le choix de quelques-unes de ses harmonies paraît je ne sais quelle sensualité qui s'ajoute à une plus grande liberté d'expression.
Dès la première mesure de sa nouvelle partition, — il est plus timoré dans le reste de l'ouvrage, — Bizet affiche crânement son dédain des vieilles règles, invente son harmonie et, plus loin, masque ses tonalités. Cela n'est pas sans contrister Benedict Jouvin, critique du Figaro, qui écrit : « M. Georges Bizet a placé au début de son ouverture la marche en ut mineur du défilé des esclaves ; elle manque de caractère, de mélodie et de rythme. La tonalité s'y dérobe avec affectation à l'oreille qui voudrait la saisir. » En outre, certains motifs, ornés d'harmonies différentes, ressurgiront au cours de la partition, lorsque la situation l'exigera. Cela suffit aux critiques pour accuser faussement le musicien de wagnérisme, — tout en le couvrant de fleurs.
L'ingénieuse disposition des masses sonores, le charme très pur qui émane du Gazel et du Lamento chantés par Djamileh, l'orientalisme léger du Pas de l'almée, encadré par le Chœur, l'élégance déliée des ensembles, la fine habileté de l'orchestration laissent indifférents les auditeurs. Créée le 22 mai 1872, Djamileh n'est jouée que dix fois. « Djamileh n'est pas un succès, dit Bizet à Galabert. Le poème est vraiment antithéâtral, et ma chanteuse a été au-dessus de toutes mes craintes. Pourtant je suis extrêmement satisfait des résultats obtenus. La presse a été très intéressante... Ce qui me satisfait plus que l'opinion de tous ces messieurs, c'est la certitude absolue d'avoir trouvé ma voie. »
Président de la Société nationale et ami de Bizet, Camille Saint-Saëns s'émeut de l'échec immérité de Djamileh, et, dans un sonnet, prend publiquement la défense de l'œuvre (il est écrivain aussi aisé que savant musicien) :
Djamileh, fille et fleur de l'Orient sacré,
D'une étrange guzla faisant vibrer la corde,
Chante en s'accompagnant sur l'instrument sacré
L'amour extravagant dont son âme déborde.
Le bourgeois, ruminant, dans sa stalle serré,
Ventru, laid, à regret séparé de sa horde,
Entr'ouvre un œil vitreux, mange un bonbon sucré,
Puis se rendort, croyant que l'orchestre s'accorde.
Elle, dans les parfums de rose et de santal,
Poursuit son rêve d'or, d'azur et de cristal,
Dédaigneuse à jamais de la foule hébétée.
Et l'on voit au travers des mauresques arceaux,
Les cheveux dénoués tombant en noirs ruisseaux,
S'éloigner la Houri, perle aux pourceaux jetée.
Reprise à l'Opéra-Comique en 1942, Djamileh n'a pas été maintenue sur l'affiche de la salle Favart.
XI
En même temps qu'il travaillait à Djamileh, Georges Bizet faisait paraître un recueil de douze morceaux pour piano à quatre mains, Jeux d'enfants. Œuvre des plus significatives du génie du musicien parvenu à la maturité et à la pleine maîtrise. Dans Jeux d'enfants, aucune trace de tournures convenues, de style appris, pâteux ou rebattu. Mais une concision brûlante et qui fait pourtant croire à je ne sais quoi d'abandonné, de jeté ; une étincelante netteté ; une finesse aisée dans l'invention ; une sûreté de facture sans défaut. Musique d'une seule coulée et accomplie d'un bout à l'autre. Partition où la personnalité de Bizet se prononce de façon décisive et qui est digne de figurer auprès des Scènes enfantines de Schumann et de la Chambre d'enfants de Moussorgski.
Bizet en tira une « Petite suite d'orchestre », qui fut donnée le 2 mars 1873, à l'Odéon, pour l'inauguration des Concerts Colonne. L'ouvrage, n'était constitué que de cinq pièces extraites du recueil et que le musicien orchestra pour la circonstance : l'impromptu la Toupie, la berceuse la Poupée, la marche Trompette et tambour, le duo Petit mari, petite femme et le galop final, le Bal. Le succès de Jeux d'enfants fut si vif qu'on l'inscrivit souvent sur les programmes des Concerts. En 1932, les Ballets Russes de Monte-Carlo en firent un divertissement chorégraphique. Exemple suivi par l'Opéra, dix ans plus tard.
Avec Jeux d'enfants, Georges Bizet nous montre qu'il n'a plus le respect superstitieux de la tradition, des doctrines ni des ouvrages à la mode. Il sait maintenant que les grands compositeurs qui l'ont précédé n'ont pas reculé devant les découvertes ; qu'ils ont osé rester fidèles à eux-mêmes, au risque d'être méconnus, attaqués et bafoués. Il imposera, à son tour, sa façon personnelle de sentir, d'exprimer, d'harmoniser.
Tout en demeurant dans le cadre des belles théories éprouvées, il garde son originalité sincère et saine. Dans la littérature sonore, il trouve et fonde un genre qui lui appartient en propre : un réalisme profond et chargé de poésie. Il s'écarte peu à peu de l'italianisme, du romantisme, du wagnérisme. Il vient à la vérité, à sa vérité. Pour son entier épanouissement, il n'a plus qu'à écrire l'Arlésienne et Carmen qui comptent parmi les plus beaux joyaux du trésor de la musique dramatique.
XII
Je ne signalerai qu'en passant l'Ouverture intitulée Patrie, faite sur commande et qui fut exécutée pour la première fois le 15 février 1874 aux Concerts Pasdeloup. Seul, le début peut en intéresser. Il semble bien que Bizet composa cette Ouverture de façon hâtive et qu'il se servit, dans l'occasion, de pages déjà écrites avant la guerre de 1870. En revanche, l'Arlésienne mérite d'être étudiée avec attention. Sa valeur n'est pas moindre que celle de Carmen.
Après avoir quitté le Théâtre-Lyrique, Carvalho avait pris la direction du Vaudeville, uniquement consacré à la comédie. Là encore, il ne peut se détacher de la musique. Il est convaincu que, pour faire une impression plus profonde sur les spectateurs, tout divertissement théâtral doit comporter une partie musicale.
En son temps, Molière, dont presque toutes les pièces étaient traversées de chants et de danses, avait fixé ce genre mixte. Genre suivi dans les comédies à ariettes, les vaudevilles, les mélodrames. De là dérivait aussi l'opéra-comique avec ses dialogues parlés, entrecoupés de musique. Dans la première moitié du XIXe siècle, les compositeurs les plus réputés avaient écrit de mémorables musiques de scène : Beethoven pour Egmont, Weber pour Preciosa, Schubert pour Rosamund, Mendelssohn pour Antigone, Athalie, le Songe d'une nuit d'été, Schumann pour Manfred.
Carvalho, dont l'amitié vigilante qu'il garde à Bizet ne s'est nullement affaiblie, fait appel au compositeur de Djamileh pour écrire la musique de scène du drame qu'il a demandé à Alphonse Daudet. Il devait débuter au Vaudeville par Madame Frainex de Robert Halt. La pièce en question ayant été interdite par la Censure, il ouvre les portes du théâtre du Vaudeville avec l'Arlésienne.
C'est le 1er octobre 1872, exactement neuf semaines après la création de Djamileh, qu'a lieu la première représentation de l'Arlésienne. L'accueil réservé que le public a fait à ses partitions antérieures n'a découragé nullement Georges Bizet. Il continue avec acharnement son œuvre, sans cesse s'améliorant et s'élevant.
On est frappé par la somme de travail qu'il fournit encore et toujours. Il termine Djamileh, compose Jeux d'enfants, l'Arlésienne, ébauche Carmen (il a le scénario de Meilhac et Halévy depuis le début de juin 1872). Il a accepté, pour peu de temps, le poste de chef de chant à l'Opéra. En 1871, il avait déjà fait répéter aux chanteurs de l'Opéra Erostrate d'Ernest Reyer. créé le 16 octobre 1871.
Pour écrire l'Arlésienne, Alphonse Daudet et Georges Bizet se sont associés, semble-t-il, dans une étroite union. Ils se sont assujettis au même ordre d'inspirations, en puisant dans une veine limpide, franche, populaire. Avec un charme souverain, avec une fière sincérité, l'écrivain a fait revivre les paysans de la Camargue, dans leurs vertus domestiques, dans leur noblesse de terriens. Le musicien, sans jamais nuire à l'action et en serrant de près chaque ligne du drame, y a introduit les voix de la nature provençale. Dans cette œuvre, à laquelle Daudet et Bizet ont participé de toute leur âme, respirent la bonhomie et la simplicité antiques, la solennité naïve des vieux aèdes.
La partition de l'Arlésienne environne et pénètre, accentue et achève l'épopée rurale conçue par Alphonse Daudet. Elle y met un couronnement, une magie. Elle relie les scènes entre elles comme par des anneaux d'or. Elle étend, élargit la signification de l'action. Elle est plus qu'un parfait accompagnement musical du drame dont elle établit à merveille « l'ambiance sonore », comme on dit aujourd'hui au cinéma. Elle en est la seconde face, l'amplification harmonieuse, le prolongement vibrant dans l'espace.
Non seulement parce que la musique de l'Arlésienne précède immédiatement celle de Carmen, mais aussi parce qu'elle en est la première esquisse et comme le préambule, elle mérite toute notre attention. C'est pourquoi, il est nécessaire d'en faire ici l'analyse avec quelque détail.
L'Ouverture-Prélude de l'Arlésienne est faite de trois parties : la Marche de Turenne, avec ses variations symphoniques, le motif mélodique de l'Innocent et le thème qui décrit tout ensemble l'Arlésienne et la passion mortelle que Frédéri a conçue pour elle. La Marche de Turenne crée l'atmosphère de droiture et de noblesse anciennes ainsi que le paysage soleilleux de la Provence, — cette Provence où est installée la famille de Rose Mamaï.
Quant à l'Innocent, on sait qu'Alphonse Daudet en a fait comme le centre, le symbole vivant et redoutable de son drame. Tant que l'adolescent demeure plongé dans son hébétude, un bonheur de surface abuse les habitants du Castelet. L'intelligence de l'Innocent ne s'éveille qu'au prix d'un sacrifice et d'une douleur immenses qui formeront toute l'action tragique.
Georges Bizet, en plaçant la figure de l'Innocent au début de sa partition, a obéi au souhait, à la pensée directrice d'Alphonse Daudet. A la fin de l'Ouverture-Prélude, les motifs de l'Innocent et de l'amour fatidique de Frédéri s'enlacent et luttent avec force pour annoncer et résumer les péripéties de la pièce.
Au premier acte, pendant que le vieux berger Balthazar raconte à l'Innocent l'histoire de la Chèvre de M. Seguin — autre symbole de l'œuvre — la phrase mélodique, qui représente le pauvre ingénu, remonte de l'orchestre, en faisant effort comme l'enfant qui veut comprendre. Le riant Chœur populaire, « Grand soleil de la Provence », retentit. Il souligne la joie de Frédéri, auquel il est enfin permis d'épouser l'Arlésienne. Le drame entre avec Mitifio, dont l'arrivée funeste suscite l'exploration des violoncelles avec les pizzicati des contrebasses qui en marquent le rythme. L'acte se termine sur un contraste violent : au moment où Frédéri apprend l'indignité de celle qu'il aime, éclate de nouveau le Chœur allègre des paysans. Solitude de l'homme qui souffre au milieu de l'indifférence des autres hommes et de la nature.
Le Prélude du deuxième acte porte ce titre : l'Etang de Vaccarès. C'est une large pastorale en la, dont le thème est d'un charme très pur. Charme surtout sensible quand le thème se dissout dans le paysage sur un pianissimo. Au loin, les laboureurs et leurs compagnes se rendent à leurs travaux en chantant un Chœur agreste, orné d'harmonies risquées, d'un rythme sinueux et assez preste et dont les dernières mesures ont quelque chose d'une élégie. Après le départ de Vivette, l'Innocent, accompagné de Balthazar, reparaît sur son motif, rythmiquement déformé. Frédéri pousse la porte de la bergerie où il s'est enfermé. Ses souffrances nous sont décrites, de façon admirable, par son thème ingénieusement harmonisé. D'une rive à l'autre, l'air est traversé par le mélancolique et bref Appel des bergers. L'Innocent essaye de répéter le conte de la Chèvre de M. Séguin. Il s'endort au milieu du récit, sur l'émouvante berceuse formée du vieux chant provençal, Er dou guet. Dans le soir qui tombe, les paysans reviennent des champs, en murmurant le Chœur qu'ils nous ont fait entendre au début de ce deuxième tableau.
Le troisième tableau, la Cuisine du Castelet, est précédé du fameux Intermezzo en mi bémol, pour saxophone et cor. Notons que Bizet est l'un des premiers musiciens qui aient introduit dans l'orchestre le saxophone. L'usage, de nos jours, s'en est partout répandu. Avec l'aide d'Ernest Guiraud, cet Intermède nous a été changé en Agnus Dei. Quoi qu'on en ait dit, il est à sa place à cet endroit de la pièce. Fait d'un long thème mélodique qui module durant trente mesures, il dépeint avec force la noble simplicité de mœurs, la gravité de sentiments, l'affectueuse solidarité dans la douleur des hôtes du Castelet.
La musique s'épure et s'élève encore davantage au quatrième tableau, intitulé la Cour du Castelet. Dans le Prélude éclate le Carillon, qui sera repris après le célèbre Andantino à 6/8, l'une des pages les plus bouleversantes et les plus originales de toute la littérature sonore. La scène se termine sur le rappel de l'Intermezzo. Le tendre duo de Frédéri et de Vivette, dont le mariage va s'accomplir, n'est accompagné que d'une phrase en arpèges de harpes. Mais l'apparition de Mitifio fait remonter dans le cœur de Frédéri la passion qu'il a pour l'Arlésienne et dont il ne peut guérir. Frédéri repousse Vivette et provoque le gardian Mitifio. La Farandole, dont le thème est emprunté à l'air populaire Danso dei chivau frus, résonne dans le lointain, s'enfle peu à peu pour exploser à la fin de l'acte.
Le Prélude du dernier tableau, la Magnanerie, est fait de deux thèmes qu'on a entendus pendant l'Ouverture : thème de la passion de Frédéri pour l'Arlésienne dont il va mourir et, dans le même ton, thème de l'Innocent, dont l'esprit dormant s'éveille lentement. Les paysans fêtent joyeusement saint Eloi. Ils chantent la Marche de Turenne qui figurait également dans l'Ouverture. On sait que les paroles de cette marche sont attribuées au roi René, comte de Provence, et la musique à Lully. La Marche de Turenne et la Farandole s'enchevêtrent l'une dans l'autre. Avant le suicide de Frédéri, le motif de l'Innocent rayonne d'une douce clarté pour le retour à la raison du petit Janet. Quand Frédéri, qui ne peut plus endurer sa souffrance, s'est levé, dans la nuit, pour se suicider, le motif haletant et morcelé de sa passion pour l'Arlésienne frémit une dernière fois. Au bas du Castelet, les paysans continuent de s'ébattre à l'occasion de la fête de saint Eloi.
Au cours de l'année 1872, — année de la création, — l'Arlésienne ne fut jouée au Vaudeville que quinze fois. Bizet tira de sa partition une Suite d'orchestre (Ouverture, Prélude, Intermezzo, Adagietto et Carillon) qui fut exécutée aux Concerts populaires du Cirque d'Hiver, un mois après que la pièce eut été retirée de l'affiche du Vaudeville. Grand succès, cette fois. La Suite d'orchestre fut ensuite donnée aux Concerts Colonne, aux Concerts du Conservatoire et dans toutes les Associations symphoniques.
Le drame de Daudet, avec la musique de Bizet ne fut remonté qu'en 1885 sur le Théâtre de l'Odéon — dix ans après la mort du compositeur. Accueil plein d'enthousiasme à cette reprise. L'Arlésienne fut jouée en 1933 à la Comédie-Française. Passée au répertoire du Théâtre populaire du Palais de Chaillot, elle vient de reparaître sur l'affiche du Théâtre-Français.
Le mot de méditerranéen, qui a servi à Nietzsche pour qualifier tout l'œuvre de Georges Bizet, s'applique plus encore, peut-être, à la musique de l'Arlésienne qu'à celle de Carmen. Il n'est pas de partition qui nous traduise avec autant d'intensité, dans les paysages lumineux de la Provence, la fatalité de la passion humaine. La grande prose franche, familière et comme dorée d'Alphonse Daudet est merveilleusement mise en valeur par Georges Bizet. Le compositeur reprend la pensée de l'écrivain au point où elle s'arrête, la complète, la conduit à son aboutissement. Au fond humain, au vrai de la passion exprimés par son collaborateur, Georges Bizet prête une ampleur mystérieuse. Grâce au personnage de Balthazar, astrologue rustique, la pièce de Daudet est comme traversée par des rayons d'astres. La musique de Bizet crée l'espace nocturne et semé d'étoiles où se forme et se dissipe le fragile destin des hommes.
XIII
PARENTÉ ENTRE « L' ARLÉSIENNE » ET « CARMEN »
Si j'ai plus longuement insisté sur la partition de l'Arlésienne, c'est parce que le musicien est là dans la toute puissance de son génie, parce qu'il est, déjà, le musicien de Carmen. Je n'ai tenté de montrer que le plan de la musique de l'Arlésienne, le découpage et la mise en place des parties symphoniques. Je n'en ai pas indiqué les nombreuses découvertes techniques, la beauté de la mélodie, ni l'audace des assemblages harmoniques. La « manière Bizet » ou, si l'on veut, le « style Bizet », sont maintenant fixés et reconnaissables entre tous.
Entre la musique de l'Arlésienne et celle de Carmen, il y a parallélisme et presque identité. La « Marche de la Cuadrilla » de Carmen répond à la « Marche de Turenne » de l'Arlésienne, le motif mélodique qui dépeint Carmen et son fatalisme est frère de celui qui est réservé à l'Arlésienne et à la passion qu'elle inspire ; la Cantilène « la Fleur que tu m'avais jetée » est de la même longueur d'haleine et de la même structure que le Prélude du troisième tableau de l'Arlésienne. On peut dénombrer, entre les deux chefs-d'œuvre, bien d'autres analogies et correspondances. L'Arlésienne est, d'une certaine façon, la première ébauche toute fraîche de Carmen. On mesure facilement l'importance qu'il faut attacher à la musique de scène que Bizet a composée pour le drame d'Alphonse Daudet.
Il y a mieux et davantage. Les personnages de l'Arlésienne ont des traits d'une ressemblance frappante avec les héros de Carmen. Frédéri, Vivette, Mitifio, le patron Marc et l'Equipage sont, en quelque sorte, les gravures en premier état de don José, de Micaëla, d'Escamillo, du Dancaïre et du Remendado. L'Arlésienne elle-même n'apparaît pas matériellement dans la pièce. Seuls, son invisible masque et son ombre planent sur toute l'action tragique et font constamment songer à la bohémienne Carmen.
Pour tracer les rôles du livret de l'opéra-comique confié à Bizet, Meilhac et Halévy sont plus influencés, dirait-on, par les personnages de la pièce d'Alphonse Daudet que par ceux du récit de Prosper Mérimée. On devine que Georges Bizet, l'esprit rempli de l'Arlésienne, qu'il était en train de composer, n'ait pu se détacher des héros de Daudet, qu'il les ait repris et comme prolongés dans Carmen. Selon son habitude, il a dû intervenir dans la rédaction du libretto de Meilhac et Halévy et imposer à ses collaborateurs ses propres vues et ses propres sentiments.
***
La figure sonore de Carmen n'a pas brusquement surgi dans l'esprit de Georges Bizet avec son feu et ses couleurs d'une exactitude violente. Elle a hanté l'imagination du compositeur pendant des années, dans ses œuvres qui ont précédé. Œuvres dans lesquelles on entrevoit la bohémienne par éclairs, où elle se précise à peine et s'enfuit pour reparaître encore. Ombre légère sans cesse perdue et retrouvée.
Depuis le début du XIXe siècle, plusieurs musiciens — et non des moindres — s'étaient inspirés, dans leurs ouvrages, des chants bohémiens. Rappelons seulement que Beethoven lui-même voulait écrire un opéra, Dragomira, la bohémienne, sur un livret du célèbre poète autrichien Grillparzer. Il avait été d'abord question d'une Mélusine, dont Grillparzer avait bâti le scénario et écrit quelques scènes. Dans les Cahiers de conversation de 1823, on lit que Beethoven, assez peu tenté par Mélusine, s'était rabattu sur Dragomira, la bohémienne, dont la première ébauche se trouvait dans un poème publié par Grillparzer, sous le titre : le Bandit Dragomir.
Pendant son séjour à la villa Médicis, à Rome, Bizet n'avait pas encore vingt ans qu'il songeait à écrire une Esmeralda sur le livret de Victor Hugo. La petite héroïne dansante de Notre-Dame de Paris n'est-elle pas la sœur aînée de la Carmen de Prosper Mérimée, qui devait paraître neuf ans plus tard ?
Dans les Chants du Rhin, son premier recueil (six lieds pour piano), Bizet intitule son quatrième lied : la Bohémienne. Ne retenons ni son second envoi de Rome, l'Ode symphonique sur les Lusiades de Camoens, ni sa transcription pour piano de la Danse bohémienne d'Ambroise Thomas. Mais dans la Jolie Fille de Perth, l'un des principaux personnages se nomme Mab, la bohémienne, et, au deuxième acte, retentit l'électrisante Danse bohémienne avec chœurs, à laquelle s'apparentera, par le rythme, la danse du début du deuxième acte de Carmen.
Musicalement aussi, on peut découvrir, dans les œuvres antérieures à Carmen, plusieurs pages dont l'écho se retrouve dans la partition écrite sur le livret de Meilhac et Halévy. C'est ainsi que, dans les Pêcheurs de perles, la première phrase de Nadir renferme en puissance le thème principal de Carmen.
Dans « le galop », le Bal, qui termine le recueil Jeux d'enfants, s'annonce, sur le même rythme, la « Marche de la Cuadrilla » du Prélude de Carmen. Marche qui reviendra au troisième et au dernier actes du drame lyrique et que Bizet traitera dans des teintes harmoniques nouvelles.
Il me faut également signaler que « l'entr'acte », placé avant le troisième acte de Carmen et qui doit dépeindre, à la fois, la beauté sereine de la nuit ibérique et le cheminement furtif des contrebandiers à travers les défilés de la montagne, avait été composé pour l'Arlésienne. L'ensemble en sol bémol, « Quant aux douaniers, c'est notre affaire », du troisième acte de Carmen, avait été aussi écrit pour l'Arlésienne.
D'accord avec Carvalho et Alphonse Daudet, Georges Bizet les avait détachés de la musique de scène de l'Arlésienne pour les introduire dans Carmen, dont il avait le scénario entre les mains quatre mois avant la première représentation de l'Arlésienne.
Il devait donc travailler, dans le même temps, à ses deux partitions suprêmes. Rien d'étonnant qu'elles soient de la même encre, de la même veine, de la même et admirable inspiration.
Enfin, on peut observer aisément comment Georges Bizet arrive à forger sa propre grammaire d'art, sa syntaxe hardie de musicien scénique : d'abord, comme s'il était gêné lui-même par ses découvertes, dans les Pêcheurs de perles (Duo de Nadir et de Leïla, Air de Zurga, Duo de Leïla et de Zurga) ; dans Souvenirs de Rome (Introduction-Allegro) ; puis, dans la Jolie Fille de Perth (Danse bohémienne, Menuet, Air de Ralph) ; dans Djamileh (Ouverture, Gazel, Lamento) et dans Jeux d'enfants (pièces n° 2, 3, 4, 6, 11 et 12). Il est en pleine possession de son style émouvant et « serré », comme il dit lui-même, et de son langage harmonique, quand il entreprend, à grands coups de génie, les compositions de l'Arlésienne et de Carmen.
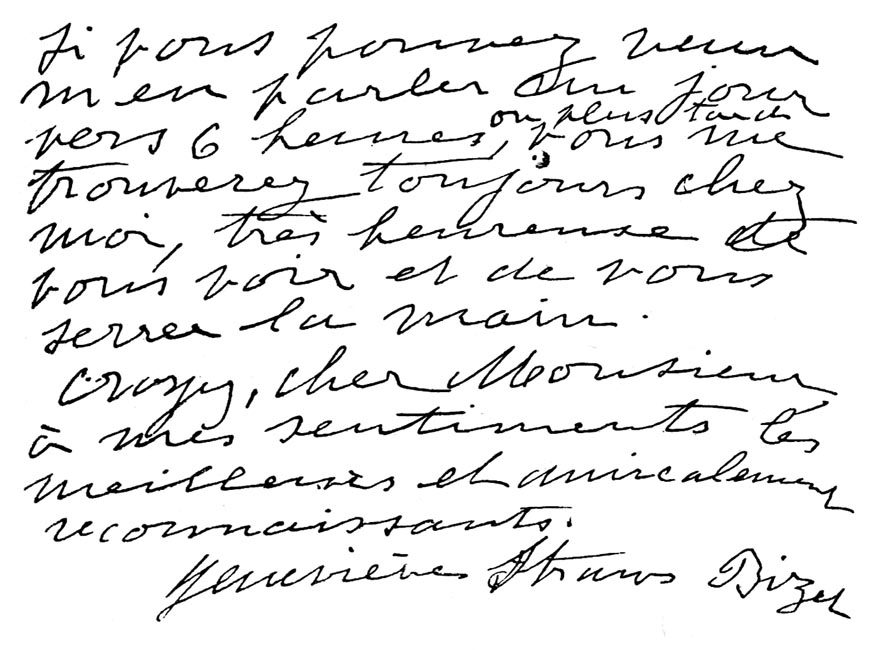
lettre autographe de Geneviève Bizet
Extrait d'une lettre écrite par Mme G. Straus-Bizet à Henry Malherbe, le 16 février 1921. Mme Straus-Bizet, alors âgée de soixante-quinze ans, s'excuse de n'avoir pu assister à la seconde conférence d'Henry Malherbe sur Georges Bizet. Conférence prononcée au Théâtre National de l'Opéra, avec le concours de l'orchestre des Concerts historiques Lamoureux (sous la direction de Rhené Bâton), de Mmes Royer, Galzi, MM. Rambaud, Goffin, Narçon, Bruyas, Girard et Soria.
DEUXIÈME PARTIE
LE MYSTÈRE DE LA MORT DE GEORGES BIZET
XIV
Le sort incertain de Carmen, aux premières représentations, avait affecté profondément Bizet. Cet insuccès fut-il la cause de la mort du grand musicien ? Charles Pigot, qui a publié une biographie étendue de Bizet, a écrit que le compositeur, en proie au désespoir, avait quitté le théâtre, après la première représentation, en compagnie de Guiraud et qu'au bras de son ami, il avait erré jusqu'à l'aube dans Paris. Charles Pigot prétendait tenir le fait de Guiraud lui-même. Or, Edmond Galabert a dit dans sa préface aux Lettres à un ami : « Il est possible qu'en sortant de la première de Carmen, il ait subi une dépression morale passagère, mais Guiraud ne me l'a pourtant pas signalée, n'y attachant pas, probablement, plus d'importance qu'il ne convenait, et il ne m'a pas parlé de cette marche dans Paris qui aurait duré toute la nuit et pendant laquelle Bizet, seul avec lui, aurait exhalé sa douleur. »
Le soir de la première représentation, les spectateurs et tous les amis de Bizet avaient la conviction que Carmen était tombée à plat et ne se relèverait pas. A la sortie du théâtre, personne n'osa aborder le musicien pour lui parler de sa nouvelle partition. Geneviève Bizet elle-même ne se trouvait pas auprès de son mari. Elle était partie, de son côté, après la chute du rideau sur le dernier acte.
Ludovic Halévy, cousin par alliance de Bizet et son librettiste pour Carmen, a écrit, en 1905, dans le journal le Théâtre, à l'occasion de la millième de Carmen : « Nous habitions, Bizet et moi, la même maison... nous rentrâmes à pied, silencieux. Meilhac nous accompagnait. »
Galli-Marié, qui avait créé le rôle de Carmen et en avait été l'interprète inégalée, a déclaré à un journaliste de Nice : « L'insuccès de Carmen, à la création, mais c'est une légende ! Carmen n'est pas tombée au bout de quelques représentations, comme beaucoup le croient. Nous l'avons jouée plus de quarante fois dans la saison et, quand ce pauvre Bizet est mort, le succès de son chef-d'œuvre semblait définitivement assis. »
A la vérité, Carmen fit encaisser à l'Opéra-Comique de basses recettes aux cinq premières représentations. Du Locle eut le courage de maintenir l'œuvre nouvelle. Les recettes commencèrent à se relever à partir de la sixième représentation. Jusqu'à la mort de Bizet, survenue le 3 juin 1875 (exactement six ans après son mariage et trois mois après la première représentation de son chef-d'œuvre), Carmen figura trente-trois fois sur l'affiche de la salle Favart. Trente-trois représentations en trois mois, c'est pour un ouvrage lyrique un fait rare et le signe indiscutable de son succès auprès du public. Après la dixième représentation de Carmen, Bizet pouvait avoir confiance en son œuvre, au lieu d'en désespérer comme l'assurent ses biographes. Aucune de ses partitions pour la scène n'avait été aussi souvent jouée, de son vivant. Rappelons que les Pêcheurs de perles n'avaient été représentés que dix-huit fois, la Jolie Fille de Perth vingt et une fois, Djamileh dix fois et l'Arlésienne quinze fois.
C'était là, au contraire, une revanche éclatante que le musicien prenait sur ses nombreux détracteurs. A l'exception d'Ernest Reyer, comme nous le verrons plus loin, les critiques musicaux s'étaient acharnés sur la nouvelle partition.
Bien que profondément ébranlé par les divers assauts qu'il venait de subir, Georges Bizet n'avait pas tardé à se remettre à l'ouvrage. Il avait presque terminé la partition piano et chant du Cid, dont le livret d'Edouard Blau avait été tiré du poème original de Guilhem de Castro. Ce qui l'en avait séduit, nous apprend Edouard Blau, c'est une scène où Rodrigue reçoit, sous sa tente et à sa table, un lépreux que le Cid tient à servir lui-même, comme s'il s'agissait d'un hôte princier (*). A la fin de juin 1875, il avait aussi promis de livrer à son éditeur une Geneviève de Paris, sur un poème de Louis Gallet, qu'il voulait dédier à sa femme dont le prénom était Geneviève.
(*) Dans le drame de Guilhem de Castro, Rodrigue, avant d'obtenir le pardon de Chimène, fait un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Galice, en compagnie de deux écuyers. Au cours du voyage, il rencontre un lépreux tombé dans une fondrière, en une gorge de la montagne. Tandis que ses deux écuyers et un berger s'enfuient, épouvantés, Rodrigue retire le lépreux de sa position fâcheuse, le couvre de son manteau, lui baise la main. Après l'avoir conduit sous sa tente, il le fait manger à son propre plat, boire dans son verre et dormir à ses côtés.
Soudain, le lépreux se lève de sa couche et apparaît sous un pallium blanc. Il restitue à Rodrigue son manteau qu'il a parfumé d'odeur divine.
Le lépreux n'est autre que Lazare (sans doute le Lazare évangélique de la parabole du Mauvais Riche). Emu par la charité sublime du Cid et en témoignage de reconnaissance, le saint personnage promet à Rodrigue la victoire sur tous ses adversaires.
XV
GEORGES BIZET S'EST-IL SUICIDÉ ?
Dans les lettres adressées à sa mère et à ses amis, Georges Bizet, sans cesse, se plaint de ses maux de gorge. A Rome, à Naples, à Paris, il souffre, presque chaque année, de la même affection. En juillet 1868, il écrit encore à Galabert : « Je viens d'être très malade : une angine extrêmement compliquée. J'ai souffert comme un chien ! Me voici sur pied, quoique très faible... »
Absorbé par ses écrasantes besognes, il avait peu de temps pour se soigner. Depuis 1872, comme s'il pressentait sa fin, il avait travaillé avec plus d'opiniâtreté encore que de coutume. En trois ans, il avait composé, malgré ses occupations « d'à côté », trois partitions maîtresses.
A l'exception de Galli-Marié, personne, à l'Opéra-Comique, ne prévoyait la réussite de Carmen. Le directeur lui-même grommelait, devant Camille Saint-Saëns : « C'est de la musique cochinchinoise. On n'y comprend rien ! »
Un ministre lui ayant demandé une loge, pour la première représentation, Du Locle lui répondit par une invitation personnelle pour la répétition générale, voulant que le ministre jugeât par lui-même s'il était convenable qu'il amenât sa famille à pareil spectacle. Deux mois avant la création de Carmen, Bizet avait été nommé chevalier de la Légion d'honneur. Mais la promotion ne parut au Journal officiel qu'à la fin du mois de février 1875. On croyait si peu au succès de la nouvelle pièce, que le jour de la répétition générale on faisait circuler dans les couloirs du théâtre ces mots prononcés par un chroniqueur en vogue : « On l'a décoré avant Carmen, parce qu'on n'aurait pas pu le faire après. »
Agacé par les incidents qui s'étaient produits avant la première représentation, indigné par les articles de la critique, surmené par les dernières répétitions, Georges Bizet inquiétait son entourage par sa mine défaite. Il voulait, malgré sa fatigue, continuer ses travaux. Il ne renonçait pas non plus à ses divertissements. Excellent nageur, il aimait faire la coupe et le plongeon dans l'eau fraîche des piscines et des rivières. A la suite d'une baignade dans l'eau froide, une paralysie partielle se déclara, provoquée par une crise de rhumatisme aigu. Immobilisé, le musicien était astreint à un traitement sévère ordonné par les médecins.
Le 1er juin 1875, Bizet se laissait conduire à Bougival, où il avait loué une petite villa située en face de la propriété de Pauline Viardot. La veille de son départ, il s'était longuement entretenu avec Ernest Guiraud dont il avait voulu écouter la partition de Piccolino, à peine terminée. Il se plaignit d'entendre confusément et finit par avouer à Guiraud qu'il était sourd de l'oreille gauche.
Dès son arrivée à Bougival, le malade se sentit mieux. Il fit une promenade en compagnie de sa femme et du pianiste Delaborde. Dans la nuit, il fut en proie à d'horribles souffrances. On appela un médecin de Rueil. Il ne sut ordonner que le repos. La nuit suivante, les douleurs se firent plus atroces encore. On rappela d'urgence le médecin et Delaborde. Obligé de faire, à pied et en pleine nuit, le trajet de Rueil à Bougival, le médecin arriva une heure après Delaborde.
Il était trop tard. Bizet venait d'expirer à minuit moins cinq. Il n'était âgé que de trente-six ans. La veille, on avait joué, pour la trente-troisième fois, Carmen, à l'Opéra-Comique.
Parmi ceux qui répandaient le bruit du suicide de Georges Bizet se trouvait Paul de Choudens, qui avait publié Carmen et les autres œuvres du musicien tant regretté. M. André Leroy, gendre de Paul de Choudens, m'a dit et écrit encore récemment ceci : « Un jour que nous traversions Bougival, mon beau-père me montra la maison où Georges Bizet est mort en ajoutant : « C'est là que Bizet s'est suicidé. Mon frère, Antony de Choudens, était un ami personnel de Bizet. Dès qu'il eut appris que Bizet était mort, il accourut à Bougival. Antony a vu le cadavre de son ami peu d'heures après le décès. Bizet portait encore au cou la trace sanglante de la blessure qu'il s'était faite. »
Si Georges Bizet était mort de mort violente, il semble impossible que le médecin, chargé de constater le décès, n'eût pas fait mention du drame qui venait de se produire. A-t-on réussi à passer sous silence le suicide pour pouvoir faire à Bizet des obsèques religieuses ? Ou bien les traînées de sang aperçues par Antony de Choudens n'étaient-elles dues qu'à l'éclatement de l'abcès qui s'était formé sur la membrane du tympan de l'oreille gauche ?
XVI
LES « CARNETS » DE LUDOVIC HALÉVY
Quand, en 1938, on célébra le centenaire de la naissance de Georges Bizet, M. Daniel Halévy publia, dans la Revue des Deux-Mondes et dans la Revue de Musicologie, plusieurs extraits des Carnets de Ludovic Halévy. J'ai pu compulser à loisir le manuscrit même de ces Carnets. Voici quelques-unes des notes prises par Ludovic Halévy, dans les jours qui suivirent la mort du grand musicien :
24 juin : « Quels vingt jours je viens de passer !... Cette mort de Bizet est le plus effroyable malheur qu'on puisse imaginer. Mardi il allait mieux, souffrait moins de ce rhumatisme, commençait à retrouver certains mouvements... Je pars mercredi matin... J'arrive, je trouve Geneviève en larmes, Bizet fiévreux, agité. Ce rhumatisme, dans la nuit, s'était porté au cœur. Il y avait eu une crise terrible. Le médecin était venu, avait fait mettre un vésicatoire... cela se passait à une heure du matin. Le médecin était revenu à huit heures. « La crise est passée, avait-il dit, il n'y a plus de danger. » La journée fut calme, Bizet se rassura, reprit un peu de courage. Le soir, à dix heures, il était bien tranquille. « Je vais peut-être dormir un peu », disait-il. A onze heures, il appelle Delaborde : « Allez chercher Delaborde tout de suite ! » Et il s'évanouit. Delaborde arrive ; une heure après arrive le médecin de Rueil. « Eh bien ! lui dit Delaborde, il est évanoui. Que faire ?
— Rien, il est mort.
... Il a fallu enlever Geneviève de cette maison. »
Le décès subit du grand musicien reste entouré d'un certain mystère.
Bizet avait-il succombé à une embolie, à un rhumatisme du cœur, à un œdème de la glotte, à un abcès interne du tympan, à une tentative de suicide, comme on l'a successivement affirmé ?
Mme Straus-Bizet m'a raconté que son premier mari était mort d'une tumeur à l'oreille qu'aucun chirurgien n'avait osé opérer et qu'on espérait voir se résorber d'elle-même. Mme Bizet pouvait-elle ignorer la nature du mal qui avait entraîné la mort de son mari ? Ce qu'elle m'en a dit semble correspondre à la déclaration d'Ernest Guiraud auquel Bizet avait confié, quatre jours avant son décès, qu'il était sourd de l'oreille gauche. Ainsi, — comme Beethoven, comme Schumann et, plus tard, comme Gabriel Fauré, — Georges Bizet avait été frappé par l'arrêt d'un destin implacable, dans son organe de l'ouïe, organe essentiel pour l'exercice de son art.
***
Est-ce parce qu'il était torturé par la jalousie que lui causaient les assiduités d'Henri Delaborde
auprès de Geneviève Bizet, que Georges Bizet se serait suicidé ? Ou bien parce qu'il ne pouvait se consoler d'une rupture avec Galli-Marié ? Les explications dissemblables qu'on nous a données de sa mort pourraient motiver les bruits qui ont couru sur son suicide.
Pour ceux qui admettent les prédispositions héréditaires, j'ajoute que, de son côté, le fils du musicien de Carmen, Jacques Bizet, a lui-même mis fin à ses jours.
Il est difficile de démêler la vérité entière dans les témoignages qui nous ont été laissés sur les derniers jours de Georges Bizet. Ce qui est certain c'est qu'après la création de Carmen, le grand artiste s'était vu brusquement abandonné par la plupart de ceux qui croyaient en lui et en son avenir. Dans la solitude hostile où il venait d'être plongé, et malgré les maux qui l'accablaient de toutes parts, il n'avait pas renié les principes qui s'étaient finalement imposés à son esprit et dont il ne voulait plus démordre.
Assuré de la valeur de sa partition suprême, il avait tenu tête à ses détracteurs. Le succès de Carmen, définitivement acquis, après deux mois de chicanes et d'incertitudes, lui donnait raison. Il allait poursuivre ses travaux dans le même sens audacieux et élevé. Quels obstacles infranchissables se sont alors dressés brusquement sur sa route ? Dans un moment de dépression nerveuse, d'amertume et de trouble, a-t-il renoncé de lui-même aux prochains accomplissements de son génie ?
XVII
Georges Bizet laissait un vide immense dans le théâtre musical. On ne s'aperçut qu'à sa mort, de la perte irréparable que venait de faire la musique française. Par un revirement soudain, les critiques qui l'avaient attaqué trois mois auparavant lui consacrèrent des articles nécrologiques remplis de regrets, débordants d'éloges posthumes.
Les obsèques eurent lieu en l'église de la Trinité le 5 juin 1875. Pendant la cérémonie funèbre, Bouhy (*), qui venait de créer le rôle d'Escamillo, chanta avec son camarade Duchesne le duo de Zurga et de Nadir, des Pêcheurs de Perles. Duo transformé par Guiraud, pour la circonstance, en Pie Jesu. L'orchestre des Concerts populaires, sous la direction de Pasdeloup, revenu précipitamment de province, exécuta la Marche funèbre de l'Ouverture dramatique Patrie et des fragments de l'Arlésienne. Ecrasé par sa douleur, Adolphe Bizet, le vieux père de Georges Bizet, soutenu par Ludovic Halévy, tint à suivre le convoi de son fils jusqu'au cimetière Montmartre, où se fit l'inhumation provisoire. Gounod, Ambroise Thomas, Camille Doucet, ministre des Beaux-Arts, Du Locle, tenaient les cordons du poêle. Des discours qui exaltaient les mérites du défunt furent prononcés par Jules Barbier, Du Locle et Gounod.
(*) Le baryton Bouhy devait fonder, une quinzaine d'années plus tard, le premier conservatoire de musique de New York.
Geneviève Bizet n'assista pas aux obsèques de son mari. Exténuée, elle s'était réfugiée à Saint-Germain-en-Laye, dans la propriété de son cousin Ludovic Halévy.
Ernest Reyer écrivait dans le Journal des Débats, quelques jours après l'enterrement : « Que tous ceux qui assistaient à la cérémonie funèbre, que tous ceux qui accompagnaient le corps de notre pauvre ami, disent s'il y eut jamais autour d'un cercueil foule plus attristée, plus recueillie... On se disait que le malheur de l'avoir perdu était d'autant plus grand que sa carrière avait été plus courte, et l'on songeait à la fois à sa jeune renommée et à toutes les espérances qu'il emportait avec lui ; dans la nef de l'église, ses chants avaient un caractère de grandeur, une élévation de pensée, une noblesse de forme qu'au théâtre ou au concert ils n'eurent jamais au même degré. »
Lié d'amitié avec le musicien de Carmen, Saint-Saëns connaissait la franchise de vocation et les points vifs du génie de Georges Bizet. Mieux que d'autres, il avait pu approfondir les éléments de supériorité de l'artiste qui venait de disparaître et qui avait été si injustement combattu dans la presse, à l'apparition de chacune de ses œuvres. « Ah ! qu'ils sont coupables, a écrit Saint-Saëns, ceux qui, par leur hostilité ou leur indifférence, nous ont privés de cinq ou six chefs-d'œuvre, qui seraient maintenant la gloire de l'Ecole française ! »
***
Pour que notre musique dramatique s'en relève et puisse aller son grand chemin, il faut attendre de longues années. Après Carmen, quelles sont les partitions théâtrales qui font événement et marquent une date dans l'histoire du développement des formes sonores ? Le Roi malgré lui, d'Emmanuel Chabrier, apparaît en 1887 (*) ; le Rêve, d'Alfred Bruneau, en 1891 ; Pelléas et Mélisande, de Claude Debussy, en 1902 ; l'Heure espagnole, de Maurice Ravel, en 1911. Bien d'autres œuvres françaises ont signalé, mais à un degré moindre, la voie neuve à suivre et qui avait été ouverte par Bizet : Namouna (1882) et le Roi d'Ys (1888), d'Edouard Lalo ; Manon (1884) et Werther (1893), de Massenet ; Gwendoline (1893), d'Emmanuel Chabrier ; Louise (1900), de Gustave Charpentier ; l'Ouragan (1901), d'Alfred Bruneau.
(*) Dès 1877, Emmanuel Chabrier avait écrit en vingt-trois jours une opérette en trois actes, l'Etoile, jouée aux Bouffes-Parisiens. Un chef-d'œuvre de la musique gaie, d'une liberté de forme, d'une finesse d'humour, d'une fermeté et d'une grâce d'accent qu'on n'a pas cessé d'admirer.
Claude Debussy qui, dans la classe de composition de Guiraud au Conservatoire, avait appris de quoi était fait le génie de Bizet, a déploré, à son tour, la disparition prématurée du musicien de Carmen. Il a écrit, en 1903, dans un article sur Gounod :
« Au surplus, Gounod laisse passer Bizet, et c'est très bien. Malheureusement ce dernier meurt trop tôt, et, quoique laissant un chef-d'œuvre (Carmen), les destinées de la musique française sont remises en question. La voici encore, telle une jolie veuve qui, n'ayant autour d'elle personne d'assez fort pour la conduire, se laisse aller dans les bras étrangers qui la meurtrissent. On ne peut nier qu'en art certaines alliances ne soient nécessaires ; au moins faut-il y apporter quelque délicatesse, et choisir celui qui crie le plus fort n'est pas suivre le plus grand. »
Au souvenir de la mort de Bizet, Debussy a, non sans amertume, consacré encore ces lignes : « Si parfois un quelconque homme de génie essaye de secouer le collier de la tradition, on s'arrange de façon à le noyer dans le ridicule ; alors, le pauvre homme de génie prend le parti de mourir très jeune, et c'est la seule manifestation pour laquelle il trouve de nombreux encouragements (*). »
(*) Claude Debussy : Monsieur Croche antidilettante, p. 65 et p. 198. (Gallimard, édit.)
***
Un an avant sa mort, Georges Bizet, qui était en train d'achever Carmen, avait brûlé les manuscrits qui ne répondaient plus à l'idée qu'il se faisait de la musique, dans la dernière période de sa vie. Dans le lot jeté au feu, se trouvaient les partitions qu'il avait déjà refusé de laisser exécuter : la Guzla de l'Emir, la Coupe du Roi de Thulé, Grisélidis, Clarisse Harlowe, les ébauches des Templiers sur un livret de Léon Halévy, de Calendal, d'autres encore. Qui sait si, par la suite, revenu de ses préventions de jeunesse et conscient de son génie, il n'eût pas supprimé, de ses œuvres, déjà éditées, toutes les pages qui ne répondaient plus, dès ce moment-là, à ses préoccupations ? Ne regrettait-il pas de s'être laissé condamner à un genre qu'il devait détester plus tard ?
Avec l'ardeur au travail dont il avait toujours témoigné, il imaginait déjà la succession d'œuvres qu'il allait enfin composer. Selon son cœur et sa pensée. Et sans viser au succès facile. Dès le 20 mars 1875, l'Univers illustré avait publié l'information suivante : M. Du Locle a demandé un nouvel ouvrage à M. Georges Bizet. MM. Henri Meilhac et Ludovic Halévy en écriront le poème. »
Cinq jours après les obsèques de Bizet, le Figaro annonçait de nouveau que Du Locle avait commandé aux auteurs de Carmen « un nouvel ouvrage ». Autre partition qui avait dû être composée, pour le moins en partie, et dont nous avons été frustrés.
Bizet avait presque terminé le piano et chant de Rodrigue et en avait indiqué, deçà et delà, l'instrumentation. Dans l'atmosphère espagnole de la nouvelle œuvre, qui, pour la couleur locale, avait des points de ressemblance avec Carmen, il pouvait enfin se livrer à une démonstration éclatante de ses découvertes et de ses dons. On le disait incapable de grandes productions. Au début, lui-même ne se sentait pas de force pour aborder le cadre imposant de l'Opéra et l'avait avoué à Guiraud. C'est justement à l'Opéra qu'il destinait le Cid. Il allait porter son défi jusqu'en ce haut lieu de la musique traditionnelle et où les abonnés, inféodés au vieux répertoire, se scandalisaient de tout semblant d'originalité.
***
Six mois auparavant, la nouvelle salle de l'Opéra venait d'être inaugurée avec grand éclat, le 5 janvier 1875. La construction audacieuse de Charles Garnier avait coûté cinquante millions or. La surface bâtie s'étendait sur près de 11.300 mètres carrés. La largeur de l'ouverture du cadre et la hauteur de la scène (15 m. 10), le grand pignon de la coupole à 70 mètres de hauteur, l'escalier d'honneur, avec ses quatre balcons d'où l'on voyait monter et descendre les spectateurs, les statues, les décorations, les cinq étages de loges provoquaient l'admiration générale. Tandis qu'à l'Opéra-Comique, le public ne pouvait disposer que de 1.500 places, on comptait 2.156 places à l'Opéra. On se battait aux portes des bureaux de location. Tous voulaient voir de près le luxueux palais érigé à la gloire de la musique dramatique.
Le Cid, avec la musique de Georges Bizet, allait être la première partition inédite créée sur la scène fastueuse du monument de Charles Garnier. A la soirée d'inauguration de l'Opéra, avaient assisté, entre autres, le lord-maire de Londres, en costume d'apparat, la reine d'Espagne Isabelle, et le roi Alphonse XII, le roi de Hanovre, le maréchal de Mac-Mahon, président de la République, Buffet, président de l'Assemblée nationale, et le comte de Paris. On joua, au cours du premier trimestre qui suivit, la Juive, la Favorite, la Source et Guillaume Tell. Jusqu'à la fin de l'année, l'Opéra n'afficha que des reprises : celles des Huguenots, Hamlet, Coppélia, Faust et Don Juan.
Par le cahier des charges, Halanzier, directeur de l'Académie nationale de Musique et de Danse, était tenu de créer, chaque année, deux grands ouvrages. Or, il n'était en possession que de la faible partition inédite que Mermet avait écrite sur Jeanne d'Arc. On conçoit avec quel empressement il eût accueilli le Cid de Georges Bizet, dont le titre était alors Rodrigue (*).
(*) A ses éclatants débuts de carrière, Claude Debussy avait repris et accompli, de son côté, le projet formé par Georges Bizet, en composant trois actes sur le même sujet. Catulle Mendès avait rédigé le livret intitulé Chimène et Rodrigue. Debussy, qui avait presque terminé la partition, s'opposa à la représentation et à la publication de l'ouvrage. Le manuscrit de Chimène et Rodrigue, que Debussy prétendait avoir perdu, a été retrouvé après la mort du musicien de Pelléas et Mélisande.
Le Cid, dont Edouard Blau, Louis Gallet et Dennery avaient écrit de nouveau le livret, ne devait être joué que dix ans plus tard, à ce même Opéra, mais sur la musique de Massenet. Et Grisélidis, dont le poème devait être refait par Armand Silvestre et Eugène Morand, était créée seulement en 1901, à l'Opéra-Comique, avec une partition qui était également de Massenet. Il n'est pas question, ici, d'incriminer Massenet qui était ami intime de Bizet. Chacun combat pour sa chimère et les musiciens ne se sont pas fait faute de reprendre des sujets déjà traités par leurs devanciers.
(*) A ses éclatants débuts de carrière, Claude Debussy avait repris et accompli, de son côté, le projet formé par Georges Bizet, en composant trois actes sur le même sujet. Catulle Mendès avait rédigé le livret intitulé Chimène et Rodrigue. Debussy, qui avait presque terminé la partition, s'opposa à la représentation et à la publication de l'ouvrage. Le manuscrit de Chimène et Rodrigue, que Debussy prétendait avoir perdu, a été retrouvé après la mort du musicien de Pelléas et Mélisande.
***
Je ne fais pas grand cas, écrivait Bizet à son professeur Marmontel, de cette popularité à laquelle on sacrifie, aujourd'hui, honneur, génie, fortune. » Mais le musicien n'avait pas seulement en lui de quoi prêter vie à Carmen, la gitane parfumée de jasmin. D'autres œuvres devaient jaillir de son génie et réclamaient la lumière. Au moment de rendre le dernier souffle, Bizet nous paraît bien loin d'être au bout de ses créations.
Dans sa tête puissante et enfiévrée, vibraient d'innombrables musiques. Pianiste d'exception, il étonnait tous ceux qu'il approchait — et jusqu'à Liszt lui-même — non seulement par sa virtuosité, mais aussi par sa mémoire prompte et précise. Un jour, il avait joué à Léon Carvalho l'un de ses derniers ouvrages en trois actes, sans avoir son manuscrit sous les yeux. Le directeur du Théâtre-Lyrique accepta d'enthousiasme de monter l'œuvre nouvelle et en réclama la partition. Gêné, Bizet répondit :
— Impossible, avant quatre mois,
— Pourquoi donc ?
— Parce que je n'en ai pas encore écrit une note. La musique en est entièrement là...
Et Bizet se frappa le front.
Quand il eut choisi les moyens d'expression qui correspondaient à sa nature de génie, quand il eut épuré par degrés et fixé son style personnel, le musicien de Carmen ne pouvait plus souffrir le répertoire auquel le public de la salle Favart continuait d'être attaché. Sa bile s'échauffait plus particulièrement à l'audition de la Dame blanche, de Boieldieu, dont il écrivait à Mme Fromental Halévy : « La Dame blanche est un opéra détestable, sans talent, sans idée, sans esprit, sans invention mélodique, sans quoi que ce soit au monde. C'est bête, bête, bête ! C'est une jocrisserie prudhommesque qui ne peut plus amuser que les sapeurs, les bonnes d'enfants et les concierges. »
Par une cruauté du destin qui a poursuivi Bizet jusqu'à la fin, on célébrait, au moment même de la mort du musicien de Carmen, le centenaire de la naissance de Boieldieu. Les journaux s'étendaient sur les détails des fêtes organisées à Rouen, pour cette commémoration : reconstitution du château d'Avenel, cinq arcs de triomphe, cortège avec station devant la maison natale de Boieldieu, feux d'artifice, illumination de toute la ville, concert par sept mille exécutants, cantate d'Ambroise Thomas, ascension d'un « ballon allégorique », stances de Frédéric Deschamps, fête vénitienne sur la Seine, banquet, galas au Théâtre des Arts, défilés devant la statue de Boieldieu.
Le soir du 3 juin 1875, quand, à Bougival, Georges Bizet entrait en agonie, on jouait, à l'Opéra-Comique, la Dame blanche. Et, dans cette journée fatidique du 3 juin, une cavalcade avait lieu, à Caen, à la mémoire d'Auber, autre bête noire de Bizet. Cavalcade avec les chars du « Génie d'Auber », de Haydée, de Fra Diavolo, du Philtre, du Cheval de bronze. Une souscription pour élever un monument à la gloire d'Auber avait réuni, dès le lancement, plus de vingt mille francs or.
Tout semblait se liguer contre le grand artiste mourant et les réformes qu'il voulait instaurer dans la musique théâtrale. Calomnié, après la première de Carmen, par les critiques influents du moment, desservi et raillé par ses interprètes et par le directeur de l'Opéra-Comique, il se croyait aussi trahi par les siens. L'affection et le dévouement que lui témoignait le virtuose Henri Delaborde lui paraissaient suspects. Pourquoi le séduisant pianiste s'était-il glissé si avant dans son intimité ? N'était-il pas attiré par le charme aigu de Geneviève Bizet à laquelle Georges Bizet prêtait parfois, lui-même, l'apparence de Carmen ?
On prétend qu'au moment de mourir, la plupart des hommes ont la vision fulgurante de l'existence qu'ils vont quitter et de tous les événements qui l'ont dominée. En évoquant sa vie de travail effréné et où la trahison semblait s'ajouter aux déceptions, en revoyant sa carrière attaquée par les critiques, et si vite interceptée, Georges Bizet ne dut-il pas éprouver, dans les jours qui ont suivi la création de Carmen, une impression de désolation et de désastre ? A quoi lui avait servi son génie d'inventeur de formes lyriques ? Pourquoi s'était-il épuisé en veilles douloureuses et enfiévrées ? Ah ! dites, pouvait-il croire, dans ce naufrage de ses espérances et de ses ambitions, qu'on lui rendrait un jour justice et que son nom, prononcé avec reconnaissance par la postérité, se graverait dans la mémoire des hommes ?

CARMEN ET DON JOSÉ.
Aquarelle de Mérimée, donnée par l'auteur de Carmen à Ferdinand de Lesseps. (Collection particulière, Barcelone.)
TROISIÈME PARTIE
PROSPER MÉRIMÉE ET " CARMEN "
XVIII
Il y a exactement cent ans, Prosper Mérimée publiait sa traduction du conte de Pouchkine, la Dame de Pique, dont Tchaïkovski devait faire plus tard un opéra. Pouchkine avait été tué en duel en 1837. Deux ans avant sa mort, il avait lui-même traduit en russe la Guzla de Mérimée.
Pour écrire Carmen, d'où Meilhac et Halévy ont tiré le livret d'opéra-comique que Georges Bizet a mis en musique, Mérimée a-t-il subi l'influence de Pouchkine ? Dans sa belle étude biographique de Pouchkine, Henri Troyat a dit qu'à partir de 1823 « on parle de Pouchkine dans les salons de Mme Ancelot, de Mme Récamier, de Cuvier ». Mérimée était l'hôte assidu de ces salons.
C'est sans doute là qu'il se prit d'admiration pour Pouchkine. « Sa sobriété, a-t-il écrit plus tard, son tact à choisir les grands traits de tous les sujets qu'il traite, à sacrifier les détails inutiles, serait un mérite considérable en tous pays... Bien qu'il connût toutes les ressources, toute l'étonnante richesse de sa langue, sa pensée se produit toujours sous une forme si simple, qu'on ne croirait pas possible de l'exprimer autrement. »
Le secret de l'art mériméen est aussi dans l'économie des moyens, dans le choix des éléments essentiels et frappants, dans l'expression juste, elliptique et naturelle.
Mérimée publia Carmen en 1845. Il ne fit paraître la traduction des Tsiganes de Pouchkine qu'en 1852. On peut trouver quelques traits de ressemblance entre Zemfira, héroïne des Tsiganes, et la zingarella Carmen. Mérimée devait s'abreuver à bien d'autres sources pour composer Carmen.
Lorsque Mérimée forma le projet d'écrire Carmen, il ne pouvait connaître les Tsiganes de Pouchkine que par ouï-dire. A cette époque, il parlait couramment l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le grec et étudiait le catalan, le basque et le romani. Ce n'est que sur le tard, et après la publication de Carmen, qu'il apprit l'arabe et le russe.
Comme Pouchkine, Mérimée s'intéressa avec passion à la vie vagabonde de la race fatidique des bohémiens. Plus superstitieux qu'ils n'osaient se l'avouer, les deux grands écrivains avaient pris au sérieux les prophéties des gitanes tireuses de cartes. A ses derniers moments, Pouchkine était encore persuadé qu'une devineresse lui avait dévoilé son haut avenir et prédit les circonstances violentes de sa mort. De son côté, Mérimée fut obsédé pendant près de quarante ans par la figure de Carmen et par la tribu démoniaque à laquelle elle appartenait.
***
Quand la silhouette de Carmen, bohémienne et magicienne de Triana, apparut-elle dans le champ de vision de Prosper Mérimée ?
Né le 28 septembre 1803, à Paris, Prosper Mérimée était le fils de Léonor-François Mérimée, peintre de tendance académique et chimiste inventif. Sa mère, qui faisait impression par sa gravité de caractère, s'adonnait également à la peinture. Encore adolescent, Prosper Mérimée se passionne pour l'occultisme. Dès l'âge de seize ans, il s'absorbe dans le Traité des apparitions de dom Calmet, la Magie naturelle de Porta, le Monde enchanté de Bekker.
Il entrevoit déjà la fuyante figure de la petite devineresse fascinante et sordide que sera Carmen.
A vingt-deux ans, il publie le Théâtre de Clara Gazul, dont Stendhal lui écrit : « Je crois que vous seriez plus grand, mais un peu moins connu, si vous n'aviez pas publié la Jacquerie et la Guzla, fort inférieurs à Clara Gazul. » Périchole, Mariquita, Préciosa, premières héroïnes mériméennes, ne sont-elles pas déjà les masques annonciateurs de Carmen ?
Comme Joachim du Bellay regrettant la douceur angevine, don Juan Diaz soupire, dans les Espagnols en Danemark du Théâtre de Clara Gazul : « O ! Espagne ! Espagne, quand reverrai-je tes basquines, tes jolis escarpins, tes yeux noirs, brillants comme des escarboucles ! » Mérimée, qui n'a encore jamais franchi la frontière des Pyrénées, donne, d'imagination, dans Clara Gazul, des vues saisissantes sur l'Espagne et ses habitants. C'est au point qu'un Espagnol a pu s'y tromper et s'écrier à la lecture de l'ouvrage attribué à une comédienne ibérique : « Oui, la traduction de Clara Gazul est bien faite, mais qu'est-ce que vous diriez si vous lisiez le texte original ! »
Au début de 1830, Prosper Mérimée prie Victor Hugo de lui envoyer des places pour la première représentation d'Hernani. Places qu'il destine à des « honnêtes gens », des « gens sûrs », qui applaudiront avec vigueur le nouveau drame. Il peut assister à la fameuse « bataille d'Hernani », le 25 février 1830. J'imagine qu'à ce spectacle d'hispanisme emphatique et fastueux notre Mérimée, si compassé et si sobre, doit être très partagé de sentiments. Il a souvent souri de « la naïveté titanique » de Victor Hugo. Hé quoi ! le bandit délirant et empanaché du drame hugolien est-il un véritable bandit de la péninsule ibérique ? Cette doña Sol est-elle une authentique maja et Ruy Gomez de Silva un véridique caballero grisonnant ?
Et ne croyez-vous pas que Mérimée, visité, en Espagne, par le fantôme de Carmen, Mérimée, que les beaux sentiments qui se débitent n'abusent ni n'amusent plus, se fait fort d'écrire, en manière de réplique à Hernani, une œuvre où se reflétera, dans sa vérité, l'âme espagnole ?
Pendant son voyage en Espagne, les personnages opposés à ceux de Victor Hugo se dessineront à son esprit dans leurs lignes respectives. Assez d'espagnolades romantiques ! Son Hernani, à lui, sera aussi un bandit noble : il s'appellera don José Lizzarabengoa et sera assassin, contrebandier et voleur de grand chemin. Sa doña Sol sera Carmen, bohémienne satanique, son Ruy Gomez, Garcia le borgne, « noir de peau et plus noir d'âme ».
Cette arrière-pensée maligne est tout à fait dans les façons de l'écrivain rigoureux et frondeur de la Jacquerie et de la Famille de Carvajal. Il a attribué les chants istriens de sa Guzla au soi-disant Hyacinthe Maglanowitch, poète d'Illyrie — cette Illyrie dont le royaume venait d'être fondé par Metternich. La couleur locale des poèmes fabriqués par son imagination est si troublante que les lettrés s'y trompent. Le grand poète Pouchkine lui-même traduit en russe les ballades de ce Maglanowitch forgé de toutes pièces par Mérimée et les donne pour modèles du lyrisme dalmate ! Pour inventer le personnage et ses stances supposées, Mérimée n'a jamais mis les pieds sur les bords de l'Adriatique. Comme nous l'avons vu, il n'a pas davantage séjourné en Espagne ni dans les anciennes colonies espagnoles pour écrire le Théâtre de Clara Gazul, qu'il prétend de la main d'une actrice ibérienne. Il lui a suffi de se plonger dans la lecture de Cervantès, Calderon de la Barca, Lope de Vega, Tirso de Molina, Alarcon, Guilhem de Castro.
Mérimée s'impose un travail plus sérieux pour se préparer à écrire Carmen. Il lit et relit Hurtado de Mendoza, Montemayor, Louis de Quevara, Queveredo y Villegas, Vicente Espinol, le picaresque Mateo Aleman. Il s'y prend tout autrement que pour Clara Gazul. Les personnages dont il rêve, il veut les surprendre sur place, d'après nature, dans leur cadre exact et leur vie intime.
Le 27 juin 1830, il part pour l'Espagne. Il y fait la connaissance de don Serafin Estebañez Calderon, qui se propose justement d'écrire une étude approfondie sur les chansons et les danses populaires du royaume ibérique. Etude d'une importance capitale pour l'histoire du folklore espagnol et qui sera publiée quelques mois plus tard sous ce titre : Cartas españoles.
Sous la conduite de Serafin Calderon, Prosper Mérimée visite Séville dans ses recoins secrets. Et, bien entendu, la Manufacture de tabac, où la physionomie accentuée de Carmen se dresse brusquement devant lui : une cigarière gitane, extrême dans ses passions, fataliste et cynique, un gros bouquet de cassie « qui sortait de sa chemise et dont elle gardait une fleur entre les dents, un bouquet de jasmin dans la chevelure ».
A cheval, à dos de mulet, en diligence, le voyageur français va à l'aventure de Burgos à Madrid, de Cadix à Cordoue et de Grenade à Valence. En compagnie d'un « Prussien, d'un muletier et son garçon », il se mêle à la populace et en observe de près les mœurs. Il boit à même la gourde « d'un galérien », mange dans une écuelle avec « des gens qu'un Anglais ne regarderait pas », couche dans les posadas et les ventas malpropres et de la plus basse catégorie. Il s'insinue dans les bonnes grâces des gitanes, pythonisses ou danseuses de flamenco, des toreros, maquignons et contrebandiers.
En même temps, il est introduit dans la bonne société de la province de Séville. En diligence, il a rencontré don Cipriano Palafox y Portocarrero, comte de Tebla, qui prendra, quelque temps après, le titre de comte de Montijo. C'est un ancien colonel des armées napoléoniennes. Grand blessé des guerres de l'Empire, il est borgne et ne peut se servir ni de sa jambe droite ni de son bras gauche. Comme il est imbu d'idées libérales et s'exprime avec facilité en français, il sympathise aussitôt avec Mérimée. L'hidalgo présente le voyageur français à sa femme. La comtesse de Manuela de Montijo, que Mérimée dépeint comme « le type très complet et très beau de la femme d'Andalousie », née Kirkpatrick, est d'origine écossaise. Elle est vivement intéressée par l'auteur de Clara Gazul et se lie d'amitié avec lui. Devenu intime de la famille, Mérimée fait sauter sur ses genoux les deux fillettes de ses hôtes : Paca, âgée de cinq ans, qui deviendra duchesse d'Albe, et Eugénie, âgée de quatre ans, qui deviendra, en 1853, impératrice des Français.
Plus tard, il sera le guide subtil et dévoué de ces dames, quand elles viendront habiter Paris. Il s'attachera à leur fortune, dans ses hauts et ses bas. Quand il ne sera pas aux côtés de la comtesse de Montijo, il ne cessera pas d'écrire des lettres à la vieille amie espagnole.
Manuela de Montijo instruit Mérimée des coutumes des bas-fonds de Triana, des pittoresques manières de vivre des chulos, des gitans et de la plèbe andalouse. Un beau jour, elle lui raconte, avec détail, les aventures de Carmen et de don José. Quand il rédigera Carmen, il fera du mari de la bohémienne un bandit qui ne voit que d'un œil : Garcia le Borgne. Par quels sentiments sera-t-il poussé quand il prêtera à ce personnage odieux la même infirmité que celle dont souffre le mari de la comtesse de Montijo ? Nous ignorons ce qu'a pu penser du procédé Manuela de Montijo, que Mérimée appelait sa « meilleure amie ». Elle ne semble pas s'en être formalisée.
Sur le chemin du retour, Mérimée écrit de Valence qu'à une lieue de Murviedro : « ... Une très jolie fille, point trop basanée, m'apporta un grand pot de cette terre poreuse qui rafraîchit l'eau... Je bus l'eau qu'on me présentait, je mangeai du gazpacho préparé par les mains de Mlle Carmencita et même je fis son portrait sur mon livre de croquis. » A Séville, à Grenade, à Cadix, il a coudoyé maintes bohémiennes « dont la vertu ne résistait pas à un douro ».
Rentré à Paris, en décembre 1830, il est incorporé dans un régiment d'artillerie de la Garde nationale. L'esprit débordant de souvenirs directs et drus, le cœur en émoi, il emporte l'image respirant de la gitane, sorcière et jeteuse de sorts.
Encore chaud de ses impressions récentes, va-t-il se mettre tout de suite à l'œuvre ? Non. Dix ans se passent. En 1840, il fait un second voyage en Espagne, où il est rappelé et harcelé par l'ombre de Carmen. Ce n'est que quinze ans après son premier voyage en Espagne qu'il publiera Carmen. Dans l'intervalle, il a été chef de cabinet du comte d'Argout aux ministères de la Marine, du Commerce et de l'Intérieur. Devenu maître des requêtes au conseil d'Etat, puis inspecteur des monuments historiques, il a fait paraître divers articles d'archéologie, des contes, des récits historiques. Membre de l'Institut dans la section des Inscriptions et Belles-Lettres, depuis 1843, il est élu à l'Académie française, le 14 mars 1844.
Plus attentif que son ami Stendhal à ménager les puissants du jour, il s'est couvert de toutes ses habiletés pour réussir. Dans ses écrits d'exécution ferme et soutenue, il n'a encore qu'à peine laissé percer le feu intérieur qui le dévore.
Assez longtemps il a porté son masque d'archéologue et d'historien, de fonctionnaire pédantesque et gourmé, de narrateur pointilleux et correct ou sarcastique. Sous son aspect de grand bourgeois à la mode du temps, de mondain, à la fois piquant et impassible, il a le goût du péché, il est resté d'une sensualité ardente et qui touche à l'amoralité. Il a en horreur les préjugés, le formalisme étroit de la société où il se meut. Encore jeune, il n'a pas craint de manquer aux lois sacrées de la famille : dans la Famille de Carvajal, il a dépeint la passion incestueuse d'un père pour sa fille ; dans la Chronique du temps de Charles IX, Bernard de Mergy tue son frère. Presque toutes ses œuvres de début étaient, comme il dit lui-même, des « tragédies immorales ». Avant son entrée à l'Académie française, il est obligé de se modérer aux yeux de ceux qu'il fréquente. Son désir s'exaspère (de jour en jour, d'année en année) à briser les entraves qui lui sont opposées pour redescendre dans la réalité de la vie, où éclatent les violences des irréfrénables passions charnelles.
Le voici de l'Académie, où il est accueilli par Royer-Collard, Salvandy, le comte Molé, Viennet, Louis de Carné, qui font profession d'austérité.
Le comte Narcisse de Salvandy et le comte Molé se reprocheront toujours de ne s'être pas opposés à son entrée à l'Académie et deviendront ses adversaires irréconciliables. « C'est une honte, s'écrie Salvandy, d'avoir nommé ce pamphlétaire, ce plaisantin pour qui rien n'est sacré... » De son côté, Mérimée écrit : « Monsieur de Salvandy arrange fort bien dans la pratique le libertinage et la religion, alors qu'en théorie il est le plus moral et le plus pieux des mortels. »
A l'encontre des nouveaux académiciens qui se rangent, dès leur entrée à l'Institut, sous les vieux drapeaux, Mérimée rompt les contraintes où il étouffait. A présent, plus de concessions aux bien pensants ! Il va pouvoir réagir ouvertement contre le style des déclamateurs romantiques, des politiciens hautains et rusés, des moralistes fades, circonspects et industrieux.
La figure de Carmen ne l'a pas quitté depuis quinze ans. Elle a occupé sans cesse l'espace où il se déplaçait. Elle a grandi dans l'ombre et le silence, toujours rejaillie du choc de ses souvenirs. Pour se débarrasser de l'obsession, il lui était difficile de projeter hors de lui la créature ou la création qui le hantaient. Cela eût gâté ses affaires.
Il lui est enfin loisible, sinon permis, de dépeindre Carmen telle qu'elle fut, dans sa perversité première, son cynisme et son débraillé. Son Hernani, à lui, sera un bandit féru de point d'honneur, tout comme le héros de Victor Hugo. Mais un bandit abêti, gangrené et féroce.
Ce qui eût desservi Mérimée auparavant doit aujourd'hui lui apporter la popularité tapageuse qui lui a manqué. La nouvelle bataille d'Hernani, la bataille de Carmen va s'engager. Car l'histoire de Carmen, qu'il jettera toute crue dans le public, provoquera sans aucun doute un scandale. Scandale qui fera pénétrer son nom dans le gros de la foule et l'imposera à l'attention de tous. Il est déjà célèbre. Ses livres ne sont pas encore de grande vente.
Six mois après sa réception à l'Académie, Prosper Mérimée réunit ses notes, compulse de nouveaux documents sur les mœurs des bohémiens, s'entoure de glossaires du dialecte gitan pour apprendre l'idiome tsigane. Dans le même temps, il s'initie au langage basque, parfait sa connaissance de la langue espagnole, dévore les Nouvelles exemplaires de Cervantès et surtout la Gitanilla, les Tsiganes en Europe et en Asie du Dr Pott, les Histoires des bohémiens de Goellmann et Mezzoforti. Au mois de janvier paraît la Bible en Espagne, de l'Anglais Barrow, qu'il explore à fond et dont il tire quelques passages qu'il insérera dans son conte.
Carmen ne sera publiée, par la Revue des Deux Mondes, que le 15 octobre suivant : « La misère, dit Mérimée à Requien, suite inévitable d'un long voyage, m'a fait consentir à donner Carmen à Buloz. » Le 16 mai 1845, il annonce à la comtesse de Montijo, installée à Paris : « Je viens de passer huit jours enfermé à écrire une histoire que vous m'avez racontée il y a quinze ans et que je crains d'avoir fort gâtée. Il s'agit d'un jaque de Malaga, qui avait tué sa maîtresse, laquelle se consacrait exclusivement au public... Comme j'étudie les bohémiens depuis quelque temps avec beaucoup de soin, j'ai fait de mon héroïne une bohémienne. »
En huit jours, vraiment ! En une seule semaine, il aurait écrit cet ouvrage qu'il a fignolé en silence, pendant des années, pour lequel il vient de s'imposer, pendant huit mois, un labeur épuisant, ouvrage qu'il considérera lui-même, plus tard, comme son chef-d'œuvre !
En peignant le personnage de Carmen, n'a-t-il pas, aussi, emprunté quelques traits à la physionomie de Manuela de Montijo ? Pour égarer les soupçons de son amie et des lecteurs à venir, il a dit qu'il « a fait de son héroïne une bohémienne ». La comtesse de Montijo s'y est-elle trompée ? En tout cas, elle l'a laissé faire sans, apparemment, s'en émouvoir.
Ce qu'entre tant, il n'écrit pas à sa correspondante, c'est que, dans les mois qui avaient précédé, le frère aîné du comte de Montijo s'était, tout comme don José, épris d'une petite cigarière sévillane et voulait à toute force l'épouser. Incident qui allait encore grossir le dossier de Carmen.
On aurait dit que l'histoire hallucinante de Carmen s'était en quelque sorte réimplantée dans la réalité et qu'elle reprenait vie autour de Mérimée. Huit ans après la publication de Carmen, c'est encore l'empereur Napoléon III qui se marie avec Eugénie de Montijo, fille cadette de l'amie de Prosper Mérimée. Episode historique, qui, à un stade différent ou plus élevé, n'est pas sans quelques points de ressemblance avec l'anecdote sanglante et obscure de Carmen et de don José.
Eugénie de Montijo est née à Grenade, où Mérimée fait vivre Carmen. La fille de l'ancien colonel napoléonien est superstitieuse, fataliste et emportée comme la bohémienne. Sa mère, ancienne camarera mayor auprès de la reine d'Espagne, installe une maison de jeux dans l'hôtel qu'elle loue à Paris, chaussée d'Antin. Après le suicide d'un ponte décavé, Manuela de Montijo et sa fille Eugénie sont expulsées. Elles se réfugient à Londres, où elles mènent une vie fantasque et inquiétante. Eugénie a eu la tête montée par de jeunes galants sans fortune. Elle s'est détachée d'eux. A vingt-sept ans, elle devient impératrice des Français. Comme Mercédès, dans le trio du troisième acte de Carmen, elle a peut-être lu son avenir dans les cartes :
Dans un château presque royal,
Le mien m'installe en souveraine.
Jamais Manuela de Montijo n'a été reçue à la cour de Napoléon III, malgré l'amour que n'a cessé de lui témoigner sa fille. A cette cour de Napoléon III, l'impératrice continuera de se livrer à la magie et à la cartomancie, évoquera les esprits, fera tourner les tables, sous le regard de Mérimée, qui lui a peut-être enseigné le « grand art ».
XIX
Si peu qu'on se soucie des pratiques de la magie blanche, on ne laisse pas d'être troublé par les enchantements de Carmen, trop séduisante sorcière d'Andalousie, par « les charmes et les philtres amoureux » qu'elle distribuait ou vendait et dont les effets se sont fait sentir même après sa mort.
Prosper Mérimée a avoué qu'il avait été gagné, dès sa jeunesse, au magisme, à l'occultisme. Il s'était attaché de prédilection au Dr Koreff, railleur à froid mais cabaliste fameux qui, depuis le Congrès de Vienne, soignait les grands personnages de l'époque par magnétisme, hypnotisme et autres sciences occultes. Il n'est pas surprenant que Mérimée se soit passionné pour la figure de la bohémienne fatidique et volage, rencontrée au bord du Guadalquivir. On jurerait que le charme de Carmen et de ceux de sa race a opéré sur Mérimée comme sur don José et que l'écrivain n'a jamais pu s'en délivrer.
Après avoir écrit Carmen, Prosper Mérimée fait un troisième voyage en Espagne. A son retour, il raconte à la comtesse de Montijo (le 15 novembre 1846) : « Hier, on est venu m'inviter à une Tertulia, à l'occasion de l'accouchement d'une gitane. Nous nous trouvâmes trente personnes dans une chambre comme celle que j'occupais à Madrid. Il y avait trois guitares et l'on chantait à tue-tête en romani et en catalan. La société se composait de cinq gitanes, dont une assez jolie, et autant d'hommes de même race ; le reste Catalans, voleurs, je suppose, ou maquignons, ce qui revient au même... Es des nostres (*), disait-on. » On voit à quel point la figure de Carmen a influé sur l'esprit de Mérimée. Membre de l'Académie française, il ne veut être qu'un bohémien parmi les bohémiens qui le tiennent eux-mêmes pour l'un des leurs !
(*) Il est des nôtres.
Pour écrire cette chronique de Carmen, d'apparence légère, Mérimée ne s'est avancé qu'à couvert de témoignages irrécusables qu'il a recherchés pendant de longues années. Bien après la publication de son conte, il a l'esprit occupé par les gitanos. Il traduit en français les Tsiganes, du célèbre poète russe Pouchkine, et se renseigne encore de tous côtés sur les origines, les mœurs et coutumes, le « jargon des Zigheuneurs ».
Il a poussé ses investigations jusqu'en Perse. Il a adressé trois lettres à Gobineau (alors ministre de France à Téhéran), qui lui a envoyé « un petit vocabulaire des bohémiens de la Perse ». Il écrit même à Mrs Senior : « Je suis trop vieux pour me marier, mais je voudrais trouver une petite fille toute faite à élever. J'ai pensé souvent à acheter une enfant à une gitana, parce que, si mon éducation tournait mal, je n'aurais probablement pas rendu plus malheureuse la petite créature que j'aurais adoptée... Le mal, c'est que les gitanes sont trop brunes et qu'elles ont les cheveux comme du crin. » A Cannes, où il devait mourir, il exprime encore le même désir, quelques mois avant de s'éteindre.
Le sortilège de la gitane violente a non seulement poursuivi Mérimée pendant sa vie, mais s'est aussi communiqué au récit qu'il nous en a fait, voire à la partition de Bizet. Valéry-Larbaud a senti cette force d'incantation qui se dégage de Carmen.
L'effet, écrit-il, ne commence qu'une fois la lecture achevée. Il a dessiné sèchement, presque pauvrement, les attitudes de ses personnages, raconté très vite ce qu'ils ont fait, et puis il les a escamotés, la plupart du temps tués, supprimés...
« Mais c'est alors qu'ils commencent à vivre. Notre imagination se met à reconstituer la nouvelle, moment par moment, action par action, si bien qu'il nous arrive de collaborer avec l'auteur, d'inventer çà et là un détail. Mais en le relisant (et Mérimée se relit), nous voyons que ce détail était indiqué, inclus dans un membre de phrase, dans un mot... »
De là à déduire que cette puissance d'envoûtement agit jusque sur les auditeurs de la Carmen de Bizet (qui va atteindre sa deux mille sept centième représentation, à l'Opéra-Comique seulement), il n'y a qu'un pas. Dans l'antiquité, comme de nos jours, dans certaines peuplades primitives ou de civilisation oubliée, la musique était tenue pour de la magie. Avec sa partition, Bizet aura renforcé, à son insu, l'efficacité du fluide aimanté, du charme magique dégagés de la nouvelle de Mérimée.
***
L'auteur de Carmen a-t-il voulu, furtivement, et en sous-main, faire aussi œuvre de magicien ? Rappelons-nous que Virgile, dans les Géorgiques, Dante, dans l'Enfer, Goethe, dans Faust, et bien d'autres écrivains illustres se sont servis de formules de l'ésotérisme pour édifier leurs chefs-d'œuvre.
Quoi donc ! Prosper Mérimée, ce réaliste avéré qui s'exprime avec la rigueur d'un logicien, ce peintre minutieux de la vie, qui observe de son regard aigu la nature et l'homme, ce chercheur de la sensation pour la sensation, cet ironiste renfrogné qui s'efforce à être plaisant ou galant et qui y parvient, faisait-il obscurément appel à l'antique science ésotérique ? Avait-il ce que les grands initiés nommaient des « idées de derrière la tête » ? Dans ce bref dialogue entre don José et la bohémienne perce l'une des pensées secrètes de Mérimée :
— Tu es le diable, lui disais-je.
— Oui, me répondait-elle.
Déjà, dans le Théâtre de Clara Gazul, il
avait intitulé un petit drame : Une femme est un diable.
Tout est possible avec un écrivain qui, sous son style net et plein, cache si
bien son jeu ou, si vous le voulez, son propre sentiment. Ceux qui ne le
connaissent que de l'extérieur l'accusent de sécheresse (comme Valéry-Larbaud,
tout à l'heure). Sa correspondance nous révèle, au contraire, qu'il était
sensible à l'extrême. Sensibilité qu'il a continuellement refoulée, tout au long
de son existence, comme il l'a avoué. « J'ai souvent constaté, écrit-il, les
manières affables des gens impitoyables. Moi qui passe pour cruel, je ne suis
pas assez bête pour le nier. Quel ennui si un jour on découvrait que je suis bon
! »
On nous affirme qu'une maladie de poitrine a été la cause de sa fin. Mais ses dernières lettres nous font penser qu'il est mort d'amour. Un paradoxe ? Non, la simple vérité. Il est mort d'avoir été abandonné par une femme qu'il aimait et dont il avait été aimé pendant quinze ans. Il avait été supplanté dans le cœur de la belle par Maxime du Camp. Après sa rupture avec Valentine, il traîna encore treize ans, sans pouvoir guérir. A la fin, il n'avait plus auprès de lui que deux vieilles amies anglaises pour panser sa blessure et veiller à son chevet d'agonisant.
***
Mérimée était l'ami et l'émule du grand égyptologue Charles Lenormant. Son esprit, à la fois ample et perçant, était informé des hautes doctrines. S'il tenait Carmen pour son chef-d'œuvre, c'est qu'il y avait des « dessous » dans ce récit. Il ne s'est pas contenté d'y relater des faits extérieurs. Il n'a pas seulement désiré de peindre et animer une prostituée, gitane étrange et fière, tragique et rieuse. A son rang, Carmen, amante de José, est magicienne comme Isolde, amante de Tristan. Comme Isolde, Carmen a ses philtres d'amour et de mort. Comme Isolde soigne et sauve Tristan, Carmen soigne et sauve José... Ne poussons pas plus loin cet irrecevable parallèle entre deux destinées. Carmen est jetée en pleine et claire réalité, Isolde flotte dans les brumes de la légende romanesque.
J'en sais qui vous diront que le choix de Mérimée s'est porté sur Carmen, parce qu'elle est de la très vieille race d'Egypte (ou de l'Inde ou du plateau de l'Iran) : l'Egypte, lieu d'élection de l'Hermès trismégiste ; la Perse, patrie de ce Zarathustra (que Nietzsche a célébré comme il célébrera, mais tout autrement, Carmen, drame lyrique).
On vous dira aussi que la gypsie de Mérimée est une voyante, bien que de « nature inférieure », que cette errante qui ne sait où se fixer et qui subjugue ceux qui l'approchent symbolise la liberté, etc... Seule la musique est capable de nous faire concevoir ces prolongements vers des entités mystérieuses et des symboles. (La partition de Bizet nous y conduit, à de certains moments.)
On vous dira enfin que Mérimée a placé Carmen « sous le signe du Taureau »; qu'helléniste raffiné il a mis, en tête de sa nouvelle, une épigraphe d'un poète de l'école d'Alexandrie — cette école qui ne s'est attachée qu'à expliquer les mystères de l'antiquité ; que la conclusion de Carmen est située à Cordoue — la ville qui vit naître le jésuite Sanchez, modèle des confesseurs, et l'illuministe Averroès... Mais, dans les deux vers de Palladas qu'on lit à la première page de Carmen, on ne peut voir qu'un sarcasme. En voici la traduction : « Toute femme est cause d'irritation, avec deux intervalles agréables : l'un au lit, l'autre à sa mort (*). »
(*) Dès le milieu du XVIe siècle, Mellin de Saint-Gelais imitait ainsi l'épigramme de Palladas :
Toute femme est importune et nuisante,
Et seulement en deux temps est plaisante,
Le premier est de ses noces la nuit,
Et le second quand on l'ensevelit.
***
Il ne convient pas de juger Carmen à la légère. Mérimée a dû glisser bien des intentions sous la forme lumineuse d'un récit préparé, médité et trituré pendant quinze ans. Intentions dont il est impossible de prendre la mesure ni la portée. Intentions qui ne sont pas perceptibles parce que l'auteur les a dissimulées de son mieux. Peut-être, comme les songeurs antiques, Mérimée a-t-il fait vœu de silence et d'humilité, pour ce qui concernait ses principes intimes et la conduite révélée de son œuvre.
Ne cherchons pas des significations profondes à Carmen. Tenons-nous-en à ce que Mérimée aurait probablement répondu, s'il avait été interrogé là-dessus : il n'a voulu découvrir dans ses personnages que la fatalité et le jeu des passions humaines, le contenu humain, la vérité du cœur humain. Et sa description du réel est si intense qu'elle donne lieu à bien des suppositions et des rêveries. Qu'elle atteint à l'universalité et au mystère de toutes choses.
Hélas ! au moment de son apparition en librairie, le conte que Mérimée a couvé pendant des années ne provoque pas le scandale attendu. La bataille de Carmen n'a pas éclaté. Prosper Mérimée passe pour un historien de l'art ancien, pour un érudit polyglotte, pour un satiriste haï des femmes et des dévots, non pour un grand romancier. Son maintien agaçant et guindé ni ses allures distantes et railleuses n'encouragent à lire ses productions littéraires. Carmen ne mord pas sur le grand public. La nouvelle, tout comme Arsène Guillot, n'a provoqué de scandale qu'auprès des abonnés de la Revue des Deux Mondes.
Détesté de la haute société qu'il fréquente, Mérimée est méconnu du peuple, dont il s'écarte lui-même. C'est un écrivain trop incisif, trop hardi, trop secret. Dans les milieux bien pensants, on s'interdit de le lire. On empêche la diffusion de ses ouvrages. La critique elle-même fait silence sur l'œuvre de Mérimée. Seul, Armand de Pontmartin publie le 1er mai 1847 un article dans la Revue des Deux Mondes, qui a fait paraître la nouvelle avant qu'elle ne fût éditée en volume. Il faut attendre jusqu'en 1854 pour lire l'étude de Gustave Planche, dans la même Revue des Deux Mondes. Celle de Léon de Wailly, dans l'Athenœum français, date de 1852. Plus tard encore, Sainte-Beuve parlera en termes superficiels et neutres de la « jolie nouvelle »... « cette Carmen n'est autre chose qu'une Manon Lescaut d'un plus haut goût qui débauche son chevalier des Grieux, également séduit et faible, mais d'une tout autre trempe ».
Toute justice ne sera rendue à l'écrivain de Carmen que longtemps après sa mort. Et c'est grâce à la musique de Georges Bizet que le récit de Mérimée a été retiré de l'ombre des bibliothèques et qu'il a été mis au rang des chefs-d'œuvre.
XX
En rédigeant sa partition, j'imagine que Georges Bizet a dû avoir plus souvent sous les yeux le conte de Mérimée que le livret de Meilhac et Halévy. Afin de mesurer le travail de refonte que le musicien et ses librettistes ont fait subir au texte du récit original, et pour discerner quelques-unes des idées secrètes de l'auteur, il est nécessaire de rappeler, dans ses grandes lignes, la nouvelle que Mérimée a composée dans la manière d'Atala et de René.
C'est en sa qualité d'archéologue et non de romancier que Mérimée nous a dit, au début, qu'il fit son voyage d'Espagne, en 1830. Il n'était venu jusqu'à Cordoue que pour retrouver l'emplacement exact de la bataille de Munda, où Jules César vainquit les lieutenants de Pompée.
Egaré avec son guide dans la campagne andalouse, et brûlé par la soif, Mérimée pénètre dans une gorge où il découvre une source. Un homme est déjà là, « un jeune gaillard, de taille moyenne, mais d'apparence robuste, au regard sombre et fier ». C'est José Navarro, voleur de grand chemin. Antonio, le guide du voyageur français, a tout de suite reconnu le malfaiteur. Au lieu de s'enfuir, Mérimée fume et mange en compagnie du brigand. Ils partent ensemble pour la misérable venta del Cuervo, où ils soupent et passent la nuit. Au grand mécontentement de Mérimée, le guide Antonio s'échappe pour dénoncer José Navarro. Mérimée tire le bandit de son sommeil et lui conseille de déguerpir, sans attendre l'arrivée des lanciers.
Revenu à Cordoue, notre archéologue assiste un soir à la baignade des femmes dans le Guadalquivir. Il engage la conversation avec une « grisette » qu'il prend pour Andalouse, Mauresque ou Juive.
— Allons, allons, réplique l'inconnue. Vous savez bien que je suis bohémienne ; voulez-vous que je vous dise la baji (la bonne aventure) ? Avez-vous entendu parler de la Carmencita ? C'est moi.
« ... Je ne reculai pas d'horreur, ajoute Mérimée, en me voyant à côté d'une sorcière... Sortant du collège, je l'avoue à ma honte, j'avais perdu quelque temps à étudier les sciences occultes et même, plusieurs fois, j'avais tenté de conjurer l'esprit des ténèbres... et je me faisais une fête d'apprendre jusqu'où s'était élevé l'art de la magie parmi les bohémiens. »
Mérimée accompagne « la jolie sorcière » chez elle. « Dès que nous fûmes seuls, écrit-il, la bohémienne tira de son coffre des cartes qui paraissaient avoir beaucoup servi, un aimant, un caméléon desséché et quelques objets nécessaires à son art. Puis elle me dit de faire la croix dans ma main gauche avec une pièce de monnaie, et les cérémonies magiques commencèrent..., il était évident qu'elle n'était pas sorcière à demi. »
Brusquement, un homme entre. La Carmencita lui dit, en idiome gitan, de détrousser le Français et de l'assassiner. Le nouveau venu n'est autre que José Navarro, le bandit de la venta del Cuervo. Mérimée s'en tirera sain et sauf. Mais la bohémienne lui a volé sa montre en or.
Plusieurs mois après, Mérimée se voit restituer sa montre. José Navarro a été arrêté, jugé, et doit être « garrotté » le surlendemain. L'écrivain va trouver le condamné à mort dans la chapelle où il est enfermé, avant d'être exécuté. Il passe quelques heures aux côtés du bandit. « C'est de sa bouche, prétend Mérimée, que j'ai appris les tristes aventures qu'on va lire. »
Don José Lizzarabengoa est issu d'une noble famille basque. Obligé de quitter la Navarre à la suite d'un combat singulier, il s'engage dans un régiment de cavalerie d'Almanza. Devenu brigadier, il va encore monter en grade. Un vendredi qu'il est de garde à la Manufacture de tabac, à Séville, une gitane, entourée de cigarières, s'approche de lui. C'est Carmen. Il n'y prête pas d'attention, occupé qu'il est à faire une chaîne pour son épinglette avec du fil de laiton. Irritée de l'indifférence du jeune brigadier, la bohémienne, d'un coup de pouce, lui lance entre les deux yeux une fleur de cassie « qu'elle avait à la bouche ». Au départ de Carmen, don José ramasse la fleur jaune et la cache sous sa veste.
Peu de temps après que les cigarières sont entrées dans la manufacture, le portier appelle la garde. Don José, suivi de deux lanciers, entre dans l'établissement. Pendant une dispute, la Carmencita s'est servie d'un couteau à couper les bouts de cigares pour dessiner des croix de Saint-André sur la figure d'une de ses rivales. Don José est désigné pour conduire en prison l'agressive bohémienne. Dans la rue du Serpent, elle lui propose « un morceau de bar lachi qui vous fera aimer de toutes les femmes », sous la condition qu'il la laissera s'échapper. Le brigadier s'y refuse. Alors elle lui dit en langue basque qu'elle est Navarraise, née dans un village proche du village où don José est lui-même né. Subjugué par la jolie fille, il favorise sa fuite. En descendant de garde, il est dégradé et envoyé pour un mois à la prison.
Dans son cachot, le souvenir de la bohémienne hante don José. Par les barreaux de sa geôle, raconte le malheureux « ... je n'en voyais pas une seule qui valût cette diable de fille-là. Et puis, malgré moi, je sentais la fleur de cassie qu'elle m'avait jetée et qui, sèche, gardait toujours sa bonne odeur... S'il y a des sorcières, cette fille-là en est une ! »
Un jour, le geôlier remet au prisonnier un pain d'Alcala dans lequel ont été dissimulées une lime et une pièce d'or de deux piastres. C'est Carmen qui a fait parvenir à José le cadeau, afin qu'il puisse s'enfuir de prison. « Je ne voulais pas m'échapper, dit don José. J'avais encore mon honneur de soldat, et déserter me semblait un grand crime. »
Après la cérémonie de la dégradation, don José. sorti de prison, est mis en faction comme simple soldat devant la porte du colonel. A sa grande surprise, il voit arriver à la soirée Carmen, qui a été appelée pour danser la Romalis. La soirée terminée, Carmen offre, à voix basse, au soldat de la rejoindre à Triana, chez le vieux bohémien Lillas Pastia, marchand de friture.
Lorsque sa garde est terminée, don José s'empresse d'aller au rendez-vous. Il restitue à la gitanilla la pièce d'or qu'elle lui avait envoyée quand il était en prison. Carmen éclate de rire. Avec les deux piastres, elle achète des provisions et, chez un confiseur, des jaunes d'œufs sucrés, des nougats, des fruits confits, des bonbons. Elle conduit José dans une vieille maison de la rue du Candilejo, où « elle se mit à danser et à rire comme une folle... Je lui dis que je voudrais la voir danser, mais où trouver des castagnettes ? Aussitôt, elle prend la seule assiette de la vieille, la casse en morceaux, et la voilà qui danse la Romalis en faisant claquer les morceaux de faïence aussi bien que si elle avait eu des castagnettes d'ébène ou d'ivoire... Le soir vint, et j'entendis les tambours qui battaient la retraite. » José se prépare en hâte à repartir pour être présent à l'appel.
Méprisante, Carmen laisse son amant rentrer au quartier pour l'appel. Il lui demande quel jour il pourra la revoir. Elle répond :
— Quand tu seras moins niais... Sais-tu, mon fils, que je crois que je t'aime un peu ? Mais cela ne peut durer... Bah ! mon garçon, crois-moi, tu en es quitte à bon compte. Tu as rencontré le diable, oui, le diable ; il n'est pas toujours noir, et il ne t'a pas tordu le cou... Va mettre un cierge devant ta Majari (ta sainte Vierge) ; elle l'a bien gagné.
Don José finit par aimer pour tout de bon la gitanilla qui se dérobe. Il cherche vainement à la rencontrer. Un jour qu'il est de faction à une brèche de la ville par où se fait la contrebande, il est abordé par Carmen. Elle lui demande de laisser passer cinq contrebandiers, moyennant finances. Il repousse l'offre. Alors, elle lui promet un nouveau rendez-vous rue du Candilejo. Il accepte et consent à l'introduction de la marchandise en fraude.
Le lendemain, Carmen se rend, en effet, dans la vieille maison où l'attend don José. Les deux amants ne font que se disputer pendant une heure. Don José sort, furieux. Désespéré, il entre dans une église pour prier, avec des larmes aux yeux. Carmen survient et l'entraîne.
Carmen a disparu de nouveau. José retourne vingt fois par jour rue du Candilejo, avec l'espoir de l'y retrouver. Un soir, il voit entrer Carmen, suivie d'un jeune lieutenant du régiment d'Almanza. L'officier ordonne brutalement au soldat de déguerpir et le blesse au front de son épée. José tire son sabre sur lequel le lieutenant s'enferre.
La gitanilla procure des vêtements à José, soigne la blessure qu'il porte à la tête et l'envoie au Dancaïre, qui appartient à une troupe de contrebandiers. Le déserteur dit à la bohémienne :
— Si je te tiens dans la montagne, je serai sûr de toi ! Là, il n'y a pas de lieutenant pour partager avec moi.
— Ah ! tu es jaloux, répond Carmen. Tant pis pour toi ! Comment es-tu assez bête pour cela ? Ne vois-tu pas que je t'aime, puisque je ne t'ai jamais demandé d'argent ?
Tout d'abord, la vie de contrebandier ne déplaît pas à don José. Enfin, il peut souvent voir Carmen. Mais elle lui fait jurer qu'il cachera toujours à ses compagnons qu'elle est sa maîtresse.
Peu de temps après, le Dancaïre apprend à José que Carmen a fait échapper des galères son rom.
— Comment ! Son mari ! Elle est donc mariée ?
— Oui, à Garcia le Borgne, un bohémien aussi futé qu'elle.
Don José est forcé de vivre auprès du galérien évadé, qu'il décrit ainsi : « Le plus vilain monstre que la Bohême ait nourri : noir de peau et plus noir d'âme, c'était le plus franc scélérat que j'aie rencontré dans ma vie. »
Au matin qui suit l'arrivée de Garcia, des lanciers sont aux trousses des contrebandiers. A l'exception du Dancaïre, du Remendado « joli garçon d'Ecija », de Garcia, de don José et de Carmen, tous se sauvent en jetant leur pacotille. Nos cinq fraudeurs, forcés d'abandonner leurs mulets, chargent les plus précieux ballots sur leur dos et s'enfuient à travers les rochers. Les lanciers les poursuivent à coups de fusil. Le Remendado est touché d'une balle aux reins et tombe. Don José lâche ses colis et emporte le blessé.
— Imbécile ! crie Garcia, qu'avons-nous à faire d'une charogne ? Achève-le et ne perds pas les bas de coton !
— Jette-le ! ordonne Carmen.
Fatigué, don José dépose un moment le blessé contre un rocher. Garcia s'approche et, de douze balles à bout portant, fracasse le crâne du Remendado. Ce crime lâche et odieux remplit don José d'amertume, de désespoir et de haine. Il se résigne difficilement à son misérable sort.
Carmen est partie pour Gibraltar, d'où elle signale le passage des voyageurs que ses trois compères doivent détrousser. Don José est désigné par ses deux camarades pour aller retrouver Carmen, dont on ne reçoit plus de nouvelles. Déguisé en marchand d'oranges, il erre pendant deux jours sur les quais du port. Il aperçoit enfin Carmen accoudée à un balcon avec un officier anglais, en uniforme rouge. Habillée somptueusement, elle rit à se tenir les côtes et fait signe à don José de monter. Elle traduit au milord, de façon bouffonne, les propos furieux que lui tient José. A la fin, elle demande à José de revenir le lendemain.
Voici comment Mérimée fait raconter par don José cette scène :
« Le domestique poudré m'introduisit aussitôt ; Carmen lui donna une commission et, dès que nous fûmes seuls, elle partit d'un de ses éclats de rire de crocodile, et se jeta à mon cou. Je ne l'avais jamais vue si belle. Parée comme une madone, parfumée... et moi fait comme un voleur que j'étais...
Et c'étaient des tendresses ! Et puis des rires ! Et elle dansait et elle déchirait ses falbalas ; jamais singe ne fit plus de gambades, de grimaces, de diableries. Quand elle eut repris son sérieux :
— Ecoute, me dit-elle, il s'agit de l'Egypte. Je veux qu'il (l'officier anglais) me mène à Ronda, où j'ai une sœur religieuse... (Ici, nouveaux éclats de rire.) Nous passons par un endroit que je te ferai dire. Vous tombez sur lui : pillé, rasibus ! Le mieux serait de l'escoffier, mais, ajouta-t-elle avec son sourire diabolique qu'elle avait dans certains moments — et ce sourire-là, personne n'avait encore envie de l'imiter, — sais-tu ce qu'il faudrait faire ? Que le Borgne paraisse le premier. Tenez-vous un peu en arrière ; l'écrevisse est brave et adroit : il a de bons pistolets... Comprends-tu ?
Elle s'interrompit pour un nouvel éclat de rire qui me fit frissonner.
— Non, lui dis-je, je hais Garcia, mais c'est mon camarade. Un jour, peut-être, je t'en débarrasserai, mais nous réglerons nos comptes à la façon de mon pays... »
De retour dans la montagne, don José provoque Garcia au couteau et tue le rom. Après avoir assassiné et dépouillé l'officier anglais, il reconquiert Carmen. Désormais, il la surveille. Elle se révolte.
— Ce que je veux, dit-elle, c'est être libre et faire ce qu'il me plaît. Prends garde de me pousser à bout ! Si tu m'ennuies, je trouverai quelque bon garçon qui te fera comme tu as fait au Borgne.
La troupe surprend les bandits dans la montagne. Les soldats tuent le Dancaïre et deux de ses larrons et blessent José d'une balle dans la poitrine. Carmen soigne son amant avec un dévouement admirable et le guérit.
Pendant que José se cache à Grenade, Carmen assiste aux courses de taureaux et y fait connaissance avec le picador Lucas.
Contre la volonté de son amant, elle retourne à une nouvelle corrida, à Cordoue. José l'y suit. Il y voit le picador Lucas arracher la cocarde à un taureau et l'offrir à Carmen, qui s'en coiffe aussitôt. Mais Lucas et son cheval sont piétinés par la bête. On emporte le picador écrasé, mourant. Carmen s'est éclipsée. Elle ne rentre qu'à deux heures du matin. José la met en croupe sur son cheval. Ils arrivent à l'aube dans une venta isolée, près d'un ermitage. José supplie Carmen de changer de vie et de le suivre en Amérique.
— Réfléchis, je suis à bout de ma patience et de mon courage.
José quitte Carmen pour demander à l'ermite de dire une messe pour « une âme qui va paraître devant son Créateur ». Ensuite, il reste en dehors de la chapelle pour entendre la messe. Pendant son absence, Carmen a retiré le plomb de l'ourlet de sa robe, l'a fait fondre et plongé dans une terrine d'eau. « Elle était si occupée de sa magie, raconte encore José, qu'elle ne s'aperçut pas d'abord de mon retour. Tantôt elle prenait un morceau de plomb et le tournait de tous côtés d'un air triste, tantôt elle chantait quelqu'une de ses chansons magiques... »
José et Carmen reprennent la route. Ils s'arrêtent dans une gorge solitaire. Il faut ici avoir recours au texte de Mérimée :
« — Est-ce ici ? dit-elle.
Et, d'un bond, elle fut à terre. Elle ôta sa mantille, la jeta à ses pieds et se tint immobile, un poing sur la hanche, me regardant fixement.
— Tu veux me tuer, je le vois bien, dit-elle ; c'est écrit, mais tu ne me feras pas céder.
— ...Ecoute-moi ! Tout le passé est oublié. Pourtant, tu le sais, c'est toi qui m'as perdu ; c'est pour toi que je suis devenu un voleur et un meurtrier. Carmen ! ma Carmen ! laisse-moi te sauver et me sauver avec toi.
— José, tu me demandes l'impossible. Je ne t'aime plus... Tout est fini entre nous. Comme mon rom, tu as le droit de tuer ta romi ; mais Carmen sera toujours libre. Calli elle est née, calli elle mourra.
— Tu aimes donc Lucas ?
— Oui, je l'ai aimé comme toi, un instant, moins que toi peut-être. A présent, je n'aime plus rien, et je me hais pour t'avoir aimé. »
José se jette aux pieds de la gitane, en sanglotant. Il va jusqu'à lui offrir de rester brigand pour lui plaire. Elle se refuse à vivre encore avec lui et lance dans les broussailles la bague qu'il lui avait donnée. Ivre de fureur, don José frappe deux fois la bohémienne avec le couteau qu'il avait pris à Garcia le Borgne. Elle expire, sans dire un mot.
José se rappelle qu'elle avait exprimé le désir d'être enterrée dans un bois. C'est là qu'il creuse une fosse et y ensevelit la bohémienne. Il remonte sur son cheval, galope jusqu'à Cordoue et se livre au premier corps de garde. Il avoue qu'il vient de tuer Carmen. Il se refuse à révéler le lieu où a été inhumée celle qui l'a ensorcelé.
XXI
Je n'ai relevé que les circonstances essentielles de l'histoire que nous a contée Prosper Mérimée. Histoire inséparable de l'auteur qui figure dans les épisodes du début de son œuvre et, aussi, peu de temps avant la conclusion tragique du récit.
L'écrivain est, en effet, l'un des personnages de Carmen, dont il fait rebondir l'action. Il ne craint pas de s'y montrer tantôt comme un amateur d'âmes violentes, tantôt comme un voyageur d'un calme imperturbable devant le danger, tantôt comme un archéologue qui, au lieu de découvrir les vestiges de l'antiquité qu'il recherche, tombe sur la fatalité de la passion vivante. Mêlé à cette aventure espagnole, il se fait, à l'occasion, intrépide, galant et libertin, ainsi qu'un Français se doit de paraître.
Il relate les incidents de Carmen comme s'il s'agissait d'une aventure personnelle. Quelques détails peuvent avoir été pris sur le vif ou d'après sa propre expérience. En 1833, « pour se consoler de la fin horriblement triste d'un amour archi-romanesque », il a pris pour maîtresse « une mulâtresse (une réfugiée espagnole un peu brune) qui a beaucoup de mérite ».
Cette « réfugiée espagnole un peu brune », qui ressemble fort à Carmen, est-elle l'une des « sorcières » qui ont prédit à Mérimée que « cette année 1833... est la dernière qu'il verrait » ?
Il croit dur comme fer à cette prédiction. Il écrit à Edouard Grasset : « L'année 1833 m'a déjà été bien fatale. J'ai perdu un oncle et une tante, un ami intime, Victor Jacquemont, une femme que j'aimais m'a planté là et une autre que j'aimais encore m'est enlevée. » Pourtant, il ne meurt pas au cours de cette année funeste. Il vivra encore trente-sept ans.
Au moment de la publication de Carmen, Mérimée fait circuler lui-même des bruits scandaleux sur son œuvre récente. « J'ai fait l'autre jour, écrit-il à Charles de Rémusat, une nouvelle immorale dans la Revue... »
Mais il prend ses précautions pour ne pas être inquiété par la justice, comme le seront plus tard Flaubert et Baudelaire.
Si, comme il l'espère ou le craint, il est appelé devant les tribunaux pour avoir publié un ouvrage immoral et impie, les arguments qui serviront à plaider sa cause sont tout préparés (*). Comment peut-on lui reprocher d'être un auteur licencieux et hérétique ? Historien et archéologue de profession, il n'a fait qu'étudier les mœurs de l'antique race des Gitanos, venue d'Egypte, d'Iran ou d'Inde et dont un essaim subsiste, dans toute sa vivacité, en Andalousie.
(*) Prosper Mérimée a été condamné à quinze jours de prison et mille francs d'amende en 1852, pour avoir défendu publiquement le bibliothécaire indélicat Libri. Affaire qui n'est d'aucun rapport avec Carmen.
Dans le volume, Carmen est suivie d'aperçus et de considérations ethniques et scientifiques sur les coutumes, le langage, la syntaxe et les caractères physiques des Gitanos. « Leurs yeux sensiblement obliques, bien fendus, très noirs, sont ombragés par des cils longs et épais. On ne peut comparer leur regard qu'à celui d'une bête fauve... La saleté des deux sexes est incroyable, et qui n'a pas vu les cheveux d'une matrone bohémienne s'en fera difficilement une idée, même en se représentant les crins les plus rudes, les plus gras, les plus poudreux. Dans quelques grandes villes d'Andalousie, certaines jeunes filles, un peu plus agréables que les autres, prennent plus de soin de leur personne. Celles-là vont danser pour de l'argent des danses qui ressemblent à celles que l'on interdit dans nos bals publics de carnaval... Les Gitanas montrent à leurs maris un dévouement extraordinaire. Il n'y a pas de dangers ni de misères qu'elles ne bravent pour les secourir en leurs nécessités... J'ai dit que la plupart des bohémiennes se mêlaient de dire la bonne aventure. Elles s'en acquittent fort bien. Mais ce qui est, pour elles, une source de grands profits, c'est la vente des charmes et des philtres amoureux. »
Mérimée a longuement étudié leur langage, le romani. Dans Carmen, il cite sans cesse des proverbes et des expressions en dialecte gitan, et aussi quelques phrases en langue basque. Il renforce ainsi cette « couleur locale » dont il s'est moqué, d'autre part. C'est un érudit de grand monde qui narre l'aventure de la bohémienne et de l'hidalgo basque avec enjouement et désinvolture, comme s'il parlait devant un auditoire élégant, dans les salons de Mme Ancelot ou de Mme de Boigne. Il ne s'exprime qu'à demi-mot. Son savoir va bien plus loin que ses propos légers.
Alors que le conteur nous donne des renseignements biographiques sur don José Lizzarabengoa, il se tait sur la famille et les origines de la zingarella. Carmen est sans attaches ni racines visibles. Le vol ni le meurtre ne sont pour elle des crimes. L'idée du crime n'a jamais traversé sa cervelle de fille naturellement perverse. Elle est hors la loi, en révolte constante contre les coutumes établies.
Mérimée la représente comme une bête gracieuse et allègre, fuyante, sensuelle et hardie. Une faunesse. Elle nous arrive d'un monde inconnu, d'un passé reculé. Incarnation vulgaire du génie dionysiaque. Sibylle, bacchante et démoniaque. Figure païenne ou satanique du mystère, du mensonge et de la luxure. Elle demande à être enterrée dans une forêt, où poussent librement les plantes obscures, belles ou vénéneuses. Son fantôme flottera parmi ses sœurs les hamadryades et les sorcières qui hantent les grands bois nocturnes.
Cette gitane volage et cynique, qui ne vit que pour jouer de ses instincts et pour les assouvir, est le type de la femme primitive, en qui se produisent incessamment les phénomènes biologiques de la sexualité. Femme qui ne refoule aucun de ses désirs, qui ne connaît aucune barrière à ses convoitises, qui se rit des conventions et des périls. Eternelle ennemie de l'homme — de l'homme autoritaire et policé. C'est quand il est sûr de l'avoir conquise qu'elle échappe à son étreinte. Cette femme n'est jamais aussi rétive que lorsque l'homme croit l'avoir asservie. Sainte-Beuve a écrit que Mérimée est « en quête de nature primitives ».
Carmen se heurte à don José, brigadier du régiment d'Almanza, chrétien de vieille roche basque, plié à la discipline et à la morale apprises. Dès qu'il a rencontré la gitanilla et qu'elle l'a pris à ses sortilèges, à sa funeste puissance, il est dégradé et jeté en prison. Au contact de Carmen, il sera plus dégradé encore et retranché de la société. Il connaîtra une solitude plus noire que la prison. Dans sa pire déchéance, il aura la nostalgie d'une vie honnête et à la mesure de la morale commune. Catholique dévot, il a ses superstitions, comme Carmen les siennes. Et celles-ci l'emportent sur celles-là. Il est curieux que les incantations de la gitane hérétique agissent aussi puissamment sur ce chrétien ancré dans la foi de ses ancêtres.
Comment pourrait-il élever jusqu'aux lois qu'il respecte cette enchanteresse intuitive et rusée, cette infidèle arrogante, licencieuse et ingénument criminelle ? Ivre de liberté, se brisera-t-elle contre les cadres rigides de la société moderne ? Ou, magicienne frivole, sera-t-elle victime des forces obscures qu'elle a imprudemment appelées pour ensorceler don José ?
***
Bien des idées, suggérées par le récit, ont dû venir à l'esprit de Mérimée, pendant les quinze années que l'écrivain a consacrées à l'élaboration de Carmen. Dans le désir d'être complet, il se mit au courant de toutes les recherches et obéit à tous les souffles. Avant tout, il voulait que son conte fût d'une forme brève, concise, d'une précision voisine de l'algèbre. Aucune phraséologie. Aucune enflure. Aucun accent d'élégie. « Une simplicité chirurgicale », dira Doudan.
Au retour de son premier voyage en Espagne, et peu de temps après avoir esquissé les Ames du Purgatoire (dont l'action se passe à Salamanque) et Carmen (qu'il situe à Séville et à Grenade), il écrit à Edouard Grasset, qui lui avait demandé son opinion sur un manuscrit : « Je trouve que le style est trop élevé, trop soutenu. C'est un défaut qu'ont assez souvent les personnes qui n'ont pas encore l'habitude d'écrire. Au reste, j'ai, dit-on, le défaut contraire, et vous voyez que j'ai tant d'antipathie pour le style brillant que je ne lui fais grâce nulle part. »
Singulière confession d'auteur, alors qu'en cette année 1831 on nage en plein romantisme. Mérimée ne s'attache qu'à la vérité des caractères de ses personnages. Personnages de mince importance et qu'il tire des bas-fonds andalous. Il devance en plus d'un sens son époque. « Il fut peut-être le seul sobre dans cette littérature enivrée », a écrit Barbey d'Aurevilly. Avant Champfleury, Flaubert, Zola et les Goncourt, Mérimée s'engage dans le naturalisme. Comme il se pique de bon ton, il ne dira que l'essentiel et avec une curiosité amusée. Etabli avec beaucoup de prudence, son travail demeure net et plein. Carmen est un chef-d'œuvre qu'on doit placer au rang de la Princesse de Clèves de Mme de La Fayette, de Manon, de l'abbé Prévost, et d'Adolphe, de Benjamin Constant.
Son père, Léonor-François Mérimée, était peintre et chimiste. L'auteur de Carmen a accroché dans sa chambre à coucher un grand tableau qui porte la signature paternelle. Tableau intitulé : l'Innocence nourrissant un serpent. Peinture allégorique toujours sous les yeux de l'écrivain et d'où il a pu tirer maintes variations en rédigeant ses contes d'une ironie amère.
Prosper Mérimée a hérité le don de peindre de son père. Il peint mieux encore avec la riche palette des mots. En écrivant Carmen, il peint avec la rigueur, avec la sourde et cruelle volupté d'Ingres. A ses heures de chimiste, Léonor-François Mérimée a découvert des couleurs qui ne s'altèrent pas avec les années. Ce que Prosper Mérimée tracera de sa plume ne se flétrira pas non plus avec le temps. Dans certaines pages, sa prose, aux arêtes vives, est dure comme l'acier dont elle a les reflets métalliques.
Avec un érudit aussi fort et aussi sournois que Prosper Mérimée, il faut sans cesse se tenir en alerte. Croyez-vous que c'est par hasard qu'il a appelé son héroïne Carmen, nom très commun en Espagne ? Je pense, au contraire, qu'il s'est arrêté sur ce nom, dont il a fait le titre de sa nouvelle, parce que, latiniste avisé, il savait que ce mot : carmen, signifie, en latin, à la fois, poésie, magie et musique. C'est de ces trois arts que sera fait Carmen, conte de Mérimée, comme sera fait, plus tard, Carmen, opéra-comique de Bizet, sur le livret de Meilhac et Halévy.

LES WAGNÉRISTES.
Tableau de Fantin-Latour (1886), Musée du Louvre. Assis de droite à gauche : Amédée Pigeon, Edmond Maître, Emmanuel Chabrier, faisant au piano la lecture de la partition de Carmen. Debout, de droite à gauche : Vincent d'Indy, Antoine Lascoux, Camille Benoît, Armand Boisseau, Adolphe Jullien.
QUATRIÈME PARTIE
LE LIVRET DE " CARMEN "
XXII
LES PERSONNAGES INTRODUITS PAR MEILHAC ET HALÉVY
Dix-huit mois avant de commencer le livret de Carmen, Meilhac et Halévy avaient fait jouer sur le théâtre des Variétés les Brigands. Dans cet opéra bouffe, dont la musique était d'Offenbach, se trouvait un jeune paysan, Fragoletto qui, par amour pour Fiorella, fille d'un chef de bande, s'enrôlait dans la clique des voleurs.
Accoutumée au brigandage dès l'enfance, la roucoulante jouvencelle Fiorella, dont le cœur est partagé entre Fragoletto et le duc de Mantoue, n'est-elle pas une Carmencita en herbe ? Certains points de ressemblance entre les scénarios des Brigands et de Carmen étaient si manifestes que Zulma Bouffar, qui avait joué en travesti le rôle de Fragoletto avec tant d'heureux entrain, avait été pressentie pour créer, salle Favart, le rôle de Carmen, dans l'opéra-comique dont Bizet venait d'écrire la musique.
Henri Meilhac et Ludovic Halévy étaient déjà les auteurs acclamés de plusieurs opéras bouffes représentés entre 1864 et 1870 : la Belle Hélène, la Vie Parisienne, la Grande-Duchesse de Gerolstein, Barbe-Bleue, la Périchole (*). Ce dernier ouvrage s'apparente au Carrosse du Saint-Sacrement. Dans la Périchole, qui se passe à Lima, tout de même que la comédie de Mérimée, et dont le vice-roi et la Périchole sont les mêmes personnages que ceux du Carrosse du Saint-Sacrement, on chante ces refrains rebattus :
On sait aimer quand on est Espagnol.
et :
Il grandira, car il est Espagnol.
Et dans les Brigands :
Y a des gens qui se disent Espagnols
Et qui ne sont pas du tout Espagnols.
Nous, nous sommes de vrais Espagnols,
Ça nous distingu' des faux Espagnols.
(*) Créée le 6 octobre 1868, sur le Théâtre des Variétés, la Périchole venait d'y être reprise avec un vif succès, quelques mois avant la première représentation de Carmen.
Dans Carmen, les deux brillants écrivains comiques étaient tenus de faire revivre sur la scène de « vrais Espagnols ». Jusque-là, Meilhac et Halévy s'étaient toujours refusés au tragique. Les malheurs éprouvés pendant la guerre de 1870 avaient-ils rendu leurs âmes plus graves ? Il n'y paraît pas. En s'attaquant à Carmen, ils conservaient leur manière d'auteurs du boulevard, d'amuseurs spirituels et de poètes légers. Ils avaient l'expérience des règles de l'art particulier au théâtre parisien. Ils ne pouvaient qu'accommoder, chiffonner à leur façon habituelle la nouvelle de Mérimée et y apporter les changements réclamés par ce qu'on appelle maintenant encore « la raison théâtrale ».
Les librettistes commencèrent par introduire dans leur adaptation scénique six nouveaux personnages : Micaëla, Escamillo, Frasquita, Mercédès, le brigadier Moralès et le lieutenant Zuniga. Rôles conventionnels qui n'auraient pas été du goût de Mérimée, de son vivant. Le grand écrivain était mort en 1870. Ses héritiers avaient autorisé Meilhac et Halévy à tirer un livret de Carmen, sans aucune condition, sans même exiger une part des droits d'auteur.
Pour fixer leur ouvrage aux mesures du théâtre comique, où il étaient passés maîtres, les adaptateurs de Carmen vidèrent le conte mériméen de sa richesse psychologique, de son pathétique, de son mystère inquiétant. Les contrebandiers, dont Mérimée décrit l'existence violente, sont devenus, sous la plume de Meilhac et Halévy, de gais lurons, semblables aux bandits facétieux des Brigands, de Fra Diavolo ou des corsaires joyeux de Zampa.
De ce fait, la frénésie de passion du contrebandier don José n'est plus de mise et perd de sa puissance émotive. Le côté étrange et profond du caractère de Carmen a disparu. Le plus fort de son charme fatidique s'est dissipé. La gitane de Mérimée n'a plus sa cruauté ni ses mobilités de félin. C'est une comédienne qui travaille pour la scène et qui ne porte que des ornements de théâtre.
La zingarella farouche, instigatrice des mauvais coups, des contrebandes et des forfaits de sa clique, l'indomptée qui se refuse au moindre semblant de servitude, est devenue une aguichante coquine aux ordres d'un chef bouffon, le Dancaïre. Ce chef de bande est même transformé par Meilhac et Halévy en gros comique de théâtre (en gracioso des zarzuelas), alors qu'il est, dans le récit mériméen, un quinquagénaire d'une clairvoyance désabusée et nullement jovial. Son acolyte, le Remendado — lui aussi affublé d'un masque hilare — n'est plus horriblement massacré par Garcia le Borgne, comme dans le chapitre III de Carmen.
Dans l'adaptation scénique, la figure de Garcia le Borgne, mari de Carmen, a été supprimée. Il n'est pas question de son combat avec José ni de sa mort atroce. Le duel au couteau a lieu entre Escamillo et José. Le picador Lucas, qui se fait piétiner par un taureau, et qui n'a jamais rencontré José, nous a été changé en Escamillo, toréador toujours triomphant et qui galantise auprès de Carmen et de ses compagnes. En opposition au personnage noir de Carmen, les librettistes ont inventé Micaëla, ingénue aux yeux de colombe, dont les fades roucoulements écœuraient Georges Bizet lui-même.
En somme, aucun personnage de la nouvelle de Mérimée ne nous est présenté dans ses nuances d'originalité ni sous ses traits distinctifs. Le style abrégé, acéré de l'écrivain, sa justesse et sa rapidité de touches ont fait place à une dialectique aimablement spirituelle, à une peinture gracieuse et riante.
Ce n'est que dans le dialogue de leur livret que Meilhac et Halévy introduisirent plusieurs passages empruntés au texte original du conte de Mérimée. Les librettistes de la Périchole étaient hommes de talent, de goût, et parfaits lettrés. Ils connaissaient la valeur et la qualité de la prose mériméenne. Plus tard, dans le premier acte de l'une de ses comédies, Henri Meilhac bâtira toute une scène d'amour sur la lecture de la Chambre bleue, cette autre nouvelle de Prosper Mérimée dont le manuscrit a été retrouvé sur les rayons de la bibliothèque de l'Impératrice Eugénie.
Afin de mesurer avec exactitude les modifications apportées par Meilhac et Halévy au récit original, il est nécessaire de faire l'analyse du livret qu'ils ont tiré de Carmen, de Prosper Mérimée.
XXIII
Acte I
L'action se passe en Espagne, vers 1820. Le décor représente une place, à Séville. A droite, la porte de la Manufacture de tabac. A gauche, le corps de garde des dragons d'Almanza. Devant le corps de garde, une galerie couverte à laquelle on accède par quelques marches. Au fond, un pont sur le Guadalquivir et qui traverse la scène dans toute son étendue. Sévillans et Sévillanes vont et viennent sur la place et sur le port. Les soldats dévisagent les passants et s'amusent de leurs démarches et de leurs mines curieuses.
Arrive Micaëla, orpheline navarraise, recueillie par la mère de don José. Les deux femmes habitent à dix lieues de Séville. Micaëla a fait le long trajet pour porter une lettre et une petite somme d'argent au brigadier don José. Elle ne trouve pas celui qu'elle cherche. Le brigadier Moralès lui apprend que José n'a pas encore pris son tour de garde. Elle veut repartir. Les soldats l'entourent, très empressés, et lui demandent d'attendre au corps de garde le retour de don José. Micaëla s'y refuse et s'échappe en courant.
Ici se trouvait une scène qui a été supprimée, lors de la reprise de Carmen en 1883. Scène comique où l'on voit un vieux mari et sa jeune femme en promenade sur la place. La jeune femme donne des signes d'impatience. Apparaît un jeune homme qui salue le couple et détourne l'attention du mari pour passer un billet galant à la señora. Cet épisode n'est que mimé. En trois couplets, le brigadier Moralès commente, pour ses camarades, les manèges plaisants des personnages : le mari, la femme et l'amant.
Marche militaire avec clairons et fifres. Précédée d'un chœur de gamins qui jouent au soldat, la garde montante vient relever la garde descendante, devant une foule de badauds. Moralès informe don José de la visite de Micaëla. Nouveau venu dans la ville, le lieutenant Zuniga interroge le brigadier don José sur le dévergondage des cigarières. Don José avoue qu'il n'a aperçu que de loin les frivoles ouvrières. Depuis la mort de son père, il n'a d'attachement que pour sa mère et pour Micaëla qui est âgée de dix-sept ans.
La cloche de la Manufacture de tabac se fait entendre. La place est envahie par les cigarières auxquelles des jeunes gens « murmurent des propos d'amour ». Elles répliquent, tout en fumant des cigarettes (qui n'étaient pas encore inventées en 1820) que « le doux parler des amants, c'est fumée »... Mais voici la Carmencita, entourée par trois ou quatre galants qui lui demandent « quel jour elle les aimera ».
« Peut-être jamais, peut-être demain », répond la zingarella. Et elle chante la habanera, l'Amour est un oiseau rebelle. Occupé à tortiller des fils de laiton pour faire une épinglette, José a regardé à peine l'impudente bohémienne. Dépitée, elle interpelle ironiquement le bel indifférent. Il continue avec calme son ouvrage. Alors, d'un jet brusque, elle lui lance entre les deux yeux la fleur de cassie qu'elle a arrachée de son corsage. Mais la cloche de la Manufacture sonne pour la deuxième fois. A ce signal, Carmen et les cigarières rentrent dans l'établissement et leurs soupirants se retirent.
Resté seul, don José ramasse la fleur de cassie, tombée à ses pieds. Il en respire l'odeur et cache la grappe sous son dolman. Etrangement troublé par le souvenir de la bohémienne, il s'écrie, à peu près comme dans le conte de Mérimée : « Certainement, s'il y a des sorcières, cette fille-là en est une. »
Micaëla survient. Le brigadier est heureux de la revoir, comme si sa présence brisait le sortilège de la gitane. La jeune fille embrasse don José et lui remet une lettre de la part de sa mère. Le brigadier lit tout haut la missive, dans laquelle Mme Lizzarabengoa conseille à son fils d'épouser Micaëla. Remplie de confusion, la jeune fille s'éclipse avant que José ait terminé la lecture de la lettre maternelle.
Soudain, grand vacarme. Le lieutenant Zuniga accourt, suivi de ses soldats. Les cigarières sortent, en désordre, de la Manufacture et entourent l'officier. Chacune veut expliquer à sa façon la dispute qui a éclaté entre Carmen et Manuelita. Zuniga ordonne à José de pénétrer avec deux hommes dans la Manufacture. Peu après, le brigadier revient, amenant Carmen. Il fait son rapport au lieutenant. Au cours d'une discussion avec Manuelita, Carmen a tracé un X sur le visage de sa rivale, avec la pointe de son couteau. Zuniga veut interroger la gitane. Au lieu de répondre, Carmen se met à chantonner. Furieux, le lieutenant commande à José de conduire tout de suite Carmen à la prison. Il entre au corps de garde pour écrire l'ordre d'incarcération.
Les mains liées, Carmen demande, d'une voix caressante, à José de lui venir en aide. Elle prétend que, comme lui, elle est Navarraise. Il n'en croit rien. Peu importe ! Elle convient qu'elle est bohémienne. Mais elle ajoute que le brigadier n'en fera pas moins ce qu'elle veut, parce qu'il l'aime déjà. Le charme de la fleur de cassie qu'il a gardée sur son cœur a opéré. José impose silence à la gitane. En chantant une séguedille, elle déclare à José qu'elle pourrait bien l'aimer. Elle a congédié hier son amoureux. Elle voit en José un nouvel amant. Ensemble, ils pourront, le soir même, danser et boire à la taverne de Lillas Pastia.
L'homme est conquis. Il délie sa prisonnière. Sur la route qui mène à la prison, Carmen pousse José qui se laisse renverser. Elle s'enfuit par le pont et jette, dans le Guadalquivir, la corde qui attachait ses mains.
Acte II
Dans la taverne de Lillas Pastia. Officiers et bohémiennes finissent de dîner côte à côte. Dans un coin, deux bohémiens jouent de la guitare. Au milieu de la scène, deux bohémiennes dansent. Carmen n'écoute pas ce que lui chuchote le lieutenant Zuniga. Elle se lève brusquement de table et entonne la « Chanson bohème » pour faire danser les deux gitanes. A la fin du troisième couplet, elle se mêle à leur danse.
Il se fait tard. Lillas Pastia prie ses clients de quitter l'établissement qui devrait déjà être fermé. Le lieutenant invite les bohémiennes à l'accompagner au théâtre. Mercédès et Frasquita s'y refusent et Carmen, plus énergiquement que ses deux compagnes. Zuniga suppose que Carmen lui en veut parce qu'il avait donné l'ordre de l'envoyer en prison. C'est le brigadier José qui a pâti de l'affaire et qui, pour avoir laissé échapper Carmen, a été dégradé et a subi deux mois d'emprisonnement. Sa peine n'a pris fin qu'hier.
Des vivats retentissent au loin. Une promenade aux flambeaux a été organisée en l'honneur d'Escamillo qui a été vainqueur aux dernières courses de taureaux de Grenade. Zuniga convie aussitôt le torero à la table de la taverne. Escamillo, en deux couplets, avec refrain repris par l'assistance, chante ses exploits tauromachiques. Carmen est captivée par le toréador des corridas de Grenade. Elle lui laisse espérer un prochain rendez-vous. Escamillo repart, entraînant dans la promenade aux flambeaux tous les personnages présents, à l'exception de Carmen, Frasquita, Mercédès et Lillas Pastia. Sur le pas de la porte, le lieutenant annonce à Carmen, rien de moins que consentante, qu'il reviendra dans une heure.
A peine Escamillo et ses fidèles sont-ils sortis que surgissent le Dancaïre, chef des contrebandiers, et le Remendado. Cette nuit même, il s'agit de transporter, en fraude, un lot de marchandises amenées d'Egypte par un navire anglais. L'aide des trois femmes est nécessaire pour détourner l'attention des douaniers. Mercédès et Frasquita acceptent ce qui leur est proposé. Carmen se dérobe. Elle attend un soldat dont elle s'est éprise. A cause d'elle, il a été condamné à deux mois de prison. Elle lui a fait remettre par le geôlier un pain d'Alcala qui contenait une lime et une pièce d'or pour qu'il pût s'évader. Mais il a purgé entièrement la punition qu'il a encourue. Il vient seulement d'être libéré. Pourquoi ne se joindrait-il pas aux contrebandiers ? insinue le Dancaïre. Il est trop niais, répond Carmen. Vainement, le Dancaïre espère que le soldat ne viendra pas, ce soir, au rendez-vous de Carmen, afin que la gitane puisse participer à l'expédition nocturne des contrebandiers.
Voici justement don José qui s'annonce par un refrain de caserne. Le Dancaïre, le Remendado, Frasquita et Mercédès s'éclipsent. Don José restitue à Carmen la pièce d'or qu'elle lui a donnée. Carmen en profite pour commander à Lillas Pastia toutes sortes de friandises. Le soldat avoue à la gitane qu'il a souffert, sans en murmurer, la dégradation et l'emprisonnement parce qu'il adore la bohémienne. S'accompagnant de castagnettes, Carmen danse pour don José la Romalis. Sa danse n'est pas encore achevée qu'au loin, sonne la retraite. Don José veut déjà partir pour être présent à l'appel. Il n'a pas cessé d'aimer Carmen. Mais son honneur de soldat lui interdit de déserter. Furieuse, Carmen jette au soldat casque et sabre pour qu'il décampe au plus vite.
A ce moment, Zuniga pousse la porte du cabaret. Il fait honte à Carmen de préférer un soldat à un officier et ordonne à don José de déguerpir. Comme don José fait mine de résister, il le menace de son épée. José tire son sabre. En hâte, Carmen alerte les contrebandiers. Ils ont vite fait de désarmer le lieutenant qu'ils garderont prisonnier pendant une heure. Le sort en est jeté. Don José abandonnera le métier militaire pour partager la vie libre et dangereuse des contrebandiers.
Acte III
Une gorge sauvage dans la montagne. Il fait nuit noire. Chargés de leurs ballots, les contrebandiers descendent sur la scène, après avoir escaladé les rochers qui barrent les sentiers. Le Dancaïre et le Remendado vont partir en reconnaissance sur les chemins par lesquels ils espèrent introduire en ville les marchandises rapportées de Gibraltar. Pendant ce temps, les autres contrebandiers pourront se reposer autour d'un feu.
Carmen et don José ont pris part à l'expédition. La bohémienne aime de moins en moins l'ancien brigadier. Il est devenu jaloux et tyrannique. Elle ne peut supporter aucun maître. Don José la menace. Elle ne s'en émeut guère. Peut-être sera-t-elle tuée un jour par son amant. Elle a souvent lu dans les cartes qu'ils devaient finir ensemble. Justement, Frasquita et Mercédès ont commencé de se tirer les cartes. Carmen étale, de son côté, un jeu. Elle a beau battre les cartes, elle n'en extrait que carreaux et piques. Cela signifie, pour elle, l'annonce de sa mort.
Le Dancaïre est de retour. La brèche par laquelle les contrebandiers doivent passer est surveillée par trois douaniers. Carmen et ses compagnes connaissent les gabelous en question. Elles partent en tête de la caravane. Carabine au poing, don José reste sur une hauteur pour garder les marchandises qu'on ne peut emporter. Il a pour tâche d'abattre tout intrus qui s'approcherait de trop près.
Conduite par un guide, Micaëla est parvenue au campement des bohémiens. Le guide la laisse seule. Dans la sierra, elle n'a pas eu peur, quand elle s'est égarée au milieu d'un troupeau de taureaux mené par le « célèbre Escamillo ». Maintenant, elle éprouve une grande frayeur à la vue du repaire des bandits. Il lui faut, à tout prix, parler à don José. Elle l'aperçoit qui, sur un mamelon, arme sa carabine et tire un coup de feu. Terrifiée, elle disparaît derrière les rochers.
Entre Escamillo, escorté par don José qui a manqué le tuer. Questionné, il confie imprudemment à l'ancien soldat qu'il aime Carmen et qu'il risquerait sa vie pour la retrouver. José se fait reconnaître et provoque le toréador. Armés de leurs navajas, les deux adversaires vont régler, sur l'heure, le conflit qui les divise. José a d'abord le dessous. Escamillo ne frappe pas l'adversaire qui est à sa merci. José exige la reprise du combat. Cette fois, c'est Escamillo qui glisse et tombe. José se précipite pour l'égorger. Son bras est arrêté par Carmen, soudain arrivée (*). Escamillo déclare, en repartant, qu'ils sont « manche à manche » et qu'ils « joueront la belle », quand il plaira à son rival.
(*) Dans la version actuelle de l'Opéra-Comique, le duel est simplifié. Au cours du combat, la navaja d'Escamillo se brise. Don José va pour frapper son adversaire. Carmen l'arrête. La première phase de la lutte, qui est à l'avantage du toréador, est supprimée de façon regrettable. Outre que cette coupure affaiblit l'action, elle enlève toute raison à ce que chante Escamillo, avant de s'éloigner :
Quant à toi, beau soldat,
Nous sommes manche à manche et nous jouerons la belle,
Le jour où tu voudras reprendre le combat.
Las de souffrir, don José s'en prend à Carmen. Le Dancaïre s'interpose et donne l'ordre de départ. Au moment où la bande s'ébranle, apparaît Micaëla. Elle annonce que la mère de José se meurt et qu'elle appelle son fils à son chevet. Don José est hésitant. Puis, ironiquement encouragé par Carmen, il se retire avec Micaëla. Avant de s'éloigner, il rudoie Carmen et lui crie : « Sois contente, je pars... mais nous nous reverrons... » Dans le lointain, Escamillo fait entendre son refrain de toréador. Carmen l'écoute avec ravissement. Don José s'est détourné un moment. Les bohémiens ont chargé les ballots sur leurs épaules et se sont mis en marche.
Acte IV
Sur une place de Séville. Au fond, les murs des vieilles arènes dont l'entrée est fermée par un large vélum. La course de taureaux qui va se dérouler avec le concours d'Escamillo a attiré une grande foule. Des marchands d'oranges, d'éventails, de vin, d'eau, de tabac offrent leurs articles à « deux cuartos ». Señoras et caballeros surexcités se pressent sur la chaussée, en attendant l'arrivée de la cuadrilla.
Le lieutenant Zuniga a invité au spectacle Frasquita et Mercédès. Il demande aux deux bohémiennes ce qu'est devenue la Carmencita. Elle est maintenant férue d'Escamillo qu'elle ne quitte plus. Quant à son ancien amoureux, José, il a failli être arrêté dans son village. Il s'est enfui à temps. Sans doute est-il à la recherche de Carmen.
Voici, parmi les fanfares et les cris, le défilé de la cuadrilla. En tête, les alguazils, houspillés par le public. On acclame les chulos, les banderilleros, les picadors, le seigneur alcade. Enfin paraît le fameux Escamillo, au bras de Carmen, qui, pour la circonstance, s'est vêtue avec faste. Les deux amants se déclarent leur flamme. Le toréador entre dans l'arène. Frasquita a conseillé à Carmen de s'éloigner. Elle a vu don José se dissimuler parmi les badauds. La gitanilla aperçoit, en effet, l'ancien dragon d'Almanza. Elle n'est pas femme à trembler. Si don José désire une explication de la conduite de sa maîtresse, il l'aura.
Quand la foule s'est écoulée, don José, amaigri, pitoyable, s'approche de Carmen. Il ne vient pas la menace à la bouche. Pour leur salut commun, il supplie humblement la gitane de commencer avec lui une autre vie, dans un pays nouveau. Elle repousse dédaigneusement les offres de José. Elle a le pressentiment qu'il la tuera. Même si l'heure de sa mort est venue, elle ne cédera pas. Elle ne l'aime plus. Mais lui, il l'adore. S'il le faut, il restera bandit pour lui plaire.
Pendant ce dialogue, des cris d'enthousiasme éclatent dans l'arène pour saluer la victoire d'Escamillo. Carmen, radieuse, veut gagner sa place dans le cirque. José l'empêche de passer. Elle proclame hardiment qu'elle aime Escamillo. Don José ne se contient plus. Pour la dernière fois, il demande à la bohémienne de le suivre. Non ! réplique Carmen. Et elle enlève de son doigt la bague qu'il lui avait donnée et la jette à la volée. Ecumant de rage, il a tiré son couteau. Bravement, elle fait quelques pas vers l'entrée du cirque. Il la poursuit et la frappe de son arme. Carmen tombe, inanimée. Le vélum s'ouvre. La foule sort du cirque. Don José s'est abattu sur le corps ensanglanté de Carmen, en s'écriant avec désespoir : « Vous pouvez m'arrêter... c'est moi qui l'ai tuée. Ah ! ma Carmen, ma Carmen adorée ! »
XXIV
Ainsi qu'on a pu le voir, le livret de Meilhac et Halévy diffère sensiblement du conte de Mérimée. Le détail énergique qui prend sur l'âme, les traits saillants de vérité que Mérimée avait scrupuleusement notés ont été, pour la plupart, négligés par les librettistes qui ne s'en tenaient qu'à l'extérieur des faits. Le sujet, taillé dans la rugueuse étoffe de la nouvelle originale, a été diminué et affaibli. Les turpitudes et les trahisons de la bohémienne ont été voilées et présentées sous un jour contraire.
Bien avant Georges Bizet, Victor Massé avait songé à mettre en musique Carmen. Le 11 août 1864, il écrivit longuement à Victorien Sardou pour lui exposer son plan. La principale interprète de l'œuvre projetée était déjà choisie : c'était Galli-Marié qui, huit ans et demi plus tard, allait incarner Carmen, dans le drame lyrique de Bizet. On se demande avec curiosité de quelle manière Massé et Sardou eussent traité et transformé la nouvelle de Prosper Mérimée.
Asservis au métier théâtral de l'époque, Meilhac et Halévy avaient de puissants motifs à conserver les façons qui leur avaient réussi avec un constant bonheur auprès du public de leur temps. Public qui n'était alors occupé que des figures légères et artificielles de l'opérette.
Dans cette seule année de 1875 — l'année de la première représentation de Carmen — non moins de trente et une opérettes avaient été créées sur les scènes parisiennes. Sur la liste de ces opérettes, on relève Geneviève de Brabant, la Créole, le Voyage dans la lune et la Boulangère a des écus, de Jacques Offenbach ; la Petite mariée et le Pompon, de Charles Lecocq ; la Belle poule, de Florimond Hervé ; la Blanchisseuse de Berg-op-Zoom et la Cruche cassée, de Léon Vasseur.
En grand nombre, les théâtres de la capitale consacraient leur activité au genre de l'opérette. Citons les Variétés, les Bouffes-Parisiens, la Gaîté, la Renaissance, l'Athénée, les Folies Dramatiques, Marigny, Déjazet, Cluny, le Château d'Eau, le Théâtre Taitbout, les Menus-Plaisirs, les Folies-Bergère, la Scala, l'Eldorado, le Cadran, les Délassements Comiques, le Concert Européen, les Fantaisies Parisiennes, le Théâtre de la Porte Saint-Denis, les Bouffes du Nord, le Théâtre Montmartre, le Théâtre des Batignolles, les Folies Nouvelles. On ne peut comparer la vogue dont jouit, pendant cette période, l'opérette, qu'à la vogue rencontrée de nos jours par le cinéma.
Meilhac et Halévy n'avaient pas peu contribué à cette faveur excessive de l'opérette. Ils ne pouvaient plus échapper au genre qu'ils avaient, en grande partie, fondé et mené au triomphe, sans risquer de compromettre leur propre carrière. Même sur les scènes nationales, même dans les sujets sérieux qu'ils traitaient, il fallait qu'on reconnût leur légère marque de fabrique. Dans l'état du goût public de leur époque, c'eût été courir à un échec que de suivre fidèlement, dans une adaptation théâtrale, l'intrigue du conte de Mérimée. Coûte que coûte ils devaient user, dans leur ouvrage, des recettes dont ils s'étaient servis pour leurs livrets d'opérettes. Leurs noms sur une affiche — fût-ce l'affiche de l'Opéra-Comique — étaient garants sérieux du succès, sous la condition de rester dans les bornes de leur distrayante manière habituelle.
XXV
Voilà qui ne faisait pas, semble-t-il, l'affaire de Bizet, si disposé qu'il fût aux concessions vis-à-vis de collaborateurs aussi rassurants, aussi écoutés, aussi vantés en tous lieux.
Au début de sa carrière, Bizet croyait lui-même que ses dons de nature le poussaient vers la musique bouffe. Il était venu peu à peu à une appréciation plus approfondie de l'art des sonorités. Dans la dernière partie de sa vie, la musique n'était plus pour lui un jeu stérile et savant, fait pour amuser la foule. Elle était la contemplation du monde intérieur et vrai », selon la définition de Schopenhauer, reprise par Richard Wagner.
Il est probable que, si le livret de Carmen a conservé certains éléments tragiques de la nouvelle de Mérimée, nous le devons à Georges Bizet. Cette fois le musicien n'accepta pas, sans protester ouvertement, le texte de ses librettistes, comme il l'avait fait quand il s'était agi des Pêcheurs de Perles et de la Jolie Fille de Perth. Ses liens de famille avec Ludovic Halévy lui permettaient d'apporter au scénario de Carmen les retouches qu'il jugeait nécessaires. Il collabora même effectivement à la rédaction du livret. Une page autographe de Bizet, que m'avait communiquée Mme Straus-Bizet, en porte témoignage.
Ernest Guiraud a raconté que, pendant les premières répétitions, Bizet s'était vu obligé de recommencer jusqu'à treize fois la « Habanera ». Le compositeur avait écrit un air d'entrée avec chœur qui ne plaisait pas à Galli-Marié, créatrice du rôle de Carmen. Après avoir composé douze morceaux différents, successivement rejetés par sa principale interprète, il finit par emprunter à un album du maestro Yradier une « chanson havanaise », El Arreglito (le Petit Arrangement), qu'il remania selon ses propres vues.
Yradier avait conçu sa chanson sur des vers plats et empommadés de Paul Bernard et Tagliafico, traducteurs des strophes espagnoles.
Chinita mia,
Danse avec moi !
Ne sais-tu pas
Que je meurs pour toi ?
Il fallait de toute urgence de nouvelles paroles pour cette musique. Sur sa page manuscrite, Bizet donne à peu près le modèle qui convient. Il écrit :
L'amour est un rebelle
Et nul ne peut l'apprivoiser.
C'est en vain qu'on l'appelle ;
Il lui convient de refuser.
Et il demande à Ludovic Halévy « huit vers pareils aux quatre premiers (qu'on vient de lire), les second, quatrième, sixième, huitième, dixième et douzième vers commençant par une voyelle ».
Après quoi, il propose à son librettiste les vers suivants de sa main :
L'amour est enfant de Bohême,
Il ne connut jamais de loi.
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime !
Si tu m'aimes... tant pis pour toi !
L'oiseau, que tu croyais surprendre,
Battit de l'aile et s'envola...
L'amour est loin — tu peux l'attendre.
Tu ne l'attends plus — il est là.
Tout autour de toi, vite, vite,
Il vient — il s'en va — puis revient.
Tu crois le tenir — il t'évite.
Tu crois l'éviter — il te tient.
L'amour est enfant de Bohême...
En marge, Bizet ajoute : « Prière de ne rien changer à tout cela, si c'est possible. »
Halévy a renvoyé au musicien la feuille manuscrite de Bizet, en haut de laquelle il a écrit ces vers, réclamés par le musicien :
Hasard et fantaisie :
Ainsi commencent les amours.
En voilà pour la vie,
Ou pour six mois, ou pour trois jours.
Un matin, sur sa route,
On trouve l'amour... Il est là...
Il vient sans qu'on s'en doute
Et, sans qu'on s'en doute, il s'en va.
Il vous prend, vous enlève,
Il fait de vous tout ce qu'il veut.
C'est un délire, un rêve.
Et ça dure ce que ça peut.
Au dos de la même page, Halévy a griffonné : «Voici les douze vers demandés. Sont-ils dans le sentiment ? J'en avais fait de plus tendres, mais je crois qu'il ne faut pas donner au début une teinte trop mélancolique à Carmen et qu'un peu de blague ne fait pas mal. Je te porterai demain, à Bougival, les petites bribes du final du troisième acte et les quatre vers qui remplaceront le petit dialogue du dernier tableau. »
Bizet ne se servit pas des douze vers que lui avait adressés Ludovic Halévy. En revanche, il conserva à peu près, dans le texte définitif, les vers qu'il avait lui-même imaginés. Quatre vers seulement furent légèrement modifiés :
L'amour est un rebelle.
C'est en vain qu'on l'appelle.
Si tu m'aimes... tant pis pour toi !
Il vient, s'en va, puis il revient.
qui ont été à peine changés en :
L'amour est un oiseau rebelle
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle.
Si je t'aime... prends garde à toi !
Il vient. Il s'en va, puis revient.
On voit avec quels soins Georges Bizet rectifiait désormais les textes qui lui étaient soumis, quand il ne les écrivait pas lui-même. La page manuscrite que nous venons de citer nous révèle la part importante que le compositeur a prise à la rédaction et à l'arrangement du libretto de Carmen. Cela nous donne à penser qu'il a collaboré de très près à l'ouvrage de Meilhac et Halévy. Remarquons que, dans son billet, Ludovic Halévy écrit qu'il ne faut pas donner au début une teinte trop mélancolique à Carmen et qu'un « peu de blague ne fait pas mal ». On peut en déduire que Bizet dut souvent lutter contre les tendances boulevardières de ses librettistes et que c'est grâce à lui que certains traits des figures violentes de Carmen et de don José ont subsisté tels que Mérimée les avait gravés.
XXVI
LES EMPRUNTS AU CONTE DE MÉRIMÉE
Si la nouvelle a été déformée, enjolivée, « théâtralisée » avec une liberté qui nous paraît aujourd'hui choquante, nous retrouvons, surtout dans le dialogue, des phrases entières de la plume de Mérimée. Elles ont été replacées presque textuellement dans le livret de Carmen.
Voici, entre autres, ces lignes qui ont été détachées par Meilhac et Halévy, sinon par Bizet, du récit de Mérimée et qui figurent au premier acte de l'adaptation scénique :
Je suis né à Elizondo... Je m'appelle don José Lizzarabengoa... Je suis basque et vieux chrétien... On voulait que je fusse d'église, et l'on me fit étudier, mais je ne profitais guère. J'aimais trop jouer à la paume... Un jour que j'avais gagné, un gars d'Alava me chercha querelle... et j'eus encore l'avantage ; mais cela m'obligea de quitter le pays... Suivant l'usage des femmes et des chats qui ne viennent pas quand on les appelle et qui viennent quand on ne les appelle pas... Cela me fit l'effet d'une balle qui m'arrivait... Certainement, s'il y a des sorcières, cette fille-là en est une !... Je trouve d'abord trois cents femmes en chemise ou peu s'en faut, toutes criant, hurlant, gesticulant, faisant un vacarme à ne pas entendre Dieu tonner. D'un côté, il y en avait une, les quatre fers en l'air... avec un X sur la figure qu'on venait de lui marquer en deux coups de couteau. En face de la blessée... je vois Carmen. La femme blessée criait : « Confession ! Confession ! je suis morte ! » Carmen ne disait rien ; elle serrait les dents, et roulait des yeux comme un caméléon... Elle commence, avec le couteau dont elle coupait les bouts des cigares, à lui dessiner des croix de Saint-André sur la figure...
— Mon officier, où me menez-vous ?
— A la prison, ma pauvre enfant...
— Hélas ! que deviendrai-je ? Seigneur officier, ayez pitié de moi. Vous êtes si jeune, si gentil... Laissez-moi m'échapper, je vous donnerai un morceau de la bar lacchi qui vous fera aimer de toutes les femmes.
— Nous ne sommes pas ici pour dire des balivernes ; il faut aller à la prison, c'est la consigne, et il n'y a pas de remède...
— Etes-vous du pays ?
— Je suis d'Elizondo.
— Moi, je suis d'Etchalar... (C'est un pays à quatre lieues de chez nous.) J'ai été amenée par des bohémiens à Séville. Je travaillais à la Manufacture pour gagner de quoi retourner en Navarre, près de ma pauvre mère qui n'a que moi pour soutien... On m'a insultée parce que je ne suis pas de ce pays de filous, marchands d'oranges pourries ; et ces gueuses se sont mises contre moi, parce que je leur ai dit que tous leurs jaques de Séville, avec leurs couteaux, ne feraient pas peur à un gars de chez nous avec son béret bleu et son maquila. Camarade, mon ami, ne ferez-vous rien pour une payse ? Elle mentait... Elle estropiait le basque, et je la crus navarraise ; ses yeux seuls et sa bouche la disaient bohémienne... Bref, j'étais comme un homme ivre...
Ces seuls exemples, pris dans le premier acte du livret de Carmen, suffisent à démontrer que Meilhac et Halévy avaient un certain respect du texte de Mérimée et qu'ils y ont fait de larges emprunts. Ils ont été jusqu'à puiser des vers dans la traduction des Tsiganes de Pouchkine que Mérimée fit paraître en 1852. Dans la scène IX du premier acte de Carmen, les quatre alexandrins :
Coupe-moi, brûle-moi, je ne te dirais rien ;
Je brave tout, le feu, le fer et le ciel même...
Mon secret, je le garde et je le garde bien ;
J'en aime un autre et meurs en disant que je l'aime.
que Carmen fredonne à Zuniga, sont extraits de la « Chanson sauvage » que Zemfira, héroïne des Tsiganes, chante à son rom Aleko. Dans la conduite de l'intrigue, la peinture des caractères et l'invention de leurs nouveaux personnages, Meilhac et Halévy se sont pourtant écartés avec insouciance de leur modèle.
***
Maintenant, nous en jugeons avec sévérité. De leur temps, les librettistes en avaient agi non sans sagesse. Malgré toutes les transformations par lesquelles ils firent passer le récit de Mérimée, Carmen provoqua, à son apparition, un véritable scandale. Journalistes, habitués et abonnés de la salle Favart furent offusqués par « l'immoralité » du spectacle. L'affadissement, — que nous déplorons à présent, — du chef-d'œuvre de Mérimée, fut ce qui sauva du désastre l'opéra-comique de Meilhac, Halévy et Bizet, à son début.
Aujourd'hui encore on peut lire, dans le « Dictionnaire des opéras », ces lignes de la main de Félix Clément qui vont à l'encontre du sentiment que nous avons de Carmen : « Il sera nécessaire de refaire le livret, d'en retrancher les vulgarités, de lui ôter ce caractère de réalisme qui ne convient pas à une œuvre lyrique, de faire de Carmen une bohémienne capricieuse et non une fille de joie, et de don José un ensorcelé d'amour, mais non un être vil et odieux... Les deux rôles du toréador et de Micaëla sont excellents. »
S'il fallait « refaire le livret » de Carmen, ce serait dans un sens tout opposé à celui qu'indique
Félix Clément, maniaque du poncif. Les deux rôles du toréador et de Micaëla, personnages conventionnels, décrochés du vieux répertoire lyrique, sont précisément ceux qui blessent le goût. Félix Clément, qui accumule décidément les bévues, n'est pas beaucoup plus perspicace quand il se permet d'apprécier la partition de Bizet. Si l'on s'était conformé à ses avis malencontreux, il y a longtemps que Carmen serait tombée à l'ombre et à l'oubli.
Quand on relit les nombreux articles que les critiques du moment ont consacrés à Carmen, — articles où est dénoncée « l'obscénité » de la pièce — on est tenté de trouver le livret de Meilhac et Halévy ingénieusement tourné, repoli, brillanté. Qu'auraient donc dit ces faux professeurs de vertu si les librettistes s'en étaient tenus scrupuleusement au texte primitif de Mérimée, au lieu de corriger, avec prudence, la rudesse du sujet ? Ceux qui en jugeaient alors avec autant de suffisance et de pruderie avaient, sans doute, négligé de lire ou de relire la nouvelle d'où le livret avait été tiré. S'ils s'en étaient avisés, dans les dispositions où ils étaient, ils auraient, à coup sûr, félicité les auteurs de leur version lyrique et les auraient approuvés d'avoir essayé de travestir les héros sataniques du conte en personnages plaisants d'opéra-comique.

PORTRAIT DE PROSPER MÉRIMÉE, PAR DEVÉRIA.
Cabinet des Estampes.
CINQUIEME PARTIE
LA PREMIÈRE REPRÉSENTATION DE " CARMEN "
XXVII
INCIDENTS AUTOUR DE « CARMEN »
Quand on annonça la première représentation de Carmen, le ministère venait de tomber. Les changements ministériels ont toujours porté préjudice aux théâtres et provoqué la baisse de leurs recettes. Les quatre premières représentations de l'œuvre de Bizet avaient été données pendant la crise ministérielle. Il n'est pas surprenant que les recettes encaissées par l'Opéra-Comique, ces soirs-là, eussent subi une diminution notable. Ce n'est que dans l'après-midi du 10 mars 1875 qu'on apprit la constitution d'un ministère, avec Buffet à l'Intérieur, Dufaure à la Justice, le duc Decazes aux Affaires étrangères, Léon Say aux Finances, et Wallon à l'Instruction publique, aux Cultes et aux Beaux-Arts.
En revanche, un drame lyrique dont l'action se passait en Espagne devait mordre sur l'attention publique. La guerre civile entre alphonsistes et carlistes se poursuivait dans la péninsule ibérique. En tous lieux et dans toutes les publications, il n'était question que des combats qui se déroulaient en Catalogne.
Le matin de la première représentation de Carmen, on apprenait que les relations diplomatiques étaient rétablies entre la France et l'Espagne. Dans la journée du 3 mars 1875, le marquis de Molina, ambassadeur du roi Alphonse XII et de la reine Isabelle, présentait ses lettres de créance à l'Elysée et remettait au maréchal de Mac-Mahon, président de la République, le collier de la Toison d'Or. La date de la création de Carmen avait été choisie, sans doute à dessein, en concordance avec la cérémonie qui devait avoir lieu à l'Elysée. On comptait sur la présence de personnalités officielles pour donner plus d'éclat à la révélation d'une pièce lyrique française inspirée par l'Espagne, et dont les auteurs étaient connus et admirés. Au dernier moment, le directeur de l'Opéra-Comique, contrarié par « l'immoralité » de son nouveau spectacle, n'osa inviter ni les notabilités ibériques, ni les hommes politiques marquants.
Une œuvre d'art de la force et de l'humanité de Carmen n'est-elle pas attachée, par des liens obscurs, aux événements et aux mœurs de l'époque où elle apparaît ?
La conclusion sauvage du dernier acte de Carmen ne pouvait surprendre un public où les souvenirs des meurtres de la guerre et de la Commune étaient encore vivants. Depuis 1871, on continuait de juger les Fédérés emprisonnés. Au moment de la création de Carmen, le quatrième Conseil de guerre venait de condamner à mort le fils Pitois et, aux travaux forcés, Pitois père, Lefèvre et Fontaine, pour avoir envahi, pendant la Commune, le couvent de Picpus.
Les jours suivants, l'impératrice de Russie arrivait à Paris, dont le roi et la reine d'Espagne étaient les hôtes assidus ; don Pedro II, empereur du Brésil, était élu à l'Académie des Sciences et l'on célébrait l'anniversaire de la naissance de Washington. A cette dernière occasion, l'ambassadeur des Etats-Unis offrait un grand dîner au Corps diplomatique et un banquet de deux cents couverts était donné au Grand Hôtel, en l'honneur et à la mémoire du fondateur de la République américaine. Le Nouveau Monde apparaissait alors comme le meilleur refuge à tous ceux dont l'existence irrégulière était difficile sur le vieux continent. A la fin de sa nouvelle, Mérimée faisait déjà dire par don José à Carmen :
— Ecoute, j'oublie tout. Je ne parlerai de rien ; mais jure-moi une chose : c'est que tu vas me suivre en Amérique et que tu t'y tiendras tranquille. Carmen refuse de
Commencer une autre vie
Loin d'ici, sous d'autres cieux.
Dans les milieux dirigeants, on affectait l'austérité. Une pudibonderie, qui masquait certains désordres, faisait commettre des erreurs grossières. Pour en donner l'idée, rappelons seulement ce qui advint à Barraud pour avoir voulu tirer mille nouveaux exemplaires de luxe des Contes de La Fontaine de la fameuse édition des Fermiers généraux. Bien qu'il eût obtenu les autorisations du ministère de l'Intérieur et du préfet de police, le malheureux Barraud fut traîné devant le Tribunal civil et condamné le 9 avril 1875. Les volumes et les gravures des Contes de La Fontaine furent saisis et l'on détruisit les planches originales de Moreau le Jeune et de Choffard, d'une valeur inestimable. Un mois auparavant, la même sottise criminelle faisait dire aux critiques et aux habitués de la salle Favart que Carmen était un ouvrage « obscène ».
***
On attendait avec curiosité la révélation de Carmen. Après s'être montré un musicien épris des doctrines académiques et qui jonglait habilement avec les formules habituelles, Georges Bizet s'était peu à peu détaché des procédés d'école. Dans ses trois partitions qui avaient précédé Carmen, il avait adopté, comme je l'ai dit, un langage harmonique plus libre, une instrumentation plus variée et plus colorée, une forme mélodique plus souple, plus sincère et mieux appropriée à l'expression des sentiments. Dans le nouvel ouvrage qui allait être joué à l'Opéra-Comique — le plus important ouvrage qu'il eût encore écrit — on se demandait à quel parti le musicien, qui s'était placé à la tête de sa génération, allait définitivement s'arrêter.
Les habitués de la salle Favart espéraient que Bizet, arrivé à la maturité, n'aurait d'autre préoccupation que d'écrire un opéra-comique bien tourné, selon toutes les recettes en circulation et en honneur. A l'opposé, les jeunes musiciens et la plupart des membres de la Société nationale de Musique souhaitaient de voir le compositeur de Carmen rompre délibérément avec les vieilles formules du théâtre lyrique et apporter à la scène musicale une œuvre moderne où se prononçât, avec force, l'idéal de la nouvelle école française.
Il n'est pas douteux que Bizet était décidé à s'affranchir des règles étroites auxquelles il s'était soumis jusque-là. Il ne voulait plus écrire que ce qui était de son inclination et n'avait pas caché à son entourage de quelle manière il entendait désormais pratiquer son art. C'est sur les instances de ses librettistes et du directeur de la salle Favart qu'il se crut obligé de se conformer encore aux coupes traditionnelles de l'ancien opéra-comique. Mais ces tournures traditionnelles, il les élargit, les renouvela, les transforma. Il n'en fut le prisonnier que d'apparence. Refondues par son génie, elles semblaient grimaçantes et faussées comme à plaisir, pendant cette soirée du 3 mars 1875.
XXVIII
Au vrai, librettistes et compositeur de Carmen faisaient preuve de courage et d'audace en donnant à l'Opéra-Comique une pièce lyrique aussi éloignée du goût régnant. Au moment de la création de Carmen, les spectacles qui voisinaient sur l'affiche de la salle Favart avec le chef-d'œuvre de Bizet étaient des opéras-comiques anodins et réjouissants, d'un genre à peine plus relevé que celui de l'opérette.
Les 25, 27 et 28 février 1875, on jouait à l'Opéra-Comique Joconde, de Niccolo Isouard, et le Caïd, d'Ambroise Thomas. Le 1er mars avaient lieu la répétition générale de Carmen et, le 3 mars, la première représentation. Les 2 et 4 mars, on affichait Haydée, d'Auber ; le 6, les Noces de Jeannette, de Victor Massé et le Caïd ; le 7, le Chalet, d'Adolphe Adam et la Dame Blanche, de Boieldieu ; le 9, la Fille du Régiment, de Donizetti et le Caïd. Les 5, 8 et 10 mars étaient consacrés à Carmen. Le public, accoutumé aux artifices lénifiants des fournisseurs attitrés de l'Opéra-Comique, devait être complètement dérouté par l'œuvre nouvelle.
La veille de la mi-carême, le 3 mars, Carmen était représentée pour la première fois avec la distribution suivante :
Carmen : Mlle Galli-Marié.
Micaëla : Mlle Chapuy.
Mercédès : Mlle Chevalier.
Frasquita : Mlle Ducasse.
Don José : M. Lhérie.
Escamillo : M. Bouhy.
Le Dancaïre : M. Potel.
Le Remendado : M. Barnolt.
Moralès : M. Duvernoy.
Zuniga : M. Dufriche.
Lillas Pastia : M. Nathan.
Un guide : M. Teste.
Danse : Mlles J. Blandini et Aline Ancke.
Chef d'orchestre : M. Deloffre.
Chef de chant : M. Soumis.
Mise en scène de M. Charles Ponchard.
Les décors étaient de Jambon, Bailly et Davan. Edouard Detaille avait peint les maquettes des uniformes des dragons d'Almanza, et Clairin celles des costumes de Carmen. Le spectacle, qui avait commencé à huit heures du soir, n'avait pris fin qu'à une heure moins vingt. Le premier acte avait duré cinquante-huit minutes, le deuxième quarante-huit minutes, le troisième quarante et une minutes, et le dernier acte, qui ne commença qu'à minuit passé, vingt-trois minutes. Le premier entr'acte s'était prolongé pendant trente-trois minutes, le second pendant quarante-deux minutes, et le dernier pendant trente-trois minutes.
Habitués aux musiques convenues et à « l'accompagnement de guitare » du répertoire, les instrumentistes eurent beaucoup de mal à se plier à l'orchestration complexe et colorée et aux fréquents changements de tonalité et de rythme de la partition de Bizet.
L'exécution orchestrale de Carmen fut, ce premier soir, correcte mais sans relief ni nuance. De leur côté, les choristes, dont la musicalité était à cette époque faible, s'embrouillèrent dans les ensembles qui leur étaient confiés et, plus particulièrement, dans le Chœur des cigarières, au premier acte. « Impossible de les faire chanter en mesure à 6/8, s'écriait avec désespoir Bizet. Je vais prendre un pis aller. Je demanderai au chef d'orchestre de battre la mesure à 3/8... »
Au duo de Carmen et de don José du deuxième acte, le timbalier, ayant mal compté ses mesures, assena un retentissant coup de grosse caisse pendant que Galli-Marié chantait pianissimo. Le public venait de faire répéter en bis l'Entr'acte de ce deuxième acte. On avait aussi applaudi les couplets du toréador et l'étincelant Quintette de Carmen, Mercédès, Frasquita, du Dancaïre et du Remendado. L'Andantino de don José, enivré d'amour, « la Fleur que tu m'avais jetée... », ne produisit aucun effet sur l'auditoire.
Les dissonances des deux avant-dernières mesures et la résolution non préparée de la dernière mesure, pour revenir au ton de ré bémol, suscitèrent des murmures parmi les compositeurs académiques. « Tous les sourds en musique, écrit André Suarès, jurent qu'on se moque d'eux quand on leur révèle des accords qu'ils n'entendent pas ; mais ils ne pensent pas à guérir ni seulement à soupçonner leur oreille. »
Mme Straus-Bizet m'a dit qu'à l'entr'acte Du Locle, le pianiste Delaborde, plusieurs musiciens et le chef de chant Soumis insistèrent auprès de Bizet pour qu'il renonçât à ses altérations des quarante-quatrième et quarante-cinquième mesures de l'Andantino qu'on a appelé depuis la « Romance de la fleur ». Le duo entier, jugé « trop naturaliste et trop long » devait, de l'avis de l'entourage de Bizet, être écourté et comporter des points d'orgue propices aux applaudissements. Georges Bizet résista à toutes les semonces, bien que la fin dissonante de l'Andantino de don José eût été, selon Mme Straus-Bizet, la cause du demi-succès de Carmen, aux premières représentations. La scène nous est heureusement restée telle que Bizet l'avait écrite, dans son originalité expressive, dans son style tout ensemble large et brisé, dans son pathétique sincère, dans sa beauté libre, simple et vivace.
Le troisième acte fut écouté sans aucune réaction de la part d'un public décontenancé, indifférent ou sourdement hostile. La musique ensoleillée, vibrante, du commencement du dernier acte, qui soulève maintenant l'enthousiasme, ne fit pas plus d'impression que les admirables scènes suivantes. La soirée qui traînait en longueur prit fin dans une atmosphère glaciale. La musique et le livret semblaient tous deux diffus, informes et choquants.
***
Comment justifier le sentiment éprouvé par les critiques et la plupart des spectateurs de cette première représentation ? L'exécution en avait été, il est vrai, languissante. Mais les artistes du chant avaient tenu leurs rôles respectifs avec un savoir ingénieux.
Galli-Marié s'était consacrée, d'une passion sans partage, au rôle de Carmen. Elle avait lu et relu le récit de Mérimée et s'était conformée aux indications de l'écrivain. Elle avait rétabli, dans sa force et son feu, le caractère de la bohémienne impétueuse et volage. Fidèle à la conception de Mérimée et résolue à aller vers le vrai, elle présentait le type de Carmen dans son entière exactitude, dans son audacieuse expression première. Son interprétation vivante, réaliste, qui devait lui attirer plus tard l'admiration générale, fut jugée inconvenante par les spectateurs de l'année 1875.
De son côté, le ténor Lhérie était préparé de nature pour figurer don José. Grand, maigre, le visage taillé à coups de serpe, il dissimulait sous une barbe courte sa lourde mâchoire. Il avait plus d'un trait de la rustique noblesse du héros de Mérimée. Sa voix était plus forte que souple. Il interprétait le rôle avec les accents d'une ardente sincérité. Accents plus incisifs et tranchants que mélodieux. Au second acte, avant l'entrée de don José, il avait chanté bas l'Air « Halte-là ! Qui va là ? » qu'il faisait entendre à la cantonade.
Doué d'un beau baryton, Bouhy tenait avec une distinction affectée le rôle d'Escamillo. Mlle Marguerite Chapuy, qui devait épouser, peu après, le général André, chantait d'habitude Rosine, du Barbier de Séville, et Rose de Mai, du Val d'Andorre. A Paris et à Londres, elle remportait de vifs succès dans les rôles à vocalises. Elle accepta, sans chaleur, de créer le rôle de Micaëla et lui prêta sa voix fraîche, caressante et bien conduite.
Avec Bouhy (Escamillo) et Mlle Chapuy (Micaëla), nous revenions aux personnages conventionnels du théâtre lyrique. Cela explique pourquoi ces deux chanteurs furent beaucoup plus applaudis que Galli-Marié et Lhérie.
Duvernoy et Dufriche, qui allaient prendre une place importante parmi les artistes de la troupe, jouaient avec talent les rôles de Moralès et de Zuniga. Sous les traits de Mercédès et de Frasquita, Mmes Esther Chevalier et Ducasse s'acquittèrent en perfection de leurs difficiles tâches musicales. Le gros comique Potel interprétait avec rondeur le rôle du Dancaïre et Barnolt (qu'on pouvait encore voir il y a une vingtaine d'années à l'Opéra-Comique), celui du Remendado.
Pendant l'orgie bohème du second acte, deux ballerines, Mlles Blandini et Ancke, exécutèrent avec brio une danse gitane, nettement caractérisée. Depuis, cette « orgie bohème » a été souvent augmentée de la Danse bohémienne de la Jolie Fille de Perth. Un directeur, porté à renchérir, a même cru bon d'ajouter un ballet espagnol au début du quatrième acte. Ces dernières années, un danseur et une danseuse sautillaient au rythme entraînant de la « Chanson bohème ».
Actuellement, à l'Opéra-Comique, une seule danseuse tournoie sur les couplets chantés par Carmen au commencement du deuxième acte. Sa danse ne rappelle nullement le « baile » d'Andalousie. Il serait nécessaire de rendre à cette scène son délire inquiétant et joyeux et de confier à deux ballerines, comme aux premières représentations, le soin d'interpréter les pas hardis et rapides de la danse gitane voulue par Bizet et ses collaborateurs. Ce coin de tableau, d'une couleur locale intense, reprendrait ainsi son infaillible efficacité d'évocation. Les indications des auteurs, en tête du deuxième acte, sont les suivantes : « Danse des bohémiennes, accompagnée par des bohémiens raclant de la guitare et jouant du tambour de basque. »
XXIX
VINCENT D'INDY A LA 1re REPRÉSENTATION DE CARMEN »
Le meilleur témoin que nous ayons de la première représentation de Carmen est Vincent d'Indy. Il s'était déjà glissé dans la salle pendant les treize répétitions qui avaient précédé. Il avait noté les luttes que Georges Bizet devait soutenir contre le metteur en scène Ponchard pour lui faire adopter les vues des auteurs.
Charles Ponchard avait été un chanteur en renom. Il fut même le premier chanteur qu'on eût décoré de la Légion d'honneur. A cette époque, il était professeur d'une classe de chant, au Conservatoire. Il appartenait à la vieille école lyrique dont il défendait les traditions avec une autorité que personne n'osait contester. Appelé à régler la mise en scène d'un opéra-comique aussi nouveau que Carmen, il ne voulait utiliser que les procédés conventionnels qui lui étaient familiers.
Bizet s'éleva avec raison contre ces façons de faire. Il avait d'interminables discussions avec Ponchard qui refusait d'écouter les avis exprimés par le compositeur. Vincent d'Indy remarqua qu'aux répétitions, Bizet voulait que les choristes entrassent, au premier acte, successivement, par deux ou par trois. Ponchard exigea, au contraire, une entrée massive des chœurs. Il obtint gain de cause. En qualité de directeur de la salle Favart, Camille Du Locle était dans l'obligation de prendre le parti du vieux professeur, gloire de l'Opéra-Comique, contre le jeune musicien exigeant et irrespectueux. Au lieu d'avoir trouvé en Ponchard un collaborateur, Bizet ne rencontra qu'un adversaire. Il est certain que Ponchard, dont les manières de voir étaient adoptées avec soumission par de nombreux disciples, par les artistes et les employés de la salle Favart, voire par les critiques, contribua, par ses propos malveillants, aux appréciations défavorables qu'on fit un peu partout de Carmen, au moment de la création.
***
Au dire de Vincent d'Indy, le personnel de l'Opéra-Comique, « depuis le directeur jusqu'au concierge », était prévenu contre le trop original musicien de Carmen. Chacun s'en détournait quand il apparaissait.
Vingt ans auparavant, Georges Bizet avait obtenu, au Conservatoire, dans la classe de Benoît, un premier prix d'orgue. A son retour de Rome, il avait renoué des relations amicales avec son vieux maître auquel il faisait visite dans l'établissement du faubourg Poissonnière.
Depuis 1872, Benoît avait été remplacé, dans sa chaire conservatoriale, par César Franck. Bizet continua de fréquenter la classe d'orgue. Il connaissait, du reste, César Franck, qu'il rencontrait aux séances de la Société nationale de Musique.
A cette date, le Conservatoire ne comptait que trois médiocres professeurs de composition : Victor Massé, Henri Reber et François Bazin. La classe d'orgue de César Franck devint, comme nous l'a appris Vincent d'Indy, « le véritable centre des études de composition du Conservatoire... Et c'est ainsi que, sans même s'en douter, le maître César Franck draina, pour ainsi dire, toutes les forces sincèrement artistiques qui se trouvaient éparses dans les diverses classes du Conservatoire... »
A première vue, rien de plus dissemblable que la musique de Bizet et celle de Franck. Pendant son séjour à la villa Médicis, Bizet déclarait déjà : « Que voulez-vous ? Je ne suis pas taillé pour la musique religieuse ! » Et la musique de Franck est presque toute d'essence religieuse. Mais, toujours avide de s'instruire, de s'élever, de se renouveler, Bizet devait se plaire parmi les disciples de Franck si prompts à s'enflammer. On peut penser que les leçons, marquées au sceau du caractère indépendant et généreux du musicien de Rédemption, ont eu une certaine influence sur le musicien de Carmen. On peut penser aussi que les contacts qui s'établirent entre les deux grands musiciens furent suivis d'effets sensibles sur leurs productions respectives. Pendant que Bizet rédigeait la partition de Carmen, Franck était dans le feu de la composition des Béatitudes. L'Andante du début de la Troisième Béatitude : Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés, écrit pendant cette période, n'a-t-il pas un accent nettement théâtral ? Et le jeu subtil et hardi des modulations auquel Bizet se livre dans la musique de Carmen ne dérive-t-il pas des principes posés par Franck ?
Fatalement et à leur insu, leurs génies devaient parfois déteindre l'un sur l'autre. Deux esprits en présence n'ont besoin ni de mots ni d'opérations visibles pour communiquer entre eux. Ils échangent leurs idées dans le silence ou hors des paroles qu'ils prononcent. Les âmes ont des colloques mystérieux et qui échappent à nos sens défectueux et grossiers.
Le matin même de la première représentation de Carmen, Georges Bizet revint dans la classe de César Franck, au Conservatoire. Il apportait trois billets, d'une place chacun, pour la soirée de l'Opéra-Comique. Pris de court, Franck ne pouvait assister au spectacle. Les trois billets furent tirés au sort entre les élèves présents. Camille Benoît fut ainsi favorisé d'une place. Vincent d'Indy se vit attribuer une autre place pour la première représentation de Carmen.
Vincent d'Indy a souvent raconté les incidents qui ont marqué cette soirée et combien il avait été révolté par l'indifférence des spectateurs à cette première audition d'une partition qu'il tenait pour un chef-d'œuvre. Au premier entr'acte qui avait duré plus d'une demi-heure, il sortit du théâtre avec ses camarades. Rue Favart, ils rencontrèrent Bizet, fort affecté par l'attitude du public et très inquiet sur l'avenir réservé à Carmen. Les jeunes musiciens abordèrent Bizet et lui dirent combien ils admiraient le premier acte qu'ils venaient d'entendre. Dans les jours qui avaient précédé, et au début de ce soir de première, on n'avait pas ménagé au compositeur de Carmen les réflexions désobligeantes. Il n'avait plus confiance dans le succès de sa nouvelle partition. Il répondit à Vincent d'Indy et à ses compagnons :
— Ce sont les premières bonnes paroles que j'entends et je crois bien que ce seront aussi les dernières.
Le 5 mars, quelques heures avant la seconde représentation de Carmen, Bizet fit une nouvelle apparition dans la classe de César Franck. Le ténor Lhérie n'arrivait pas à chanter juste « Halte-là ! Qui va là ? Dragons d'Alcala ? » qu'il devait entonner de la coulisse. Quand, l'avant-veille, en entrant en scène, il avait terminé fortissimo sur « Dragons d'Alcala ! », il avait baissé de deux tons ! Il fallait à tout prix quelqu'un auprès du chanteur pour lui indiquer le ton exact et l'y maintenir. A la grande satisfaction de Bizet, Vincent d'Indy accepta cette humble tâche. Pendant la première série de représentations de Carmen, chaque fois que l'œuvre de Bizet était affichée, l'élève de César Franck, installé derrière un portant, donnait sur l'harmonium des chœurs la note juste au chanteur.
Vincent d'Indy eut ainsi le loisir de pénétrer les particularités de la partition de Carmen qu'il ne cessa plus d'admirer. La plupart de ses camarades du Conservatoire avaient adopté les opinions dénigrantes qui circulaient sur Carmen. Il ne put jamais les faire revenir de leurs préventions. Trente-cinq ans plus tard, en publiant son livre sur César Franck, il écrivait : « ... La Carmen de Bizet, qui venait d'être représentée, ne trouvait pas grâce devant les mêmes juges, et je sais des élèves de classes de composition d'alors qui incriminaient cette partition de wagnérisme outrancier, tandis que d'autres se voilaient la face devant un aussi grossier sujet, criant très haut au scandale... (*) »
(*) César Franck, par Vincent d'Indy, dans la Collection des Maîtres de la Musique, pp. 229 et 230. (Félix Alcan, éditeur.)
***
Les propres collaborateurs de Bizet pour Carmen étaient, au début, très partagés de sentiments sur la valeur de la partition. Dans les Carnets de Ludovic Halévy, publiés par Daniel Halévy, l'état d'esprit de l'un des deux librettistes de Carmen est nettement indiqué. Ludovic Halévy écrit :
4 mars (1875). Hier soir, centième de la Boule (*) ; en même temps, première de Carmen.
16 mars. J'ai passé sur cette pièce, pendant les répétitions, par des impressions très diverses. D'abord la musique parut tourmentée, compliquée. Peu à peu, ces nuages se sont dissipés et les artistes ont commencé à voir clair dans toutes les choses délicates et originales qui remplissent cette curieuse et très originale partition. Tout le monde a subi, au théâtre, lentement, ce même charme. Les dernières répétitions ont été excellentes. Elles avaient pour public les gens de la maison, qui, tous, vivaient dans cette musique depuis trois ou quatre mois et qui avaient eu, par conséquent, le temps d'en pénétrer les beautés.
Nous étions pleins de confiance le soir de la première représentation. Mais, hélas ! il est évidemment arrivé au public ce qui nous était arrivé à nous-mêmes dans les premiers jours. Il nous avait fallu un peu de temps pour arriver à aimer et à admirer cette partition. Nous avons été tout d'abord plus étonnés que ravis. Telle a été l'impression évidente du public du premier soir. L'effet de la représentation a été incertain, indécis. Pas mauvais, mais pas bon non plus.
(*) L'une des comédies de Meilhac et Halévy qui ont obtenu un grand succès.
Dans ces lignes, griffonnées à l'époque de la création de Carmen, on trouve, franchement dépeint, le trouble provoqué par l'apparition de l'œuvre nouvelle. Très rares étaient les invités de la première représentation qui ont mesuré la valeur de la musique qui leur était révélée. Vincent d'Indy ne s'y trompa point. L'importance qu'il attachait au chef-d'œuvre de Bizet était telle qu'en 1905 il disait encore : « Je considère Carmen comme le point de départ de l'évolution actuelle de la musique dramatique en France. »
XXX
FRÉDÉRIC NIETZSCHE ET GEORGES BIZET
Dans la dernière période de sa vie, le grand philosophe allemand Frédéric Nietzsche avait pris violemment parti contre les doctrines wagnériennes qu'il avait autrefois admirées et prônées. Lié d'amitié avec Richard Wagner de 1868 à 1876, il avait rompu toutes relations avec l'auteur de la Tétralogie, à la suite de dissentiments qu'il n'y a pas lieu d'exposer ici.
En 1888, Frédéric Nietzsche fit paraître, chez l'éditeur Naumann, de Leipzig, le Cas Wagner, un problème musical, qu'il venait d'écrire à Turin et à Sils-Maria. Dans cette étude, il s'attaquait sur tous les points à Richard Wagner avec autant de fougue que de cruauté. « La musique de Wagner, écrivait-il, si on lui retire le secours du goût du théâtre, goût très endurant, est simplement de la mauvaise musique, la pire qui ait peut-être jamais été faite. »
A cette musique wagnérienne « d'un incomparable histrion », Nietzsche opposait la musique de Carmen dont il avait pleinement saisi le caractère lumineux et la nuance humaine. Ses réflexions sur le chef-d'œuvre de Bizet, qu'il avait exploré dans toutes ses parties, constituent la plus précieuse des préparations pour l'intelligence de la partition de Carmen.
Nietzsche entendit pour la première fois Carmen en 1881, à Gênes. Peu après, il écrivait à sa sœur : « J'ai entendu avant-hier un opéra, Carmen, d'un Français, Bizet, et j'en ai été bouleversé. C'est si fort, si passionné, si plein de charme, si méridional ! » Dans sa correspondance avec son ami Pierre Gast, il ne cesse de louer Carmen : « C'est le meilleur opéra qui existe, écrit-il, c'est l'opéra des opéras... Tant que nous vivrons, il restera au répertoire des théâtres d'Europe. »
Dans l'avant-propos du Cas Wagner, qui devait prendre place plus tard dans le Crépuscule des Idoles de ses « Œuvres complètes », Nietzsche déclare tout de suite : « Ce n'est pas par pure médisance que, dans cet écrit, je loue Bizet aux dépens de Wagner. » Le philosophe d'Humain, trop humain était trop difficile pour lui-même et d'une conscience trop exigeante pour laisser publier un texte qu'il n'eût pas mûri et qui n'eût pas été digne de lui. De plus, il était armé de connaissances musicales supérieures. Il avait longuement médité sur les grandes conceptions de la musique qui lui étaient familières. Il avait même formé à tous les exercices de la technique sonore son esprit extraordinaire en ses perspectives. On peut faire confiance à son jugement (*).
(*) Frédéric Nietzsche a composé lui-même plusieurs ouvrages de musique qui ne sont pas sans valeur : hymnes pour chœur et orchestre, pour chœur et piano à quatre mains, lieds, pièces pour piano à quatre mains, etc.
Les biographes de Georges Bizet n'ont cité que quelques courts fragments des commentaires que Nietzsche a faits de Carmen dans le Cas Wagner. J'ai recueilli, dans l'excellente traduction de ce livre par Henri Albert, les passages qui ont trait à Bizet (*). Je les reproduis ici.
(*) Le Crépuscule des Idoles (le Cas Wagner), par Frédéric Nietzsche, traduit par Henri Albert, Paris, éditions du « Mercure de France ».
Lettre de Turin. Mai 1888.
J'ai entendu hier — le croiriez-vous ? — pour la vingtième fois le chef-d'œuvre de Bizet. De nouveau j'ai persévéré jusqu'au bout dans un doux recueillement, de nouveau je ne me suis point enfui. Cette victoire sur mon impatience me surprend. Comme une œuvre pareille vous rend parfait ! A l'entendre, on devient soi-même un « chef-d'œuvre ». Et, en vérité, chaque fois que j'ai entendu Carmen, il m'a semblé que j'étais plus philosophe, un meilleur philosophe qu'en temps ordinaire : je devenais si indulgent, si heureux, si hindou, si rassis... Etre assis pendant cinq heures : première étape vers la sainteté ! Puis-je dire que l'orchestration de Bizet est presque la seule que je supporte encore ? Cette autre orchestration qui tient la corde aujourd'hui, celle de Wagner, à la fois brutale, factice et naïve, ce qui lui permet de parler en même temps aux trois sens de l'âme moderne — à quel point elle m'est néfaste, cette orchestration wagnérienne ! Je la compare à un sirocco. Une sueur contrariante se répand sur moi. C'en est fait de mon humeur de beau temps.
Cette musique de Bizet me semble parfaite. Elle approche avec une allure légère, souple, polie. Elle est aimable, elle ne me met point en sueur. « Tout ce qui est bon est léger, tout ce qui est di vin court sur des pieds délicats » : premier principe de mon Esthétique. Cette musique est méchante, raffinée, fataliste : elle demeure quand même populaire, — son raffinement est celui d'une race et non pas d'un individu. Elle est riche. Elle est précise. Elle contraint, organise, s'achève : par là, elle forme un contraste avec le polype dans la musique, avec la « mélodie infinie ». A-t-on jamais entendu sur la scène des accents plus douloureux, plus tragiques ? Et comment sont-ils obtenus ? Sans grimace ! Sans faux-monnayage ! Sans le mensonge du grand style ! — Enfin, cette musique suppose l'auditeur intelligent, même s'il est musicien, — et, en cela aussi, elle est l'antithèse de Wagner qui, quel qu'il soit quant au reste, était, en tout cas, le génie le plus malappris du monde.
... Et encore une fois : je me sens devenir meilleur lorsque ce Bizet s'adresse à moi. Et aussi meilleur musicien, meilleur auditeur. Est-il possible de mieux écouter ? — J'ensevelis mes oreilles sous cette musique, j'en perçois les origines. Il me semble que j'assiste à sa naissance — je tremble devant les dangers qui accompagnent n'importe quelle hardiesse, je suis ravi des heureuses trouvailles dont Bizet est innocent. — Et, chose curieuse, au fond ,je n'y pense pas, ou bien j'ignore à quel point j'y pense. Car des pensées toutes différentes roulent à ce moment-là dans ma tête... A-t-on remarqué que la musique rend l'esprit libre ? qu'elle donne des ailes à la pensée ?... Où suis-je ? Bizet me rend fécond. Je n'ai pas d'autre gratitude, je n'ai pas d'autre preuve de la valeur d'une chose.
L'œuvre de Bizet, elle aussi, est rédemptrice. Wagner n'est pas le seul « rédempteur ». Avec cette œuvre on prend congé du nord humide, de toutes les brumes de l'idéal wagnérien. Déjà l'action nous en débarrasse. Elle tient encore de Mérimée la logique dans la passion, la ligne droite, la dure nécessité ; elle possède avant tout ce qui est le propre des pays chauds, la sécheresse de l'air, sa limpidezza. Nous voici à tous les égards sous un autre climat. Une autre sensualité, une autre sensibilité, une autre sérénité s'expriment ici. Cette musique est gaie ; mais ce n'est point d'une gaîté française ou allemande. Sa gaîté est africaine ; la fatalité plane au-dessus d'elle, son bonheur est court, soudain, sans merci... J'envie Bizet parce qu'il a eu le courage de cette sensibilité, une sensibilité qui jusqu'à présent n'avait pas trouvé d'expression dans la musique de l'Europe civilisée, — je veux dire cette sensibilité méridionale, cuivrée, ardente... Quel bien nous font les après-midi dorés de son bonheur !... — Et que la danse mauresque nous semble apaisante ! Comme sa mélancolie lascive parvient à satisfaire nos désirs toujours insatisfaits ! — C'est enfin l'amour, l'amour remis à sa place dans la nature. Non pas l'amour de la « jeune fille idéale » ! Pas trace de « Senta‑sentimentalité » (*). Au contraire, l'amour dans ce qu'il a d'implacable, de fatal, de cynique, de candide, de cruel — et c'est en cela qu'il participe de la nature ! L'amour dont la guerre est le moyen, dont la haine mortelle des sexes est à la base ! Je ne connais aucun cas où l'esprit tragique qui est l'essence de l'amour s'exprime avec une semblable âpreté, revête une forme aussi terrible que dans ce cri de don José qui termine l'œuvre :
Oui, c'est moi qui l'ai tuée.
Carmen, ma Carmen adorée (**).
... Vous voyez déjà combien cette musique me rend meilleur ? — Il faut méditerraniser la musique : j'ai des raisons pour énoncer cette formule. Le retour à la nature, à la santé, à la gaîté, à la jeunesse, à la vertu !
(*) Nietzsche fait un jeu de mots sur le nom de Senta, l'héroïne exaltée du Vaisseau fantôme de Richard Wagner.
(**) La citation n'est pas tout à fait exacte. Les deux derniers vers de Carmen sont :
Vous pouvez m'arrêter... c'est moi qui l'ai tuée.
Ah ! ma Carmen ! ma Carmen adorée !
En ces quelques lignes de Frédéric Nietzsche, la partition de Carmen est sentie dans sa qualité profonde. Tous les points vifs en sont touchés avec une justesse infaillible, tous les degrés de beauté marqués d'une manière nette, définitive. Nietzsche ne se donne pas la peine de faire de la critique musicale en règle. Il se laisse aller à la liberté de ses impressions et de ses idées, avec des mobilités, des revirements d'artiste et de philosophe fiévreux. Il obéit au génie qui le possède. Grâce à quoi, il trouve le trait qui pénètre et démêle avec promptitude et comme en se jouant les points essentiels du chef-d'œuvre de Bizet.
A l'exception d'un ou deux critiques, tous ceux qui ont écrit de Carmen, au lendemain de la première représentation, se sont trompés lourdement sur le caractère de la musique de Bizet. Ils ont pris tout à faux la partition qui venait de leur être soumise. Contre toute évidence, ils ont prétendu que le musicien de Carmen était « un wagnérien de mauvais goût ». Depuis les Pêcheurs de perles jusqu'à Carmen — et y compris Carmen — Bizet traînait après lui l'accusation insoutenable d'être « plus wagnérien que Wagner ».
Arthur Pougin déclarait, quatre jours après la première représentation de Carmen : « Bizet, l'un des plus farouches intransigeants de notre jeune école wagnérienne... » Paul de Saint-Victor prétendait que Bizet était inféodé à « cette secte nouvelle... cette école dont M. Wagner est l'oracle... » Pierre Véron regrettait que le musicien de Carmen « se fût fourvoyé à la remorque d'un wagnérisme atrophiant ». Etc.
Dans le Crépuscule des Idoles, Nietzsche démontre de façon catégorique que l'art de Bizet est à l'opposé de l'art de Wagner et qu'ils s'accusent par contraste.
Georges Bizet, qui connaissait et admirait Wagner, n'était nullement wagnérien. Il s'en expliquait ainsi, dans une lettre à Mme Halévy, en date du 21 mai 1871 : « Il est bien entendu que, si je croyais imiter Wagner, malgré mon admiration, je n'écrirais plus une note de ma vie. »
On sent le prix du suffrage enthousiaste du philosophe allemand. Et le prix de son témoignage qui précède tous les témoignages faits depuis à la barre de l'histoire de la musique. Témoignage de choix qui va à l'adresse de l'avenir et qui a influé de façon décisive sur les opinions exprimées plus tard. Habitué à évoluer sur les hautes cimes de la pensée, Frédéric Nietzsche dépasse royalement ceux qui se sont mêlés d'expliquer l'œuvre de Georges Bizet. Il arrache le sens vif de Carmen et en révèle, dans leur étendue, l'action libératrice et féconde, la beauté riche de vérité humaine.
A présent, on sait en France... aller au-devant de ces méditerranéens nés, de ces bons Européens. C'est pour eux que Bizet a écrit de la musique, Bizet, le dernier génie qui ait vu une nouvelle beauté et une nouvelle séduction, Bizet, qui a découvert une terre nouvelle : le midi de la musique (*).
(*) Par delà le bien et le mal, par Frédéric Nietzsche, traduit par Henri Albert, p. 283, Paris, éditions du « Mercure de France ».
Dans le tribut de gratitude et d'admiration que Nietzsche a payé à la mémoire de Bizet, certains critiques n'ont voulu voir que le désir d'opposer, par vengeance et rancune, un rival à Richard Wagner. Nietzsche a précisé qu'il avait assisté à vingt représentations de Carmen. Sa sentence est fondée sur une étude attentive et poussée du chef-d'œuvre. C'est un arbitre qui en juge à coup sûr et avec une entière compétence. C'est peut-être grâce à cette critique d'où percent des lueurs étranges (texte sur lequel Nietzsche a apposé sa griffe), que le chef-d'œuvre de Bizet s'est relevé entièrement devant l'élite et devant la postérité.

HORDE DE BOHÉMIENS ÉTABLIS DANS LES VOSGES.
Aquarelle peinte par Mérimée d'après nature, au cours d'une « visite » qu'il fit aux Bohémiens. (Collection du Dr M. Parturier.) Le sujet et les personnages de cette aquarelle sont exactement décrits par Mérimée dans la dernière partie de sa nouvelle Carmen, pages 89 et 90 de l'édition Calmann-Lévy.
SIXIEME PARTIE
LA PARTITION
XXXI
« CARMEN » ET LA MUSIQUE ESPAGNOLE
Après les bouleversements de la technique musicale qui se sont produits depuis soixante-quinze ans, après les partitions explosives de chercheurs et de novateurs plus ou moins heureux, Carmen conserve son attrait de nouveauté, sa séduction originale qui s'exercent même sur nos compositeurs d'avant-garde. Igor Stravinsky, chef de file des musiciens modernes, n'a-t-il pas placé Georges Bizet en tête de toute la musique française ?
Carmen reste semée de surprises pour les musiciens les plus inventifs et les plus séditieux. On n'a pas fini d'en dénombrer les finesses de détail, les ingéniosités, les vivacités, les trouvailles ni les audaces. Ceux qui se sont appliqués à analyser cette partition de pleine réussite se sont trompés à son apparente facilité de moyens, à sa netteté de lignes, à sa structure d'opéra-comique convenu, à sa signification.
Pour peu qu'on l'explore dans ses sentiers secrets, on est étonné de voir combien le compositeur de Carmen est, sous cette simplicité, hardi et profond. Au lieu de copier sagement les modèles à succès, comme il avait fait à ses débuts, il a ses formules à lui — des formules qui piquent par l'imprévu et l'ingénieux. Dans son infidélité, permanente et méditée, aux règles et aux traditions, se mêle, dirait-on, un coin de gageure. A-t-il le pressentiment de sa fin et que Carmen est sa dernière œuvre ? Il y enferme tout ce qu'il a en lui d'émancipé, de spontané, d'original. Il joue son va-tout.
Pourtant il n'a aucun désir de faire étrange. Chacune de ses innovations correspond à une pensée sincère. Il a longuement fouillé les caractères de ses personnages. Il s'applique à les décrire, en toute franchise, avec sa musique.
Carmen et don José sont totalement étrangers aux faux héros qu'on a l'habitude de voir dans le répertoire lyrique courant. Impossible de leur prêter le langage sucré, stéréotypé ou ampoulé dont on usait dans les ouvrages qui tenaient l'affiche. Pour rendre musicalement ces figures encore inconnues à la scène lyrique, une technique neuve était nécessaire. Pour dépeindre harmoniquement la gitane, ivre de sa liberté, il fallait un art affranchi de contraintes théoriques.
Lorsque Bizet a eu à traiter des sujets conventionnels comme les Pêcheurs de perles ou la Jolie fille de Perth, dont il critiquait lui-même les platitudes et les boursouflures, pouvait-il faire autrement que de se servir de procédés rebattus et de se conformer au système proposé par les poèmes ? Il en fut différemment quand il eut entre les mains des œuvres frémissantes de vie et de passion comme l'Arlésienne et Carmen. Dans sa partie, il devait aller aussi loin que Mérimée et Alphonse Daudet et, comme eux, paraître clair, naturel et sobre. Dans les premiers livrets qu'il a traduits en musique, il n'a trouvé ni des stimulants ni l'étincelle qui eussent allumé sa propre ardeur et réveillé son génie.
Encore de nos jours, on est trop tenté de voir dans Carmen le compositeur des Pêcheurs de perles ou de la Jolie fille de Perth. Si bien intentionnés qu'ils soient, les critiques continuent de considérer Bizet comme un praticien de marque, non comme un artiste d'exception. Ils s'en réfèrent à sa correspondance et ses travaux de jeunesse pour déclarer que son esprit était de peu d'envergure, sa sensibilité banale, son goût faible. A son début de carrière, Beethoven lui-même ne pouvait être reconnu comme un musicien de génie et il fallait attendre ses chefs-d'œuvre de la maturité et ses derniers Quatuors pour être saisi de sa puissance orageuse et de sa souveraineté incontestée. A son rang, Georges Bizet ne donne sa mesure et ne jette tout son feu que dans ses deux partitions de la fin.
***
Des compositeurs et des critiques modernes prétendent que Bizet s'est attaqué avec imprudence à la musique espagnole qu'il ne pouvait connaître, en son temps, parce qu'il n'avait fait aucun voyage au delà des Pyrénées pour se documenter. Bizet n'avait pas besoin d'aller jusqu'en Espagne pour se renseigner sur la musique andalouse.
Après la répression sanglante de 1823, nombre de réfugiés espagnols vivaient à Paris. Ils y avaient transporté leurs coutumes, leurs chants et leurs danses populaires. Parmi eux, se trouvaient des musiciens comme Arriaga, Tintorer, Libon, Miro, Salvador Daniel (*) qui avaient fait leurs études au Conservatoire de Paris. Ne remontons pas jusqu'à Francisco Javier Garcia, Ferdinand Sor, dont deux ballets avaient été exécutés à l'Opéra de Paris, José Melchior Gomis, joué au Théâtre Ventadour et à l'Opéra-Comique, voire jusqu'à Manuel Garcia, compositeur, ténor, directeur de théâtre et professeur de chant. Manuel Garcia était le père des fameuses cantatrices Malibran et Pauline Viardot. La Malibran chantait souvent dans les salons, en s'accompagnant elle-même à la guitare, des polos, des soleares, des cañas. Quant au fils de Garcia, il avait été professeur de chant au Conservatoire de Paris jusqu'en 1852. De nombreux recueils de romances espagnoles avaient été publiés par les éditeurs Troupenas, Meissonnier, Pacini et d'autres. De longue date, le public parisien était familiarisé avec les danses espagnoles. A l'Opéra même, sous la Monarchie de juillet, Fanny Elssler, Manuelita Dubuisson, Dolores Seral, les sœurs Fabiani exécutaient des cachuchas, fandangos, boleros et zapateados.
(*) Le fils de Salvador Daniel était un spécialiste de la chanson populaire. Il prit part au mouvement insurrectionnel de la Commune de Paris, en 1871.
L'impératrice Eugénie de Montijo avait attiré à Paris plusieurs de ses compatriotes qu'elle couvrait de sa protection. Dans sa jeunesse, Bizet a dû connaître Pedro Escudero qui était professeur d'alto et de violoncelle au Conservatoire de Paris, les compositeurs espagnols Miguel Terramorell, mort en 1871 à Paris, Salvador Sarmiento qui avait fait jouer Guillery le trompette au Théâtre-Lyrique et qui est mort aussi à Paris en 1869, Trinidad Huerta y Catula qui s'est également éteint à Paris en 1873, José de Cicha, auteur d'un opéra en trois actes représenté pour la première fois au Théâtre-Italien, Jaime Bosch, professeur de guitare à Paris, etc... La cantatrice Rosine Stolz était née à Madrid d'un père espagnol.
En 1852, François Gevaert avait fait paraître un important Rapport sur la musique en Espagne où il étudiait le folklore ibérique. Rapport qui, plus tard, n'avait pas dû échapper à l'attention de Bizet, non plus que l'Ouverture-fantaisie sur des airs nationaux espagnols du même Gevaert que le compositeur de Carmen considérait comme « un immense musicien, éclectique... » Il me semble difficile, d'autre part, que le musicien de Carmen eût ignoré l'ouvrage capital que don Serafin Estebañez Calderon, grand ami de Mérimée, avait écrit dès 1832 sur les danses et chansons populaires d'Andalousie.
Bizet avait trop de scrupules de conscience pour ne pas s'entourer de tous les documents souhaitables ni s'en éclairer. Il avait à sa disposition les nombreux albums d'airs espagnols publiés en France. Il avait même pu assister aux représentations de danseuses valenciennes, de chanteurs et d'acteurs castillans venus jouer à Paris leurs zarzuelas, bailes et comedias harmonicas. Pour l'Arlésienne, il avait recueilli quelques motifs dans le folklore provençal. Dans certaines pages de Carmen, il ne s'est pas défendu d'user des formes musicales populaires d'Andalousie. Signalons que, dans les anciennes éditions de Carmen, on trouve, au bas de la page où est gravé le début de la Habanera, cette note : « Imitée d'une chanson espagnole. Propriété des Editeurs du Ménestrel. »
***
Il est curieux d'observer que les trois principaux interprètes de Don César de Bazan de Massenet, Galli-Marié, Lhérie et Bouhy devaient être, deux ans et demi plus tard, les créateurs de Carmen. Don César de Bazan avait été représenté pour la première fois, à l'Opéra-Comique, le 30 novembre 1872, environ six mois après la première de Djamileh. L'un des personnages importants de l'œuvre de Massenet est la bohémienne Maritana. Un autre personnage est nommé, dans la distribution, don José. L'entr'acte qui fut le plus applaudi est intitulé Sevillana. Peu de temps auparavant, Massenet avait fait exécuter ses Scènes pittoresques dont le passage dominant est la Fête bohême. On pourrait croire que ces ouvrages ont influé sur l'esprit de Bizet. Non. Ces musiques de Massenet n'ont qu'un rapport des plus lointains avec la partition de Carmen.
Depuis le romantisme, écrivains et musiciens subissaient, comme au début du XVIIe siècle, l'empreinte de l'hispanisme. La liste est trop longue des œuvres inspirées, à partir de 1830, par l'Espagne. Notons que, sept ans après la publication de la nouvelle de Mérimée, Théophile Gautier intitulait encore l'une de ses poésies Carmen et faisait paraître son Voyage en Espagne (*). Après une tournée de concerts dans la péninsule ibérique, Franz Liszt avait composé son Rondo sur un thème espagnol et sa Rhapsodie espagnole. Mieux encore, Liszt avait fait paraître une importante étude sur les Bohémiens et leur musique, qui était, disait-on, de la main de la princesse de Sayn-Wittgenstein. Bizet avait dû prendre connaissance de ces ouvrages du célèbre virtuose. Alors qu'il était encore élève de la classe de composition, au Conservatoire, il avait été présenté, dans le salon d'Halévy, au maître hongrois qui avait été surpris par la mémoire musicale et par le talent pianistique de son jeune confrère.
(*) Les six strophes, vives et colorées, de Carmen se trouvent dans Emaux et Camées et commencent ainsi :
Carmen est maigre, — un trait de bistre
Cerne son œil de gitana.
Ses cheveux sont d'un noir sinistre.
Sa peau, le diable la tanna.
En 1875, l'année même de la création de Carmen, Massenet faisait paraître la Sarabande espagnole et Edouard Lalo la Symphonie espagnole.
***
Georges Bizet pouvait donc puiser aux plus sûres sources d'information sur la musique espagnole et la musique tsigane. S'il s'en est nourri, il en a merveilleusement assimilé les sucs et les substances. N'attachons pas d'importance au fait qu'il s'est servi, tour à tour, de la musique espagnole teintée d'italianisme et de la musique espagnole dérivée du chant arabe. Sauf en certains passages, les éléments constitutifs de son chef-d'œuvre lui sont pourtant personnels et ont été prélevés sur son propre fonds. Ceux qui lui reprochent de ne pas avoir assez fait flamber la couleur locale sévillane oublient que les deux principaux personnages de Carmen ne sont pas originaires de l'Andalousie. Carmen est d'une tribu tsigane et don José du pays basque. On verra plus loin que, beaucoup plus subtil que tous les commentateurs de Carmen, Bizet s'est discrètement aidé, dans sa partition, des formes des musiques gitane, espagnole, voire basque (*).
(*) Peut-être Bizet a-t-il eu aussi connaissance des Cantos españoles que le folkloriste Ocon avait fait paraître au début de 1874.
Mozart, que Bizet avait en adoration et qu'il relisait sans cesse, ne s'est pas beaucoup préoccupé de la couleur locale espagnole dans les Noces de Figaro ni dans Don Juan. Pour Fidelio et le Barbier de Séville, qui se passent aussi en Espagne, Beethoven et Rossini en avaient agi de même. Sans en charger sa mémoire, Bizet a fait usage du chant flamenco dans certaines parties de sa Carmen. Il ne pouvait s'en dispenser. Meilhac et Halévy avaient situé leur livret à Séville et à Ronda, qui étaient justement, alors, les deux grands centres du chant flamenco.
De toute évidence, Bizet était instruit des formes de la musique espagnole. Il en connaissait les chants, les danses populaires et les zarzuelas, entremeses et tonadillas. S'il n'en a pas davantage utilisé les ressources, c'est parce qu'il n'avait pas le dessein d'écrire un divertissement pour amateurs d'hispanisme. Le pittoresque extérieur l'intéressait beaucoup moins que le conflit d'âmes. Il s'est surtout appliqué à traduire les sentiments de ses personnages, en établissant des correspondances aussi directes et aussi fidèles que possible entre la musique et le drame humain. En greffant son art sur l'art de Mérimée, il était décidé à sauvegarder son originalité, tout en se rattachant au style des grands maîtres qui l'avaient précédé.
***
Carvalho avait eu, le premier, l'idée de tirer un opéra-comique du récit de Mérimée et d'en demander la musique à Georges Bizet. C'est Camille Du Locle qui devait mettre le projet à exécution. Il s'engageait, trois semaines après la première de Djamileh — qui n'avait pas été un succès — à monter Carmen dont le scénario venait de lui être soumis par Meilhac et Halévy. Le 17 juin 1872, Bizet écrivait à son élève Galabert : « On vient de me commander trois actes à l'Opéra-Comique. Meilhac et Halévy font ma pièce. Ce sera gai, mais d'une gaieté qui permet le style. » Et il annonçait la même nouvelle à un ami, en ajoutant qu'il « traiterait aussi serré que possible » le livret fourni par Meilhac et Halévy.
Il se tient parole. Les échecs de Djamileh et de l'Arlésienne ne l'ont pas découragé. Il ne reviendra pas en arrière. Forcé d'emprunter le moule du vieil opéra-comique, il le fera crever de toutes parts. Comme il l'a confié à Guiraud, « il en élargira et en transformera le genre ».
Si, à son retour de Rome, il avait consenti à flatter le mauvais goût de la clientèle du Théâtre-Lyrique et s'il avait ainsi recherché un succès d'argent, c'était pour venir en aide à ses parents dans la gêne. Son « petit plan » n'avait pas réussi. Sa mère était morte à la tâche. Il était resté pauvre et travaillait plus dur que jamais pour subsister. A quoi bon refaire ce que d'autres musiciens ont déjà fait ? Des Pêcheurs de perles, il disait à Galabert : « ... la forme laisse à désirer. Sans forme pas de style et sans style pas d'art. »
C'est avec la volonté de libérer et de soigner la forme qu'il entreprend la composition de Carmen. Depuis quelques années, de nouvelles et vives lumières lui étaient venues sur son art. Il implantera le style dont il rêvait entre ses percées vers le classicisme. Il se propose surtout d'introduire dans l'œuvre qu'il commence sa plus forte dose d'invention. Sans cesse, il se répète tout bas : « Imiter est d'un sot. Il vaut mieux faire mauvais d'après soi-même que d'après les autres. » Sa partition de Carmen sera marquée au coin de son individualité, maintenant puissante.
***
La qualité d'inspiration ni l'originalité de forme ne sont venues brusquement à Bizet, au moment de ses trois partitions majeures : Jeux d'enfants, l'Arlésienne et Carmen. Dans ses lettres à Galabert, on voit poindre, dix ans avant Carmen, son esprit de rénovation, sa rupture avec l'académisme, son dédain des décences d'école, les naissantes particularités du système qu'il adoptera.
Voici quelques principes que je détache des leçons qu'il donnait, par correspondance, à Edmond Galabert, entre 1865 et 1869. Des leçons qui révèlent son intelligence admirable pour la conduite et la composition d'une partition de théâtre, autant que sa préoccupation constante de l'expression purement musicale et strictement appropriée.
« Tâchez que vos syncopes fassent dissonance le plus souvent possible. »
« Lancez-vous, tâchez d'arriver au pathétique, évitez la sécheresse, ne faites pas trop fi de la sensualité... Songez à Mozart et lisez-le sans cesse. Munissez-vous de Don Juan, des Noces, de la Flûte, de Cosi fan tutte. »
« Pas de frottements, pas d'unissons, que tout cela ait l'air facile. C'est là, la véritable difficulté. »
« Des dissonances tant que vous pourrez... Des dissonances avant tout... Ne perdez aucune occasion d'introduire des dissonances, les retards enrichissent l'harmonie. »
« C'est trop cherché, pas assez clair, pas assez simple. Préoccupez-vous de la bonne note... Cherchez la bonne harmonie. C'est le moyen de trouver l'harmonie élégante, distinguée.
« C'est mou, ça. Ce n'est pas net d'harmonie. Ce n'est pas suffisamment musical. »
Quand Bizet et Guiraud participèrent au concours d'opéra-comique avec le livret imposé, la Coupe du roi de Thulé, Bizet envoya un exemplaire du poème à Galabert qui devait, de son côté, écrire la musique de cet opéra-comique et lui soumettre son travail. Les observations que Bizet fit à son élève sur les pages qui lui étaient adressées sont d'un vif intérêt. Dans les annotations, que j'extrais ici, perce déjà le musicien de Carmen.
C'est, selon moi, une courtisane antique. Le côté chatte n'a pas été suffisamment indiqué par les librettistes c'est au musicien à réparer cette faute... Tout en laissant dominer l'amour d'Yorick, il faudrait là un dialogue, pour les deux caractères à l'orchestre...
Appelez l'inspiration, elle viendra. Il ne s'agit plus d'études de caractères ; il faut exprimer cet état maladif, nerveux qui s'appelle l'amour. De la fantaisie, de l'audace, de l'imprévu, du charme, surtout, de la tendresse, de la morbidezza !
Soyez musical, surtout. Faites de la jolie musique. La rêverie, le vague, le spleen, le découragement, le dégoût doivent être exprimés comme les autres sentiments par des moyens solides. Il faut toujours que ce soit fait... En art, il ne s'agit pas d'aller vite... Ne vous occupez pas d'autre chose que de sentir et d'exprimer.
Dans l'observation suivante, faite par Bizet sur la copie de son disciple, on sent déjà bouger l'ombre de la Carmen future :
Si vous aviez eu à peindre avec la plume, vous auriez fait le contraire de ce que vous m'envoyez. Cette Myrrha est une courtisane... Dans ses yeux, il doit y avoir cette expression glauque, indice certain de sensualité et d'égoïsme poussés jusqu'à la cruauté.
Enfin, ces conseils, entre beaucoup d'autres que je ne puis signaler :
Si vous faites là une phrase commençant par la tonique, vous vous tromperez. Il faut une idée incidente mais importante. C'est difficile, très difficile. J'en sais quelque chose... A la deuxième strophe, un dessin aux violoncelles, aux altos, une gamme chromatique serpentant à travers l'orchestre : l'astuce, la cruauté, la bassesse, etc...
Que de gammes chromatiques de cette espèce « serpentant à travers l'orchestre » de Carmen !
Les lignes qui précèdent suffisent à démontrer que Bizet ne composait pas « d'intuition », comme l'a écrit Raoul Laparra. Qu'il étudiait dans le détail et avec d'infinis scrupules de conscience les livrets, avant de les traduire en musique. Qu'il en pénétrait jusqu'aux intentions les plus cachées et les plus fugitives. Qu'il lui arrivait de donner aux sujets qu'il avait à traiter des significations étendues et profondes auxquelles ses librettistes eux-mêmes n'avaient pas songé.
En outre, il apparaît clairement qu'aussitôt après les Pêcheurs de perles, Bizet allait au delà des doctrines établies. Que sa musique n'était plus nourrie aux traités d'harmonie ni de composition mais aux fontaines des sentiments, aux sources de la vérité et de la vie. Qu'il était à la conquête de modes d'expression modernes. Qu'il préparait de longue main les réformes qu'il a apportées au drame musical.
Dans l'examen critique qui va suivre, nous verrons comment Georges Bizet a fait entrer dans la musique de Carmen la révolution qu'il méditait.
***
A la fin de l'année 1888, Nietzsche avait offert, en cadeau, à son ami Pierre Gast, une partition de Carmen. En marge, il avait inscrit au crayon de nombreuses remarques, toutes élogieuses, pour justifier le goût extrême qu'il avait pour le chef-d'œuvre de Bizet. Sept ans avant de publier le Cas Wagner, il indique l'admiration qu'il a pour « la ligne ravissante de la mélodie » de Bizet, pour son orchestration souple, vive, pittoresque, riche et si différente de celle de Wagner (*).
(*) L'effectif de l'orchestre pour Carmen était, à l'Opéra-Comique, pour les premières représentations, de soixante-deux musiciens répartis de la façon suivante : deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes, deux bassons, quatre cors, deux pistons, trois trombones, trois instrumentistes à la batterie (timbales, caisse claire, tambour de basque, grosse caisse, cymbales, triangle, et, s'il y a lieu, castagnettes), deux harpes, dix premiers violons, huit seconds violons, six altos, six violoncelles, cinq contrebasses et, pour la fanfare de coulisse, trois trombones et deux pistons. L'instrumentation de Bizet, aux couleurs magistralement distribuées, est une merveille d'agencement et d'équilibre entre l'orchestre et les voix.
Cette partition, avec les brefs commentaires du grand philosophe, se trouve aux Archives Nietzsche. Pour toute analyse de la musique de Carmen, on doit désormais consulter ces notes marginales de Nietzsche.
XXXII
Ainsi que nous l'avons vu, Georges Bizet était en possession du scénario et d'une partie du livret de Carmen depuis le mois de juin 1872. Grâce à l'une de ses lettres adressées à Paul Lacombe, nous sommes informés que la musique du premier acte n'en avait été achevée qu'à la fin du mois de mai 1874. Pendant ces deux années, la pensée du compositeur avait été absorbée par son nouvel ouvrage qui ne devait, à l'origine, comporter que trois actes.
Nous sommes instruits de la façon de composer de Bizet et de sa mémoire stupéfiante. Sa partition était agencée, notée dans sa tête, avant d'être écrite. Le manuscrit en devait être prêt, par contrat, au début d'août 1874. Il était convenu que les études commenceraient à cette date et que la première représentation serait donnée quatre mois plus tard. Il fallut doubler le nombre de répétitions prévues, tant l'œuvre était criblée de difficultés. La création n'eut lieu, comme on sait, que le 3 mars 1875.
Depuis le début de 1874, Bizet travaillait nuit et jour à la musique de Carmen, déjà arrêtée dans son esprit. En une tension de tout son être, il la reportait d'affilée sur le papier, après l'avoir ruminée, triturée pendant deux ans. En deux mois à peine, il avait achevé les 579 grandes pages de la lourde partition d'orchestre.
Pour être tracée au net, la musique du premier acte n'a pas exigé moins de cinq mois. C'est, en effet, l'acte le mieux préparé, le plus varié, le plus ciselé du chef-d'œuvre. Par des notations subtiles, mais qui paraissent très simples, le compositeur a fait renaître l'atmosphère ensoleillée de l'Andalousie et campé ses personnages dans les milieux où l'action s'engage.
Avec l'Arlésienne, Bizet avait créé la forme de la musique de demi-caractère. Forme à la fois claire et originale, où le plaisant se mêle au tragique. Forme dans laquelle il allait désormais couler ses partitions destinées au théâtre et, d'abord, la partition de Carmen.
Comme l'Ouverture-prélude de l'Arlésienne, le Prélude du premier acte de Carmen comprend trois motifs qui se succèdent : la « Marche du défilé de la cuadrilla » qui correspond à la « Marche de Turenne » de l'Arlésienne ; le refrain de l'Air du toréador qui désigne Escamillo et qui remplace le motif mélodique de l'Innocent ; le thème de la fatalité ou thème de la bohémienne Carmen qui est de la même veine que le thème de la mystérieuse Arlésienne.
De la « Marche du défilé de la cuadrilla » qui ouvre le drame lyrique, Nietzsche a dit que c'est « un magnifique tapage de cirque ». Cette Marche nous invite aux jeux grisants et sanglants de l'arène, où l'on n'immole pas seulement des animaux mais aussi des hommes. Ecrite en la majeur et à 2/4 comme la plupart des danses et chants populaires d'Espagne et du pays basque, mais avec des accidents, des brisures, des altérations, — modulations dans les tons éloignés, harmonies inopinées, — est-elle aussi triviale qu'on l'a dit ? Je ne le pense pas. Pour dépeindre l'agitation joyeuse de la foule avant une corrida et la corrida elle-même, Bizet ne pouvait pas mieux choisir.
L'action de Carmen n'est-elle pas aussi une corrida, une lutte tragique entre deux forces libérées et cruelles, entre deux passions humaines aveugles ? Ne ressemble-t-elle pas à une sorte de tauromachie de l'amour charnel, où l'animal ébloui et furieux est figuré par don José et l'espada, par la zingarella, — avec ses feintes excitantes et ses ruses diaboliques ? Dans leur escrime étincelante et dangereuse, les adversaires s'épuisent et trouvent, tous deux, la mort.
Le public théâtral qui, aux fausses lumières des rampes et des projecteurs, assiste, mélangé et vibrant, à la mise à mort de Carmen, est, en définitive, le même public qui se presse brutal, exalté ou jubilant, sur les gradins d'une arène brûlée de soleil, pour juger si c'est dans les bonnes règles qu'une bête farouche est provoquée, harcelée, blessée et immolée. A l'un et à l'autre de ces publics convient l'Allegro giocoso, au rythme rapide et franc de 2/4, que Bizet a placé au début de sa partition pour mettre en branle le spectacle, et les spectateurs (*) en état de réceptivité.
(*) Il est inutile de donner, dans cette étude, le graphique musical des thèmes de Carmen qui chantent dans toutes les mémoires.
Le deuxième motif du Prélude de Carmen, également d'un rythme binaire de marche, est le refrain des Couplets qu'Escamillo chante — « légèrement et avec fatuité », selon les indications de Bizet — au deuxième acte. Le refrain qui sert à caractériser le toréador éclate ici, aux bois et aux cordes, sur le martèlement des cuivres, après une montée en tierces de l'orchestre. Apparition dominante et vite envolée du héros de la fête populaire, suivie de la reprise de la « Marche pétillante de la cuadrilla » qui est interrompue net par un silence.
Les clarinettes en la, les bassons, les pistons et les violoncelles font alors retentir, à 3/4, le troisième et dernier motif du Prélude. Motif de cinq notes qu'on a appelé motif du destin et qui est aussi l'image sonore, trouble et fugace, de la gitanilla démoniaque, attirante et fataliste. (Le motif du destin de la Ve Symphonie de Beethoven, auquel il a été comparé, n'est que de quatre notes.) Sorte de leitmotiv qui n'est pas développé symphoniquement comme ceux de Wagner, mais qui traverse toute la partition. A chacun de ses rappels, il se transforme selon les états d'âme de la bohémienne ou de don José, et selon les besoins des diverses situations du drame. D'après Nietzsche, c'est une « épigramme sur la passion, ce qu'on a écrit de plus fort à ce sujet, depuis Stendhal ».
Ce thème principal, qu'on est tenté de nommer thème conducteur, est caractérisé par un curieux intervalle de seconde augmentée qui marque comme une séparation et une brisure du groupe de croches centrales qui devraient se suivre dans l'ordre.
On découvre ici les soins ingénieux et constants avec lesquels Bizet a édifié son œuvre. L'intervalle de seconde augmentée est caractéristique de la gamme usuelle des violonistes tsiganes qui comprend deux de ces intervalles : mi bémol-fa dièse et la bémol-si.
Ainsi la zingarella, visage de la passion et de la fatalité, est évoquée par une imprécation prophétique, par une menace continue de la fortune adverse, par une formule incantatoire, par une espèce de paralipse mélodique et gémissante où l'on retrouve les secondes augmentées de la gamme tsigane. Thème énoncé dans le dialecte musical qui appartient en propre à la race de Carmen. Race ténébreuse et vouée à la magie primitive.
L'étude analytique de la partition démontre aux esprits attentifs que les touches de couleur locale, habilement distribuées par le compositeur, proviennent moins de la musique espagnole que des complaintes tsiganes et, si l'on veut, du canto jondo. Carmen est, en effet, une zingara et doit se mouvoir dans l'ambiance des nomades visionnaires et lascifs de sa tribu.
Bizet a été jusqu'à adopter le chromatisme, les tons mineurs, le rythme brisé ou syncopé des tsiganes et, pour le Chœur des cigarières, la mesure à 6/8 qui est la mesure habituelle de la cantilène tsigane et du chant flamenco. Les musiciens tsiganes ignorent, pour la plupart, les règles de la composition ou, quand ils en sont instruits, n'en tiennent aucun compte pour exprimer fidèlement les sentiments qui les agitent. A leur exemple, Bizet a paru négliger, de parti pris, les préceptes de la technique musicale, qu'il connaissait dès l'enfance, pour traduire, en franchise et avec justesse, les passions de ses personnages.
Tout au long de la partition, il a plaqué des agrégats sonores neufs, attaqué les accords sans préparation, incrusté les successions rares, laissé des dissonances sans les résoudre, modulé dans les tons lointains et imprévus, suivi les sentiers de traverse, sans vouloir revenir sur le chemin tonal recommandé par la syntaxe harmonique.
Par cette indécision tonale, intelligemment entretenue, par ces discordances produites et amenées là où elles étaient nécessaires, Bizet entendait traduire non seulement les désordres de ses héros atteints d'une passion mortelle mais aussi l'instinct de l'évasion, toujours inassouvi, et l'humeur vagabonde de la gitane déracinée qui ne pouvait se fixer ni à un seul amour, ni dans une contrée particulière, ni dans les murs d'une demeure, parmi d'autres hommes sociables. Ce qui allèche Carmen c'est de passer ses nuits sous la tente, dans des régions désertiques et sans cesse nouvelles ; c'est de vivre à l'aventure, sous le vent du péril, dans l'incohérence et le crime. Voilà ce que Bizet a rendu dans sa partition lumineuse, hardie et plus inspirée par la nouvelle de Mérimée que par le libretto de Meilhac et Halévy.
Sur sa musique, d'un accent français typique et facilement reconnaissable, Bizet a greffé des scions de sauvageons de musique tsigane et de musique espagnole. Scions qui se sont si intimement mêlés au « sujet » que la floraison sonore semble éclose d'une souche unique et intacte. Il a repris à son compte le mépris des règles harmoniques que montrent les tsiganes dans leurs chants. La nature même du drame qu'il avait à traiter symphoniquement obligeait le musicien à renoncer aux doctrines traditionnelles et à les remplacer.
Les critiques de la première représentation de Carmen et ceux qui leur ont succédé n'ont pas compris pour quelles raisons parfaitement valables Bizet s'était écarté du code des sonorités. Certains d'entre eux, irrités par cette liberté d'écriture et vains de leur science superficielle, ont voulu en remontrer à Bizet qui, à l'époque, était probablement le compositeur le plus savant en son art. De leur côté, les musiciens, cramponnés aux conventions et encore plus sourds et plus aveuglés que les critiques, dénonçaient avec imprudence, avec acharnement, les « fautes de technique » commises par ce technicien hors ligne qu'était Bizet.
A la fin du Prélude, Bizet mettait le comble à ses infractions successives aux règles. Après avoir répété par trois fois le thème bizarre du destin, après s'être fourvoyé dans des tonalités éloignées et hostiles, il ne revenait pas au ton obligé du début et terminait sur un accord de septième diminuée, brusquement assené par tout l'orchestre. Accord qu'on retrouvera au cours du drame comme un bref leitmotiv comme un signe d'orage et de dévastation.
Dans ce Prélude de Carmen, le musicien venait de nous esquisser le tableau de la foule sévillane en effervescence, avant la course de taureaux, et de présenter l'image du fameux matador Escamillo. Il venait aussi de nous annoncer rapidement, mais avec force, le drame auquel nous allions assister. Pourquoi avait-il arrêté son exposition sur cet accord intempestif, malsonnant et ravageur ?
Le grand musicien voulait-il nous faire sentir que la tragédie latente bougeait sous le clinquant de la corrida qui mettait en liesse le peuple et en réveillait les instincts sanguinaires ? Pensait-il, avec cette conclusion abrégée, étouffante et brouillée, nous montrer subitement le désordre et la mort — ce désordre suprême — amenés par la passion charnelle ? Ou bien nous donner la vision soudaine et future de l'égorgement de Carmen et de la strangulation, par la garrotte, de don José ? Ou encore, a-t-il fait frapper par l'orchestre cette septième diminuée, tout simplement parce que l'altération du septième degré est caractéristique de la vieille musique gitane d'Andalousie ?
Quoi qu'il en soit, ce thème menaçant de la fatalité, avec ses quatre notes descendantes et imprécatoires, plane et fond, comme un rapace, sur don José. Thème qui est un long cri d'animal en détresse. Il semble venir du fond des âges, lorsque l'homme n'avait pas encore inventé son langage articulé. Il fait songer à l'effraie qui hulule, au vautour qui glapit, au corbeau qui croasse, au crocodile qui vagit. Bizet n'oubliait pas que Mérimée prêtait à la bohémienne « un rire de crocodile » ni que Sainte-Beuve avait dit de l'écrivain de Carmen qu'il « était en quête de natures primitives ».
XXXIII
Bizet, qui excellait dans la musique légère, emploie ses plus sûrs et plus prestes tours de métier pour nous décrire, dans la première scène, la place de Séville où se trouve le corps de garde des dragons. Les habitants pittoresques, alertes ou indolents, passent et repassent devant les soldats amusés par les mines grimaçantes et façonnières des promeneurs qui piètent et gazouillent comme des oiseaux lâchés dans les clairières. Un motif de doubles croches, enlevé en si bémol par les flûtes, les clarinettes et les violons, auxquels, pour finir, viennent s'ajouter comiquement les bassons, nous donne le croquis sonore de ces évolutions distrayantes. Motif orné d'harmonies piquantes et neuves et qui donne lieu à des modulations dans les tons les plus déroutants, sans retour à la tonalité initiale. Le musicien semble toujours se rapprocher de la tonique et s'en écarte toujours. Il veut bien se conformer à l'obligation d'un Chœur pour le commencement d'une comédie lyrique. Il ne renonce pas, pour cela, à ses inventions personnelles ni à la traduction de la réalité par des sonorités aussi suggestives que possible.
Ces raffinements d'écriture pour un Chœur d'apparence aussi facile que celui des dragons se retrouvent, plus loin, dans le thème de la garde montante, d'aspect non moins facile, quand Micaëla est entrée sur les triolets des violons, ponctués par les cordes graves. (Triolets qui désignent les allées et venues de la jeune fille agile et fureteuse, à la recherche de don José.) La mièvre galanterie du dialogue entre Micaëla, Moralès et les soldats, est rachetée par les trouvailles spirituelles ou hardies qui s'y mêlent. Dans le détail, Bizet sait toujours rester fin.
Dans la coulisse, le quadruple appel des pistons, à vide, annonce l'arrivée de la garde montante. La relève a lieu sur une Marche allègre, sifflée par deux petites flûtes, suivies des pistons, puis des cordes. Marche dont la tonalité de ré mineur est sans cesse désagencée, diversifiée et masquée. Notons que, pour les épisodes militaires, Bizet n'emploie ni clairons ni trompettes mais les pistons, les cors d'harmonie et les trombones.
Le Chœur des gamins qui succède nous offre le modèle du travail étonnamment libre et subtil de Bizet. Sous ce chant puéril, en forme de Marche à 2/4, le compositeur accumule les fantaisies et les inventions techniques, fournies par sa virtuosité et son génie novateur. Jeux d'enfants nous avaient donné l'avant-goût de ces ciselures, précieuses et encore inconnues, sur une matière banale et dédaignée des savants gourmés. Dans sa façon d'harmoniser et de traiter ce Chœur élémentaire, interprété par des gosses, Bizet aiguise ou dépasse son art. Il fait subir un renouvellement soudain à la musique. Méfions-nous de sa candeur simulée. Elle cache les audaces et les ruses d'un musicien transcendant.
Avec la même ingéniosité, la même singularité et la même sûreté de main, Bizet nuance, orne et polit le Chœur des jeunes gens qui attendent la sortie des ouvrières sévillanes. Dans ce court ensemble, où l'on distingue certaines fautes de prosodie, il y a je ne sais quel gongorisme volontairement déformé. Sans doute Bizet désirait-il indiquer avec quelle grâce empruntée ces novices galants d'un faubourg andalou s'essayent aux déclarations d'amour si maniérées et si communes en Espagne.
Nietzsche comparait le Chœur des cigarières à « un souffle des jardins d'Epicure ». Rien de plus léger, de plus malicieux que cet ensemble, dans son alanguissement. Sous forme enjouée, la musique dévoile la basse coquetterie et le charme onduleux des frivoles compagnes d'atelier de Carmen. Désabusées, elles répondent avec nonchalance aux compliments madrigalesques de leurs adorateurs, tout en fumant des cigarettes. Clarinettes, flûtes, altos, aidés des cordes amorties par les sourdines, retracent les spirales indécises et flottantes de la fumée du tabac. Spirales qui s'envolent dans l'air et disparaissent comme les propos, les transports et les serments d'amour.
Violons, puis altos et violoncelles, enlèvent vite leurs sourdines pour émettre le thème qui, sous sa forme voltigeante, désigne tantôt Carmen, tantôt, sous sa forme tragique et affaissée, la fatalité. Ce thème qu'on a entendu, lourd d'angoisse, à la fin du Prélude, est allégé, accéléré pour caractériser Carmen. Maintenant, il bondit, en doubles croches aiguës, glapies en allegro moderato à 6/8. Les cordes le céderont aux flûtes qui le surhausseront pour le rendre plus perçant et plus moqueur.
Sur son motif, devenu, en diminution, dansant et précipité, Carmen nous apparaît piaffante, aguichante, railleuse. Le dialogue qu'elle engage effrontément avec ses soupirants est une merveille d'interprétation minutieuse, par la musique, des plus fugitives intentions des personnages. Bizet y arrive par sa maîtrise, par son originalité à varier, assortir et distiller les tonalités.
L'air d'entrée, avec chœurs, de Carmen est la populaire Habanera, « L'amour est enfant de Bohême. » On se rappelle que Bizet en avait écrit lui-même les couplets, à peine retouchés par Halévy, et qu'il fut mis dans l'obligation d'en recommencer treize fois la musique. Pour en finir, il emprunte à l'album Fleurs d'Espagne du maestro Yradier une Havanaise. L'annotation : « imitée d'une chanson espagnole », qui figure au bas de la page 43 de la vieille édition pour piano et chant de Carmen, nous donne à penser que la Havanaise en question a dû être puisée par Yradier lui-même dans le folklore ibérique. Mais Yradier, « maître de chant de l'impératrice des Français », nous la présente, dans son recueil, en musicien ignare et trivial. Sous la grosse main d'Yradier, El Arreglito est une vieille romance de salon, sans aucune valeur, et qui a perdu jusqu'à sa saveur de terroir. En s'en saisissant et en y mettant sa propre griffe, le grand musicien français lui restitue, comme par gageure, son caractère espagnol, l'enjolive de parures harmoniques curieuses et savantes et l'accorde à la nature versatile, hardie et perfide de la gitanilla.
En marge de la Habanera, Nietzsche a écrit : « C'est un exercice de séduction, irrésistible, satanique, ironiquement provocant. C'est ainsi que les anciens imaginaient Eros. Je ne connais rien de semblable (en musique). A chanter en italien, non en allemand. »
Dans le motif de la chanson, cascadant et trois fois répété dans chaque couplet, on entend « le rire de crocodile » que Mérimée prêtait à la bohémienne.
A la sortie de Carmen, les flûtes font de nouveau entendre le thème de la « jolie sorcière » qu'ils repassent aux clarinettes puis aux violoncelles. C'est encore le même thème, esquissé légèrement et en triples croches par les violons puis par les violoncelles, qui sautille et scintille quand don José, resté seul, ramasse, en se cachant, la fleur que lui a jetée Carmen et qu'il en respire le parfum.
***
Le retour de Micaëla interrompt la rêverie de don José. En fournisseurs avisés de spectacles qui attirent le public, Meilhac et Halévy ont placé là un duo, d'un romanesque attendrissant, destiné à remplir d'aise la clientèle de l'Opéra-Comique. Duo où le brigadier chasse le souvenir de la femme corrompue qui l'a enjôlé pour revenir à la jeune fille aimante et pudique qu'il se doit d'épouser. Avec cette scène, d'une sentimentalité convenue, les malins librettistes comptaient créer l'ambiance favorable aux ébauches des fiançailles bourgeoises dont la salle Favart était alors le lieu d'élection. Grâce à deux ou trois épisodes pleins de cette fadeur idyllique, les auteurs de Carmen espéraient masquer le réalisme passionnel de leur drame lyrique.
Bon gré mal gré, Georges Bizet fut obligé de plier son génie à ce genre enfariné. Entre la musique du duo de Micaëla et de don José et la musique de Gounod il y a une parenté indéniable. Les enchaînements sont soignés et la ligne mélodique, — surtout au début du duo, — est d'une douceur nostalgique qui ne manque pas de distinction. Cela se gâte sur la fin, quand don José évoque sa première enfance au village basque, sur un rythme de berceuse à 3/4. Là est, évidemment, le passage le moins significatif et le plus vieillot de ce premier acte d'une verve éblouissante. Les critiques en ont dit beaucoup trop de mal, tandis que le grand public s'en est toujours enchanté. Nietzsche le jugeait « tannhäuserien et trop sentimental ». Bizet lui-même regrettait de l'avoir écrit.
Comme nous l'avons vu, pour l'entrée de Carmen, il avait déjà été poussé à choisir, dans l'album du maestro Yradier, une Havanaise intitulée El Arreglito dont la traduction en espagnol est le Petit arrangement, ou la Petite promesse qu'on fait avant un mariage. Et cela, toujours en vue de créer, avec son œuvre, l'atmosphère requise pour les accordailles qui se nouaient à l'Opéra-Comique. Mais, avec la Habanera, il prenait une revanche âpre et secrète : d'un génie irrité et comme ricanant, il modifiait du tout au tout la romance informe et bêtement sentimentale d'Yradier pour la prêter à la voix rauque d'une bohémienne impudente et encanaillée.
Après la Habanera et le duo de Micaëla et de José, les auteurs de Carmen pouvaient faire accroire aux dirigeants naïfs ou distraits de l'Opéra-Comique que, respectueux de la tradition, ils avaient introduit dans leur œuvre tout ce qu'il fallait pour plaire aux fiancés et aux marieurs de la salle Favart. Ce n'est que pendant les répétitions que Du Locle et son metteur en scène Ponchard s'aperçurent de leur méprise et que le nouvel ouvrage, par le naturalisme sous-jacent de l'intrigue comme par le modernisme agressif de la musique, était aux antipodes de l'édifiant répertoire courant.
Du Locle avait laissé voir son air soucieux et son pessimisme querelleur aux dernières répétitions et à la première représentation de Carmen. Les jours suivants, il changea encore d'attitude. Il avait trop de goût et de culture pour ne pas apprécier à sa valeur la partition de Bizet. Malgré les attaques de la presse musicale, il continua à jouer Carmen, soit parce que le public populaire était attiré à l'Opéra-Comique par le nouveau spectacle, soit parce qu'il avait appris les troubles moraux et physiques provoqués, chez Bizet, par l'échec immérité de la première de Carmen, soit parce qu'il en était venu lui-même à admirer le chef-d'œuvre du malheureux grand musicien.
***
Pour avoir obéi aux sollicitations de son prudent entourage, en écrivant le duo entre don José et Micaëla, Bizet avait semblé fléchir du côté artificiel du théâtre lyrique. Il se releva vite et de toute sa hauteur dans les dernières pages de ce premier acte, si riches en harmonies rares et en bonheurs d'expression. Par l'esprit qui l'anime, par le style dégagé et nerveux de l'écriture, par son mouvement endiablé, l'Allegro vivace de la dispute des cigarières n'a pas d'équivalent dans la comédie lyrique. Jamais encore un musicien n'avait traité un ensemble pour voix de femmes avec autant de finesse suggestive, de fantaisie mordante et soutenue, de souplesse et de fermeté.
D'une exubérance méridionale, les premiers et les seconds soprani racontent à Zuniga l'altercation qui a eu lieu entre la Manuelita et la Carmencita. Les premiers soprani prennent parti pour la Manuelita, les seconds pour la Carmencita. Dans l'orchestre coloré mais léger, les bois et les cordes semblent participer à la discussion. Remarquez avec quelle habileté Zuniga interrompt le Chœur pour faire reparaître le motif du début de la controverse. La chamaillerie entre soprani n'en reprend que de plus belle. Le tumulte est à son comble quand survient Carmen, amenée par le brigadier don José et encadrée par deux soldats.
Au lieu de répondre à l'interrogatoire de Zuniga, Carmen nargue le lieutenant, en lui chantant une Séguedille, tout en faisant les doux yeux au brigadier José. C'est là le point dominant du premier acte. Bizet s'y montre dans le fort et le plein de son génie.
La Séguedille est précédée d'une introduction qui ressemble à s'y méprendre à une improvisation de violoniste tsigane, revue et corrigée par un grand musicien de notre pays. L'analogie est d'autant plus frappante qu'au début, cet exorde n'est accompagné que d'un violon solo, d'un deuxième violon solo et d'un alto solo et que son rythme à 6/8 et ses interversions tonales appartiennent en propre à la musique tsigane. Musique caressante, gargouillante et de premier jet. Musique épanchée du cœur de la bohémienne frétillante, insolente, farouchement indépendante. Sarcastique ou langoureuse, Carmen roucoule l'impromptu tsigane et s'en gargarise avec une jactance où se mêle le plaisir. C'est sa façon, à elle, de préluder, par cette étonnante vocalise, à la Chanson bohème tronquée et à la Séguedille qu'elle va nous faire entendre.
Immobilisée sur une chaise, les mains au dos et liées, gardée par le brigadier don José qui a ordre de la conduire en prison, Carmen est tout à fait sûre que rien ne saurait s'opposer à sa liberté. Obligée de demeurer assise, elle esquissera quand même, de ses pieds impatients, un pas de danse, tout en chantant la Séguedille qui est du plus franc, du plus pur canto jondo. Bizet n'a pourtant pas extrait cette Séguedille du folklore flamenco. Elle provient de son fonds personnel. Elle porte aussi bien sa marque que les signes caractéristiques du canto jondo.
Pour avoir assimilé aussi intimement les formes pittoresques des vieux chants tsiganes d'Andalousie, Bizet a dû, sans nul doute, se nourrir à leurs sources. Il n'a pas appliqué servilement à sa partition de Carmen ces formes de la sorcellerie musicale des gitanos. Il n'a fait que s'en aider pour enrichir ou se créer à lui-même sa langue, son genre, son style et leur donner une puissance plus tranchante. Non moins qu'ailleurs, on reconnaît là sa verve de nature, sa technique forte et souple.
Sur l'accompagnement immuable de deux doubles-croches, émis par les violons et les altos, « aussi pianissimo que possible », la Séguedille s'élance vers des tonalités écartées, dissidentes, inaccoutumées et toujours changeantes, accrochant, de-ci de-là, au passage, une note fallacieuse qui nous attire sur une route que nous croyons connaître mais qu'à notre désappointement, le musicien aura vite quittée, pour aboutir, après maintes embûches et maints détours, à la conclusion tant suspendue et différée.
La Séguedille bondit et se tortille, dans son indécision modale, comme une flamme, comme une danseuse de flamenco, comme Carmen elle-même, si cruellement inconstante. Cette forme de danse chantée était exécutée habituellement à la fin des tonadillas, sortes d'opérettes populaires en un acte qui avaient eu leur haut moment de faveur dans les dernières années du XVIIIe siècle.
C'est aussi avant le Finale du premier acte de Carmen que Bizet introduit sa Séguedille qu'on dirait échappée d'une tonadilla ou d'une zarzuela grande. De l'extérieur, toute la partition de Carmen ressemble, par ses accents populaires, par la sobriété des moyens, par les touches de son orchestre, par son débraillé, à une tonadilla, développée en quatre actes et faite pour enthousiasmer la plèbe de Séville et de ses cuevas. Mais, sous cette simplicité brutale, quelle variété et quelle intensité d'expression, quelle langue harmonique complexe et savante, quelle puissance de souffle, quelle fantaisie ailée ! Le génie de Bizet, qui va s'éteindre peu de temps après, y jette ses lueurs les plus vives.
Comment résister à cette Séguedille ? En l'entendant, don José s'abandonne entièrement à sa passion pour la gitane. Au Finale du premier acte, Carmen reprend le refrain de sa Habanera d'entrée. Puis l'orchestre se ressaisit du motif de la Dispute des cigarières auquel il prête la structure sommaire d'une fugue interceptée. Il nous dépeindra ainsi l'ordre troublé et les gardiens bafoués par la bohémienne. Quand, pour s'évader, Carmen a rompu ses liens et bousculé don José et les dragons dont elle est captive, l'agitation et la confusion sont extrêmes, sur la scène comme à l'orchestre.
XXXIV
L'Entr'acte est entièrement bâti sur la chanson de caserne que don José entonnera tout à l'heure, dans la coulisse, quand, après sa sortie de prison, il viendra rejoindre Carmen dans la taverne de Lillas Pastia. Le thème est présenté comiquement par deux bassons, soutenus par le tambour. Courtes variations riantes par les flûtes, clarinettes et violons. Bref développement en contrepoint par clarinettes et bassons qu'accompagneront, pour finir, les autres instruments de l'orchestre. Cet Allegro moderato, joué pianissimo, baigné d'harmonies piquantes, semble appartenir à un opéra bouffe. C'est un divertissement, rempli d'esprit, voisin de la caricature, et qui nous annonce que quelques scènes de la vie de garnison vont se dérouler devant nous.
Dans sa biographie de Bizet, assez souvent en défaut, Paul Landormy tient cet Entr'acte pour un « hors-d'œuvre ». Contrairement à ce qu'il pensait, l'Entr'acte est parfaitement lié à l'action qui va suivre, — action dont Nietzsche avait entrevu le côté « militaire ». Au cours du deuxième acte, nous assisterons, en effet, aux frasques du lieutenant Zuniga et de quelques-uns de ses camarades qui festoient en compagnie de bohémiennes ; nous verrons le même lieutenant Zuniga, berné par Carmen, se battre avec le brigadier dégradé José, pour les beaux yeux de la gitane ; nous apprendrons que le dragon José quitte l'habit militaire pour faire partie d'une troupe de contrebandiers, alors qu'hier encore il était chargé de procéder à l'arrestation des mêmes contrebandiers.
Comme au premier acte, on nous montre, au deuxième acte, un coin de la vie d'un détachement de dragons, à Séville. Dans ces deux premiers actes de Carmen, entre pour beaucoup l'élément militaire que, dans son commentaire symphonique, Bizet a traité avec autant de gaîté que de finesse savoureuse.
La Chanson bohème est précédée, au lever du rideau, d'une danse vive, tracée par la grande flûte et la petite flûte. Danse exécutée par les gitanes et qu'accompagnent les guitares « raclées » par les « zigheuneurs ». Bizet, qui ne pouvait sans doute pas recruter de guitaristes pour l'Opéra-Comique, a été obligé de les remplacer par les harpistes, altistes, violoncellistes, auxquels se joignent, un peu plus tard, les violonistes. Sur l'accompagnement invariable de deux croches obstinément répétées soit pizzicato soit arco, le motif rapide de la danse s'envole, se pose ou descend dans des tonalités trompeuses et dissidentes.
Quand la danse s'arrête, Carmen entonne le premier couplet de la Chanson bohème qui, dans ses suites de quintes, évolue avec la même spontanéité, la même irrégularité et sur le même accompagnement uniforme. Seuls changent pour chacun des trois couplets les timbres de l'orchestre, où sont intercalés les frémissements des grelots du tambour de basque et les tintements métalliques du triangle. Les bohémiennes Frasquita et Mercédès s'associent à Carmen pour le refrain. Le rythme est de plus en plus accéléré. Dix mesures avant la troisième et dernière reprise du refrain, les danseuses enfiévrées n'y peuvent plus tenir et recommencent leurs trémoussements et leurs trépignements. Ce n'est qu'après la fin de la Chanson bohème que flûtes, hautbois, clarinettes et violons font entendre de nouveau, et avec plus de précipitation, le mouvement de danse vive du début. Tous les acteurs prennent part au baile flamenco. Ils s'agitent et tournoient avec fureur.
La fête se prolonge. Au cours d'une promenade aux flambeaux dont il est le héros, Escamillo passe devant la taverne de Lillas Pastia. Les bohémiennes font signe au toréador d'entrer. Accueilli par les vivats de l'assistance, il est atteint par le charme aigu de Carmen comme par une banderille ou par la pointe d'une navaja. Il prend des poses avantageuses pour nous conter ses exploits et nous livrer les secrets du sport tauromachique. C'est à l'intention de la belle gitane qu'il chante, avec une vulgarité insolente, ses deux couplets et le refrain, repris par les aficionados qui l'entourent.
Une anecdote a circulé au sujet des Couplets d'Escamillo qui provoquent d'habitude l'enthousiasme des auditeurs. Bizet était, paraît-il, d'un avis tout opposé à celui du public. Il aurait même déclaré au chef d'orchestre Charles Lamoureux :
— Puisqu'ils veulent de l'ordure, en voilà !
Cette appréciation malsonnante qui aurait été émise par Bizet lui-même a été recueillie par la plupart des biographes du grand musicien. Il y a eu, là, confusion. Il s'agit de rétablir les faits. Homme de théâtre par excellence, Ludovic Halévy avait exigé qu'un air fût placé au début de la scène II du deuxième acte. Il en avait remis les vers à son collaborateur musical. Après avoir longtemps tergiversé, Bizet finit par en apporter la musique, en disant avec malice à son cousin :
— Tiens ! Voici ta saleté !
On en a conclu que Bizet détestait la « Marche du Toréador ». Alors pourquoi la fait-il entendre dès le Prélude de Carmen et la donne-t-il pour motif à Escamillo ?
Au torero vaniteux et triomphant, il ne pouvait prêter qu'un air populaire, brutal et d'une emphase naïve. Mais il a donné à ce chant trivial une ligne vocale en zigzag et une couleur où se manifestent, malgré tout, son souci de l'exactitude figurative et de la vérité observée. On y découvre comme les bonds et les piétinements du toréador, les faenas de la muleta écarlate, les enchaînements des passes, les arabesques décrites, pendant « la danse », autour de la bête rageuse. Dans la blanche et les deux noires (do bémol, do bécarre, sol), du troisième trombone, pendant qu'Escamillo chante « C'est la fête du courage », Nietzsche « entendait mugir le taureau ». Après chaque copla, le vainqueur de l'imaginaire combat tauromachique semble offrir à Carmen la cocarde arrachée au lobito ensanglanté et terrassé. Et le refrain, en forme de marche, est repris par les assistants comme par les spectateurs d'une corrida, levés des gradins pour acclamer le torero victorieux « dans son habit de lumière », comme on dit là-bas.
Non que Bizet ait voulu faire une musique imitative quelconque. C'est par l'expression du sentiment, nécessairement banale mais bien assortie, et par les timbres de l'orchestre qu'il fait naître à l'esprit le tableau ardent d'une course de taureaux. Sur la trame commune, le travail du compositeur a été très poussé. Bizet a même indiqué que les couplets ont un caractère « rude et très rythmé ». L'Air d'Escamillo est, d'autre part, semé de difficultés et les plus habiles barytons sont gênés par sa tessiture. Nietzsche soutenait qu'il « ne pourrait être plus caractéristique ». En définitive, l'Air en question ne mérite pas le dédain où le tiennent ceux qui se croient délicats et compétents, quand ils ne sont que superficiels ou trop pressés à en juger.
Le Quintette n'a pas été, non plus, apprécié à sa valeur. C'est une manière de court chef-d'œuvre de musique bouffe. Nietzsche trouvait dans le Trio des cartes « une grâce mozartienne ». Cette « grâce » est beaucoup plus sensible dans le Quintette qui fait penser aux étincelants ensembles des Noces de Figaro. Sur un rythme accéléré à 6/16, Bizet nous offre là un modèle, en son genre, de technique serrée, de virtuosité incisive et souveraine. Après ces pages parachevées, lequel de ses adversaires peut lui dénier la connaissance approfondie des meilleures règles dans l'art de faire de la musique ? Quand il échappe aux doctrines des harmonistes classiques, quand, poussé par son génie individuel, il prend le contrepied de ses adversaires, il tend toujours à un perfectionnement de l'expression sonore, il renouvelle et enrichit le système établi par les maîtres qui l'ont précédé.
Dans les assemblages et les entrelacements des traits du Quintette, dans ses dentelures et ses brillantes diversités, dans sa souplesse et sa finesse d'écriture, dans la fantaisie légère et animée de son instrumentation transparente, on distingue la maîtrise avec laquelle Bizet manie les principes académiques dont il tire les effets les plus sûrs et les plus savoureux. Jusque dans cet exercice de grand lettré, il introduit sa dose d'invention.
Dans sa partie médiane, le Quintette est coupé par les répliques de Carmen qui refuse de prendre part à l'expédition projetée par les contrebandiers. Le Dancaïre, le Remendado, Frasquita et Mercédès essayent vainement de faire revenir la gitane sur sa décision. Carmen ne se rend pas à leurs raisons. Elle a pris rendez-vous avec don José, aussitôt après sa sortie de prison. Elle tiendra sa promesse. L'ensemble vocal qui semble sceller l'union entre la zingarella et ses quatre acolytes est brisé. Mais, par un tour d'adresse particulier à Bizet, le motif du Quintette reflue et le savant et spirituel Allegro est conduit à sa fin piquante et obligée.
Signalons ici qu'à l'exception de la Chanson des Dragons d'Alcala, les airs et les ensembles de Carmen ne sont pas des « morceaux détachés », comme dans l'ancien répertoire. Ils sont toujours en situation. Ils aident à la progression dramatique. Ils sont étroitement liés à l'intrigue. Les solistes n'arrêtent pas l'action scénique pour faire admirer leurs prouesses vocales. Leurs chants ont des subdivisions, des ramifications ou des sortes d'interférences par lesquelles ils communiquent avec la substance de la pièce. Ensembles ou monologues sont traversés par les reparties d'autres personnages et sans cesse accordés à ce qui se passe sur la scène.
Sans avoir recours au système wagnérien de la mélodie continue, Bizet est arrivé à maintenir l'unité de son discours musical, tout en y incorporant des airs et des chœurs, comme il était d'usage à l'Opéra-Comique. Il apportait ainsi au drame lyrique l'une de ses nouveautés heureuses. C'était déjà assez pour lui de s'être plié au décret qui imposait à la salle Favart de ne jouer que des comédies lyriques avec des dialogues parlés.
***
Nous voici parvenus à l'un des passages les plus significatifs du chef-d'œuvre. Sans aucun accompagnement instrumental, don José lance, dans le lointain, puis, en se rapprochant peu à peu, les deux couplets de sa chanson de cavalier, en forme de marche : « Halte-là ! Qui va là ? Dragons d'Alcala ! » Chanson qu'on dirait faite pour rythmer le pas, le trot, les voltes, les sauts et la caracole des chevaux d'une patrouille de lanciers.
Carmen accueille avec un tendre empressement le soldat relaxé. Pour lui seul, elle danse la Romalis. Elle en fredonne l'air, accompagnée par les castagnettes et les cordes en pizzicato, auxquelles se mêlent bientôt, en contrepoint, les pistons qui sonnent au loin la retraite. José fait mine de partir pour être présent à l'appel. Rendue furieuse, Carmen prétend que José ne l'aime pas. Alors, pendant que le gémissant cor anglais fait de nouveau entendre le motif de la fatalité, l'humble soldat tire de la poche intérieure de son dolman la fleur de cassie, toute séchée, que Carmen lui avait jetée et dont il n'a pas cessé de respirer l'odeur amère et tenace. Et, avec une confondante puissance de souffle, dans une seule et ample phrase mélodique — elle ne dure pas moins de quarante-six mesures — il confesse à mi-voix la passion soudaine et torturante que lui a inspirée la gitane.
L'Andantino, chanté à cette place par don José, est totalement étranger à tous les airs, de style maniéré ou ampoulé, ténorisés jusque-là sur nos scènes musicales. Bizet s'est difficilement résigné à accepter le ton de ré bémol dont on usait généralement pour les cavatines galantes de ce genre artificiel. Sa longue ligne mélodique se hasarde dans les méandres divergents, effleure les tonalités opposées, périlleuses, éloignées, s'élève et retombe pour revenir sur elle-même, remonte plus haut encore et finit de la façon la plus singulière. On dirait le trait d'un sismographe sonore qui a enregistré les mouvements du séisme produit dans l'âme de don José par l'irruption de Carmen. Le musicien ne songeait nullement à séduire son public avec une cantilène qui appelât les applaudissements. Ce qu'il voulait — et il y a supérieurement réussi — c'était dépeindre, dans ses nuances les plus intimes et les plus fuyantes, les ravages de la fascination exercée par Carmen sur don José. A la suite de quoi il a été amené à faire retentir cet avant-dernier accord, équivoque, anormal, mystérieux, qui avait fait scandale le soir de la première représentation de Carmen. Bizet indiquait ainsi que l'amoureux aveugle et pitoyable de la zingara était définitivement asservi au pouvoir de celle qui l'avait ensorcelé.
Le duo se prolonge. Carmen n'est pas convaincue par l'aveu désespéré de José. Sur le rythme tsigane à 6/8 qui lui est personnel, elle exhorte son amant à déserter et à fuir avec elle « là-bas, là-bas, dans la montagne ». Les violons et les altos mettent leurs sourdines pour prêter plus de douceur insinuante aux appels de la bohémienne. Un dessin d'accompagnement trottinant, balancé et berçant, tracé par les violons, fait penser à une chevauchée dans la campagne. Carmen laisse entrevoir que, montée en croupe derrière don José, elle s'élancera avec lui vers la sierra où ils pourront vivre et s'aimer sans contrainte. José, éploré, réagit faiblement et avec douleur. Unissant sa voix à celle de Carmen, il a déjà cédé aux sollicitations troublantes de la gitane.
Brusquement, il se refuse à l'aventure, « à la honte, à l'infamie ». Il reprend son rythme à 4/4. Les violons retirent leurs sourdines. Carmen signifie à José son congé. Les deux amants vont se séparer pour toujours.
Nous arrivons au Finale du deuxième acte. Au moment où don José, délaissant Carmen, pousse la porte de la taverne pour sortir, il se heurte au lieutenant Zuniga, venu pour retrouver la bohémienne. L'officier et le soldat se provoquent et dégainent. Carmen se jette entre eux et appelle les contrebandiers qui désarment Zuniga. Avec le Dancaïre et le Remendado, elle se moque de l'officier qu'on fait prisonnier.
Maintenant, don José ne peut plus que déserter et se joindre aux contrebandiers. L'acte se termine à 6/8 par un hymne bohème à la liberté sur le motif « là-bas, là-bas, dans la montagne », hymne chanté par Carmen, ses camarades et les chœurs, et accompagné par un orchestre vibrant. Les deux dernières scènes sont agencées et filées avec une souple entente du théâtre lyrique. On n'y distingue qu'un savoir-faire extrême, sans nouveauté appréciable.
XXXV
Un second Entr'acte sert de prélude au troisième acte. Il avait été composé pour l'Arlésienne. Il était resté pour compte parce qu'on avait jugé que la musique de scène que Bizet avait écrite pour le drame de Daudet tenait beaucoup de place dans le spectacle. Reporté dans la partition de Carmen, il forme une disparate. A l'origine, il était destiné à évoquer un paysage riant de Provence et non « une gorge sauvage dans la montagne », en Andalousie. Ses attaches avec l'Arlésienne sont visibles. Bizet n'a modifié que légèrement l'instrumentation dépouillée qu'il avait faite pour l'orchestre réduit du Vaudeville (*). Cela apparaît surtout dans la première moitié de cet Entr'acte de quarante-trois mesures. Bizet n'utilise qu'une flûte et deux harpes pour les douze premières mesures, et n'y ajoute, pour les dix mesures suivantes, que deux clarinettes, un seul premier violon, un seul deuxième violon, un seul alto, deux violoncelles divisés et deux contrebasses.
(*) Pour les premières représentations de l'Arlésienne, au Vaudeville, l'orchestre comprenait vingt-six instrumentistes : sept violons, un alto, cinq violoncelles, deux contrebasses, deux flûtes, un hautbois remplacé, à quelques endroits, par le cor anglais, une clarinette, deux bassons, un saxophone, deux cors, un timbalier, un piano.
Au vrai, c'est une Pastorale (dans le ton de mi bémol du Prélude du IIIe tableau de l'Arlésienne) qu'on peut rapprocher de la Pastorale de l'Etang de Vaccarès. Le motif de la Pastorale de Carmen est exposé par la flûte au lieu d'être exposé par les violons comme dans la Pastorale de l'Arlésienne. Toutes deux ont la même structure et jusqu'aux mêmes nuances. Plusieurs musiciens et non des moindres — Haendel, Gluck, Beethoven, Rossini, pour ne citer que ceux-là — ont ainsi transporté dans d'autres œuvres des extraits de certaines de leurs partitions déjà écrites. Une page de musique peut prendre diverses significations, selon la place qu'on lui assigne dans un ouvrage.
Admettons que l'Entr'acte qui nous occupe, d'une poésie facile et légère, nous décrive, dans Carmen, le passage de contrebandiers d'opéra-comique à travers la montagne, par une nuit calme et chaude. Le thème, présenté par la flûte, sur le simple accompagnement de deux harpes, est transmis aux clarinettes, au cor anglais, aux bassons. Les instruments se le repassent les uns aux autres, en un contrepoint plaisant et discret. Les contrebandiers, agiles mais prudents, semblent échanger et remporter leurs ballots, en chantonnant gaîment et à voix basse. A la fin de l'Entr'acte, le motif est repris par la flûte pianissimo et s'évanouit à l'aigu, dans l'air nocturne, comme dans la Pastorale de l'Etang de Vaccarès.
***
Dès que le rideau se lève, se dévoilent, de nouveau, la maîtrise et l'audace du compositeur de Carmen. Dans l'ensemble inquiétant, en forme de marche, qui suit, le mode d'ut mineur du début se dérobe avec une insistance particulière. Bizet invente sans cesse des agrégats sonores, dévie dans les tons lointains, inattendus, troublants. Il se soucie bien peu des règles établies. Il a sa loi à lui, qui le mène directement là où il veut aller. Rien ne l'empêchera d'avancer.
Selon sa volonté ou sa fantaisie, avec la verve et la technique qui lui sont propres, il peint l'existence précaire et menacée des contrebandiers. Une sorte de refrain, chanté pianissimo par les chœurs, encadre le Sextuor, curieusement expressif dans son bariolage et son éparpillement, et qu'interprètent Frasquita, Mercédès, Carmen, don José, le Dancaïre et le Remendado. C'est, si j'ose dire, une chanson de métier, mais détaillée, modulée, instrumentée, illustrée comme seul Bizet sait le faire.
La même disposition a été adoptée pour le fameux Trio des cartes. Frasquita et Mercédès entourent de leur excitation juvénile et de leurs illusions flatteuses les présages sinistres que Carmen découvre dans les cartes étalées devant elle. Lorsque Frasquita et Mercédès, pour se dire la bonne aventure, mêlent, coupent et retournent leurs cartes, la musique court et sautille à 2/4. Dès que Carmen « essaye à son tour », nous revenons au rythme flamenco à 6/8 et les flûtes susurrent l'angoissant thème de la fatalité, terminé, cette fois, par une descente chromatique, plus angoissante encore et qui s'éteint étrangement dans une septième diminuée, comme à la fin du Prélude du premier acte. Résignée au sort tragique qui lui est réservé, Carmen chante l'admirable et bref Andante en fa mineur et à 3/4 : « En vain pour éviter les réponses amères... » La phrase mélodique se déploie dans le grave, uniquement accompagnée par des accords sobres, imposants, oppressants comme une marche funèbre. Nietzsche trouvait « terrifiant » l'accord majeur (inopinément surgi) qui est émis sur la fin de « carte impitoyable » par les cors, les seconds violons et les altos, pendant le roulement des timbales.
Après ce chant de la fatalité, où le désespoir s'exprime avec une noblesse très simple, sans aucune plainte bruyante contre l'adversité, nous retournons au tempo à 2/4 du début. Frasquita et Mercédès mêlent leurs joyeux pronostics aux prévisions funestes de Carmen. Une dernière fois, violoncelles et contrebasses font entendre, sur les accords accablants des bassons et des cors, le thème de la bohémienne en qui s'incarne le destin.
***
Le Morceau d'ensemble en sol bémol, « Quant au douanier... », avait été également composé pour la musique de scène de l'Arlésienne et n'avait pu être retenu par Carvalho. C'est un Allegretto, en forme de marche vive. Le chant en est amusant mais banal. Dans la disposition des parties et l'instrumentation, se glissent maintes trouvailles précieuses, spirituelles ou attrayantes. Pour la sortie des contrebandiers, l'orchestre est réduit progressivement. Il ne comporte plus que les flûtes et les violons pianissimo, quand le Dancaïre et le Remendado, restés seuls en scène, se décident à partir, à leur tour. Après avoir fièrement lancé, avec tous les autres, « Marchons en avant ! », les deux compères se font tirer l'oreille pour aller à la rencontre des douaniers.
A l'entrée de Micaëla, nous renouons avec l'ancien opéra-comique. L'air dont nous gratifie l'amoureuse ingénue de don José est complaisamment étiré d'après toutes les recettes dont se servaient les faiseurs de mélodies du vieux répertoire. Bizet l'avait écrit pour la Coupe du Roi de Thulé. Il l'avait replacé dans Grisélidis, peu de temps avant la guerre de 1870. Il se maintenait alors dans les artifices ordinaires du théâtre lyrique. Les nouveaux horizons vers lesquels il devait s'élever étaient encore noyés dans la brume.
La paix revenue, il s'était complètement détourné de ce style traînant, mièvre et affecté. Il avait renoncé à faire jouer Grisélidis. S'il a utilisé cette cantilène dans la partition de Carmen, c'est parce qu'elle convenait tout à fait au rôle de la petite paysanne rosâtre que ses librettistes avaient introduite dans le drame rouge et or conçu par Mérimée. Nietzsche, qui a toutes les indulgences pour le musicien « méditerranéen » qu'est pour lui Bizet, a seulement dit, du rôle de Micaëla, de son duo du premier acte et de son air du troisième acte, qu'ils sont « d'une trop grande sentimentalité ».
***
Avec l'apparition d'Escamillo, la musique se relève rapidement. A l'exception du passage poncif où les deux hommes lient à l'unisson leurs voix pour se défier, avant le combat, le duo entre le toréador et don José est conduit avec une force, une souplesse et une intensité de couleur rares. Sans ralentir le mouvement, la traduction sonore est toujours vivante, osée et choisie, d'un goût sûr et haut placé. Escamillo n'est plus le personnage vulgaire et fanfaron du second acte. Il s'exprime avec des locutions fines et originales. Séduit par la magie enveloppante de la gitane, il s'est transformé en cavalier soucieux de s'exprimer avec recherche et singularité. Signalons, en passant, avec quel léger enivrement l'imprudent torero avoue à don José qu'il aime « une zingara, mon cher ». Sur les mots « zingara » et « Carmen », flûtes, hautbois, clarinettes et bassons ramènent, soudain, le thème troublant de la bohémienne.
Lorsque Carmen détourne le coup mortel que don José se préparait à porter à Escamillo, commence le Finale du troisième acte. L'action est sans cesse réveillée, poussée. Jusqu'au baisser du rideau, la musique, dans sa montée irrésistible, est d'une concision, en même temps que d'une puissance de suggestion et d'un éclat de nouveauté qui appellent l'admiration à tout moment. Escamillo remercie Carmen de lui avoir sauvé la vie, sur des harmonies d'une élégance et d'une ingéniosité frappantes. Quand il prend congé de la gitane, en l'invitant insidieusement aux courses de Séville où il doit « briller de son mieux », les violoncelles divisés, puis les altos, également divisés, les clarinettes et les bassons nous font de nouveau entendre le refrain de l'air du toréador du second acte. Mais comme ce refrain banal est amoureusement alangui et avec quel art raffiné il est varié !
Micaëla rentre sur un extrait de sa cantilène. Elle va repartir avec José dont la mère est mourante. Carmen insiste railleusement pour que son amant décampe au plus tôt. Emporté par la jalousie et la colère, José brutalise la gitane. Il sort, la menace à la bouche, pendant que flûtes, clarinettes, hautbois, bassons et cors répètent le thème de la fatalité. Dans le lointain, Escamillo, qui n'est accompagné piano que par les pizzicati des violons, des altos et des violoncelles, entonne son refrain, comme un chant assourdi de victoire. Sa voix se perd dans le vent de la montagne.
XXXVI
Voici le sommet rayonnant du chef-d'œuvre. Georges Bizet a écrit ce quatrième acte dans une haute tension d'âme. Comme avec des fureurs de plume. Jamais encore la musique n'avait dépeint aussi intensément la passion de la chair, les fièvres de la sensualité. Bizet en a fixé l'expression sonore pour jamais.
Le dernier Entr'acte est tout entier parcouru par la sève exubérante du chant flamenco. D'un bout à l'autre vibre la couleur locale. Nietzsche déclare que ce passage « fait bondir le cœur » et ajoute : « C'est la fièvre de la passion proche de la mort. »
Le musicologue espagnol Rafaël Mitjana a écrit dans l'Encyclopédie de la Musique (*), au sujet d'un polo du Domestique supposé, opéra-comique en un acte de Manuel Garcia, représenté à Madrid à la fin de 1804 : « Trompé par l'apparence et le croyant du domaine commun, Bizet en profita pour composer le fameux Prélude du quatrième acte de Carmen. Nous n'avons jamais vu signalée cette curieuse analogie... » Mitjana cite, en exemple, le polo qu'aurait imité le musicien français.
(*) Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire, librairie Delagrave, Paris, 1923, page 2299.
Pauline Viardot, fille de Manuel Garcia, sœur de la Malibran et grande amie de Bizet, a-t-elle fait connaître au compositeur de Carmen le polo paternel ? Elle était non seulement une cantatrice célèbre, mais elle avait aussi écrit plusieurs mélodies et jusqu'à des opérettes. Elle a dû fournir à Bizet de précieux renseignements sur la musique populaire d'Espagne. On ne peut en déduire que Bizet ait emprunté à Manuel Garcia le polo du Domestique supposé. Il l'aurait indiqué dans sa partition, comme il l'avait fait pour la romance d'Yradier dont il s'était servi pour composer la Habanera du premier acte.
Quand on rapproche l'Entr'acte de Bizet de la mélodie de Manuel Garcia, l'on constate que la ressemblance est toute fortuite et superficielle. Mitjana prétend que « la curieuse analogie » est frappante entre la phrase initiale, les dessins des premières mesures du polo et le texte de Bizet. Ces dessins du début, la chute de la phrase mélodique et le rythme de Garcia pourraient à la rigueur être reconnus dans le Prélude du quatrième acte de Carmen. Mais combien transformés, relevés et enrichis par le maître français ! J'ajoute que les dessins du commencement du polo et le premier motif de l'Entr'acte sont nettement différenciés et que le rythme et les chutes de phrases mélodiques de cette sorte se retrouvent constamment dans le canto jondo et le folklore ibérique. Il y a eu peut-être réminiscence et non imitation consciente.
Il est curieux de noter que cet Entr'acte a un caractère hispanique beaucoup plus énergiquement prononcé que le polo de Manuel Garcia. Le premier motif, lancé fortissimo et à l'unisson par tout l'orchestre où scintillent le triangle et le tambour de basque, nous électrise par ses trépignements de zapateado. Le public lui-même participe à la feria des gitanes frétillantes. Après neuf mesures de transition, le hautbois, aiguillonné par les pizzicati des seules cordes, chante piano le thème du destin, transformé en un chant flamenco de toute beauté. Page où s'exprime l'âme gitane, avec ses implorations dolentes, ses rêveries rongées de nostalgie et son mystère. Cinq fois le hautbois répète ce chant, suivi par les dessins rapides et arpégés de la flûte et de la clarinette et par le bref et monotone accompagnement, à vide, d'une danse, par les cordes pincées.
Tout au long de l'acte qui s'ouvre, nous rencontrerons cette opposition entre la joie de la foule et le dénouement tragique du drame d'amour de Carmen et don José. Dans la pensée de Bizet, la corrida palpitante, enthousiasmante, qui se déroule devant le public du cirque, dans la coulisse, a pour prolongement et comme pour corollaire la corrida passionnelle et intérieure qui se passe entre la gitane et son amant, devant le public du théâtre. Nous verrons, à la fin du quatrième acte, le meurtre de Carmen se produire au moment même où, derrière le décor, le taureau vaincu est tué par l'espada, aux acclamations de l'assistance qui entonne le refrain de l'air d'Escamillo.
***
Lorsque le rideau se lève, Sévillans, Sévillanes et gamins assiègent l'entrée des arènes. Les marchands ambulants racolent des clients. Les premiers soprani offrent des éventails ; les seconds soprani, des oranges ; les premiers ténors, les programmes ; les secondes basses, du vin ; les seconds ténors, de l'eau ; les premières basses, des cigarettes. Tout cela en un Chœur spirituellement varié. Chœur juxtaposé à l'orchestre étincelant qui nous décrit, comme au premier acte, l'agitation de la populace en effervescence et impatiente d'applaudir, au passage, les champions de la course de taureaux.
Les bassons amorcent les quatre premières mesures de la Marche, déjà entendue comme thème initial du Prélude qui précède le premier acte. Les clarinettes s'unissent aux bassons, quand les enfants s'écrient : « Les voici ! » Le défilé de la cuadrilla commence. En tête, le détachement des alguazils que conspuent, d'abord, les enfants, puis tous les autres assistants. Après quoi, les enfants annoncent successivement les Chulos, les Banderilleros, les Picadors, salués par les chœurs et l'orchestre, divisés et ingénieusement diversifiés. Tout cela pendant que l'orchestre exécute et répète, sans se lasser, avec une excitation croissante, la « Marcha torera ».
Les bassons nous informent de l'approche de l'espada sur la reprise de la Marche de la cuadrilla. Les flûtes et clarinettes s'unissent aux bassons. Escamillo apparaît enfin, aux côtés de Carmen, rayonnante de fierté et de bonheur. En son honneur, les chœurs attaquent fortissimo et « très rythmé » le refrain de l'Air du toréador. Acclamations de la foule, tandis que l'orchestre, en un tutti fracassant, ressasse la Marche obsédante.
Selon quelques hispanisants vétilleux, cette « Marcha torera » n'est pas de bon aloi ibérique. Elle a pourtant été acceptée comme musique nationale pour toutes les réjouissances populaires qui ont lieu en Espagne. Aucune corrida ne se déroule au delà des Pyrénées ou en d'autres pays, sans qu'un orchestre plus ou moins honorable et congru fasse retentir la « Marche du défilé de la cuadrilla ». Avec ce morceau trépidant, Bizet aura plus fait pour le renom mondial de la France et de l'Espagne que tous les musiciens réunis. En 1931, quand le chef de notre gouvernement, à la tête d'une nombreuse délégation, est allé jusqu'à Moscou signer un traité d'alliance, un orchestre militaire de l'U.R.S.S. a accueilli, sur le quai de la gare, nos représentants, non avec la Marseillaise, mais avec la Marche du quatrième acte de Carmen.
Après une pause, altos et violoncelles divisés accompagnent de leurs inflexions caressantes les quelques phrases amoureuses qu'échangent Escamillo et Carmen et dont Nietzsche dit qu'elles sont « indescriptiblement émouvantes et d'une divine simplicité d'invention ». Le duo d'amour est interrompu par l'arrivée de l'alcade. A sa suite, s'introduisent dans les arènes les toreros de la cuadrilla et les ardents amateurs de tauromachie.
Frasquita et Mercédès sont restées en arrière pour glisser à l'oreille de Carmen qu'elles ont aperçu don José qui essayait de se cacher dans la foule. Dans un terzetto balancé et d'une coquetterie tourmentée, pendant que flûtes et bassons jacassent et cancanent, les deux bohémiennes préviennent à voix basse la zingara, éprise d'Escamillo, du danger qu'elle court. Sur les dessins des violons, altos et violoncelles légèrement tremblants, Carmen répond qu'elle attend José pour lui parler. Raoul Laparra appelle cette page « une charmante petite symphonie ». Frasquita et Mercédès gagnent leurs places sur les gradins.
Don José, qui s'est approché, et Carmen restent seuls devant le porche du cirque, par où les spectateurs se sont engouffrés.
***
Arrêtons-nous avec respect devant la dernière scène, absolument unique dans tout le théâtre musical. Nietzsche dit que c'est « un morceau de maître, à étudier, comme progression, contrastes, justesse ». Il ajoute que, dans les cinquante dernières mesures, Bizet a fait « de la véritable musique de tragédie ». Et, lorsque la sonnerie des pistons et des trombones annonce, dans la coulisse, la victoire d'Escamillo, il écrit que la fanfare « retentit effroyablement ».
Dans ce duo final, le génie de Bizet est, en effet, à sa suprême puissance. La musique serre de près chaque point de la situation, épouse étroitement le sentiment, touche le fond du sentiment. Là, tout est simple, direct, saisissant, abrégé. Chaque accent vient du cœur. On ne peut plus l'oublier, tant il a de prise sur notre âme, voire sur nos sens.
Aucune fioriture. Aucun faste oratoire. Chaque note arrive par une nécessité interne. Chaque note a sa signification dans l'évolution du drame et fait deviner ce qui est secret dans les caractères des deux amants d'Andalousie. Et si l'on cherche bien, chaque note a sa raison d'être théorique ainsi que sa raison d'être psychologique. Les relations d'harmonie les plus anormales, les plus risquées trouvent leur justification subtile.
La scène s'engage dans le silence, — ce silence angoissant de la nature avant l'orage. Après deux longues pauses, les accords brusques et nus des cordes ne soulignent que les fins des phrases de Carmen. Elle affronte sans crainte son ancien amant. Tendrement assisté par les violons, altos et violoncelles, don José propose, avec douceur, à la gitane de « commencer une autre vie ». Carmen répond sèchement que « tout est fini ». Avec plus d'élan, il recommence son offre qui les sauvera tous deux. La bohémienne, qui entend l'heure fatale sonner aux cors et aux timbales, ne cédera pas. Sa voix se lie mal à celle de José et n'y adhère pas.
L'orchestre s'est tu complètement, lorsque l'homme se sent abandonné de Carmen, de tout et de tous. Il murmure, avec angoisse : « Tu ne m'aimes donc plus ? » Seul, l'orchestre riposte avec deux accords altérés et rauques. Dans le vide et le silence revenu, José répète, dans un cri déchirant, sa question. Carmen réplique froidement : « Non, je ne t'aime plus. » Avec des jets lyriques puissants, José redit à la zingara la passion qui le brûle. Il embrasse les genoux de Carmen et la supplie de ne pas le quitter. La bohémienne s'obstine dans son refus.
Après qu'elle a prononcé que : « libre elle est née, libre elle mourra », l'orchestre de la salle s'est arrêté. On n'entend que les pistons et les trombones d'une fanfare de coulisse attaquer les premières mesures de la Marche du défilé de la cuadrilla, pendant que les chœurs, dans l'enthousiasme, nous relatent, derrière la toile de fond, les péripéties de la corrida. Carmen écoute, dans le ravissement, les échos du succès d'Escamillo. Elle veut entrer dans les arènes. José lui barre le passage. Dévoré de jalousie, il demande à Carmen si Escamillo est son nouvel amant. Les cordes roulent et déroulent sept fois une gamme chromatique, descendante et montante, dans le grave, comme le flux et le reflux de la mer en tempête. Excédée, Carmen finit par déclarer, vibrante d'orgueil, qu'elle n'aime plus que le torero.
Nouveau silence de l'orchestre de la salle, pendant que les chœurs et la fanfare de coulisse racontent, de loin, les incidents de la lutte, sur les six premières mesures de la « Marcha torera ». Alors, tout l'orchestre de la salle lance quatre fois, à grand fracas, le thème de la fatalité. On dirait quatre banderilles enflammées enfoncées dans les flancs du héros du drame.
La dispute de José et de Carmen s'est passée comme un combat sanglant dans l'arène. L'instant de la mise à mort est venu. Carmen veut s'enfuir dans le cirque. José l'empêche encore de s'échapper. Alors, elle enlève la bague qu'il lui avait donnée et la lui jette à la face. Dans la coulisse, les chœurs hurlent « Victoire ! » et entonnent le refrain de l'Air du toréador. Escamillo a frappé au cœur le taureau.
Carmen essaye encore de fuir. Ivre de fureur, don José la poursuit et la blesse mortellement. Une dernière fois, les bois et les violons répètent fortissimo le thème de la fatalité. Don José s'écroule sur le corps inanimé de la gitane, en criant son désespoir dans une phrase qui est à la limite de la souffrance humaine. Phrase mélodique bouleversante et qui se termine sur une cadence mutilée qui a je ne sais quoi de démentiel et semble jaillie d'un cauchemar. Phrase qui tranche, par son pathétique, sur les musiques les plus tristes du monde.
FINALE
Dans la suite d'épisodes contrastés qui forment cette partition pour toujours respirante, on cherche vainement la discontinuité, les disparates, les ruptures que l'emploi du dialogue parlé et le mélange du plaisant et du sévère devaient y engendrer. D'un bout à l'autre, la musique de Carmen est nourrie par le rythme intérieur que Beethoven appelait « le rythme de l'esprit ». Grâce à quelques motifs qui reparaissent là où ils sont nécessaires, grâce, surtout, au thème qui désigne à la fois la fatalité et la gitane magicienne, Bizet atteint à cette « ténébreuse et profonde unité » de Baudelaire.
Le chef-d'œuvre a je ne sais quoi de physique, comme une palpitation artérielle, une chaleur animale, une vitalité de bête fauve. De là, peut-être, l'attirance, l'émerveillement subis par le grand public depuis soixante-quinze ans, malgré la variabilité des modes et des coutumes.
***
Chef-d'œuvre populaire, a-t-on dit. Sans doute. Et d'abord parce que recherches irritantes ni calculs subtils n'y apparaissent. La musique se déroule d'un plein courant. A peine, à la surface, des reflets d'irisation, des rayons soudains. Les richesses, les nouveautés harmoniques sont déposées au fond comme les paillettes dans le sable d'une rivière aurifère.
On croit généralement que, pour conquérir la faveur de la foule, un musicien doit se soumettre aux méthodes faciles et usées. Pour plaire aux auditeurs innombrables de Carmen, Bizet ne s'est pas proposé d'écrire de la musique populaire. Il a tracé, sur le papier, sa musique à lui, selon sa pensée, son cœur et son génie. On ne fabrique pas de la musique populaire comme certains compositeurs troussent de la musique de salon.
Les ouvrages bâclés pour le peuple sont ceux que le peuple rejette au bout de peu de temps. Ce sont les œuvres hardies, fortes qui, finalement, triomphent auprès du peuple. En musique comme dans les autres arts, le peuple a le sens de la beauté vraie. Sens qui n'est ni flétri ni vicié comme chez les pédants et les blasés. Le peuple se prend d'instinct à l'originalité, à l'audace.
Si mordant et prompt que soit son esprit et si frémissante sa sensibilité, Bizet, Parisien de Montmartre, a un tempérament robuste et sain qui correspond à celui du peuple dont il est issu. C'est pourquoi le peuple a, dès les premières représentations, adopté Carmen, comme, quatorze mois auparavant, à l'extrême pointe de l'Europe, la jeunesse populaire russe avait adopté Boris Godounov. Entre le musicien slave et le compositeur français, il y a une parenté et quelque chose comme la courbe d'un même destin. De sept mois plus jeune que Bizet, Moussorgski est moins savant en son art que son aîné. A leurs débuts, ils sont tentés par la musique légère, où leur verve se déploie à bon compte ; ils s'arrêtent, tous deux, à l'éclat extérieur du métier.
Moussorgski, qui n'est pas embarrassé par son bagage d'école, arrive plus vite au libre et au profond de son inspiration. Dès 1869, il a terminé la première version de Boris Godounov. Sa partition qu'il a retouchée est jouée pour la première fois au Théâtre Marie de Saint-Pétersbourg, le 24 janvier 1874. La critique pétersbourgeoise est violemment hostile au musicien de Boris, comme la critique parisienne sera, quatorze mois plus tard, hostile au musicien de Carmen.
En revanche, le public populaire accueille avec enthousiasme Boris. Le musicologue Stassow a écrit à ce sujet : « Souvent des cortèges de jeunes gens chantaient la nuit, par les rues, sur les ponts de la Neva, les chœurs de la partition. »
Moussorgski et Bizet sont deux personnages extrêmes de la musique. Le style de l'un diffère essentiellement du style de l'autre. Des rapports étroits ne peuvent être établis qu'entre leurs tendances, leurs luttes victorieuses contre le dogmatisme, leurs aspirations au rajeunissement des formes musicales et les révélations dont ils nous frappent. A plus de deux mille kilomètres de distance, ils agissent dans le même sens. Ils remettent en fusion le drame musical et installent le réalisme sur la scène lyrique.
Au sujet des musiciens partisans du conformisme, Moussorgski écrit : « Sans esprit ni fermeté, ces gens se perdent dans les liens enchevêtrés de la tradition... ils s'essoufflent à faire le déjà fait et ce que personne ne leur demande... Ils ne prennent aucun intérêt à l'essentiel de la vie. Jusque dans l'empire des nuées, on ne pourrait découvrir des êtres plus inutiles à l'art moderne. » Plus loin, il fait sa profession de foi. « La vie partout où elle se montre, dit-il, la vérité, fût-elle désespérante, l'audace, la franchise devant tout le monde, sans concession, voilà mon levain, ma ligne de conduite à laquelle je tacherai de ne pas faillir. » Et, enfin : « L'expression sincère, à bout portant, voilà ce que je veux et ce que je crains de manquer. »
Avec plus de nuances, Bizet soutient des idées analogues, ainsi qu'on a pu l'observer dans les extraits de sa correspondance cités plus haut. Il n'aborde pas de front les problèmes qui le préoccupent, mais sous forme détournée et sous d'autres aspects que l'artiste russe. A son corps défendant, il se plie à l'ancien système. Tandis que le musicien de Boris n'y met pas tant de façons et invente sa musique au fur et à mesure qu'il la rédige de sa main brûlante, le musicien de Carmen rit sous cape des conventions, combine son plan et parvient à ses fins sans appuyer, en souplesse, par une docilité superficielle et trompeuse et en n'introduisant ses éléments originaux que par voie de culture.
En faisant succéder les lumières aux ombres, les périodes arrondies ou fleuries aux périodes tragiques, en ménageant des pauses dans la conduite de la partition, Bizet atteint, plus facilement et dans le vif, l'âme populaire. Sans qu'on y prenne garde, il insinue et fait accepter son message étrange, violent ou doux. Message qui se change en poison, quand il pénètre dans les régions intimes des consciences et des sensibilités mal éveillées. Carmen n'est pas seulement une œuvre d'art forte, neuve et dont a profité toute l'activité des compositeurs qui ont suivi. La musique de Bizet prête aussi une telle intensité au réalisme de ce drame de l'amour charnel que l'action s'en est prolongée dans la vie et que ses effets se sont fait sentir jusque sur notre état de société. N'est-ce pas parmi les auditeurs influencés par le dernier acte de Carmen que le crime passionnel a recruté ses amants sanguinaires et ses jurés attendris ?
***
A l'entrée de Bougival, Bizet habitait une villa de deux étages. La façade donnait sur la route nationale dont elle n'était séparée que par une avant-cour de deux mètres de large. Jusqu'au pont de Bougival, la route s'appelle aujourd'hui rue Ivan-Tourgueniev. La maison était entourée aux ailes de deux bandes de terrain où s'élevaient six marronniers. A l'arrière-cour, quelques tilleuls et vernis du Japon, au milieu desquels étaient disposées trois corbeilles de fleurs. Derrière, aménagée au-dessus de la cuisine du rez-de-chaussée, une petite terrasse d'où l'on pouvait voir la nappe verte et mouvante de la Seine. Le bâtiment était adossé au chemin de halage.
Actuellement, la maison, sise au n° 5 de la rue Tourgueniev, est occupée par Mme Gass et sa famille qui ont bien voulu m'autoriser à visiter de nouveau chaque pièce. Elle subsiste à peu près dans l'état où elle était au moment où Bizet, sa femme et son fils y résidaient.
La chambre du grand musicien se trouvait au premier étage. On y montait par un petit escalier intérieur qui existe toujours. A la droite du couloir, une porte par laquelle on entrait dans la pièce assez étroite et qui ne prenait jour sur la route nationale que par une seule fenêtre. Au fond, l'alcôve où Bizet a expiré et qui n'a pas été conservée.
Le 2 juin 1912, nous avons inauguré une plaque de marbre, apposée par les soins des journaux Musica et Excelsior, pour rappeler que Georges Bizet est mort dans cet immeuble. Depuis, j'ai fait de nombreux séjours à Bougival. J'ai souvent passé et repassé devant le pavillon où s'est éteint, en pleine force de l'âge et du génie, le maître français.
***
Il y a une trentaine d'années, Jacques Bizet m'avait conduit à Bougival pour revoir la maison où s'était produit le drame qui provoqua la mort de Georges Bizet.
Le fils du musicien de Carmen était à l'époque un gros gaillard nerveux, exubérant et despotique. Homme de goût, de plaisir et d'érudition, il avait été le condisciple de Marcel Proust. Il en était resté l'ami intime. Il avait quelque chose de bizarre et d'inquiétant dans sa tenue, ses propos et son regard. On eût dit que, par son agitation et sa gaîté forcée, il voulait sans cesse écarter de son esprit les soucis ou les angoisses qui le tourmentaient. Nous nous sommes arrêtés pendant une heure, sous la fenêtre du premier étage où Georges Bizet avait l'habitude de se tenir. Puis, Jacques Bizet m'entraîna plus loin, vers le pont.
Ce jour-là, c'était, comme on disait, « la fête du pays ». Des baraques de marchands, d'athlètes, de pythonisses, de bateleurs, des stands de tir, des manèges de chevaux de bois avaient été dressés sur le terre-plein des bords de la Seine. Il y avait peu de monde. Des pianos mécaniques et des orgues de Barbarie moulaient tristement leurs rengaines. Trois lourdes commères, en maillots roses, demandaient vainement à un jeune soldat de monter sur l'estrade pour se mesurer avec elles dans la lutte gréco-romaine. Sans plus s'occuper de moi, Jacques Bizet lia conversation avec le troupier et s'éloigna avec lui de quelques pas. Comme je donnais des signes d'impatience, il quitta son compagnon de hasard, avec des démonstrations de soudaine sympathie, et revint à mes côtés. Nous nous dirigeâmes enfin vers la station de tramways pour rentrer à Paris.
Nous marchions à larges enjambées, lorsque Jacques Bizet s'immobilisa de nouveau devant la roulotte d'une voyante foraine, — roulotte à l'écart des autres baraquements. Deux gitanes vieillissantes, en longues robes fripées et de couleurs criardes, invitaient les rares passants à entrer pour se faire prédire l'avenir. Malpropres, le visage ridé, terreux et fier, la taille encore souple et la démarche majestueuse, elles avaient l'air de deux princesses d'Orient tombées à la vieillesse et à la misère. Mon compagnon leur dit qu'il était musicien et leur demanda si elles connaissaient des chants tsiganes anciens. Aussitôt la plus âgée des deux bohémiennes se mit à fredonner, d'une voix éraillée, une complainte tantôt nostalgique, tantôt pleine d'emportement.
Jacques Bizet s'excusa subitement de ne pouvoir retourner à Paris en même temps que moi. Il s'élança sur le marchepied de la roulotte et, aidé par les deux zingaras, s'enfonça dans la voiture des nomades. Il se montra encore dans l'encadrement de la petite fenêtre de la guimbarde pour me dire adieu, jusqu'au revoir. A cet instant, où une lueur du soleil couchant errait sur son visage, il ressemblait d'une façon saisissante aux portraits que j'avais de son père.
***
La nuit tombait. Le dernier tramway pour la porte Maillot était parti. Pour regagner la capitale, je devais aller à pied jusqu'à la gare de Chatou et prendre, là, le train pour Paris. Au moment de me mettre en route, je m'arrêtai, cloué sur place. A l'intérieur de la roulotte, un violoniste jouait, avec une virtuosité intuitive, tour à tour véloce et nuancée, le dernier Entr'acte de Carmen. Je n'ai jamais entendu exécution plus incorrecte ni plus incisive de ces pages.
Quand ce fut fini, un dialogue s'engagea entre mon ami et une gitane à la voix grave et voilée. Dans le vent du soir, leurs paroles ne me parvenaient que confuses et mêlées aux bruits lointains de la fête foraine.
La bohémienne avait-elle -mal compris les explications de Jacques Bizet et pensait-elle qu'elle était en présence du musicien de Carmen ? Ou Jacques Bizet, qui était parfois vantard et brouillon, voulait-il laisser croire qu'il était Georges Bizet en personne ? Troublé par les événements de cette journée, écrasé de fatigue, j'en arrivais moi-même à identifier le père avec le fils. J'avais l'étrange sentiment qu'à travers la paroi de la roulotte des devineresses tsiganes, comme à travers la brume et la barre ténébreuse de l'au-delà, Georges Bizet, levé des profondeurs et ranimé, parlait, invisible et présent, de son art et de sa vie, avec son ardeur coutumière.
— Pour avoir composé cette musique de soleil et de feu, murmurait la vieille zingara, il faut avoir vécu à Triana, dans l'une de nos tribus, il faut être imprégné de notre canto jondo.
— Votre Andalousie ne m'est apparue qu'en songe, répondait Bizet. C'est à Paris, à Bordeaux et à Bade que j'ai connu de façon effective vos musiques et vos musiciens, vos sortilèges et vos sorcières. Depuis mon enfance, j'ai été conquis à vos clans, attiré par votre genre d'existence et vos mystères, fasciné par vos danses et vos chants. Je n'avais que quinze ans quand vous autres tsiganes vous êtes entrés dans ma vie, avec votre musique d'une sensualité fiévreuse et d'un tour si libre, avec votre fatalisme, vos joies délirantes et coupées de lamentations, avec votre mélancolie sauvage.
***
« Ce jour-là, en sortant de chez moi, poursuivait Bizet, au lieu de prendre le chemin du Conservatoire, je me suis mis à remonter la pente qui menait au village de Montmartre. Je me proposais de pousser jusqu'à la rue Saint-Vincent pour voir la maison habitée par Hector Berlioz. Je me suis perdu dans les venelles et les sentiers qui serpentaient au bord ou à travers les vignes et les jardins de banlieue. Arrivé à l'église Notre-Dame de Clignancourt, j'ai fait halte devant les tentes plantées par des bohémiens autour du sanctuaire. D'un groupe de vanniers et d'étameurs, une fillette de mon âge se détacha pour venir à moi. Elle me proposa de lui acheter deux petits paniers, d'affreuses images, des fétiches. J'avais une trentaine de sous. Elle prit mon argent et ne me donna en échange qu'une petite main de justice en ivoire.
Quand je lui eus appris que je me consacrais entièrement au service de la musique, elle changea d'attitude et mit tout en œuvre pour me retenir et m'intéresser. Au lieu de me montrer où se trouvait la maison de Berlioz, rue Saint-Vincent, elle me prit par la main et me conduisit jusqu'aux bastions où plusieurs campements de bohémiens étaient établis.
Six couples, se faisant vis-à-vis, dansaient au milieu d'un cercle formé par des marchands de chevaux, des tireuses de cartes et des enfants dépenaillés. Tous avaient les pieds nus. Ils frappaient des mains en cadence. De temps en temps, une gitane se détachait de la foule pour exécuter, seule, une série de pas, où la fureur sensuelle le disputait à la noblesse. Parfois une zingara entonnait un chant, d'une voix tantôt nasillarde, tantôt caverneuse. Un violoniste, un guitariste et un joueur de tympanon improvisaient, sans trêve, une musique vive, capricieuse ou caressante, pleine de nostalgie et d'une étonnante richesse expressive. Ma petite compagne de Notre-Dame de Clignancourt se mit, elle-même, à bondir et tournoyer avec tant d'impétuosité provocante que je ne pus m'empêcher d'applaudir. Quand elle eut terminé, elle me toisa avec pitié, fierté ou mépris, attrapa le bras d'un tsigane dégingandé et s'éloigna avec lui en me faisant des grimaces. J'eus ainsi la révélation du canto jondo et de l'âme flamenca.
— Vous étiez une proie facile. La gitanilla n'at-elle pas essayé de s'accrocher à vous ?
— Je n'ai jamais pu la revoir. Trois jours après notre rencontre, je suis retourné au village de Montmartre. Toute trace de campement avait disparu, sur les bastions et autour de Notre-Dame de Clignancourt.
— Vous lui aviez pourtant confié qui vous étiez et où vous habitiez.
— Elle savait tout de moi et je ne connaissais rien d'elle. Son souvenir ne m'a jamais quitté ni la musique qui la passionnait et la faisait entrer en transes. Quand je croyais l'avoir oubliée, elle se rappelait à moi brusquement. Je remarquais que toutes les femmes qui m'attiraient avaient quelque chose d'elle : celle-là son regard noir et fiévreux, celle-ci, son teint de caraque ; une autre, sa taille pliante et élancée ; une autre encore, sa voix étrange, enrouée et triviale. Les deux ou trois femmes que j'ai aimées lui ressemblaient. Elles étaient insolentes, légères et rusées. Je croyais qu'elles s'étaient attachées pour toujours à moi. Elles m'ont trahi bassement. Mon art m'a trahi, lui aussi.
— Comment pouvez-vous parler ainsi ? Bien des cœurs féminins n'ont dû battre que pour vous. Et vous avez apporté, en musique, des idées qui n'avaient pas encore cours.
— En art, ce qui fait le succès, c'est le talent et non l'idée originale. Le public ne comprend l'idée que plus tard. Pour arriver à ce plus tard, il faut que le talent de l'artiste, par une forme aimable, lui fasse la route facile et ne le rebute pas dès le premier jour. Je me suis efforcé à avoir ce talent-là. Je n'y ai pas réussi.
— On reconnaîtra un jour votre valeur.
— Oui, j'étais destiné à avoir raison quelques années trop tôt. Me voici au bout du chemin. Au moment où je me suis fait le serment de n'écrire de musique que ce qui est digne d'en être écrit, j'ai été frappé par le destin. Je suis à demi paralysé et sourd d'une oreille. Dans l'état misérable où je me trouve, comment espérer composer d'autres œuvres et ramener à moi la femme qui m'est plus chère que tout ? Il ne me reste rien de ma joie ni de ma force. Où découvrir un repos à ma détresse ? Je n'ai plus qu'à disparaître. Vous autres gitanes, vous m'avez appris la liberté de chanter, d'aimer, de vivre. Et la liberté de mourir à l'heure désignée par moi seul. Le mauvais sort qui poursuit depuis des siècles vos tribus errantes s'est communiqué à mon existence, s'est abattu sur moi. La petite main de justice en ivoire que la zingarella m'a vendue à Montmartre était une main tragique, une main tyrannique, une main augurale. Ses cinq doigts levés et plats étaient comme les doigts du destin. C'est pourquoi, peut-être, le thème de la fatalité qui sillonne ma partition de Carmen n'est que de cinq notes.
— Vous, si vif, si riant, et qui composiez votre musique si facilement...
— Si facilement ! A mes derniers ouvrages, j'ai tout donné de ma peine, de mon sang, de mon existence. Ceux qui auraient dû me comprendre et me couvrir de leur autorité sont restés de glace devant mon œuvre et ma souffrance. Je ne peux plus me plier aux édits ni aux dits d'imposteurs devenus puissants. Je fuis leurs regards faux, envieux, ennemis. Je les méprise et leur pardonne parce que le destin qui me frappe les guette aussi. Dans cette société, il faut être dupeur ou dupe. Je ne veux être ni l'un ni l'autre. Je reste seul avec ma douleur. Et comme je refuse la douleur...
— Tu oublies ton père et ton fils.
— Ils ignoreront toujours que je me suis moi-même délivré de mes tortures. Ils se consoleront. L'un est trop jeune, l'autre trop âgé pour me porter l'aide qui réconforte et qui sauve. Je leur laisse de quoi subsister. Ce sont eux qui seront payés de mes sacrifices. Adieu. »
***
Ces mots avaient-ils été prononcés par le malheureux grand musicien ? Ou n'étaient-ils nés que dans mon esprit ? Dans l'espace où Georges Bizet avait vécu ses heures suprêmes, j'étais comme enveloppé de ses souvenirs, sans cesse évoqués au cours de cet après-midi.
La nuit était tombée. J'attendais depuis une demi-heure, à la gare de Chatou, quand j'aperçus Jacques Bizet, la mine égarée et défaite. Il se précipita sur moi, me serra dans ses bras et me dit :
— J'ai eu la faiblesse d'ouvrir mon portefeuille devant les deux gitanes pour les payer de m'avoir tiré les cartes. Elles m'ont habilement soutiré tout l'argent que je possédais. Je n'ai même plus de quoi acquitter le prix du billet pour rentrer à Paris. Rendez-moi donc le service de me prêter la petite somme qui m'est nécessaire pour le voyage.
A l'habitude loquace et surexcité, Jacques Bizet garda le silence pendant le trajet. Quelles sombres prédictions lui avaient-elles été faites par les cartomanciennes foraines ? je ne l'ai jamais revu. Plus tard, j'appris qu'il s'était suicidé
APPENDICE
« CARMEN » AU THÉATRE-LYRIQUE
Fille du ténor Marié, Galli-Marié était née à Paris en 1840. Elle avait débuté, à dix-neuf ans, au Théâtre des Arts de Rouen. A l'âge de vingt-deux ans, elle était engagée à l'Opéra-Comique. Après avoir paru dans le rôle de Zerbine de la Maîtresse servante, de Pergolèse, elle avait repris l'Ombre, de Flotow et créé Fior d'Aliza, de Victor Massé, Lara, de Maillard, Mignon, d'Ambroise Thomas. Brune, d'une taille peu élevée et ronde, elle était douée d'un puissant mezzo qu'elle avait mis longtemps à assouplir. Encore meilleure comédienne que chanteuse, elle séduisait par sa physionomie expressive, par la vivacité de son jeu, par son expérience et son assurance scéniques.
Meilhac et Halévy avaient difficilement consenti à l'attribution du rôle de Carmen à Galli-Marié. Ils craignaient que l'interprétation de la créatrice de Mignon fût trop conventionnelle. Pour tenir le rôle de la bohémienne, ils préféraient, comme je l'ai dit, Zulma Bouffar, frétillante chanteuse d'opérette. Grâce à Du Locle et à Ponchard, le choix se porta finalement sur Galli-Marié, qui avait été informée de l'engagement éventuel de Zulma Bouffar.
On s'explique ainsi la mauvaise humeur dont témoigna Galli-Marié pendant les premières répétitions de Carmen. Forte de ses droits de vedette de l'Opéra-Comique et irritée par les hésitations que les auteurs avaient eues avant de lui distribuer le rôle, Galli-Marié ne mit plus aucun frein à ses exigences ni à ses prétentions. On se rappelle qu'elle avait fait recommencer treize fois l'air d'entrée de Carmen. Comme tous ceux qui l'entouraient, elle n'avait pas d'abord bonne opinion de la musique de Bizet dont la nouveauté la déconcertait.
Georges Bizet n'était pas patient de nature. Il se prêta pourtant de bonne grâce aux désirs ou aux caprices de sa principale interprète. Au bout de quelques jours, toute opposition cessa. Sensible et intelligente, la cantatrice fut peu à peu conquise à l'art et à l'esprit du musicien. A la veille de la répétition générale, elle était saisie au plus profond d'elle-même par le génie de Bizet. Le soir de la première représentation, elle se désespérait de constater que le public ne se laissait pas aisément persuader par les trouvailles de Bizet, par son langage brûlant, neuf et direct, par son art vivant et osé.
L'attrait mystérieux qui réside dans la figure de l'héroïne de Mérimée s'était irrésistiblement communiqué à Galli-Marié. Elle fut Carmen et resta Carmen jusqu'à la fin de sa vie. Elle n'échappa plus au personnage qui s'était inscrit dans sa voix, dans sa chair et dans son âme.
On a prétendu que sous l'empire et la hantise du rôle de Carmen, elle avait acquis, comme la sorcière gitane, un sens divinatoire. Ernest Guiraud a raconté que le 3 juin 1875, pendant qu'à Bougival Georges Bizet était à l'agonie, Galli-Marié, qui chantait ce soir-là Carmen pour la trente-troisième fois devant le public de la salle Favart, avait eu plusieurs crises de larmes. Elle ne pouvait expliquer les motifs de son angoisse. Elle aurait ainsi pressenti qu'à une vingtaine de kilomètres de là, Bizet rendait le dernier soupir.
Cette légende, propagée par Guiraud et reprise par Charles Pigot et d'autres biographes de Bizet, ne répond pas à la réalité des faits. La trente-troisième représentation de Carmen avait eu lieu, à l'Opéra-Comique, le 2 juin et non le 3 juin. Le soir de la mort de Bizet, le spectacle de la salle Favart était composé du Chalet et de la Dame Blanche.
Après la mort de Bizet, Galli-Marié se repentait amèrement d'avoir harcelé avec ses exigences le compositeur tant regretté. Par ses récriminations incessantes, par les changements qu'elle s'entêtait à réclamer dans la partition, par ses sautes d'humeur, n'avait-elle pas contribué aux fatigues qui avaient ruiné la santé de Bizet ? De plus, ne s'était-elle pas attachée à Bizet, comme on l'a raconté, par des liens intimes qu'elle avait brusquement rompus, dans les jours qui ont précédé la mort du grand musicien ?
Avant d'imposer définitivement Carmen à l'Opéra-Comique, le 27 octobre 1883, elle joua le chef-d'œuvre à Bruxelles (après Mlle Dérivis), à Bordeaux, à Naples, à Madrid, à Barcelone, à Gênes, à Dieppe, à Florence. En 1881, à Gênes, elle interpréta le rôle de Carmen, avec une sincérité si convaincante que le ténor qui lui donnait la réplique dans le rôle de don José se prit au jeu et, d'un coup de poignard, transperça la joue de sa partenaire. Galli-Marié termina, malgré sa blessure, la représentation. Les jours suivants, elle continua de chanter Carmen, avec un pansement sur son visage balafré.
Coûte que coûte, il lui fallait poursuivre la tâche de dévouement et de diffusion qu'elle s'était assignée. Elle avait une dette de conscience, des obligations de toutes sortes envers la mémoire de Georges Bizet.
De son vivant, Bizet n'avait pu faire jouer aucune de ses œuvres à l'étranger. Ce n'est que la veille de sa mort qu'il signa un traité avec Jauner, directeur de l'Opéra de Vienne, pour les représentations de Carmen dans la capitale autrichienne. Le chef-d'œuvre fut monté sur la grande scène viennoise, quatre mois et demi après le décès du grand musicien. Encore la partition avait-elle été modifiée pour la circonstance. Une grande partie du dialogue parlé fut supprimée et remplacée par des récitatifs chantés, composés en hâte par Ernest Guiraud. En outre, le ballet du deuxième acte fut augmenté de la « Danse bohème » de la Jolie Fille de Perth. Le succès alla surtout au quatrième acte, à cause du défilé de la cuadrilla qui fut acclamé.
La version établie par Guiraud fut adoptée par tous les théâtres de l'étranger. A Vienne, le 23 octobre 1875, Mlle Ehnn fut la créatrice du rôle de la bohémienne. Le 8 février 1876, Carmen fut représentée à Bruxelles, avec Mlle Dérivis dans le principal rôle. Le 22 juin 1878, Mlle Minnie Hauck chantait pour la première fois Carmen à Londres, au Théâtre Her Majesty's. Déjà, le 10 mars 1878, le chef-d'œuvre avait été monté au Théâtre Marie de Saint-Pétersbourg. A Berlin, en 1880-1881, Carmen fut jouée vingt-trois fois de suite. Dans les derniers jours de l'année 1878, l'œuvre de Bizet avait été transportée aux Etats-Unis, où trois tournées successives la faisaient connaître aux auditoires de New York, San Francisco, Boston, Philadelphie, Chicago, La Nouvelle-Orléans et des autres grandes villes du Nouveau-Monde.
Treize jours après la mort de Bizet, l'Opéra-Comique effectuait sa clôture annuelle. A la réouverture, Carmen était encore affichée treize fois, du 15 novembre 1875 au 15 février 1876. Du Locle était tombé malade. Il croyait trouver la guérison en Egypte. Du 6 novembre au 23 décembre 1875, il séjourna au Caire. Pendant son absence, il fut remplacé, à la tête de la salle Favart, par Charles Nuitter, archiviste de l'Opéra. A son retour à Paris, Camille Du Locle était plus gravement souffrant qu'auparavant. Le 5 mars 1876, il fut contraint de quitter la direction de la salle Favart, où il laissait un déficit de 100.000 francs. Pour l'année 1875, le chiffre global des recettes n'avait été que de 947.265 francs. A ses fonctions d'administrateur général de la Comédie-Française, Emile Perrin ajouta celles de directeur de l'Opéra-Comique jusqu'au 15 août 1876. Pendant son intérim, Carmen ne fut pas jouée. Léon Carvalho fut alors appelé à prendre la direction du théâtre de la place Boieldieu.
On attendait que Carvalho, ami et protecteur de Bizet à ses débuts, remontât aussitôt Carmen. Il n'en fut rien. Ce n'est que sept ans plus tard et lorsque le chef-d'œuvre français eut triomphé sur les grandes scènes musicales de la province et de l'étranger, qu'il se décida à faire reparaître Carmen sur l'affiche de la salle Favart.
La reprise eut lieu le 21 avril 1883. La pièce venait d'être remaniée. Le rôle de Carmen avait été transposé pour le soprano léger d'Adèle Isaac, colorature en vogue dont on disait qu'elle était « un éléphant qui a avalé un rossignol ». De plus, les deux derniers actes avaient été insuffisamment répétés et l'exécution de la partition, à dessein, édulcorée et ralentie. La distribution, peu conforme aux désirs exprimés par Meilhac et Halévy, était la suivante :
Carmen : Mmes Adèle Isaac
Micaëla : Merguillier
Frasquita : Dupuis
Mercédès : Chevalier
Don José : MM. Stéphanne
Escamillo : Taskin
Le Dancaïre : Labis
Le Remendado : Barnolt
Zuniga : Maris
Moralès : Collin
Les admirateurs de Bizet, dont le nombre s'était accru avec les années, protestèrent avec énergie contre le nouveau masque dont on avait affublé la bohémienne de Mérimée. Carmen fut remise en répétitions par Carvalho. Galli-Marié, dont on n'avait pas oublié les démêlés qu'elle avait eus avec Bizet, avait été écartée de la distribution. Elle fut rappelée pour reprendre le rôle qu'elle avait brillamment créé. Bilbaut-Vauchelet fut désignée pour le rôle de Micaëla.
Le 27 octobre 1883, le chef-d'œuvre reparut dans la version originale, légèrement écourtée. « Ce fut le triomphe complet, absolu de Bizet », écrivit Ludovic Halévy. Le 22 décembre 1883, on célébrait la 100e représentation de Carmen et le 30 janvier 1885, la 200e représentation. Depuis, le drame lyrique de Meilhac, Halévy et Bizet, tiré de la nouvelle de Mérimée, constitua le spectacle le plus fréquemment joué sur les scènes musicales du monde entier. Carmen est l'œuvre du répertoire qui a fait encaisser et continue de faire encaisser les plus fortes recettes.
La Presse parisienne, dont les critiques, au lendemain de la création de Carmen, maltraitaient et injuriaient le grand musicien, fit amende honorable. En 1890, elle organisait, avec le concours de Jean de Reszké, Lassalle, Galli-Marié et Melba, une représentation de gala de Carmen, dont le produit a servi à l'érection du monument à Georges Bizet.
L'Opéra-Comique donnait, le 21 octobre 1891, la 500e représentation de Carmen et, le 23 décembre 1904, la 1.000e représentation avec la distribution suivante :
Carmen : Mmes Emma Calvé
Micaëla : Marie Thiéry
Frasquita : Tiphaine
Mercédès : Costes
Don José : MM. Clément
Escamillo : Dufranne
Le Dancaïre : Cazeneuve
Le Remendado : Mesmaecker
Zuniga : Félix Vieuille
Moralès : Soulacroix
Au cours de l'année présente (1950), le chef-d'œuvre de Bizet a dépassé, à la salle Favart, la 2.600e représentation. Toutes les cantatrices qui se sont illustrées sur nos théâtres lyriques et dont le médium était suffisamment sonore ont eu l'ambition de paraître dans le rôle de Carmen. On a même vu, après Mme Adèle Isaac, la célèbre colorature Adelina Patti s'attaquer, non sans imprudence, au personnage de la gitanilla.
Jusqu'à la 1.000e de Carmen, les plus notables de nos chanteuses qu'on a pu applaudir à Paris, sous les traits de la bohémienne, étaient : Mmes Castagné, Deschamps-Jehin, Vaillant-Couturier, Tarquini d'Or (qui devint la compagne du chansonnier réaliste Aristide Bruant), Nardi, Fouquet, Sigrid Arnoldson, Emma Calvé, Charlotte Wyns, Nina Pack, de Nuovina, Zélie de Lussan, Cécile Thévenet, Jenny Passama, Marié de l'Isle, Bressler-Gianoli, Georgette Leblanc, Claire Friché, Marie Delna.
Après 1904, des cantatrices non moins nombreuses se montrèrent dans le rôle de Carmen : Mmes Maria Gay, Mérentié, Lucienne Bréval, Marthe Chenal, Brohly, Mary Garden, Hélène Demellier, Marthe Davelli, Lise Charny, Alice Raveau, Madeleine Mathieu, Conchita Supervia, Ninon Vallin, Hélène Bouvier, Anduran, Pocidalo, Renée Gilly, Lily Djanel, Solange Michel, Suzanne Darbans, Suzanne Chauvelot, Jacqueline Lussas.
Bien peu de ces cantatrices semblent avoir lu avec attention le récit de Prosper Mérimée pour nous restituer l'image de la zingarella, telle que l'écrivain l'avait tracée. Pourtant, à la scène cinq du premier acte de leur livret, Meilhac et Halévy avaient donné les détails suivants : Entrée de Carmen. Absolument le costume et l'entrée indiqués par Mérimée.
Reportons-nous à la nouvelle pour trouver le vrai visage de Carmen. La première fois que Mérimée rencontra Carmen à Cordoue, sur le quai qui borde la rive droite du Guadalquivir, il nous décrit ainsi la bohémienne.
Elle avait dans les cheveux un gros bouquet de jasmin, dont les pétales exhalent le soir une odeur enivrante. Elle était simplement, peut-être pauvrement vêtue, tout en noir... En arrivant auprès de moi, ma baigneuse laissa glisser sur ses épaules la mantille qui lui couvrait la tête... je vis qu'elle était petite, jeune, bien faite et qu'elle avait de très grands yeux... Sa peau, d'ailleurs parfaitement unie, approchait fort de la teinte du cuivre. Ses yeux étaient obliques mais admirablement fendus ; ses lèvres un peu fortes mais bien dessinées et laissant voir des dents plus blanches que des amandes sans leur peau. Ses cheveux, peut-être un peu gros, étaient noirs, à reflets bleus comme l'aile d'un corbeau, longs et luisants... C'était une beauté étrange et sauvage, une figure qui étonnait d'abord, mais qu'on ne pouvait oublier. Ses yeux avaient une expression à la fois voluptueuse et farouche que je n'ai trouvée depuis à aucun regard humain...
Plus loin, lorsque don José fait sa confession à Mérimée, l'écrivain la dépeint avec plus d'exactitude encore, au moment où elle s'arrête devant lui, à la porte de la Manufacture de Séville.
Elle avait un jupon rouge fort court qui laissait voir des bas de soie blancs avec plus d'un trou, et des souliers mignons de maroquin rouge attachés avec des rubans couleur de feu. Elle écartait sa mantille afin de montrer ses épaules et un gros bouquet de cassie qui sortait de sa chemise. Elle avait encore une fleur de cassie dans le coin de la bouche, et elle s'avançait en se balançant sur ses hanches comme une pouliche du haras de Cordoue. Dans mon pays, une femme en ce costume aurait obligé le monde à se signer. A Séville, chacun lui adressait quelque compliment gaillard sur sa tournure ; elle répondait à chacun, faisant les yeux en coulisse, le poing sur la hanche, effrontée comme une vraie bohémienne qu'elle était...
Quand elle va danser la romalis, chez le colonel des dragons d'Almanza, puis à la taverne de Lillas Pastia, elle apparaît ainsi à don José :
Elle était parée, cette fois, comme une châsse, pomponnée, attifée, tout or et tout rubans. Une robe à paillettes, des souliers bleus à paillettes aussi, des fleurs et des galons partout. Elle avait un tambour de basque à la main.
Don José la revit à Gibraltar « habillée superbement : un châle sur ses épaules, un peigne d'or, toute en soie... » Bien mieux, Mérimée avait représenté lui-même Carmen et don José sur une aquarelle qu'il avait offerte à Ferdinand de Lesseps, à Barcelone, en 1846. Cette aquarelle se trouve à la bibliothèque de l'Opéra, où chacun peut l'examiner à loisir. Je dois avouer que, dans la vingtaine de chanteuses qu'il m'a été donné de voir dans le rôle de Carmen, aucune d'entre elles ne m'a laissé l'impression d'avoir suivi, ni dans le jeu ni dans l'accoutrement, le signalement que Mérimée a fait, avec minutie, de son héroïne.
Après Lhérie, nombreux sont les ténors qui abordèrent le rôle de don José et, entre autres, Stéphane, Mauras, Mouliérat, Lubert, Leprestre, Maréchal, Engel, Saléza, Alvarez, Caruso, Muratore, Salignac, Clément, Beyle, Lauri-Volpi, Devriès, Francell, Sens, Ovido, Trantoul, Fontaine, Lapelletrie, Friant, Micheletti, R. Girard, Lugo, Verdière, Luccioni, Kriff, Thygesen. Pour camper le rôle du Navarrais, ils ne se sont guère inspirés, eux non plus, du portrait dessiné par Mérimée :
C'était un jeune gaillard, de taille moyenne mais d'apparence robuste, au regard sombre et fier. Son teint, qui avait pu être beau, était devenu, par l'action du soleil, plus foncé que ses cheveux... Cheveux blonds, yeux bleus, grande bouche, belles dents, les mains petites, une chemise fine, une veste de velours à boutons d'argent, des guêtres de peau blanche... sa figure, à la fois noble et farouche, me rappelait le Satan de Milton.
J'ajoute que, sur l'aquarelle de Mérimée qui appartient à une collection de Barcelone, le visage de don José est orné de longs favoris. Nul ténor, à ma connaissance, ne s'est soucié des indications de l'écrivain et n'a voulu faire de don José un homme blond avec une touffe de barbe de chaque côté de la figure. Presque tous les chanteurs chargés du rôle de don José nous changent l'amant de Carmen en cavalier brutal et noirâtre, quelque chose comme un Othello de la banlieue sévillane.
Parmi les interprètes d'Escamillo, retenons les noms de Taskin, Max Bouvet, Cobalet, Soulacroix, Delvoye, Dufranne, Vanni-Marcoux, Ghasne, Albers, Audoin, Vigneau, Boulogne, Ponzio, Baugé, Bourdin, Jeantet, E. Rousseau, Legros, Dens. Et parmi les chanteuses qu'on distingua plus particulièrement dans le rôle de Micaëla, il faut citer : Bilbaut-Vauchelet, Rose Delaunay, Simonnet, Molé-Truffier, Guiraudon, Marie Thiery, Mastio, Aïno Ackté, Nelly Martyl, Vallandri, Lucy Vauthrin, Brothier, Gastardi, Denya, Coiffier, Geori-Boué, Irène Joachim, Angelici, Madeleine Gorge, Ginette Gaudineau.
« Carmen » et la mise en scène du drame lyrique
Décors ni costumes de Carmen qu'on nous présente sur les théâtres lyriques n'ont été exécutés d'après les descriptions qu'en a faites Prosper Mérimée dans son récit. Décorateurs ni costumiers ne se sont beaucoup souciés des annotations scéniques de Meilhac et Halévy. Voici, par exemple, ce qu'en écrivent les librettistes de Carmen en tête du premier acte :
« Une place à Séville. — A droite, la porte de la Manufacture de tabac. — Au fond, face au public, un pont praticable traversant la scène dans toute son étendue. — De la scène on arrive à ce pont par un escalier tournant qui fait sa révolution à droite, après la porte de la Manufacture de tabac. — Le dessous du pont est praticable... » Et, plus loin : « ... La garde montante débouche, venant de la gauche, au fond, et traverse le pont... Enfin, quand le premier acte se termine : ... Carmen s'enfuit... Arrivée au milieu du pont, elle s'arrête un instant, jette sa corde à la volée par-dessus le parapet et se sauve. »
Dans le décor du premier acte qu'on nous montre aujourd'hui, l'escalier qui n'est pas « tournant » conduit à une terrasse qui ne ressemble d'aucune façon à un pont. Nul parapet n'est visible. Le « dessous » de cette terrasse qui fait office de pont (ou si vous préférez l'arche et la berge), n'est pas « praticable ». Il est impossible de régler des mouvements de personnages sur le plan vertical pour varier la mise en scène et occuper l'espace théâtral.
Les indications fournies par Meilhac et Halévy pour les décors et la mise en scène des trois actes suivants ne sont pas davantage respectées. La scène de la salle Favart n'a pas suffisamment de profondeur pour les décors de plein air.
On conçoit parfaitement qu'afin de correspondre aux visions des générations successives, les mises en scène de Carmen se transforment avec les modes et les goûts qui changent. A présent, on condamne le réalisme des décors, surtout quand il s'agit d'ouvrages lyriques.
Un décor théâtral doit être un véritable tableau, un paysage avec figures, brossé selon les principes de l'art pictural. Il faut que les teintes des costumes et des accessoires s'harmonisent avec les couleurs des paysages ou des intérieurs. Dans une maquette, un peintre-décorateur qui travaille pour la scène ne saurait, en aucun cas, manquer à la justesse des valeurs, bousculer les rapports de tons ni s'épargner les recherches des volumes, des équilibres, du rythme, du style. Pour régler les éclairages, faire mouvoir et grouper les personnages et placer les touches vivantes et colorées des costumes — n'envisageons que le côté visuel —, le metteur en scène ne peut se dispenser de connaître les lois qui régissent la peinture et l'architecture.
La mise en scène du drame musical demande une technique spéciale. Une technique qui ne s'apparente que de loin à celle du drame parlé. Une technique où est nécessaire un goût informé non seulement de la peinture, de la sculpture et de l'architecture mais aussi de la musique, de la danse, du cinéma et de la poésie. En bref, une culture très étendue y est devenue indispensable.
Autrefois les théâtres lyriques ne pouvaient subsister et prospérer que grâce aux nouveautés qu'ils jouaient chaque saison et dont les auditeurs se laissaient pleinement persuader. Depuis quelques années, les ouvrages lyriques inédits dont on essaye n'accrochent même plus l'attention du public qui s'y passionnait jadis. Il y a plusieurs motifs à cette indifférence de nos contemporains aux pièces lyriques nouvelles, qu'elle qu'en soit la valeur. J'y vois une raison majeure qui, à mon sens, détermine toutes les autres raisons : le caractère démodé, routinier et discordant des mises en scène des œuvres lyriques nouvelles.
***
Il faut bien nous rendre à cette évidence : dans le spectacle théâtral moderne, après les rôles des auteurs, les rôles dominants appartiennent désormais au « directeur de la production » et au metteur en scène. Comme au cinéma, l'écrivain dramatique, le compositeur de musique, le décorateur, les interprètes et tous ceux qui collaborent à la création d'une œuvre théâtrale doivent, après avoir lié leurs travaux et échangé leurs réflexions, se soumettre aux décisions du directeur et du metteur en scène. Si mortifiante qu'elle soit pour les praticiens de la vieille école, cette toute-puissance se justifie aisément. De nos jours, n'est-ce pas l'idée que le directeur et le metteur en scène se font d'un ouvrage dramatique qui est exposée et imposée au public ? Pour donner à l'ouvrage lyrique nouveau sa forme achevée, directeur et metteur en scène doivent, pour le moins, être égaux, par le talent et l'érudition, aux auteurs et à tous ceux qui participent à la création du spectacle.
Le Zarathoustra de Nietzsche prédisait déjà, en son temps : « Dans le monde, les meilleures choses ne valent rien sans quelqu'un qui les mette en scène... »
Enfermés dans leur rêve, auteur et compositeur dramatiques n'apportent le plus souvent au directeur et au metteur en scène qu'une œuvre qui n'a pas été écrite pour un théâtre donné, une œuvre qui n'a pas le style de représentation requis. Style de représentation éloquent, fait pour toucher et subjuguer le public. C'est au directeur et au metteur en scène de rendre l'œuvre en question vivante, attachante, durable, d'en augmenter la valeur théâtrale, en la remodelant, en quelque sorte, pour les nécessités de la scène et les désirs profonds des auditeurs présents et futurs.
Jacques Copeau qui, avec Stanislawsky, Meyerhold, Gordon Craig et Appia, fut l'un des premiers régénérateurs subtils et passionnés de la mise en scène, a dit : « L'habitude technique, la compréhension profonde, le degré d'enthousiasme peuvent et doivent fomenter chez le metteur en scène une inspiration seconde qui se déclenche au contact de l'œuvre d'autrui. » Où trouvons-nous cette inspiration seconde chez nos metteurs en scène lyriques ?
La mise en scène du drame musical exige des calculs, des recherches et des soins encore plus attentifs et plus nombreux que la mise en scène du drame parlé. Il s'agit de faire mouvoir chaque personnage d'après le rythme particulier que lui a assigné le compositeur dans sa partition ; d'accorder les éclairages et les teintes des décors et costumes avec le lieu de l'action, l'évolution de l'intrigue, la matière musicale ; de faire correspondre les harmonies et les lignes mélodiques avec les couleurs, les contours des décors et les taches mobiles des costumes ; de projeter, si l'on peut dire, la musique sur la toile peinte ; de transposer scéniquement, par des artifices à la fois discrets et frappants, les thèmes essentiels de la partition ; de créer l'atmosphère musicale voulue ; de renforcer le sens et la portée de chaque épisode ; de communiquer au style général de la présentation scénique le style particulier de la partition, etc. Il est inutile d'entrer à fond dans cette question dont le développement nous entraînerait trop loin.
Chaque artiste peut imaginer une mise en scène pour Carmen, sous la condition qu'il pénètre les intentions des auteurs, qu'il approfondisse le plan et les particularités du chef-d'œuvre, qu'il en éclaire les replis secrets et nous en donne, en traits ardemment expressifs, une idée tout ensemble vivante, pénétrante, enrichissante. Il s'agit d'abord de puiser dans le texte toutes les indications scéniques des auteurs, tant pour les jeux de scène que pour les aspects des personnages et la plantation des décors. C'est là une méthode qui vient tout de suite à l'esprit. Bien peu des metteurs en scène la suivent. A voir les mises en scène qu'on nous présente aujourd'hui, on constate que les avis et les conceptions des auteurs de Carmen sont oubliés, ignorés ou dédaignés.
***
Il est convenu que Carmen est une œuvre réaliste. Reste à savoir si le naturalisme est compatible avec la musique. Du seul fait qu'un drame est lyrique, ce drame est au-dessus ou en dehors du réalisme. Schopenhauer a dit que la musique nous révèle la vérité profonde, la vérité dont nous n'avons pas conscience nous-mêmes. On ne saurait enfermer le drame lyrique dans le décor servilement copié d'après nature.
Le naturalisme musical instauré par Bizet avec Carmen est un naturalisme intérieur et, si j'ose dire, spiritualisé. Si l'on veut que la musique soit réalité, elle ne peut être que réalité transfigurée. Quoi qu'on fasse et prétende, la musique, malgré ses incitations à la sensualité, est émanation de l'âme et pure construction de l'esprit. Comment en effectuer la traduction scénique et, selon l'expression de Mallarmé, « l'incorporation visuelle » ? Là, doivent intervenir l'ingéniosité, l'imagination et le goût de l'animateur théâtral qui passera au fil de son intelligence l'œuvre qui lui est confiée.
Comme les autres chefs-d'œuvre, Carmen n'a pu conserver l'aspect qui lui fut donné à l'époque de sa création. La présentation théâtrale s'en est modifiée, selon les visions qu'en avaient les générations nouvelles et dans des moments et des milieux différents. A la mise en scène de Ponchard a succédé celle de Carvalho, puis celle d'Albert Carré qui, notablement altérée, est encore conservée pour les spectateurs actuels de l'Opéra-Comique. Depuis près d'un demi-siècle, on se tient à cette dernière mise en scène, captivante et habile en son temps, mais aujourd'hui inacceptable parce qu'elle ne tient aucun compte des progrès techniques ni des variations des goûts et des mœurs.
Pierre-Aimé Touchard, administrateur de la Comédie-Française, a justement dit que, pour correspondre aux modes et aux styles qui changent, il est indispensable que mises en scène, décors et costumes des œuvres restées au répertoire soient renouvelés tous les dix ans.
Nous sommes loin de compte avec Carmen. Il y a une dizaine d'années, le peintre Dignimont avait bien établi de nouvelles maquettes de décors et de costumes. Harmonies, valeurs et rapports de tons, finement ménagés sur les maquettes originales, ont été vite bouleversés par l'ignorance de ceux qui sont chargés de l'ordonnance des spectacles de l'Opéra-Comique. Le décor que Dignimont avait conçu pour le troisième acte a été remplacé par un ancien décor qui est à l'opposé de la manière du peintre et fait disparate avec les décors des trois autres actes. Les costumes ont été changés au gré des interprètes et diffèrent sensiblement de ceux que Dignimont avait dessinés. La gamme des rouges et des bruns échelonnée par le peintre a été dérangée et brouillée. Ces atteintes portées au crédit et au talent d'un artiste de valeur et qui entachent sa technique sont d'autant plus choquantes qu'elles se sont produites sur une scène lyrique d'Etat.
Les maquettes des décors et des costumes sont, elles aussi, des œuvres d'art auxquelles profanes ni barbouilleurs ne doivent apporter de retouches. Rappelons-nous les maquettes de Bérain, de Boucher et, de nos jours, celles de Bakst, Benois, Braque, Chirico, Drésa, Dethomas, Dufy, d'Espagnat, Gontcharova, Henri Matisse, Picasso, Rouault et leurs émules. Il est aussi inexcusable de modifier les tracés et les effets de couleurs de leurs maquettes, que de changer et remanier les phrases mélodiques et les harmonies de la partition d'un compositeur de marque.
Pourtant, même les maquettes de peintres rusés et en renom finissent par ne plus répondre aux vœux ni aux vues des générations nouvelles. Pour accrocher l'attention des publics jeunes et dissidents ou blasés et tard venus, il faut, à certaines dates, varier, équiper à neuf les présentations des œuvres lyriques les plus mémorables. Sans quoi, elles risquent de perdre de leur mordant et de leur portée.
***
Carmen est l'un des chefs-d'œuvre de la scène musicale qui se prêtent le mieux aux transformations subies ou exigées par le monde moderne. Ses épisodes d'une fadeur gracieuse ou d'une allégresse facile font oublier les vérités tragiques qui s'y trouvent encloses. A l'audition des passages pathétiques, on sent remuer en soi les instincts et les passions cachés en toute âme humaine. Et un souffle mystérieux, un souffle comme venu de l'enfer passe et repasse sur cet opéra-comique éclairé par la lumière dure de Séville. A l'instar des vieilles sorcières de Macbeth, Carmen, petite sorcière juvénile et provocante, veut évoquer « les esprits noirs, blancs, rouges et gris ». A la fin du drame, il semble qu'un fantôme, « puissance inconnue », s'est dressé devant don José, comme devant Macbeth, pour lui ordonner :
« Sois orgueilleux, sanguinaire et tendre. »
Pendant mon passage à la direction de l'Opéra-Comique, j'avais formé le projet de rectifier, sinon de moderniser la mise en scène de Carmen, afin de la rapprocher de l'optique et du caractère de notre temps. Il s'agissait, d'abord, de régler avec plus d'ingéniosité, sinon d'art, les allées et venues des personnages sur la place de Séville, au premier acte ; de rendre plus expressives les danses des deux gitanes et moins ridicule « la promenade aux flambeaux » d'Escamillo, au deuxième acte ; de rétablir la première phase du combat entre don José et Escamillo et d'accuser le côté inquiétant de la scène du « Trio des cartes », au troisième acte ; de coordonner et diversifier les mouvements de la foule, au dernier acte. Jeux scéniques dont la maladresse sautait aux yeux et qui avaient été peu à peu introduits par des acteurs insoucieux de la tenue esthétique de l'ensemble du spectacle.
Quand j'ai proposé ces premières améliorations, je me suis heurté à l'opposition de ceux qui se considéraient comme les tenants de la routine infatuée d'elle-même, de la vulgarité fière d'être vulgaire et, si vous voulez, d'une tradition inviolable. Tradition qui s'était pourtant notablement corrompue avec les années. Des raisons misérables étaient opposées à mes desseins. Dans sa présentation discordante, irritante, Carmen n'attirait-elle pas toujours la foule ? Pourquoi se donner la peine de faire disparaître les erreurs de mise en scène, de cette mise en scène malavisée et qui sent le renfermé ? Pourquoi empêcher les interprètes de se costumer à leur fantaisie et d'aller ainsi à l'encontre des intentions du peintre-décorateur et des auteurs eux-mêmes ? Les manquements et les injures à l'art n'influaient en rien sur les recettes.
Par respect pour la mémoire de Bizet et pour la satisfaction des spectateurs qui ont encore du goût, il serait nécessaire, j'en suis sûr, de renouveler du tout au tout la traduction théâtrale de Carmen pour la remettre au point de vue actuel. Au moyen d'artifices scéniques peu compliqués, on pourrait en faire paraître la signification profonde, révéler quelque chose de la magie particulière à la gitane (Carmen n'est-ce pas, aussi, un drame de la sorcellerie ?), indiquer le cheminement du motif de la fatalité à travers l'action scénique, imprimer à la pièce entière le style musical propre à Bizet, renoncer, enfin, aux procédés périmés de « théâtralisation » qui, auprès des auditoires nouveaux, ôtent de sa qualité et de sa force irradiante à la partition du maître français.
Tandis que sur certains théâtres de l'étranger — comme ceux de Prague ou de Moscou — on s'efforce de donner un intérêt vivant aux nouvelles présentations de Carmen et de retenir l'attention des jeunes générations avec les méthodes et les éléments artistiques de notre époque, on s'en tient, chez nous, à une mise en scène ancienne, immuable et, en beaucoup d'endroits, faussée.
Récemment, on a vu à Pforzheim, près de Bade, une Carmen dont « l'action se passait dans l'Espagne d'aujourd'hui ». Les dragons d'Alcala portaient l'uniforme des Phalangistes et se saluaient le bras tendu. La Manufacture de tabac de Séville était une usine dont les ouvrières étaient appelées au travail non plus par des sons de cloche, mais par les stridences d'une sirène. Les contrebandiers étaient changés en guerilleros. Quant à Carmen et à ses compagnes — cigarières ou contrebandières — elles se pavanaient en des robes luxueuses de vamps du pire goût germanique. Cette mise en scène ridiculement inspirée du fascisme n'a rien à voir avec l'art ni, bien entendu, avec le chef-d'œuvre de Bizet.
Un ballet inspiré de « Carmen »
Roland Petit, danseur hardi et savant et maître de ballet bien inspiré à ses heures, a fait exception à la règle de paresse qui présidait jusqu'à présent à la mise en scène de Carmen. Il a transformé l'œuvre de Bizet en ballet. Conception qui peut se défendre, à la rigueur. La partition de Carmen est, comme on l'a souvent dit, de caractère chorégraphique. En la composant, Bizet n'avait jamais pensé, pourtant, qu'elle pût servir de ferment ni d'argument à un ballet.
De formation classique mais de tendance moderne, Roland Petit, qu'on peut ranger dans l'avant-garde artistique, avait combiné un drame chorégraphique rempli de trouvailles plastiques, d'évolutions curieuses, d'élans neuf et variés. Noverre avait enseigné, dès le dix-huitième siècle, que le langage de la danse est susceptible de traduire tous les sujets tragiques ou comiques. Et le langage chorégraphique de Roland Petit, qui a pour base la syntaxe traditionnelle, est brûlant et original. En passant par son esprit, la danse espagnole, trépidante et brutale, se fond dans la danse classique abstraite et ailée et y perd ses duretés, sa brutalité sensuelle et sa fière animalité.
Si Roland Petit n'avait pas annoncé sur ses affiches que son ballet était « inspiré » de Carmen, de Georges Bizet, et s'il n'avait pas fait servir à ses desseins de chorégraphe fantasque la partition du maître parisien, on aboutirait, en définitive, à des éloges sur son compte. En réalité, son ouvrage chorégraphique est tout à l'opposé du conte de Mérimée et de l'opéra-comique de Bizet. De plus, le jeune maître de ballet a déchiqueté, dénaturé, bouleversé de fond en comble une partition absolument unique dans l'histoire musicale.
C'est ainsi que la Habanera chantée par Carmen à son entrée, au premier acte, a été déplacée et attribuée à don José qui exécute une danse tragique sur cette chanson populaire, malicieuse, riante, enveloppante. En revanche, le refrain de caserne des Dragons d'Alcala, qui est entonné par don José, au deuxième acte, sert à une danse de Carmen. La Romalis chantée par la bohémienne dans le cabaret de Lillas Pastia est devenue une danse de la gitane sur les pointes. Le finale du premier acte a été reporté au dernier tableau du ballet. Sauf un chœur, changé en « chœur parlé en mesure », toutes les parties chantées ont été transposées et confiées à divers instruments.
Je vous fatiguerais à vous dire avec quel aveuglement ou quel sans-gêne les « extraits » de la partition de Carmen ont été disloqués, intervertis, ravagés. Je ne peux pourtant pas passer sous silence l'impression de froissement pénible qu'on éprouve au cinquième et dernier tableau de cet étrange ballet. La musique admirable de la scène finale où Nietzsche découvrait « tout l'esprit tragique qui est l'essence de l'amour » a été tout simplement supprimée. Elle a été remplacée par un interminable solo de timbales ! C'est pendant que retentissent sans arrêt les coups de mailloche assenés sur la caisse claire ou sur la grosse caisse, que don José crie son amour désespéré et poignarde la femme qui ne l'aime plus et le repousse après l'avoir subjugué et plongé dans l'abjection et le crime.
J'ajoute que, sous le coup d'une contrainte singulière, les mouvements des pages arrachées à la partition pour la fabrication du ballet en question ont été complètement altérés et l'instrumentation décolorée et appauvrie pour les besoins d'un orchestre réduit. Les ingéniosités d'écriture, la richesse des timbres, le jeu audacieux des tonalités, les précieuses propriétés de cette musique pour jamais mémorable ne sont plus sensibles à aucun moment. On croit entendre une de ces « mosaïques », un de ces « pots pourris » bâclés pour quelques instrumentistes médiocres qui opèrent dans les cafés ou les kiosques d'obscures villes d'eaux.
Roland Petit a cru en agir comme la troupe d'acteurs noirs qui ont fait du chef-d'œuvre une curieuse adaptation appelée Carmen Jones. Adaptation où Carmen et don José étaient métamorphosés en nègres de Harlem et Escamillo en boxeur. Cette Carmen, sous la forme d'un grimaçant opéra-jazz a fait courir, pendant deux ans, le public de New York. C'est également aux Etats-Unis que la Carmen valsante et acrobatique du chorégraphe français Roland Petit a obtenu le succès le plus bruyant.
Qu'on renouvelle décors, costumes, mise en scène de Carmen, selon le goût ou la fantaisie d'artistes modernes, rien de plus fondé ni parfois de plus louable. Qu'on traite même et développe d'autre manière le sujet conçu par Mérimée, c'est encore admissible. Les facultés de transposition ont leurs mérites. Que, du moins, on ne nous présente pas sous un jour contraire la partition de Georges Bizet qui marque l'une des trois ou quatre dates essentielles de la musique théâtrale.
Presque toutes les grandes œuvres ont eu à subir des travestissements burlesques. Carmen n'a pas échappé aux parades, aux gaudrioles ni aux accoutrements improvisés par des satiriques badins ou des railleurs industrieux. A ma connaissance, il y a eu quatre parodies du chef-d'œuvre de Bizet : la Petite Carmen (1902), la Revanche de don José (1904), Mam'zelle Carmen (1916) et Carminetta (1917). Faut-il ajouter à cette liste peu recommandable Carmen Jones et la Carmen tournée en ballet ? Poussé à ce point, le genre parodique devient choquant et presque diffamatoire, même quand il est accommodé à l'état présent de l'art.
Lettres de Bizet (1857-1871), Paris, 1909 (Delagrave).
Lettres à un ami, Paris, 1909 (Calmann-Lévy).
Portraits et études par Hugues Imbert, Paris, 1894 (Fischbacher).
Symphonistes et virtuoses par Marmontel, Paris, 1881 (Fischbacher).
Notes d'un librettiste par Louis Gallet, Paris, 1891 (Calmann-Lévy).
Georges Bizet et son œuvre par Charles Pigot, Paris, 1881 (Delagrave).
G. Bizet, sa vie et son œuvre dans l'Année musicale de Camille Bellaigue, Paris, 1890 (Delagrave).
Le Crépuscule des idoles par Fr. Nietzsche, traduit par Henri Albert (Mercure de France).
Un demi-siècle de musique par Julien Tiersot, Paris, 1918 (F. Alcan).
Georges Bizet par Paul Landormy, Paris (F. Alcan et Gallimard).
Correspondance générale de Mérimée, recueillie par M. Parturier, Paris, 1943.
Lettres d'Espagne par Mérimée, Paris, 1927.
Bizet et l'Espagne par Raoul Laparra, Paris, 1935 (Delagrave).
Souvenirs par David d'Angers, Paris, 1928.
Mérimée par le Marquis de Luppé, Paris, 1943 (Albin Michel).
Carmen de Bizet par Charles Gaudier, Paris, 1923 (P. Mellottée).
Vie et Aventures de Céleste Mogador par Françoise Moser, Paris, 1935 (Albin Michel).
Vincent d'Indy par Léon Vallas, Paris, 1949 (Albin Michel).
Mémoires de Céleste Mogador, Paris, 1876 (Librairie Nouvelle).
Giorgio Bizet par Mastrigli (en italien), Rome, 1888.
G. Bizet par Weissmann (en allemand), dans la collection die Musik, Berlin.
G. Bizet par H. Gauthier-Villars, Paris, 1911 (Laurens).
A la recherche de Marcel Proust par André Maurois, Paris, 1950 (Hachette).
Ernest Reyer : Quarante ans de musique publiés par Emile Henriot, Paris, 1909 (Calmann-Lévy).
Portraits et Souvenirs par Camille Saint-Saëns, Paris, 1909 (Calmann-Lévy).
Cinquante ans de musique française, Paris, 1924 (Librairie de France).
Le Guide musical (8, 15 et 22 mars 1914).
Georges Bizet, conférence à l'Opéra par H. Malherbe, Paris, 1922 (Heugel).
La partition de Carmen a été éditée par Choudens et Cie, Paris.
TABLE DES MATIÈRES
Avant-propos
PREMIÈRE PARTIE
LA VIE ET L'ŒUVRE DE GEORGES BIZET
I. — La Jeunesse de Bizet
II. — Bizet en Italie
III. — « les Pêcheurs de perles »
IV. — « la Jolie fille de Perth »
V. — Rencontre avec Céleste Mogador
VI. — Mariage de Bizet
VII. — Geneviève Bizet
VIII. — Transformation progressive
IX. — Suites d'une guerre
X. — « Djamileh »
XI. — « Jeux d'enfants »
XII. — « l'Arlésienne »
XIII. — Parenté entre « l'Arlésienne » et « Carmen »
DEUXIÈME PARTIE
LE MYSTÈRE DE LA MORT DE GEORGES BIZET
XIV. — Le faux échec de « Carmen »
XV. — Georges Bizet s'est-il suicidé ?
XVI. — Les « Carnets » de Ludovic Halévy
XVII. — Les obsèques de Bizet
TROISIÈME PARTIE
PROSPER MÉRIMÉE ET « CARMEN »
XVIII. — Voyages en Espagne
XIX. — La magie de « Carmen »
XX. — Le récit de Mérimée
XXI. — Un écrivain érudit et secret
QUATRIÈME PARTIE
LE LIVRET DE « CARMEN »
XXII. — Les personnages introduits par Meilhac et Halévy
XXIII. — Le scénario de « Carmen »
XXIV. — La musique légère en 1875
XXV. — Bizet a collaboré au livret
XXVI. — Les emprunts au conte de Mérimée
CINQUIÈME PARTIE
LA PREMIÈRE REPRÉSENTATION DE « CARMEN »
XXVII. — Incidents autour de « Carmen »
XXVIII. — La soirée du 3 mars 1875
XXIX. — Vincent d'Indy à la première représentation de « Carmen »
XXX. — Frédéric Nietzsche et Georges Bizet
SIXIÈME PARTIE
LA PARTITION
XXXI. — « Carmen » et la musique espagnole
XXXII. — Le prélude
XXXIII. — Le premier acte
XXXIV. — Le deuxième acte
XXXV. — Le troisième acte
XXXVI. — Le quatrième acte
FINALE
APPENDICE
« CARMEN » AU THÉATRE-LYRIQUE
« Carmen » et la mise en scène du drame lyrique
Un ballet inspiré de « Carmen »