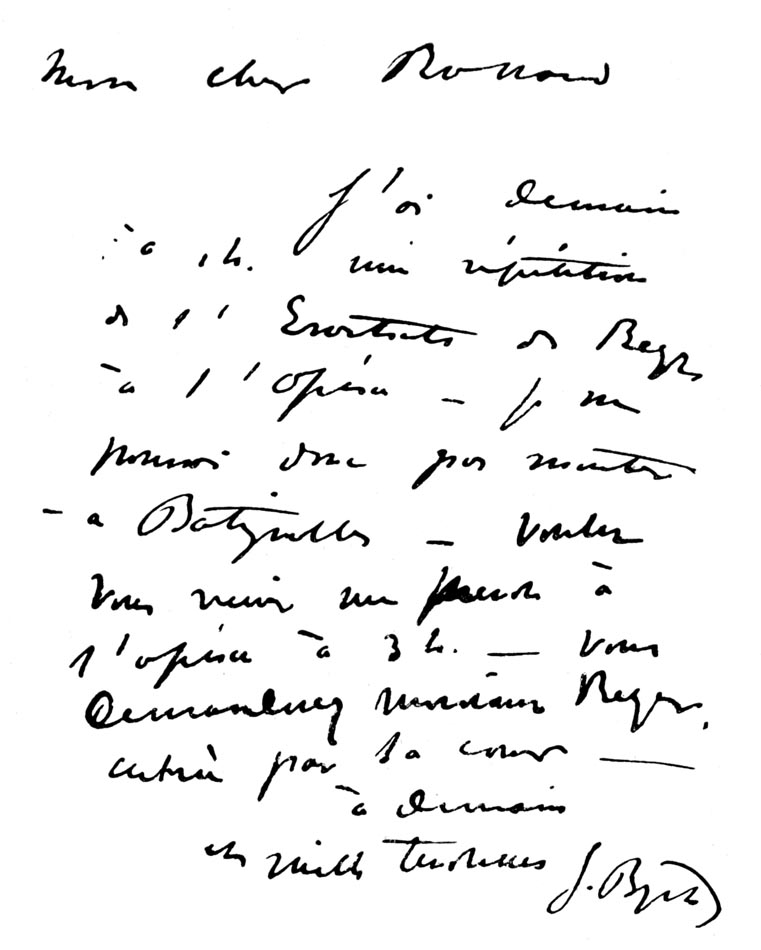
HENRY GAUTHIER-VILLARS
BIZET
biographie critique
(collection les Musiciens célèbres)
Librairie Renouard
Henri Laurens, éditeur
6 rue de Tournon
Paris VIe
1928
TABLE DES MATIÈRES
III. L’ŒUVRE. De Don Procopio aux Pêcheurs de perles
IV. L’ŒUVRE. La Jolie fille de Perth, Djamileh
V. L’ŒUVRE. L’Arlésienne, Carmen
LISTE DES ŒUVRES. BIBLIOGRAPHIE
LA VIE
C'est sous les prénoms royaux d'Alexandre-César-Léopold que, le 25 octobre 1838, à Paris, un modeste professeur de chant nommé Bizet faisait inscrire son fils sur les registres de l'état civil. Mais ces trois noms fastueux ne devaient pas sortir des actes officiels et, dans sa famille, l'enfant fut toujours appelé Georges. La postérité n'y contredit point.
On ne rencontre pas dans les premières années de son adolescence ces indécisions, ces luttes et ces angoisses d'une vocation hésitante ou contrariée qui constituent le fond habituel des jeunesses d'artistes. Par cette anomalie, la biographie de Georges Bizet se distingue nettement de celle de la plupart des compositeurs. Fils d'un professionnel, neveu de Delsarte qui avait épousé la sœur de Mme Bizet, très brillante pianiste, l'auteur de Carmen entra dans l'Art par la large porte du métier dont vivait sa famille. Bénéficiant ainsi d'une hérédité heureuse et d'un enseignement aussi précoce qu'assidu, l'enfant acquit, presque sans s'en apercevoir, une technique solide qui fit de lui, en peu de temps, un harmoniste adroit, un pianiste élégant et surtout, un lecteur infaillible.
Dans ces conditions, la carrière scolaire du petit Georges devait être courte et brillante. En six mois il obtenait le premier prix de solfège et, en deux concours, le premier prix de piano dans la classe de Marmontel. A dix-sept ans, il ajoutait à ces lauriers un premier prix de fugue et un premier prix d'orgue dans la classe de Benoit, et deux ans plus tard le premier grand prix de Rome. Il ne lui restait plus qu'à faire joyeusement ses malles pour l'Italie.
Méthodique, Bizet se trace aussitôt un plan de travail et fixe ainsi ses trois envois réglementaires : un opéra bouffe italien, la Esméralda de Victor Hugo et une Symphonie.
L'Académie, qu'offusque un peu l'oubli de la « Messe » traditionnelle ne laisse pas de réserver néanmoins un aimable accueil aux travaux du bon élève et lui accorde un rapport élogieux, tout en lui faisant remarquer par la bouche d'Ambroise Thomas que « les natures les plus enjouées trouvent dans la méditation et l'interprétation des choses sublimes un style indispensable même dans les productions légères ».
L'opéra bouffe, Don Procopio, enchanta ces messieurs et obtint les suffrages qu'ambitionnait son auteur. La Esméralda, devenue soudain une Symphonie descriptive avec chœurs sur Vasco de Gama, passa plus inaperçue, mais la « Symphonie » muée en « Suite d'orchestre » fut accueillie avec un réel enthousiasme.
Le règlement comportant une année de voyage en Allemagne, Bizet se disposait tristement à quitter Rome lorsque l'idée lui vint de solliciter du ministre l'autorisation de remplacer ce voyage par une prolongation de séjour à la Villa Médicis. Appuyée par le directeur de l'Académie, le bon Schnetz, qui s'était attaché au jeune musicien, la demande fut agréée (*) et Bizet, ravi, put communier de nouveau avec l'art italien en compagnie de son cher Guiraud qui, nanti lui aussi du laurier suprême, venait de débarquer à la Villa.
(*) Voici le dossier administratif, actuellement aux Archives Nationales, qui résulta de ce petit passe-droit :
A. — LETTRE DE GEORGES BIZET
A son Excellence Monsieur le Ministre d'État.
Monsieur le Ministre,
Pensionnaire de l'Académie de France à Rome depuis deux ans, je dois, aux termes du règlement, passer la troisième année de ma pension en Allemagne ; mais désirant remplir en temps et lieux mes obligations envers l'Académie et ayant commencé en Italie un travail important qu'il m'est impossible de terminer avant le mois de juillet prochain, je viens supplier Votre Excellence de vouloir bien m'accorder la permission de passer à Rome cette troisième année de pension. Je craindrais en quittant l'Italie sans avoir achevé mes travaux, de ne pas me trouver en mesure pour l'époque des envois et, d'un autre côté, de ne pouvoir profiter comme je le désire, de mon séjour en Allemagne.
En attendant votre, décision, Monsieur le Ministre, je suis de Votre Excellence le très humble et très obéissant serviteur,
GEORGES BIZET.
B. — APOSTILLE DU DIRECTEUR DE L'ACADÉMIE
Rome, 26 novembre 1859.
Monsieur le ministre,
M. Bizet, pensionnaire musicien, est très studieux et fort intelligent et croit, et je pense comme lui, que le beau ciel d'Italie doit avoir une heureuse influence sur le travail qu'il a entrepris. Il supplie donc Votre Excellence de lui accorder la faveur de passer sa troisième année de pension à Rome. Je prends la liberté de recommander la demande de ce jeune compositeur à toute la bienveillance de Votre Excellence.
Le Directeur de l'Académie,
V. SCHNETZ.
N.-B. — Il pourrait recevoir son traitement ici par les mains de M. le payeur de la division française à Rome.
C. — ARRÊTÉ DU MINISTRE
MINISTÈRE D'ÉTAT ARRÊTÉ
:
Beaux-Arts Au nom de l'Empereur, Le Ministre d'État,
Arrête :
M. Georges Bizet, compositeur de musique, pensionnaire du Gouvernement, est autorisé à passer à Rome la troisième année de son pensionnat.
ACHILLE FOULD.
Paris, le 9 décembre 1859.
(Les pièces officielles indiquent que le traitement de Bizet, lui fut versé par le « payeur du corps expéditionnaire français en Italie ».)
Ces douze mois dérobés à la patrie de Bach, de Beethoven et de Wagner passèrent vite pour celui qu'on devait bientôt traiter de « farouche germain ». L'heure du retour en France sonna.
A Paris, nous trouvons immédiatement — heureux temps ! — notre prix de Rome travaillant à la Guzla de l'Emir, un acte reçu d'avance à l'Opéra-Comique. Cet acte, dû à la plume de Jules Barbier et Michel Carré, mettait en scène, pour la millième fois, la mésaventure du barbon ridicule berné par sa pupille qu'il cherche à épouser malgré elle, et l'obligatoire intervention du bel adolescent faisant triompher, avant la chute du rideau, les droits de la jeunesse et de l'amour. Cette intrigue, sœur jumelle de l'anecdote de Don Procopio, présentait la seule originalité — si l'on ose dire — d'être située en Orient et de se dérouler entre un Emir déguisé, un Cadi, une ingénue nommé Fatmé et un vieux marchand de babouches du nom de Babouc !
L'ouvrage aussitôt terminé entre en répétitions à la salle Favart, quand soudain — époque fortunée ! — Carvalho, directeur du Théâtre-Lyrique, prie Bizet de mettre en musique pour son théâtre trois actes de Michel Carré et Cormon, les Pêcheurs de Perles. Un tel début semble plus honorable au jeune compositeur qui s'empresse de retirer sa partition de l'Opéra-Comique et, ce qui s'explique moins, d'en rendre le livret à son auteur en le priant de placer cette Guzla entre les mains d'un autre musicien. (*)
(*) Michel Carré le trouva : le 30 avril 1873, la Guzla de l'Émir était représentée avec la musique de M. Théodore Dubois.
Carvalho donna, le 29 septembre 1863, la première représentation des Pêcheurs. Le 23 novembre, il en affichait la dix-huitième et dernière. Les amis de Bizet avaient été émerveillés ; le public, courtois ; la presse, pointue. Mais le jeune musicien était désormais classé.
Cinq actes, de Louis Gallet et Edouard Blau, lui parurent dignes de son effort : Iwan le Terrible fut destiné à remplacer les Pêcheurs de Perles sur la scène du Théâtre-Lyrique. Mais cette œuvre volumineuse, entièrement orchestrée et prête à affronter la rampe, ne vit jamais s'en allumer les feux. Les biographes de Bizet affirment même qu'elle fut brûlée par l'auteur, comme l'avait été sans doute celle de la Guzla. Charles Pigot, qui nous a laissé sur Georges Bizet un ouvrage remarquable, à la documentation duquel nous nous référerons docilement au cours de cette élude plus modeste, explique cet autodafé par la conscience que ressentit soudain le compositeur d'avoir cédé à son engouement excessif en faveur de Verdi au point d'abdiquer toute personnalité. Voilà, certes, une explication trop honorable pour que nous osions en rechercher une autre à cette singulière aventure.
Pour la quatrième fois en trois ans, les directeurs des grandes scènes se mirent à ses ordres. Carvalho lui confia un troisième livret en quatre actes, la Jolie fille de Perth, de Saint-Georges et Adenis. En six mois, ce fut une partition achevée (décembre 1866).
Le choix de l'illustre Nilsson pour le rôle de Catherine Glover retarda d'un an la première représentation. On attendit la diva à son retour de Londres ; on laissa passer la canicule pour avoir un public choisi, et lorsque l'hiver fut revenu, l'illustre cantatrice daigna, enfin, chanter.., à l'Opéra, abandonnant Bizet et la Jolie Fille. Mlle Jane Devriès la remplaça. Mais les auteurs se résignaient mal à la perte de la grande vedette ; et songèrent bientôt à reprendre le rôle pour l'offrir à Mme Carvalho. Ce furent de nouveaux retards pour le compositeur qui resta d'ailleurs étranger à ces démarches. Une lettre de Bizet (*) récemment publiée, ne laisse subsister à ce sujet aucune incertitude : « Mes collaborateurs, écrit-il, veulent à toute force Mme Carvalho. Ils ont raison, mais c'est bien dur pour Mlle Devriès !Je vous dis cela sous le sceau du secret. Si vous voulez savoir le fond de ma pensée, j'espère que cela ne se fera pas. J'y perdrai 10.000 francs, dit-on, c'est possible ! Mais..... ».
(*) VI. lettre à Paul Lacombe (publiée par H. Imbert), Fischbacher.
Les 10.000 francs furent perdus. La pièce aussi. Malgré un vif succès de première et une presse favorable, on atteignit à grande peine la dix-huitième représentation (26 décembre 1867).
Mais, pas plus que la bienveillance des directeurs, l'ardeur du compositeur ne se décourage. On va lui livrer un poème pour l'Opéra. Puis, on le supplie de terminer le Noé de son maître Halévy. Il s'y attelle sans retard. Pendant ce temps, l'Opéra-Comique lui commande un ouvrage : il en commence trois, Calendal de Paul Ferrier, Clarisse Harlowe de Philippe Gille et Grisélidis de Sardou. Cependant, à l'Opéra et à l'Opéra-Comique, de grands concours sont ouverts. A l'Opéra le livret est imposé, c'est la Coupe du Roi de Thulé, de Gallet et Edouard Blau : tout en s'en défendant (*), Bizet s'empresse d'envoyer une partition. A l'Opéra-Comique, très discrètement, il prend part également au concours, avec une œuvre mystérieuse dont MM. Soubies et Malherbe sont seuls à affirmer l'existence (**). Le livret, également imposé, était le Florentin de Saint-Georges.
(*) « Je suis embêté. Le grand Lama de l'Opéra me fait relancer par tous mes amis. Il veut que je fasse la Coupe du Roi de Thulé. Il insiste avec rage ! Ça m'embête ! Quel fichu métier ! Si je pouvais en essayer un autre ! » (VIIe lettre à Paul Lacombe.).
(**) Soubies et Malherbe. Histoire de l'Opéra-Comique. T. II, p. 202.
Notons pour l'édification publique qu'à l'Opéra le vainqueur, Diaz, simple amateur, triompha non seulement de Bizet, mais encore de MM. Massenet, Guiraud et Barthe, tous quatre prix de Rome, et qu'à l'Opéra-Comique le champion de la génération fut Lenepveu.
Les lettres de Bizet de cette époque font allusion à d'autres commandes : « Ce que vous avez lu des Italiens est vrai, écrit-il à Paul Lacombe, M. Bagier m'a commandé un ouvrage, mais cela a raté, le poème ne m'allait pas : j'ai lâché ! » (lettre VII). Il commence cinq actes avec Halévy : les Templiers, et si l'on veut bien remarquer que ce fut précisément dans cette courte période, déjà si bien remplie, que se place la composition et l'exécution de deux opérettes, Sol-si-ré-pif-pan aux Menus-Plaisirs et Malbrough s'en va-t-en guerre (en collaboration avec Delibes, Jonas et Legouix) ; si l'on note le ton du jeune auteur parlant des directeurs qui implorent ses partitions (*) on pourra difficilement s'apitoyer sur le sort des prix de Rome de cette époque et sur la tristesse des fameux « cartons » où dorment leurs chefs-d'œuvre dédaignés.
(*) « J'ai envoyé promener l'Athénée ! Mais ils sont venus pleurer chez moi et je leur ai bâclé le premier acte ! » (VIe lettre à Lacombe).
Entre deux partitions dramatiques, Bizet avait fait exécuter au concert Pasdeloup (28 février 1869) une fantaisie symphonique vingt fois remaniée depuis sa conception. Ces Souvenirs de Rome (qui devinrent la Roma éditée par Choudens parmi les œuvres posthumes) ne parvinrent pas à triompher de l'indifférence de la foule.
Le compositeur n'insista pas et revint au théâtre où lui était offert le poème de Namouna que Louis Gallet, sur le conseil de du Locle, avait retiré à Duprato pour le confier, sous le nom de Djamileh, à l'auteur des Pêcheurs de Perles. Malgré l'exhibition sensationnelle d'une Houri mondaine, Mlle Prelly — pseudonyme adopté par la baronne de Presles, née de Pomeyrac, beauté célèbre sous le second Empire mais chanteuse médiocre, entrée par caprice à l'Opéra-Comique (*) — la pièce ne put dépasser onze représentations (22 mai-29 juillet 1872).
(*) Dans une lettre du 4 juin 1872, Gallet écrit avec bonne humeur « La diva baronne de Presles a trouvé son rôle trop long à la première. Elle a du moins permis au public de le croire, car elle a passé 22 mesures dans la ballade persane ». (Communiqué par M. J.-L. Croze).
Mais Carvalho veillait. Nommé directeur du Vaudeville, il trouva le moyen de faire briller dans un théâtre de comédie son musicien favori. Il demanda à Daudet l'Arlésienne et commanda à Bizet une partition de scène quatre mois après Djamileh, le compositeur reprenait contact avec le public.
Quelques représentations devant des spectateurs glacés, et l'exquis spectacle qui lance aujourd'hui des foules enthousiastes à l'assaut de l'Odéon disparaissait de l'affiche.
Pasdeloup, heureusement, était toujours là, prêt à témoigner au compositeur une confiance que chaque échec semblait rendre plus solide. Il recueillait immédiatement la partition et, sous forme de suite d'orchestre, en présentait à son public, le 10 novembre 1872, les pages principales. Et ce fut un succès qui ne se démentit plus, qui, dès l'hiver suivant, força Édouard Colonne à inscrire cette sélection au répertoire du Châtelet, et obtint même au compositeur, le 21 février 1875, l'accès des Concerts du Conservatoire.
Cependant, avant même que Djamileh disparût de l'affiche, la direction de l'Opéra-Comique avait commandé à Bizet un autre ouvrage. Henry Meilhac et Ludovic Halévy furent chargés du livret. Ils le tirèrent d'une nouvelle de Mérimée : ce fut Carmen.
Tout en y travaillant, Bizet amorce d'autres compositions avec une fièvre que rend très émouvante l'approche d'une mort qu'il ne peut soupçonner ! « Il faut produire, écrit-il à Paul Lacombe, le temps passe et il ne faut pas claquer sans avoir donné ce qu'il y a en nous... J'ai des projets d'oratorios, de symphonies..., etc., etc … » Puis, cette information stupéfiante et tranquille : « J'ai fait cet été un Cid en cinq actes. C'est Faure qui m'a lancé dans cette affaire. Je vais lui faire entendre son rôle un de ces jours. Si la chose lui plaît il y aura espoir d'arriver à la grande boutique. » Et encore : « Je vais terminer Carmen à Bougival et y commencer, peut-être y finir, Sainte Geneviève, oratorio en trois parties sur lequel je compte beaucoup. » En même temps il fait exécuter (15 février 1874), au Cirque d'Hiver, Patrie, ouverture symphonique, et aux concerts Colonne une Petite suite d'orchestre sur les Jeux d'enfants qu'il venait de publier pour piano.
Et Carmen vit le jour le 3 mars 1875. M. Henri Rochefort a raconté dans le Figaro du 2 janvier 1908 : « Le soir de la première, Carmen fut sifflée au point qu'on eut peine à entendre la proclamation du nom des auteurs ». C'est bien exagéré. Il n'y eut point de tapage, mais la salle demeura impassible et ennuyée ; pour la première fois, le Tout-Paris qui juge les œuvres inédites se détachait de Bizet et le privait de ce succès d'un soir qui avait adouci ses précédents échecs. Le public, lui, garda son coutumier dédain et la pièce traîna une existence médiocre.
Mais, là encore, nous devons constater une fois de plus le paradoxal privilège de Bizet que nous avons signalé à chaque époque de sa production : allécher les directeurs par des insuccès ! Le 10 mars 1875, sept jours après cette triste première, le Figaro annonçait que M. du Locle venait de commander un nouvel opéra-comique à Bizet et aux deux librettistes de Carmen Meilhac et Halévy. Et, quelques semaines plus tard, le directeur du Théâtre Impérial de Vienne traitait pour les représentations de l'œuvre languissante !...
Hélas, un dénouement brutal survint : le soir de la trente-troisième représentation de Carmen (3 juin 1875) Bizet mourait subitement à Bougival. Le lendemain, son génie ne faisait plus de doute pour personne.
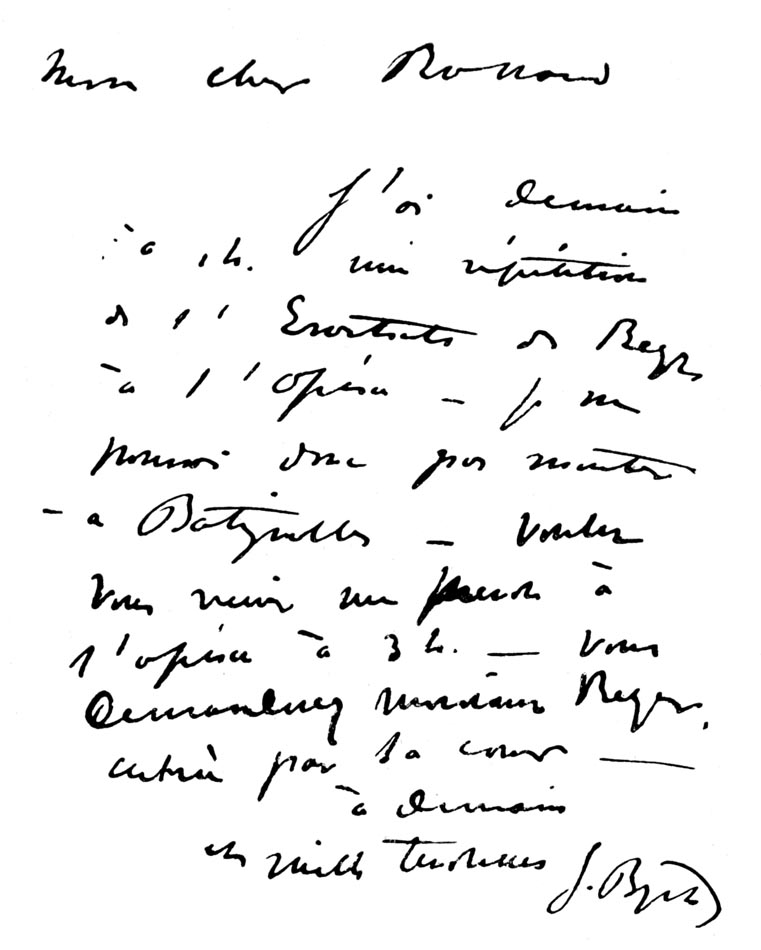
lettre de Georges Bizet à M. Rolland (collection de M. Charles Malherbe)
LE TALENT ET L'ESTHÉTIQUE
Vouloir fixer la psychologie d'un artiste disparu et préciser ses secrètes tendances esthétiques, le plus souvent inconscientes, est toujours une tâche difficile. Lorsqu'il s'agit de Bizet, elle devient singulièrement dangereuse, la physionomie intellectuelle du musicien de l'Arlésienne se composant de traits si étrangement contradictoires que toute analyse semble une trahison. D'autre part, l'excusable manie qui nous pousse à ne pas séparer l'homme de l'œuvre et à parer de toutes les vertus un auteur qui sut charmer nos tympans, nous rend pénible l'observation impartiale de son caractère. La sagesse serait sans doute de s'en tenir aux procédés d'oraison funèbre, à l'esthétique des peintres ou sculpteurs officiels, et de camper un Bizet décoratif, brûlant d'une ardente soif d'idéal nouveau, sacrifiant tout à sa flamme créatrice et mourant crucifié par l'injustice de son siècle. Mais n'y a-t-il pas plus d'irrespect à dresser pieusement un tel mannequin qu'à fixer, le plus équitablement possible, quelques traits d'une physionomie très vivante, avec ses imperfections et ses beautés ? C'est un hommage délicat à la mémoire d'un grand artiste que d'écarter tout ce qu'une piété respectable mais malavisée a pu entasser autour de sa statue. Moins pompeuse, mais moins fade, la réalité a d'ailleurs, pour les amis de Bizet, tout autant de saveur que la légende.
Dès l'enfance de Georges Bizet, nous trouvons les traces de l'importune idolâtrie des biographes. Dans le dessein de rendre immédiatement sympathique le futur auteur de Carmen, ils sont visiblement préoccupés d'en dessiner une trop impressionnante silhouette. A lui toutes les qualités et toutes les vertus ; son superbe avenir éclate à tous les yeux ! C'est ainsi qu'on a cru bien faire en présentant le jeune Bizet comme un enfant prodige. Inattentifs à ce que fut l'enfance de ce fils de professeur de musique, insensibles à l'intérêt que présente la culture d'un jeune sens artistique dans cette atmosphère de pédagogie musicale exaspérée, les fervents de Bizet qui se sont consacrés à la tâche de le faire revivre à nos yeux sont tombés un peu facilement dans ce pieux travers. Ils n'ont pas assez repoussé la tentation d'attribuer à une précocité prodigieuse ce qui — fort heureusement d'ailleurs ! — provenait d'une source plus estimable et plus rassurante. Méthodiquement instruit de son métier par les professionnels laborieux qui composaient son entourage, Bizet-fut le « professionnel » par excellence, admirablement maître de son art, rompu à la pratique de toutes les méthodes d'écriture scolastique avant d'entreprendre la composition, poussant jusqu'à la virtuosité l'étude du piano, vainqueur de tous les concours et triomphateur de tous les examens. Il faut se pénétrer de cette considération pour comprendre sa psychologie musicale si équilibrée et si pondérée, sans rien de commun avec la précocité des petits anormaux auquel on a voulu l'assimiler par vénération indiscrète.
L'excellent Charles Pigot n'a pas échappé à ce léger reproche. Voici en effet avec quelle touchante naïveté il nous présente son jeune héros :
« La façon dont M. Bizet fit la découverte du génie musical de son fils est vraiment curieuse.
« Un jour, qu'il lui faisait chanter une leçon de solfège très ardue, hérissée d'intervalles difficiles, il fut frappé de la justesse avec laquelle il attaquait les différentes intonations sans la moindre défaillance. Il lève les yeux et s'aperçoit que ceux du jeune lecteur sont égarés loin du cahier ouvert sur le pupitre. L'enfant, qui ne se doutait pas d'avoir éveillé l'attention de son maître, continuait à solfier, sans lire, la leçon commencée. Il avait entendu souvent cette leçon à travers la porte et il la répétait sans broncher.
« M. Bizet, qui aimait la musique et la cultivait, autant peut-être par goût que par profession, fut très heureux de la découverte ! »
En cette occurrence, le bonheur de M. Bizet s'explique mal. Ce phénomène très normal de psittacisme ne permettait pas de deviner l'art musical du jeune élève. Quel est le professeur qui, au lieu de l'admirer, n'a pas dû combattre comme un obstacle à tout progrès cette faculté, trop répandue, d'enregistrement inconscient des rythmes et des intonations, qui dispense les sujets médiocres de tout effort personnel ? Une verte semonce et le choix d'un solfège nouveau, voilà, en réalité, tout ce que méritait cette douteuse manifestation de génie chez le petit Georges.
Victor Wilder, également sensible à l'attrait romantique de ce genre d'anecdotes, en situe une analogue à l'entrée de Bizet au Conservatoire.
« Votre enfant (*) est bien jeune, fait-il dire à Meifred chargé de l'examiner et ne manquant pas de « toiser le petit bonhomme avec une moue dédaigneuse ». — C'est vrai, répliqua le père sans se laisser déconcerter ; mais s'il est petit par la taille, il est grand par le savoir — Ah, vraiment ! Et que sait-il faire ? — Placez-vous devant le clavier, frappez des accords et il vous les nommera sans faire une erreur. » L'épreuve fut tentée sur-le-champ. Le dos tourné vers l'instrument, l'enfant nomma sans hésiter tous les accords qu'on lui fit entendre et qu'on choisissait à dessein dans les tonalités les plus éloignées ; en même temps, avec une facilité surprenante, il énumérait rapidement les diverses fonctions de ces accords dans l'ordre où elles se présentaient sous les doigts. Meifred ne put retenir l'élan de son admiration : « Toi, mon garçon, s'écria-t-il, tu vas tout droit à l'Institut ! »
(*) Ménestrel, juin 1875.
Qu'il me soit permis, une seconde fois, de m'étonner de l'enthousiasme de Meifred ! L'exercice de dictée musicale auquel fut soumis le petit candidat est de pratique courante dans les cours de solfège et d'harmonie, et si l'Institut devait être la récompense normale d'un tel exploit, la vénérable bâtisse qui fait l'ornement du quai Malaquais serait contrainte d'agrandir considérablement sa salle de séances, car des milliers de musiciens s'apprêteraient à y prendre place !
Ce qui demeure indiscutable c'est que le métier fut toujours, chez Bizet, complet, et facile. Il avait conquis une réelle notoriété en réduisant à première vue au piano n'importe quelle partition d'orchestre. Berlioz ne cacha pas l'admiration que lui causa ce tour de force. Nous en trouvons le témoignage dans un de ses feuilletons des Débats (*) où il affirme en outre que « depuis Liszt et Mendelssohn on a vu peu de lecteurs de sa force. » Dans le même journal (**), douze ans plus tard, Reyer avouait n'avoir pas connu de « musicien qui fût plus sûr de lui et d'une mémoire aussi prodigieuse ». Nous voyons Bizet, très jeune encore, chargé par les grands éditeurs de travaux importants nécessitant un « tour de main » et une aisance technique indiscutables. Les cent cinquante transcriptions pour piano qu'il exécuta pour Heugel (***), les arrangements à quatre mains des partitions de Faust, Mignon, Hamlet, sont des modèles du genre, tant par l'intelligence des réductions que par le sens pianistique de l'écriture et le bonheur des sonorités orchestrales obtenues au clavier. A vingt-trois ans, chez son maître Halévy, il stupéfiait Liszt en reconstituant instantanément avec un doigté impeccable des traits que l'ex-abbé ne croyait accessibles qu'à ses mains souveraines ou à celles d'Hans de Bülow.
(*) 8 octobre 1863.
(**) 13 juin 1875.
(***) Le pianiste chanteur (six séries).
Dans l'Événement du 6 juin 1875, Armand Gouzien nous a laissé le témoignage de son admiration naïve pour le tour de force accompli sous ses yeux chez Offenbach, où Bizet déchiffra et réduisit au piano, sur le fin manuscrit de Gounod, la partition d'orchestre de Jeanne d'Arc. On connaît également la facilité de ses improvisations et de ses commentaires musicaux. L'Enterrement de Clapisson, où il s'amusait à caricaturer le compositeur de la Fanchonnette, faisant entrer en contrepoint plaisant des extraits de cette médiocre partition et des fragments de la cinquième symphonie de Beethoven, est resté dans la mémoire de ses amis comme le type de la satire musicale. On trouvera dans l'ouvrage de Charles Pigot la joyeuse analyse de cette improvisation descriptive évoquant les funérailles du pauvre Clapisson, les discours du baron Taylor et d'Ambroise Thomas, l'arrivée au séjour des élus, l'accueil de Beethoven, la lutte des thèmes ennemis analogue à celle du prélude des Maîtres chanteurs et le triomphe grotesque du piètre musicien. Enfin, nous voyons Bizet composer et écrire complètement, en six mois, sans abandonner les travaux habituels auxquels il était astreint, toute la Jolie Fille de Perth, et orchestrer sans hâte, en soixante jours, les 1.200 pages de la partition de Carmen (*). Partout, nous retrouvons le bienfait de cette initiation méthodique, de cette enfance baignée de solfège et d'harmonie, de cette assimilation profonde de tous les procédés de son art.
(*) Lettre XXII à Paul Lacombe.
C'est aussi cette particularité qui explique le côté « bon élève » du caractère de Bizet. Ses succès scolaires au Conservatoire, l'orthodoxie de ses doctrines musicales maintinrent une parfaite entente entre ses professeurs et lui. Nous ne rencontrons pas, chez le jeune artiste, ces fougueuses révoltes contre la routine, ces impatiences du joug, ces secrets dédains pour la génération précédente qui se retrouvent fréquemment chez les adolescents créateurs avec plus ou moins d'exagération et de partialité. Élève de Zimmermann, pour le contrepoint, et d'Halévy, pour la composition, il fut tout de suite le disciple préféré de ces deux musiciens dont les qualités pédagogiques l'emportaient de beaucoup sur les facultés inventives. Halévy choyait et présentait partout avec orgueil ce disciple chéri, auquel il finit même par accorder la main de sa fille (3 juin 1869). Bizet sut également se faire un ami de Charles Gounod, qui avait été appelé par Zimmermann à lui servir de répétiteur, et auquel il avait voué une affection et une admiration sans bornes. Dans une lettre adressée de Rome (17 janvier 1860), à Marmontel, il s'exprime ainsi pour stigmatiser le mauvais goût d'un camarade, en lui opposant les Titans de la musique : « Il me parle Donizetti, Fesca... je lui réponds Mozart, Mendelssohn, Gounod !... » Cette progression n'est-elle pas édifiante ? (*)
(*) Mais Bizet ne suivra pas jusqu'au bout l’auteur de Mors et Vita et écrira en 1867 à Paul Lacombe : « Gounod est absolument fou... ses dernières compositions sont navrantes ! » (VIIe lettre).
Les lettres publiées par Marmontel dans Symphonistes et Virtuoses (1880) nous montrent également quel degré d'affectueuse intimité persista entre le jeune compositeur et son ancien professeur de piano, auquel il resta toujours reconnaissant d'avoir fait de ses pianistes de véritables musiciens.
Lorsque Bizet part pour Rome, ses projets d'avenir sont d'un consciencieux fort en thème. Il ne songe pas, comme Berlioz en pareille circonstance, à foudroyer d'admiration l'univers attentif ; tout au contraire, prodigue de témoignages sympathiques à l'esthétique transalpine, il nourrit l'honnête espoir « que l'Académie trouvera beaucoup de progrès dans son style (*) ».
(*) Lettre du 11 janvier 1859.
Gounod, Halévy et Marmontel étant les seuls guides du jeune pèlerin sur les routes de l'Art, il ne faut pas s'étonner outre mesure de l'éclectisme complaisant qui forma toujours le fond de l'esthétique de Bizet, et qui nous trouble un peu chez un artiste d'une incontestable originalité. On a souvent admiré, l'indulgence inlassable de l'auteur de Carmen pour toutes les musiques qui lui tombaient sous les yeux : c'était, par excellence, un juge bienveillant. Dans sa correspondance avec son élève Paul Lacombe, nous trouvons les appréciations suivantes sur les premiers essais que lui soumettait ce modeste compositeur : « Vous êtes un grand musicien... Votre morceau est digne d'un Maître..., avec votre andante, nous voici en plein Beethoven ! Pas de réminiscences, cependant ; votre belle idée vous appartient : soyez-en fier... J'ai joué vingt fois votre morceau et chaque fois je l'ai trouvé plus élevé, plus pur !... C'est d'un charme inexprimable. Voilà de l'inspiration, mettez le nom que vous voudrez là-dessus et ça ne bougera pas d'une semelle !... » etc.
Loin de marcher, comme on se plaisait à
l'imaginer, au premier rang des artistes soucieux de purifier le goût public de
la corruption italienne, il s'écartait du généreux mouvement créé et soutenu par
Berlioz et Reyer en faveur d'une esthétique plus haute. « Ma nature sensuelle,
avoue-t-il, se laisse empoigner par cette musique facile, paresseuse, amoureuse,
lascive et passionnée tout à la fois... j'aime la musique italienne comme on
aime une courtisane !... Je vous l'avoue tout bas, j'y trouve un plaisir
infini !... » etc. Et, tout en gardant à Wagner une rancune étroite et tenace,
il s'empresse de déclarer : « Je suis allemand de conviction, de cœur
et d'âme ! » Cet étrange état d'esprit nous avait déjà été révélé lorsqu'il
multipliait les démarches pour éviter le voyage en Allemagne et prolonger son
séjour à la Villa Médicis. Cet Allemand de conviction, de cœur et d'âme
proclamait : « Rome est la vraie patrie des artistes ! » tout en protestant de
son admiration pour l'auteur de la Symphonie avec chœurs en termes
d'ailleurs un peu déroutants : « Ni Weber avec sa puissante, sa colossale
originalité, ni Meyerbeer avec son foudroyant génie dramatique ne peuvent, selon
moi, disputer la palme au Prométhée de la musique ! » Évidemment, il pouvait
sans audace excessive sacrifier au Prométhée de la musique l'auteur de
Robert-le-Diable, et de telles professions de foi n'avaient rien d'agressif,
surtout si l'on songe à tout ce que l'on avait écrit, dès cette époque, sur ces
brûlantes questions d'esthétique.
Verdi l'enthousiasmait. Il ne tarit pas d'éloges sur l'auteur du Trouvère. En vain ses amis lui objectaient, la vulgarité de certaines pages bâclées par son musicien préféré, il trouvait pour les défendre d'ingénieux arguments : « Quand un Verdi, écrivait-il (*), dote l'art d'une œuvre vivante et forte, pétrie d'or, de boue, de fiel et de sang, n'allons pas lui dire froidement : « Mais, cher Monsieur, cela manque de goût, cela n'est pas distingué. » Distingué !... Est-ce que Michel-Ange, Homère, Dante, Shakespeare, Beethoven, Cervantes et Rabelais sont « distingués » ?
(*) Revue Nationale (3 août 1867) où Bizet tint un seul jour la plume de critique d’art sous l'anagramme de Gaston de Betzi.
On aimerait en revanche lui voir deviner chez le futur auteur de Falstaff cette conscience et cette loyauté artistique à peu près sans exemple qui décidèrent un compositeur triomphant à renier les dieux qui le protégeaient et dont il prévoyait le crépuscule prochain. Au lieu d'admirer ce courageux abandon des succès certains pour une lutte dangereuse en l'honneur d'un plus noble idéal entrevu, Bizet le désavoua au premier pas tenté en avant. Voici comment il jugeait Don Carlos (11 mars 1867) : « Verdi n'est plus italien ; il veut faire du Wagner, il a abandonné la sauce et n'a pas levé le lièvre. Cela n'a ni queue ni tête... Il veut faire du style et ne fait que de la prétention... C'est assommant, four complet, absolu » (*) !
(*) IIe lettre à Paul Lacombe.
On ne saurait donc s'étonner d'entendre Marmontel déclarer que les maîtres favoris de Bizet furent toujours « Auber, Halévy, Gounod et Thomas ». La partition d'Hamlet le plongeait dans l'extase. Au fond c'était à ce genre de musique qu'allaient d'instinct ses sympathies, et le raisonnement seul le poussait à émettre parfois des théories d'art plus libérales. Il ne fut jamais de cœur le « musicien d'avant-garde » que certains ont voulu voir en lui et l'on comprend qu'il se soit défendu, comme d'un reproche infamant, de l'épithète de « wagnérien » qui lui fut quelquefois appliquée.
Certes, entendre traiter de « farouche wagnérien » le compositeur de la Jolie Fille de Perth nous serait une surprise un peu forte, si nous ne savions ce qu'il faut penser des classifications de ce genre. Toutes les époques musicales ont connu ces épithètes synthétiques délicieusement fausses dont l'inexactitude commode fit précisément la fortune. La réforme wagnérienne a permis à des générations de critiques ignorants d'user d'un adjectif unique pour stigmatiser tout effort novateur, quelle que fût sa tendance. On disait alors « Wagnérien » comme on dit aujourd'hui « Debussyste », et toute quinte augmentée semblait provenir d'un vol au préjudice de l'auteur de Tannhäuser, de même que toute neuvième apparaît comme le fruit d'un larcin commis chez l'auteur de Pelléas.
Au lieu d'en sourire et d'y voir le témoignage obtus mais irréfutable de son originalité, Bizet prit au tragique les qualificatifs évidemment immérités mais point déshonorants dont on l'affublait. Et avec quel zèle excessif ses amis ne travaillent-ils pas à le laver de cette honte : « Farouche wagnérien ! s'exclame Charles Pigot indigné, wagnérien, ce bon, cet excellent garçon, ce parfait musicien qui ne demandait qu'à faire de la bonne musique !... » L'argument n'est pas irrésistible. On peut être un bon et même un excellent garçon, aimer la bonne musique et garder quelque estime aux Maîtres Chanteurs.
D'ailleurs, rien n'explique l'unanimité de cette appréciation. Les caractères extérieurs de l'esthétique wagnérienne manquent absolument à l'œuvre de Bizet. Les ennemis de Wagner ne pouvaient certes pas y découvrir de mélodie continue, pas plus que d'abus de leitmotivs, puisque, jusque dans ses dernières œuvres, le compositeur resta fidèle aux formes italiennes.
Les musicographes qui affirment le wagnérianisme de Bizet peuvent, il est vrai, citer à l'appui de leur assertion ce récit, fait par Victorin Joncières, du premier concert de Wagner à Paris :
« On se précipite au foyer... Depuis les querelles des Gluckistes et des Piccinistes, on n'avait vu pareille ardeur dans la discussion d'une question purement musicale. « C'est du Weber travesti », disait l'un. « C'est un charivari incohérent », ajoutait un autre. « Si c'est là la musique de l'avenir, clamait Scudo j'espère bien n'être plus de ce monde lorsque son règne arrivera ». « Vous n'êtes qu'un crétin et voici ma carte », ripostait un jeune homme à l'air provocateur. Je demandai son nom : c'était Georges Bizet, le futur auteur de Carmen ! (*) »
(*) Revue internationale de Musique. 1er mars 1898.
Cette petite scène est assez décorative ; malheureusement elle est fabriquée de toutes pièces. Cette soirée mémorable avait lieu le 25 janvier 1860 et, ce jour-là, Bizet travaillait tranquillement à la Villa Médicis à son second envoi de Rome, un Vasco de Gama qui n'avait rien de subversif ! Ce n'est que dix mois plus tard que le « jeune homme à l'air provocateur » devait rentrer en France où d'ailleurs il ne pensa jamais à défier les critiques musicaux en combat singulier pour défendre Wagner. Mais que vaut une date contre une légende ?...
A vouloir démontrer la fausseté de ces allégations on se laisserait facilement entraîner à deux manifestations également fâcheuses pour la mémoire de Bizet, soit que l'on s'écrie : « Dieu merci, il était trop foncièrement italien pour être wagnérien » ou « Hélas ! il aimait trop Verdi pour comprendre Wagner ! » Dans les deux cas, on se voit obligé de ranger, tristement ou joyeusement, le compositeur parmi les artistes réactionnaires.
Malgré tout le désir qu'on éprouve de faire marcher l'auteur de Carmen en tête de sa génération, on est à chaque instant obligé de constater la répugnance instinctive qui l'empêchait de sortir des voies frayées par ses prédécesseurs. Après la Jolie Fille de Perth, la critique elle-même fut obligée de lui déclarer qu'il allait un peu loin dans ses concessions à la routine et sa docilité à flatter les manies du public. Reger, avec indulgence, dans les Débats, Johannès Weber, avec plus de netteté dans le Temps, lui donnèrent une leçon méritée. Bizet s'excusa dans une lettre (*) où il reconnaissait ses torts, ce qui prouvait bien qu'il n'agissait pas par inconscience, et que la gloire des innovateurs le tentait médiocrement. « Cette fois encore, disait-il, j'ai fait bien des concessions... J'aurais bien des choses à dire pour ma défense, devinez-les ! »
(*) Lettre adressée à Johannès Weber qui la reproduisit dans le Temps du 15 juin 1875.
Je ne sais s'il est très facile de deviner les raisons qui pouvaient pousser un musicien très averti à déclarer hautement : « l'école des flonflons, des roulades, du mensonge est bien morte ; enterrons-la sans larmes, sans regrets, sans émotion, et... en avant ! » tout en écrivant sans remords les « copieuses roucoulades » de Catherine et l'effroyable ensemble de l'entrée de Glover, qui eût fait reculer Auber lui-même. Cette contradiction perpétuelle entre le style de Bizet, sa nature musicale, ses tendances naturelles et ses théories esthétiques ne laisse pas que de troubler. Deteriora sequitur... Indéniablement il apportait à l'art de son époque une note nouvelle, et pourtant il s'attarda toujours dans ce qu'il appelait avec une ironie moins sincère que celle de Berlioz, « les mauvais lieux de la musique ».
Dût le mot paraître un blasphème, nous répéterons qu'il fut toujours trop « bon élève » pour oser se livrer à son vrai tempérament. Toute sa vie il garda ce respect des traditions scolaires et des formes officielles qui le maintinrent dans une esthétique timorée. Avec quel sérieux de jeune « fort-en-fugue » il demande à un compositeur dont il veut connaître le mérite : « Avez-vous fait du quatuor, de la symphonie, de la scène lyrique, de l'opéra et de l'oratorio ? » Comme si la composition pouvait se diviser ainsi en petits compartiments étanches! Comme si tous ces exercices, dûment catalogués, pouvaient être assimilés aux matières d'un examen universitaire !
C'est aussi la raison qui le rend si peu hardi dans sa technique et l'empêche de deviner sur quel point de l'horizon se lèvera le soleil de demain. C'est lui qui donne à Paul Lacombe ces conseils prudhommesques : « Éviter les frottements... que chaque partie ait autour d'elle une atmosphère suffisante pour se mouvoir... Le timbre de chacun des instruments de bois étant particulier, il n'est pas bon de les employer « en corps »... Plus je vais, plus je suis convaincu qu'il ne faut user des bois et des cuivres qu'avec circonspection... Vous employez le cor comme instrument ordinaire, c'est un grand tort : le timbre spécial de cet instrument, la grande difficulté qu'il éprouve à faire entendre certains sons bouchés le rendent impossible comme instrument d'harmonie, etc., etc... » Comment a-t-on osé traiter de wagnérien un musicien qui ignorait les quatuors de « vents » et s'en tenait au solo de flûte et aux effets de cor à découvert pour colorer timidement l'éternel quintette à cordes qui devait, selon lui, former le fond de toute orchestration ?
Pour comprendre un tel état d'âme, il ne faut pas perdre de vue les circonstances toutes spéciales qui entourèrent la production de Bizet. Nous avons vu que, dès ses débuts, le jeune auteur ne fit jamais antichambre. Il était encore sur les bancs de la classe d'Halévy lorsqu'il fut appelé à goûter pour la première fois les émotions de la rampe. Offenbach avait mis au concours le livret d'une opérette de Battu et Halévy, le Docteur Miracle. Le premier prix fut décerné à MM. Bizet et Lecocq, dont les partitions, couronnées ex-æquo, furent représentées aux Bouffes en 1857. Dès son retour de Rome, on vit deux théâtres lui ouvrir leurs portes ; on vit ce jeune homme de vingt-quatre ans retirer même de l'Opéra-Comique, où elle était déjà en répétitions, la partition qui, à son avis, eût constitué un début trop modeste pour un auteur aussi sollicité. Depuis, il continua à écrire sur commande et à voir ses ouvrages mis en scène dès qu'il en eut tracé la mesure finale.
Lorsqu'il écrivait une œuvre, ce n'était pas pour condenser dans un lent travail autour d'une pensée chère toutes ses aspirations d'art. Au lieu de choisir le sujet idéal que tout artiste élit secrètement et rêve d'immortaliser, il se contentait de mettre consciencieusement de la musique autour du livret qui avait l'agrément de M. le Directeur du Lyrique ou de M. le Directeur de l'Opéra-Comique. Il n'écrivait pas pour écrire, pour déverser le trop-plein de ses rêves, il écrivait pour être joué. Et voilà qui change singulièrement l'optique musicale d'un auteur. Nous avons peut-être là l'explication des singulières anomalies qui nous surprennent dans ses opinions et ses œuvres. Là sont peut-être les fameuses excuses qu'il priait Johannès Weber de deviner !
C'est Carvalho qui choisit le livret des Pêcheurs de Perles que Bizet accueille avec empressement sans même les avoir lus. C'est Carvalho encore qui commande quatre actes à Saint-Georges et Adenis et les confie à son musicien préféré qui s'engage par traité à terminer cette Jolie Fille de Perth avant la fin de l'année courante. Puis ce sont les sujets imposés pour le concours de l'Opéra et de l'Opéra-Comique, la Coupe du Roi de Thulé et le Florentin, et celui que lui suggère une piété quasi filiale : Noé. Camille du Locle lui passe alors une commande en blanc. Bizet découvre Calendal de Mistral. Il en fait tirer un livret par M. Paul Ferrier et déclare qu'il a enfin trouvé un bon poème. Sera-ce donc l'œuvre sincère où il pourra laisser parler librement sa foi musicale ? Point du tout : il croit comprendre que le Directeur de l'Opéra-Comique n'aime pas ce sujet, et aussitôt Bizet ne trouve plus aucun intérêt à la poésie de Mistral et rend le livret à son auteur. Avec Djamileh, c'est presque un livret directorial que le musicien reçoit, dans un traité en règle. Louis Gallet l'avait écrit sous la dictée de du Locle et, seule, la paresse excessive de Duprato avait fait échouer ce poème sur le piano du bon ouvrier en musique, toujours prêt à ponctuellement assurer ses livraisons. L'Arlésienne fut une idée de Carvalho qui régla lui-même la forme de la partition en exigeant un essai de « mélodrame ». On a vu Bizet ne pas hésiter à écrire les cinq actes du Cid dès qu'il vit le chanteur Faure s'intéresser à ce sujet et parler de le recommander à Perrin. Le « bon livret » était pour lui tout autre chose qu'une œuvre d'art pur. Il le laisse voir naïvement : « On fait en ce moment, écrit-il (*), deux opéras sur lesquels j'ai l'œil très ouvert : un des deux intéresse beaucoup le Directeur de l'Opéra et d'ici à quelques mois j'aurai probablement un ouvrage en train ». De même la crainte que lui prêtèrent ses amis de n'être pas doué pour l'opéra ne semble pas procéder d'un sentiment de défiance envers soi-même, mais bien d'une simple absence de commande officielle. La preuve, c'est qu'après avoir dit longtemps à Guiraud : « Je crains de m'y montrer mesquin, d'y manquer d'ampleur », il finit par s'écrier avec un soupir de soulagement : « On paraît décidé à me demander quelque chose à l'Opéra ; les portes sont ouvertes : il a fallu dix ans pour en arriver là ! (**) » Enfin Carmen fut le résultat d'une commande et en provoqua immédiatement une autre aux mêmes fournisseurs, — commande qui ne fut jamais livrée, car le musicien venait de disparaître.
(*) VIIIe lettre à Paul Lacombe.
(**) XVe lettre à Paul Lacombe.
Il y a loin, avouons-le, de l'exécution ponctuelle de ces nombreux traités, à la composition libre de toute entrave dans le temps et dans l'espace, à la gestation de l'œuvre qui possède l'auteur et qu'il nourrit de son sang, à la création idéale d'un ouvrage qui ne sera peut-être jamais joué (peut-être, même, jamais terminé), mais qui directement émane de toutes les facultés créatrices du compositeur, de toute sa puissance d'invention. Vivre son œuvre n'a jamais paru à Bizet une condition de sincérité. Musicien admirablement doué, il para de son mieux d'harmonies adroites les pièces qu'on lui confia, sans perdre de vue les convenances à observer vis-à-vis des Directeurs bien intentionnés, ni les ménagements à garder envers un public insuffisamment instruit. Très cérébralement il dosa dans son œuvre les concessions et les hardiesses, avec ce sens latin de l'équilibre et de la clarté qui rend l'auteur de Carmen si représentatif.
C'est par lui que Nietzsche rêvait de « méditerraniser la musique » et nul en effet ne pouvait plus complètement synthétiser les tendances caractéristiques qu'à tort ou à raison la moitié de l'Europe envie à l'autre. Les « droits de la Méditerranée » ont gouverné toute l'œuvre de Bizet et, suivant le degré de sympathie qu'on éprouve pour l'idéal des races latines, on apprécie son esthétique avec indulgence ou sévérité. Il faut bien comprendre ce caractère d'un artiste qui, de Rome, écrivait tranquillement : « Si je pouvais repasser à mon ami Hector un peu de mon aplomb, comme ça ferait l'affaire ! (*) » et « j'ai beaucoup d'espoir pour ma carrière : j'aurai probablement moins de talent et des convictions moins arrêtées que Gounod ; par le temps qui court c'est une chance de succès (*) » Se glorifier aussi paisiblement, à vingt ans, à l'âge des timidités extérieures et des volcanismes intimes, d'avoir de l'aplomb et peu de convictions arrêtées, voilà un aveu étrangement significatif.
(*) Lettres de Rome. (Revue de Paris, 15 décembre 1907.)

Jeux d'enfants, petite suite d'orchestre n° 5 (Op. 22) (Collection de M. Charles Malherbe)
L’ŒUVRE. — DE DON PROCOPIO AUX PÊCHEURS DE PERLES
Présenter les œuvres de Bizet ne consiste pas à suivre, de partition en partition, le développement logique d'une idée, la poursuite méthodique d'un idéal d'art. Renonçant à l'élégance d'une telle hiérarchie, nous devrons nous contenter d'énumérer, dans l'ordre où elles parurent, les œuvres qui remplirent la carrière du compositeur. Certes elles suivent esthétiquement une ligne ascendante, mais nous le savons, ce progrès résulta bien moins d'un effort vers la vérité entrevue que de mille contingences extérieures à l'œuvre, grâce auxquelles l'auteur put diminuer à son gré les concessions qu'il ne refusait guère à son public ni à ses Directeurs.
La première œuvre de Bizet fut David, cantate de Mlle de Montréal, imposée au concours de Rome de 1856, et qui n'inspira guère les concurrents puisqu'aucun d'eux ne fut jugé digne d'un premier prix. Bizet obtint, avec un second grand prix, la récompense la plus élevée.
En attendant l'instant d'affronter de nouveau cette épreuve, nous avons vu qu'avec Lecocq, son camarade de la classe d'Halévy, il triompha au concours d'opérette ouvert par Offenbach au théâtre des Bouffes-Parisiens. Sa partition du Docteur Miracle fut jouée alternativement avec celle du futur auteur de la Petite Mariée primée au même titre, et il ne semble pas que le public se soit nettement prononcé entre les deux jeunes rivaux.
L'année suivante vit le triomphe du brillant élève avec la cantate Clovis et Clotilde de M. Burion, chantée par Mlle Henrion, MM. Jourdain et Bonnehée.
Négliger ces trois premières productions d'un étudiant en musique et les laisser dans le mystère dont les enveloppe leur retraite inconnue nous semble un devoir d'élémentaire courtoisie.
A la Villa Médicis plusieurs sujets tentèrent la plume de Bizet ainsi que nous l'apprennent ses lettres de Rome, publiées en 1907-1908 par la Revue de Paris. Ce fut d'abord Parisina, opéra oublié de Donizetti, où il admirait « des situations » ; puis, un Te Deum qu'il écrivit péniblement en vue d'obtenir les 1.500 francs du prix Rodrigues. « Ce prix existe : je veux l’avoir : je l'aurai », déclara-t-il avec énergie, en entreprenant cette composition qui convenait mal à son tempérament artistique et eut pour résultat de lui faire modifier, plus tard, la nature de ses envois officiels : « Je ne suis pas taillé pour faire de la musique religieuse, avouait-il cependant bientôt ; aussi me priverai-je de faire une Messe. J'enverrai un opéra italien en trois actes, j'aime mieux cela ! » Le prix, d'ailleurs, ne récompensa pas ce vigoureux effort et fut décerné à Barthe ! Ce fut ensuite un projet de collaboration avec Edmond About qu'une mission artistique avait conduit à Rome : « C'est un fort joli opéra bouffe et cela m'amusera beaucoup », écrit-il à sa mère ; mais About, rappelé brusquement par un ministre mécontent, quitta l'Italie et emporta sans doute son scenario, car Bizet n'y fait plus, dans ses lettres, aucune allusion.
C'est alors que la découverte de Don Procopio le comble d'une joie que nous avons peine à comprendre. Cette banale farce italienne « dans le genre de Don Pasquale », lui semble une inestimable trouvaille. « Dire le mal que j'ai eu à trouver ce poème serait impossible. J'ai fait tous les libraires de Rome et j'ai lu deux cents pièces. » Voilà qui n'est pas de nature à rehausser le prestige de la littérature dramatique italienne !
Le même état d'esprit pourra nous surprendre lorsque nous le verrons renoncer à Ulysse et Circé, au Tonnelier de Nuremberg et, dans son désir ardent de « faire quelque chose de nouveau », s'enthousiasmer du lamentable sujet de Vasco de Gama ! Incontestablement la culture littéraire de Bizet était moins complète que son éducation musicale !
Quoi qu'il en soit, son premier envoi officiel de Rome, constitué par les deux actes bouffes de Don Procopio, obtint à l'Institut un franc succès. Rappelant le jugement du rapporteur Halévy qui reconnaissait à l'auteur « une touche aisée et brillante, un style jeune et hardi », Charles Pigot s'afflige de la perte de cette partition et déplore l'incurie des bibliothécaires d'alors qui ne prenaient pas la peine de réunir méthodiquement au Conservatoire ces envois officiels. Depuis, Don Procopio a été retrouvé en 1894 par M. Charles Malherbe, dans des circonstances assez curieuses.
Auber, ex-directeur du Conservatoire, troublé par les événements politiques qui assombrirent ses dernières années, était inquiet sur l'avenir de la Maison qu'il avait si longtemps dirigée. Un mois avant sa mort, il modifia son testament et légua à ses deux neveux les papiers et manuscrits qu'il destinait primitivement au Conservatoire. Vingt-trois ans plus tard, la famille d'Auber ayant voulu vérifier le contenu de ce legs, M. Malherbe, archiviste de l'Opéra, fut invité à jeter les yeux sur cette collection et reconnut, dans le lot disparate, plusieurs envois de Rome que l'Institut avait réglementairement versés entre les mains du directeur du Conservatoire, mais que celui-ci avait oublié de faire classer à la Bibliothèque. Obligeamment, les héritiers d'Auber firent restituer au Conservatoire, par le bibliothécaire Weckerlin, ces compositions officielles, parmi lesquelles se trouvaient deux cent trente-six pages d'orchestre de grand format, de l'écriture de Bizet, élégante et sans ratures. Aucune date, mais ce titre sur la première page : « Don Procopio, opera buffa in due atti ». La partition était complètement achevée à l'exception des récitatifs que le compositeur se réservait d'écrire au dernier moment. Chaque acte comprenait six numéros (*). M. Malherbe fut aussitôt chargé d'en surveiller l'édition et de composer et orchestrer les récitatifs. S'avisant même que le personnage principal n'avait aucun solo à chanter, l'érudit adapteur emprunta deux airs à la partition inachevée de Clarisse Harlowe. Grâce à ce zèle éclairé, l'envoi de Rome de Bizet devint une partition prête à être mise en scène.
(*) En annonçant à sa mère l'achèvement de cette partition, Bizet affirmait pourtant qu'elle se composait de quatorze morceaux. (Revue de Paris. 1er janvier 1908. Lettre XXXIV.)
Elle le fut, somptueusement, par les soins de M. Raoul Gunsbourg au Théâtre de Monte-Carlo, le 13 mars 1906. Le livret, tiré par Bizet d'une farce italienne de Gambaggio dénichée pendant son séjour à Rome dans l'éventaire d'un bouquiniste, n'avait pas été retrouvé, mais il ne fut pas difficile à MM. Paul Collin et de Choudens de reconstituer cette classique bouffonnerie.
La jeune Bettina, aimée du brillant officier Odoardo, mystifie, grâce à la complicité de son frère Ernesto, son tuteur Andronico qui lui présente un soupirant ridicule : Procopio. On fait croire à cet avare que Bettina est sans fortune, frivole et dépensière ; dès lors, il rompt avec effroi et le bel officier vient tout réparer avant la chute du rideau. Ces mésaventures de tuteurs bernés et de prétendants grotesques ont eu pendant deux siècles une « vis comica » que nous pouvons difficilement apprécier, mais à laquelle le jeune Bizet était encore sensible. Il écrivit une partition facile, très italienne, dans le style de Rossini. Certaines pages lui semblèrent plus tard dignes d'une plus noble carrière : les chœurs du premier acte devaient reparaître dans les Pêcheurs de Perles et la sérénade d'Odoardo devait figurer dans la Jolie fille de Perth. Mais ni la cavatine en ré bémol d'Ernesto ni la petite marche militaire du premier acte ne laissent deviner un tempérament bien personnel. Le trio de basses du second acte est d'une bouffonnerie très prévue, de même que le finale, imité du Barbier de Séville. Seules quelques harmonies déjà savoureuses, l'instrumentation de la sérénade (deux cors anglais imitant la musette des pifferari, une guitare et une mandoline), et la grâce expressive d'une longue phrase (prélude du second acte) permettent de voir dans ce pastiche autre chose qu'un amusement de bon élève de composition. D'ailleurs la « manière » italienne était si naturelle au jeune prix de Rome que le mot pastiche est sans doute inexact.
Don Procopio envoyé, la chasse au livret recommence. Apprenant que son ami David vient de triompher à l'Institut avec le Vœu de Jephté et se dispose à venir le rejoindre à la Villa Médicis, Bizet le charge d'une commission, celle de lui apporter la Esmeralda, opéra en quatre actes de Victor Hugo. « J'en ferai certainement, ajoute-t-il, mon second envoi. » Dans une longue lettre à son cher Hector Gruyer, l'élève préféré de son père, il confirme bientôt ce projet et quelques mois plus tard il en entretient encore son professeur Marmontel. Mais, dès qu'il a en mains l’œuvre attendue, il n'en souffle plus mot et, peu de temps après, il annonce une Ode-Symphonie sur Ulysse et Circé comme second sujet officiel. Cette idée lui fut suggérée par la visite du cap Circé et de la grotte de la Magicienne. Il écrit de Terracine : « Sitôt que je serai de retour à Rome je relirai dans Homère le passage qui concerne mon affaire et j'écrirai à Fournel pour le prier de me faire les vers dont j'aurai besoin. Il y a des choses charmantes à faire sur ce sujet : le chœur des compagnons d'Ulysse, la scène des enchantements de Circé, la scène de l'ivresse. Il y aurait quatre morceaux d'orchestre purement symphoniques et cinq ou six morceaux de chant et chœurs. Cette idée me sourit d'autant plus que j'aurais ainsi, en rentrant à Paris, une chose importante à faire exécuter dans le cas où MM. les directeurs voudraient me faire poser. Je ferai donc un scenario sur Homère et je l'enverrai à Fournel, Je compte beaucoup sur cette idée-là. » Mais, un mois plus tard, il écrit : « Je ne sais que faire pour envoi. Ulysse et Circé est impossible. Le vieil Homère est dur à se laisser arranger ou plutôt déranger. » Et il abandonne une fois de plus la piste découverte avec tant d'enthousiasme.
Mais aussitôt il se tourne vers un autre point de l'horizon et annonce à sa mère : « Persuadé qu'un musicien intelligent doit trouver lui-même l'idée de ses poèmes (hélas ! nous avons vu que le jeune compositeur devait abandonner rapidement cette belle théorie), je m'en occupe activement. Prends dans la bibliothèque les contes d'Hoffmann et lis le Tonnelier de Nuremberg. Je veux faire trois actes avec ce délicieux poème. Le Concours de chant serait une scène très originale et d'un effet certain. Tu vois qu'on n'est pas trop crétin et qu'on pense à son affaire. »
Mme Bizet ne partageant pas l'avis de son fils sur le choix d'un tel sujet, ce projet fut enterré avec les autres. « Je suis fâché (*), lui répondit seulement le musicien, que le succès de ce conte ne te semble pas si sûr qu'à moi. Relis-le, et tu y découvriras cette fleur de sentiment que les Allemands seuls savent trouver et qu'on aime tant chez nous. » Mais il n'insista pas, sans se douter que, depuis longtemps, Wagner — qui ne partageait pas les opinions littéraires de Mme Bizet — avait remarqué le Tonnelier de Nuremberg et s'en était inspiré pour écrire le poème des Maîtres Chanteurs !
(*) Revue de Paris. 1er janvier 1908. Lettre XXVIII.
C'est alors que les Lusiades de Camoens tentent la fantaisie descriptive du jeune pensionnaire, qui se dispose à en tirer une sorte d'Ode-Symphonie « dans le genre du Désert ou de Christophe Colomb ». Mais, tourmenté par le désir de « faire du comique » il rime lui-même un opéra-comique sur l'Amour peintre de Molière pour le joindre à son envoi symphonique. Malheureusement, ce nouveau Procopio était à peine commencé qu'arrivait à la villa Médicis le fameux rapport officieux d'Ambroise Thomas conseillant au jeune musicien « la méditation des choses sublimes » et lui faisant remarquer qu'un opéra bouffe ne remplace pas une messe. Bizet s'empresse docilement de déchirer son opéra-comique et se met en devoir de composer un Credo. Mais, comme il le déclare à sa mère, il ne veut pas faire une messe « avant d'être en état de la faire bien, c'est-à-dire chrétienne » (*)... et il se décide à « faire du religieux païen » en prenant le Carmen seculare d'Horace.
(*) Lettres de Rome. Lettre LXIV.
Un mois plus tard, ce beau projet était abandonné, mis de côté comme les autres et l'Ode-Symphonie, qui avait reçu comme titre le nom de Vasco de Gama, restait seule sur le chantier. Le scénario terminé avait été confié aux fins de versification à Louis Delâtre, « poète français, homme très savant, sachant et parlant vingt-cinq langues, mais écrivant la sienne d'une façon peu intelligente » (*) et le résultat avait été si peu brillant que le musicien avait dû refaire lui-même quelques vers ; gardons-nous de les rechercher, car le poème entier, d'une gaucherie attendrissante, dépasse en banalité les plus pâles cantates de l'Institut.
(*) Lettres de Rome. Lettre LVIII.
On y voit Vasco de Gama naviguant en compagnie de
son frère Alvar et d'un jeune officier nommé Léonard. Les matelots chantent des
chœurs tour à tour mélancoliques et guerriers. Léonard déclame des vers et
propose de redire la chanson qu' « Inès de sa voix tendre lui chantait chaque
jour ». Vive approbation des ténors et des basses qui s'écrient : « Écoutons !
écoutons ! » et sont immédiatement régalés d'un Boléro portugais, La
marguerite a fermé sa corolle, qu'ils terminent en chœur par des
« la-la-la-la » bien sentis. Mais le ciel se couvre, « les tonnerres grondent,
le vent courbe des mâts l'impuissante forêt » et, au milieu des éclairs,
Adamastor, le géant des mers de l'Africaine, apparaît à l'équipage
épouvanté sous la forme de six basses-tailles clamant à l'unisson ces vers
imprévus : « Je m'oppose à vos conquêtes ; je suis le cap des tempêtes !...
Respectez cette barrière ; retournez vite en arrière ! » Les marins se jettent à
genoux, et Vasco chantant « gravement et avec onction » leur conseille d'en
référer au Très-Haut. Un chœur à quatre voix (où les mousses, sans doute, se
chargent des soprani) à « Dieu dont la main sauva Moïse avec tous ses enfants
des gouffres écumeux » dissipe le grain ; bientôt la vigie crie « Terre !
Terre ! » Après quoi un dernier chœur de gratitude marque la fin de cette rude
traversée et de cet indigent scénario.
La musique dont Georges Bizet agrémenta cette fantaisie restera le très instructif témoignage des « préoccupations d'oreille » des compositions de cette époque. Le jeune pensionnaire de la Villa Médicis devait, forcément, faire honneur à ces « élégances d'écriture » si conventionnelles, si éphémères, plus variables que les modes féminines, et qui datent si impérieusement. A ce titre-là il faut s'arrêter sur ce premier 6/8 balancé qui accompagne le chœur des matelots et dont le rythme de barcarolle reviendra à quatre reprises différentes, au cours de la partition, évoquer le roulis et le tangage qui bercent les pieux Portugais. Il faut goûter cette prosodie hachée qui n'hésite pas à séparer par un soupir les syllabes d'un même mot, faisant d'une phrase un groupe de tronçons verbaux inintelligibles (later refuit lavoi leglisse surlo céan... etc). Il faut savourer ces récitatifs aux modulations d'école, l'abus touchant de la sixte augmentée conduisant à la quarte-et-sixte du ton où l'on veut se rendre par les plus courts chemins, les belles ritournelles d'une écriture serrée, pleines de chromatismes de traités d'harmonie, de marches, d'imitations, d'adroits renversements et d'altérations dites « piquantes ! » Il faut aimer ce Boléro, recueilli sur les lèvres d'une Inès de 1840, avec son premier motif mineur (qui fait déjà pressentir l’Arlésienne) son second majeur et « expressif » et son refrain syllabique !
Mais, au milieu de tous ces poncifs, éclatent d'étonnantes audaces harmoniques, rapides, discrètes, presque honteuses : c'était le cri du vrai génie de Bizet, vite étouffé par les scrupules du bon élève craintif, désireux avant tout de plaire à ses maîtres. Certes, qu'ont-ils dû penser des âpres appoggiatures inférieures de la phrase en zigzag qui amorce le premier chœur des matelots ? N'ont-ils pas pris pour une simple faute de copie la stupéfiante et prophétique conception de l'accord parfait que révèlent les six mesures qui suivent ce chœur, où l'on voit l'accord de la bémol se présenter suivant les plus pures traditions debussystes (la b, mi b, fa-do) avec l'appoggiature supérieure de la dominante écrite en même temps que le cinquième degré ?... Ne serait-ce pas à ces savoureuses tentatives que pensait Halévy lorsque, dans son rapport officiel sur les envois de Rome, après avoir loué dans Vasco « un style élevé, des formes larges, de beaux effets d'harmonie et une orchestration riche et colorée », il engageait l'auteur « à se tenir en garde contre certaines hardiesses harmoniques qui parfois peuvent être qualifiées de duretés ! » L'appoggiature non résolue stigmatisée en 1859 par l’auteur de la Juive, n'est-ce pas un piquant document d'esthétique ?...
Le troisième envoi fut une Suite d'orchestre composée d'un « Scherzo et Andante » et d'une « Marche funèbre ». Exécuté à la distribution des prix de 1861, il obtint un succès très vif. Charles Pigot nous affirme que l'on remarqua surtout le « Scherzo ». Or précisément son exécution aux Concerts populaires de Pasdeloup, le 11 janvier 1863, devait provoquer des tempêtes. Comment expliquer la colère des habitués du Cirque Napoléon, colère qui alla jusqu'aux lettres de menaces adressées au chef d'orchestre, devant une page qu'un auditoire académique avait entendue avec sympathie deux ans plus tôt ? L'Institut fut-il animé, ce jour-là, d'une prescience heureuse, ou la foule des concerts populaires montra-t-elle une juste rigueur ?... La postérité semble avoir donné raison à l'Institut : le fait est assez rare pour mériter une mention respectueuse et étonnée.
Rien d'ailleurs, de cette Suite d'orchestre, ne devait être perdu : le Scherzo trouva place presque sans modifications, dans la Symphonie Roma, la Marche funèbre servit à souligner, au troisième acte des Pêcheurs de Perles, l'entrée de Leïla condamnée par les Indiens.
Dès son retour à Paris, Bizet s'était vu ouvrir les portes de l'Opéra-Comique avec un acte de J. Barbier et Michel Carré, la Guzla de l'Emir, suivant la clause du cahier des charges qui assure aux lauréats de l'Institut dans les théâtres subventionnés, une hospitalité frugale. Jusqu'à l'heure où un nouveau Charles Malherbe la déterrera, nous devons considérer cette partition comme brûlée avec celles que Bizet incinéra avant sa mort.
Mais voici enfin un ouvrage sérieux. Carvalho donne au jeune musicien qu'il estime les trois actes des Pêcheurs de Perles. Ce fut la destinée de Bizet d'être voué aux recherches de couleur locale. Par un accord tacite ses protecteurs le dirigèrent toujours dans cette voie où ses qualités de peintre devaient faire merveille. Il y aurait toute une étude à faire sur la géographie musicale de Bizet. Après l'Italie de Procopio nous visiterons l'Egypte de Djamileh et nous n'aborderons à l'Espagne de Carmen qu'après escale aux côtes de Provence avec l'Arlésienne. Si l'on joint à cette croisière les classiques excursions d'un pittoresque assez conventionnel dans l'Ecosse de Walter Scott avec la Jolie Fille de Perth, et l'Extrême-Orient de Michel Carré avec les Pêcheurs de Perles, nous aurons le tableau complet des préoccupations qui hantent un globe-trotter de la fin du second Empire.
Les pêcheurs de Ceylan ont pour coutume d'intéresser les dieux à leurs recherches huîtrières en obligeant une vierge voilée à chanter « jour et nuit » au sommet d'une colline. La jeune Leïla, mystérieusement amenée par les vieillards de la tribu, se voit investir de ses délicates fonctions et jure suivant l'usage de vivre « sans ami, sans époux, sans amant ». Or il se trouve que le chef des pêcheurs, Zurga, et son ami Nadir, sont obsédés par le souvenir d'une adorable inconnue entrevue jadis à Candi. Fidèles à l'amitié qui les lie, ils ont tout fait pour oublier l'amour qui menaçait de les rendre rivaux : ils ont fui la charmante anonyme. En voyant arriver Leïla voilée, le public a tôt fait de comprendre qu'une surprise se prépare et que la belle inconnue de Candi... Nadir lui aussi a compris et se glisse jusqu'à elle. Touchante reconnaissance et duo d'amour. Hélas ! ce n'est pas pour chanter des duos que Leïla est engagée : le ciel s'émeut et la mer se soulève. Avertis par ces signes que leur virginale protectrice manque à tous ses devoirs, les pêcheurs se précipitent et constatent le flagrant délit. Zurga indigné et mordu de jalousie prononce l'arrêt de mort. Soudain qu'a-t-il vu ? Au col de Leïla brille un collier. Il se souvient : jadis il fut sauvé d'un péril par une enfant à qui il donna ce joyau. Leïla ! c'était donc Leïla ! Très affecté par cette rencontre, l'honnête chef ne trouve qu'un moyen de se tirer d'affaire. Il vole incendier le campement de ses pêcheurs et crie « Au feu ! au feu ! » Et pendant que les malheureux courent à toutes jambes pour sauver leurs enfants et leurs femmes, l'ingénieux Zurga a toute tranquillité pour conduire les coupables jusqu'à sa barque qui les mettra hors d'atteinte. Surpris d'ailleurs dans cette trahison, il paie pour les fugitifs et expie, sous le couteau d'un Indien, son excessive complaisance.
Il était difficile de réussir un chef-d'œuvre avec une aussi puérile affabulation. Très attentif à la mode, (et en cela bien différent de Reyer, dont la Statue avait su trouver une note si nouvelle), le jeune compositeur ne pouvait songer à employer d'autres formules que celles de son temps. A cette époque, le pittoresque exotique se traduisait exclusivement par la présentation de groupes d'indigènes et n'avait d'autre expression que celles des chœurs. Bizet se conforma à l'usage et fit chanter ses pêcheurs à quatre parties aussi souvent qu'il en fut besoin. La sincérité descriptive et l'exotisme documenté de ces manifestations chorales paraissent d'ailleurs assez discutables (surtout depuis que l'on s'est aperçu que certaines d'entre elles avaient été simplement transcrites de Don Procopio). Aussi bien rien de plus modeste que l'idéal extrême-oriental d'alors : quelques grupetti dans les conclusions de phrases ou la suppression de la sensible dans la ritournelle mineure du chœur Sur la grève en feu, et voilà le paysage situé.
On cherche en vain ce qui a pu, dans cette innocente partition, faire crier les contemporains au wagnérisme farouche, au parti pris de bizarrerie, à « l'allure excentrique », suivant le mot d'Arthur Pougin. Jamais ces vagues reproches n'ont été précisés, et pour cause. Dès le prélude, nous savons que le jeune compositeur ne nourrit pas de desseins révolutionnaires. Comme dans les moins prétentieuses opérettes, l'ouverture est la transcription textuelle d'une des pages du premier acte. Ici, c'est l'entrée de Leïla avec sa mélodie inspirée de Gounod qui est exposée sans vaine ornementation. Lorsqu'elle est achevée, on la reprend tout entière, une octave plus haut, sans en changer une note mais en jouant un peu plus fort et on conclut par huit mesures d'accords parfaits de tonique étagés, arpégés et rythmés d'après les principes d'Auber. On voit que la symphonie ne tente pas encore le futur auteur de Roma. Les tournures mélodiques des chœurs sont extrêmement banales, leurs harmonies s'abstiennent de toute audace, les rythmes sont francs et carrés, ténors et basses réunis chantent (*) à la manière de Bazin : « Voilà notre domaine » et ne craignent pas de dessiner sur une pédale de tonique les plus molles courbes de tierces qu'on puisse rêver ; ils savent aussi répéter éternellement le même vers et l'allonger quand il en est besoin par le « Oui » énergique et traditionnel qui rendit tant de service à la prosodie lyrique de deux ou trois siècles (« Dansez jusqu'au soir..., oui, jusqu'au soir... »), et n'ignorent point l'art de s'arrêter court sur un effet d'un comique imprévu « Dansez ! dansez ! dansez !... » chantent-ils, et sous ce mot lancé impérativement on lit : « Les danses cessent (**). » A eux la large mélopée « Celui que nous voulons pour maître » accompagnée des arpèges ogivaux chers à Loïsa Puget et harmonisée bientôt en « tierce-quinte-sixte » à la façon des fanfares de piqueurs. Dans tout cela, rien qui ne soit parfaitement conforme aux usages de l'époque. Que dire de l'air de Zurga « Si tu restes fidèle » où le plus banal 12/8 conduit au pire point d'orgue agrémenté de vocalises qu'un baryton puisse exécuter ? Faut-il rappeler que l'air de Leïla « Dans le ciel sans voile » terminé, lui aussi, par de longues vocalises sur « Ah ! » est accompagné par un chœur à 6/8 d'une telle vulgarité que Berlioz, dans les Débats, le rangea dans la catégorie « de ceux qu'on n'ose plus écrire aujourd'hui ! » (8 octobre 1863). Tous les airs sont conçus dans la forme italienne avec la carrure traditionnelle, l'accompagnement symétrique et la coda stéréotypée ; les récitatifs ont la coupe d'usage, et se brisent sur les « cadences rompues » des traités d'harmonies. C'est Zimmermann qui avait dû apprendre à son élève préféré l'effet « tragique » de la septième diminuée : il en fait à chaque page un usage immodéré, et jamais il n'amorce un « numéro » nouveau sans une ritournelle ou une « rentrée » de la plus triste espèce, ces rentrées qu'il aimait tant et pour lesquelles il garda si longtemps une incroyable indulgence (***). Certes, on n'avait pas le droit de confondre avec le terrifiant procédé du leitmotiv les rappels de phrases que l'on peut relever çà et là au cours de ces trois actes, tels que la mélodie sur laquelle Zurga et Nadir évoquent au premier acte le souvenir de Leïla et qui reparaît à la fin du troisième lorsque les deux amants s'éloignent, ou la phrase qui souligne les recommandations de Nourabad et qui n'est autre que la formule « Si tu restes fidèle » par laquelle Zurga a précisé le pacte sacré..., etc. Rien n'explique donc les ahurissantes excommunications des critiques de 1863 en face d'un ouvrage si conforme aux pires traditions.
(*) Noblement, dit la partition.
(**) Les mêmes effets se retrouveront dans Noé où l'on chante : « Dansez, mes belles, oui, dansez et bondissez » et où, sous ce dernier mot, la partition indique « La danse cesse... »
(***) Qu'on en juge par l'attendrissant conseil d'instrumentation qu'il donnait à Paul Lacombe : « Il faut employer deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes... il est impossible de bien orchestrer en ne disposant que d'un instrument de chaque espèce. En effet une rentrée en tierces, par exemple, sera bien meilleure exécutée par deux clarinettes et deux hautbois que par une clarinette et un hautbois. » (Ve lettre). Vraiment si la division des « pupitres » n'avait pas d'autre justification !...
Est-ce à dire cependant que Bizet n'ait pas trouvé le moyen d'y laisser deviner ses dons précieux d'écriture, malgré son incompréhension des formes ? En aucune façon : de loin en loin se rencontre quelque savoureux détail harmonique ou quelque trouvaille mélodique faisant entrevoir les plus parfaites de ses futures réalisations. Dès le premier chœur « Sur la grève en feu », d'une allure générale et d'un rythme pourtant si fanés, on trouve des témoignages éclatants de sa prescience d'oreille et de l'acuité de ses sens : ici, une adroite disposition de la sixte augmentée autour d'une pédale intérieure donnant un balancement harmonique d'une infinie douceur, là l'emploi exquis d'une septième par prolongation et de frottements chromatiques sur une double tenue, là encore un renversement de septième mineure du second degré si savoureusement amené qu'on croirait entendre, comme dans Vasco de Gama, un moderne accord parfait selon la formule debussyste où l'appoggiature est écrite en même temps que la note réelle !
Plus loin, certains récitatifs moduleront avec une audacieuse aisance et Zurga s'exprimera déjà sur des contours mélodiques et des cadences que lui empruntera plus tard l'aimable Micaëla. Faut-il faire remarquer le charme neuf qu'apportaient alors les trois harmonies superposées du serment de Leïla et les courageuses quintes augmentées dont on craignait alors l'âpre volupté ? Et doit-on insister sur l'élégance d'écriture qui permettait à Bizet de passer, grâce à une seule et subtile altération, de cinq dièzes à deux bémols, réalisant ainsi un modèle de modulation rapide aux tons éloignés ?
Pour minuscules qu'elles soient, de telles préoccupations de détail sont étrangement significatives et ouvrent d'émouvants horizons sur la carrière qui semblait attendre un musicien aussi exceptionnellement doué.
D'ailleurs il semble que — pour de touchantes raisons que la musique ne connaît pas ! — une indulgence secrète ait attaché bon nombre de nos contemporains à cette partition balbutiante. L'exemple le plus caractéristique de ce curieux état d'esprit nous sera fourni par ces charmantes lignes de Camille Bellaigue, qui prouvent de quelles racines imprévues peuvent naître les fleurs vivaces des convictions esthétiques :
« En plus d'une page des Pêcheurs de Perles, dit l'élégant critique de la Revue des Deux Mondes, demeure un charme harmonieux, comme au fond d'une frêle coquille, sous la nacre pâlie, quelque chose survit toujours du secret des vagues et de l'âme chantante des flots. Oui, c'est bien l'âme de la mer, de la mer orientale, tiède et claire, qui respire et qui soupire ici !...
« ... La chanson de Nadir !... « Ma bien-aimée est enfermée dans un palais d'or et d'azur. » Oh ! la ravissante mélodie, unique, je crois entre tous les appels d'amour ! Sérénade non pas seulement de pêcheur, mais de plongeur, qui semble venir du fond des eaux, traverser lentement les nappes transparentes et s'épanouir à la surface comme une fleur humide... Sur un navire, naguère, sous un ciel criblé d'étoiles, nous entendîmes, comme jamais nous ne l'entendrons plus, la chanson exquise... Le long des côtes africaines, chaque soir d'un radieux été, des flancs d'acier du vaisseau s'élevaient des concerts. On avait coutume de se réunir autour d'un piano dans le poste formé par l'arrière du navire. A la brise très douce les hublots étaient ouverts ; par le plus grand, celui qu'on appelle « l’œil » et qui, les jours de manœuvre ou de combat, livre passage aux torpilles, la lune quelquefois se montrait, toute ronde et, dans l'orbite de métal comme dans une paupière de cuivre, encadrait son globe d'argent. Pas un soir on ne manqua de saluer la mer et la nuit, si belles toutes deux, par la marine et nocturne cantilène des Pêcheurs de Perles. Toujours ce refrain le premier, revenait errer parmi nous. Les arpèges de l'accompagnement suivaient le rythme des vagues, la mélodie flottait sur les eaux ; le grupetto final couronnait chaque strophe comme d'un flocon d'écume et ce paysage achevait si merveilleusement cette chanson qu'elle ne paraissait plus l'inspiration d'un homme mais pour ainsi dire la respiration des choses autour de nous, l'haleine de la nuit, du ciel et des eaux... Et voilà comment, pour nous, la sérénade des Pêcheurs de Perles est demeurée un de ces airs qu'on ne saurait entendre sans tressaillir. »
On ne saurait avec plus de grâce mettre la musique à la porte de son domaine, et les fleurs dont M. Bellaigue tresse d'aussi harmonieuses guirlandes sont bien celles dont Platon couronnait le front des poètes... avant de les bannir de sa république ! Il est permis de rêver pour l’œuvre d'un musicien un éloge plus affranchi de littérature, et l'on peut estimer plus digne de la gloire de Bizet une appréciation, même sévère, d'où serait éliminés les charmes impérieux d'une nuit de mai, des étoiles, de la mer africaine, de la lune et... d'un bateau. Mais, soyons tout de même reconnaissants aux belles-lettres, des sauvetages qu'elles opèrent parfois ainsi dans le passé, et ne vérifions pas de trop près, dans l'exemple présent, l'orient des perles qu'elles repêchent !...
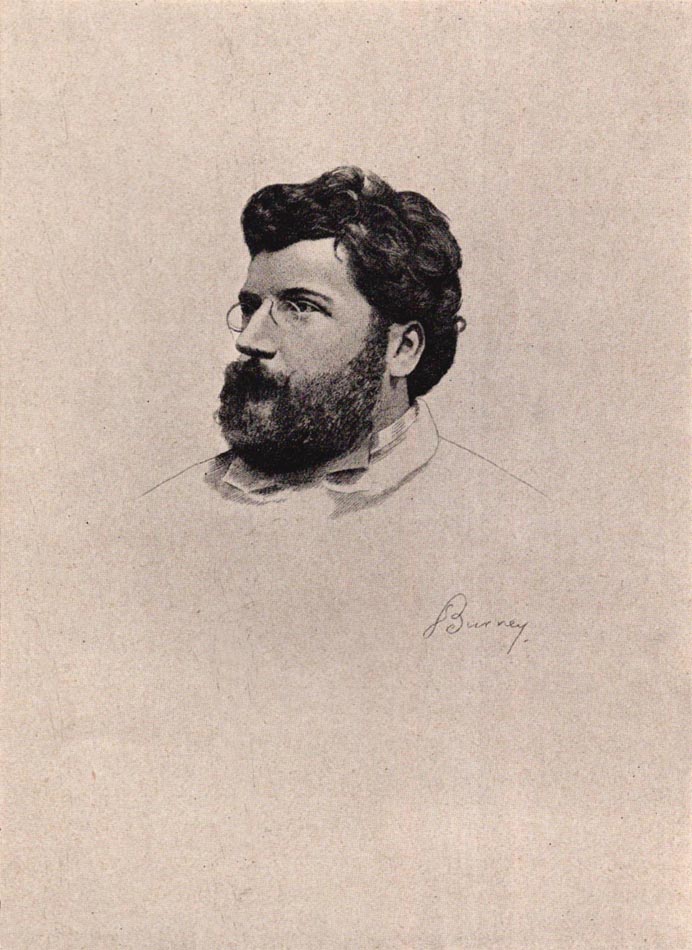
Georges Bizet, eau-forte de Burney
L'ŒUVRE. — LA JOLIE FILLE DE PERTH, DJAMILEH
Pris d'un tardif remords, MM. Cormon et Carré auraient dit (*) un jour : « Mais nous sommes des misérables d'avoir donné cet ours infame à un garçon de pareil talent. » Cet improbable aveu, les coupables Saint-Georges et Adenis auraient pu le refaire pour leur propre compte après la confection de leur Jolie Fille de Perth. Chaque jour nous voyons découper et mettre en couplets quelque chef-d'œuvre, mais rarement trahison semblable fut consommée à la face du ciel. Qu'on éprouve pour le talent de Walter Scott une admiration courtoise ou effrénée, il est impossible de ne pas être indigné du traitement infligé à son roman. On en vient à se demander si les deux adapteurs l'ont réellement lu et si leur traduction scénique n'est pas le résultat d'une conversation avec un bas-bleu ingénu qui leur aurait dicté quelques noms et narré deux ou trois détails surnageant dans sa mémoire incertaine.
(*) Alfred Bruneau. (Musica, février 1905)
De toute cette évocation de l'Écosse, de ses rivalités de gentilshommes, de bourgeois et de montagnards, il ne reste qu'une fade anecdote relatant les fiançailles de Catherine Glover et du forgeron Smith, retardées pendant quatre actes par de puériles péripéties. Ces personnages sauvés du massacre sont eux-mêmes méconnaissables. Qui retrouvera dans cette gantière évaporée l'ardente et mystique Catherine, néophyte du Père Clément, rêvant sans cesse d'évangéliser l'Écosse et d'en chasser le démon, prophétisant, lisant dans les destins, menant campagne contre le duel, sorte de salutiste ou de quakeresse avant la lettre, parfaitement impropre à fournir une jeune première d'opéra-comique. Smith le forgeron a subi, lui aussi, de tristes maquillages pour devenir ténor et le malheureux gantier Simon Glover a été travesti en simple ganache à la manière des beaux-pères d'Eugène Labiche. On ne sait d'où sort Mab la bohémienne, étrange métamorphose de Louise, l'honnête veuve du ménestrel Bertrand. Mais ce qui confond l'imagination, c'est la transformation d'Eachim-Mac-Jan, le romantique jeune chef, fils de Gilchrist, qui se cachait à Perth sous le nom de Conachar ; cette très intéressante silhouette du « nourrisson de la Biche Blanche », cet enfant du siècle rêveur et mélancolique appelé à vivre dans le fracas des armes à la tête d'une tribu guerrière et mourant de l'angoisse secrète de se sentir au cœur une invincible lâcheté, est devenu le lamentable Ralph, apprenti gantier, amoureux transi de la hile de son patron et basse-chantante spécialisée dans la chanson à boire, soit seul, soit à deux parties avec Simon. La trahison est méthodique, étudiée, définitive ; on peut pardonner à Bizet — qui, comme tous les musiciens précocement déterminés était resté littérairement un primaire, — d'avoir consenti à y tremper, mais on doit signaler à l'indignation publique les deux auteurs responsables de la forfaiture.
Les librettistes semblent avoir d'ailleurs influencé leur musicien sous le rapport de l'élasticité de conscience ! La seconde partition du jeune compositeur fait regretter la première. Visiblement Bizet y fait taire ses goûts personnels pour chercher à plaire, plaire à tout prix aux auditeurs qu'avaient effrayés les timides originalités des Pêcheurs de Perles. Il fait sa soumission au goût du jour avec un empressement si docile que ses contemporains eux-mêmes s'en scandalisent. Dans des lettres que le Figaro a publiées en août 1907, le peintre Henri Regnault, fervent admirateur de Bizet, éprouve une vive déception à la lecture de la partition qu'il déchiffre avec Lenepveu : « J'aime mieux certaines choses des Pêcheurs de Perles, écrit-il ; il n'y a rien là-dedans qui soit à la hauteur du commencement du duo des deux hommes au premier acte des Pêcheurs. » Et parlant des mystérieux retards subis par la pièce attendue il en donne cette explication : « Peut-être Bizet refait-il son dernier acte, et il ferait bien car ce n'est pas bon » ! Dès l'apparition de l'ouvrage, nous avons vu Reyer et Johannès Weber incapables de dissimuler leur étonnement en présence de ce mouvement de régression chez un compositeur dont on était en droit d'attendre au contraire d'heureuses hardiesses. La réponse embarrassée de Bizet avouant ses « concessions » et les priant d'en deviner les causes secrètes prouve à quel point avait été remarqué son pas en arrière.
Comment d'ailleurs accepter sans sourciller une
inspiration aussi fade, aussi volontairement tendue vers la plate romance et
l'inflexion banale que celle qui engendra, par exemple, la phrase en sol
bémol de Smith : « Et ce jour-là, quand l'amoureux qui veille », l'andantino
du Duc « Que vous êtes jolie » ou la lamentation mineure de Catherine : « A
peine au printemps de la vie ». Même en 1867, il se trouvait des oreilles assez
exigeantes pour se scandaliser des airs à roulades, à vocalises et à points
d'orgue du type de ceux de Catherine : « Vive hiver et vive son cortège » ou
« Écho, viens sur l'air embaumé ». Malgré les déplorables traditions lyriques de
l'époque, on ne pouvait pas davantage écouter sans malaise des pages prosodiées
d'une façon aussi comique que le sont les chœurs du Carnaval, le trio et le
quatuor de l'Atelier, et en général tous les ensembles de la partition. On se
lassait déjà des « morceaux » construits sur un dessin rythmique caractéristique
et composés d'un bout à l'autre sans aucune préoccupation de la métrique du
poème qu'on se décidera à y incorporer plus tard ; le public devenait sensible
au ridicule de ces absurdes découpages de vers débités, pour la plus grande
commodité de la phrase musicale, en tronçons inintelligibles où, sous le couteau
du rythme, les mots eux-mêmes se trouvaient sectionnés de place en place avec la
plus parfaite indifférence du sens et traités comme des onomatopées dénuées de
toute signification précise ;
plus d'un auditeur haussait les épaules quand South et le Duc de Rothsay, ayant
à se partager deux par deux en écho les noires d'une mesure à quatre temps,
hoquetaient toutes les deux syllabes pour « compter » leurs soupirs et tenaient
textuellement ces propos : « Ah ! — oui sa — Ah ! la — présence — rencontre —
inat — est im — tendue — prévue — a dé — une — sarmé — femme ah ! — mon bras —
le sé — vengeur — ducteur.... etc. », ahurissant cryptogramme qui ne devient
déchiffrable que par la suppression de deux syllabes sur quatre ! Chez tout
autre que l'auteur des Pêcheurs de Perles, de telles pratiques musicales
apparaîtraient comme le plus rédhibitoire des vices au point de vue du goût et
de l'invention artistiques ; venant de Bizet elles n'ont pas la même portée, ce
ne sont que des « concessions » volontaires et conscientes, des satisfactions
accordées avec un empressement excessif à quelques-uns de ses contemporains. On
peut s'en affliger au point de vue de la dignité professionnelle qu'aurait dû
garder héroïquement un créateur, mais on ne saurait en tirer, au sujet des
opinions personnelles de l'auteur, des généralisations dangereuses.
Chronologiquement la Symphonie suivit la Jolie Fille, mais en réalité cette œuvre résume un effort dispersé en plusieurs années depuis 1866. Reprise et abandonnée vingt fois, suivant l'urgence des commandes, elle eut beaucoup de peine à naître et à se constituer une forme définitive. Contemporaine de la Jolie Fille de Perth, de la Coupe du Roi de Thulé, de Noé, remontant même par son « Scherzo » jusqu'aux travaux de Rome, cette fantaisie ne révèle pas chez son auteur une fibre nouvelle et ne montre pas son talent sous un aspect inédit. On sent ce musicien de théâtre un peu gêné par la forme symphonique pure et les nombreux tâtonnements qu'il avoue prouvent son incertitude et son embarras. Bizet aimait infiniment cette œuvre, mais la tendresse qui le portait vers la Symphonie ressemble à celle d'Ingres pour son violon. En réalité, le sens symphonique lui manquait. Le fait de n'avoir jamais été tenté d'écrire une Sonate est déjà significatif chez un compositeur de son espèce. Le simple concerto l'épouvantait : c’est « horriblement difficile », déclarait-il avec sincérité. « Depuis trois ou quatre ans, lit-on dans sa 22e lettre à Lacombe, je rêve un concerto et je ne puis parvenir à faire à la fois du piano et de la symphonie. » Si l'on songe au prodigieux talent d'exécutant de Bizet et à la perfection de son écriture pianistique, on verra clairement ce qui pouvait le gêner dans une telle composition.
Au théâtre il fuit toutes, les occasions de confier à l'orchestre un monologue ordonné et « composé », il évite les préludes, les interludes développés, se contentant de brèves introductions ou d'intermèdes formés de morceaux juxtaposés, très en dehors, comme le solo de flûte en mi bémol baptisé « prélude du troisième acte » de Carmen (*). Lorsque son orchestre est forcé de parler seul il se réfugie d'instinct dans la forme qui lui épargnera un développement étendu : la variation « harmonique » dont l'introduction du second acte de la Jolie Fille et l'ouverture de l'Arlésienne sont de charmants exemples. Répéter intégralement plusieurs fois de suite une phrase carrée en modifiant ingénieusement les formules d'accompagnement, la mesure, et, en variant subtilement les fonctions tonales de certaines notes est un procédé qui lui fut toujours cher. Il ne faut donc pas s'étonner de le voir travailler à un « Thème varié » destiné à former le premier mouvement de sa Symphonie. Mais ce projet ne put aboutir définitivement. A la suite de « méditations et de recherches », s'il faut en croire Charles Pigot, de pressants « avis de Choudens et de Pasdeloup », selon le dire de Charles Malherbe, les variations furent supprimées. Dans une lettre à Galabert, l'auteur s'exprime ainsi sur ce nouvel état de son œuvre : ‘Je crois que le premier morceau sera bon. C'est l'ancien thème précédé d'une importante introduction calme qui revient au milieu dans l'agitation et termine le morceau dans une tranquillité complète. C'est nouveau et je compte sur un bon effet. Le milieu de l'andante est le deuxième motif du finale qui s'arrange à merveille dans ce mouvement large. Curieux ! Satanée musique, on n'y comprend rien ! » (juin 1868).
(*) Cette page d'ailleurs avait été composée pour l'Arlésienne, et l'utilisation de ce laissé pour compte rend assez piquante l'émotion des auditeurs littéraires devant cette description « si caractéristique ».
Puis il songea à utiliser le fameux Scherzo de son troisième envoi de Rome, cher à l'Institut en 1861, odieux aux abonnés de Pasdeloup en 1863. Mais la crainte de manifestations hostiles pouvant entraîner l'insuccès de l'œuvre entière fit supprimer « provisoirement » la page dangereuse lors de l'exécution de la Symphonie, au Cirque, le 28 février 1869. A cette date l'ouvrage se présentait avec ces trois parties mal équilibrées sous une forme trop peu classique pour pouvoir conserver le titre auguste et nu de « Symphonie ». Bizet, très averti des manies du public, sut adroitement escamoter les critiques certaines en baptisant son œuvre « Fantaisie symphonique » et en l'intitulant Souvenirs de Rome. Et, pour augmenter la vraisemblance, il prêta à chacun des mouvements une intention descriptive nettement précisée. Le premier temps devint ainsi « Une chasse dans la Forêt d'Ostie », le second « Une procession » et le troisième un « Carnaval à Rome ». Le public accepta fort bien comme musique à programme ce qu'il eût sifflé comme musique pure et, ce jour-là, apparut une fois de plus l'arbitraire de la distinction trop rigoureusement établie entre les « qualités » de musique convenant à chaque genre.
L'audition de 1869 fut sans lendemain et Bizet mourut sans avoir pu rendre à sa Symphonie sa forme rêvée. Ce ne fut que le 31 octobre 1880 qu'on put voir un programme de Pasdeloup annoncer non plus les Souvenirs de Rome mais la Roma de Bizet, Symphonie en quatre parties composées d'une Introduction allegro, d'un Andante, d'un Scherzo et d'un Carnaval. C'est sous cette forme que les Concerts Colonne l’ont inscrite à leur répertoire et que l'ex-Fantaisie Symphonique descriptive augmentée d'un fragment d'envoi de Rome représente aujourd'hui tout l'effort de Bizet dans le domaine de ce que l'on est convenu d'appeler la musique pure. Conclusion : avec la meilleure volonté du monde, il est impossible de ranger ce musicien de théâtre au nombre des compositeurs ayant marqué d'une empreinte personnelle la forme sacro-sainte de la Sonate d'orchestre.
Avec Djamileh, nous entrons dans la période la plus aiguë du malentendu qui sépara si souvent Bizet de ses auditeurs. Du haut en bas de l'échelle, ce fut un concours de niaiseries et de sottises. Le siège de tous les critiques était fait : l'auteur des Pêcheurs de Perles étant classé comme wagnérien forcené, c'est sous cet angle qu'on examina sa nouvelle partition. Seule, en effet, l'autosuggestion peut expliquer l'effarante impression qui fut ressentie par tout le monde avec une sincérité et une absurdité également indiscutables. La musique est l'art où les classements préalables et les hiérarchies préconçues exercent le plus impérieusement leur tyrannie : que de gens sont incapables de discerner les italianismes de Wagner ! Combien de mélomanes antidebussytes ont grincé de bonne foi, en souvenir de la Mer ou des Images, aux quartes et sixtes massenétiques de la Demoiselle élue ! Bizet fut victime d'un daltonisme analogue, en présentant au public l'inoffensive Djamileh.
Djamileh, c'est — ou plutôt ce veut être — une adaptation scénique de Namouna, mais ceux qui connaissent le poème de Musset auront quelque peine à retrouver la trace du poète dans l'ouvrage du librettiste. Camille du Locle avait vu, on ne sait pourquoi, dans cette longue dissertation lyrique remplie d'apartés, de hors-d'œuvre, de parenthèses, de digressions et de confidences au lecteur, un sujet d'opéra-comique. Afin de réaliser cet étrange projet, il fallut la célèbre habileté professionnelle de Louis Gallet, qui sut dépouiller Namouna de tout ce qui en faisait le charme pour en tirer à tout prix la banale anecdote de cette Djamileh, aussi étrangère à Musset que devait l'être plus tard la ballerine présentée à Edouard Lalo par le fâcheux M. Petipa.
Voici le résultat de cette étrange opération.
Haroun, riche fêtard, Barbe-Bleue pacifique de l'Orient, fait de houris une
consommation prodigieuse et méthodique. Ce polygame déterminé a soin de se
munir, le premier jour de chaque mois, d'une épouse nouvelle choisie par son
intendant Splendiano. Il ne chicane pas sur la marchandise et s'accommode
indifféremment de
« la Mauresque aux yeux languissants, de la juive au front sévère (sic)
ou de la Grecque, ivresse des sens ! » Il ajoute ingénument que puisque le vin
reste le même, le métal de la coupe, « argile ou or », peut changer cent fois
sans inconvénient pour le buveur !
Splendiano, qui succède volontiers à son maître auprès des femmes que celui-ci a cessé d'aimer, compte adopter pour lui-même la délaissée du mois qui s'achève, la brune et tendre Djamileh. Mais celle-ci ne se sent pas née pour cette condition : elle rêve d'enchaîner son seigneur et de lui faire comprendre la beauté de la monogamie. Haroun proteste, lui offre le petit cadeau d'usage et la congédie. Alors la tenace amoureuse revêt tranquillement le costume de l'aimée destinée à lui succéder et se présente de nouveau au débauché qui, soudain, vaincu par l'amour, ouvre-les bras à cette esclave triomphante à laquelle il restera, croit-il, éternellement fidèle !...
Ce scénario, tout d'abord impudemment orné du nom de Namouna, avait été offert, en 1869, à la verve scholastique de Duprato. Mais — soit qu'il fût affligé d'une paresse incurable, soit qu'il fût favorisé d'un goût délicat — cet honnête compositeur ne se décida jamais à livrer la musique inspirée par cette falote élucubration (*). Du Locle, tenant à son idée, décida Louis Gallet à retirer son manuscrit de ces mains nonchalantes pour le confier à Georges Bizet, avec qui les mésaventures de ce genre n'étaient pas à redouter. Toujours empressé à prendre des commandes, l'auteur de la Jolie Fille de Perth répondit à cet espoir, mit promptement de la musique autour de cette Namouna, devenue Djamileh, se laissa même imposer comme interprètes principaux la belle Prelly, Vénus aphone, et le ténor Duchesne, débutant qui ne donnait que des promesses. Et ce fut, une fois de plus, un amical succès de première, suivi d'une indifférence générale.
(*) Le 8 novembre 1869, tout en confessant que « ce damné musicien » le contraignait à, « un travail abominable », Louis Gallet écrivait « La pièce, très soigneusement montée... se jouera, j'espère, vers février » (Lettre communiquée par M. J.-L. Croze).
Mais il faut voir de près les critiques
unanimement soulevées par l'ouvrage et ouvrir en même temps la partition de
Bizet. On croit rêver et l'on se demande si c'est bien cette musique-là qui fut
exécutée le 22 mai 1872 à l'Opéra-Comique. Reyer, lui-même, signale le
Wagnérisme, mais sans aigreur : « J’ai senti passer dans certaines pages de
Djamileh, connue un souffle des
Maîtres Chanteurs (*). »
(*) Journal des Débats, 31 mai 1872.
Joncières, Saint-Victor renchérissent, avec déjà moins d'indulgence pour un tel crime. Mais le 25 mai 1872, Bénédict, dans le Figaro, précise, techniquement : « Lorsque M. Bizet consentira à se compter en musique pour quelque chose, il deviendra quelqu'un », dit cet homme avec une sympathie attristée. Il fait même remonter jusqu'aux œuvres précédentes cette absence de personnalité qui l'afflige. Dans la Jolie Fille et les Pêcheurs , « certaines idées préconçues et systématiques se substituaient trop souvent à l'inspiration du compositeur ; on eût dit qu'en écrivant, la main de Georges Bizet, serrée comme dans un étau, était dirigée par celle de l'homme qui a plus bouleversé encore l'Allemagne musicale qu'il ne l'a remuée ». Et, ouvrant Djamileh, il entre dans des détails réjouissants : « La marche des esclaves en ut mineur, manque de caractère, de mélodie, de rythme. La tonalité s'y dérobe avec affectation à l'oreille qui la voudrait saisir. Pour rendre ceci par une image corporelle, figurez-vous l'auditeur marchant sur des dissonances étagées en nuages superposés et perdant l'équilibre à la suite du musicien en posant le pied à vide. C'est cette sorte de sensation que donne l'orchestre de M. Bizet. »
Il faudrait pouvoir graver immédiatement après ces lignes la page incriminée. On lirait alors un quatre-temps bien carré, solidement rythmé comme un pas redoublé, d'allure presque triviale à force de banalité d'accentuation, coupé régulièrement de quatre en quatre avec un souci très étroit de l'absolue symétrie pour obtenir les inexorables périodes de seize mesures des marches militaires les plus patriotiques. Et ce qu'il y a de plus caractéristique dans ce prétendu escalier de nuages, c'est précisément qu'il ne module jamais et, que loin de « se dérober avec affectation » la tonalité s'y affirme avec une énergie poussée jusqu'à la platitude. Le plan est un modèle d'ingénuité : motif A (seize mesures en ut mineur), motif B (seize mesures : huit au ton relatif majeur et huit en ut mineur) trio large et chantant (seize mesures en la bémol majeur), rentrée de deux mesures et reprise du motif A sans aucune modification. C'est une composition auprès de laquelle les marches exotiques de nos Louis Ganne paraîtraient d'obscures déliquescences : les music-halls parisiens en exécutent chaque soir de plus audacieuses qui ne soulèvent aucun étonnement. S'il était un détail susceptible de choquer les tympans de 1872, c'est justement, le seul que n'ait pas signalé ce juge sévère, l'appogiature un peu dure de la sensible chevauchant la tonique dans l'accord final d'ut mineur. Mais pour tout le reste, ses observations semblent s'appliquer à une partition inconnue.
Est-ce bien également dans l'ouvrage de Bizet qu'il a pu entendre l'air « Nour-Eddin, roi de Lahore » qu'il analyse ainsi : « La phrase musicale se perd dans un labyrinthe dont le compositeur a cassé le fil conducteur. Impossible pour l'oreille la plus consciencieusement attentive de se diriger à travers un dédale d'harmonies brisées avec une affectation systématique... » Ici encore il faut suivre du doigt le terrifiant passage. Sur un rythme connu de tambourin la mélodie est d'abord exposée très clairement en ré mineur sans la moindre altération, puis, le plus naturellement du monde, on se dirige vers le ton voisin de si bémol en usant de la banale et éminemment tonale quarte-et-sixte des traités d'harmonie ; mais on revient vite au ton initial en se servant de la traditionnelle sixte augmentée qui nous y réinstalle sans effort. Rentrés en ré mineur nous n'en sortirons que par une nouvelle quarte-et-sixte qui nous conduira au ton prévu de la dominante avec une imitation parallèle et symétrique pour aboutir au ton relatif majeur de celle-ci. On chercherait vainement un plan plus élémentaire et tous ces procédés sont ceux que pourrait employer un élève harmoniste qui n'aurait lu que les premières pages de ses traités scolaires. Parvenu au ton d'ut majeur, par ces larges voies traditionnelles, Bizet s'amuse à écrire des accords de sixte conjoints sur pédale de tonique pour obtenir un aimable exotisme de convention par quelques frottements passagers et innocents. Serait-ce là que « l'oreille consciencieusement attentive » de Bénédict aurait été égarée ? En vérité cela lui ferait peu d'honneur : les harmonies sur pédale ne datent pas de 1872 et n'ont pas été non plus inventées par Wagner ; et parmi elles les accords de sixte par mouvements conjoints sont les plus douces. Que reste-t-il encore dans ce labyrinthe ? Une classique cadence rompue (toujours en ré mineur) sur le vieil arpège de septième diminuée, procédé poussiéreux, et l'on termine en ré majeur avec une double pédale de tonique et de dominante sur laquelle des accords parfaits glissent par degrés conjoints jusqu'à l'accord final. Aucune audace, aucune recherche harmonique de la première à la dernière note : moduler de tierce en tierce sans oser se passer de la quarte-et-sixte rituelle et se voir traiter en décadent privé du sens tonal n'est-ce pas là, pour un compositeur, une mésaventure révoltante ?
Toute la partition est réalisée dans cet esprit. Le duo : « Celle que l'on n'attend pas » ; les couplets : « Tu veux savoir si je préfère » ; la phase : « Enfant, laissons dans les buissons » sont d'une fadeur mélodique bien faite pour trouver grâce devant les auditeurs les plus affamés de romances. Quant aux chœurs, d'une vulgarité extraordinaire, le « Salut, salut, Seigneur Haroun » et le « deux-quatre » piqué : « Quelle est cette belle dont, l'œil étincelle » trouveraient place sans changement dans n'importe quelle opérette d'Offenbach. Tout le rôle de Splendiano est volontairement maintenu dans une note bouffe qui aurait dû désennuyer Sarcey ; ses deux couplets : « Il faut pour éteindre ma flamme » avec leur consciencieuse ritournelle, n'offrent véritablement rien de wagnérien, et si un souffle passe dans le grand duo final, c'est uniquement celui de Gounod.
Mais on sent très bien que quelques minuscules hardiesses d'écriture, toujours les mêmes d'ailleurs, ont dû prendre à cette époque les proportions d'un scandale suffisant pour donner à la critique son incompréhensible parti pris. Sur ces cent trente pages de musique on réunit à peine une dizaine de mesures, en tout, présentant quelque audace. C'est assez pour que le musicographe impressionnable, se souvenant qu'il s'est bouché dix fois les oreilles au cours de la soirée, s'imagine sincèrement avoir entendu une cacophonie perpétuelle. Bizet avait le goût de l'appogiature un peu âpre et l'écrivait souvent en même temps que la note réelle : dans le Prélude de Djamileh il accompagnait une sensible par l'accord parfait de tonique, ce qui dut faire passer un frisson d'horreur sur bien des épidermes, et, plus loin, l'on put entendre un fa dièse sur un fa naturel ou un si naturel contre un si bémol. Ces pratiques, très légitimes et très régulières, ont pu choquer les critiques peu au courant des choses de l'harmonie et se piquant de purisme. De là à crier au wagnérisme et au chaos il n'y avait qu'un pas ; et lorsqu'on se trouvait en face d'un accord de septième sans préparation avec appogiature inférieure de la basse comme dans le délicieux « lamento », il ne restait plus qu'à se voiler la face et à masquer son ignorance en parlant de labyrinthe, de dédale et de nuages !
Ce fut là le grand malentendu. Parce que Bizet rehaussa ses formes essentiellement italiennes de passagères et menues élégances d'écriture, on ne voulu plus reconnaître sa fidélité aux coupes traditionnelles, pour ne se souvenir que d'un détail infime mais de forte saveur (*) et ses romances les plus melliflues passèrent pour d'obscures divagations germaniques dès qu'on put découvrir quelque part, dans leur accompagnement, un seul frottement savoureux de notes ennemies !
(*) « A mon sens, Djamileh jouera à l'Opéra-Comique le rôle de caviar dans un diner : deux ou trois amateurs y tâtent ; les autres préfèrent le simple filet de bœuf ». (Lettre de Louis Gallet, du 4 juin 1872).

l'Arlésienne, acte II (dessin de Meyer)
L'ŒUVRE — L'ARLÉSIENNE, CARMEN
Beaucoup d'admirateurs de Bizet tiennent la partition de l'Arlésienne pour une réalisation musicale supérieure encore à Carmen. Nous nous garderons de discuter cette hiérarchie. Camille Bellaigue, à qui nul ne songerait à refuser une compétence toute particulière en matière d'art latin, déclare qu'avec plus de brièveté, l'Arlésienne a plus d'étendue et de profondeur que Carmen. « Dans l’Arlésienne, dit-il, les choses même vivent ; elles ont une voix et des pleurs. Musicien de la vie et de la mort, Bizet fut de l'une et de l'autre un musicien véridique. Il a donné de toutes les deux des images sonores dont la musique avait jusque-là rarement connu la franche et forte réalité. Les maîtres de l'opéra-comique firent-ils jamais chanter des paysans comme chantent par la voix de l'orchestre le vieux Balthazar et la maman Renaude, la douce Vivette et le malheureux Frédéri ? »
Le public français semble s'être rallié à cet avis ; soit qu'elle retentisse par fragments, sous les ormes des mails provinciaux, à l'heure de la musique militaire, soit qu'elle assure, sous sa forme intégrale, les recettes maxima de l'Odéon, la partition de l'Arlésienne rencontre dans tous les auditoires un accueil sympathique. En mai 1909, le penseur wagnérien Edmond Schuré vantait, dans la Revue des Lettres et des Arts « cette idylle tragique où les génies d'Alphonse Daudet et de Bizet se fondirent en une si caressante et si incisive mélodie ». Quant aux esthètes d'avant-garde, souvent sévères pour l'auteur de Carmen, ils n'ont jamais voulu s'attaquer à cette courte et savoureuse évocation de la claire Provence que Félibres pas plus que Rosati n'ont songé à discuter un seul instant.
On sait qu'il n'en fut pas toujours ainsi et que les spectateurs du Vaudeville présents à la première représentation ne crurent pas avoir eu la primeur d'un chef-d'œuvre. Pour cette fois, il ne faut pas les accuser trop vivement d'incompréhension ; le public qui se rendit coupable de cette monstrueuse injustice eut quelques excuses.
Tout d'abord, reconnaissons que cette tentative audacieuse de Carvalho, donnant au genre méprisé du « mélodrame » une importance imprévue, avait été mal présentée et insuffisamment annoncée. Charles Pigot affirme que l'Arlésienne « inaugurant une nouvelle direction avait été montée avec le plus grand soin » et estime que le « nouveau directeur tenait à faire bien augurer de l'avenir par cette entrée en matière ». Il est permis d'en douter. Certes Carvalho ne peut être accusé de mauvaise volonté : il témoigna toujours à son musicien favori une tendresse active et un dévouement éclairé ; mais on ne saurait sans légèreté négliger l'examen des conditions toutes spéciales dans lesquelles se présenta l'œuvre nouvelle. Les circonstances qui entourèrent sa naissance devaient fatalement paralyser les efforts du plus affectueux des parrains.
L'ouverture du Vaudeville devait se faire non pas avec l'Arlésienne mais avec une pièce de Robert Halt intitulée Madame Frainex sur laquelle s'étaient concentrés tous les efforts de la nouvelle direction. Les journaux de l'époque sont remplis de « communiqués » et de notes sur cet ouvrage fort attendu. Il est probable que l'Arlésienne tenait alors bien peu de place dans les préoccupations directoriales.
Un incident violent attire plus vivement encore
l'attention publique sur la pièce annoncée : on apprend que le général de
Ladmirault veut interdire Madame Frainex. Grande émotion. On porte la
question jusque sur le tapis vert de la table du Conseil des Ministres : Jules
Simon n'ose résister au général-censeur et le véto devient définitif au Conseil
du 21 septembre 1872.
Huit jours après, le 30 septembre, l'Arlésienne voyait les feux de la
rampe !
N'a-t-on pas le droit de penser que ce travail
désespéré d'une semaine, pour sauver l'affiche, n'était pas celui que rêvait
Carvalho pour une œuvre qu'il aimait et qu'il comptait monter à loisir au cours
de sa saison ?
La discrétion excessive des « Courriers des théâtres » pendant cette rapide
incubation n'est pas pour nous contredire. Ce fut presque la conjuration du
silence autour d'une tentative qui précisément ne pouvait réussir qu'après une
méthodique préparation de l'opinion.
La partition, en tout cas, passa presque inaperçue : la Gazette musicale, alors importante, constata que le musicien s'était volontairement « effacé derrière le poète ». Par convenance pour le compositeur on imprima des appréciations de ce genre : « M. Bizet a écrit pour cette pièce une Ouverture et des entr'actes qui m'ont paru mériter d'être écoutés avec plus d'attention qu'on ne leur en a donné. Les chœurs, où je n'ai rien distingué de très saillant, ralentissent encore la marche d'une œuvre si languissante par elle-même. » Ce fut le ton adopté par tous les critiques à la Vitu. Seul, Reyer dans son article des Débats rendit pleine justice à l'effort du musicien et loua pertinemment « les fines harmonies, les phrases au contour élégant et les jolis détails d'orchestre » de cette « jolie » partition où lui, du moins, avait su découvrir autre chose que le traditionnel « trémolo à l'orchestre » avec lequel les spectateurs du Vaudeville ne furent pas éloignés de la confondre.
Mais quelle entreprise malaisée que de vouloir dégager l'impression exacte emportée par les auditeurs de 1872 ! Les témoignages les plus autorisés que nous avons pu recueillir s'accordent si mal ! « La musique de Bizet, affirme Charles Pigot, réunit cette fois tous les suffrages : quant à la pièce on la discuta vivement. » Léopold Dauphin, spectateur de la première, écrit tout le contraire : « Le succès de la pièce fut très vif : celui de la partition le fut moins ». Dans Mon frère et moi, M. Ernest Daudet parle de « la lassitude et de la déception d'une victoire douteuse » et précisait récemment : « Je n'ai gardé de la première représentation de l'Arlésienne d'autre souvenir que celui de la très amère déception que nous causa l'accueil fait à ce délicieux chef-d'œuvre par le public du Vaudeville, qui n'y vit qu'une très banale paysannerie. » Mme Bartet, qui créa le rôle de Vivette, raconte qu'à la chute du rideau, tandis qu'Alphonse Daudet tâchait de le réconforter, Georges Bizet, pris d'une crise de découragement, s'effondra sur une chaise et, tendant le poing vers la salle, répéta avec désespoir : « Ils ne m'ont pas compris, ils ne m'ont pas compris ! » D'autre part, une phrase discrète mais significative de M. Ernest Daudet semblerait confirmer ce que nous craignions de deviner, au sujet de la présentation hâtive et incomplète de l'ouvrage par une direction en désarroi : « C'est à Porel, affirme-t-il, que revient l'honneur d'avoir remis en lumière l'Arlésienne à l'Odéon avec une mise en scène et un orchestre qui faisaient revivre la Provence, son soleil et ses chansons avec plus de relief qu'au Vaudeville. »
D'ailleurs quelle difficulté pour fixer même les détails matériels les plus élémentaires ! Léopold Dauphin, en bon compositeur, a bien remarqué l'introduction d'un saxophone dans l'orchestre de Constantin chargé d'exécuter la partition, mais il évalue à quarante le nombre des instrumentistes que l'énumération minutieuse de Reyer ramène à vingt-six (sans compter un harmonium tenu, derrière la toile, par un ami de la maison, tantôt Guiraud, tantôt Antony Choudens, tantôt Bizet lui-même). Pour Charles Pigot, dont la documentation est si sûre, l'Arlésienne aurait été jouée seulement quinze fois, alors que les archives de la Société des Auteurs fixent la première au 30 septembre et la dernière au 18 octobre, et que les collections de journaux de l'époque nous affirment de leur côté que la série ininterrompue de ces représentations commencée le 1er octobre se poursuit jusqu'au 21 du même mois !
Quoi qu'il en soit, éclatante ou discrète, la disgrâce de l'œuvre fut complète. Et, tout en tenant compte des conditions défavorables dans lesquelles se présentait l'ouvrage, on peut donner de cet insuccès des raisons d'un ordre plus général.
Il ne faut pas qu'une partition de scène soit trop belle, il ne faut pas qu'elle contienne trop de musique. Toute composition qui apporte à l'oreille des foules une pensée neuve ou une forme imprévue exige une « attention active » et ne s'accommode pas de la demi-perception d'un auditeur partagé entre l'intelligence du dialogue, le sentiment de la situation dramatique et l'appréciation du décor musical.
Dès qu'un texte s'affranchit de la servitude rythmique du chant, il impose nettement à l'auditeur son harmonie propre, ses cadences, sa musique dont, les inflexions sont assez impérieuses pour ne souffrir aucune autre superposition sonore. La vie musicale de la parole est subtile et intense : sa technique souple et minutieuse, qui se suffit à elle-même, crée, des intonations et des dessins mélodiques dont l'infiniment petit ne supporte pas un parallélisme prolongé avec les formes de langage et les locutions orchestrales. L' « adaptation musicale » est un non-sens. Au-delà de la rampe résonne un idiome qui n'a, avec la langue parlée en deçà, aucun point de contact ; et je ne connais pas de cerveau humain assez fortement organisé pour opérer la perpétuelle dissociation nécessaire à l'intelligence du double texte et effectuer la synthèse instantanée qui lui permettra d'apprécier l'heureux accord de ces éléments d'émotion. Il ne faut pas railler l'indigence du « trémolo » des orchestres de mélodrame : c'est au fond tout ce que peut se permettre un compositeur trop délicat pour ne pas détourner à son profit l'attention des fauteuils d'orchestre émus par l'infortune de l'orpheline ou la vilenie de ses persécuteurs. Une partition de scène réellement « organisée » est une véritable trahison envers la pièce car, pendant que vous savourez l'adroit rappel du thème, la fine modulation et le bon retour au ton principal d'un motif prodigue, vous laissez échapper ce qu'il y a de perfide dans la question insidieusement posée au trop confiant gentilhomme, et vous ne comprenez pas que la réflexion du vieil écuyer est la clef de tout le troisième acte !
Donc, ne flétrissons pas trop énergiquement les abonnés du Vaudeville, incapables de recevoir dans l'oreille droite les préciosités (le mot est de Reyer) d'une prose dont Alphonse Daudet « avait caressé les périodes avec amour, nous dit son frère, comme les stances d'une pastorale » tout en recueillant dans l'oreille gauche les délicates inventions harmoniques et mélodiques de Georges Bizet. Il y a là une impuissance organique nettement caractérisée en face de deux éléments rebelles à une superposition contrapuntique. Contempler le Nord de l'œil gauche et le Sud de l'œil droit, cela s'appelle loucher : la première exécution de l'Arlésienne n'aurait pu réussir que devant des spectateurs atteints de strabisme auditif.
Et qu'on ne cherche pas dans la qualité de la partition le motif de son échec : cette musique n'était pas venue avant son heure, elle convenait parfaitement à l'éducation du public d'alors ; la meilleure preuve en est que, vingt jours après son départ du théâtre, elle reçut au Concert du Cirque d'Hiver un accueil immédiatement sympathique. Il y fallait les deux oreilles.
Le cas s'est renouvelé souvent dans l'histoire musicale : tout près de nous, n'avons-nous pas vu la partition de scène de l'Abbé Mouret chercher vainement à l'Odéon un succès qu'elle n'obtint qu'aux Concerts Colonne et, pour la même raison, n'avons-nous pas eu à déplorer l'inutile dépense de musicalité en laquelle Ramuntcho induisit le délicieux Pierné ? Nous n'avons pas montré plus de souplesse que les auditeurs de 1872 et si le public actuel est parvenu à goûter aujourd'hui un plaisir complet aux représentations de l'Arlésienne c'est que sa mémoire fait tous les frais de la synthèse et que la partition, popularisée par les concerts, enregistrée d'avance dans tous les cerveaux, prend place automatiquement dans la perception de l'ensemble. Et c'est ainsi qu'il faudrait toujours pouvoir en user avec ces sortes de réalisations : ce n'est qu'après un stage suffisant aux programmes des concerts symphoniques qu'une belle partition de scène devrait être autorisée à prendre place au Français ou à l'Odéon ! Ce procédé (peut-être paradoxal) est le seul qui préviendrait les malentendus.
Plus que toute autre, la partition de l'Arlésienne aurait eu avantage à demeurer quelque temps sur le pupitre de Pasdeloup avant d'entrer chez Carvalho. Ses numéros symphoniques présentent pour la plupart un sens propre et complet qui permet de les isoler facilement de l'ouvrage. L'un d'entre eux, inutilisé, est entré tranquillement dans la partition de Carmen (*), les autres auraient pu recevoir également une destination différente. Sauf les petits « mélodrames » de six à huit mesures qui ramènent aux bons endroits une courte phrase expressive avec d'ingénieuses élégances harmoniques, les pages maîtresses de l'œuvre sont des morceaux de genre où le souvenir de Daudet, du mistral, de la ville d'Arles et de ses habitants se découvre malaisément. Lorsqu'il n'était pas enchaîné par son texte à la couleur locale, Bizet ne pensait plus qu'à écrire d'agréables feuilles d'album. Jugeant suffisantes les concessions faites au Folklore provençal en utilisant la « Marche dei Rei » dans son prélude, l' « Er dou Guet » dans la berceuse de l'innocent et la « Danse dei Chivau-Frus » pour sa farandole, il laissa dans sa partition assez d'éléments musicaux d'intérêt plus général pour offrir matière à deux copieuses suites d'orchestre, l'une établie par lui-même et l'autre par Guiraud. Il faut avouer en en effet que le chœur à 6/8 « Grand soleil de la Provence » n'est pas situé très fortement au point de vue géographique et pourrait célébrer musicalement un paysage tout différent. Quant à la description problématique de la « Cuisine du Castelet » elle est devenue sans modification aucune un O Salutaris fade mais vraisemblable.
(*) Un autre laissé pour compte, le chœur « pour récolter le vermillon » a également survécu dans Carmen, avec les paroles « Quant au douanier c'est notre affaire ».
Le chœur en fa dièse mineur rythmé en boléro trouva place tout naturellement dans le recueil des vingt mélodies sous le titre de « Pastorale ». Et quant au charmant Intermezzo, affranchi de préoccupation descriptive ou psychologique, il faut toute la lyrique piété d'un Charles Pigot pour y trouver un tableau donnant « une impression de sénilité charmante, à l'allure vieillotte, au chef branlant » et pour justifier le caractère trop différent du large trio en la bémol en y cherchant « l'expression de la tendresse douce et résignée des deux vieillards ».
La partition de l'Arlésienne est avant tout une œuvre de musicien, un recueil de fine et excellente musique et cela est mieux ainsi. Pourquoi vouloir à tout prix y découvrir des conceptions de poète, des recherches d'analyste et des reconstitutions de paysagiste provençal ? Bizet ne fit guère que des voyages autour de sa chambre ; il connaissait aussi mal les plaines de la Crau que l'île de Ceylan ou la ville de Perth, et ne s'embarrassait certes pas des scrupules d'un globe-trotter. Qu'importe donc le côté un peu approximatif de ses descriptions puisque l'oreille y trouve toujours son compte ? Consolons-nous de ne pas retrouver telle ou telle intention du texte en constatant combien le goût du compositeur s'est affiné depuis la Jolie Fille de Perth, en savourant la délicate virtuosité harmonique du Prélude ou du Carillon, en notant au passage l'audace heureuse de telle fausse relation qui marque une étape nouvelle dans le développement du sens de l'ouïe au XIXe siècle. Et ceci est plus important que cela !
Carmen est peut-être la seule œuvre humaine qui échappe actuellement à toute discussion. Ceux qui l'aiment n'admettent aucune restriction dans l'éloge qu'ils décernent à ce qu'ils considèrent comme le chef-d'œuvre du théâtre lyrique contemporain, et ceux qu'un autre idéal musical attire vers des ouvrages différents, n'ont jamais songé à opposer aux admirateurs de Bizet ces objections dont ils se montrent, par ailleurs, pourtant si prodigues. Il semble que les spectateurs de 1875 aient épuisé la somme de malveillance et d'incompréhension qui est la rançon habituelle de toutes les tentatives créatrices. L'univers entier sourit aujourd'hui à la capricieuse bohémienne et oublie en sa présence les incompatibilités de races ou d'écoles. Bien plus, cette évocation si factice et si arbitraire de l'Espagne a su tromper non seulement les partisans les plus résolus de l'exactitude en matière de couleur locale, mais les Espagnols eux-mêmes qui ne conçoivent plus une corrida sans une exécution d'un fragment de Carmen. Il faut noter également ce qu'il y a de paradoxal dans le respect, ou tout au moins dans la silencieuse déférence de nos wagnériens et même de nos debussystes les plus forcenés, envers une partition dont le système et la technique sont de ceux qu'ils ont toujours férocement combattus. Mais les âmes latines n'ont pas été seules sensibles à un art qui semblait pourtant nettement spécialisé et étroitement racé. Le Nord a failli dépasser le Midi dans l'expression de son délire. On sait qu'aucun méridional n'a égalé Nietzsche dans l'apologétique de Carmen et qu'en voyant l'auteur du Cas Wagner brûler la tétralogie sur l'autel de Georges Bizet, les méditerranéens les plus convaincus, Camille Bellaigue, entre autres, ont protesté contre « le trop glorieux holocauste ».
Mieux encore, la Russie semble prête à sacrifier à la Carmencita les délicieuses conquêtes que ses compositeurs modernes ont réalisées dans le domaine des sons. Voici ce qu'écrivait le 18 juillet 1880 à Mme von Meck l'opportuniste Tchaïkovski : « Carmen est un chef-d'œuvre dans toute l'acception du mot, c'est-à-dire, une des rares créations qui traduisent les efforts de toute une époque musicale... La nouvelle école russe est-elle autre chose qu'un ensemble d'harmonies piquantes, de combinaisons originales d'orchestration et d'autres choses aussi superficielles ! Autrefois quand on composait, on créait : maintenant on cherche à découvrir... Mais voilà qu'un Français vient, chez qui tout ce piment et tous ces excitants ne paraissent pas être le résultat d'un labeur, mais coulent comme de source, flattent l'oreille et en même temps émeuvent le cœur comme s'il nous disait : Vous ne voulez pas quelque chose de grandiose, de puissant, vous voulez du « joli » voilà un « joli opéra ». En fait, je ne connais rien qui mérite mieux ce nom de joli. Bizet n'est pas seulement un compositeur bien de notre temps, mais aussi un artiste qui ressent profondément, un maître..... Je suis persuadé que dans dix ans Carmen sera l'opéra le plus populaire du monde entier (*). »
(*) Cité par les Tablettes théâtrales, du 10 mai 1903.
Enfin on doit souligner l'enthousiasme presque national de toute l'Allemagne contemporaine se précipitant, à la suite de Nietzsche, aux pieds du musicien jugé seul capable de « méditerraniser la musique » et poussant l'enthousiasme envers son œuvre jusqu'à une tentative de dénaturalisation : « Carmen, a-t-on pu lire dans la National Zeitung, si elle est l'œuvre d'un Français, ne renferme pas de musique vraiment française. Cet opéra est un exemple de ce que peut donner la musique quand elle est animée d'un esprit général, sans préjugés d'école et de traditions ».
Faut-il voir réellement dans Carmen autre chose qu'un opéra-comique très traditionnaliste et surtout parfaitement français ? Cela paraît bien discutable !
Le livret que Meilhac et Halévy ont tiré de la célèbre nouvelle de Mérimée est singulièrement tendancieux. On y sent la volonté constante d'adoucir, d'estomper et même de banaliser la silhouette de cette libre bohémienne si nettement campée par le conteur. Pour ne pas effrayer la clientèle bourgeoise et familiale de M. du Locle, les adroits adapteurs ont fait subir aux personnages de Mérimée un prudent maquillage. L'évènement leur prouva que la précaution n'était pas superflue. Même travestis d'après l'esthétique du genre, les honnêtes fantoches fabriqués par les librettistes soulevèrent la réprobation des spectateurs qui n'admettent les coups de poignard que dans les opéras historiques et la liberté de l'amour que chez les maladives repenties du genre « Traviata ».
Et pourtant, que de concessions à la morale publique dans ce que Bizet appelait « une édition très expurgée » ! Le farouche José Lizzarrabengoa, le terrible gars d'Elizondo que Mérimée retrouva « en chapelle » prêt à expier quelques assassinats trop éclatants, s'est vertueusement assagi pour monter sur le plateau de l'Opéra-Comique. A part le crime passionnel du dernier acte — geste pour lequel toute indulgence est acquise par tradition ! — le dragon d'Alcala, le « canari » un peu niais de Meilhac et Halévy n'a pas grand'chose à se reprocher. On ne sait plus ce qui l'a contraint à quitter son village et à s'engager dans la cavalerie, abandonnant une mère à laquelle il prodigue cependant de si touchantes effusions mélodiques. Aucun souvenir du duel aux « maquilas » avec le pelotari de l'Alava. On se garde bien de lui faire tuer Zuniga et le coup de pointe qui étendit à ses pieds le lieutenant de dragons chez la vieille Dorothée, dans le bouge de la rue du Candilejo, est devenu un simple dialogue aigre-doux, vite interrompu par les bohémiens à l'heure où le geste va remplacer la parole. Plus de couteau planté jusqu'à la garde dans la gorge de Garcia le Borgne. Plus d'embuscades aux carrefours pour détrousser les passants et abandonner leurs cadavres aux corbeaux de la sierra. Aucune allusion à l'assassinat mûrement organisé de l'officier anglais de Gibraltar ! Un bandit d'opéra-comique ne saurait se permettre une collection d'exploits aussi caractérisés. Il peut prendre un air sombre et farouche, brandir à l'avant-scène une navaja ou une espingole, mais tout doit se passer en conversations et en cavatines. Le don José de Bizet, un pauvre garçon qui aimait bien sa mère et que l'amour d'une « créature » a entraîné hors du droit chemin, n'a plus la haute allure du bandit conçu par Mérimée.
Carmen n'a pas été rendue moins méconnaissable avant de paraître devant les mélomanes. Elle n'est plus qu'une cigarière effrontée, une fantaisiste qui n'écoute que les impulsions de son cœur et répugne au partage au point d'avertir don José lorsqu'elle se sent attirée vers Escamillo. On a négligé de nous dire sa virtuosité dans l'art de dépouiller les gens. Le héros de Mérimée confesse que l'aimable personne lui subtilisa sa belle montre à répétition, dès leur première conversation, avec un doigté si discret qu'il ne constata le larcin que le soir en rentrant chez lui. A Grenade, à Cordoue et à Malaga, elle savait découvrir les riches négociants pour les voler ensuite ou les pousser dans une embuscade organisée par ses amis. C'est ainsi que José assassina au passage, sur les indications de Carmen, le gros officier anglais qui avait accepté d'accompagner la perfide bohémienne à Ronda où elle prétendait visiter une sœur religieuse ! Il y a loin de cette terrible femme-apache à la chanteuse de « habaneras » qui coquette aujourd'hui sur la scène de l'Opéra-Comique et dont la perversité suprême consiste à « passer en avant » d'une caravane de contrebandiers pour faire quelques agaceries aux douaniers et détourner l'attention de ces modestes fonctionnaires des contributions indirectes.
Enfin, si le sinistre Garcia le Borgne, premier mari de Carmen, a disparu de l'horizon et si le picador Lucas, montant en grade, est devenu le torero Escamillo, il faut saluer la naissance d'un personnage nouveau sorti de toutes pièces du cerveau des librettistes : l'insipide et bêlante ingénue sans laquelle il n'est pas d'opéra-comique digne de ce nom. Mérimée n'avait pas soupçonné Micaëla, candide soprano dont l'intrusion dans l'action farouche qui se déroule de la place de Séville aux gorges de Cordoue peut sembler d'une opportunité discutable, encore que Charles Pigot, avec une indulgence décidément inlassable, tienne cette invention pour un trait de génie. « Au théâtre, dit-il, il faut à tout prix que le spectateur s'intéresse à quelqu'un ou à quelque chose : à qui aurait-il donc pu s'intéresser dans l'abominable séquelle des scélérats de Mérimée ? » Et il va même jusqu'à affirmer que, sans la présence de cette « chaste figure », la nouvelle de Mérimée « eût manqué d'intérêt ! » En vérité c'est faire au public un affront un peu vif que de lui prêter une mentalité aussi simpliste et j'avoue n'avoir jamais constaté l'heureux effet des deux interventions de Micaëla sur la foule qui suit passionnément les aventures de « l'abominable séquelle ». Il semble bien au contraire, que ces deux apparitions de l'ange gardien en « jupe bleue et nattes tombantes » ralentissent singulièrement l'action et donnent l'impression de hors-d'œuvre artificiellement introduits dans le drame.
Loin d'en féliciter les inventeurs, il serait peut-être plus équitable de leur chercher une excuse, et l'on peut en trouver une en constatant que l'appoint d'une voix de soprano léger était à peu près obligatoire dans l'équilibre des timbres de cette partition. La Carmen de Mérimée manquait de femmes et les trois hommes de métier lyrique qu'étaient Meilhac, Halévy et Bizet y remédièrent sans retard. Croyez bien que des considérations de tessiture, le souci de la variété et de l'opposition des voix ont suffi à tirer du néant la douce fiancée navarraise (*) en compagnie de deux falotes créatures qui se nomment Frasquita et Mercédès et n'ont d'autre but dans la vie que de prêter leur utile concours aux ensembles vocaux de la partition. Mais le moyen de faire admettre une explication aussi prosaïque !...
(*) M. Saint-Saëns, qui assista à la troisième représentation, écrivait récemment : « le contraste était parfait entre la crânerie savoureuse de Mme Galli-Marié et la grâce si chaste, le talent si pur de la future générale André » (Mlle Chapuy).
En relisant ce livret composé selon toutes les règles du genre, respectueux de toutes les traditions lyriques de l'époque, adroitement coupé suivant les formes vocales habituelles et cantonné, en somme, dans l'opportunisme le plus timoré, nous ne pouvons plus comprendre l'impression ressentie par ses premiers juges.
Qui oserait traiter en créature douée de raison l'homme qui écrivit par exemple : « Le style de Mérimée, exact et froid comme une photographie, le cynisme de sa pensée m'ont toujours fait regarder le succès de ses œuvres littéraires comme un symptôme alarmant de démoralisation et, à l'exception de Colomba, je crois qu'il n'y a aucun profit à s'associer à ses conceptions fantastiques... M. Bizet en a fait la cruelle expérience. Son opéra renferme de beaux fragments mais l'étrangeté du sujet l'a lancé dans la bizarrerie et l'incohérence (*). »
(*) Félix Clément, Dictionnaire des Opéras.
N'est-il pas édifiant de songer que toutes les déplorables concessions de Meilhac et Halévy pour travestir leur héroïne ne les ont même pas préservés de ces obtuses critiques et que, plus ils s'efforçaient de flatter l'opinion moyenne, plus ils soulevaient de réprobation dans les milieux réactionnaires !
Le compositeur ne fut pas plus heureux que ses deux collaborateurs. Il les avait d'ailleurs suivis dans la voie de l'opportunisme et ne s'en vit pas récompensé. Ici encore il faut s'inscrire en faux contre la légende qui veut à tout prix faire de la partition de Carmen un instrument de combat. Rien ne permet de voir dans ce dernier ouvrage cet idéal novateur, cette conception d'artiste précurseur que l'on prétend systématiquement attribuer à Bizet malgré lui. Sans doute il scandalisa une fois de plus ses contemporains par de délicieux détails harmoniques, fugitifs et insaisissables ; il modula avec recherche et témérité ; il fit de la couleur locale d'un ibérisme approximatif mais suffisant pour inquiéter les ignorants ; il fit bondir tous les critiques sur leurs fauteuils en terminant par des emprunts aux tons éloignés la romance de José « La fleur que tu m'avais jetée »..., etc., mais il ne songea pas un seul instant à détourner des voies habituelles le char de l'Opéra-Comique dont on lui avait confié la direction ; aucune tentative de rajeunissement ne se décèle dans la coupe de son œuvre, ni dans le détail de ses formes musicales. Ce sont toujours les chœurs de franche carrure, les duos symétriques, les ensembles placés aux endroits habituels, les cavatines, les prières, les romances, les danses, les airs à couplets et à refrains du vieux répertoire. Bizet n'avait rien d'un anarchiste et n'a jamais songé à modifier les usages lyriques de son temps.
D'ailleurs, comme nous l'avons invariablement constaté à l'occasion de ses ouvrages précédents, ce prétendu révolutionnaire se préoccupait surtout de flatter son public ou ses interprètes. On sait que, pour obtenir l'approbation de Galli-Marié, il recommença treize fois la Habanera du premier acte afin d'assurer à cette exigeante cantatrice une entrée applaudie. Et il déchira une première version, d'un style trop relevé, des couplets d'Escamillo pour y substituer celle que nous connaissons et qui ne pèche évidemment pas par excès de distinction. Charles Lamoureux, qui eut la primeur du nouveau refrain, rapportait que Bizet déclara lorsqu'il eut fini de l'exécuter : « Ah ! ils veulent de... l'ordure, eh bien en voilà ! »
Il y a donc exagération manifeste à proclamer, comme on le fait trop souvent, Carmen « le point de départ du drame lyrique moderne ». En réalité, Bizet n'a pas apporté grand'chose dans ce domaine, et c'est tout au contraire chez ses ascendants que se découvrent de telles aspirations. M. Louis de Fourcaud l'a judicieusement souligné : « Le répertoire du XVIIIe siècle abonde en essais de drames lyriques qui, pour n'être pas conçus à notre façon, n'en sont pas moins caractérisés : drames lyriques, drames d'émotion et non de tranquille bonne humeur, le Déserteur de Monsigny, le Richard Cœur de Lion de Grétry, la Nina de Dalayrac, la Stratonice et le Joseph de Méhul. On voit les musiciens se préoccuper de plus en plus de l'expression juste, et les poètes s'attacher à la mettre toujours davantage aux prises avec des situations serrées, d'un intérêt dramatique aussi intense qu'il est en eux. Le commentaire orchestral suit du même pas (*). »
(*) L. de Fourcaud. Le Gaulois (9 mars 1891).
Carmen constitue évidemment une réaction dans cet ordre d'idées plutôt qu'un progrès. Bizet n'en fut pas récompensé. Sans parler du jugement directorial de Camille du Locle qui, au témoignage de M. Saint-Saëns, disait « de sa voix moqueuse et aigrelette » à qui lui parlait de l'œuvre nouvelle : « C'est de la musique cochinchinoise, on n'y comprend rien », l'opinion de la critique s'avoua presque unanimement hostile. Mais les motifs de cette hostilité sont si absurdes, si incohérents et si contradictoires qu'il est nécessaire de remettre au jour quelques extraits de l'inépuisable Sottisier, qu'enrichit quotidiennement, depuis plusieurs siècles, la critique musicale.
Dans le Moniteur universel, Paul de Saint-Victor décrétait : « M. Bizet appartient à cette secte nouvelle dont la doctrine consiste à vaporiser l'idée musicale, au lieu de la resserrer dans des contours définis. Pour cette école, dont M. Wagner est l'oracle, vague comme celui des chênes de Dodone, le motif est démodé, la mélodie surannée ; le chant, soufflé et dominé par l'orchestre, ne doit être que son écho affaibli. Un tel système doit nécessairement produire des œuvres confuses... L'orchestration de Carmen abonde en combinaisons savantes, en sonorités imprévues et rares. Mais cette concurrence excessive faite aux voix par les instruments est une des erreurs de l'école nouvelle ».
Dans la Revue des Deux Mondes, F. de Lagenevais raffinait complaisamment : « La mélodie de M. Bizet produit sur moi l'effet d'une de ces lumières qu'on place dans un globe de cristal opalisé... » etc., formulant ainsi une critique analogue à celle de la République Française dont le rédacteur déplorait « l'absence de lumière » de cette musique « demeurant d'un bout à l'autre dans une teinte grise ».
Certains précisaient, malencontreusement, tel le pauvre Henry de Lapommeraye qui, dans la France, rendait cet arrêt motivé : « L'air de José dans la coulisse est d'un contour indécis et d'une harmonie prétentieuse. » Quand on songe que l'air du dragon d'Alcala est précisément le seul que Bizet ait écrit sans accompagnement, on est forcé de convenir que l'excellent homme n'avait pas de chance dans ses observations harmoniques !
Plus prudents, quelques-uns de ses collègues restaient dans le domaine confortable des idées générales et se contentaient d'agiter le spectre wagnérien. Dans le Charivari, l'insupportable Pierre Véron écrasait un pleur au coin de sa paupière et s'écriait noblement : « Nous éprouvons du regret à voir un compositeur si prématurément doué se fourvoyer à la remorque du wagnérisme atrophiant ». Dans le Siècle, l'ineffable Oscar Comettant mettait de l'orgueil à renchérir : « Le cœur de M. Bizet, blasé par l'école de la dissonance et de la recherche, a besoin de se refaire une virginité... Cet opéra n'est ni scénique ni dramatique... Ce n'est pas avec des détails d'orchestre, des finesses instrumentales qu'on peut exprimer musicalement les fureurs et les caprices de Mlle Carmen... Nourri des succulences enharmoniques (sic) des chercheurs de la musique de l'avenir, Bizet s'est échauffé l'âme à ce régime qui tue le cœur ! »
Quelques auditeurs, plus avertis, trouvèrent dans Carmen de plus valables motifs d'affliction. Weber reprocha une fois encore au compositeur son « parti pris de satisfaire le goût du public » et Adolphe Jullien écrivit quelques lignes pénétrantes qu'il convient de citer intégralement :
« Le dernier acte de cette comédie qui se joue entre M. Bizet et la critique vient de se jouer à propos de Carmen et cette conclusion inattendue peut tourner tout à l'avantage de M. Bizet, s'il en veut bien étudier la cause, s'il reconnaît que lui-même n'a fait que déprécier et rabaisser en pure perte son talent, sans rencontrer, je ne dirai pas un succès plus franc, mais même une approbation plus sincère.
« Le musicien s'est naïvement figuré qu'il lui suffirait d'atténuer ses préférences, de répudier ses juvéniles audaces, si humbles et si modestes, de se rallier franchement au genre de l'opéra-comique, dont il avait cru pouvoir étendre ou varier les formes consacrées selon les exigences de ses livrets ; d'écrire enfin force couplets guillerets et refrains faciles à retenir, pour conquérir ces éloges si précieux que la plupart des critiques lui refusaient obstinément.
« Ils lui commandaient de s'amender et de rejeter ses propres idées pour adopter les leurs ; il jugea qu'il avait assez longtemps résisté et se courba humblement sous cet ordre formel.
« Qu'arrive-t-il ? C'est que ses juges sont fiers d'avoir aussi facilement humilié ce superbe, et, la faiblesse momentanée du justiciable doublant leur assurance, ils le traitent encore plus durement pour ses erreurs passées, sans lui savoir gré de les avoir répudiées.
« Leur siège est fait d'avance, et M. Bizet ferait jouer demain, sous son nom, tel opéra oublié de Grétry ou de Philidor qu'il se trouverait encore des gens délicats pour le juger convaincu de wagnérisme, aussi justement que par le passé, et pour le vouer à une réprobation universelle.
« Qu'a-t-il servi à M. Bizet de se plier au goût de personnes dont il doit se rire par derrière et railler les façons de voir en musique, si différentes des siennes, de celles du moins qu'il s'est laissé gracieusement attribuer ? La presse lui marque encore moins de faveur, et le public moins d'empressement. Le seul résultat de cette regrettable évolution sera de retirer au compositeur l'approbation et l'appui des rares personnes, amateurs ou critiques, qui, sans le porter droit aux nues, auraient au moins aimé à rendre justice à ses tentatives sérieuses, à la justesse de ses vues artistiques, et auguraient bien de cette sévérité du musicien vis-à-vis de lui-même. Du reste, cet opéra-comique n'est qu'une longue suite de compromis aussi bien dans le poème que dans la musique ».
Il n'y a rien à ajouter à une pareille analyse. Elle résume très complètement le caractère assez spécial de la gloire posthume de Bizet, tout en dévoilant la véritable cause de ses échecs primitifs.
La carrière de ce compositeur sans ancêtres et sans postérité restera exceptionnelle dans l'histoire de la musique. Commencée au milieu d'une hostilité injustifiable, continuée par une apothéose prématurée, elle semble devoir s'achever dans une indifférence excessive. L'opportunisme est une attitude qu'un artiste ne saurait conserver longtemps sans dommages. Bizet en a fait la cruelle expérience depuis quelques années. Le coup le plus cruel a été porté à sa mémoire par la publication récente de ses lettres d'adolescent qui nous révèlent, très indiscrètement, une âme assez banale et une assez médiocre sensibilité. Ce fut un véritable sacrilège, consommé, d'ailleurs, avec la meilleure foi du monde et la plus sincère pitié.
Il reste à Bizet, hors de nos frontières, le rôle honorable et représentatif de commis-voyageur de l'esprit musical français. Carmen et l'Arlésienne sont, à l'étranger, les « articles de Paris » par excellence et leur succès s'annonce encore durable. Il faudra de longues années pour organiser l'exportation de nos plus récents produits artistiques : le culte des nouveautés revêt toujours, à distance, un caractère rétrospectif. Berlin et Pétersbourg peuvent, sans déshonneur, porter des modes musicales un peu marquées.
Et puis, ces modes sont trop caractéristiques pour être méprisables. On ne comprendrait pas toute l'âme française sans elles. Elles sont documentaires. L'âme d'une race ne se révèle jamais tout entière et en une seule fois : il faut rapprocher, au cours de l'histoire de son art, les différentes faces de son génie. Un critique, réactionnaire d'instinct, notait récemment ce phénomène, afin d'en tirer une justification de ses tendresses pour tels auteurs périmés. En présence des exploits de l'école moderne, M. Romain Rolland (*) proclamait que les maîtres de l'heure ne représentent pas complètement notre génie national, et regrettait de ne pas rencontrer dans leurs œuvres les aspirations héroïques, le rire vainqueur, la ruée vers la lumière, ces forces tumultueuses dont peut s'enorgueillir la France de Rabelais, de Molière, de Diderot, de Berlioz et de Bizet. C'est la vérité même ; oui, deux Frances coexistent et c'est leur équilibre qui fait le génie français. Nous ne pouvons que nous associer — en réservant nos préférences — à ces conclusions : « Dans notre musique contemporaine, Pelléas et Mélisande est à l'un des pôles de notre art, Carmen à l'autre pôle. Celle-ci, tout en dehors, toute lumière, toute vie, sans ombre, sans dessous ; l'autre, tout intérieure, toute baignée de crépuscule, tout enveloppée de silence. C'est ce double idéal, ce sont ces alternatives de soleil fin et de brume légère qui fout le doux ciel lumineux et voilé d’Ile-de-France ! »
(*) Romain Rolland. Musiciens d'aujourd'hui.

Carmen aux Arènes de Nîmes, en 1901 (acte IV)
LISTE DES ŒUVRES (*)
(*) Mon ami Henri de Curzon a bien voulu se charger de rédiger ce catalogue des œuvres de Bizet et la bibliographie qui le suit. C'est un travail qui lui est plus familier qu'à moi, et dont je le remercie.
I. — ŒUVRES LYRIQUES
DAVID (Mlle de Montréal) cantate, 1856 (2e prix
de Rome ; inédit).
LE DOCTEUR MIRACLE (Battu et Halévy) 1 acte, 1857 (Bouffes-Parisiens).
CLOVIS ET CLOTILDE (Burion) cantate, 1857 (Prix de Rome ; inédit).
DON PROCOPIO (livret italien) 2 actes, 1859 (1er envoi de Rome ; représenté pour
la première fois à Monte-Carlo, en 1906, adaptation de Ch. Malherbe).
VASCO DE GAMA, ode symphonique, 1860 (2e envoi de Rome).
LA GUZLA DE L'EMIR (M. Carré) 1 acte, 1862 (4e envoi de Rome ; inédit).
LES PÊCHEURS DE PERLES (M. Carré et Cormon) 3 actes, 1863 (Théâtre-Lyrique).
MALBROUGH S'EN VA-T-EN GUERRE (Siraudin et
Busnach) 4 actes, 1867 (Athénée ; 1er acte seul, les autres par Legouix, Jonas,
Delibes).
LA JOLIE FILLE DE PERTH (Saint-Georges et Adenis) 4 actes, 1867 (Théâtre-Lyrique).
[IVAN -LE-TERRIBLE ; CALENDAL ; LE FLORENTIN ; LA COUPE DU ROI DE THULÉ ; CLARISSE HARLOWE ; GRISÉLIDIS ; LES TEMPLIERS, 1868-1871 (inachevés et inédits)].
NOÉ, opéra biblique, 1869 (instrumentation des 3
premiers actes de Halévy, et 4e acte. Première représentation à Carlsruhe, en
1885).
DJAMILEH (L. Gallet) 1 acte, 1872 (Opéra-Comique).
L'ARLÉSIENNE, musique de scène pour le drame d'Alphonse Daudet, 1872 (Vaudeville).
[LE CID (L. Gallet) 5 actes, 1873 (inédit)].
CARMEN (Meilhac et Halévy) 4 actes, 1875 (Opéra-Comique).
[SAINTE-GENEVIÈVE DE PARIS (L. Gallet) oratorio, 1875 (inachevé et inédit)].
Feuilles d'Album (6 mélodies : Heugel). — Vingt mélodies (Recueil factice t. I : Choudens). — Seize mélodies (Recueil, t. II). — Duos (Quatre : Choudens). — Saint-Jean de Pathmos (Chœur d'orphéon : Choudens).
Agnus Dei ; — Ave Maria ; — Regina cœli ; — L'Esprit-Saint (Motets et hymnes : Choudens).
Il. — ŒUVRES INSTRUMENTALES
a. Orchestre.
Scherzo et andante, 1861 (3e envoi de Rome).
Souvenirs de Rome,
fantaisie symphonique, 1869 (Roma).
L'Arlésienne, 2 suites, réorchestrées, 1872.
Petite suite d'orchestre (arrangement de cinq des Jeux d'enfants), 1873.
Patrie, ouverture, 1874.
b. Piano.
Les Chants du Rhin, six lieder . — La Chasse fantastique (Heugel). Jeux d'enfants, 12 pièces pour piano 4 mains (Durand). Variations chromatiques de concert. — Danse bohémienne. — Venise. — Cinq chansons-mélodies. — Nocturne. — Romance sans paroles (Choudens).
c. Transcriptions pour piano à deux et quatre mains.
6 transcriptions sur Mignon. — 6 transcriptions sur Don Juan. — 9 transcriptions sur Hamlet (Heugel).
Le Pianiste-chanteur,
6 séries (150 morceaux de toutes les écoles).
Transcriptions d'œuvres religieuses de Roques (120 morceaux, 30 cantiques).
12 transcriptions simplifiées de l'Art du chant de Thalberg.
Transcriptions et réductions de partitions diverses de Grétry, Mozart, Rossini, Gounod, Thomas, Saint-Saëns, Massenet et de nombre de ses propres œuvres.
BIBLIOGRAPHIE
G. BIZET. — Lettres : Impressions de Rome ; 1857-1860 : La Commune, 1871. Publiées par L. Ganderax, 1 vol., 1908 (Revue de Paris, 1907-1908)
G. BIZET. — Lettres à un ami : 1865-1872. Publiées par E. Galabert, 1 vol., 1909.
G. BIZET. — Lettres à Paul Lacombe et à E. Guiraud, 1866-1874. Publiées par Hugues Imbert : Portraits et Études (p. 132-213), 1 vol., 1894.
E. REYER. — Quarante ans de musique (articles de 1868 à 1875), 1 vol., 1910 (p. 270-300).
AD. JULIEN. — Musiciens d'aujourd'hui (articles de 1872 à 1890), 1 vol., 1892 (p. 332-370).
E. GALABERT. — Georges Bizet : Souvenirs et correspondance, 1 vol. 1877.
MARMONTEL. — Symphonistes et virtuoses, 1 vol., 1881.
CH. PIGOT. — Georges Bizet et son œuvre, 1 vol., 1886.
C. BELLAIGUE. — Georges Bizet, sa vie et son œuvre, 1 vol., 1889 (Revue des Deux Mondes, 1889).
L. GALLET. — Notes d'un librettiste (Lettres inédites de Bizet), 1 vol., 1891.
H. IMBEBT. — Médaillons contemporains, 1
vol., 1903 (p. 27-54).
Musica (numéro consacré à Bizet), février 1905.
H. MARÉCHAL. — Paris. Souvenirs d'un Musicien, 1 vol., 1907 (p. 221-239).
A. WEISSMANN. — Georges Bizet (Collection die Musik, t. XX), Berlin, 1 vol.
TABLE DES MATIÈRES
III. L’ŒUVRE. De Don Procopio aux Pêcheurs de perles
IV. L’ŒUVRE. La Jolie fille de Perth, Djamileh
V. L’ŒUVRE. L’Arlésienne, Carmen
LISTE DES ŒUVRES. BIBLIOGRAPHIE